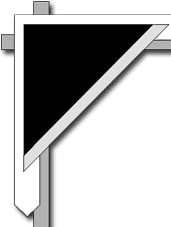
|

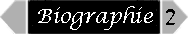
IL JOUAIT DU PIANO DEBOUT
La vie est d’une densité extraordinaire, ce qui ne rend pas facile sa réédition sous forme écrite. Après mon retour à Mulhouse ma vie se complique rapidement. Pour ma famille, c’est à dire ma mère, je suis sensé préparer mon baccalauréat dans les meilleurs conditions qu’elle m’a offertes. Pour ma part, je me sens comme revenu à la case départ, celle qui aboutit cinq ans plus tôt à mon aventure grecque. La seule différence est que Jean est présent, il vit sous mon toit et je fais connaissance d’une nouvelle martingale de « copains », excroissance mulhousienne de la branche Théo Frey. En fait deux personnages qui joueront tous les deux le rôle que le même Théo leur laissera dans la fête permanente qu’il organise à Strasbourg. Ils s’appellent Fischer et Gerber, mais ces deux néo-Mulot se voient rapidement infligés des sobriquets d’origine conjoncturelle qu’au demeurant j’ignore. Fischer restera plus connu sous le surnom de « cabillaud » ou parfois « fischderch » (Fischer signifie en Allemand pêcheur, l’origine semble donc assez logique quoique faible) quant à René Gerber, il deviendra rapidement Dolphi, rapport direct au saxophoniste génial Eric Dolphi dont il défendait les couleurs envers et contre toute critique. Les deux compères travaillent ensemble dans une grande surface appelée à devenir la FNAC quelques années plus tard. Théo Frey fera pour les mois qui viennent la liaison entre les situs de Strasbourg et notre petit groupe partiellement reconstitué, car Richard est venu s’ajouter au cercle des artistes maudits. Jean-Louis Charvot est également de retour en Alsace, mon plus ancien camarade de classe m’avait réservé une surprise de taille lors de mon passage à Bâle quelques mois plus tôt. Récit.
L’épisode se passe lors de mon retour d’Algérie vers la fin Avril 1965. A cette date je suis encore interdit de séjour en France (autrement qu’à mes risques et périls) et je décide de séjourner quelques temps à Bâle où je pourrai rencontrer tous mes amis qui ne sont pas loin, Mulhouse et Strasbourg. Ils viendront tous, sauf Jean et Richard qui finissent l’année scolaire à Saïda. D’entre eux tous, il n’y aura donc que Jean-Louis qui peut figurer parmi les « compagnons » d’origine, car même Théo n’était qu’un courtisan de notre groupe dans les années cinquante et il s’était infiltré dans le Saint des Saints en mon absence, quoique l’affaire de Genève (le sauvetage nocturne), ainsi que sa connaissance de Marx, me l’ait rendu plus que sympathique. Pour la compréhension de la suite, il est utile de signaler ici que ce personnage a quelque chose du caméléon, fort habile à adapter son comport – j’emprunte ce mot à Heidegger car il est plus fort que comportement et dit quelque chose de tout différent, un comport est plus global qu’un simple comportement, il englobe le spirituel et le matériel – dans les différentes situations et dans sa position dans celles-ci.
IL vient de raccrocher le téléphone avec un sentiment de profond dégoût. Cette fois ILl ne tentera plus jamais de reprendre contact avec Théo. Egalement retraité, ce dernier s’est retranché dans son immense ferme-domaine dans les Vosges qu’il partage avec sa sœur Edith et son beauf, terme que Théo lui a infligé lui-même, sa jalousie avait quelque chose d’incestueux au point qu’il intervient un jour pour détruire dans l’œuf une relation amoureuse entre elle et LUI. Ces derniers temps IL avait tenté plusieurs fois de le joindre, car le numéro de téléphone de cette ferme n’avait jamais changé. La première fois Nelly, sa compagne, LUI avait affirmé que Théo était absent pour un court séjour à Paris. Quelques temps plus tard, il lui vint l’idée de tenter d’appeler Edith elle-même, dont le numéro de téléphone traînait également dans son agenda, mais avec peu de chance d’être encore valable. Or il l’était. Edith et son mari Jean Garnaud, vivaient toujours à Aix en Provence où ils avaient tous les deux fait une carrière d’enseignant parfaitement banale et ils étaient désormais de gentils retraités de l’Education Nationale. IL eut donc la surprise d’entendre la voix d’Edith qui lui confirma la présence de Théo à Paris. Quelques semaines plus tard, IL fit une nouvelle tentative. Surprise, toute la famille était là-haut dans la forteresse qu’IL avait osé un jour baptiser Berchtesgaden, eût égard à la position en nid d’aigle de la ferme de Théo et surtout de la puissance financière que ce garçon, qui s’affichait d’un communisme absolu, éloignait soigneusement de la vue de ses amis. Mais LUI savait depuis longtemps que Théo était secrètement riche, des héritages en cascade l’avait depuis longtemps mis à l’abri de lendemains difficiles, ce qui lui permettait, entre-autre, de soigner une collectionnite enragée et anarchique. Théo collectionnait tout, depuis ses robots en fer blanc jusqu’à des murs entiers de masques de carnaval, sans parler des choses en papier comme des revues de Science-Fiction et d’anciens textes pré-situationnistes dont il se flatte de posséder toute la production. Retour au récit : IL appelle donc et c’est Edith qui décroche : Théo est malade, très malade, d’ailleurs tout le monde est malade, une pandémie grippale s’est abattue sur la ferme et personne n’est disponible. IL raccroche écœuré, la comédie a assez duré. Comme IL est en train d’écrire son autobiographie, IL prend conscience de ce que, au fil du récit, il va devoir révéler à propos de ce Théo, traité de menteur par Debord non sans pertinence même si cette accusation en son temps n’avait qu’une valeur purement tactique. C’est l’épisode de l’exclusion des « Garnautins » où des « menteurs de Strasbourg », bref c’était, avant Mai68, la fin des ambitions révolutionnaires de Théo, un fin qui en sera une véritable, car après avoir tenté pendant quelques semaines de contre-attaquer, notamment par un texte qui a sa célébrité indirecte et qui s’intitule « L’Unique et sa Propriété » en souvenir de la thèse de Stirner, il se met à stagner dans une vie d’enseignant mélomane et de collectionneur vaguement spéculateur, le communiste Théo avait peur de l’argent, du manque d’argent, ce qui fait de lui un simple avare, défaut qui LUI vaudra un jour un camouflet qu’IL ne saurait oublier, même s’IL LUI est étranger d’ arrêter son jugement sur qui que ce soit à propos d’un tel incident, sur une telle révélation. L’avarice est une maladie de l’âme, et IL ne saurait s’en prendre à un malade. IL est cependant conscient que la lecture de ce texte ne manquera pas d’alimenter la haine que LUI porte Théo en secret depuis des décennies. La seule chose étonnante est que ce pantin de Debord n’a jamais osé agresser directement l’auteur de ces lignes. De même il préfère se réfugier derrière un mensonge aussi grossier qu’une grippe pour LUI infliger une humiliation inutilement cruelle. SON principal défaut est son impuissance à haïr, l’aurait-IL déjà écrit ? Cela ne l’étonnerait nullement tellement IL est obsédé par cette tournure de son âme. Ce texte ressemble cependant fichtrement à une vengeance, et ce n’est pas fini, pense-t-IL en achevant ce paragraphe. Le grand malheur de toute biographie est qu’elle contraint l’auteur, tôt ou tard, à exhiber des sentiments pas forcément vécus, mais qui découlent de la logique d’événements que l’auteur ne peut pas changer.
Cette longue parenthèse risque de dérouter le lecteur. A Bâle il était question de Jean-Louis Charvot, ami de la petite enfance de l’auteur, amitié égratignée par la « trahison » de Paris mais, comme je l’avais précisé, sans conséquence directe : j’avais décidé de tirer un trait sans même m’y arrêter. C’est une question de primauté de l’amitié sur des logiques qui nous échappaient largement dans les conditions dans lesquelles nous vivions. Le jugement que j’aurais dû porter sur Jean-Louis, je l’ai réservé à sa mère, puissance tutélaire dont je n’avais pas encore découvert toute les réserves de maîtrise sur un enfant assez mou et faible mais que nous prenions comme tel, chacun étant ce qu’il est et qu’il faut savoir prendre ainsi. Or dans le bistrot où nous nous rencontrons, une énorme surprise m’attend. Ou plutôt deux surprises : Jean-Louis est accompagnée par une femme, petit bout de rouquine sans relief, l’œil cependant si aiguisé qu’il aurait coupé n’importe quoi, et en l’occurrence le à découper c’était moi. Difficile de m’étendre sur cette pénible entrevue à laquelle je ne compris sur le champ pas grand chose sinon qu’il venait mettre fin à notre amitié au nom de son mariage avec cette chose dont j’ai oublié jusqu’au nom et au surnom que nos amis lui avaient déjà décernés. Jean-Louis me sert un galimatias auquel je reste imperméable en évoquant une trahison dont je n’entends rien d’autre que le fait qu’il se décharge sur moi-même de sa propre culpabilité. Je rappelle ici que cet ami d’enfance m’avait mis à la rue sur les ordres de sa mère alors que je me trouvais à Paris, déserteur, sans un sou et sur le point de me retrouver sous les ponts en attendant que la police fasse son devoir. Cette expulsion survint de surcroît sans préavis, du jour au lendemain, de la minute à l’autre, ce qui m’interdisait le moindre délai pour trouver une solution. Souvenez-vous du miracle de Mouna sur le quai du métro de la Porte d’Orléans et ce qui s’en suivit.
Je reste stupéfait plutôt que scandalisé, et la haine que je lis dans les yeux de la femme, car elle est déjà sa femme légale, me fait comprendre l’essentiel : Jean-Louis a reçu l’ordre de couper les ponts avec le pire de tous. Car à Strasbourg il continue de fréquenter le groupe déjà dénommé les « Situs » qui semble, à ma grande surprise d’une bénignité étonnante à son endroit. C’est quand j’aurais appris le rôle pratique et financier qu’il joue dans le jeu de Théo que la lumière se fera lentement dans mon esprit naïf et surtout préoccupé par bien d’autres sujets que les relations de palier entre vieilles connaissances de Mulhouse. Ils sont voisins dans un immeuble cossu de la Place du Corbeau, et se rendent de mutuels services parmi lesquels les échanges de disques en vinyle et jazzistiques demeurent au premier rang. Il faut noter ici qu’entre-temps, c’est à dire entre mon départ en exil et mon retour, Théo était devenu un amateur de jazz, et en particulier de free-jazz, ce qui valait à une époque carte d’entrée dans le cercle restreint des Zaz mulhousiens. D’un certain point de vue, point de vue que je découvre aujourd’hui, Théo m’avait subtilisé mon ami, comme il tentera à plusieurs reprises de me subtiliser mes amies et même mon épouse. J’imagine donc, aujourd’hui seulement, le travail de taupe auquel il a dû se livrer pour obtenir un tel changement dans le comportement et les sentiments apparents de Jean-Louis à mon égard. Par la suite j’aurai encore de multiples occasions de pouvoir analyser cette sorte de manie qui s’installait dans le groupe de Strasbourg et qui consistait à modifier sans cesse les alliances affectives et qui donnaient lieu à un véritable commérage permanent dont on ne connaissait jamais les véritables sources et la portée réelle. Car ces querelles incessantes ne portaient jamais à conséquence et les réconciliations modifiait le paysage aussi rapidement que les ruptures. Pour la plupart des membres de ce groupe, il s’agissait d’un sport extrêmement pénible dans lequel il s’agissait de ne pas se tromper au risque de subir, pour un temps, le même sort que le ou les ostracisés du moment. Je pense à présent que cette praxis d’une trivialité honteuse devait se calquer, mal, sur ce qui se passait autour de Debord à Paris, sans toutefois porter aux mêmes conséquences que celles qui émanaient de la radicalité sans pitié de Guy Ernest. Mais nous y reviendrons sans doute, notamment à propos des incidents de Mai68 au cours desquels Théo et quelques uns de ces amis du moment se sont parfaitement ridiculisés en dépit de leurs convictions le plus clairement exprimées dans les rares textes qu’ils rédigeaient en ce temps-là.
Jean-Louis, sa femme et moi en restons là et nous nous quittons sans autres rebondissement. En mon for intérieur l’étonnement surpasse largement la déception, et je ne peux croire un instant à la sincérité de mon ami d’enfance. Connaissant parfaitement son indécrottable mollesse, je n’attribue que peu d’importance à cet incident, comprenant instinctivement la structure diabolique dans laquelle il se débat entre sa mère qui me porte une haine sans limite, et cette femme – dont j’apprendrai par la suite qu’elle lui fut pour ainsi dire imposée par sa mère ! – qui n’a apparemment qu’un but : le soustraire à mon influence et détruire tous les obstacles qui se dresseraient devant son projet de construction d’une famille aussi normale que possible. Quelle rigolade, en réalité, si l’on songe à ce que nous pensions et manifestions depuis des années aux dépens de ce genre de choix d’existence. C’est, plus sérieusement , la raison qui m’instilla les premiers soupçons à l’égard de l’honnêteté intellectuelle de Théo Frey, qui faisait visiblement tout pour limiter la moquerie générale dont Jean-Louis était inévitablement la cible, moquerie dont je fus sans doute le seul à m’abstenir pour des raisons éthiques qui n’ont jamais varié dans mon âme. Je peux affirmer que Jean-Louis me faisait même pitié, pris qu’il était dans le piège d’un attachement au groupe qu’il avait le privilège de fréquenter et la fureur d’une créature, sa femme, dont l’hystérie était devenu un autre objet de réjouissances sadiques de la part des « amis » de bistrot et aussi de théorie. Malheureusement, Jean-Louis ne comprenait strictement rien aux textes de Debord et encore moins à son contexte culturel et historique, ignorance qui acheva, quelques mois plus tard de m’en faire un ennemi dont je ne pouvais, au mieux, que faire semblant d’ignorer la réalité. Cette inimitié devait durer plusieurs décennies, et ce ne sera que vers 1995 qu’au détour d’un bistrot je le rencontre à nouveau, sortant très abîmé d’un cancer du larynx et réduit à un orphelinat que je qualifierais d’ontologique tant il était total.
Le récit de cette rencontre à Bâle nous a quelque peu déplacé dans le temps, et nous allons donc revenir quelques mois plus tard, après mon retour à Mulhouse où s’organisa, ou plutôt se désorganisa rapidement une existence planifiée par maman et détruite aussitôt par la même maman. Car elle apprit rapidement, par le biais de notre ancienne bonne qui était payée pour veiller sur l’appartement de la rue de la Paix. Après le retour de Jean (sans foyer), je décidai d’occuper la chambre de ma mère, en prenant toutes les précautions pour ne pas laisser de traces de cette trahison des engagements pris envers ma mère. La réplique ne tarda pas, et nous fûmes, Jean et moi, jetés à la rue comme des animaux, sans autres scrupules, comme une vengeance des années dites d’angoisse que j’aurais fait passer à l’auteur de mes jours. Nous reviendrons aussi sur ce mensonge ou disons sur cette plainte dont ma mère avait saturé toute la famille. Les quelques mois, peut-être deux ou trois, que nous passons à Riedisheim dans le confort et la tranquillité, nous avions passé l’âge de passer nos nuits à faire des frasques coûteuses pour la bourse et le matériel, sont pourtant marqués par un incident à la fois grotesque et pour moi dramatique. Si, en effet, nous vivions « rangés des voitures », mais au fait nous n’avions guère vécu autrement, sauf peut-être lors de nos quinze ans, il arrivait que nos nouveaux « amis », Fischderch et Dolphi, nous entraînent, abondance d’argent et voiture à l’appui, dans des sortes de dérives qui nous rappelaient vaguement un passé où il nous arrivait d’aller jouer de la trompette à minuit au bord du lac Noir ou du Lac Blanc, deux joyaux des Vosges encore relativement épargnés par le tourisme de masse.
Un jour donc, les deux lascars me proposent, Jean était à Strasbourg, une virée dans les Vosges, en souvenir des mythes dont ils ont été abondamment abreuvés en mon absence. Fischer possédait une 203 et une petite amie d’à peine quinze ans qu’il traînait avec lui jour et nuit. Nous visons le vignoble, et l’idée idiote me vient de monter dans mon ancien bagne d’été, savoir la colonie de vacance que possède le Collège Episcopal de Zillisheim et où m’envoyait maman chaque été de mon enfance. C’était devenu un cauchemar tout à fait conforme à la célèbre chanson qui traite le sujet. En fait cette visite était une affaire intime, mes trois compagnons n’ayant rien en commun avec le thème ou le lieu.
Mais chaque action, à cette époque, devait être en quelque sorte baptisée, c’est à dire précédée d’une forte absorption d’alcools de toutes sortes. Dolphi est déjà alcoolique, Fischer en mourra sans doute, car il est atteint d’un diabète incurable, ce qui ne l’empêche nullement de s’adonner à la dive bouteille ou aux mètres de demi de bière. Quant à moi, je suis dans une période « mouillée » qui vient d'alterner avec une période sèche. J'avais pris l'habitude d'alterner de deux ans en deux ans des périodes alcoolisées et des périodes sans. C’est donc déjà complètement saouls que nous arrivons à la colline de Montjoie, un très joli site en contre-bas du Lac Blanc, en fait une simple colline au sommet de laquelle on avait installé des bâtiments propres à recevoir, l’été venu, une bonne centaine de jeunes colons. A l’heure qu’il est le paysage est totalement bouleversé par l’installation inlassable depuis une dizaine d’années de remonte-pentes dont les pistes sont alimentés par des canons à neige deux années sur trois depuis que nos hivers ont cessé d’être ce qu’ils étaient. La glisse est une éthique de vie, ou bien disons plutôt qu’elle appartient à ce qui pousse à évacuer tout souci éthique de l’existence. Imaginez ce que signifie en investissements et en sacrifices de sites naturels, l’entreprise qui consiste à permettre à des milliers d’individus de se hisser dans les hauteurs de ces vieilles montagnes qui n’en peuvent déjà plus depuis longtemps tant elles ont servi à tout, la guerre, l'exploitation du bois, le pire de tout à savoir le tourisme. J'ai fait récemment un tour dans ce secteur, m'enfuyant à peine aperçu les parkings bourrés de véhicules immatriculés touristes. Bref, nous grimpons.
Jusqu'à présent je n'ai pas ressenti de franc malaise dans l'évocation de mon passé. Pas de péché grave, du moins pas de ceux dont le souvenir vous fait monter le rouge aux pommettes, plutôt une sorte de coup de poing dans le ventre, quelque chose qui a à voir avec le souffle. Bref, me voici face à ce phénomène pour des raisons qui ne sont pas claires dans ma conscience, et c'est sans doute ce manque de clarté qui provoque ce malaise depuis longtemps balayé. Mais ceux qui manient le balais savent qu'il reste toujours un brin de poussière ou un bout de papier gras qui sont passés à travers les brins de paille ou de plastique du l'outil de nettoyage. Il doit donc se cacher quelque part une saleté qui a échappé au balai de ma mémoire, mais lequel ? Ca peut aller très loin et vous allez voir pourquoi.
Arrivé à la colonie que je retrouve miraculeusement telle quelle, telle que je l'avais vue pour la dernière fois quelque quinze ans plus tôt, une bâtisse à un seul étage, comme plaquée sur le sommet de la colline, le tout surmonté d'un crucifix d'une dizaine de mètres de haut, souvenir des cérémonies au drapeau suivies de prières sans fin, condensé de notre haine commune pour tout l'aspect collectif, moutonnier de nos activités, genre pas un jour qui ne commence sans le lever au drapeau, genre actuellement très à la mode dans les sectes américaines d'évangélistes ou de fondus de la vie militaire, porte de secours bien imaginée pour tous les angoissés de l'existence. Nous visitons les bâtiments, ouverts à tous les vents et je retrouve le grand réfectoire, donnant directement sur les chambrées où se terminaient nos journées de « vacance » de jeunes bourgeois catholiques, le camp était la propriété du Collège où mon frère préparait le grand séminaire qu'il aura un mal fou à éviter dans des conditions dramatiques pour ma bigote de mère. Tout avait été comme préparé par Dieu lui-même, l'un des meilleurs amis de Christian, ce frère que j'évoque ici, n'étant autre que le neveu de Mgr Weber, l'archevêque qui devrait, à l'heure qu'il est, être au moins béatifié, tant il avait su gérer son diocèse avec toutes les qualités que l'imaginaire du peuple attribuaient alors à ces porteurs de bagues de saphir ou de Lapiz-Lazuli. Et il y avait quelque chose de vrai dans les qualités de cet homme, qualités qui surgirent lorsqu'on eût affaire à la personnalité de son successeur, adversaire acharné du Concile que préparait Jean XXIII et de toutes les libertés dont le bon pape laissa alors la porte ouverte sans avoir le temps d'y faire entrer ce qu'il désirait de tout son cœur, à savoir, entre-autre, la fin du célibat des prêtres. Ce Jean-là est mort trop vite, mais ce qu'il avait réussi à faire en à peine quatre années d'intense travail mondial, l'autre Jean, le Jean-Paul II, mit quand-même trois décennies à l'anéantir ou presque. Je m'égare, tout ça pour tenter d'expliquer mon comportement d'égarement qui me saisit à la vue anamnétique de ce lieu de mon enfance. La petite chapelle attenante au réfectoire n'avait pas changé et je trouvai tout d'un coup ce ciboire, curieusement posé sur l'autel, comme une provocation. Je vis rouge, comme on dit, et la moindre des actions qui me semblait nécessaire était de renverser ce calice qui représentait si bien celui que j'avais bu pendant tant d'années d'enfance sacrifiées à une anti-culture de bénitier sans cesse démentie en son essence par la lubricité patente des adultes qui nous séquestraient.
Je pensais qu'il fallait achever le travail en renversant la grande croix qui jouxtait la chapelle et annonçait orgueilleusement les couleurs catholiques-chrétiennes de ce lieu que la nature avait fait pur et neutre de toutes ces sottises idéologiques.
Hélas, mes compagnons ne l'entendaient pas de cette oreille, et leurs préoccupations n'avaient rien de spirituel. A travers le rideau de leur ivresse grossière, ils ne songeaient qu'à ce qui distingue réellement le barbare de l'homme civilisé, à savoir le pillage des utilités. Habitués qu'ils étaient de voler sur les lieux mêmes de leur travail le bien de la collectivité en toute bonne conscience – le marxisme a servi à masquer bien des vices sous les arguments de la lutte de classe – mes nouveaux « amis » se mirent à chercher le trésor, le ciboire de la chapelle s'étant avéré n'être qu'un bout de cuivre bien ciré ! En l'absence de ce dernier et furieux de ne rien trouver qui satisfassent leur cupidité, ils se rabattirent sur les utilités les plus triviales, et tout d'un coup je les vis, les mains chargés de couverts dérobés dans les cuisines, prêts à prendre la fuite. Par bonheur pour mon honneur, je haussai brutalement le ton, en leur reprochant leur médiocrité et en leur intimant l'ordre de remettre à sa place ce butin ridicule. Par bonheur, car au même moment apparurent deux personnages non attendus qui avaient tout entendu et dont le témoignage me dégagera, plus tard, de l'attendu le plus infamant du procès en simple police qui nous attendait. Car les personnes qui venaient de nous surprendre n'étaient autre que les gérants de la colonie, dont un prêtre en soutane, qui revenaient d'une tournée d'inspection, ce qui expliquait aussi le fait que la maison était restée ouverte à tous les vents. Sans perdre mon sang froid, j'expliquai en deux mots le motif de notre visite, en résumé la chanson de Pierre Perret. Mais le sort que j'avais réservé à la grande croix ne leur avait pas échappé, et face à leur menace de poursuite judiciaire, mes compagnons se mirent à dévaler la colline persuadés qu'ils avaient encore une chance de fuir à bord de notre véhicule parqué assez loin au pied de la colline. A part moi j'étais persuadé que ceux qui nous avaient surpris en plein pillage de fourchettes et de couteaux de cuisine avaient relevé le numéro minéralogique de la 203 de Cabillaud et que nous n'échapperions pas aux poursuites annoncées. Ce qui fut le cas dans les pires conditions que l'on puisse imaginer. Car loin d'être achevée, la journée se poursuivi de restaurants en bistrots et de bouteilles de framboise à 50° d'alcool en bouteilles de vins fins, l'argent semblant ne pas manquer ce jour-là. Je rentrai ce jour-là dans l'état que l'on nomme très justement l'état de « delirium tremens », tentant d'oublier dans l'alcool cette sinistre et médiocre aventure qui devait encore se doubler d'une trahison humiliante pour moi.
Car lors des premiers échanges censés que nous pûmes faire après une fuite grotesque dans les lacets de routes vosgiennes, il avait été décidé tout naturellement que l'on tairait mon identité, quelle que soit les conditions qu'on infligerait à mes « amis », et ce en raison de ma situation délicate par rapport à l'armée. Le lendemain matin, la Gendarmerie était à ma porte, et je fus entraîné au dépôt dans un état comateux, la nuit avait été terrifiante, une sorte de paralysie m'avait gagné et un moment j'ai craint pour ma vie, mon corps semblant devenu de bois et mon visage d'une couleur verte qui épouvanta ma petite amie qui avait vaquée, heureusement pour elle, à son travail de shampouineuse pendant toute cette maudite journée. Quelqu'un m'avait donc trahi, et mes deux compagnons adultes ne manquèrent pas de charger la petite adolescente qui les accompagnait et que je voyais ce jour-là pour la première fois de ma vie, du crime de cette trahison. Or par malheur pour eux ils ignoraient que je savais que cette jeune fille ignorait tout de moi, Nom, adresse et qualité, et ne pouvait donc pas être à l'origine de la trahison. Mais, avant de conclure, rions quand-même un peu aux frais de la maréchaussée.
Beaucoup de procédures policières ou gendarmesques sont parfaitement ridicules du point de vue de l'efficacité. Ainsi en va-t-il en cas de désertion, où la gendarmerie de la zone de domicile du fugueur est tenue de vérifier chaque jour si ce dernier ne serait pas soudain présent à son dernier domicile connu. Dans mon cas, le pensum a dû être pénible pour le régiment responsable de la zone mulhousienne, puisqu'ils durent se rendre pendant plus de quatre ans et demi tous les jours vérifier si par hasard je n'étais pas rentré chez moi !! Inutile de vous peindre la fureur que cette corvée quotidienne a provoqué chez les pandores mulhousiens, l'un d'entre-deux, dont l'épouse entretenait l'appartement de ma mère, a failli s'étrangler de rage le jour où j'ai dû me rendre chez lui pour rendre les clés de l'appartement d'où ma mère venait de m'expulser. Or, le jour de mon arrestation, le quartier-général s'apprêtait à fêter ma capture et à me préparer une fête dont je me souviendrai sans doute longtemps. Malheureusement leur joie a été de courte durée. D'abord parce que mon état de santé les a obligés à m'envoyer à l'infirmerie militaire pour y être soigné, puis pour une raison bien plus humiliante encore : ils reçurent l'ordre surprenant de me libérer sur le champ, malgré des aveux sur lesquels je n'avais nullement lésiné, m'en tenant à la stricte vérité et malgré le degré de gravité que représentait en Alsace toute forme de vandalisme anti-clérical. La raison de cette libération était simple, mon compagnon Fishderche était le frère de la secrétaire particulière du Sous-préfet du Haut-Rhin. La conséquence est simple à déduire : pas question de faire passer mon « copain » en correctionnelle, donc le Sous-préfet a tout simplement ordonné notre mise en liberté avec passage devant un tribunal de simple police au lieu de la correctionnelle. En échange de ces libéralités il y avait quand-même une condition, c’est primo que mes « potes » me dénoncent, et secundo qu’on me charge de la responsabilité globale de ce scandale, mon âge prouvant de facto ma place de meneur. Quelle que soit la méthode utilisée par mes « amis » - ils ont sans doute chargé la petite jeune fille de faire l'intermédiaire en lui donnant mes coordonnées, ce qui les libéraient de l'infamie d'une dénonciation directe mais ne les déchargeaient nullement de la responsabilité de mon arrestation.
Il y eu donc quelques semaines plus tard, un procès surréaliste, où l’Avocat Général ne savait pas s’il devait m’assommer avec mon passé de rebelle ou me féliciter pour mes vertus personnelles. Il n’avait pas échappé aux témoins qui nous avaient surpris que je m’en étais pris assez violemment à mes « amis » en les voyant s’emparer de quelques fourchettes et de quelques couteaux, et on dût reconnaître que j’étais le seul à ne pas être un voleur. Cela dit le cœur du problème était la croix renversée, et pour cet acte je fus non seulement désigné comme l’ordonnateur du délit, mais encore chargé de la responsabilité de l’ensemble de l’acte de vandalisme « ignoble » selon la presse locale, friande de ce fait-divers original et rarissime dans cette province qui, comme je l’ai déjà fait remarquer, n’était pas encore sortie de son pétainisme génétique. Au résultat je pris deux semaines de sursis et Cinq Cents francs d’amende alors que mes petits « copains » s’en tirèrent avec une admonestation assortie d’une amende beaucoup plus légère que la mienne. Curieusement, le bureau du Tribunal où je venais faire mes versements très irrégulièrement puisque je n’avais aucun revenu, me traita avec une extrême gentillesse et laissa traîner le paiement de mon amende plus de deux années ! J’avais fini par m’en faire des amis qui m’attendaient joyeusement, ce qui en disait long sur l’opinion qu’ils s’étaient faite sur mon affaire. Il y avait encore des fonctionnaires agnostiques, à cette époque, des gens que mon « sacrilège » avaient plutôt amusés que scandalisés.
Entre mes nouvelles connaissances et moi, l’affaire fut enterrée vaille que vaille, car les larrons restaient les amis de mes amis, mais en vérité, personne n’était dupe et une haine souterraine s’installa pour le reste du temps que nous eûmes à nous fréquenter. La seule chose qu’ils craignaient par dessus-tout était que je les dénonce aux situs, surtout à leur ami Théo, mais ce n’était pas mon genre et je préférai enterrer cette vilaine histoire jusqu’à ce jour. Dans le troisième volume on comprendra ce changement d’humeur et mon absence de scrupules caritatifs, car ces petits voleurs de fourchettes étaient bien des petits voleurs de fourchettes et pas grand chose d’autre. Au demeurant, je n’ai jamais été très fier de cette histoire précisément à cause de cette fin lugubre et du climat de mensonge qui régnait autour de la dénonciation. Même pour moi j’avais un doute sur la légitimité de mon exigence de silence de la part de mes « complices », exigence qui fut acceptée tout naturellement au regard de la place que j’occupais alors en tant « qu’ancien combattant ». D’un autre côté il leur aurait été plus simple de me dire la vérité sur le deal passé avec le Sous-préfet, il était évident que j’aurais accepté les conditions qui furent appliquées dans mon dos. Je me souviens encore de la tête de l’avocat qui m’avait été commis d’office et qui ne savait pas comment tourner ses phrases pour me faire accepter le rôle de meneur, car il fallait que je reconnaisse devant le Jury le fait que j’avais « entraîné » ces pauvres petits innocents dans cette affreuse aventure. Je coupai court en acceptant d’emblée sous la condition qu’il serait fait mention du fait que je m’étais opposé violemment à la rapine ridicule de mes petits copains. Finalement c’est moi qui sorti la tête haute du tribunal colmarien et cela suffisait bien comme châtiment pour Dolphi et Fischer. Cette affaire fit du bruit dans la vallée de mes vacances d’enfants et personne, même pas et surtout pas mes comparses, n’ont compris les causes profondes de ce qui s’était passé. Nous étions certes déjà bien imbibés d’alcool, mais ma colère une fois sur place n’avait rien à voir avec mon état d’ébriété. En réalité, et je ne me fis pas faute de le proclamer haut et fort devant le Tribunal médusé, en réalité je ne faisais que vomir les souvenirs répugnants de mes colonies de vacances en pèlerines bleu-marines « à boutons dorés ».
Ce qu’il y a de plus insupportable dans l’existence est ce qu’on appelle « des sentiments mélangés », l’âme est dans une impasse car les affects ne répondent plus correctement. D’ordinaire tout jugement d’une situation est spontanée, on aime ou on aime pas, et cela concerne évidemment en priorité le jugement des personnes. C’est ce qu’on appelle l’empathie ou l’absence d’empathie, la sympathie ou l’antipathie. Mais c’est encore pire lorsqu’il s’agit de se souvenir et que la représentation du passé devient floue. C’est le cas pour ces colonies de vacances, car si tout n’étais pas rose, loin de là, et si j’ai de graves raisons de haïr cette période que ma mère m’imposait chaque année sans raison particulière – le prétexte était qu’il fallait que j’aille prendre le grand air de la montagne, et pourquoi pas, il y avait peut-être un fond de vérité dans cette excuse, car ma mère ne pouvait pas ne pas me voir quitter le foyer familial en pleurs – ces périodes en montagnes n’étaient pas entièrement négatives et j’en garde de bons souvenirs mélangés aux pires noirceurs de l’existence d’un enfant. Noir comme les soutanes que portaient nos moniteurs. Je ne vais pas revenir sur ce à quoi j’ai déjà fait allusion quant à la pédophilie « ambiante » à cette époque, mais je ne peux pas passer sous silence les blessures infligées à mon âme d’enfant. La situation existentielle était simple : d’une main les adultes maniaient le fouet de l’impératif de la vertu, tandis que de l’autre ils justifiaient la tentation du vice. Ce déchirement a été le cauchemar de mon enfance dès la disparition de mon père, car, Freud, Lacan ou pas, mon père a veillé avant tout sur ce débat. Il m’a laissé, sans doute, ce que j’appellerais un surmoi de luxe, c’est à dire une sorte l’Excalibur qui m’a sauvé de la perdition totale, sans doute de la folie. Si j’extrapole cette aspect de mon existence d’enfant au plan sociologique, je trouve une société démente, qui avait fait de ces contradictions morales le tissu éducatif, la païdéia ordinaire du citoyen ! Que pouvait-on attendre historiquement d’un tel pourrissement de l’éducation ? Que ce soit dans les institutions collectives ou dans les familles ? En fait, je vois immédiatement le raccord avec ce qui va suivre, à savoir Mai 68, cette explosion d’une révolte qu’on n’a pas voulu analyser sous sa véritable lumière, à savoir la révolte de la jeunesse contre l’hypocrisie fondamentale de leurs aînés. Pas étonnant que St Clément, mon collège-jésuitière se soit désintégré pendant ces « événements » qui n’étaient que la critique vivante d’une génération littéralement moisie, du moins dans les sphères bourgeoises et petites bourgeoises de la société française. Quand je lis aujourd’hui une de ces sempiternelles insultes contre Mai 68, je suis pris d’une rage frénétique tant il nous était évident que nos maîtres étaient devenus des singes mimétiques, enfermés dans leur fausse tradition qui n’était que soumission à la magistrature du pouvoir, et déchirés entre les exigences morales dont ils faisaient une exigence essentielle et leur comportement vénal. Bien évidemment que notre génération a le droit de juger ses aînés, ceux qui ont laissé exploser l’Europe à deux reprises sans rien faire d’efficace. Aujourd’hui il suffit qu’un million de pékin défilent dans la rue pour que le pouvoir recule. Pourquoi, au fait, recule-t-il ? C’est un mystère pour moi, et je vous prie de croire que dans ce domaine il n’y en a pas beaucoup. Ca a commencé avec le millions de fanatiques qui ont sabordé la réforme de Savary, et depuis s’est installé une « tradition » du pouvoir de la rue. La peur de Mai68 ? Sans doute, ce qui prouve que ces gens de la droite sont des pleutres, vagues souvenirs de Lucien Leuwen.
Etrange coïncidence, mais en réalité le genre d’événement qui dé-couvre d’un coup tout une structure parallèle : maman me surveillait de loin, depuis son Afrique où elle avait fini par prendre la « vie du bon côté », elle me faisait observer à mon insu et très habilement, comme pendant mon exil, et le lendemain du procès elle me faisait virer de son appartement de Riedisheim en me coupant les vivres. Bof, je n’en ai pas fait une maladie, mais il y avait Jean dans le courant des conséquences, et nous nous retrouvions à la rue et sans le sou. Il fallait faire marcher le communisme de base de nos groupes de choc. Bernique. Seul Richard (Richard Marachin, le premier d’entre-nous à quitter ce monde sordide) nous ouvre une perspective. Vous allez rire. Dans le prochain chapitre.
|

|
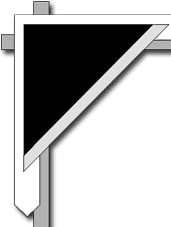

![]()