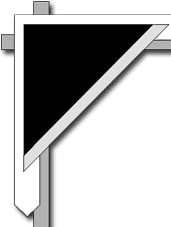
|

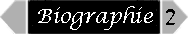
LES PORTES DU PENITENCIER
Avril 1965. J’ai vingt-quatre ans et je « rentre à la maison ». Depuis Juillet 1960 je divague à travers l’Europe et l’Algérie au gré des vents d’un exil tantôt personnel, tantôt lié à la guerre coloniale que la France a mené en Algérie de 1954 à 1962 et dont je refuse tous les aspects, simplement militaires mais aussi politiques et éthiques. Pas de ça chez moi. Un Allemand un peu idiot que je rencontre croyait que je me désolidarise logiquement de la France parce que je suis Alsacien ! Il n’est pourtant pas n’importe qui, il est patron du syndicat des syndicats de la Germanie Mercedes- Volkswagen, il se voit encore au dix-neuvième siècle ! Il est vrai que nos « pauvres » voisins n’ont pas une grande expérience coloniale, et ça me fait tout d’un coup penser à ce que devait avoir été les quelques territoires africains et autres que Berlin a gérés pendant quelques décennies : une annexe du pays, mieux, une excroissance du territoire allemand qu’il fallait paramétrer aux normes du pays. J’en ai d’ailleurs eu la preuve des années plus tard lorsque j’ai séjourné deux années merveilleuses dans le fameux « Bec de Canard », petite zone Nord du Gabon que la France avait cédée à l’Allemagne après la menace d’une attaque navale d’Agadir en 1911. L’organisation et l’esprit germanique avait réussi à pénétrer jusque là en à peine quelques anées, puisque les franco-anglais vont les déloger dès 1915. A preuve aussi le destin singulier du Cameroun, cadeau des grandes puissances au Kronprinz en 1885, la seule colonie allemande digne de ce nom et qui a conservé aussi des traces durables de cette forme originale de colonisation, dont le geste inaugural était partout de planter en premier lieu l’arbre des pendus, châtiment rapide et dissuasif auprès d’une population de guerriers d’opéra rigolards mais finalement aussi cruels que nos amis désormais européens. Mariage d’amour, on n’y peut rien…A Oyem, la capitale provinciale des Fangs, on disait d’ailleurs que cette ethnie dominante au Gabon mais largement présente dans toute l’Afrique Centrale, étaient les « Allemands » de l’Afrique. Autant pour l’histoire qu’on leur prête, c’est à dire une origine nomade, des guerriers venant du Nord-Est et s’arrêtant on ne sait pourquoi dans les profondeurs de la forêt où demeurent encore les derniers pygmées. Un médecin du dix-neuvième siècle, voyageant pour son plaisir sur les traces de Brazza, racontait que dans la région où j’ai passé trois années de ma vie, les Gabonais passaient le plus clair de leur temps à s’amuser à s’entre-tuer, même pas de tribus à tribus, mais même de clan et de famille à famille. C’était, paraît-il, un jeu permanent qui finissait en rôti cannibale, origine, peut-être, de l’appellation que les Belges ont donné à une sorte de sandwich (abominable) fait de viande crue, de pain et de sauce mayonnaise. Enfin, voyez ça avec Conrad qui a magnifiquement décrit l’autre aspect de ce siècle, celui de la colonisation du Congo Belge, les éternels imitateurs, imitant là, en Afrique, leurs voisins néerlandais qui avaient colonisé bien avant eux l’archipel d’Indonésie au prix d’un véritable génocide. Et Gide, bien entendu.
Vous allez encore penser que je digresse alors que je ne cherche qu’à résumer ! Mais vous avez raison, on ne résume pas une vie, ni même une partie de la vie. D’ailleurs je me pose des questions sur la pertinence et la possibilité de cette autobiographie. Il s’agit d’un acte du présent et rien de « présent » n’atteste de la vérité de ce que je raconte ici. Il faut quand-même que je rappelle que le présent n’est nulle part détaché du passé ou du futur, le tout forme un tout, qu’on le veuille ou non. Peut-être les personnes qui font l’expérience de la « petite mort », c’est à dire d’un coma conscient, peuvent-elles parler d’une rupture dans leur existence, et il est vrai que j’ai vécu l’un ou l’autre de ces petits comas dont je suis sorti par miracle, mais cette ex-istence se met elle-même constamment en abîme et s’invente des arrières-plans toujours un peu décalés. Mais la représentation que l’on s’en fait par la suite reste une image d’ensemble, d’où la difficulté de ne pas céder à ce tire-manches qu’est la digression vers les horizons et les paysages du passé. Ces derniers nous paraissent évidemment toujours plus rayonnants, plus dignes de nos panoramiques et de nos zooms que les pauvretés du présent. Mais voyez le problème : en parlant du passé, mon passé, je trébuche souvent, trop souvent, dans un autre passé, plus lointain, plus reluisant peut-être, ou peut-être aussi qui me donne quelque chose dont j’ai besoin, soit pour distraire le lecteur de ce qu’il pourrait lire entre les lignes, soit pour m’éloigner moi-même de moi pour d’obscures raisons morales, peut-être ? Le salaud, comme dit Sartre, trouve toujours un moyen pour alimenter sa mauvaise foi et pour la dissimuler, quand elle s’exhibe ! Enfin relisez : j’annonce mon retour définitif en Europe, après quatre années d’exil, et deux lignes plus loin je me retrouve à Berlin chez le Kronprinz ! Non mais, de qui me moque-je ?
Bon, Suisse-Air me largue pour la nième fois à Genève où il se passe tout de suite quelque chose de drôle. L’aéroport de Cointrin est quadrillé par l’armée suisse et les passagers descendent d’avion entre deux files de soldats hérissés de fusils d’assaut peu amènes. La raison est à chercher en Palestine, où commence la saga de l’OLP qui détourne des machine volantes, le commencement de ce qu’on va tout de suite nommer terrorisme, comme ça c’est réglé, on a défini son objet et la négativité de sa négativité. Bref, je passe avec les autres entre les bidasses pas rigolards du tout, et je me dis in petto – « si je me mets à courir, je suis mort, pas mal comme fin, non ? » . J’ai même un petit moment d’hésitation. Il est vrai que je me retrouve un peu comme avant mon départ pour la Grèce, devant le néant d’un avenir dont je me fiche déjà. Je m’en fous : cette petite proposition deviendra un jour un bon résumé de ma personne, résumé fait par moi, évidemment, mais non moins pertinent pour autant, et bien des imprudents vont encore s’y brûler des ailes pour ne pas l’avoir cru avec assez d’intelligence. Mais soit, je rejoins le hall d’arrivée avec tout le monde, passe à une fouille minutieuse puis me précipite presque automatiquement vers le bus de Genève Cornavin, la Gare des extraordinaires Chemins de Fer suisses, souvenir de mon enfance de crève-la-faim de la guerre, pris en charge par la Croix Rouge en 1947 pour aller se gaver de semoule sucrée sur les hauts-plateaux du Piedmont alpin. Déjà à cet âge j’avais le diable au corps, car les autorités suisses se souviendront d’un petit groupe d’enfants hauts comme deux pommes qui sabotent une voie de Chemin de Fer près de Rougemont, en plaçant quelques cailloux sur des rails ! Quel scandale, avec punition collective, mais l’esprit malin, c’était moi. Pardon, mais je n’avais plus de papa, et le petit Paul sera vite pardonné. Je ne recommencerai plus : mais qu’est-ce qui m’est passé par la tête ? Allez un effort : je me souviens que nous étions là, abandonnés par nos monitrices, et qu’il m’a paru tout d’un coup très drôle d’empiler quelques cailloux sur les rails de ces michelines rouges et jaunes qui nous conduisaient si gentiment partout où nous voulions ! Je pensais même que ça ne se verrait même pas, que les locomotives repousseraient ces objets comme poussière, mais non, la micheline a dû s’arrêter et tout le monde a eu une belle peur ! Mais bon Dieu, pourquoi j’ai fait ça ? Pour rien. Les enfants font des choses pour rien, ils possèdent encore cet instinct poétique, et sans doute y avait-il déjà dans mon geste une prophétique et inconsciente haine des machines et des moteurs, haine qui n’a fait que grandir entre-temps, prenant presque toute la place de mes préoccupations sociologiques et politiques. Ecolo à 7 ans ! Et puis voyez ce que c’est qu’une autobiographie : même pas capable de rester dans la chronologie ! Eh ben oui, ou plutôt non, pas possible de rester dans le train du temps astral et mathématique, la mémoire ne fonctionne pas comme les batteries des moteurs, en continu alternatif, elle se défend, elle taille dans le temps comme dans la brousse, à coup de machettes sans égards pour la logique. Elle a sa propre logique, elle est notre logique singulière, notre trésor personnel qui dort là où nous l’avons caché sans trop nous soucier des coordonnées qui nous permettrons de le retrouver, car nous sommes généreux. Les enfants sont généreux de leur temps, ils ne le dissimulent pas sous des piles de draps, au deuxième étage de la grande armoire normande ou alsacienne. Il n’y a que les enfants qui savent le donner, ce temps qui leur échoie au petit bonheur la chance, comme tout le reste. Je possède encore le rapport établi par les monitrices si gentilles sur l’ensemble de cette colonie diététique : j’y suis décrit comme adorable, et la rédactrice en particulier m’aimait beaucoup, elle n’a pas attaché beaucoup d’importance à l’incident, sans pour autant le passer sous silence, déjà fiché !…
Bâle 1965. Je me propose quelques jours de vacances dans cette ville jadis maudite, une sorte de revanche avant de monter dans le Nord belge ; et brusquement, sans préméditation, voici Ira, Ira la belle, Ira la folle, Ira ma chance méconnue, ma fée courageuse et si mal récompensée. Je la rencontre au Casino de Bâle, un grand café où les jeunes confrontent leur ennui. Elle me repère tout de suite et me drague sans attendre mais aussi dans un style qui me plaît tout de suite : Ira est une dangereuse préfiguration des jeunes extrémistes de Mai 68 et en même temps du mouvement hippie. Elle ne fait que des « études », en petits morceaux, mais elle dessine des caricatures pour un grand quotidien de la métropole du Sud helvétique, des dessins humoristiques ou poétiques qui lui sont payés royalement. Quand quelques mois plus tard je moisirai à Fresnes, elle composera mon histoire pour son journal qui n’y voit que du feu. Ce sera l’histoire de polo, petit personnage dont elle raconte l’histoire avec humour et amour au fil des jours et des semaines. Les matons sont si salauds qu’ils me censurent ce courrier, et refuseront même de me le rendre à ma sortie, crime que je ne leur pardonnerai jamais. Toute une catégorie de la population française qui se contentera, sauf une exception, de mon mépris, jusqu’à ma mort. Pourtant je n’avais rien contre eux a priori, mais j’ai bien senti au moment de récupérer mes affaires au guichet de la comptabilité des sorties qu’il s’agissait de pur sadisme et non pas d’une directive venant de plus haut. Déjà trouver au milieu des lettres que l’on reçoit un tampon bleu CENSURE suffit à vous faire enrager, mais alors là c’était du vol. Je n’ai pas encore eu le courage de faire des recherches dans les archives de la Basler Zeitung, mais c’est au programme. Car il y a encore des choses au programme, ne croyez pas que je sois fini, loin de là ; c’est ce qu’ont cru trop souvent mes Rédacteurs en Chef respectifs, à leur grand dam.
Ira représente aussi mon retour dans la gestion de ma libido. Pour parler cru, nous couchons jour et nuit. Cette femme hors du commun a une particularité qui me fait peur, elle est une femme-fontaine, ce qui ne signifie pas qu’elle souffre de la perversité des mictions réciproques, mais qu’elle possède le même orgasme que les hommes, en plus impressionnant. Ce phénomène est à la fois rassurant pour l’homme, car il est confronté aux « résultats » de ses efforts, mais aussi inquiétant. Pourquoi ? Sans doute car cette singulière manière de jouir a un caractère trop masculin, ce qui en plus correspondait parfaitement à la libertine ou la femme libre qu’était Ira. Nous passons quelques jours et quelques nuits chaudes dans un petit hôtel du Klein Basel, le quartier chaud de la ville, puis je lui fais mes adieux. Mais Ira ne l’entend pas de cette oreille, elle me tient et veut me garder. Elle m’accompagne donc à Bruxelles où elle s’installe cependant seule dans un hôtel pendant que je rejoins mon ami Jacques qui est de retour en Belgique et qui enseigne à l’Université Libre de Bruxelles. J’ai beau signifier ma volonté de rupture à Ira, elle ne veut rien savoir. Mais elle comprend et se tient en retrait pendant que j’entreprends mon enquête pour mettre la main sur Raoul Vaneigem, le Situationniste qui vit quelque part dans la capitale belge, une grande ville pour une telle recherche et pour laquelle je n’ai aucune aide directe ou indirecte. Je m’installe donc d’abord chez Jacques qui me prend en charge à cent pour cent, me préparant au matin mes premiers thés Lipton en sachet, ce qu’il sait que je trouve scandaleux lorsqu’on vit dans la ville du monde la mieux achalandées en produits exotiques, et notamment en cafés et en thés de toutes sortes. Et aussi quelques biscottes, nourriture qui correspond à ses malheurs de santé dont il ne me donnera jamais aucun détail précis.
Les premiers soirs sont réservés à mes retrouvailles avec les congolais des boîtes de nuit de mon premier séjour. Si je ne supporte pas les moteurs, j’assume au contraire avec un grand plaisir les centaines de décibels de ces lieux de, de quoi ? Pas de plaisir ni de divertissement, mais de dépense corporelles et chorégraphique. J’ai appris à danser comme les blacks et j’en suis à la fois fier et heureux car leur musique me comble, elle me fait frissonner au plus profond des zones de plaisir esthétique, totalement platoniques mais qui marient mon corps avec le mouvement. Pas n’importe quel mouvement, évidemment, le mouvement cosmique dont les Africains ont capté le secret, depuis le petit tintement de deux cuillers sur un verre jusqu’à la grosse caisse ou au steel-band des Caraïbes. Ceux qui m’ont connu beaucoup plus tard, avec femme et enfants, journaliste à la télé, déchiré entre le mouvement naturel qui me porte toujours à contre-courant et la force désespérante du flux qui emporte ce monde et auquel il faut se soumettre parce qu’on a lié à soi des destins d’autrui, ceux-là ne croiront pas un mot de ce portrait. Mes relations réelles avec le monde, le réel de mes relations se passe dans une sorte de clandestinité, et c’est de cela qu’il va être question dans ce second volume : comment et par quel mouvement je suis parvenu, malgré tout ce qui vient de marquer ma vie, à devenir un citoyen lambda, à me hisser à la position quasi bourgeoise de l’existence d’aujourd’hui. Cette mutation, car c’en est une, même s’il se peut qu’elle ne soit que provisoire, me vaudra ennuis et souffrances, avec la seule contrepartie ou compensation que représenteront mes deux enfants, Alexi et Elise.
Ce n’est pas facile à expliquer abstraitement, alors je vais retourner au récit. Nous sommes donc aux environs de mai 65 et je « rentre à la maison », j’ai décidé de me mettre en règle avec ma République et de reprendre une existence dont je ne connais rien sinon qu’elle est « normale ». C’est curieux, mais je n’ai jamais envisagé de m’incruster ailleurs comme l’ont fait certains d’entre-nous, les déserteurs. Situation comparable à celle de tous les exilés de l’Histoire. Je pense par exemple aux Huguenots qui ont dû quitter la France sous Louis pour échapper aux persécutions. Combien d’entre eux se sont facilement intégrés dans les sociétés étrangères qui les ont accueillis ? L’Allemagne, les Pays-Bas ou le Royaume Uni ? Combien n’ont, comme moi, jamais envisagé de devenir citoyen d’un autre pays, d’une autre nation ? Beaucoup me répondront que les conditions ne sont pas les mêmes, et que l’exemple que je prends, les Huguenots, est mauvais parce que les protestants n’avaient plus aucune chance de reprendre une existence normale dans leur propre patrie, alors que moi j’ai encore la chance d’obtenir le « pardon » de la mienne. Mais ce n’est pas tout à fait exact. D’abord parce que ma patrie, en réalité, ne m’a jamais rien pardonné : la France est un pays où la souveraineté réside dans le papier de l’administration et non pas dans la conscience d’un Roi ou d’une aristocratie. Or ce qui est écrit sur le papier, parfois avec une plume rouge comme dans mon carnet militaire, ne s’efface jamais. J’ai fait souvent l’expérience de trouver sur mon chemin des signes de rappel de ce que j’avais été et fait, des signes cachés, soigneusement voilés pour la raison simple que j’avais eu raison de faire les choix que j’avais fait. Depuis maintenant presque trente ans, l’Histoire me donne tous les jours un rappel de la pertinence historique et morale de ce que j’ai fait. Encore hier on a commémoré le massacre de Sétif, horreur coloniale que résume a contrario tout ce qu’un citoyen respectueux des Droits de l’Homme devait forcément choisir de faire au lieu de conforter la tyrannie du colonialisme en se rendant complice de nouveaux massacres. Mais cela ne change rien à ma position de coupable. Lorsqu’en 1981 Mitterrand parviendra au pouvoir, je ne me faisais pas d’illusions sur ce qui m’attendait : rien ne m’attendait de neuf quant à ma condamnation ad vitam de mon « crime » contre la Loi. Mais, j’y reviens, jamais je n’ai songé à m’installer ailleurs parce que je n’ai jamais pensé qu’il existait un ailleurs, et c’est là la spécificité du destin des Alsaciens. Leur histoire a fait d’eux des sortes de Rambo apatrides, comme je le dis dans mon Prologue, et partout où ils se rendent pour fuir ou seulement pour vivre, ils découvrent le même pays que le leur. Les meilleurs d’entre eux, ou disons les plus fidèles à eux-mêmes et aux odeurs et saveurs de leur passé, reviendront toujours, tôt ou tard, comme j’ai tenté plusieurs fois de le faire avant de réussir. Les autres finiront leur vie au pire dans le Midi parce qu’ils sont en général assez riches pour se le payer et surtout pour soigner leurs corps et échapper au froid de la plaine du Rhin. Très peu d’Alsaciens s’enfuient pour toujours de France. Je me souviens d’une émission de télévision d’un confrère axée sur des enquêtes sur les Alsaciens de « l’étranger » et qui a tourné court parce qu’ils ne sont pas assez nombreux en Australie, en Californie ou même à Tahiti. Bref, en débarquant à Bruxelles, mon premier souci est de prendre contact avec Paris et le réseau qui défend juridiquement les jeunes qui sont dans ma situation. Mais il faudra encore attendre jusqu’en octobre avant que je ne reçoive le signal pour y aller.
Raoul Vaneighem. Je ne vais pas faire l’injure au lecteur de le présenter, il est le seul situationniste avec Debord à s’être fait un nom dans la culture contemporaine. Son premier livre, « Manuel à l’Intention des Jeunes Générations » a été et reste encore un best-seller politique et moral. Aujourd’hui, dans cette ambiance de retour à la civilisation de la peur et du châtiment, ses ouvrages restent une référence pour les jeunes, et bien que je n’approuve guère le fond de la pensée de Raoul, je me réjouis qu’il en soit ainsi. Cela prouve que malgré tous les discours médiatiques et pseudo culturels qui s’en prennent de plus en plus férocement à Mai 68, l’esprit de cette époque vit encore et vit bien. Mais nous reviendrons sur tout cela. Pour l’instant je suis à la recherche de Raoul dont je ne connais que quelques textes qui figurent dans les huit premiers numéros de l’Internationale Situationnistes que Théo m’a, entre-temps, apportés à Bâle quelques jours avant. Je me souviens d’ailleurs que j’ai retardé mon départ pour Bruxelles parce que je voulais avoir lu toute la collection, ce qui est un travail assez difficile, car Debord et ses amis ne font aucun cadeau théorique. Pas de démagogie, il faut comprendre ou laisser tomber. Or ce que je lisais dans cette revue tranchait tellement avec tout ce qui existait sur le marché théorique et culturel que je n’arrivais même pas à envisager d’arrêter ma lecture avant d’avoir tout lu in extenso. Alors, arrivé à Bruxelles, comment faire pour trouver mon Raoul dont Théo avait fait la connaissance à Paris en même temps que celle de Debord. Bruxelles et toute la Belgique avaient des lois bizarres pour les Français : pas d’alcool dans les cafés, c’est à dire pas d’alcool forts. Que les alcools qui ressortissent, en France, à la Licence III, c’est à dire les vins et les bières, mais si l’on voulait boire du Whisky ou du Cognac, ou encore bien d’autres liqueurs, il fallait s’inscrire dans des clubs privés et là, seulement là, on avait accès à ces boissons considérées comme dangereuses. Lors de mon premier séjour, j’avais vaguement fréquenté deux ou trois de ces clubs, des endroits curieux et réjouissants, car si on y venait certes pour boire du plus de 17°, on y était aussi entre soi, libres de jouer aux cartes, c’est à dire de jouer tout court, aux échecs ou encore au backgammon ou de simplement entamer de longues discussions philosophiques ou politiques. Bien sûr, on y venait aussi pour faire des rencontres. Non pas dans le style club échangistes, pas du tout, mais ces clubs étaient des terrains naturels pour jouer sa chance auprès des femmes. En fait, il y a peu de femmes dans ces clubs, mais celles qui sont là ne sont pas n’importe quelles femmes : elles représentent déjà un féminisme d’avant-garde déjà fort en Belgique alors qu’on est encore à un lustre du MLF français. Ce soir-là j’ai de la chance, enfin si l’on veut, car s’il fallait faire un bilan général de ce que cette soirée a provoqué dans ma vie, je serais plus réservé. Au bar je pose ma question classique, où peut-on trouver Raoul ? Le barman me regarde au fond des yeux et après une hésitation me montre du doigt une table occupée par un couple apparemment occupé à bavarder : -« demande à la belle brune que tu vois là, elle pourrait te renseigner »-. Dont acte. Dix minutes plus tard, la belle et moi sommes dans un taxi à destination d’Uccle, la banlieue chic de Bruxelles. Béatrice, car cette fois elle s’appelle bien Béatrice, n’a pas hésité longtemps pour répondre par l’affirmative à ma question. Dans son regard j’aperçus immédiatement autre chose qu’un intérêt neutre pour une rencontre avec le situationniste en réalité fort peu connu dans son propre pays, et pour cause, il n’avait encore rien publié, sauf, dit-on, des romans pornos dont il tirait le plus clair de ses revenus. Dans le taxi même, deux corps faisaient déjà connaissance, avant même d’arriver à l’adresse où nous aurions une chance de rencontrer Raoul. Dans le taxi flottait un parfum de Genève by night, et je reste sur mes gardes, pendant un certain temps…
Le situationniste belge dirigeait en sous-main un autre de ces clubs privés, ce qui paraissait à cette époque une excellente manière de faire du business en Belgique, puisqu’il suffisait d’avoir un appartement assez grand et de quoi investir dans un mobilier minimum. Mais le club de Raoul c’était tout autre chose. Une splendeur dans l’Europe du néon et du bakélite faisant sa mue vers le plastique. Généralement ces clubs n’étaient guère autre chose, donc, que des appartements négligemment transformés en bistrots. Ici on pénètre dans une grande salle aménagée un peu comme une salle de château fort, mais sur la base d’un dessin architectural dans un style Bauhaus très élaboré, qui faisait penser à une salle de spectacle de luxe, avec des tables très confortablement réparties dans l’espace et un mobilier qu’un Stark n’aurait même pas pu imaginer. A la place de la scène il y avait un immense tableau, mais, pardon, ce n’était pas un tableau, mais une scène iconique vivante. De quoi s’agit-il ? Simplement d’une vaste peinture couvrant presque tout un mur , où chaque visiteur du club pouvait venir ajouter son illumination artistique, un tableau vivant qui changeait au gré des soirées et des membres plus ou moins inspirés. Ce gadget culturel illustrait à sa manière la destruction de l’art tel qu’inspiré par Dada : l’art n’est pas un objet, l’art ne peut pas se figer ou se fossiliser dans la chose objective, l’art doit pouvoir vivre comme tous les êtres biologiques. Il s’agit là de l’un des fondements de ce que les ignorants appellent le Situationnisme, alors que Debord précise dès le numéro 1 de sa revue qu’il n’existe pas de Situationnisme, mais seulement des situationnistes. On pourrait aussi dire sur la base de ce qu’on a vu naître depuis ces années, que cette œuvre n’était qu’une sorte d’installation permanente, un événement en mouvement permanent, certains auraient dit un happening. Béatrice et moi prenons place sur l’un des tabourets moelleux qui entourent de petites tables rondes et commandons la spécialité du lieu, un cocktail fait de cognac chauffé dans lequel on fait glisser de la crème fraîche sucrée. Une sorte d’Alexandra avec une saveur et un parfum de sabayon, car la crème remontait au-dessus du cognac, et on dégustait l’alcool à travers elle, une invention de génie dont nous abusâmes longtemps. Raoul arrive quelques minutes plus tard. Je me présente de la part de Théo que Raoul a déjà rencontré plusieurs fois à Paris chez Guy, rue St Jacques, où il avait déjà fait ma publicité, et une chaleureuse ambiance s’installe jusqu’à l’aurore. Raoul est une sorte de bon grand géant belge, le type même du bon vivant qui n’hésitait pas à pratiquer et à théoriser un hédonisme non tragique, en somme il écrivait des prémices pour la fête de Mai 68. On se promet de se revoir à Paris très bientôt, du moins dès que je serais sorti de prison, et Raoul me montre les bonnes feuilles de son premier Best-seller qui devrait paraître chez Gallimard vers la fin de l’année. Re-taxi, cette fois direction le « cot » 1 de Béatrice où la nuit se termine un peu comme celle de Genève, mais cette fois ma confiance reste inébranlable, et pourtant si j’avais su !..
Commence alors une deuxième période de mon second séjour dans la capitale belge, ma vie avec Béatrice. Je ne quitte pas le domicile de Jacques, me contentant d’aller passer certaines soirées chez la jeune femme qui menait une vie étrange et mystérieuse. En fait, Béatrice, de son nom de famille Landes, était connue de toute la Belgique pour une raison idiote, elle avait posé pour une de ces affiches publicitaires en métal émaillé pour une marque de boisson chocolatée. On la rencontrait donc à tous les coins de rue. Mais Béatrice ne faisait pas que cela. Lorsqu’elle disparaissait pour deux ou trois jours, elle se partageait, disait-elle, entre des jobs de mannequin publicitaire et des visites chez un homme aujourd’hui très connu en France, un historien de la République originaire du Midi cathare dont je tairai le nom par respect pour lui, tombé éperdument amoureux d’elle et qui assurait une grande partie de son train de vie. Etrange femme, cette Hongroise, petite-fille d’une vicomtesse originaire du Banat qui vivait du revenu de ses titres qu’elle avait placés à la City de Londres après sa fuite de Hongrie en 56 avec sa fille Véra qui tenait une petite boutique d’antiquité de valeur dans le quartier des Sablons, Véra, la mère donc de Béatrice. Quant au père, dont elle tenait le nom de Landes, il avait, disait-elle, disparu en Amérique du Sud, abandonnant toute la famille qui tombait ainsi sous la dépendance directe de la Vicomtesse. Véra ne s’occupait pratiquement plus de sa fille, mais la surveillait en fonction de projets classiques d’avenir pour une jeune fille qui allait devoir subvenir à ses propres besoins malgré la fortune d’une grand-mère dont on ne comptait jamais percevoir le bénéfice pour une mystérieuse raison. Béatrice avait fait une école d’hôtesses de l’Air et avait commencé à travailler dans l’alors prestigieuse compagnie Sabena, spécialisée dans les liaisons africaines et asiatiques. Sa mère continua donc de croire que sa fille passait son temps dans les avions longtemps encore après que Béatrice se vit licenciée pour retards constants et rédhibitoires. Béatrice somatisait systématiquement tout ce qui n’allait pas dans sa petite âme, aussi bien dans ses relations professionnelles que dans ses aventures amoureuses. Elle somatisait en toute lucidité, c’est à dire que lorsque les choses atteignaient un certain degré de dépression, elle se mettait à faire cuire deux kilogrammes de pommes de terre et se confectionnait le plat national hongrois, le râkot krumpli, c’est à dire l’étouffe-Chrétien absolu. Imaginez des strates de pommes de terre, de yaourt, d’œufs durs tranchés en rondelles, de sour-cream (crème fraîche acidulée) et de rondelles de salami hongrois. Elle prenait trois kilo en une nuit et passait ensuite une semaine à s’en débarrasser, et c’est ainsi que j’ai ajouté à mes compétences, celle de masseur de cellulite, son cauchemar de sang-bleu à la peau délicate. Ma liaison n’affecte en rien mes relations avec Jacques, et c’est bien pratique de pouvoir décider au jour le jour de l’endroit où je réside. Chez Jacques, je continue à travailler, c’est à dire à lire systématiquement ce que j’avais mis à mon programme, et cela va de Marx à Gramsci ainsi que Trotski in extenso et les Serge, Sartre et ce certain Crevel qui se trouve avoir vécu un destin étrangement semblable au mien avant son suicide.
Depuis la mort de papa, le suicide est au programme quotidiennement. Cela signifie qu’il ne se passe pas un jour sans que je n’y pense, non pas par des préparatifs fébriles ou par des volitions qui s’éteignent rapidement, mais comme sujet de méditation. Toute cette réflexion avait commencé par un calcul : papa est mort à quarante ans pile. Ma question tournait donc autour de ma capacité éventuelle d’ arriver à cet âge qui me paraissait alors déjà de l’ordre du début du troisième âge, et surtout de celle de dépasser la date fatale du Quatre Janvier 1981, anniversaire de mes quarante ans. Mais cette année 81 vous est aussi familière qu’à moi, et dès cette date j’étais déjà engagé dans l’aventure de l’élection à venir de François Mitterrand, convaincu que j’étais que nous nous trouvions à un tournant de l’histoire contemporaine de la France. Une chance, sans doute qui m’a préservé d’un geste malheureux. Mais entre-temps il s’était effectué un travail dans ma personne, et certaines réponses m’étaient parvenues de ce travail qui allaient mettre un terme à la question du suicide, provisoirement, sans pour autant exclure celle de ma mort, sujet de méditation dont on pourrait dire qu’il remplaça d’une certaine manière tous les rituels catholiques de mon enfance, la prière, les cultes et tout le reste. Une vérité avait fini par émerger de toute cette élaboration, et elle me paraît dépasser de loin mon cas personnel : le suicide est un acte prétentieux, vaniteux. Evidemment, on ne peut pas standardiser le suicide, c’est à dire fourrer tous les cas dans le même sac. J’avais eu un camarade de fac qui s’était tué en se défénestrant, et j’avais appris à cette occasion que ce genre de suicide était commandé par une impulsion irrépressible, un acte qui échappait à la volonté consciente du sujet. Et cela m’a fait penser à papa et à sa « bêtise », mais dans son cas j’avais repéré trop de préméditations pour le classer dans le même cas. Ce qui en revanche provoquait un doute chez moi, c’était le peu de chance de réussite de la tentative de mon père, l’absence de réaction de ma mère et de mes frères restant un parfait mystère pour moi. Bref, je ne me suiciderai sans doute jamais, par modestie réelle, parce que j’avais aperçu, ici et là, nous le verrons dans la suite, l’ombre du destin, et que je n’avais aucune prétention à me substituer à ce dernier. Il ne s’agit pas de religion ni de Dieu, mais de l’équation de Leibnitz, de la caractéristique par rapport à laquelle la mort était un élément trop important pour figurer comme simple vol de papillon. On pourrait aussi dire que la fréquentation acharnée de Spinoza m’a décillé les yeux sur une véritable possibilité de gagner en sagesse réelle, c’est à dire en bonheur. Reste l’euthanasie pour cause de dignité, mais ce n’est pas la même chose.
Le temps passait et les négociations avec Paris s’achevaient avec un contrat clair. Je me rendrai à Paris où j’irai me livrer aux autorités selon une procédure qui m’avait été prescrite par mon avocate Maître Beauvillars. D’abord la Gendarmerie, puis de là le Deuxième Bureau et enfin Fresnes où je ne devrais, en principe, moisir que quinze petites journées d’un octobre resplendissant, le plus bel été indien que j’ai connu de toute ma vie. Je fixe donc ma reddition au trente septembre et me prépare pour une aventure dont je n’étais pas si sûr que cela qu’elle se déroulerait comme prévu. Les derniers jours avec Béatrice prennent un tour étrange. Elle commence par m’avouer qu’elle a travaillé pour le SDEC, sans préciser si ma rencontre dans le fameux Club privé faisait ou non partie de sa mission. Mais cet aveu débouche sur une demande en …mariage ! Amoureux je l’étais suffisamment pour acquiescer sans demander mon reste, et au moment de mon départ, tout était décidé au point que la famille de Béatrice avait déjà commencé à se mettre en ordre de bataille pour une cérémonie qui devait se situer vers la fin de l’année 1965. Dans les radio, on commençait à entendre : « I can get noo,,,, satisfaction ». Maman aussi était informé de mes mouvements, et à Paris j’étais attendu par ma tante Jeanne et l’oncle René, toujours renfrogné et bougon, il n’avait toujours pas digéré ma disparition de décembre 60. J’ai eu beau lui parler de son « pote » Lemoine, le tâcheron du bâtiment qui nous faisait crever dans les caves et sur les chantiers inondés, il se retranchait toujours derrière son argument à la graisse de chemise, j’aurais dû me faire pompier ! Mon dieu ! Mon oncle René était le parfait représentant du râleur français dans toute sa splendeur : en 36 on était tous dans la rue pour la semaine de Quarante heures, et aujourd’hui tout le monde veut faire des heures sup ! Toutes ses analyses politiques s’arrêtaient là, et il retournait à la fabrication de sa piquette, mélange de kiravi et d’eau citronnée, le tout légèrement fermenté, ce qui donnait une boisson très rafraîchissante en été. Quand je pense à ce que ce poussah faisait faire à la pauvre Jeanne ! Des repas gargantuesques tous les jours, avec un menu invariable fait d’un hors d’œuvre, d’un poisson –en général un sardine grillée, il n’avait pourtant rien de portugais ! – d’une viande garnie, d’un fromage et d’un dessert ! Merci, hic ! En province nous mangions comme des moines, un seul et unique plat midi et soir, cela porte le beau nom allemand de Eintopfgericht : tout en une seule casserole. Alors les repas interminables de la pauvre Jeanne qui bossait aux mêmes heures que René comme secrétaire de direction chez Bourgeois (les parfums) et faisait tout le reste en supplément, trajet compris entre l’usine et le pavillon de Courbevoie. Bref, il ne m’impressionnait plus et je le laissais regarder sa télé, dernière consolation après son premier infarctus qui mit fin à sa carrière de chef d’atelier chez son beau-frère Monsieur Ferquin, PDG de Sonabel, filiale de Klaxon, décentralisée à Mantes la Jolie par le premier plan de la Datar.
A Bruxelles mes maux de santé étaient revenus en force. Tout se cumulait : diverticulose permanente, calcul des reins, lumbagos chopés en Algérie à dormir par-terre et ulcères duodénaux. Or Jeanne était atteinte d’un cancer, qui guérira miraculeusement, et en pleine crise de douleurs abdominales, elle me sort de la morphine, la première fois depuis des années que mon corps soulagé se détend totalement, et c’est la chance de ma vie, car le lendemain c’est l’épreuve de la reddition, et je me rends aux pandores complètement « chargé ». Les comprimés de Moscontin défilent au fur et à mesure qu’avancent mes rencontres avec les gendarmes, les officiers du Deuxième Bureau et puis l’entrée à Fresnes, l’horreur absolue, l’indignité en soi, après ça plus besoin de faire de taule, on est puni pour la vie. Mais pendant que le capitaine me demandait avec ironie si je désirai faire des déclarations sur mes activités en exil, pendant que les matons me douchaient en inspectant mes « cavités naturelles », je flottais dans l’extase, me foutant de tout ce qui se passait autour de moi. Je n’ai pourtant pas manqué cette parole de ce gardien qui s’était abaissé à considérer mon anus d’un air admiratif : - au moins un qui a le cul propre -, le plus beau compliment de toute ma vie. Ce bref moment de gaieté sera suivi d’une grosse déception pratique : j’avais apporté deux cartouches de cigarettes pour voir venir, mais toutes mes affaires me seront enlevées et consignées jusqu’à mon éventuelle sortie. Il faudra donc que j’attende la première cantine pour pouvoir commander du tabac, et jusque-là, ceinture. Le supplice, si on peut dire, durera une dizaine de jours, pendant lesquels je vais apprendre à rouler des cigarettes avec tout ce qui me tombe sous la main, j’irai même jusqu’à en reconstituer à partir de mégots ramassés par-terre et savamment insérés les uns dans les autres. Cela faisait partie du folklore de la prison, mais en réalité ce n’était un folklore que pour moi qui avait un compte bien garni, qui me permettait de cantiner, c’est à dire d’acheter à peu près n’importe quoi à manger ou à fumer. Bien d’autres détenus étaient logés à une toute autre enseigne, celle de la dèche permanente qui les contraignaient à se contenter du régime courant, et à trouver toute sortes de combines peu ragoûtantes pour fumer autre chose que des mégots.
Je suis dirigé vers le secteur militaire de Fresnes. Un aile de bâtiment avec les coursives classiques, dans une cellule où résident déjà deux jeunes déserteurs dits « de droit commun », c’est à dire de jeunes étourdis qui ne sont pas rentrés à l’heure à la caserne à cause d’une liaison féminine, ou qui se sont fâchés au point de cabosser tout un peloton de policiers-militaires, condamnation à un an de prison ferme, on ne plaisante pas avec la discipline. En pénétrant dans la cellule, je prends conscience brutalement de ce qui m’arrive. Petit moment de panique en considérant d’un œil marri le WC commun jouxtant le lavabo également commun et trois lits superposés dont le dernier étage m’était réservé d’office, les deux occupants purgeant leur peine ensemble depuis plusieurs mois déjà. Une table et deux chaises, dont on me laissera le monopole sans problème pour lire et écrire, mes deux nouveaux collègues ne sachant ni l’un ni l’autre. Le plus âgé des deux, celui qui s’est révolté contre le classique caprice d’un sous-officier, affiche une sorte d’obésité malsaine, il m’expliquera que c’est l’effet des quantités de pain qu’il avale chaque jour en ajoutant que c’est fatal à cause du manque d’exercice. Raison pour laquelle je décide sur le champ de me lever une bonne demi-heure avant les autres, tous les matins, pour faire des pompes et toute la gymnastique que me permet les douze mètre carrés de la cellule. Autre détail douteux, mais réel – lorsqu’on se rapproche du réel, il y a toujours une mauvaise odeur – le soir j’attends que mes compagnons dorment avant de me servir des toilettes, considérant comme impossible d’accomplir cela en présence consciente de qui que ce soit.
Une autobiographie doit-elle comprendre nécessairement ce genre de détail ? Bien sûr, il s’agit ici d’une situation extrême qui justifie que j’en parle sans fards, mais d’un point de vue général faut-il, contrairement à la littérature ou au cinéma, censurer tout ce qui concerne les fonctions naturelles du corps ? La critique d’un Hergé qui n’évoque jamais le transit intestinal de son héros Tintin est-elle pertinente ? Il faudrait interroger le rêve pour répondre à cette question et se demander si la fiction exclut d’office toute allusion à la physiologie. Or le rêve, du moins le mien, intègre parfaitement cette dimension de la vie. Lorsque en Grèce nous fûmes, Mulot et moi, saisis de diarrhée permanente, je n’ai pas hésité à le noter, sans cependant m’attarder, comme j’aurais pu et sans doute dû le faire, sur les conditions d’exercice de chaque épisode excrémentiel. J’aurais ainsi pu donner des détails non inintéressants sur l’hygiène du néolithique, c’est à dire la description des conditions qui nous permettaient, malgré tout, de rester aussi propres que possible, c’est à dire aussi propres que si nous vivions dans l’environnement normalement équipé. Dans les situations d’urgence, la nature se dépêche de vous enseigner tout ce qu’il faut pour compenser les « acquis » du progrès technique, et lorsque je serai amené à vivre en pays musulman, je retrouverai culturellement la réponse à toutes les questions sur le corps, à savoir l’eau. Je trouve extrêmement sale notre méthode occidentale consistant à se servir de papier, car le papier ne purifie rien, il se contente de masquer ce qui est sale en l’étalant. Dans le beau livre de Terre Humaine qui raconte l’histoire d’Ishi, cet Indien rescapé du passé et retrouvé par un ethnologue dans une partie du désert du Névada, il est longuement question de l’hygiène « naturelle » : on peut résumer cela en affirmant, après l’avoir expérimenté, que le problème de la propreté n’est pas le même que celui de la pureté, mais que paradoxalement la nature nous donne spontanément tous les instruments de la purification, à savoir le végétal, l’eau, les graisses et le feu, alors que la civilisation ne s’intéresse qu’au profit que peuvent générer des pratiques d’entretien de la propreté qui restent toutes douteuses quant à leur effectivité. D’où la remarque du gardien de prison qui m’examinait sous toutes les coutures ; en fait, la généralité de l’humanité occidentale est sale parce que la propreté n’est pas conçue comme purification mais comme simple obligation sociale. Notre hygiène est une hygiène factice, qui flatte davantage le plaisir des jeux d’eau que la finalité de la propreté en tant que telle. Au plan moral c’est exactement la même chose, la confession est l’équivalent du papier hygiénique, ce que les Jansénistes ne pouvaient pas tolérer, à juste titre.
Mes relations avec mes compagnons de cellule ne posent aucun problème, malgré ou peut-être grâce au fossé culturel qui nous sépare. Mais la raison majeure de l’absence de toute manifestation de défi ou d’hostilité tient dans le récit des causes de mon incarcération. Quatre ans et demi d’exil valent un respect immédiat et inconditionnel, nous entretiendrons désormais d’excellentes relations dont ils n’auront qu’à se féliciter, mes moyens de cantine étant larges et ma générosité égalitaire. Tout ce qui me sera livré les jeudi matin, sera partagé en trois, et lorsque j’aurai entrepris ma grève de la faim, ils bénéficieront même de la totalité de mes commandes, sauf le tabac. Pas de soucis majeurs, donc, pour un séjour prévu pour durer deux semaines. Reste cependant l’autre souci, souterrain, le doute sur la réalité de l’annulation de ma condamnation à trois ans de prison. Car par une étrange évolution qui s’achève dans le présent, je n’arrive plus très bien à concevoir toute l’horreur que j’ai ressentie lorsque la porte s’est refermée dans mon dos la première fois. Je veux dire par là qu’aujourd’hui cette perspective ne m’effraie nullement, et non seulement ne m’effraie pas, mais constitue parfois dans mon imaginaire une possibilité de finir ma vie. La prison pourrait bien être mon monastère sans que la privation de « liberté » ne me procure ce frisson d’épouvante que je ressentais en 1965. A cette époque, la perspective de passer trois ans dans cette cellule me rendait malade d’angoisse, une angoisse que j’ai du mal à comprendre aujourd’hui, mais c’était patent au point que je préparais déjà, dans ma tête, un moyen éventuel de m’évader, y compris déjà, bien avant les premières tentatives réelles, celui de l’hélicoptère que mes amis pourraient emprunter pour venir me libérer. Curieuse angoisse, aussi curieuse d’ailleurs que le bonheur formidable que j’ai ressenti en sortant de Fresnes, un épisode que j’aurais, sur un plan personnel, pu comparer à la Libération et aux grands événements de ma vie, à la différence qu’il ne s’agissait là que de ma petite personne, et non pas de grands mouvements de la planète ou de la nation. J’en conclus provisoirement que ces sentiments étaient liés à ma jeunesse, à la force des pulsions que la prison réprimaient de facto, mais j’avoue que rien n’est clair dans mon esprit à ce sujet.
D’autant que mon séjour s’annonçait relativement agréable. Passé le mauvais pas de l’absence de tabac, je rentrais dans une sorte de prospérité due à la générosité conjoncturelle de ma famille, qui me récompensait à sa manière, l’argent, pour une décision qui arrangeait et soulageait tout le monde. Octobre 65 est un mois de soleil permanent, au point que je peux remplacer l’absence de montre, objet interdit à l’époque, de même que les radios ou les télévisions bien entendu, par un cadran solaire que je dessine sur le rebord de ma fenêtre. Il est précieux, pour moi, de rester en relation avec le temps sous sa forme mathématique, car je ne conçois pas cet état d’aveuglement infantile dans lequel on se meut à cette époque dans une prison française. Les livres sont abondants et le choix étendu pour une raison que j’apprends par la suite : tous les livres apportés en prison par les détenus deviennent propriété de la bibliothèque et ne ressortent jamais. C’est à Fresnes que j’ai pu lire l’essentiel de ce qui avait été publié sur le génocide des Juifs en Allemagne, lecture qui venait compléter ce que je savais déjà depuis mon adolescence, car la pédagogie des jésuites comprenait aussi des illustrations authentiques des grands événements du siècle. Les bons Pères nous avaient projetés tous les documents existants, la plupart du temps inconnus du public et souvent même interdits comme l’était encore le film de Resnais « Nuit et Brouillard », et j’ai même pu voir le film des explosions atomiques d’Iroshima et de Nagazaki ! Privilège du pouvoir de cette compagnie religieuse encore très influente. Bref, la vie quotidienne carcérale se passait le mieux possible, les promenades me permettant même de rencontrer des amis de résistance qui attendaient comme moi leur libération conditionnelle. La nourriture n’était même pas aussi médiocre que j’aurais pu l’imaginer, et une certaine simplicité des menus remplaçait la sophistication culinaire. J’appréciais particulièrement la qualité du pain, pain de batterie, c’est à dire analogue à celui que l’on distribuait à volonté dans les tranchées de Quatorze. Il était lourd, c’est à dire dense avec une consistance exactement telle que je l’aime, légèrement croustillante, mais surtout d’une élasticité qui en conservait assez longtemps la fraîcheur et prouvait la présence abondante de gluten, élément aujourd’hui écarté de ce pain industriel que je nomme par dérision de la « mousse » de pain. Le pain joue un rôle important dans les prisons, car beaucoup de détenus n’ont rien d’autre pour passer le temps : mastiquer du pain au risque de prendre du poids sous la forme hideuse de la cellulite. Inutile de noter ici que les conditions carcérales ont bien changé depuis mon expérience. Quand je pense à la présence des médias audiovisuels dans les cellules, je rêve ! Notre cellule était vide, et les contrôles réguliers étaient brefs et ne posaient aucun problème : un coup de tube en métal sur les barreaux de la fenêtre pour vérifier si nous ne sommes pas en train de les scier, un regard sous les matelas et dans l’armoire, et basta. Soit, il existait quelques moyens de faire pénétrer quelques substances interdites dans la prison par le biais des visites. Exemple rigolo, l’alcool. Pour pouvoir offrir un Ricard à ses copains de cellules, il suffit de demander à sa femme de tremper une chemise dans l’alcool pur et de la repasser telle quelle. Il suffira, en cellule, de faire retremper le vêtement dans le lavabo pour en essorer un liquide qui ressemble fort à une véritable anisette. Mais je n’ai jamais eu à connaître de la présence de drogue, par exemple, alors que nous avions des contacts directs avec les détenus de droit commun dans la cour de promenade et par le biais du service de distribution de la nourriture ou des livres. Jamais je n’ai entendu parler de quelque trafic de ce genre.
Levé vers six heures et petit déjeuner sous forme d’un grand gobelet de fer blanc de café et distribution du pain à volonté. Après quoi il était loisible au détenu de se recoucher jusqu’à l’heure de la promenade, vers dix heures, seule occasion pour les hommes cloués dans leurs petit espace clos de se mouvoir de manière relativement sportive. Je me souviens du jeu dit du « Coq », un jeu qui consistait à foncer vers un mur et à former le plus brutalement possible un agglomérat de corps qui s’empilait pour former une sorte de pyramide. Etait-ce un entraînement pour se préparer à l’occasion d’une évasion ? Je ne le pense pas, mais ce jeu avait pour effet heureux une détente efficace des corps repliés et inertes le reste du jour. Pour ma part je n’ai pas non plus à connaître du travail en prison, bien qu’une partie de mes codétenus semblaient le faire couramment pour gagner de l’argent, les travaux forcés venant d’être abolis quelques années au paravent. En moi je constate une nouveauté : je m’agrège assez facilement au groupe des détenus, et rapidement on vient me consulter. Ma réputation se répand assez vite comme compétent dans l’estimation des peines et les conduites à tenir vis à vis des avocats et des juges. On me consulte avant le départ au Palais et les questions sont parfois pathétiques qui portent sur des durées qui me terrifient. Prendrai-je cinq ou dix ans ? Qu’est-ce que tu en penses, toi qui connais ces gens ? « Mon bavard me conseille de plaider à fond coupable et prétend m’obtenir des circonstances atténuantes »…, et parfois toute ma promenade se passe à tenter de comprendre des situations que ces malfrats soudain timides arrivent à grand mal à me décrire. C’était frappant. Des adultes dans la trentaine qui s’adressaient à moi comme des enfants, des adultes qui en d’autres circonstances n’auraient pas hésité à frapper, blesser voire tuer. Pas facile d’ailleurs de se rendre compte sur le moment de ce qu’ils cherchaient immédiatement, car j’avais rapidement compris que la prison n’était pas du tout ce qu’on peut imaginer lorsqu’on n’en a aucune expérience. En fait, la prison est un lieu de vie presque familial ; les truands les plus endurcis y ont en quelque sorte fait leur nid existentiel, leur domicile permanent qu’ils ne quittent que de temps en temps lorsque leur temps est épuisé. Vivement la récidive pour la plupart d’entre-eux parce qu’il n’y a pas de famille en-dehors de la prison, pas d’affection, pas de liens humains. Je ne sais pas si c’est une affaire d’époque, mais en 1965, à Fresnes qui était le Fleury-Mérogis de ce temps-là, ce n’est pas la terreur des forts contre les faibles qu’on ressentait, ni cette image d’Epinal du bagne américain où le plus cruel domine comme une bête. Non, le soir souvent, un grand silence s’installait dans les coursives : on attendait la « chanson ». Et tout d’un coup une voix d’opéra italien éclatait, venant de partout et de nulle part, exprimant la plupart du temps une sorte de mélancolie, étrange et surréel instant de complet décalage avec l’univers carcéral mais aussi avec la mode musical du moment. Derrière la chanson aux accents ringards, se profile pour tout le monde la longue peine du chanteur qui n’a plus jamais vécu assez longtemps en liberté pour remettre son répertoire à jour. Mais les applaudissements unanimes et chaleureux étaient un moment de grande émotion collective. Un jour, dans la cour de promenade, une véritable ambassade est venu me voir pour me demander de chanter les deux tubes qu’il m’arrivait de chantonner dans mon coin, et il m’a bien fallu, un soir, tenter comme je le pouvais, d’offrir aux coursives de mon bâtiment le dernier tube de Christophe : « moi, je construirai des marionnettes, avec de la ficèle et du papier… » et le fameux No Satisfaction des rock’n roller anglais. Le triomphe était bien supérieur à la valeur de ma performance misérable de chanteur même pas amateur, mais les chansons m’avait plu, et elles devait correspondre quelque part au destin quotidien des taulards passant leur temps à fabriquer des dés en savon ou des cartes de jeu avec le carton fragile des paquets de Gitanes, cigarette encore dominante, celle des Gabin et des Brel, celle des machos de la culture ambiante, élément beaucoup plus essentiel que l’on ne pourrait le penser de la part d’un milieu privé par essence de toute culture. Quant au tube des Rolling Stones, il était taillé sur mesure pour la situation carcérale, et dans les douches tout le monde se prenait sans complexe pour Mike Jagger.
Deux semaines passent, et patatras ! Personne ne vient me chercher à l’heure dite pour la fameuse libération conditionnelle promise. Pour le coup je panique, et ma décision tombe sur le champ : grève de la faim illimitée. Le doute s’était insinué en moi que les trois ans me pendaient quand-même au nez, perspective intolérable. Les gardiens sont embêtés et deux jours plus tard je reçois la visite d’un avocat que je ne connais pas, une femme timide et bafouillante qui ne me convainc pas du tout : elle est chargée de me faire savoir que mon avocat attitrée avait été invitée par Mao Tse Toung – ce qui s’est avéré tout à fait vrai – et qu’elle n’a donc pas pu effectuer au moment voulu auprès juge d’application des peines la demande de mise en liberté conditionnelle. Selon mon interlocuteur il ne s’agit que d’un retard de deux semaines, c’est désolant et Me Beauvillars s’excuse, mais je ne veux rien entendre, je continuerai ma grève jusqu’au moment, et même au-delà mais pour d’autres raisons, de ma mise en liberté. Deux semaines qui seront vraiment dures, rien à voir avec la diète en Grèce, car la cantine continue de livrer toutes sortes de délices que mes compagnons de cellules dégustent presque honteux de ne pas se solidariser avec mon attitude. Je ne leur en demandais évidemment pas tant, et leur exprimais mon plaisir de les voir prendre du bon temps, eux qui étaient encore loin de cette zone de temps qui précède la liberté. Les journées deviennent interminables, et ma rage se déplace lentement vers une sorte de folie. Le matin mes exercices musculaires sont doublés et je torture de plus en plus férocement ce corps qui hurle pour sa liberté. Je me mets définitivement au régime tabac-café, et me réfugie dans une solitude qui préfigure ce qui va m’arriver quelques jours seulement plus tard. Et puis, en plein cauchemar, une visite inattendue, celle de ma future épouse venue exprès de Bruxelles et parvenant au parloir en vertu de son statut de « fiancée ». Par–dessous le vitrage de plastique à travers lequel nous nous parlons, elle me fait passer un colis qui embaume tout le local, attirant les regards extatiques de mes codétenus, fascinés par la beauté de ma compagne. Un silence s’installe qui me vaudra un hourrah fracassant lorsque nous nous retrouverons dans le grand hall où se faisait l’appel. Cette cérémonie se faisait selon une méthode curieuse mais après tout logique : le maton hurlait le nom et au lieu de répondre « présent », nous devions décliner notre prénom. Ce jour-là mon nom fit l’effet d’une bombe qui me laissa cramoisi de plaisir et de honte mélangés, dans mon esprit un bonheur aussi violent ne devait pas avoir cours dans cet endroit pour damnés de la société. En même temps je me disais que c’était leur manière de vivre la réalité qu’on qualifie aujourd’hui de « pipol », et si les détenus avaient édité une fanzine comme c’est devenu un cas courant dans les geôles modernes, j’aurais fait la Une sans aucun doute.
Mais le vrai bonheur m’envahit dans ma cellule, Béatrice avait déversé tout un flacon de Chanel 5 sur un pull bleu magnifique que je n’eus jamais l’occasion de porter, les événements vont s’emballer et le rêve se dissiper pour laisser place au pire des cauchemar. Mais dans l’instant présent, je passe ma nuit le nez collé dans la laine moere d’une infinie douceur, j’ai l’impression de caresser la peau de la femme qui était, incroyablement présente là où jamais je ne l’aurais attendue. Le soleil reste fidèle à son poste lorsque mes yeux se ferment tout seuls, quelques minutes avant les coups de clé du réveil. Mes compagnons de cellules sont plus heureux que moi, mon bonheur est un immense soulagement et ils ne cessent de me rassurer sur ma libération imminente.
Ma comptabilité temporelle est exacte à la minute près et ce jeudi-là, je crois que c’était un jeudi, mais je peux me tromper, ce devait être le jour de ma seconde chance de libération conditionnelle, le 31 octobre 1965. Le soir venu donc, je plie mes draps et les couvertures, rassemble quelques petits effets personnels et m’assois par-terre, le dos au mur, attendant le miracle. Sept, Huit, Neuf heures, rien, mais une intuition me rassure sans que je sache pourquoi, et en effet, à Dix heures pile une clé se met à tourner dans la serrure de la cellule et mon nom retentit de la coursive : Kobisch, vous sortez ! Indescriptible moment de complet bonheur, malgré la logique qui se jouait implacablement dans les faits – bien que je ne sache rien des décisions prises en-dehors de la cellule, personne ne m’avait prévenu, je me fiais à ma seule intuition, à une certitude que je qualifierais volontiers de créatrice, à ce moment-là je fabrique ma liberté, au nez et à la barbe des événements contraires et contradictoires – malgré une sorte d’incrédulité qui m’accompagne tout au long de l’itinéraire interminable qui nous conduit le maton et moi vers la Porte, la grande Porte, celle de la liberté. Interminable aussi l’arrêt bureaucratie, on me rend des objets que j’avais oublié, mes cigarettes, ma montre, on me fait signer ici et là. Et là incident : où se trouvent le courrier que j’ai reçu quotidiennement de Bâle ? En effet, Ira, la passionnée, m’avait prévenu par courrier qu’elle dessinait pour un grand quotidien de Bâle ma propre histoire chaque jour sur quatre images. Or tout cela avait été censuré, mais le pire c’est qu’on me refuse de me les rendre à la sortie. Je fais mon petit scandale et je vais respirer un grand coup devant la Porte géante qui s’ouvre sur ma petite personne éblouie par les lampions de la liberté. En face de cette porte, un bistrot, LE bistrot des libérés, où je suis pratiquement attendu et où je déçois tout le monde en refusant la série de tournées à base d’alcool. Je continue ma grève de la faim et je ne bois que du café, le plus fort possible, la tête commence à bouillir et je finis sur un lit d’hôtel, enivré de liberté plus que de café et de faim.
La vraie liberté commence en fait le lendemain, au soleil, ce soleil qui ne me lâche décidément pas d’une semelle. L’administration m’accorde 24 heures de liberté, après quoi je suis censé me présenter dans une caserne de Rueil-Malmaison, dans la Compagnie des Isolés, centre de regroupement de tous les paumés de l’armée, qu’ils soient des ex-déserteurs ou de simples psychotiques revenus à eux après une thérapie au Val de Grâce. Dans cette unité je suis censé finir mon temps de service, c’est à dire une douzaine de mois, la loi ayant réduit mon compte de 33 à 18 mois, dont il fallait encore retrancher ce que j’avais déjà effectué. Bref, pas question pour moi de faire cette année supplémentaire dans l’uniforme, il fallait jouer serré, d’où le sacrifice de toute nourriture, l’absorption de café sur café. Mon état psychique se dégradait de jour en jour, mais avant de me rendre à Rueil, je passe chez un coiffeur de l’Avenue de la Grande Armée qui accepte à contre-cœur de me tondre, boule à zéro. Cela faisait partie de ma mise en scène qui faillit d’ailleurs par mal tourner. A mon arrivée au Bataillon des Isolés, j’ai une allure étrange, encore une fois plus militaire que militaire, l’air d’un bagnard sapé comme un jeune bourgeois. Et pour la première fois de ma vie, je me découvre agressif, d’une agressivité à faire peur à n’importe qui. Dans la file de la cantine du matin, un bidasse me marche sur les pieds, mal lui en prend car il se prend un coup de poing qui le laisse plus surpris que chagriné. L’espace s’ouvre autour de moi, et je me confine dans la solitude la plus complète et la plus arrogante possible. Je ne me reconnais plus, mais en réalité le café et la diète me rendent cinglé, la souffrance atteint des degrés qui vont produire dès la première nuit l’effet cherché. Avant cela, passage en revue devant le Commandant de la Compagnie qui s’arrête devant moi, me demande d’où je viens puis, ayant digéré ma réponse s’exclame :-« hé bien vous ferez un excellent secrétaire, le mien vient juste de nous quitter » - Demain matin, huit heure à l’état-major. Il ne me reverra jamais.
Car le mal enflait, et vers dix heures, affalé sur mon lit picot, je suis saisi de douleurs abdominales intenses, auxquelles je suis assez habitué, mais que je n’avais aucune raison de dissimuler ou de ne pas mettre en valeur. Hurlements, médecin, ambulance, nous traversons toutes sirènes hurlantes les trois-quart de Paris direction le Val de Grâce, où va commencer la dernière partie de mon calvaire. Je parts assez confiant, ma diverticulose et mes ulcères sont manifestes, mais le premier diagnostic tombe, inattendu : colique néphrétique. C’est essentiel car on me transfère immédiatement en urologie, un service spécialisé qui ne s’occupe que de l’appareil urinaire et basta. Je dois changer de tactique, c’est d’autant plus urgent que les examens s’avèrent les uns après les autres négatifs. Pas de calculs, peut-être un léger pincement de l’urètre, mais rien qui pourrait expliquer mes douleurs. J’ai beau leur parler de mon passé digestif, ça ne les intéresse pas ; en fait, ils se fichent éperdument de mon cas, ce qui les intéresse c’est le cobaye que je représente pour les premiers essais d’un antispasmodique qui va s’avérer être une vraie cochonnerie, à base d’amidopyrine, une molécule hautement dangereuse depuis longtemps interdite dans la plupart des pays et qui en plus ne me soulage en rien. Mais le Val de Grâce c’est l’hôpital de l’armée ; ici pas de problèmes financiers et le temps passe, je dois faire quelque chose avant qu’ils ne décident de me renvoyer dans mon corps d’armée. Je ne mange toujours pas, mon apparence commence à inquiéter les infirmières. Je prends une décision dramatique : simuler une dépression. Pas facile, mais intuitivement je trouve exactement ce qu’il faut faire pour attirer l’attention sans faire de bruit et sans crise dont je ne connais aucun symptôme. Je cesse de quitter mon lit, demeurant couché dans une position figée, le regard fixant un point précis de l’une des nombreuses fenêtres de la vaste salle où je me trouve. En même temps je rassemble tous mes souvenirs sur les symptômes de la schizophrénie que je connais vaguement. Je procède par analyse : il faut donner l’impression que je quitte le groupe, que je me replie totalement sur moi-même, toujours figé dans la position triangulée par deux repères fixes qui me font penser au nouveau roman, notamment ce livre de Butor qui vient de sortir et qui commence par une description quasi géométrique du lieu où commence l’action. Je passe aussi en revue ce que je sais des tests psychométriques auxquels je ne pourrai pas me soustraire le cas échéant. Celui que je connais le mieux est le fameux test de Rorschach, ces dessins dédoublés représentants en général des sortes de papillons ou de têtes de mort. Je fais un véritable travail théorique sur les diverses possibilités d’interprétation, mais c’est en vain, je n’ai pas la compétence requise et c’est désespérant.
C’est à ce moment-là que le destin m’assène le coup qui aurait pu être fatal si paradoxalement il ne venait m’aider dans mes desseins : je reçois une lettre de Béatrice qui m’annonce sa volonté de rompre, elle a rencontré quelqu’un d’autre et elle est désolée. Je tombe dans un trou sans fin, écroulement tellement visible que l’infirmière en chef m’enjoint de la suivre dans son bureau où j’éclate en sanglots. Elle ne sait rien des réalités qui provoquent ces larmes et pense qu’il s’agit d’un syndrome qui colle bien avec les observations qu’elle fait depuis une semaine. Elle me prend maternellement dans ses bras et tente de contenir le flot d’émotion qui me bouleverse, comme si toute la pression à laquelle je me soumets depuis des semaines venait de faire craquer le barrage de tout savoir-vivre et de toute dignité, valeurs qui figurent au premier rang de mon panthéon personnel. Déjà elle sort de sa poche un comprimé bleu qui me calme étonnamment vite, ce cachet s’appelait Valium et les dix milligrammes qu’elle me fait avaler agissent avec une efficacité extraordinaire. –« Vous n’êtes pas dans le bon service, Paul, je vais vous faire transférer en psychiatrie, mais n’ayez pas peur vous serez dans un service pour malades légers » - . But atteint. J’avais attendu trop longtemps en comptant sur mes maux physiologiques, mais je ne connaissais rien à l’histoire des maladies, et celles dont j’étais affecté, et en particulier la diverticulose permanente, ne figuraient pas dans les urgences des recherches, il ne me restait donc que le RD II, la possibilité de me faire réformer pour motifs psychologiques avec toutes les conséquences fâcheuses qui pourraient s’en suivre dans ma vie professionnelle future, crainte vraiment superflue car l’informatique n’existe pas encore et la bureaucratie a appris à se débarrasser des dossiers qui vieillissent en prenant la place de la vie qui vient et veut la sienne. Restait la peur de ce qui m’attendait en psychiatrie, le service que je redoutais le plus, car il faudra là-aussi montrer des symptômes qui se tiennent. Au fond de moi, une lumière tremblante me rend un peu de courage, car le suicide ne me paraît plus évitable, le sentiment de solitude que m’avait asséné la lettre de Béatrice s’ajoutant à mon état psycho-physique général s’était transformé en une angoisse dont ne j’avais jamais palpé la nature, quelque chose d’absolument effrayant, une véritable sensation de solitude sidérale, cosmique, un détachement absolu de toute humanité existante ; je touche la solitude en son essence, celle qu’on ne peut toucher que dans certaines expériences comme le LSD ou bien encore un coma profond. Cette état « pathologique » ne me quittera plus pendant des années, pendant des années je ne pourrai plus m’endormir sans me projeter à l’autre bout de l’univers, voyage dont seul le Valium pouvait freiner le vertige et adoucir la souffrance. La première pensée qui me revient après avoir avalé le comprimé de l’infirmière est une consolation majeure : après tout, il me reste la drogue. Je n’avais pas oublié la morphine de ma tante et ses effets euphorisants ; il me restait encore de l’espoir, cet espoir-là. Mais la vie continue, je dois rassembler mes quelques affaires et mon infirmière m’entraîne à travers la grande cour du Val de Grâce pour rejoindre un bâtiment proche de l’entrée où on me dirige vers une salle de quelque six lits presque vide.
Je n’ai pas le temps de respirer car mon voisin de lit m’entreprend sur le champ, un personnage, celui-là, de nom Hervé Guibert, petit-fils de général et jeune germanopratin cultivé et rempli de vie. Nous sympathisons immédiatement et je lui raconte toute mon aventure y compris la conclusion que j’avais tiré de mon expérience de la drogue. Là son visage s’éclaire et il part d’un large sourire – « ne t’en fais pas, j’ai tout ce qu’il faut, pas la peine d’avaler les saloperies qu’ils vont te servir tous les matins. Ce sera ma première expérience de l’héroïne en intraveineuse, explosion d’ivresse brutale et lumineuse, éclatement de la bulle de réalité rugueuse qui fait le fond de l’existence quotidienne, puis doux glissement vers un état d’amour entier, pur et sans restes. Hervé partage mon bonheur en rangeant sa petite cuiller et sa seringue qui resservira encore souvent, le Sida demeurant inconnu au bataillon médiatique et médical.
Le sens de l’existence a toujours fait le fond de commerce de son esprit. Mais le mode de sollicitation de son âme semble se transformer. Jusque encore ces derniers mois, la recherche ontologique appartenait à une sorte de pratique professionnelle faite de lectures toujours anarchiques, même si parfois elles s’enchaînent selon une logique qui peut aller de la remarque de bas de page jusqu’à une citation qui le frappait au point de lui enjoindre de passer par son auteur de manière plus approfondie. Et puis l’essentiel du travail consiste à reprendre inlassablement la lecture des grands textes de Heidegger, IL n’avait pas encore trouvé mieux dans la formulation de la question de l’Être. Pourtant, ces derniers temps, cette question prend une forme nouvelle, elle se simplifie en quelque sorte. IL se couche, par exemple, pour dormir, et la même pensée s’impose à peine le tête sur l’oreiller : mais pourquoi vis-je ? La simplicité de l’expression figurait déjà dans sa manière de s’exprimer dans sa jeunesse, et le retour de cette forme semble donc marquer une régression ou un rajeunissement de la manière de gérer le souci de l’Être. Pourquoi vit-IL ? Simple mais efficace. IL a l’impression qu’il y a un rapport avec le raccourcissement du délai qui le sépare désormais de la mort. Dans le questionnement classique ou plus professionnel, la question du sens de l’existence porte en général sur le mystère de la parousie, le secret de la raison de l’apparition du monde et de notre obligation de nous conformer à un «vécu » aléatoire dans sa subjectivité et sans importance par rapport aux dimensions abyssales de l’univers. Cette fois, maintenant, c’est de la vie qu’il est question : pourquoi est-IL plongé dans la vie, contraint de subir la douleur ou le plaisir, la tension ou le confort d’un corps étendu et détendu. Manger lui semble devenu idiot, mais ces derniers temps IL attend d’avoir faim, IL refuse de se soumettre à quelque rite alimentaire que ce soit ; la faim lui procure une sorte de plaisir supplémentaire, plaisir qui lui permet de négliger à peu près totalement ce qu’IL va absorber pour supprimer la sensation de faim, suppression qui le frustre de l’essentiel. Comme si la faim appartenait au secret de la vie, aux plus profondes explications du fait d’être et d’être vivant. IL jongle avec la drogue qu’il continue de prendre chaque jour. Comme il ne contrôle pas les vagues de douleurs qui déferlent tout d’un coup, il lui arrive de dépasser la dose qui s’efforce de garder sous une limite bien inférieure aux prescriptions du médecin, et ce dépassement se fait toujours payer un peu plus tard, le lendemain, un intérêt pénible, péniblement psychique. IL n’a, ceci dit, pas faim de morphine, elle ne l’obsède pas, mais IL se demande s’il existe un rapport entre l’habitude qui s’installe de vivre avec cette substance dans le sang en permanence et la forme nouvelle que vient de prendre la question si claire pour lui du sens de ce qui se passe. Vous comprenez, c’est comme si la question de l’Être avait changé de camp. Se demander pourquoi on vit est la question simple de n’importe qui, centrée sur soi et sur son parcours ; on est loin d’une certaine manière de la question ontologique du « pourquoi le monde existe plutôt que pas ? ». Le monde s’est rétréci à la dimension du « IL vit », sa question ne porte plus que sur cet aspect presque trivial du souci ontologique, la vie. Et pourtant cette forme lui plaît, c’est avec un certain plaisir qu’IL se pose cette question en même temps qu’il se rend compte qu’elle prend une sorte de permanence. IL respire avec la question, ouvre les yeux avec la question, écoute les choses avec la question, et c’est assez bon. D’un autre côté le reste de ses occupations quotidiennes lui deviennent assez pénibles ; les programmes de télévision se vident de toute attraction, il se fatigue de tout bavardage radiophonique sur France-Culture. IL sait tout, et ça l’agace. La télévision lui est un mensonge insupportable, le meilleur produit culturel ne lui apporte rien. IL est renvoyé à lui-même, IL va devoir se nourrir de son Soi. Pour survivre ? Il lui reste la mémoire.
Mais voici que se pose une question étrange : si IL dit : « pourquoi vis-je ? », cela ne sonne pas du tout comme s’IL disait « pourquoi vivons-nous ? ». Vous ne trouvez pas qu’il y a comme une discrépance entre les deux ?, Veuillez excuser ce mot savant qui est une nuance rarement employée du mot différence, une différence qui aurait comme singularité de signifier une certaine activité réciproquement destructrice et non pas simplement passive. Une discrépance pourrait être comparée à une fausse note, une dissonance, quelque chose qui fait mal, qui déstabilise ou qui défigure. Ici donc les signifiants semblent révéler quelque chose de plus profond qu’un simple différent esthétique. « Pourquoi vis-je ? » n’est pas beau, cette expression pose un problème du genre : on n’emploie jamais une telle construction syntaxique. Or l’autre modèle ne pose, lui aucun problème esthétique alors qu’il signifie, ou veut signifier exactement la même chose. Alors je demande carrément : y aurait-il autre chose qu’une simple différence esthétique entre les deux énoncés ? Le « pourquoi vis-je » contiendrait-il un peu moins de quelque chose, un peu moins de vérité ou d’adéquation aux questions qu’il soulève que l’autre manière de poser la même question ? « Pourquoi vis-je ? » serait-elle une expression à la limite de la possibilité ? Presque impossible ? Seulement parce qu’elle est à la limite de ce qui peut s’écouter. Ce qui irait très loin, car cela pourrait signifier que la question est impossible sous cette forme : je ne peux pas vivre en tant que je, mais si je dis « nous », alors tout va bien. La vie serait une affaire de nous, rendant le je disgracieux pour le moins, au pire carrément faux. D’ailleurs cette question de syntaxe se pose pour toutes sortes de questions dont le sujet est « je ». Pourquoi mangé-je ? C’est ridicule, non ? Pourquoi t’aimé-je ? Absurde. On est même obligé d’ajouter un accent étranger à l’orthographe normale de la construction verbale. Le « je » est décidément bien seul dans tout cela et IL se retrouve devant un problème qui va très au fond du sujet de ce qu’IL écrit en ce moment-même. IL écrit sur le « je », et n’écrit que sur ce « je », or on vient de sentir que quelque part ce « je » dérange, bouscule des habitudes linguistiques dans lesquelles il ne trouve pas de véritable place, ou disons qu’il ne trouve pas d’espace dans le tableau qu’il est lui-même en train de peindre ! Et pourtant la logique formelle n’aurait rien à redire à cette formule, ni aucune grammaire à l’exception de celles qui ignorent le mot être, comme ce serait le cas dans la langue chinoise, ce qui reste à vérifier. Encore que, comme nous venons de le remarquer, ce problème du « je » se pose dans de nombreuses autres opérations du sujet, sauf à considérer que l’être se décline dans toutes les opérations du sujet, quelles qu’elles soient. Ce qui LUI paraît assez juste. On ne peut pas manger et à la fois ne pas être. Non, il s’agit bien d’un problème d’expression et donc de dialectique dont le but principal est de permettre le mensonge, de le légitimer formellement.
Pourtant, il y a une autre manière de différencier les deux expressions dont l’une concerne le « je » et l’autre le « nous ». En effet, le « je » porte avec lui son histoire, la remise en question de son existence peut donc ne concerner que lui seul, alors que le nous (sauf s’il est question d’une histoire restreinte d’un groupe qui se trouve dans une situation identiquement désespérée que pourrait l’être un simple individu désigné par le « je »). Si donc je pose cette question « pourquoi vis-je ? », on peut interpréter cette question comme une simple conjoncture personnelle dans laquelle se pose en effet les possibilités de poursuivre l’existence, mais pour des raisons particulières, subjectives. Il s’agit alors d’une question que le « je » se pose à lui-même et strictement à lui-même, sans même qu’il appartienne forcément au sens qu’il y a pour tous les « je » d’exister. Exemple qui va clarifier : admettons qu’un individu soit atteint par une maladie dont les délais évolutifs sont implacables, alors le « je » peut se poser cette question sans qu’il n’entraîne ainsi un questionnement ontologique qui implique l’humanité en tant que tel. Bon cette remarque ne change pas grand chose au problème de fond, mais il fallait la signaler pour éviter tout malentendu.
Le département psy du Val de Grâce comporte plusieurs corps de bâtiments, dont celui des chambres fortes où on voit de temps en temps se diriger un brancard sur lequel est couché en camisole de force un bidasse qui a pété les plombs, souvent un légionnaire dont le képi repose sur le corps parfois agité de soubresauts évocateurs. Guibert et moi étions seuls dans une grande chambrée pour RD2, c’est à dire les appelés qui justifient leur inaptitude au service armé par une névrose quelconque. On disait à l’époque que c’était une arme à double tranchant, car cette réforme risquait de compromettre dans l’avenir du jeune appelé des velléités de faire carrière dans la Fonction Publique. Or, je n’ai jamais eu vent du moindre exemple d’une telle conséquence, et la plupart de mes collègues du Service Public (certes semi-étatique comme les médias) s’étaient fait réformer RD2, la manière la plus facile d’y arriver. Je suis incapable de me souvenir combien de temps, combien de jours j’ai passé dans ce service, mais je suis sûr d’une chose c’est que mon séjour a été bref. Dès le lendemain de mon arrivée, un médecin-capitaine me soumit à une sorte d’interrogatoire destiné à se rendre compte de ma situation. Je n’y vais pas par quatre chemins : Mon Capitaine, je ne passerai pas ne fût-ce qu’un seul mois de plus dans l’armée. Je considère avoir déjà donné quatre ans et demi de ma vie à cette sale guerre, et cela contre mon gré, et, étant donné le résultat, à savoir l’indépendance de l’Algérie, j’ai le droit d’être convaincu d’avoir fait le bon choix historique, certes en rébellion ouverte contre le gouvernement de mon pays, mais la Constitution elle-même me donne le droit d’une telle rébellion à laquelle l’histoire me donnera raison officiellement même s’il faudra attendre encore longtemps avant que ma Patrie ne reconnaisse la légitimité de mon action. Le capitaine m’écoute, silencieux, puis me fait passer dans un bureau voisin nanti d’un énorme volume, un questionnaire-test, le Cincinnati si je me souvient bien, c’est à dire un ensemble de cinq cents questions auxquelles il fallait répondre impérativement par oui ou par non, le droit de ne pas répondre étant restreint à sept possibilités. Ca m’a bien pris une heure et demi pour donner mon avis positif ou négatif à un ensemble de questions aussi diverses que mon amour pour mon pays que celui qui me lie à la nature ou à d’autres personnes. La lecture du test prit peu de temps à mon psychiatre, les réponses étant colligées par des cartes perforées sur le mode de l’ancienne méthode informatique. Une heure plus tard, l’officier me convoque en me priant cette fois de m’asseoir. Il a un air presque hagard : -« mais que faites-vous encore ici ? » - me fait-il d’un air presque paniqué. Je me le demande aussi, mon Capitaine, mais je n’avais pas le choix, et je dois vous avouer qu’après de longues semaines de préparation psychologiques puis de simulations, j’ai fini par craquer, et si vous me gardez dans ce service, je ne donne pas cher de ma peau. Il comprend sans dessin et sa réaction dépasse toutes mes espérances. Voici, me dit-il en me tendant une feuille de papier imprimée, signée et contre-signée visiblement par les plus hautes instances de l’hôpital ; vous êtes libre, vous allez quitter l’hôpital pour la destination de votre choix et resterez en permission libérable jusqu’à la fin officielle de votre service, c’est à dire dans quelques treize mois et quelque. Mais vous pouvez faire ce que bon vous semble, en fait tout est fini pour vous ici. Lorsque votre permission prendra fin, vous reviendrez signer quelques papiers, puis vous serez définitivement rendu à la vie civile. Au-revoir et bonne chance pour l’avenir. Je vous ai également préparé une ordonnance que je vous conseille de renouveler régulièrement, vous aurez besoin de ce médicament pendant quelques temps pour diminuer l’angoisse qui vous ronge depuis le syndrome qui vous a pris ici, par un accident stupide et qui aurait pu être évité. Cet officier s’appelait le capitaine Leclaire, et je profite de ce livre pour lui rendre un hommage total. Cette compréhension immédiate et sans hypocrisie de ce qui m’était arrivé, aussi bien pendant les années d’exil que pendant ces quelques journées terribles où tout semblait avoir basculé dans ma vie psychique, je ne l’ai jamais retrouvée depuis. Homme exceptionnel, qui a pris, dans l’instant, les décisions les plus hardies étant données la structure de commandement à laquelle il appartenait et qui a préféré sauver une vie psychique en voie de décomposition que de respecter un règlement aveugle.
Guibert me suivit quelques heures plus tard et il me fit visiter l’immense appartement de l’avenue de Saxe où vivait sa tribu d’aristocrates visiblement ruinés. Leur logement immense, vous imaginez trois ou quatre cents mètres carrés dans ce quartier qui borde les Invalides, était pratiquement dans l’état dans lequel l’avait laissé le grand-père général, des mètres carrés hors de prix sans doute hypothéqués, et on voyait encore ici et là la trace de meubles précieux vendus pour assurer la survie du clan. Il m’entraîne aussi une dernière fois dans les toilettes du tout nouveau Drugstore du Boulevard Saint Germain pour une ultime injection d’héroïne qui me laissa une impression de malaise. Il ne me paraissait pas très « classe » de s’enfermer dans un WC pour faire bouillir sa petite cuiller, se passer le garrot pour s’enfoncer une aiguille douteuse dans l’artère la plus visible de mon bras. Ce dispositif me dissuade, je crois, de m’accrocher à cette forme de drogue, et je n’y reviendrai que l’une ou l’autre fois, sans lendemain. A distance, c’est l’occasion aussi pour moi de me poser toujours et toujours la même question : manipulation ? Hasard ? Ce que je sais, c’est que les services de police me mettrons sous surveillance une fois rentré à Mulhouse, et qu’ils feront tout pour me procurer toutes les drogues auxquelles j’étais tenté de m’accrocher. Ca ne marchera pas, ou si peu qu’il leur faudra mentir dans leurs rapports qu’ils ne cesseront de noircir jusqu’au cœur de Mai68 où je deviens, ce n’est pas un hasard, un leader étudiant à Strasbourg. Mais n’allons pas si vite.
Le plus difficile dans un projet comme celui-ci, savoir raconter avec précision et dans une certaine continuité des périodes du passé, est de mobiliser les petites transitions, les articulations entre des situations plus ou moins stables et représentatives de choix simples et lisibles, c’est à dire ce qu’on pourrait appeler les temps « intersticiels « , les interstices de l’existence. Prendre un ascenseur est une sorte de temps mort qui est un interstice entre une action et une autre, et la mémoire ne s’intéresse que rarement à ces temps morts, quasi inexistants pour la bande enregistreuse de la mémoire. C’est là, je crois, que se trouvent quelques trésors du moi, des éléments certes à la limite de l’ imperceptible, mais dont les qualités devraient trahir ou révéler des aspects constants de ce moi, des comportements que je qualifierais de « lourds » car répétés, allant de soi dans chaque circonstance et révélant quelque chose comme le style de la personne. Or la mémoire n’en veut guère de ces choses lourdes, sans doute fait-elle ainsi le jeu d’une partie du moi qui se défend pied à pied de l’intrusion en lui du langage et de la communication à autrui des secrets les plus profonds de la personnalité. Prenons un exemple. Je viens de rencontrer Monsieur Henry, et nous allons nous séparer. En général nous ne nous séparions pas en même temps, c’est à dire que l’un de nous deux restait un peu plus longtemps dans le café avant de quitter à son tour les lieux. Que se passait-il pendant ces moments furtifs, où je continuais habituellement à griller quelques cigarettes en préparant la monnaie de mes consommations, et surtout comment cela se passait-il ? Il y a là en perspective toute une série de comportements habituels, d’habitudes acquises d’une manière ou d’une autre, mais aussi qui surgissent d’un fond psychologique qui, lui, possède une stabilité dont la source est bien difficile à découvrir. Ainsi, je suis toujours d’une extrême générosité dans mes pourboires. Cela fait partie à la fois d’une manière de m’affirmer vaniteusement comme « étant à la hauteur des manières d’une certaine classe sociale », et cette vanité revêt chez moi bien d’autres aspects, mais aussi un respect un peu excessif peut-être du travail de cette sorte de « serviteur » dont j’ai du mal à tolérer l’existence et le statut. Exagérer le montant du pourboire m’a toujours apparu comme une reconnaissance ou une complicité entre la partie servile de ma propre situation et la servilité obligée du garçon de café ou du groom d’hôtel. A ce sujet j’ai quand-même vécu quelques moments de rares satisfactions politiques - avez-vous déjà été satisfaits politiquement autrement qu’à l’occasion d’un scrutin qui vous aurait convenu ? question difficile car elle implique un jugement sur une situation politique et non pas sur un événement ponctuel - or, c’est en Allemagne de l’Est en 1971 que j’ai fait une expérience étrange et réjouissante. Comme nous allions passer une nuit à Berlin-Est, ce qui était déjà un tour de force étant donné les conditions dans lesquelles on avait accès au droit de seulement s’y rendre, nous avions, ma compagne et moi, formé le projet d’aller manger au restaurant. Or, le concierge de notre hôtel nous avait prévenus, il fallait réserver sa place quel que soit le restaurant de notre choix. Ce que nous fîmes, pour constater que l’établissement où on nous reçoit très froidement était quasi vide et que les rares couples qui arrivaient aussi ponctuellement que nous, étaient tous vêtus comme pour une soirée de gala. Notre aspect tranchait malencontreusement avec cette ambiance de restaurant de rang médiocre, mais qui semblait vouloir former un environnement de « luxe » sans doute passager, mais qui faisait penser à la restauration du temps de ce chef d’œuvre du cinéma allemand « Le Dernier des Hommes », le Berlin des années folles où la misère la plus noires côtoyait le luxe effarant des grands établissements pour milliardaires. Le film de Murnau formait comme la scène de ce restaurant qui eût bien du mal à glisser dans nos assiettes quelques bouts de viande difficilement identifiables. D’autant que le personnel était lui-même vêtu de costumes impeccables, à la limite du smoking, nous avions l’air fins ! Nous apprîmes par la suite que la réservation faisait partie, en réalité, d’une planification plus générale car la nourriture étant rare et chère, il n’était pas question de gaspiller, c’est à dire d’offrir une carte qui impliquerait des réserves importantes. Le rationnement permanent faisait le reste. Or ce qui me frappa immédiatement dans ce secteur de la vie sociale de la RDA d’alors, c’était la mauvaise volonté des serveurs, ou plutôt la volonté de montrer qu’il n’étaient pas des larbins et que ce travail les dégoûtaient au plus haut point. Le système de réservation obligatoire avait d’ailleurs partie liée avec le rejet général de cette profession dans le régime communiste : ici le métier de serveur était un métier d’appoint qu’on haïssait et on le faisait savoir à des étrangers comme nous, cependant qu’avec les autochtones s’était installé une sorte de complicité qui égalisait le serveur et le client. J’ai eu un mal fou à faire comprendre à notre garçon que son attitude, au lieu de me mécontenter, me faisait un grand plaisir et il restait sceptique face à ce qu’il interprétait sans doute comme un opportunisme qui avait d’abord comme but que nous soyons bien servis. La soirée s’acheva dans une mélancolie qui nous avait relégué dans une marginalité étrange, où l’on pouvait aussi bien distinguer une certaine jalousie qu’un mépris d’initiés pour des étrangers qui masquaient leur bourgeoisie foncière sous des blue-jeans qui étaient déjà à cette époque devenus le vêtement le plus porté dans cette partie de l’Allemagne censée être anti-américaine au plus haut degré. Plus tard, dans la fameuse année 1989, lorsque je chassais les réfugiés de Hongrie jusqu’au Rhin avec mon équipe de télé, le jean était devenu plus qu’un vêtement à la mode, il était devenu un véritable uniforme qui permettait d’identifier immédiatement un Allemand de l’Est. Ce retournement de situation esthétique recelait pour moi un mystère qui valait méditation, une réflexion qui devait aller plus loin que de ce contenter d’établir le paradoxe du désir profond et rebelle de la population de la RDA. Et de fait, le jean avait dans ses propres gènes une histoire essentiellement axée sur le travail puisqu’il était en Amérique ce qui était le bleu de travail pour un Français moyen. Les Allemands de l’Est se définissaient ainsi publiquement et volontairement comme des travailleurs. Ernst Jünger trouvait là un symptôme géant de la perspective de sa Figure du Travailleur. Et pourtant, autre paradoxe, les Allemands de l’Est étaient de très mauvais travailleurs, aux dires des économistes de l’Ouest bien entendu, plus bureaucratiques et paresseux dans leurs ateliers que nos ouvriers des années soixante que j’ai bien connus et dont j’ai même eu à affronter la colère au regard de ma productivité compulsive d’intellectuel qui s’ennuie dans toute activité répétitive et refuse de laisser l’esprit suivre l’action au lieu de la précéder.
Nous sommes loin des interstices du vécu, mais en relisant attentivement on trouvera sans doute de quoi nourrir des analyses me concernant dans des fondements comportementaux essentiels. Vanité, compassion ou désir de fraternité spontanée, que ce soit dans une queue de magasin ou sur une banquette de train, mon comportement est rarement introverti et détaché de la réalité humaine et matérielle qui m’entoure. Je crois que l’un des aspects de mon comportement qui me caractérise le mieux dans ce cadre apparemment secondaire est précisément ma curiosité permanente et mon ouverture à tout contact. Que ce soit d’ailleurs en public ou dans des circonstances plus intimes, je ne possède aucune forme de timidité, du moins depuis mon retour de mon périple odysséen de ma désertion. En Mai 68 j’appris à contrôler cette facilité à parler à n’importe qui de n’importe quoi et surtout de m’adresser à des foules d’étudiants que mon éloquence n’avait aucun mal à manipuler. J’ajoute ici que ces « manipulations » s’arrêtaient toujours au seuil de ce qui m’apparaissait comme l’esprit démocratique, et lorsque la majorité avait manifesté sa volonté contre mon point de vue, quel qu’ait été son succès rhétorique, succès qu’il m’était toujours loisible de pousser jusqu’à des résultats plus concrets. Il en alla ainsi lors de la décision prise par la majorité des étudiants de Strasbourg d’imiter les Parisiens et de défier les forces de police que le gouvernement avait déployé sur la ville ; j’avais mobilisé tout mon talent et toute mon éloquence pour les dissuader d’aller se frotter inutilement aux CRS, alors que nous étions en position de force par l’occupation de tous les locaux universitaires de Strasbourg, occupation dont nous avions d’ailleurs donné l’exemple à tous nos camarades des autres régions de France, y compris Paris. Au résultat, je m’inclinai, et fit même mine de suivre le cortège de casseurs jusque sur les lieux où se joua la comédie des « événements » strasbourgeois qui durèrent en tout et pour tout environ une heure et demi, le stratège de la police ayant fort bien fait son travail et le Maire en personne étant venu mettre un terme modéré à la bataille symbolique que les étudiants avaient cru devoir livrer pour faire comme à Paris. Mais nous y reviendrons, le moins répétitivement possible.
Le Val de Grâce justifia donc rapidement son patronyme en me libérant pratiquement d’une heure sur l’autre. Le capitaine suivit personnellement toutes les démarches bureaucratiques qui me restaient à accomplir avant de pouvoir franchir le vénérable portail de cette ancien lazaret du Dix-Septième siècle, autre propriété si je ne me trompe, de l’avaricieux Mazarin. Sur le large trottoir qui borde l’hôpital militaire, j’avais un problème à régler. Où aller ? Une fois de plus, ma famille avait perdu ma trace et je n’avais même pas songé à donner de mes nouvelles depuis que l’ambulance m’avait transporté en urgence à travers la nuit parisienne. Je choisis donc de prendre contact avec ma tante Emy, (Emilie), la sœur fortunée qui m’avait généreusement alimenté en argent lors de mon séjour à Fresnes. Le majordome m’appris qu’elle était retourné en Côte d’Ivoire et m’informa qu’il avait reçu la consigne de me diriger vers ma cousine René, la fille d’Emy, qui séjournait provisoirement à Paris chez son fiancé Pierre Butel, rejeton d’une famille de grands banquiers (rien moins que la BNP). Ils habitaient Villa Poirier, luxueux immeuble du Seizème arrondissement dans lequel était domicilié, j’ai appris cela bien plus tard par mon frère, Le Pen en personne et sa famille d’alors (nous sommes en 1965). Ce détail n’est pas sans importance, car il montre que contrairement à la légende qui fait de Le Pen un personnage d’origine modeste, le futur dirigeant du Front National vivait déjà selon des critères d’aisance qui ne devaient encore rien aux dons et aux héritages de ses admirateurs qui ont fini par le contraindre à payer l’Impôt Sur la Fortune. Autre détail curieux mais non sans importance, mon oncle et ma tante avaient leur domicile rue Frémiet, au pied de la butte de Passy, une rue en impasse bordée d’immeubles Haussmann haut de gamme. Or dans celui de ma famille et sur le même palier, vivait un autre personnage d’envergure, dont la biographie est non moins chargée d’ambiguïté, à savoir l’alors Ministre des Affaires Etrangères de De Gaulle, Monsieur Couve de Murville en personne. Tout le monde sait maintenant que ce personnage, qui devait même occuper un temps l’hôtel Matignon, avait été un agent actif de Pétain auprès des autorités allemandes à Wiesbaden, centre bureaucratique de tous les régimes depuis Bismarck jusqu’à nos jours, c’est là que se trouve ce qui correspond à notre INSEE. Le Quid précise qu’il fut révoqué par le Maréchal en 1943, après avoir occupé le poste de Directeur des Finances Extérieures depuis 1940. Ces détails me paraissent importants car cette partie de ma famille avait beau afficher un apolitisme de droite classique, leur vie quotidienne était tissée de relations politiques au plus haut niveau. On sait que la famille D’Estaing formait un maillon important du groupe de Suez, et que l’activité de ce groupe se concentrait largement autour de l’économie coloniale, tant en Indochine qu’en Afrique. Ce qui explique peut-être l’intervention personnelle du Président Giscard d’Estaing pour tirer d’affaire mon oncle Jacques, intercepté en avion lors d’un survol du Nigéria pendant la guerre dite du Biafra et qui dut moisir un mois dans une cellule inconfortable, accusé d’espionnage aérien, lui qui ne pensait qu’à dépeupler les immenses forêts de cette Afrique dévorée à petit feu par les grandes entreprises du bois exotique. Bref, Le Pen voisin de ma cousine Renée, Giscard volant au secours de Jacques Barnéoud, mon oncle, des tables où l’on pouvait trinquer avec le Vicomte de Vomécourt, représentant pour l’AOF de la plus grand entreprise de transports maritimes de l’époque, à savoir Delmas Vieljeux, devenue entre-temps le fleuron du groupe Bolloré, tout cela constitue un ensemble cohérent politiquement et économiquement, représentant au demeurant une forme historique de l’économie de la France, longtemps à la recherche de plus-values coloniales destinées à compenser la pauvreté de sa productivité dans les autres branches de l’économie moderne. L’exploitation coloniale + la politique d’immigration mise en place très tôt dans le Vingtième siècle, permirent à la France de tenir, face aux puissances économiques montantes comme l’Allemagne ou des groupements déjà très puissants réunissant ce qui est aujourd’hui le Bénélux aux économies anglo-saxonnes.
Villa Poirier. La pierre de taille avait, cette fois, subi le traitement Malraux, et l’immeuble de ma cousine resplendissait à l’extérieur comme à l’intérieur où les escaliers rivalisaient encore largement avec les ascenseurs par leur largeur et le beau tapis rouge flambant neuf qui courait du rez de chaussée au septième étage, niveau dévolu au personnel et disposant de sa propre entrée côté jardin et minuscule escalier en colimaçon. Je ne garde qu’un vague souvenir d’un appartement explosant le neuf et le « bon goût » parisien, savoir cet assemblage fragile de meubles Louis XIII voisinant avec une console Boulle et avec des croûtes authentiques signées Utrillo ou au pire Buffet. Du fric réparti comme on peut répartir des placements sans faire trop jurer des esthétiques aussi conflictuelles que celle d’un Lorjou et le Buffet de service. Et puis toujours l’origine paysanne qui transpire là où l’argent n’est pas assez ancien pour masquer la figure bourgeoise de la prétention aristocratique, où la cristallerie joue un rôle déterminant ainsi que de vastes armoires vitrées auxquelles cette jeunesse n’avait pas su échapper. Donc, repas qui démarre assez morne, en réalité nous n’avons rien à nous dire, et cette absence de matière échangeable ne pouvait que finir en eau de boudin, c’est à dire en un débat assez brutal entre Pierre et moi, celui-là représentant le futur Front National, et puis l’autre, ce faux cousin, ennemi de classe déclaré qui n’étonnait que par sa compétence en grands vins, faiblesse qui m’était venue tôt dans les caves de maman, Grand-Rue. Ma cousine Renée semblait n’avoir reçue qu’une seule consigne : écourter ma présence dans cette demeure où je n’avais rien à faire ni à dire. Cela dit, la discussion avec Pierre Butel, le banquier HEC, n’avait rien de médiocre, l’homme avait une certaine compétence dans la chose économique, sans toutefois en avoir la matière historique, ce qui me donnait un avantage qui le faisait parfois enrager à rougir de colère. Mais l’instinct du dominant rassure toujours et emporte finalement toute opposition même rationnelle : c’est ainsi que l’on apprend que la raison n’a cours que là où elle est alliée au pouvoir et à l’argent. On a donc su garder son sang froid et son sourire « familial », allant jusqu’à reconnaître le courage de ce cousin de province barbouillé de Jean-Paul Sartre auquel on ne comprenait soi-même la moindre goutte. Dans le salon pousse-café, on me donne mes instructions, cette fois bien familiales : ma mère me place pour ainsi dire dans l’appartement qu’elle a acheté à Riedisheim, à un jet de pierre du lieu que j’habite à présent, avec pour vif souhait de me voir faire mon Bac, maintenant que la parenthèse de la rébellion semble bien fermée. Les élections présidentielles avaient en effet mis un point final à l’instabilité de ma situation juridique en me classant dans le troupeau formé par les anti-coloniaux et des OAS, globalement amnistiés en l’honneur de l’élection au suffrage universel de notre César qui n’aura pas, malgré toutes les tentatives, l’honneur du couteau de Brutus. En supplément une modeste pension qui doit venir combler mes propres revenus.
Je dois rappeler ici le petit incident de la visite de mon ex-camarade de Collège, envoyé par les Bons Pères Jésuites pour m’aider à me « réinsérer », comme si, et d’une, cette insertion était mon problème numéro 1, et de deux, comme s’il y avait une quelconque possibilité de dialogue entre ce type fiché OAS et moi. Je le mets donc courtoisement à la porte avec pour mission de faire savoir à la Centrale de Chantilly qu’il est temps que la Compagnie de Jésus cesse de m’espionner, fût-ce au service de ma mère. Curieux, mais le nom de cet ambassadeur des jèses n’a cessé de m’obséder toute ma vie à cause d’une tournure singulière de mon intelligence. Mes adversaires se sont toujours trouvés, face à moi, entre la question de savoir si j’étais un imbécile absolu ou bien si je leur réservais un coup de Jarnac, situation qui m’a sans doute souvent sauvé de bien des ennuis. En bref, je suis d’une lenteur désolante à comprendre ce qui m’arrive, et mes réactions demeurent donc imprévisibles et l’étonnement est toujours le sentiment qui domine dans les réactions de ceux qui tentent de me manipuler. D’où des hésitations qui forment finalement une sorte d’abri naturel. Darcel, il s’appelait Darcel, fils de général et pas n’importe lequel puisqu’il était Président de la Croix-Rouge Internationale. Maintenant que son nom me revient, c’est le prénom qui fait défaut, mais disons qu’il s’appelait Pierre. Pierre m’avait été balancé dans les pattes lors de mon passage anticipé en deuxième division, peu après mon arrivée à Saint Clément. « Balancé » signifie que les Bon Pères avaient décidé d’en faire mon parrain sous la forme d’un ami, créé de toute pièce mais qui jouait assez bien la comédie. Ma naïveté sans bornes lui avait fait un accueil chaleureux et entier. Pierre était un grand garçon très blond, massif et destiné à une forme molle d’obésité mal contenue par des exercices sportifs de toutes sortes. Son intelligence tenait plus de la ruse que de la facilité à comprendre. C’est ce qui explique à la fois ses choix politiques en Terminale, où la majorité militait pour l’Algérie Française et où il fit ses premiers exercices d’opportunisme courant, et finalement son choix pour une carrière politique tout court puisque je le repère quelques années plus tard dans l’équipe de Raymond Barre, alors au sommet de sa carrière et plus engagé à l’extrême-droite que ses manières patelines ne le laissent penser. Bref, les jésuites me collent Pierre Darcel, histoire d’entrer dans ma vie intime et de vérifier par la bande ce qui se dit dans le confessionnal que je fréquente encore pendant la première année. Je ne sais pas s’il s’agit d’une manipulation générale et qui s’applique à tous les collégiens des jésuitières ou bien s’il s’agissait là d’une méthode exceptionnelle réservée à des cas difficiles. Pour le malheur des manipulateurs la mission de Pierre ne fait pas long feu, le garçon fait un faux pas dont je ne me rappelle pas les détails, mais son « amitié » se révèle d’un coup si fausse qu’il est comme contraint de prendre les devants. Je ne me souviens que de cette phrase qu’il lâche un jour, rouge de colère – « tu n’es qu’un pauvre con » -. Sur le coup je n’ai pas pris la peine de méditer cette saute d’humeur, après tout j’avais d’autres amis, et des bien meilleurs, et cette « rupture » ne me causait aucune peine particulière. Or, si j’avais alors réfléchi correctement, analysé le déroulement des petits événements qui ont abouti à cette conclusion, j’aurais compris l’ensemble de la manipulation et identifié l’espion du Père Préfet. En même temps je me rends compte que ce Pierre est un piètre ami, ce qui me met sur la piste du doute, doute qui mettra beaucoup de temps à s’éclaircir pour devenir la vérité de son statut par rapport à moi. C’est ça ma lenteur, je mets des lustres à comprendre le jeu des autres, pour la bonne raison que j’ai un mal fou à imaginer qu’un être humain puisse vouloir en manipuler un autre. Je dis cela en fonction, évidemment, de ma propre personne, car ma culture, largement fondée sur les piliers de Machiavel, ne parle que de cela, de manipulation des êtres et des masses. Or, cette naïveté va très loin, au point qu’il me faudra parfois des années pour me rendre compte rétrospectivement que tel personnage, par exemple Béatrice, cette femme qui me fit tant de mal à ma sortie de prison et que j’avais eu la faiblesse d’aimer, n’était à l’origine qu’une vulgaire petite-main des services français en Belgique, pour lesquels elle faisait des « piges » de temps en temps. Elle personnifiait la belle espionne, à laquelle personne ne résiste, à peu près comme celle qui me dragua à Genève comme on capture des truites affamées dans un concours de pêche truqué.
Ce défaut, car c’en est un, me vaudra de longs malheurs, des périodes de plusieurs années, coincé par une manipulation féminine dont j’avais été incapable de flairer la moindre fragrance. Il me donnera aussi une vision de l’existence comme celle d’un puzzle que la mémoire complète au fur et à mesure et qui explique ou éclaire progressivement le mouvement qui me mène au présent. Le présent travail a pour objet principal l’assemblage de toutes les pièces de mon puzzle, si une telle construction est réellement possible. Parfois je me dis que la fiction est plus forte dans cet exercice que les efforts de la mémoire, l’exemple d’écrivains comme Stendhal ou Dostoïevski faisant foi, qui parlent mieux d’eux-mêmes dans leurs héros que les cahiers qu’ils ont consacrés directement à eux-mêmes. Je pense essentiellement à Stendhal, car je ne connais pas de mémoires dues au grand génie russe, mais des personnages comme l’Idiot ou le Joueur correspondent parfaitement à ce que l’on sait de la personne de l’écrivain. J’estime d’ailleurs que l’Idiot n’est qu’une vaste autobiographie d’une précision hallucinante, du moins en ce qui concerne l’univers psychologique dans lequel a vécu Dostoïevski.
|

|
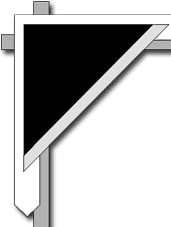

![]()