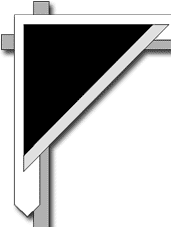
|

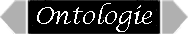
|
Il y a va ici de la relation que nous, les hommes, entretenons avec l'étant. Sans faire d'histoire, dans tous les sens de l'expression. Dans l'entretien précédent, nous n'avions fait que constater que l'étant nous apparaissait comme un mystère, en découvrant que c'était cette qualité de mystère elle-même qui remplissait la relation. La question célèbre : pourquoi l'étant est-il plutôt que de n'être pas, alimente en fait la substance de la relation, son épaisseur. Cette épaisseur est la valeur intrinsèque de l'existence, au point que la sagesse pourrait se décrire comme le jouir du mystère de l'étant : le caractère incroyable de l'être (qui s'impose au non-être) est en lui-même la raison suffisante et la fin de toute vie humaine. Les philosophies contemplatives, pour autant qu'il en existe d'autres, ont toutes implicitement encaissé cette vérité. Peu importent les conditions de la vie, elles sont toutes soumises à la même condition générale, le mystère de l'être sous la forme de l'étant.
Nous avions ainsi affirmé l'étantité absolue de toute chose, au sens où l'étant contient l'être comme simple infinitivité et non comme une dichotomie. La différence ontico-ontologique n'est qu'un tremblement de l'infinitif grammatical. Cet infinitif révèle, en tant qu'infinitif, la possibilité de l'infini de la condition de l'étant et le repos du concept hors du mouvement de l'action, hors de la relation sujet-objet.
Nous avions aussi conclu que la vie humaine possède en soi une valeur absolue du fait que toute conscience peut participer du miracle permanent de l'étant. Cette valeur fonde de manière absolue ce qu'on appelle les Droits de l'Homme. A propos des animaux, nous avions établi que l'on ne peut rien affirmer d'aucune manière, qu'il n'existe aucune méthode ou expérimentation qui permette de se prononcer sur leurs états de conscience.
DU STATUT DE LA CONSCIENCE
Pour en arriver à ces conclusions, on est parti de la conscience. Mais qu'est-ce-que la conscience ? A première vue, celle-ci ne peut recevoir le statut de phénomène puisque c'est elle qui reçoit ou qui forme l'ensemble des phénomènes. Sauf à se phénoménaliser elle-même, procès que tentent de réaliser certains philosophes comme Husserl, la conscience nomme tout simplement et seulement la relation à l'étant. Comme son nom l'indique, la conscience "sait ensemble". Autrement dit ses opérations n'appartiennent ni à un sujet, ni à un objet ou à une transcendance, mais toujours à une communauté de sujets, d'objets, de transcendances. En ce sens le véritable sujet est la conscience elle-même. En elle se révèle un certain dédoublement de l'étant lui-même en tant que tel, raison pour laquelle la conscience ne peut pas vouloir se transformer elle-même en phénomène. La reflexivité de la conscience est une simple répétition de ce dédoublement qui n'apporte aucune nouveauté. Le savoir qui semble résulter de l'opération de la conscience ne doit pas être conçu comme la saisie d'un élément par soustraction de l'étant. Ce savoir surgit dans l'étant à partir de l'étant qui se scinde dans la vie de la conscience. Autrement dit, l'étant ne peut pas vouloir se séparer de quelque chose pour quelqu'un, mais toujours seulement pour lui-même et ses propres fins. Le savoir qui a lieu dans la conscience ne peut pas non plus être revendiqué comme un acquis par le sujet mais toujours comme un acquis commun du sujet et de l'étant, en tant que cet acquisition se produit par simple scissiparité. Ce savoir enfin ne peut ni présenter ou représenter sa propre fin ni justifier aucune fin ni du sujet ni de l'étant en son altérité. La communauté de savoir implique une communauté de destin en soi aveugle : l'existence est une aventure commune de l'homme et de l'étant en tant que l'homme est étant. Et que l'étant est humain au même titre qu'il est animal, végétal ou minéral. Le fait que nous-mêmes, les humains, possédions à la fois toutes ces déterminations montre bien que nous ne sommes pas un "être" transcendant le reste de l'étant. Au contraire, il est plutôt à soupçonner que cette ambivalence générique se retrouve dans la plupart des autres "êtres" qui constituent l'étant.
DU STATUT DE L'ETRE
L'être n'est à priori rien d'autre que l'infinitif du verbe dont le participe est l'étant. En tant qu'infinitif il indique un universel dans la mesure où l'action qu'il implique n'est ni singulière ni particulière. Cette universalité est seulement dans la mesure où rien de l'étant ne lui échappe : tout l'étant, ou bien encore tous les étants, participe(nt) de l'être. Mais l'être n'est pas saisissable dans une infinité temporelle, il ne caractérise jamais qu'une action présente. Le présent agit par l'être.
Car l'être est action. D'où il résulte que la forme passive n'existe jamais et nulle part. Pourtant la grammaire et les représentations courantes font état de formes passives et de formes actives. C'est précisément parce qu'il s'agit de formes et non de substances. Or les formes sont de l'ordre de la représentation, c'est à dire des synthèses opérées par la conscience dans sa relation à l'étant. Dans la conscience, l'étant est forme, c'est pourquoi la représentation du langage laisse une place pour ainsi dire vide à une forme particulière qui s'appelle l'infinitif. L'infinitif est une forme vide car pour l'ensemble des verbes l'infinitif est pure abstraction, il n'existe que comme forme verbale destinée à formaliser la construction grammaticale et linguistique, mais n'a aucun autre usage. Sa transformation en substantif est également à considérer comme une formalisation instrumentale de la conscience. C'est justement cette opération qui a provoqué un profond malentendu sur l'être, en le projetant dans la logique objectale. Si on entendait aujourd'hui le mot être comme un simple infinitif verbal au lieu de le prendre pour un substantif, on ne pourrait pas confondre le concept avec des objets comme dieu, la nature, la réalité etc...
L'être est donc l'action de ce qui est perçu comme étant. Le fait que le verbe s'applique à toute chose et à tout être montre l'étant dans la pluralité de ses actes. "Je suis" signifie qu'il existe un étant "je" qui détermine un aspect de l'action de l'être de l'étant. L'étant devient ainsi la somme de tous les aspects de l'action de l'être. Pour mieux comprendre la transitivité de l'être, il faudrait user du terme théologique et juridique de "ester". Dieu este, j'este en justice, ces expressions illustrent la coincidence entre être et agir.
Répétons : l'étant en tant que tel ne peut pas exister parce que le temps ne peut pas s'arrêter pour offrir à l'être une configuration stable. Lorsqu'on dit "l'étant", en désignant la réalité qui nous entoure, on montre en vérité la participation à l'être de ce que l'on perçoit , mais en aucun cas un objet susceptible de devenir une constante de l'expérience. L'être pourrait être métaphorisé sous l'idée d'un tremblement de l'étant, ce qui exclut de facto le participe présent "étant". Et même lorsque le participe présent étant sert de copule entre un sujet et un attribut, il reste dans la même et fausse approximation à cause du changement qu'imprime nécessairement le temps dans la relation.
L'être ne contient en lui-même aucun mystère méthodologique, c'est à dire qu'il n'offre aucune difficulté logique de compréhension quant à son essence dans les constructions possibles de la langue. L'être est d'une parfaite banalité, il n'est qu'un avatar grammatical de la présence. La grande question est de savoir qui de l'être ou de la présence est antérieur à l'autre.
DU STATUT DE LA PRESENCE
Dans l'histoire des idées, il semble que l'être a toujours eu l'antériorité sur la présence. Il faudra attendre le dix-neuvième et le vingtième siècles pour que la situation théorique s'inverse. Depuis l'Antiquité, la substantivation de l'être, notamment par la théologie, a considérablement faussé le débat, au point de provoquer un recul des pensées qui avaient été le plus loin dans le débat sur la présence. Déjà au Moyen-Age, la présence avait opéré une percée vite colmatée par la Renaissance classificatrice. Si on se souvient que l'Antiquité avait déjà tout pressenti, y compris la singularité phénoménale, il revient au Moyen-Age précoce d'insister avec vigueur sur la singularité comme caractéristique fondamentale des phénomènes. Cette caractéristique repousse l'être dans l'univers de l'abstraction. Or, la singularité des phénomènes ne peut pas se concevoir hors de la présence. Détachés de la présence, lorsqu'ils passent par exemple dans la représentation, les phénomènes perdent leur singularité en se chargeant des universaux implicites au langage, langage externe ou interne, celui des graphes et des phonèmes ou celui de l'imagination et de la mémoire. La singularité est le cordon ombilical qui relie présence et langage de même qu'en logique pure elle relie le particulier à l'universel.
La conséquence du constant retour de l'être sur le devant de la scène est la disqualification de la présence comme concept. En résumé, la tradition retombe toujours dans l'équation : présence = apparence. Il se produit alors l'illusion d'une double réalité. La première, la présence (ou l'apparence), serait soumise au temps et à ses "vicissitudes". L'autre partie aurait le privilège de bénéficier d'un statut d'intemporalité. Or, la conceptualité ne saurait, selon l'imaginaire commun, se mouvoir dans le milieu mouvant du temps. Le langage aurait besoin d'une terre ferme où s'ancrent les catégories et les concepts, fermeté sans laquelle la systématisation des séquences sémantiques s'avèreraient impossible. La recherche de la vérité serait définitivement compromise.
La lutte que se livrent présence et être décide depuis toujours de la validité de l'idée de vérité elle-même. Le dernier épisode du retour sur scène de la présence comme concept ne s'en est pas pris, cette fois à la vérité en tant que concept opératoire, mais en a modifié considérablement la nature. L'empirisme avait définitivement écarté la vérité comme objet d'intérêt philosophique, précisément sur fond de l'instabilité empirique. En fait, ce rejet montre que les empiristes partaient du même point de vue sur la vérité et lui confèraient la même valeur que les idéalistes. Cette valeur c'est la permanence et la pureté de la fonctionnalité technique de la vérité dans l'évolution des chaines sémantiques. Avec le retour de la présence, on ne parle plus d'une telle fonction de la vérité. Elle n'a plus pour vocation l'auto-production de sa valeur en systèmes mais sa simple performance dans le temps. La vérité aléthéique, celle du dévoilement de l'étant en tant qu'étant, se contente d'attribuer son degré d'authenticité à la relation esthétique, au sens de l'aisthésis, terme grec destiné à signifier l'ensemble sensitivo-perceptif.
Cette authenticité réside essentiellement dans l'assomption de la singularité. Espace et temps ne sont jamais des cadres ni des synthèses aprioriques, des sortes d'écrans sur lesquelles se dérouleraient seulement des images de l'être, mais la matière elle-même de la relation esthétique. Dans cette relation, la singularité est le grain du temps, son atome ou sa texture intime et elle-même changeante : le temps n'est ni cadre vide, ni absolu homogène, il est destin. Assumer la singularité c'est donc suivre au plus près le sens du destiné, sa direction et son "aventure". En un mot : le temps n'a pas d'âge.
Si le temps n'a pas d'âge, la présence renferme l'éternité, ou bien, l'éternité est une composante de la présence. De même pour l'espace, qui n'a pas de cadre. Sans cadre, l'espace expose directement l'infini, il n'est rien d'autre que l'infini
La présence renferme donc tout : l'origine et la fin. Pour comprendre simplement cet état des choses, il faudrait imaginer la réalité comme une sorte de sphère parfaite, celle-là même, peut-être, que Platon fictionne dans le Timée. L'origine n'est plus, dès lors, une sorte de point de départ temporel fixé lors de la "création divine", mais tout simplement le centre de cette sphère. La fin, elle, ne serait jamais que la rectitude ou l'harmonie des mouvements d'aller et venue entre la surface et le centre. Les images d'un univers en expansion ou au contraire en contraction sont les images mêmes de la science aux prises avec un mouvement transcendantal dont elle ne perçoit que les équations : jamais, nulle part, aucun de ces mouvements n'a pu être observé, et quand bien même le serait-il, qu'il ne refleterait jamais que l'intérieur d'un champ perceptif lui-même transcendantal. Les mouvements observés seraient en quelque sorte les doubles du véritable mouvement enraciné dans le centre.
Ainsi le temps, plutôt que d'être ligne droite, est cercle. L'enjeu de cette forme est absolu : il ne souffre ni avance ni retard, il fonde et défait ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une histoire, hier comme une mythologie. Les formes qui s'illustrent à la surface de la sphère sont le produit d'un jeu supérieur : progrès technique, progrès humain, progrès philosophique, ces changements apparents ne sont jamais que la reconstitution permanente du présent sous des envois différents du centre qui ne choisit lui-même qu'à partir de la logique qui se construit dans les allers et venues de la surface. L'idée de construction peut prêter à confusion, il vaudrait mieux dire effectuation de la logique sphérique du réel.
LE CENTRE DE LA PRESENCE
L'image de la sphère doit être prise pour ce qu'elle est, une image. Quand on dit "la sphère du réel", comme on dirait la sphère de l'économie, on se rapproche de cette symbolique. Il en va donc de même pour son centre. Comme il n'est pas question ici de fictionner quoi que ce soit, ni de manière métaphysique - c'est à dire onto-théïologique - ni purement religieuse, ni mythologique; les images de sphère et de centre sont à prendre en tant que métaphore pure, une métaphore qui englobe le concept d'immanence.
La conscience ici, est conçue comme l'auto-affection perceptive, affective et morale du centre. Pour élargir la métaphore (ou l'exténuer) on pourrait dire que la circulation de ce centre, qui "est partout et nulle part", trace l'individuation spatiale de son propre parcours : nos conscience individuelles sont les pointillés du trajet fictif de ce centre, le temps en est la vitesse de rotation.
La métaphore exagère ici à dessein. Non pas de systématiser une "vision" de l'être ou de l'immanence, ou encore moins de son "fonctionnement". Elle doit permettre simplement de tenter de concevoir quelque chose comme un retournement "en doigt de gant" d'une réalité dont l'opacité libère une surpuissance de l'objet. La nuit du réel - c'est à dire tout le message de la métaphysique - "envoie" des matrices techniques qui renforcent l'apparence de lisibilité de la substance et durcissent en même temps son caractère énigmatique et dénué de sens.
Le centre de la sphère est donc l'idée d'un pivot du réel ou d'une réalité absolue qui rayonne infiniment vers la surface considérée comme "apparence".
Or cette apparence ne saurait être conçue comme une sorte de reflet déformé des mouvements de ce rayonnement parce qu'il n'y a pas de dichotomie impliquant une relation d'objet avec elle : l'apparence est bien un texte, mais un texte qui n'est pas à lire, un texte qui est textuellement à être. Lire dans le grand livre de la Nature, c'est comprendre que tout étant est symbole, ou si l'on préfère lettre d'un alphabet. Les alphabets sont en eux-mêmes de purs symboles de la lisibilité réelle de l'être même si cette lisibilité échappe absolument à toute formalisation ou saisie scientifique. Or cette lisibilité est contemplativité pure. Elle échappe à toutes les formalisations scientifiques et à toutes les caractérisations mathématiques de l'étant, qui ne sont, à leur tour, que des formes d'alphabet, c'est à dire des indices ou des preuves symboliques de la lisibilité de l'être. La lecture qui dérive de cette lisibilité est l' auto-effectuation de l'être parce que nous ne pouvons pas imaginer un autre sens de notre situation dans l'étant. Retour donc à la contemplation comme degré supérieur de toute dialectique.
La position du centre s'avère donc par un alphabet lisible à des degrés divers et dont la lecture, ne l'oublions pas, ne peut pas être objectale, c'est à dire qu'il est impossible de lire quelque chose comme une vérité du centre puisque nous appartenons constitutionnellement à l'être et à l'effectuation du centre. Nous sommes sa vérité dans et par notre vérification de l'être.
|

|
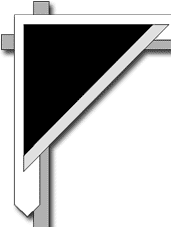


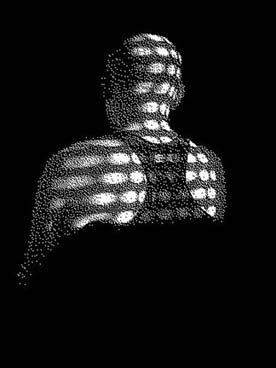
![]()