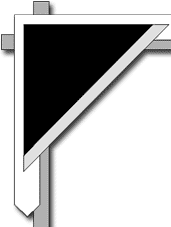
|


 ESSAI D'ANTHROPOLOGIE POETIQUE
ESSAI D'ANTHROPOLOGIE POETIQUE
|
NEOLITHIQUE : TERMINUS
La naissance de l'agriculture demeure le mystère le plus tenace de l'histoire. Un peu comme cette autre inconnue que reste encore la division cellulaire, le néolithique et les transformations qui le caractérisent ne se laissent pas saisir, comme si c'était là que se jouaient les épisodes les plus graves du déroulement du temps humain. La phylogenèse contient les mêmes mystères que l'ontogenèse, les mêmes articulations qui ne se laissent éclairer ni par la science, ni par la philosophie. Il ne reste que la poésie, l'imaginaire aventureux, fille et fils de l'expérience directe de l'homme, sédiment onirique présent dans les mythologies, mais aussi dans les grandes philosophies. On ne peut que spéculer sur la base fragile de ce qui a mûri en soi comme vision historique, nourrie ici et là des grands documents et des non moins fragiles certitudes offertes par la science historique elle-même. On peut aussi faire appel au sentiment, aligner notre rapport esthétique au monde avec les événements qui l'ont marqué et introduit dans sa forme actuelle. Marx avait deviné que l'histoire se déroule selon des vases communicants cumulatifs qui préservent dans le présent toutes les formes que ce monde a traversées. Le néolithique vit encore aujourd'hui quelque part dans notre sensibilité, dans notre goût, dans notre inconscient personnel et collectif.
Ainsi, se révèle-t-il aujourd'hui que notre rapport à l'agriculture revient au centre de nos préoccupations, de nouveaux choix à son propos sont en gestation qui semblent devoir revêtir une importance au moins égale à celle de la découverte de la reproduction contrôlée des céréales en Mésopotamie, il y a de cela environ sept mille ans. Un vaste reclassement des terres productrices et des terres stériles a commencé qui ne suit pas seulement les lois du marché, aujourd'hui on s'attaque même au cœur de l'invention néolithique, à savoir la force de reproduction des végétaux comestibles et leurs qualités génétiques. En fait, tout se présente comme si, ici, se préparait un retour situationnel de nouveaux choix à accomplir, les mêmes en importance que ceux que firent les hommes qui décidèrent de créer des greniers pour la soudure de l'hiver.
Cet événement, vieux d'environ six à sept mille ans, eu pour conséquence le monde actuel, le présent de la planète qui est notre abri, mais qui est aussi devenu par notre action, le sujet de nos pires inquiétudes. Car depuis l'époque où l'être humain s'est mis à retourner cette terre pour la rendre productive, il lui a conféré un destin propre, une altérité vénéneuse dont il doit désormais se méfier autant que des pénuries qui perlaient son destin au gré des hasards de ses voyages. Marées noires et tempêtes non répertoriées le montrent alors qu'on est en train de s'efforcer d'oublier que le danger nucléaire reste suspendu sur nos têtes. F. Engels s'est interrogé en vain sur la naissance de l'agriculture, sur sa causalité pratique, car le matérialisme dialectique lui-même achoppe sur cette question. Il y a une véritable solution de continuité entre l'avant et l'après de ce choix humain et personne n'a encore donné l'explication satisfaisante de ce coup de barre à cent quatre-vingt degrés donné au destin humain par quelques mystérieux inconnus. On peut spéculer sur toutes sortes de causes dites naturelles, dire qu'il s'agit de l'aboutissement d'évolutions biologiques, de transformations anatomiques qui auraient pour ainsi dire contraint les hommes à abandonner le régime de l'autarcie animale, à cesser de parcourir le monde pour en épuiser les ressources avant de les laisser se reconstituer pour y revenir plus tard. Cette attitude n'a d'ailleurs pas totalement disparue de la surface de la terre, car certains peuples continuent de vivre de chasse et de cueillette sans songer au calendrier des saisons. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas leur calendrier, celui des parcours de leur espace, espace qui, comme en Amazonie, se réduit de jour en jour en peau de chagrin.
La seule certitude sur ce qui s'est passé en Mésopotamie, et ailleurs dans le monde en une non-moins mystérieuse synchronie, c'est ce qu'on peut déduire du phénomène lui-même : l'homme a dû s'arrêter pour pratiquer la première agriculture. S'arrêter ne signifie pas seulement installer un campement dans une clairière pour défricher, planter et récolter, car on sait que cela s'est pratiqué de tout temps. De tout temps, comme c'est encore le cas aujourd'hui dans les Iles de la Sonde ou dans les profondeurs des forêts de la Papouasie, les hommes on su construire des campements pour la saison, ravager l'espace environnant, puis repartir selon une logique et un savoir sans doute aussi scientifiques que les nôtres. Le grand changement, la révolution néolithique c'est tout autre chose, c'est le terminus de ce long voyage, de ces déplacements sans doute cycliques mais dont nous ne connaissons pas très précisément les rythmes, même si les préhistoriens en maîtrisent assez bien les itinéraires classiques. Au fond ils ne diffèrent pas de beaucoup de la dernière forme de nomadisme, bien connue celle-là, celle des Touaregs, à la différence près que les nomades du désert se sont très tôt spécialisés dans le commerce et la guerre. Or cet arrêt, dont le mythe du jardin d'Eden retrace sans doute l'idée et l'utopie fondatrices, aura été total, voire totalitaire, et ce qu'il s'agit ici de comprendre, c'est moins le comment que le pourquoi.
Car cet arrêt dans les plaines juteuses de la Mésopotamie, mais aussi déjà dans le delta du Nil, en Amérique Centrale, en Indonésie ou en Chine, ne s'explique ni par une menace spécifique de catastrophes naturelles, ni par un comportement humain devenu subitement agressif, rendant précaire du jour au lendemain les campements habituels. Les villes de pierre et de brique ne surgissent ni sur fond de pénurie, bien au contraire, ni sur fond de crise politique, pour la bonne raison que le politique n'existe pas encore. Du haut de sa cité grecque, Aristote a beau jeu de naturaliser le politique en le faisant dériver de la famille, il ne pouvait guère se voir contredire dans une société ou le génos, la famille tribale, continuait de former la base essentielle de la société grecque, et ce malgré l'établissement des formes politiques qui ont fait la grandeur et la gloire de l'Hellade. Il n'en demeure pas moins qu'en posant la première pierre de ces habitations toutes nouvelles, l'homme a donné le branle à une évolution qui allait s'achever dans la déroute complète de la famille, même réduite à ses éléments les plus substantiels, le couple. Si Aristote pouvait être le témoin de notre époque, il serait contraint de réviser de fond en comble ses théories politiques, sociologiques et morales, seulement parce que la naturalité de la famille a cessé d'exercer ses prérogatives sur la réalité sociale.
Il manquait à Aristote la connaissance exacte de la révolution qui avait eu lieu quelque quatre mille ans avant lui, et sans doute l'agriculture n'a-t-elle jamais été autre chose dans son esprit que l'une des formes de cette alliance entre la physis et la teknè, ce que la nature produit sous la conduite de la main humaine. Mais dans la naïveté anhistorique et largement mythologique encore, aucun âge d'or ni d'argent aurait pu alors se concevoir sans une agriculture aussi éternelle que le soleil. Or, l'arraisonnement de la terre, pour reprendre un terme de Martin Heidegger, avait constitué cela même qui naturalisa la terre, qui produisit le doublet si célèbre de physis et teknè. Il faut donc arriver à imaginer cette réalité dans laquelle il n'y a pas de Nature et pas de Technique, où hommes, animaux et végétaux sont le même, une substance commune, ce qu'illustre parfaitement le mythe de la bonne entente entre tous ces êtres vivants dans le Paradis de la Genèse. Dans cet Eden, l'homme et sa réalité sont physis, ils forment l'UN, un ordre divin naturel. Il faudra ensuite fabriquer le tissu pour couvrir la nudité des corps, mais cela aura lieu après la condamnation divine au travail agricole, après l'invention de la culture des céréales. L'arbre de la connaissance a donné ses premiers fruits dans les plaines de l'Euphrate et du Tigre et dans celle de la Bekaa, les premiers épis d'orge et d'épeautre.
Pour faire tout cela, les hommes du quatrième millénaire avaient dû, pour le moins, prendre une décision capitale, celle de s'arrêter là, dans ce jardin réputé pour l'abondance de son eau, la qualité de ses terres et la facilité avec laquelle la terre se laisserait précisément arraisonner en douceur. Pendant combien de millénaires avaient-ils dû tourner autour de cet espace prodigieux avant de s'asseoir en disant STOP, on ne le saura jamais. Ce que ces hommes avaient dans l'esprit à ce moment-là me paraît bien plus important que l'invention proprement dite de la technique agricole. Peut-être faudra-t-il penser un jour la succession des faits non pas en partant de la découverte de cette technique, mais à partit du désir de s'arrêter et on admettra alors que le savoir technique n'est que l'accomplissement du désir et en aucun cas sa cause. Nous voulons nous arrêter de parcourir le monde, il faut donc que nous domestiquions la terre et ce qu'elle produit librement le long de nos pistes de nomades. Après tout, on peut légitimement se demander si l'invention des techniques agricoles a été un si grand événement, ou bien si elles n'étaient pas déjà largement connues, empiriquement acquises tout au long d'une expérience de plusieurs millions d'années, faisant l'affaire au moment où certaines tribus ou certains clans ont pris la décision fondamentale de fonder un lieu de vie permanent.
L'histoire de la technique en Chine impériale montre fort bien qu'un savoir-faire n'est pas forcément mis en œuvre et exploité dans la dimension qu'il permet d'emblée, et parfois même pas du tout, parce qu'il ne converge pas avec d'autres nécessités, poétique, spirituelle ou religieuses. Le Talmud et la longue liste des centaines de lois judaïques devraient assez bien illustrer les rapports entre teknè et liberté dans l'histoire humaine. Car le vrai mystère est bien là, dans la décision de s'arrêter au milieu de l'espace libre, de dire un beau jour en regardant la clairière ou l'oasis, voici le lieu où je veux mourir, voici le lieu qui recèle une telle perfection que je veux lui consacrer mon aventure, mon existence, mon destin, le tout de mon être passé, présent et à venir.
Voilà l'enjeu réel, et non pas la triviale pensée de "vivre mieux", "plus longtemps" ou d'entreprendre je ne sais quelle quête magique de la jouissance ou de la vérité. Pensez - y, à ce citoyen de nulle part, dont l'existence était entièrement faite de mouvement, peut-être de cercles qui avec le temps se sont rétrécis pour devenir les fondements des Palais et des cités. Les mystérieuses connaissances astronomiques de ces hommes qui venaient à peine de poser leur bagage ne sont pas un miracle, ils étaient tous des navigateurs, des animaux migrants, pour qui l'espace résidait autant dans le cerveau que dans la réalité extérieure : cet homme ne connaissait-il pas tout de l'intérieur, à l'instar de ce que les Grecs, selon Heidegger, appelaient matémata, ce que l'homme connaît toujours déjà avant toute expérience ? Matemata qui devaient évidemment devenir nos mathématiques modernes.
Ce choix de l'immobile, c'est donc celui d'une posture dont nous ne pouvons que difficilement imaginer la nature, sinon peut-être en se reportant à nos propres alternatives, aux choix qui nous incombent aujourd'hui sans que nous ne nous en rendions toujours compte. Nous verrons cela plus loin. Pour le moment, essayons de développer cette question du passage à l'immobile dans toutes les régions de l'existence où ce fait d'interrompre la pérégrination doit nécessairement produire des effets que nous avons oubliés et en vérité fonder une toute nouvelle réalité. La nouveauté de cette réalité nous demeure masquée par toutes les idées qui tournent autour de l'évolution, évolution qui semble d'ailleurs prendre le relais du mouvement réel : l'homme se connaît soudain comme évoluant, comme se mouvant dans le temps, alors qu'il vient d'arracher par des souffrances sans nom l'immobilité pour son être-là, son destin et sa mort. Reprenons : l'homme s'arrête dans l'espace, et au moment où il croit avoir réussi à intégrer son destin dans des coordonnées spatiales définitives, on lui apprend que c'est son être qui bouge, qui évolue selon des lois implacables, des lois qui l'effraient tant qu'il se met en quête de ce qui pourrait lui donner le pouvoir de diriger cette évolution, de reprendre son ancienne navigation, mais cette fois-ci pour son être lui-même. La science génétique et sa découverte semblent avoir replacé l'homme devant un dilemme qui ressemble à celui qui l'a saisi devant les plaines de Mésopotamie ou des vallées du Sze Shuan, il y a de cela quelques millénaires.
Nos connaissances actuelles de cet événement du néolithique nous indique un autre mystère, celui de son caractère synchronique à travers le monde. Le miracle mésopotamien se déroulait en même temps aux quatre coins du monde, comme si les nomades d'alors possédaient déjà un pouvoir de communication dont nous ignorons absolument tout. Maintenant si on compare ces nomades à nos migrants d'aujourd'hui, oiseaux, insectes ou sans papiers, on peut lever un coin du voile sur ce miracle. Nous nous gargarisons un peu vite à propos de facultés mondialistes, de notre réseau de communication en temps réel et autre fadaises. Et il n'est pas impossible de postuler que les nomades d'avant l'agriculture possédaient des pouvoirs de communication dont nous ne savons rien, comme nous ne savons pas grand chose sur les navigations transocéaniques de ces époques-là. La lecture de Mardi, le roman de Herman Melville, donne une idée assez poétique mais très réaliste sur ces possibles pérégrinations marines, sans vapeur, sans moteur à explosion et sans énergie nucléaire. Jünger souligne quelque part le côté plouc, prétentieux et disgracieux de cette technique qui ne respecte rien que la futilité de sa propre conception. On pourrait donc rêver à une réalité préhistorique qui contredirait radicalement ce que nous pensons aujourd'hui à son sujet, ceci : les hommes nomades disposaient non seulement de liens réels d'un bout à l'autre du monde, ce qui est sans doute certain d'après les derniers travaux, mais qu'ils étaient en mesure, et cela est de loin le plus incroyable, de dialoguer et de se concerter sur une décision aussi importante que celle d'interrompre et de transformer une praxis commune aussi universelle alors que la politique aujourd'hui. C'est dire si cette décision, ce choix décisif pour des millénaires n'aura pas du tout ressemblé à cet événement hasardeux que nous nous imaginons aujourd'hui à travers les mythes qui en ont immédiatement découlé et qui forment le fond d'un discours d'autant plus stupide que, face aux difficultés de la sédentarisation, les architectes de cette épopée se sont cru obligés de conférer la responsabilité de ses difficultés à des dieux. Nietzsche est un des rares à avoir compris le rôle réel des prêtres, confrontés à la médiocrité des peuples. Il pensait à juste titre que ces prêtres se sont cru obligés de simplifier les problèmes liés aux conséquences de la fondation des cités et de raconter des histoires parfaitement mensongères pour pouvoir imposer ce qui se profilait désormais comme le vivre ensemble, comme la naissance du social et du politique. Mais le philosophe allemand oubliait un détail ou manqua d'une intuition tant il était fasciné par la propre médiocrité de sa société, c'est que la médiocrité des peuples antiques n'était rien d'autre que celle à laquelle étaient condamnés ces apprentis d'un tout nouveau mode d'exister. Un mode d'exister qui allait produire des conséquences dont les prêtres eux-mêmes n'avaient sans doute qu'une faible conscience.
Rêvons. L'homme d'avant, le bon ou le mauvais sauvage de Rousseau ou de Hobbes, allonge le pas sur la piste que lui seul perçoit entre les arbres. Il n'est ni dans l'aller, ni dans le retour. Le poème de Hölderlin, rentrant de Bordeaux dans sa Souabe natale, n'aurait pu ni se penser ni s'écrire. Mais cela confirme, en réalité, que cet homme marchant, est d'emblée installé dans le poème de Hölderlin, il performe le poème, au sens de ce que nous appelons aujourd'hui les "performances artistiques". Et il réalise cette performance en permanence, jamais ne cherche de ponctuation dont le sens ne sera rien d'autre que la fin ou la mort de l'expérience. L'extase de Hölderlin donna lieu à ces poèmes patriotiques que Guillaume II et Hitler firent ajouter au paquetage des soldats des deux guerres mondiales. L'extase du nomade n'a aucune chance de finir dans les sacs à dos des soldats parce qu'aucun retour n'est prescrit, aucune patrie à défendre au prix du sang. Cet homme-là est le "poète aux semelles de vent", une sorte de Rimbaud, le poète qui n'écrivit que tant qu'il resta collé à la glèbe de son Ardennes natale. Mais Rimbaud s'arrachera de toutes les manières possibles à la position statique du sédentaire, ce qui est remarquable c'est qu'il le fit par le poème bien avant d'y lancer son être tout entier. Cela peut prouver qu'il n'est pas si absurde de poétiser la vérité, de rêver cette science historique si impuissante à théoriser le tout du passé. Tout juste parvient-elle à donner un semblant de cohérence à tout ce qui est venu après la révolution néolithique. Au fond, l'histoire reste encore entièrement à faire, si tant est que sans hypothèse plus plausible que la réalisation du Livre, les documents ne suffiront jamais, et pour cause, à rendre compte d'une histoire qui nous concerne et nous serve à quelque chose.
GENESE
Et puis un jour pas comme les autres, juste après que le soleil surgissant des cimes l'aie sorti de son rêve nocturne, l'homme aux pieds usés, regarde autour de lui comme pour la première fois. Il contemple les troncs immobiles de vieux chênes barbus disséminés dans une futaie couverte de fougères, les couleurs du monde ont changé, le vacarme de la forêt n'est plus le même, au-dessus de lui le ciel a pivoté, son bleu découpe un espace qu'il n'avait jamais vu, ni en courant dans la toundra, ni en chassant le bison dans la savane. Il voit, il est ému, il entend le monde lui murmurer quelque chose, le monde s'est mis à parler : " arrête, reste ici, ne va pas plus loin, construis, marie les pierres et le bois, pour vivre tu feras une partie de mon travail, tu élèveras le blé et les bêtes, en échange je te donnerai le repos toutes les semaines, tu apprendras à vivre les saisons telles que je te les donne ici, tu pourras faire des récoltes et les conserver pour passer d'une saison à l'autre, et même en travaillant tu pourras me contempler, me poser des questions, nous parlerons tous les deux pendant les milliers de siècles qui viennent, tu ne seras plus jamais seul car tu élèveras aussi tes enfants, tu auras des compagnes et non plus des femelles, tu auras des voisins et vous vivrez ensemble, vous vous constituerez en clans puis en tribus et puis peut-être qu'un jour vous vous rassemblerez en peuples, l'unité fait la force, homme, brisez dès aujourd'hui les chaînes du hasard et du risque", et ainsi de suite. Mais le dernier mot fut le plus surprenant - "Nous apprendrons à nous connaître et, un jour peut-être, nous ferons alliance pour l'éternité et pour l'infini, pour ce que tu ne connais pas encore, le temps et l'espace, ces deux éléments que tu parcours depuis si longtemps sans même savoir qu'ils existent et te veulent du bien. Reste assis, ne pars jamais plus d'ici et même si de terribles épreuves t'attendent, sois patient, moi je te rêve comme mon ami, tu dois le devenir, sinon ton espèce périra comme toutes les autres, et je resterai seul pour l'éternité".
En réalité, l'homme de la clairière avait parlé en son for intérieur, il avait entendu une autre voix dans son cœur. Les paroles rares et frustes qui réglaient sa vie antérieure s'étaient à présent arrondies, et se bousculaient dans son thorax cherchant l'instrument qui leur donnera leur perfection. Elles avaient fleuri dans le terreau de ses soucis, car tout ça, le temps, l'espace, l'infini et l'éternel lui rongeaient l'âme depuis longtemps, depuis des années il sentait le besoin de nommer ces mystères dont il avait perçu qu'ils rythmaient son existence, et les mots en gestation, ce jour-là, ont surgi dans leur première vérité, la clairière et ses chênes.
Cette mise en scène anthropo-mythologique a un petit air de ridicule, elle reflète cependant fidèlement nos mythes actuels, dont celui du sens qui domine aujourd'hui les discours les plus respectés même s'ils sont encore bien loin de la vérité, tant il est encore trop tôt pour que le sens deviennent la loi et la justice des temps futurs, tant il est encore trop tôt pour que le concept soit parvenu au bout de son chemin dans une humanité qui vient à peine d'apprendre à parler. Elle bouscule aussi quelques lieux communs pseudo scientifiques et pseudo anthropologiques. Le darwinisme avait échoué sur un point majeur, celui qui consistait à certifier la spécificité de l'être humain pour ne pas dire sa légitime supériorité. L'homme dont la tradition culturelle des dix-huit et dix-neuvième Siècles avaient fini par tracer le profil, n'est pas plus homme que les animaux domestiques qui l'accompagnent, on connaît le jeu de mot de Lacan sur "d'hommestiques". Pourquoi cela ? Sans doute faut-il avant tout se référer à cette manie de tout expliquer par les causes les plus triviales : l'une des contradictions les plus flagrantes de Karl Marx est cet écart béant entre d'une part la description d'une société du besoin, entée en automatique sur une évolution du mode de production, et d'autre part les intuitions utopiques qu'il tente lorsqu'il parle du désir humain, affirmant en substance que l'homme se forge lui-même en forgeant son histoire selon sa volonté et son désir. Adversaires et disciples n'auront jamais retenu de cela que le versant sombre de l'inconscient collectif du ventre, l'économie, cette idéologie qui aujourd'hui imprègne tout discours et se tient en retrait de toute pensée, prête à la gazer.
Soyons plus précis. Commençons, pour donner un début à toute analyse historique ou anthropologique, par abandonner notre arrogance culturelle, une arrogance qui ne fait que trahir notre peur de ne pas "aller mieux", de ne pas "être mieux" que nos ancêtres, de n'avoir pas, en réalité, raflé la mise de ce progrès fantasmatique qui nous permet de dormir tranquille, tout futur anesthésié, toute mort engourdie derrière nos cartes de menus quotidiennes. Une telle condition intellectuelle pour avancer n'est ni simple, ni facile à concevoir, ni surtout à admettre. L'humilité et le silence a toujours été l'apanage des peuples conquérants, condition absolue de la victoire : pour cette raison simple, c'est qu'il fallait entrevoir en permanence l'idée de disparaître du jeu, de mourir au combat, de laisser d'autres semblables jouir des fruits de la victoire, et tout cela sans arrière-pensée, avec une sorte de satisfaction sacrée et lucide d'être totalement associé à la jouissance de cette étrange chose qu'était devenue la horde ou la patrie. Ce phénomène n'a, à ma connaissance, jamais fourni beaucoup de dissertations, et pourtant personne ne peut nier que cette action auto-sacrificielle recèle un profond mystère. Elle nous interroge au plus profond de nous-mêmes, tant l'incrédulité est ce qui domine ici : bien sûr, on peut toujours démythifier nos bons Plutarque, nos chers Tite-Live et autres Thucydide. On peut toujours les accuser de prolonger les homérades en langage pseudo scientifique, mais à les lire avec beaucoup d'attention, ce scepticisme ne tient pas. En fait, il n'est pas nécessaire de faire ce travail d'Hercule, il n'est pas nécessaire d'analyser longuement des textes anciens, il suffit de retourner un demi-siècle en arrière et se souvenir des plages de Normandie et des dunes de Libye. Les cinéastes qui, de nos jours, tentent de mettre ces journées héroïques en scène, ne savent pas comment naturaliser l'action, lui donner assez de réalisme pour tempérer la valeur et la grandeur de ces hommes. Comment, après les avoir vu agir dans un enfer que nous pouvons à peine imaginer, pourrions-nous continuer de vivre tranquillement, sachant que nous ne sommes pas ces héros, que notre humanité à nous n'est, en définitive, certifiée par rien d'autre que l'état civil ?
Redoutable question qui surgit à chaque nouvelle génération, et qui aura fait plus pour la civilisation de guerre que n'importe quelle ambition impériale ou régionaliste : regardez la Corse, où le problème est pourtant simple, la société corse ne se rebelle que parce que le monde actuel n'offre plus aucune occasion aux hommes de prendre d'autres gallons que ceux de l'ancienneté. Comment un jeune Bastiais de vingt ans peut-il envisager d'asseoir son existence future de patriarche sans faire un tour dans le combat, sans cette initiation foncière, dans tous les sens du terme, qui lui donnera l'assurance de son être et la légitimité de son avenir. Si on faisait une démographie du terrorisme corse, on trouverait que l'âge des combattants se situe entre Dix-Huit et Trente ans. Passé cet âge on passe dans la classe des Corses confirmés, ce qui explique que le terrorisme corse n'a pas de fin, chaque génération doit y passer et chaque génération apporte des troupes fraîches, qui vont agir sous le regard sourcilleux de leurs prédécesseurs.
Lorsque donc nous aurons fait cet effort de rendre aux hommes du passé leur dignité entière, pas seulement octroyée par un humanisme fallacieux, en se disant qu'ils étaient aussi (sic) des êtres humains. Et au cours de ce chemin, tant qu'à faire, cessons de mythifier même ceux que la tradition retient comme des Barbares, comme les ennemis nés de l'humanité, comme la réalité dont la négation dialectique aurait permis de faire progresser cette humanité qu'au demeurant chacun définit comme il veut et comme il vaut. Radicale condition de toute possibilité de raisonner sur l'histoire : en finir avec l'idée d'un progrès essentiel de la nature de l'homme elle-même. Nulle part l'homme ne s'est amélioré, nulle part l'homme ne s'est transformé ou n'a acquis de nouvelles vertus ou de nouvelles qualités fondamentales. Il faut accepter cette vérité que l'homme n'est qu'une idée, il est une martingale spirituelle sans cesse retravaillée dans un sens nouveau qu'il ignore la plupart du temps, mais son être, dont il n'est pas propriétaire, est un fondement inchangeable. La culture, la tradition et sa préoccupation de transmettre sa nature aux générations futures ne forment que la discipline qu'exige chacune des martingales (certaines se sont voulues millénaires et ont lamentablement échoué, d'autres n'ont pas cherché d'avenir et ont fleuri à travers des siècles). D'ailleurs, si cette éternité de la nature humaine n'était pas vérace, on serait contraint d'admettre que certaines de ces tentatives de former un homme nouveau qui ont tant coûté à l'humanité entière auraient pu faire réellement régresser l'humanité vers une barbarie supposée. Rien de tel n'est jamais arrivé de Tamerlan à Adolf Hitler. Tout ce que l'on peut dire au sujet de ces périodes de barbarie, c'est qu'elles ont appartenu à un jeu plus vaste où la nature humaine a dérivé globalement vers ses limites, mais le noyau de son être a toujours su retrouver son sang-froid et éviter que son action ne les brise. Une telle cassure ne serait, on le sait bien, rien d'autre que la disparition de l'homme, à tort, à raison, par accident ou pour cause d'obsolescence. En ce sens d'ailleurs, l'homme est condamné, comme les jeunes Corses, à l'action qui sans cesse le mène à ses limites, car ces limites sont celles de l'être dont l'homme s'est approprié le langage. Qu'il se prenne un jour à mettre en place le vaste matelas de sa paresse et de sa pusillanimité, il aura tôt fait de se dissoudre dans l'entropie épicurienne de la paix éternelle. La vie n'est rien d'autre que ce moment où il est donné à chaque individu de participer à cette fantastique aventure de l'être dont l'essence est d'être exploré, atteint, décrit, et dépassé dans le risque de la disparition. Que seraient pour nous ces soldats dont le souvenir couvre des hectares de cimetières disséminés à travers le monde, si ce qu'ils nous ont légué n'était pas un surcroît de vie, une nouvelle dimension de notre relation à l'être. Mais attention, ce n'est pas la paix éternelle que ces héros nous offrent aujourd'hui, mais la possibilité de passer à d'autres aventures où il faudra sans doute à nouveau affronter la peur et résoudre son problème avec le même panache.
On dit aujourd'hui, et nous y reviendrons, qu'à peine dissipée la peur de la guerre humaine, l'homme s'est lancé dans une exploitation forcenée de la planète au risque de la détruire, de l'épuiser et surtout de lui ôter pan par pan toutes les qualités qui nous font aimer la vie. C'est donc bel et bien l'amour de la vie qui aujourd'hui est en jeu, ce qui nous oblige à inverser toutes nos visions de l'avenir, toutes nos perspectives afin de ne pas finir comme les lemmings sur les falaises de la Scandinavie, sans même que nous nous soyons aperçus de la trajectoire qui nous y amène déjà. Ne nous réfugions pas derrière la sécurité sociale de l'existence, il n'y en a pas, il n'y a rien d'acquis dans l'histoire de cet animal à nul autre pareil et le travail, cet importun que Hegel définissait prophétiquement comme la seule pensée, est devant nous pour désirer et vouloir ce qui viendra. Cette inquiétude répond en écho à celle de S. Freud dans son opuscule "Malaise dans la Civilisation", où l'inventeur de la psychanalyse montre comment l'histoire est saisie dans un piège : ou bien laisser l'agressivité s'exprimer au risque de faire sauter la planète, ou bien augmenter sans cesse le Surmoi collectif au risque de faire tendre vers zéro notre "ration" de bonheur et de plaisir.
Si nous voulons nous donner une chance de ne pas nous laisser aller à un aléatoire qui ne ferait pas partie des fins dernières de l'être, il faut donc analyser globalement ce qui nous a fait parvenir jusqu'à ce présent et comment nous avons réagi à ce que Heidegger appelle si joliment les "envois de l'Etre". Il faut moins se fatiguer à tenter de comprendre la vérité de ce mystérieux néolithique, que de développer en fonction de notre désir actuel ce qu'il a lancé dans le temps de l'homme et quels étaient les effets escomptés de cette révolution que nous n'avons aucune raison de traiter comme un phénomène bio-physiologique, mais que nous devons traiter avec tout le respect qu'exige une décision humaine qui a tellement bouleversé l'être-là du monde.
CAÏN ET ABEL
Parmi les développements qui devraient naître autour de ce livre qui s'est écrit dans l'urgence, il y a un travail qui mérite particulièrement l'attention parce qu'il constitue pratiquement le paradigme de cette dialectique entre nomadisme et sédentarisme, c'est l'analyse du récit de la Bible, assorti de ses commentaires talmudiques. Nous avions intitulé un chapitre précédant "Genèse". Ce chapitre tentait de fictionner le moment du retournement, l'instant magique où la décision est née chez l'homme de s'asseoir dans la nature, de porter le fer non plus dans les êtres rencontrés au hasard des pérégrinations, mais dans le sol même qu'ils découvrent sous leurs pieds. Le sacrifice d'Abraham raconte exactement ce glissement d'une victime à l'autre. La Genèse c'est d'abord l'invention - la Création - de l'homme et de son univers. Cette création est à entendre évidemment au sens de l'apparition de la dimension humaine que nous connaissons et que nous avons toujours déjà définie, chez un être que nous ne connaissons pas, et c'est aussi la naissance d'un être que nous pouvons désormais comprendre, dont le désir et les valeurs sont approximativement les nôtres. La Bible, dans sa totalité n'est qu'une méditation sur le néolithique, depuis le Jardin d'Eden jusqu'au retour des Juifs en Palestine, elle retrace le double échec des Juifs à réussir ce que leur offrait la Genèse. Le destin des enfants d'Adam est particulièrement clair : de Caïn et d'Abel, c'est Caïn qui obtempère aux ordres de l'envoi de l'être, il s'installe et prend soin du jardin, devient agriculteur pendant que son frère Abel, artiste aux semelles de vent parcours l'espace en chassant sans considération pour la terre et ses fruits. Ce faisant il contrevient explicitement aux ordres divins reçus après la Chute de son père, puisque Adam fut explicitement condamné à l'agriculture. C'est Dieu lui-même qui est à origine du changement de régime existentiel, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas, dans l'esprit des rédacteurs du Livre, d'un événement aléatoire ou d'une évolution lente entre la liberté de parcourir un Jardin et l'obligation de se courber vers la terre pour lui extorquer la nourriture à la sueur de son front.
Or, Dieu aime Abel et non pas celui qui obéit à ses commandements. Ici les choses se compliquent, car le jeu divin est extrêmement retors voire pervers : après avoir poussé Caïn au meurtre de son frère, Dieu l'envoie errer à travers le monde, chercher le fameux refuge qui le soustrairait à son regard courroucé : il contraint au retour au nomadisme celui qui avait obéi à l'injonction originaire. Mais on sait que Caïn persista dans cette volonté d'enraciner l'homme dans l'immobilité terrestre, il construisit les premières cités, il inventa en fait la manière d'assumer le commandement d'entrer en commerce avec le monde de la manière sédentaire. Comment ici interpréter le geste divin ? Geste divin qui est en réalité l'interprétation du scribe, du Juif qui parle pour Dieu, Moïse, celui qui réitérera la tentative de l'Eden en rapatriant son peuple en Palestine, deuxième essai de sédentarisation qui devait connaître le sort que l'on sait, à savoir la diaspora finale, la nomadisation définitive du peuple juif. La diaspora sera vécue comme une condamnation comparable à l'exil de Caïn ou à la captivité à Babylone. Risquons une interprétation, Dieu est en réalité cet œil qui vit le monde pour la première fois dans sa clairière, il représente la conscience naissante, fragile et hésitante entre l'aventure nomade et la finitude confortable mais implacablement exigeante quant à sa structure sociale et politique. On peut voir, dans les destructions successives du Temple de Jérusalem, les échecs de cette mutation, mais aussi son impossibilité radicale, tout simplement parce que le nomadisme n'est pas une posture purement matérielle, mais une dimension réelle de l'esprit qui continuera jusqu'aujourd'hui à commander en secret les choix destinaux de l'humanité. Les Juifs furent les seuls à reconnaître la vanité du choix sédentaire jusqu'au jour où se profila la possibilité du retour en Israël. Mais cette aubaine n'est pas universellement reconnue comme telle par les Juifs, le retour au Grand Israël n'est que la version davidienne du messianisme. Le messianisme de Joseph se tient soigneusement à l'écart d'une pensée une fois de plus engagée dans la confusion entre pulsion de l'installation et tension impérialiste, d'extension nomade. Mais Joseph fut le maître d'œuvre de la cité égyptienne, il fut l'ingénieur de la sédentarité la plus parfaite que l'on connaisse de l'Antiquité, étant entendu que ce n'était ni son pays, ni son peuple.
En résumé, l'épopée du peuple juif représentée dans la Torah constitue un récit historique qui retrace avec une hallucinante exactitude la dialectique, ou le double-bind dans lesquels sont pris les humains depuis le néolithique, le double-bind qui emprisonne une essence nomade dans une volonté sédentaire. Cette dialectique se joue selon ce que j'appelle un "stop and go" historique que l'on retrouve clairement dans le peuple hébraïque, mais également dans une confusion plus difficile à analyser chez tous les peuples du monde. L'errance de Caïn, le fils d'Adam qui avait respecté scrupuleusement l'injonction divine de "trier l'herbe à la sueur de son front", forme le paradoxe qui informe toute l'histoire occidentale. Car c'est dans le mouvement de l'errance qu'il fonde les cités, un trajet qui est aussi bien celui d'Athènes que de Rome que de toutes les grandes capitales mondiales actuelles. Ce qu'on peut relever tout de suite, c'est que les quelques pays privilégiés où la transition s'est avérée plus douce, je pense notamment à l'espace des Celtes, des Gaulois ou des Etrusques, ont tous conservé jusqu'à nos jours un certain bénéfice destinal, une efficacité plus grande qui procède de la cohérence des choix successifs de leurs habitants. On peut voir en réduction des régions frontalières de la France, c'est à dire les zones au contact des invasions et des tensions nomadiques, minées par leurs problèmes identitaires, et déjà militantes pour une radicalisation de leur enracinement local, symptôme d'un manque ancien.
Pour en revenir aux Juifs, ce qui les distingue de tous les autres peuples n'est pas seulement une certaine limpidité dans l'assomption de leur destin divisé entre Caïn et Abel, entre l'instinct de la diaspora, celui de l'assimilation, et aujourd'hui celui du retour davidien dans le Eretz Israël. Les Juifs ont aussi continué d'observer et de commenter le choix initial. L'herméneutique de la Torah n'est pas seulement l'étude d'une interprétation purement religieuse des lois pour ainsi dire les moderniser dans le temps, mais c'est aussi l'observation et l'analyse permanente de leur devenir par rapport au sentiment nomade et à l'injonction sédentaire. En accord avec une certaine vision juive orthodoxe de l'histoire récente, on pourrait aller jusqu'à dire que la Shoah est bien la sanction d'un désordre provenant d'une diaspora s'incrustant en assimilation et perdant ainsi lentement le fil de son commentaire, c'est à dire l'essence même du judaïsme. Celui-ci est aujourd'hui encore notre mythologie vivante, notre Iliade et notre Odyssée qui perpétue froidement l'étude du paradoxe de l'envoi divin. De son côté la philosophie, mais nous y reviendrons plus longuement, tente un commentaire très voisin, mais n'arrive pas à relier, comme le fait le Talmud torah, la dimension ontologique à la vie pratique. Et pour cause, le scénario religieux permet des raccourcis que la philosophie ne peut pas tolérer. La Shoah est donc, comme le soulignent bien des commentateurs philosophiques, une sorte de limite absolue, qui non seulement anéantit pour les Allemands toute possibilité de penser et de poétiser dans leur langue, mais aussi pour les Juifs eux-mêmes la nécessité impérieuse de repenser les choix fondamentaux. En réalité, ils se retrouvent devant l'alternative difficile d'une allia générale, ce qui est impossible, et d'un retour vers les tendances assimilationnistes qui ne sont pas moins négativement connotés par la conséquence que représente la Shoah. Que la Russie, la Pologne, l'Allemagne et la plupart des pays européens soient devenus dès 1945 des déserts de Juifs est un événement saisissant pour ceux qui ont l'âge d'avoir voyagé en Europe dans les années trente, et les plaies ne guérissent que très lentement, constamment rouvertes qu'elles sont par la problématique de l'état d'Israël et de son statut hybride entre Religion et Laïcité.
La Genèse est suivie de l'Exode. L'Exode est la conséquence immédiate de la Genèse. Cela signifie très clairement que la décision d'ancrage dans le sol fut immédiatement suivie par l'échec. Condamnés à la fuite en Egypte, Jahvé donne une seconde chance à son peuple en lui permettant de revenir en Palestine pour y tenter une seconde fois de s'installer dans sa Création pour y aimer leur Dieu dans la paix. Ce Dieu, déjà régional, enjoint à son peuple de conquérir par les armes la Terre Sainte, fantasme passager de l'Eden primordial. Dans cette injonction dont la barbarie paraît terrible dans l'Anathème qu'il prononce contre les Cananéens et tous les autres habitants non-juifs de la Palestine, Dieu trahit la nature finale de cette immigration par l'utilisation de la violence impérialiste. Car cette forme de violence repose sur les bases logiques et pratiques du nomadisme bien qu'elle appartienne en fait à l'histoire de la sédentarisation générale de l'être humain. C'est très complexe, mais l'impérialisme est une extension territoriale qui ne peut avoir lieu que sur la base d'un sol déjà occupé et conquis. On sait que les peuples nomades conquérants, comme les Huns ou les hordes de Tamerlan, n'avaient pas en vue d'Empire, mais un simple pillage de l'espace conquis. Attila n'a jamais conçu de s'installer nulle part ou d'y installer son peuple, son objectif était la pure rapine qu'il faisait rapatrier en Asie centrale. Pas d'impérialisme dans la culture nomade, l'impérialisme est la face cachée de la volonté de s'arrêter, il est comme l'acte manqué d'une civilisation qui se veut stable et garnie d'une clôture. Celui des Juifs revenants d'Egypte est encore une fois une exception, car ils ne viennent de nulle part, ils fuient leurs camps égyptiens. Dieu rejouera pour eux l'injonction de la Genèse, cette fois selon son affinité élective, celle qu'il attribue aux douze tribus d'Israël.
Par ailleurs la violence nomade est sans doute non pas une violence historique résiduelle, comme on a tendance à la représenter dans le discours occidental sur la barbarie - Daudet disant que la civilisation représente "l'état des mœurs d'une société donnée, la barbarie son état antérieur". Elle est bien plutôt dialectiquement liée à la violence systématisée en guerre dans la période de sédentarisation primitive. Elle ressemble à une imitation sui generis de ce qui commence à se jouer aux frontières des espaces encore inviolés par l'idée agraire, les nomades du Caucase ou de la Germanie réagissent à la militarisation impériale et impérialiste sur le modèle des mœurs nomades, à savoir la chasse et la cueillette. Ces deux activités naturelles ne font que substituer au gibier traditionnel un gibier unique, l'homme qui a pris le risque de se définir comme étant de quelque part, décision qui retranche de l'espace libre la surface de ce quelque part. Autrement dit, la barbarie possède une légitimité intrinsèque très forte, plus originaire que l'instinct de civilisation. Plus tard les termes s'inverseront, puisque l'impérialisme ne sera plus défensif, mais offensif. La véritable barbarie n'apparaîtra vraiment que lorsque des nations décideront de voler l'espace d'autres nations, et tout se jouera sur les définitions plus ou moins résistantes des différentes nations. L'exemple de la Chine est sans doute le plus évident, dont toute la politique fut dominée pendant plus de quatre millénaires par la pression des peuples nomades qualifiés de barbares. Le plus étrange, et aussi le plus éclairant, est que la Chine d'aujourd'hui se définit sans doute encore selon ce modèle : un vaste empire entouré de barbares. C'est dire combien nous-mêmes, occidentaux, apparaissons comme des nomades qui ne songent qu'au rapt de l'espace sacré de l'Empereur. En Chine c'est le Dieu-Empereur qui détermine l'essence de l'espace et du temps, toute atteinte au territoire est donc une atteinte directe à la personne divine, à tel point que bien des dynasties sont tombées par pure naïveté, laissant leur territoire se couvrir de hordes ennemies parce qu'ils pensaient que c'était impossible. La dualité nomade / sédentaire se dédoublera au cours de l'histoire selon la qualité du territoire : le modèle féodal donnera la souveraineté corporelle, ce qu'on entend sous l'expression le Corps du Roi, et dont la logique n'est pas strictement territoriale, mais avant tout personnelle. Cette forme ne connaît pas l'irrédentisme parce que les oppositions sont toujours des oppositions de personnes et non pas des oppositions de territoires. Dans l'Alsace du dix-septième siècle, le Roi Louis pouvait bien asseoir son autorité sans toucher à des enclaves allemandes ou suisses représentées par des nobles sans nationalité réelle. La naissance du concept de souveraineté territoriale, autre étape de la sédentarisation orchestrée par les rois de France et les philosophes, minera progressivement ces fiefs liés à une figure humaine et dynastique. Mais nous reviendrons plus en détail sur cette phase de l'histoire moderne.
HERMENEUTIQUE BIBLIQUE ET CULTURE ORALE
|
|
"tu sais, aux Indiens il ne faut pas faire signer de papiers"
Phœnix Arizona
|
L'une des transformations essentielles des mœurs à partir de ce passage à l'agriculture a été l'invention de l'écriture, abondamment contestée par la philosophie post-socratique dans son opposition aux qualités intrinsèques de l'oralité. Les Juifs d'abord, ont traité cet événement d'une manière originale, en sacralisant les premières synthèses religieuses de leur nouvelle Weltanschauung, en faisant provenir le texte d'une voix transcendante, manière de conserver dans la lettre le principe de l'oralité : ce n'est pas un texte proprement écrit, c'est un enregistrement technique d'une voix entendue par les prophètes. Ce débris de l'oralité sera ensuite soumis à un traitement oral continu, régulièrement enregistré sous forme de commentaires talmudiques destinés à poursuivre, malgré la rupture que représente la disparition des prophètes, un discours oral, sans doute seul garant d'une fidélité réelle à la chose, c'est à dire à la première Parole. En fait, tout se passe comme si l'écriture n'était qu'un avatar dont il faut contourner le maléfice par tous les moyens et surtout ne jamais arrêter le commentaire par une matrice définitive, par un système clos. Un système philosophique a cette prétention à l'éternité de son sens, de son signifié, il est comme la réalité incontournable d'une cité dressée dans l'horizon et qui fonctionne comme menace pour tout étranger qui en approche ou qui veut seulement passer à proximité. Le seul moyen d'en conjurer le danger est de s'en emparer par la compréhension et de le critiquer, ce qui aboutit en définitive à un abandon, ce qui représenterait pour les Juifs l'abandon du Livre lui-même.
Cette attitude prudente vis à vis de l'écriture et cet asservissement technique à l'oral - car ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les Juifs continuent, en réalité à interpréter le présent comme poursuite de l'interprétation de la Parole - en fait comme continuation de l'empire de cette Parole sur le présent. La seule nouveauté qui pourrait venir interrompre ce travail serait l'arrivée du Messie, moment où se renouerait la parole avec la divinité, rendant caduque le Texte et ses commentaires. En philosophie la caducité n'existe pas, ne se conçoit aujourd'hui que dans des discours certes importants mais marginaux comme ceux de Lacan, voire en forçant un peu les choses, de Heidegger. A propos de caducité, il faut bien concevoir que la réalité nomade est traversée par le caduc : chaque jour est par définition caduc, il n'est porteur d'aucun avenir discernable et le monde se renouvelle sans cesse. C'est dans l'écart entre ce que pose l'écriture comme vérité figée et l'incertitude ludique que distille la parole que peut se mesurer l'écart entre la pensée Judaïque et la philosophie occidentale, entre ce qui reste de ce qu'il faudra bien un jour appeler la civilisation nomade, en se souvenant seulement que pour les nomades, la civitas n'existe que dans le temps : les jours, les semaines, les saisons et les années sont les seules villes de nos ancêtres. Dès lors que les hommes ont décidé de coloniser l'espace, le temps se vide de sa substance et perd sa consistance ontologique. L'ennui est la conséquence psychique première d'un temps vide. D'une certaine manière, l'espace-temps nomade préfigure l'espace-temps relativiste d'Einstein, où la distinction s'efface entre les deux éléments pour former un tout substantiel. La séparation des deux est donc bien une opération intuitive, mais cela ne donne que partiellement raison à Kant, dans la mesure où cette intuition n'est pas donnée telle quelle dans l'essence humaine, mais qu'elle est liée à sa praxis, à son histoire et surtout à son désir.
S'éclaire alors aussi la continuité du destin juif. On peut se demander pourquoi ce petit peuple semi-nomade de bergers moyen-orientaux a pu vivre dans une continuité qu'aucune peuplade et aucun état au monde ne pourraient revendiquer. Comment ils ont franchi les siècles sans que leur identité ne finisse par s'affadir et se sublimer dans l'histoire commune. La réponse est simple : leur ancrage spirituel, c'est à dire l'oralité primitive a été soigneusement préservée, et ce faisant, leur propre destin, qui se confond avec l'herméneutique biblique n'a aucune raison de se heurter à des citadelles théoriques ou théologiques. Souplesse adaptative, non pas seulement aux données techniques, scientifiques ou simplement matérielles, là où l'occident demeure morcelé entre mille visions du monde, ayant chacune produit ses effets dans la réalité politique et sociale et continuant de se heurter en produisant, avant tout, leur dégradation réciproque. C'est ce qui arrive aux "Oecuméniques" qui n'arrivent pas à s'arracher aux étages diaboliques de la Tour de Babel doctrinale. Au fond, les Juifs occupent une telle place dans notre actualité pour la simple raison qu'ils sont un peuple exemplaire dans le travail d'un questionnement auquel ils n'attribuent qu'une fin mythique, on sait bien que le sujet des meilleurs Witz juifs, c'est le Messie.

II
LE STOP AND GO OCCIDENTAL
ATHENES ET ROME
L'Occident ne sera pris ici que comme un exemple certainement incomplet de la démonstration, mais tout le monde comprendra qu'on ne peut exiger de personne, le temps n'en est pas encore venu, une culture mondiale, un encyclopédisme capable d'intelliger toutes les histoires régionales des civilisations et d'en faire la synthèse finale selon l'une ou l'autre hypothèse, selon l'une ou l'autre expression du désir théorique, la vraie semence de l'histoire.
Sumer, Athènes, Rome, les premières étapes du mouvement déclenché par la révolution agraire du néolithique, illustrent chacune à sa manière, l'œuvre issue de la pensée des hommes nomades que l'on a trop crû tout simplement fatigués de parcourir la planète.
Quel était le tout premier but de la stratégie qui découlait logiquement de cette décision de tout arrêter ? C'est simple, il fallait mettre un terme global au mouvement de transhumance généralisé qui caractérisait les hommes de toute la planète. Rien ne permet de distinguer le destin des peuplades d'occident de celui des orientaux ou des américains, partout se fait sentir, dans cette synchronie que nous avons observée, l'absolue nécessité, la raison de fer qui consistait à trouver la solution de l'installation immobile sur un sol désormais identique à lui-même dans le temps. Pour cela, il fallut sans doute avant tout choisir les sites d'accueil de ces populations appelées à grandir d'une manière toute nouvelle, cette fois elles grandiraient ensemble, côte à côte. Cette réalité que la pensée de ces nomades étaient certainement à même de concevoir et d'anticiper, exigeait de leur part une grande prudence. Ce n'est sans doute pas un hasard si les Sumériens se sont caractérisés par leur scrupuleuse manie de tout noter jusqu'au moindre détail. L'exercice du pouvoir, comme chez les Egyptiens de la même époque, était aux mains des scribes, ceux que l'on se hâte aujourd'hui de qualifier de prêtres, par une volonté naïve de projeter en arrière l'importance des prêtres d'aujourd'hui. Tout noter étaient une attitude de scientifiques face à une expérimentation dangereuse et nouvelle, le passage du nomadisme au sédentarisme était déjà conçu dans toute l'importance historique de ce qu'il allait déclencher au cours des millénaires à venir. Aussi, Babylone a-t-elle sans doute été une sorte de chef d'œuvre de la sédentarisation, ce que prouve d'ailleurs au seul plan esthétique ce qu'il en reste au Pergamon de Berlin. Dans cette cité mythique( nous la prenons ici comme modèle de toutes les cités qui ont couvert la Mésopotamie, sans lui attribuer une primarité quelconque, et sans oublier que dans les plaines de l'Inde, se construisaient à la même époque de semblables Palais, de même qu'en Chine et en Amérique Centrale), les nomades ont condensé tout ce qui a fait, par la suite, la gloire humaine : ils ont inventé l'écriture, le calcul, inscrit leurs connaissances astronomiques dans la pierre, comme pour déposer leurs trésors transcendantaux avant que l'oubli ne les emporte, et inventé comme sortant d'un rêve leur architecture prodigieuse.
J'imagine Babylone, une sorte d'essence de l'être-sédentaire, que ne retrouverons pas de si tôt les cités d'occident, d'Athènes à San Francisco. Ce qui la caractérisait sans doute le mieux était sa structure organique, le caractère unaire de son urbanisme, qualité urbanistique qu'ont recherchée passionnément les Situationnistes dans les années cinquante. On retrouve aujourd'hui en Kabylie ou en Afghanistan ces villages construits d'un seul tenant, où la circulation intégrait en un seul espace le public et le privé, montrant ainsi que cette dichotomie n'a jamais été une fatalité liée à je ne sais quelle nature morale bonne ou mauvaise de l'être humain, mais qu'elle est née d'une dégradation de la conception originaire de la vie sédentaire. Porteur aussi sans doute d'une éthique encore inconnue à l'heure qu'il est, ce modèle "intégré" provenait d'une Weltanschauung morale nomade dont on peut encore percevoir le génie chez les Touareg ou les Esquimaux. Les visions et projets du Bauhaus n'avaient en apparence pas grand chose pour inquiéter le socialétisme nazi, pourtant ce qui les rendaient totalement irrecevables par la pensée esthétique du Reich, c'est précisément qu'elles intégraient, comme Le Corbusier le tentera plus tard, ces deux espaces apparemment irréconciliables.
Quel est le sens de cette unarité de l'espace de vie commune ? D'abord logiquement elle coagule la souveraineté dans une personne architecturale : le roi n'est que le sommet d'une pyramide parfaitement homogène, parfaitement égalitaire, car chaque brique de Babylone était identique aux autres et le lieu de résidence des souverains ne se distinguait en rien des domiciles pensés comme privatifs, mais qui ne possédaient certainement pas cette qualité. Il faut bien plutôt concevoir ces cités comme des ruches expérimentales, où tout le monde était attelé à l'observation du déroulement des conséquences de ces tentatives réellement conçues comme telle, et non pas fruit du hasard ou du struggle for life. Sans doute Clysthène tentera-t-il quelques siècles plus tard de reproduire ce modèle en redécoupant Athènes, mais il était déjà trop tard, tant l'ancien modèle nomade, le génos avait déjà repris le dessus, retour en arrière du projet premier dont l'occident connaîtra encore de nombreux exemples avant de trouver quelque chose comme une homéostasie de sa nouvelle essence.
La guerre du Péloponnèse, véritable source du déclin grec, se présente précisément comme l'échec du projet de sédentarisation originaire. Les Spartiates ou Lacédémoniens étaient moins les aristocrates masqués qu'on représente toujours comme opposés aux démocrates d'Athènes, que les va-nu-pieds semi-nomades qui continuaient de s'amuser à parcourir l'Hellade pour piller et dominer, nouvelle inflexion donnée à l'éthique sous le masque de l'honneur pour justifier leur modèle parfaitement réactionnaire. Ce modèle il faut le rattacher à la mémoire, passée depuis longtemps dans leur inconscient collectif de leurs lointains ancêtres réellement nomades. Ces derniers, faut-il le souligner, étaient sans doute parfaitement étrangers à ces nouvelles valeurs guerrières et insolemment hostiles à tout égalitarisme. C'est un peu comme la Noblesse de la Fronde, se rebellant contre le pouvoir absolu au nom des vertus de leurs ancêtres, de vertus dont ils avaient depuis longtemps perdu jusqu'au souvenir.
Les Grecs ont donc échoué, comme Sumer, dans la construction d'une existence sédentaire stable, mais leur désir a été encore si vif d'y parvenir qu'ils ont mis à l'abri dans leur écriture tout ce qui restait de l'hypothèse nomade. La République de Platon ou la Politique d'Aristote auront été ces restes brillants d'une réflexion sur ce qui restait de l'idée des précurseurs de ce lointain néolithique, qu'on peut sans doute identifier à ce que les Grecs entendaient sous le terme d'âge d'or. Mais la pensée politique de ces deux philosophes que la tradition a retenus si fermement tout en plongeant au feu tout ce qui ne convenait ni à ses propres projets, ni à sa pensée du monde devenue entre-temps aussi simpliste que fatale aux siècles à venir. Les Grecs les plus proches de l'état antérieur, ceux qu'on place sous la catégorie des présocratiques, avaient encore une toute autre vision de la réalité. Là où Platon et Aristote ne font rien d'autre que de tenter de réitérer l'exploit théorique des nomades, de relancer des expérimentations existentielles nouvelles mais déjà faussées par les déviations concrètes, les présocratiques ont encore une fois tenté de ressaisir l'impensé qui fonde la décision des hommes de s'arrêter, de cesser de se mouvoir à la surface de la planète, sans but, sans fin, sans jamais voir l'équivalent réel de ce que serait le destin de chacun. Nous y reviendrons, mais d'ores et déjà on peut dire que c'est la conscience de la mort, parvenue à sa maturité qui a poussé les nomades à rechercher un lieu fixe pour leur sépulture, ils avaient commencé de penser leur éternité. Les présocratiques se sont donc à nouveau interrogés sur la nature du monde, sur son essence, c'est à dire sur ce qui devait guider leurs pas dans l'existence.
Il faut noter ici que la réponse ontologique qu'apportera Aristote sera celle du mouvement, venant se heurter de front avec la praxis sédentaire des Grecs et ses propres analyses morales et politiques. Là est tout l'échec des Grecs, accompli en dernière instance par Alexandre, l'élève parfait d'Aristote, celui qui anéantira définitivement l'empire hellénique en entraînant les Grecs dans une nouvelle aventure de pillards nomades, même s'il faut y voir le projet civilisateur grandiose que tentera de réitérer quelques vingt siècles plus tard Napoléon Bonaparte.
Presque à la même époque, Rome devenait Rome. Qu'en retiendra-t-on ? Au fond exactement le même schéma que celui qui décrit la naissance et le développement de la Grèce entre les invasions successives des Achéens, des Doriens et la Grèce d'Alexandre. Il est frappant de constater un parallélisme rarement étudié en lui-même et pour sa valeur véritative dans l'analyse du tissu historique. Comme on sait, les Romains, comme les Grecs, sont d'anciens nomades. La légende en fait des descendants des Troyens, disons des quelques survivants qui ont réussi à fuir et à rejoindre la péninsule italique en passant par les marécages de la future Venise. Ce qui m'amuse en écrivant cela, c'est que je perpétue une tradition parmi les historiens qui veut que cette légende largement reconnue comme fausse, soit régulièrement rappelée comme hypothèse, sans autre raison apparente que de donner une sorte de ciment poétique à une épopée qui fut sans doute tout sauf poétique. Car les premiers Romains eurent la vie sédentaire très dure. Choisissant à dessein l'un des sites les plus difficiles à aménager, en raison des nombreux marais pestilentiels qui cernaient les sept collines de la cité, mais aussi parce que la terre était extrêmement pauvre, difficile à travailler et sans intérêt agricole particulier sinon un été étouffant qui détruisait une année sur deux les récoltes assoiffées. L'idée n'était pas, en vérité, d'y faire de l'agriculture. Ces faux ex-Grecs, dont on sait au moins qu'ils provenaient de régions côtières de l'Adriatique, avaient tablé sur tout autre chose. Ils anticipaient une activité qui ressemblait bien davantage à leur ancienne marotte de coureurs de terre et de mer. Rome était, en effet, magnifiquement placée pour devenir rapidement le premier port de la Méditerranée occidentale qui allait prendre le contrôle du trafic Nord-Sud en sorte que cette mer devint, selon les plans les plus anciens de ces colons, la fameuse Mare Nostrum des cartes stratégiques.
Aussi, les Romains y ont-ils mis le prix, un prix qui ne fut pas mince. Quels étaient les paramètres de leur problème ? Satisfaire leurs instincts nomades tout en restant sur place. Ce qu'ils visaient à long terme c'était bel et bien de devenir des commerçants qui défieraient et soumettraient à terme leur concurrence punique et étrusque. Mais pour atteindre ce but il leur fallut aussi impérativement asseoir leur autorité sur le Hinterland et sur la zone qui les séparaient encore de la mer. D'où la contrainte absolue de s'installer sur place, modestement mais solidement, avec des instruments sociaux et politiques qui conviendraient à cette nouvelle forme d'existence. Grosso modo ils firent exactement comme leurs voisins grecs. Ils fondirent leur société sur l'agriculture, non pas parce qu'il fallait manger, mais parce que l'agriculture était déjà devenue l'éthique pratique des sociétés avancées, comme l'Etrurie ou les pays celtes que ces anciens nomades connaissaient parfaitement bien. Rome, au fond, était une province éloignée du centre de la civilisation du 7ème siècle avant Jésus-Christ qui se situait alors bien plus au Nord, dans les contrées qui allaient devenir la Gaule. Les Romains n'ont donc fait qu'imiter comme d'excellents élèves qu'ils furent, ce qu'ils avaient entre - aperçu pendant leurs courses de nomades.
Autre parallèle saisissant, leurs instruments politiques et sociaux non seulement ont été les mêmes que ceux des Grecs, mais ils évoluèrent au cours du temps de la même manière. Ils se dotèrent de tyrans dès leur arrivée le long du Tibre, firent une belle révolution à peu près à la même époque où Clisthène débarrassa Athènes des tyrans pour former la république. Après cette révolte, les Romains passèrent à un autre système de gouvernement, très complexe mais dont l'essence était l'égalité républicaine, c'est à dire l'égalité dans l'exercice de la souveraineté selon une péréquation largement contradictoire avec son principe. De fait, ce système ne fonctionna jamais réellement, malgré les tirades du vieux Caton sur la Rome de ses ancêtres. Tout de suite les différences de classe prirent le devant de la scène, des classes qui entrèrent en conflit rapidement, conflits d'abord de caractère clanique, entre la classe des nobles et celle des chevaliers, puis résolument politique entre ces deux classes et la plèbe, non moins romaine qu'eux, mais qui, de par sa dépendance économique des riches ploutocrates, n'avait obtenu qu'une part minime du pouvoir réel. La véritable Rome, celle qui fit la gloire de l'Italie entre le deuxième siècle avant JC et le deuxième après, était devenue une fausse démocratie de représentation, où un Sénat tout-puissant, manipulé en sous-main par les riches familles de chevaliers, dirigeait les affaires. Pendant certaines périodes d'incertitude, notamment pendant les guerres puniques où Rome faillit périr corps et biens, la démocratie fonctionna à peu près correctement, nonobstant le fait que ce furent aussi les périodes où la République s'endetta tellement auprès de la classe des riches, qu'elle ne s'en relèvera jamais. La richesse s'accumula en si peu de mains que la porte s'ouvrait alors déjà à l'Empire.
Athènes, Rome, deux destins politiques tout à fait comparables. Leur histoire, selon notre analyse est celle de cette époque au cours de laquelle le monde commença de se stabiliser dans la posture sédentaire. Comme nous l'avons vu, Rome comme Athènes ou Sparte, ne le firent pas de gaieté de cœur, ni surtout de manière linéaire et résolue. Au fond de leur inconscient, l'instinct de baroudeurs de l'espace n'avait pas disparu, et le projet du sédentarisme était déjà trop loin dans sa pureté et son sens originel. C'est qu'entre l'envoi de ce que Heidegger nomme le nouveau "comport" de l'homme dans le monde et son achèvement occidental, il se passe plusieurs millénaires, encore largement tiraillés entre l'ancienne et la nouvelle attitude. Nous verrons plus loin comment les cycles mythologiques, religieux, culturels et politiques correspondent à chaque fois à l'un ou l'autre désir, à celui de l'installation sur la terre, à son appropriation et à son arraisonnement ou bien au retour aux chevauchées sauvages, finissant en ruées de Panzer sur les glacis soviétiques. Ernst Jünger dit quelque part que le sort de l'Empire Ottoman et de l'Occident tout entier s'est joué dans la bataille de la Montagne Blanche, dernier coup de boutoir raté de Constantinople pour rentrer dans les frais d'une politique de conquêtes séculaire mais désordonnée. Le pauvre Alexandre, la plus belle machine humaine produite par l'Antiquité, ignorait certainement qu'en partant conquérir l'Orient, il contrevenait à la vocation fondamentale de l'être grec. Car la pérégrination militaire comportait les éléments fondamentaux du nomadisme, une praxis considérée par les Grecs comme barbare. Les troupes qui avançaient triomphalement vers les confins de l'Inde étaient livrées dès le départ au risque de la mort du Chef, car le nomadisme ne connaît que des chefs, des égaux, une éthique politique dont la monarchie macédonienne venait de pulvériser les derniers restes dans toute l'Hellade. Alexandre était donc seul, son entreprise dépendant entièrement de lui. Tous les efforts de Philippe son père pour unifier la Grèce échouait dans une expédition qui s'identifiait forcément avec une vulgaire razzia de bandits nomades. Comme Napoléon dans les premières années de la conquête européenne, Alexandre a bien cru parer à ce danger en structurant politiquement les pays conquis selon la sage politique héritée de l'enseignement d'Aristote. Mais il oubliait, ce faisant, que la Grèce avait déjà presque trois siècles de démocratie derrière elle alors que l'orient ne connaissait, partout où il passait, que des formes plus ou moins pures de ce que Marx appelait le despotisme oriental. Combien de temps résisteraient les réformes importées par une armée de conquête, quel que soit le succès du conquérant lui-même auprès des masses conquises ? L'échec d'Alexandre est le modèle parfait du piège que représente une cassure brutale avec une praxis purement sédentaire. Son échec sera longuement étudié par les stratèges ultérieurs dont le souci restera toujours, voyez Clausewitz, le maintien d'une logistique toujours reliée à la base de départ. La méthode nomade consiste à vivre sur les pays traversés sans regard pour le point de départ, partout le monde est égal et partout il donne et reçoit de la même manière. Or cela ne vaut que pour un monde entièrement nomade. Au fond, Alexandre a dû caresser le rêve insensé de remodeler le monde antique sur l'attitude mythique du nomadisme et sur ses valeurs qui étaient celle de l'âge d'or. Cela nous apprend autre chose encore, c'est la supériorité désormais installée dans le monde de l'idée sédentaire. Le moment n'était pas venu d'un retour en arrière, il faudra encore attendre quelques millénaires.

III
LES BRAS MORTS DU NOMADISME
Comme un fleuve impétueux, la mutation entre un monde mouvant et le clocher de village, ravage la Mésopotamie, la Grèce, Rome et tout le bassin méditerranéen, avant de se calmer progressivement entre les montagnes et les forêts de l'Europe du nord. Les hommes de la Gaule romaine puis du Moyen age balisent son lit et construisent des digues. L'idée de l'Empire sans borne dépérit au profit d'entités plus réduites. Charlemagne tentera une dernière fois de fondre en un seul bloc ce que les Romains avaient tracé comme territoire sous leur dépendance, mais déjà sans ambitionner de poursuivre la conquête au-delà des bornes de l'Europe centrale. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, les anciens espaces gaulois et celtes s'étaient peut-être déjà mieux arrangés de cette mutation agraire, n'étant pas au contact de la frénésie commerciale des Phéniciens. D'une certaine manière, les civilisations qui sont nées autour du bassin méditerranéen ont très vite détourné leur vocation agricole en investissant dans le commerce, manière de rester dans le mouvant, symptôme peut-être de la difficulté de l'évolution et aussi de la disparition de l'intuition originaire. Le commerce est peut-être l'une des premières distractions pascaliennes : la naissance du commerce reste un mystère peut-être encore plus épais que l'agriculture, dans la mesure où plus on se rapproche de la période purement nomade, moins on trouve de raisons concrètes à l'échange. La diversification des besoins doit nécessairement précéder le commerce et il n'est pas facile de distinguer à quelle étape de l'évolution ces besoins apparaissent. Une chose est absolument certaine, c'est que l'échange proprement marchand ne surgit qu'avec l'apparition de l'habitat fixe. Les rencontres nomades donnent lieu traditionnellement au potlatch, puis, selon les théories courantes, mais il faudra y regarder de plus près, au troc qui est, en vérité, déjà une forme marchande puisqu'il procède toujours d'une évaluation, et donc d'une valeur d'échange.
Le nord de l'Europe sera donc immédiatement plus obéissant à l'injonction du "settlement" et aura, déjà sous la domination romaine, construit tout un monde d'horizons immobiles que le Christianisme contribuera à conforter en venant doubler les liens de servitude et de vassalité issus du banditisme primitif. De cette histoire on retiendra un phénomène suggestif, c'est l'invasion des Francs, barbares germaniques nomades sortants de leurs forêts de Thuringe et de Franconie pour venir occuper les nids des Celtes et des Gaulois. Leur succès est tel qu'ils formeront pour les siècles à venir le plus clair de la noblesse française. Moralité : ce sont des nomades barbares, même pas Chrétiens, qui s'emparent littéralement de l'histoire d'un territoire qui deviendra tout naturellement la France. On sait que les premiers Francs étaient des guerriers très arrogants qui se sont implantés en France avec une brutalité féroce. Ils ont longtemps conservé une distance radicale à l'égard des populations indigènes, une distance qui s'est transmise dans le temps pour donner cette classe tellement imbue d'elle-même qu'il faudra les remettre à leur place les armes à la main. Mais cette culture du sentiment aristocratique arrogant, d'un quant à soi le plus souvent méprisant, limite-raciste, a donné ce style monarchique qui fait les délices des salariés de la France d'aujourd'hui. Il faudra dans la suite analyser ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme à la lumière de la préservation dynastique de ce sentiment d'orgueil sans limites, mais surtout d'une véritable culture du défi d'honneur qui en prend le relais au vingtième siècle dans la mafia américaine, porche d'un monde des affaires dont les guerres parfois sanglantes tiennent en réalité plus souvent à des conflits de personnes qu'à des considérations purement économiques. Le cinéma américain, et nous le montrerons plus loin, est déjà tout entier engagé dans une culture-retour à l'éthique nomade. Il n'est pas obligatoire de se contenter d'y voir une opération de propagande libérale, il vaut mieux y voir un symptôme de la nostalgie d'un peuple qui n'a jamais su assumer le "settelment" jusqu'au bout, parce que son destin était génétiquement frappé de la marque du nomadisme dont il a goûté les fruits dans une sorte d'interlude édénique et sauvage. Le châtiment fut la Guerre de Sécession, mais elle n'a pas su détruire le souvenir dans la mémoire des Américains. Le romantisme américain tourne aujourd'hui autour du crime en série que distille le Nord aux dépens du Sud, une confrontation arbitrée par un sud excentré, Hollywood.
TERRITOIRE ET MONARCHIE ABSOLUE
|
|
"Le territoire est une humanité mise en forme, qui fait corps avec des lieux, les déchiffre, les habite."
Pierre Legendre : Miroir d'une nation.
|
La monarchie absolue est née comme une mode. Il faut s'imaginer l'Europe du second millénaire comme une constellation de pouvoirs qui reposent au commencement sur les personnes, comme nous l'avons déjà souligné. Pour rappel, cela signifie que le territoire s'identifie non pas à un ordre cartographique et quantitatif, mais à la personne du souverain. Cette idée cache l'ancien statut nomade, où la souveraineté sur l'espace procède directement de la simple présence de l'homme : en ce temps-là, il n'y a pas réellement de territoire, il n'y a que du parcours où celui qui marche possède en continu ce qu'il parcourt. Entre l'homme et la nature qui l'entoure, il n'y a pas de différence radicale, il y a une entente d'origine, un équilibre écologique hérité des conditions de stabilisation de la vie. La chasse n'est pas une pure prédation au sens animal, mais une sorte de pacte silencieux entre des entités qui représentent chacune la vie stockée en quantité limitée. Ces entités ont donc des relations que nous imaginons difficilement, car elles se passent du langage, mais il existe quelques expériences connues qui rendent compte de la possibilité de telles relations. On a pu ainsi observer que des naufragés dépourvus de toute réserve de nourriture et sur le point de périr au milieu du Pacifique soient sauvés pendant des semaines par ce qu'ils décrivent comme un miracle, c'est à dire un véritable sacrifice organisé par des espèces de poissons et de tortues qui se laissent prendre en l'absence du moindre outil de pêche ou de chasse. Un couple d'Anglais a survécu ainsi cent dix-sept jours dans une survie de caoutchouc, alimenté par une sorte d'écosystème qui s'était constitué autour de leur esquif. Dans de tels cas, la vie semble se reconnaître non pas comme une simple tendance à persister, mais comme une conscience réciproque d'une échelle de valeur sans raison apparente, une hiérarchie naturelle qui doit, quelque part poursuivre des fins communes. Le naufragé est, de nos jours, la réplique exacte de ce que pouvait être le nomade avant le néolithique, enfermé dans un statut de la déréliction que nous ne connaissons pas, où l'abandon n'est pas vécu comme l'absence de signe d'une entité transcendante, mais comme le silence des autres, silence des autres naturels et non pas seulement le silence des autres hommes. "Le silence des agneaux" est un titre parfaitement génial pour le destin d'un serial killer pour qui les hommes sont redevenus des êtres indéterminés, identiques aux êtres naturels qui s'offrent au sacrifice de la manducation universelle.
Ces hobereaux répandus à travers l'espace s'observent et examinent les méthodes de gouvernement de leurs pairs. Comme aujourd'hui l'Europe se met à l'américanisme, des souverains comme le Grand Frédéric de Prusse ou Joseph II d'Autriche-Hongrie, prennent des leçons d'absolutisme et de modernité chez les souverains voisins. Ainsi se déplace la prépondérance, selon l'application d'une idée qui réussit, qui est reprise et améliorée, ou, comme dans le cas de Joseph II, qui rate par incompatibilité avec l'ordre régnant. Encore une fois, ce ne sont pas les forces économiques ou militaires, ou encore les vertus particulières d'un peuple qui déterminent le succès de l'entreprise, mais la force et la rationalité d'une intuition soutenue par l'énergie d'une pensée ferme et résolue.
Il en va ainsi du modèle de la monarchie absolue. Celle-ci se veut à l'origine comme l'ampliation du modèle primitif : le Roi n'est à l'origine que le représentant des véritables souverains, le symbole d'un accord entre ces représentants sous son arbitrage. Le Roi n'est qu'un hobereau parmi les autres, la plupart du temps choisi parmi les plus pauvres afin de limiter son pouvoir d'intervention dans les affaires privées des Seigneurs. Saint-Louis, Richard Cœur de Lion et presque tous les Empereurs du Saint Empire Germanique, n'étaient que des instruments politiques aux mains des puissances réelles, l'Eglise et les grands féodaux. L'extension de cette puissance réelle se fera donc aux dépens des féodaux et de l'Eglise. De Louis XI à Mazarin le jeu consiste à agrandir le domaine royal par le jeu des événements successoraux, quitte à tricher quand il le faut pour forcer les cartes. Le territoire reste alors strictement lié à une figure humaine jusqu'au point critique où naît le territoire proprement dit, la nation, c'est à dire un espace homogène mathématique - la res extensa partes extra partes de Descartes - qui deviendra la Nation. A mesure que la figure royale s'empare du territoire, de l'image de la nation, celles des féodaux qui continuent de gérer leurs espaces régionaux se délitent et perdent leur emprise. Or, dans cette opération qui provoquera aussi bien la Fronde que la Révolution Française, l'emprise du corps du Roi sur le territoire faiblit en même temps que celle des seigneurs locaux. Elle faiblit pour disparaître totalement en tant que définition de la souveraineté. On passe alors dans la nation matérielle, dans un vécu du territoire en tant que pur terrain quantifié et limité strictement par des frontières dont la naturalité vient renforcer l'idée qu'un pays n'est qu'une surface de terres utilisables techniquement de telle ou telle manière, exploitable, certes par le Roi, mais par n'importe qui d'autre. Le territoire se disqualifie en tant que spécificité féodale ou royale. Pour mieux comprendre cette évolution en réalité philosophique, on peut se reporter à l'évolution de certaines activités comme la chasse et la pêche, ou encore l'aménagement des territoires, des activités qui portaient toutes la marque personnelle du souverain. Celles-ci vont très rapidement s'homogénéiser à l'instar de la monnaie, des méthodes juridiques et administratives, ainsi que des mœurs.
L'absolutisme se révèle donc être une toute autre opération qu'une simple extension du pouvoir ou d'une centralisation violente de ce dernier. Elle transforme en profondeur la nature même de la relation de l'homme à son environnement. Les blessures qu'a infligé cette évolution aux êtres humains se produiront encore souvent sous les coups de boutoirs du progrès technique. Des hobereaux hongrois se battront jusqu'à la mort pour empêcher le train de morceler leurs terres, les écologistes ne ratent pas une occasion de protester contre un nouveau projet qui porte atteinte à l'intégrité du territoire devenu pur spectacle et inépuisable source de romantisme anti-technique. Le sentiment des écologistes procède à l'évidence de la vague intuition d'une unité ontologique de la réalité humaine et de ce qu'ils nomment encore la Nature. Ils savent pourtant que cette nature est devenue depuis longtemps elle-même une réalité technique, un produit des mains et de l'esprit humain qui ne contient plus rien de la richesse d'une nature autonome - dans laquelle il faut inscrire aussi la nature humaine, nantie de la même "autonomie", cette liberté dont on parlera tant beaucoup plus tard - à peine perceptible encore dans les quelques hectares de forêts primitives qui subsistent à la surface de la planète.
La centralisation monarchique, suivie logiquement comme le note Marcel Gaucher, par le Jacobinisme, forme donc en les aménageant, les bras morts du nomadisme. Ce dernier ne périt pas par formation de frontières - le limes romain n'était pas en réalité une frontière car une frontière ne devient telle qu'à partir du moment où s'installe une circulation dans les deux sens - mais par dépersonnalisation du territoire, par son inscription dans une pure matérialité. Les pays commenceront alors par se définir comme paysages, comme recel de richesses diverses et comme objets de représentations essentiellement cartographiques. Le visage humain de la souveraineté s'estompera progressivement. Seuls quelques exemples exceptionnels continueront d'alimenter la chronique des états à problème, les tyrannies attardées pratiquants ce qu'on appelle naïvement le culte de la personnalité comme la Roumanie de Ceaucescu, les divers stalinismes survivants comme Cuba ou la Corée, mais aussi la France dont la République a d'ailleurs pris le visage de Marianne, une Marianne qui continue de séduire les peuples au point de devenir gênante dans le concert tonitruant du mondialisme.
La France est ainsi devenue l'une des grandes réussites de la sédentarisation, le plus grand bras mort du nomadisme. Mais un bras mort est toujours entouré de masses vivantes qui, en général, travaillent à la réduction des marais formés par les fleuves qui meurent. De nos jours cet environnement, qui continue de troubler la République et à la déstabiliser, est à chercher évidemment à ses frontières, là où couve la braise du mouvement, là où continuent de frémir les angoisses de l'incertitude identitaire et linguistique. Les populations dont l'histoire est une série d'allers et venues entre des souverainetés hostiles ne se sont jamais réellement identifiés au territoire national. La Corse, l'Alsace, la Bretagne ou encore le Pays basque ne cessent d'être agités par un vertige qui entretient certains aspects archaïques de la vie sociale et des mœurs et parfois le mélange des deux. Ainsi la Corse où le terrorisme ne devrait pas être interprété comme une dérogation au patriotisme, mais au contraire comme la volonté d'une implication plus forte dans la participation à la démocratie. Les Corses, en effet, se distinguent par un archaïsme fondamental qui lie l'activité politique à l'évolution sociale de chaque individu : c'est dans le courage politique que le jeune Corse doit prouver sa capacité à prendre des responsabilités dans son clan familial, de prendre la suite du pouvoir tribal. Le rattachement des Corses à leur "vallée" n'est pas folklorique, même s'il fait rire les énarques, il manifeste le sérieux avec lequel ces Français se mobilisent pour gérer leur posture sédentaire. Ce côté initiatique incline malheureusement encore du côté de la violence parce que le courage de l'individu n'a pas encore trouvé à s'exprimer autrement, mais dès qu'une acculturation plus poussée aura gagné les plaines et les montagnes de l'Ile de Beauté, alors on découvrira une toute nouvelle dimension de ce petit peuple têtu, plein d'humour et de ruse. Beaucoup moins rigolos sont les Alsaciens qui ne trouvent à réagir à leur malaise que par la réponse menaçante d'un fascisme rampant, d'une nostalgie de l'ordre Hitléro-Suisse qui représente le degré zéro du sédentarisme, le degré où la mort se transforme elle-même en néant.
LES EMPIRES OU LA JOIE RETROUVEE
Bonaparte, la reine Victoria, Behanzin ou Chaka, Hitler ou Staline ont tous transgressé sous une forme ou une autre, selon des impulsions plus ou moins diverses, le statut quo péniblement conquis avant leurs règnes. Avec eux naissait l'impérialisme, lointain cousin des expéditions espagnoles et portugaises dans les eaux de l'Atlantique sud. Les deux formes de cette resucée du colonialisme des Anciens, sont très différentes l'une de l'autre, en même temps qu'elles ne ressemblent en rien à la tradition des clérouquies grecques ou des conquêtes d'espace romaines.
Il reste que toutes ces expéditions ont un point commun : l'aventure d'une errance plus ou moins calculée. Donc, une tendance vers le retour aux mœurs de nos chasseurs d'avant l'araire et le grenier à blé. Dans la Grèce ou la Rome antiques, les décisions d'expédier au loin des groupes d'hommes et de femmes avaient, en général, deux causes : ou bien l'entretien de la population devenait soudain problématique, effet d'une série de mauvaises récoltes, ou d'une guerre aux conséquences graves, ou bien le commerce exigeait une nouvelle escale qui bien souvent étaient destinée à couper l'herbe sous les pieds des Phéniciens ou des commerçants venus du nord. Les colonies ainsi créées, qui gardaient une relation de vassalité directe avec la cité d'origine, formaient un réseau de villes destinées avant tout à abriter les flottes de commerce ou de guerre et à assurer aux métropoles la fourniture de produits spécifiques comme les métaux rares ou les matières premières nouvelles et devenues indispensables comme les teintures, les terres rares, les parfums et la joaillerie, rares en Hellade et en Italie. Jamais elles n'étaient conçues comme une extension du territoire grec lui-même, malgré les liens qui les attachaient à leurs métropoles relatives. Ces colonies étaient planifiées et fondées comme on jette une bouteille à la mer : ça marcherait ou ça ne marcherait pas, de toute façon il fallait, soit partir pour réduire le nombre de bouches à nourrir, soit partir au nom de l'expansion de la métropole et assurer ainsi sa survie. Au résultat, les clérouquies restaient des cités associées au destin de la métropole. On l'a vu dans la guerre du Péloponnèse où la flotte athénienne envoyée en Sicile, subit un échec catastrophique pour Athènes qui perd dans l'opération le plus clair de sa puissance et la plupart de ses clérouquies siciliennes.
Cette forme de l'aventure nomade reste donc ambiguë quant à sa nature qui reste avant tout de favoriser la stabilité et la puissance de la métropole. Elle ressemble en cela aux conquêtes coloniales du dix-neuvième siècle en Afrique et en Asie, du Moyen jusqu'à l'Extrême-Orient, étant entendu que pour chacune de ces zones il faudra encore distinguer les colonisations de peuplement et les autres. Là où les Portugais et parfois les Anglais envisagent de s'installer, comme par exemple ils l'ont fait en Afrique australe, ni les Français, ni les Belges, ni les Allemands ne se donnent comme objectif clair de devenir les nouveaux habitants de l'Inde, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou du Nyassaland. Dans l'Antiquité, en fin de compte, tous les clérouques grecs seront assimilés par les puissances qui naissent partout, de l'Egypte jusqu'au pourtour de la Mer Noire. En l'an 200 après JC, les Grecs d'Italie n'existent plus que comme une classe de clercs et de précepteurs au service de la chevalerie romaine.
L'AVENTURE AMERICAINE
La distinction entre colonisation de peuplement, dont l'exemple le plus simple est le retour des Juifs en Palestine, hier et aujourd'hui, et l'impérialisme qui n'est qu'une forme exportée de l'exploitation économique, est essentielle. Elle recouvre notre propre dichotomie des tendances sédentaires et l'instinct du retour au nomadisme. L'exemple le plus intéressant à étudier dans tout le lot des expéditions lointaines, est certainement celui de la colonisation de l'Amérique du Nord. Son originalité est d'abord qu'elle s'entame dans la totale aventure, c'est à dire qu'elle ne se pose aucun objectif précis, pour finir comme la plus grande colonisation de peuplement réussie de tous les temps. Or les premières expéditions qui suivent l'aventure espagnole plus au sud, vont révéler un territoire tellement vaste que les colons aventuriers, les grands nomades transatlantiques vont devoir poursuivre sur le terrain leur dérive dans l'inconnu. De nomades marins, ils vont devenir des nomades terriens, et dans une grande mesure le rester, au gré des conjonctures économiques, rarement politiques. La caravane est encore aujourd'hui le symbole d'une existence sans racines territoriale, et ce qui caractérise le mieux l'espace des Etats-Unis est l'unité des mœurs et de la langue : d'un bout à l'autre du pays on parle la même langue, on mange les mêmes hamburgers et on construit à peut de choses près les même maisons, les mêmes gratte-ciel, les mêmes usines, les mêmes églises et les mêmes bâtiments publics. Comparée à l'Europe, l'Amérique est un pays d'une monotonie culturelle incroyable et le caractère des Américains semble comme formaté dans ce moule unaire. C'est que les patries sont devenues interchangeables, la mobilité de l'emploi ayant le dessus sur toutes les autres considérations. Pendant les années de crise, les trains de marchandises étaient remplis de "hobos", ces faux-chemineaux qui parcouraient les Etats-Unis à la recherche de travail. Ils étaient redevenus des nomades chasseurs d'emplois aussi précaire que le gibier d'il y a dix mille ans. Le travail étant devenu l'étalon de la survie, la mobilité est devenue aussi naturelle que les itinéraires nomades qu'on peut décrire comme le puzzle alimentaire du temps. La naissance d'une entreprise est le même événement que l'anticipation du lieu où l'on sait que l'on va découvrir une bonne récolte de fruits. Aussi, l'Amérique possède-t-elle de forts traits de ressemblance avec l'avant néolithique, ce qui explique son isolationnisme et l'absence de tout esprit de conquête autre qu'économique, son sens de la démocratie et d'un droit qui repose sur la jurisprudence plutôt que sur la loi écrite, son taux de violence élevé, qui dépend de deux facteurs, l'esprit de risque nomade et les frontières vitales, à commencer par celles du pays. Car les USA sont malgré tout pris dans la contradiction d'un caractère nomade dans une universalité sédentaire. Leur mépris sans cesse renouvelé pour l'organisation des Nations-Unies, montre que les Américains ne sont pas des universalistes stricto sensu, mais les universalistes de leur modèle seulement. La paix mondiale ne les intéresse que pour autant qu'ils puissent circuler en toute sécurité à travers le monde pour y faire commerce. Leur hostilité pour la France provient directement de cette opposition fondamentale entre paix immobile et paix mouvante, la France a inventé l'art de vivre sur un sol, chose incompréhensible pour les pionniers du nouveau monde. En réalité l'ancien.
L'histoire elle-même de l'Amérique, aussi courte qu'elle soit, résume d'une manière assez claire l'histoire du destin global de l'occident. Elle est marquée en gros par deux phases essentielles, révélatrice des mouvements sous-terrains du destin de ces aventuriers. La guerre d'indépendance ne compte pas beaucoup comparée à la guerre de sécession, car cette dernière a un triple effet. Les causes de cette guerre tiennent toutes dans les forces centrifuges, économiques et culturelles qui éloignent progressivement les états du sud qui demeurent comme envoûtés par l'esprit nomade. La victoire du Nord est donc avant tout la victoire de la stabilité sociologique, de l'Américain qui veut et réussit son "settlement". La libération des esclaves noirs est aussi la fin des transhumances transatlantiques, des aventures que représentent la chasse aux esclaves et leur "domestication". Dernier effet important, la destruction de la société esclavagiste unifie d'un coup, au prix certes d'immenses souffrances, le territoire de l'oncle Sam.
Ici, il faut aborder l'aspect politique de l'histoire américaine, dont la forme démocratique et le libéralisme originaire sont évidemment liés à la trajectoire nomade primitive, puis à celle de la conquête de l'Ouest, puis enfin à l'épopée de la guerre de Sécession qui remua une immense partie de la population du nord et du sud une nouvelle fois. Si on compare les événements qui suivent l'indépendance, il faut bien reconnaître que les Américains semblent brûler certaines étapes. Non seulement leur modèle politique d'origine, la monarchie constitutionnelle anglaise est plus près d'une aristocratie régnante que d'une démocratie, mais le pays n'est pas prêt à l'exercice de la démocratie, les vraies cités sont rares, le territoire immense, plutôt redevable d'une politique à la Pierre Le Grand qu'à la Périclès. Et cependant, il n'y aura aucune transition par quelque forme de tyrannie ou de monarchie qui soit. La guerre d'indépendance aura certes suffi comme expression du refus de l'autorité royale, mais rien n'empêchait les colons enfin débarrassés de structurer leur état sur le même modèle que l'ancienne métropole. Pour les politologues de l'époque, la décision démocratique fera figure de révolution fondamentale, la première en fait depuis l'Antiquité. On explique volontiers cette révolution par quelques lieux communs sur l'origine et la répartition des classes sociales. Pour la plupart d'extraction modeste, les colons européens auraient tout naturellement choisi un modèle pour lequel beaucoup d'entre eux se sont battus dans leur propre pays. D'autre part beaucoup de ces colons représentaient des minorités religieuses mal tolérées en Europe et dont le messianisme nomade faisait des militants acharnés de l'égalité. Ces arguments sont bons, mais ils ne rendent pas compte entièrement du phénomène. Ils ne tiennent surtout pas compte de ce qu'a induit, pour les premiers arrivés, la vie sauvage des débuts, lorsque ces hommes furent plongés du jour au lendemain dans un statut dont ils ne connaissaient rien mais qui impose rapidement ses paramètres physiques et idéologique.
Le mot pionnier, "pioneer", est en Amérique un mot sacré. Il condense en fait ce qu'on appelle le rêve américain. Ce fantasme de liberté totale confrontée à ces travaux d'Hercule qu'a représenté la fondation d'une nation civilisée, anime aujourd'hui encore la foi du peuple américain dans le génie et la puissance de l'individu placé dans des conditions d'absolue liberté. Comment ces hommes dont les ancêtres ont conquis l'espace les armes à la main, comment ces citoyens pourraient-ils sérieusement envisager de confier leurs armes et la violence en général, au contrôle du seul état ? C'est une des différences essentielles entre la démocratie américaine et la République qui, elle, confisque tout naturellement l'usage de la violence à l'ensemble des individus citoyens. Mais il faut imaginer et poétiser l'aventure dans sa toute première phase, un peu à la manière de Jarmusch dans son film Dead Man qui réussit à rendre l'atmosphère d'une déambulation dans des forêts sans fin, à mettre en scène les enjeux d'une rencontre au milieu de ce néant comparable à la situation du marin au milieu de l'océan. Il analyse d'ailleurs avec génie la double condition de ce blanc livré à l'aventure la plus dangereuse - il est pourchassé par la police mais aussi par des meutes de tueurs - et sa rencontre avec un vrai nomade indien. Il est vrai que cet Indien connaît William Blake pour avoir vécu parmi les Blancs comme un singe dans un Zoo, et c'est précisément sur ce signe poétique de reconnaissance que va se sceller une amitié impossible. Je cite cet exemple pour concrétiser la situation nomade, mais il est évident que la mise en scène de Jarmusch ne correspond en rien à la situation nomade pure.
En effet, les pionniers eurent affaire à une telle pureté au contact des Indiens. Dans le film dont nous venons de parler, la situation du héros postule a priori la violence absolue. On se trouve sur le radeau de la Méduse où l'homme va jusqu'au cannibalisme, mais la vérité primordiale du nomadisme n'a sans doute rien à voir avec un tel postulat. On a fait trop vite de nos civilisations un dégradé de barbarie, or il n'en est certainement rien. Avant la sédentarisation, la violence n'a pas pu être la seule rationalité des rencontres humaines, car une telle hypothèse ne laisse aucune place à une modification, à la mutation dont nous parlons, à ce que l'on nomme un peu vite le progrès. Non, les pionniers américains ne se sont pas immédiatement heurté à l'hostilité des tribus indiennes presque toutes nomades. Au contraire, on sait que les premières relations ont été amicales et fructueuses pour les deux partis. Il en a d'ailleurs été de même lorsqu'au XVème siècle les Portugais ont établi des relations politiquement pacifiques avec les habitants du Congo et de l'Angola. Globalement nous pensons le contraire, nous sommes persuadés que la violence est l'exception dans la rencontre nomade.
Et ce pour de nombreuses raisons dont la plus importante à nos yeux est à mettre au compte de la problématique linguistique. Retour à la Bible. Le mythe de Babel intervient comme le point de départ de la condition nomade, comme l'éparpillement des hommes sur la planète parce qu'ils ont osé se mesurer à Dieu. A noter ici qu'il faut toujours lire le Livre sur un double registre : d'une part il retrace la révolution néolithique proprement dite, de l'autre la totalité de l'histoire humaine. Comme les auteurs de la Bible ne pouvaient concevoir la réalité de l'époque de l'errance humaine dans sa pureté, ils ont forcément imaginé, exactement comme la plupart des anthropologues, que cette errance était une régression par rapport à la réalité civilisée qu'ils connaissaient déjà. Dans la chronologie du Livre, la période nomade appartient donc à une punition divine, et on ne saurait imaginer des nomades heureux. La diversité linguistique dont Dieu les frappe signifie immédiatement violence réciproque sur la base des différences. Or l'erreur de logique est évidente, la diversité des langues ne peut faire référence qu'à une réalité postérieure au néolithique, car les langues en tant que telles ne peuvent se tisser que dans des sociétés rassemblées et sédentarisées, au moins partiellement. Pour partager une langue, il faut partager un territoire, c'est une loi qui ne souffre aucune exception, les ethnologues le savent bien et en particulier ceux qui ont étudié les langues bantoues qui possèdent toutes des racines communes et s'adaptent facilement les unes aux autres. La zone Swahili de l'Afrique, en gros la côte Est, fonctionne exactement de la même manière, par une structure commune où se distinguent des dialectes particuliers. On pourrait comparer cette situation linguistique à celle de l'Allemagne par rapport à la France. Nos voisins disposaient à l'origine deux langues de base, le Moyen Haut-Allemand et le Moyen Bas-Allemand. Ces deux langues étaient en réalité des familles de langues, des ensembles de dialectes qui mirent beaucoup plus de temps à se résoudre dans le Haut-Allemand tout court que les dialectes ressortissants de la langue d'Oc et de la langue d'Oïl. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne sortait d'une période nomade qui a duré beaucoup plus longtemps que dans la Gaule celte et romaine, comme nous l'avions souligné plus haut. Le Saint Empire Germanique ne fut en effet stabilisé réellement qu'à partir du X- XIème siècle, après la terrible campagne de christianisation qui dépeupla tant de Länder. Les langues vernaculaires n'avaient donc aucune raison de s'unifier comme on allait le faire en France à partir des premières dynasties franques dès le 5ème siècle.
L'Allemagne attendra le dix-septième et le dix-huitième siècle pour que Leibniz compose une langue essentiellement basée sur le dialecte du Hanovre. L'opération fut facilitée par un trait particulier aux langues nomades, leur circulation continuelle leur conférant de plus grandes ressemblances que des dialectes locaux immobiles. Il est certain que les dialectes en usage dans le peuple en France différaient beaucoup plus de la langue académique qui, elle, s'unifiera très tôt mais au niveau de l'aristocratie seulement. A tel point que lorsque les Normands eurent conquis la Grande-Bretagne la langue anglaise devra se constituer sur la base d'un mélange 50 / 50 de Français et de Saxon. Tant que la noblesse normande gardera la puissance en Grande-Bretagne, on ne parlera que le Français dans les châteaux de la fière Albion.
Les pionniers américains étaient des nomades en tout, sauf dans leur langue. L'Anglo-Saxon est aussi une famille de langues, comme nous venons de le voir pour le rôle qu'a joué le Français dans sa constitution. Cette famille comprend, en fait, la totalité des langues européennes sauf les langues du sud, l'Italien et l'Espagnol, ce qui ne manquera pas de conférer aux ressortissants de ces deux péninsules un statut très particulier dans la nouvelle colonie. Donc, les pionniers se comprenaient lorsqu'au détour d'un sentier il leur arrivait de se croiser. Détail essentiel, car parler une même langue c'est d'abord pouvoir faire rapidement état de ses intentions. Dans la posture purement nomade, celle d'avant l'agriculture, le problème était beaucoup plus difficile. Il est vraisemblable qu'alors c'était le rite et la gestuelle qui remplaçaient la parole vive. Sans doute le silence était-il de rigueur précisément pour éviter les malentendus, pour ne pas anticiper sur une relation qui pouvait se faire pacifiquement ou ne pas se faire. Mais les Américains rencontraient aussi des Indiens, avec lesquels ils ne pouvaient pas spontanément s'exprimer sur une base commune. On peut donc imaginer qu'ils eurent aussi recours à l'artifice du rituel, tout le monde en connaît certains aspects.
Cette phase de la colonisation de l'Amérique est en quelque sorte le trésor culturel des Etats-Unis. Sa richesse est multiple : au premier plan il y a cette sorte d'audace permanente qui est exigée en permanence de la part de ces aventuriers que l'on qualifie souvent de "têtes brûlées", autant dire suicidaires dans la mesure où en général ce sont des hommes et des femmes qui n'ont rien à perdre. Cette témérité est d'autant plus remarquable qu'il vient de la part d'êtres humains qui ont appris la vie sous les auspices d'une réalité parfaitement sédentaire. Toutes et tous ont des souvenirs de la banlieue de Londres ou de Dublin, de leur village scandinave ou germanique, ils ont été enracinés dans une réalité qu'il ne faudrait pas, imprudemment et trop vite qualifier de sûre, en ces temps-là la sécurité n'était pas un bien automatiquement assuré par l'état, mais la familiarité des lieux et la solidarité clanique remplaçaient très largement les carences du contrat social. Or, face aux espaces américains, il fallait bien faire son deuil de cette bonté de l'environnement, de la chaleur familiale et du flux lent des journées pacifiées par les cloches du village. Dans la culture américaine, et notamment le cinéma, ce thème du courage viril, de l'audace des têtes brûlées, quels que soient les objectifs, fait le fond commun de la plupart des scénarios. L'héroïsme est ce par quoi s'identifie le sujet depuis qu'il a quitté les sentiers de la liberté pour la société, les Grecs on poussé cette détermination jusqu'au bout.
Pour conclure sur l'Amérique, on pourrait dire ceci : sa conquête est une rupture totale avec l'évolution de l'Outre - Atlantique. Les émigrants du Mayflower ne partaient pas dans un autre pays, mais bien comme on le dit encore aujourd'hui, dans un autre monde. Et ce monde ressemblait à s'y méprendre au monde d'avant le néolithique. Le phénomène de la sédentarisation n'avait pas encore affecté la civilisation indienne, qui vivaient encore totalement sur le mode nomade. Et là il y a une observation intéressante à faire, c'est que ces Indiens avaient aussi connu des formes sédentaires, ou du moins se sont retrouvés au contact de formes sédentaires de vie dans le sud. Ce qui signifie de deux choses l'une : ou bien ces Indiens sont des résidus des Empires du sud mexicain et ils auraient donc vécu une évolution inverse de la nôtre, ou bien ce sont des ensembles tribaux qui représentent une forme, peut-être la forme la plus évoluée, aboutie, du nomadisme. L'histoire d'Ishi, cet indien découvert en 1950 dans le désert du Névada et qui n'avait jamais eu de contact avec les blancs parce qu'il se croyait encore en guerre contre eux, montre remarquablement comment vivaient ces Indiens et quelles étaient leurs valeurs. On peut découvrir dans l'ouvrage publié par Terre du Monde et qui porte le nom de ce héros devenu portier de l'Université de Californie, des mœurs qui semblent répondre à la perfection à toutes les questions politiques, morales et métaphysiques, sans dogmatisme et sans la violence qui l'accompagne partout. Le monde d'Ishi n'est pas le monde décrit par Bougainville dans le Pacifique tahitien ou par les utopistes du dix-huitième siècle, il est un monde réaliste et dur, où la paix est la condition première de la survie, et non pas le produit d'une évolution séculaire. Sa morale est une morale ouverte sur le mystère de l'être et respectueuse de ce que l'être dévoile dans l'étant, un écologisme intégral avant la lettre. Dans cette forme d'animisme, ces premiers Américains avaient une relation à l'être dont nous n'avons jamais connu collectivement la forme. C'est sans doute la raison pour laquelle les Européens les ont massacrés si froidement et avec un tel sens de la légitimité de leurs crimes. Eux, les arrivants, provenaient d'un espace où régnait l'oubli de l'être dans ses formes les plus radicales, les religions chrétiennes, il n'était pas question d'accepter une révolution aussi radicale de leur mentalité et de leur économie libidinale.
L'AVENTURE COLONIALE
|
|
"C'était l'Afrique, la vraie, la maudite : l'Afrique noire...
- Restez avec nous, fit le commandant. Là c'est le pays du diable."
Albert Londres Terre d'ébène.
|
Le colonialisme ou l'impérialisme, n'ont pas toujours eu mauvaise presse, même dans les classes modestes. Décrits par les historiens comme des mouvements d'expansion politiques, économiques ou de civilisation, ces vastes mouvements de transhumance ont pris leur essor avec la fin du trafic esclavagiste. Les premiers aventuriers cédaient la place à des administrateurs et à des exploitants, comme si les zones de l'AOF, de l'AEF et de l'Afrique Centrale, étaient promises à un peuplement européen qui viendrait coiffer en maître la destinée des "indigènes", trop contents d'envisager de devenir leurs esclaves sans avoir à franchir les mers du sud. En Europe, dans les fratries paysannes de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, mais surtout du début du vingtième, le départ pour la colonie restait toujours une solution séduisante pour la bouche surnuméraire ou pour le jeune attiré par l'aventure et les rêves de fortune. L'existence sédentaire a un terrible désavantage pour la jeunesse, c'est qu'elle ne laisse aucune place au rêve, du moins le rêve ne peut-il excéder quelques objectifs modestes au plan des conditions dans lesquelles passe le temps dans leur hameau, leur petite commune ou la ville. La grande ville est sans aucun doute possible, la mise en scène des formes aléatoires d'existence, l'anonymat et le jeu dynamique des destins personnels, alors qu'à la campagne, quoi qu'on fasse, le temps finit toujours par s'arrêter. La désertification actuelle des zones rurales n'est certainement pas à mettre au compte d'un quelconque appauvrissement de ces espaces, mais bien à leur appauvrissement dans le mouvement des choses et des destins, et la pénurie de plaisir. La paix ancestrale du clocher dominical et des chants du coq, s'est transformée en cimetière des ambitions les plus humbles. La vie a comme cessé d'irriguer ces espaces, le bras mort du nomadisme étant devenu le champ mort de la vie sédentaire. Au demeurant, le capitalisme et le commerce moderne ont donné une sorte de coup de grâce à la vie rurale, parce que celle-ci abandonnait de plus en plus vite l'autarcie qui définissait en grande partie son essence. Autarcie = liberté, et tant que les paysans ont su tirer leur épingle du jeu dans cette opposition entre leur liberté et l'aliénation industrielle, leur milieu n'était pas menacé. Il en sera autrement dès qu'ils accepteraient de dépendre du commerce et plus tard directement de l'industrie.
Dans ce monde métropolitain qui se pétrifiait de toute part, les gouvernements ne savaient plus comment stopper l'exode rural, autre genre du nomadisme intérieur, qui remplissait les manufactures et donc les villes, quelle que soit la conjoncture. Avec les colonies ils encourageaient la naissance d'un autre exode, ce qui ne fut pas si difficile car depuis le Roi Louis XVI le mouvement du peuple français n'a jamais plus cessé. Tout d'abord c'est la Révolution qui dût s'exporter pour se défendre et établir ses valeurs dans le monde, puis ce fut l'Empire, mais même en pleine prospérité banquière du Second Empire, la capitalisation du plaisir n'arrivait jamais à se faire assez, ni en quantité, ni en qualité. Pour trouver l'ivresse, il fallait choisir la grande ville ou bien l'expatriation. Les colonies offraient un avenir même aux plus pusillanimes, l'état français se chargeant progressivement d'administrer ces espaces inconnus, pour lesquels étaient requis outre une forte maréchaussée, de nombreux ronds de cuir bien primés et à la carrière courte pourvu qu'ils survivent aux climats létaux des Tropiques.
La colonie, c'est l'histoire honteuse de la France, une histoire dans laquelle la République s'est compromise et salie sans scrupules. Si l'histoire présente reste fidèle à elle-même dans sa quête de mémoire, elle jugera un jour les responsables et les coupables. Ce sera pourtant un rude procès, où il apparaîtra sans doute que la belle stabilité de la Troisième République, cet état jubilatoire des Français qui ne tarda pas à les saisir au lendemain même de la défaite de Sedan, bref que ce fut grâce à ces clérouquies modernes qui naissaient depuis l'Afrique australe jusqu'à l'Indochine, que le pays le plus calme du continent réussissait à rester un foyer intellectuel, inventif, puissant et riche, capable de préparer sans trop de faiblesses la prochaine boucherie mondiale de 14-18. Pendant toutes ces années, les colonies n'avaient pas encore atteint tout leur rendement, les grands profits ne commenceront à enrichir les spéculateurs que dans les années trente et quarante de notre siècle, quand les quelques grands travaux d'infrastructure auront ouvert quelques voies essentielles pour pomper les richesses forestières, minières ou vivrières. Les colonies joueront donc longtemps un rôle de fantasme libératoire, de nomadisme onirique dont les contenus évoquaient davantage les joies barbares des Huns que la discipline laborieuse des Romains.
Et de fait, la colonie fonctionnait avant tout comme un immense défoulatoire, où les braves Français découvraient une liberté d'homme supérieur face à l'état de barbarie décrétée. On commence seulement ces dernières années à étudier et à illustrer par des évocations culturelles la vie coloniale. Le destin de l'Afrique du Sud a grandement masqué ce qui s'est passé dans l'ensemble du continent africain, mais aussi en Indonésie, en Extrême-Orient et dans les possessions éparses du Pacifique et des Antilles. L'Apartheid a pris sur soi la plus grande part du péché colonial, et on oublie volontiers que la situation raciste était universelle dans le contexte colonial. Le racisme était de rigueur, même lorsque des individus refusaient de s'y soumettre. Dans les années 50 encore, dans notre siècle, il fallait montrer patte blanche pendant les mois d'essai, il fallait démontrer qu'on était assez raciste pour être efficace, c'est à dire rentable. Pas étonnant qu'un journaliste courageux comme Albert Londres ait déchaîné un véritable scandale lorsqu'en 1928 il s'est permis de décrire la vie et la mort dans ces pays lointains. Le degré d'exploitation des Africains avait atteint une hauteur tenant du génocide, hommes et femmes à la peau noire mourraient par dizaines de milliers dans les grands chantiers ouverts par la métropole aux moindres frais techniques. Londres n'était pas un idéologue anticolonialiste, il ne faisait que constater l'avarice criminelle de la métropole française comparée aux méthodes des autres colonisateurs européens, sur lesquels il semblait lui-même s'illusionner grandement. S'il avait eu connaissance des méthodes néerlandaises de colonisation dans l'archipel indonésienne, il aurait sans doute chanté l'humanité des Français maniant la chicote sur le dos des esclaves noirs. Peut-être n'avait-il pas lu le petit ouvrage de Joseph Conrad qui porte un titre évocateur : "Au cœur des ténèbres", et qui décrit sans fard la situation tragique des peuplades noires du Congo belge.
Au début du vingtième siècle, l'Europe s'était définitivement installée dans son espace clos par des frontières. Les grands schèmes idéologiques à la Hobbes ou à la Rousseau pouvaient commencer à donner leurs fruits pourvu qu'ils soient encadrés par une société réellement telle qu'elle avait été fictionnée par les deux philosophes, c'est à dire une sorte d'espace fixe et définitif, où contrats, lois et règlements pouvaient jouer pleinement leur rôle et échapper à des bouleversements constants. Or, le nomadisme avait regagné en profondeur le désir des européens, comme les Grecs et comme les Romains, ils n'arrivaient pas à arrimer leur bonheur à la terre qui portait leur nom et leurs espoirs. Le colonialisme allait leur permettre de reporter une fois de plus dans l'ailleurs, une espérance plus grande de bonheur et d'entretenir le désir d'échapper à la condition immobile et pensive de l'homme sédentaire.
Mais cet engouement pour les pays lointains et exotiques ne suffira pas à éteindre cette mélancolie qui s'emparait des métropoles où pourtant le progrès technique diminuaient jour après jour les souffrances physiques de la quotidienneté. La pression continuait de monter de partout, le rêve de dériver lentement vers les projets classiques de la guerre, dernière pratique barbare intégrale, dernière ressource pour retourner dans le fantasme du plaisir issu du risque et non pas du travail. L'un des aspects de la colonisation jamais commenté, littéralement passé sous silence dans la recherche historique et donc dans ce qui se transmet dans l'Ecole, c'est l'exploitation sexuelle des colonies. On se scandalise aujourd'hui à propos de ce phénomène que l'on prétend nouveau et qui s'appelle le tourisme sexuel. On fait mine d'oublier que les colonies, toutes les colonies ont été de vastes maisons closes pour les colonisateurs, et qui plus est, des bordels gratuits. En 1958 encore, alors que la Côte d'Ivoire venait de voter son Indépendance sous les auspices de la Communauté franco-africaine, le prix moyen pour une "secrétaire de brousse" - entendez une esclave sexuelle chargée de quelques travaux de ménage - était de quelques bouteilles d'alcool remises au père de la jeune fille, choisie en général dans les âges les plus tendres, et asservie pour une année complète. Que l'on cesse un instant les pompeuses analyses sur l'impérialisme économique des pays d'Europe, et que l'on se penche sur les plus-values libidinales que se sont octroyé tous les aventuriers qui rêvaient bien de s'enrichir, mais qui avaient aussi en vue de quitter le carcan moral rigide des métropoles pour "s'éclater" dans les brousses équatoriales.

III
LA VRAIE CRISE DU MONDE SEDENTAIRE
Les conquêtes coloniales ont été des symptômes réels d'un courant sous-terrain qui n'a jamais cessé d'agiter les sociétés post-médiévales. Au point qu'il faudrait situer le point d'acmé du sédentarisme entre le cinquième et le quatorzième siècle de notre ère, juste avant que la navigation à voile n'entamât ses grandes circumnavigations et ses traversées qui allaient remettre le monde en mouvement. Encore faut-il en retrancher les expéditions des Croisades, mais comme on sait, ces pérégrinations n'affectaient qu'une élite mélancolique, dont les motivations pour la guerre Sainte n'étaient pas foncièrement différentes de celles qui aboutirent aux expéditions coloniales. On sait que la féodalité était en crise depuis le dixième siècle, trop nombreuse et trop pauvre pour tenir son rang, elle chercha un exutoire à ses problèmes dans l'aventure du Proche-Orient. Notons ici que, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, la féodalité s'est définie pratiquement comme une société des égaux. Le doublet classique suzerain/vassal recouvre des engagements contractuels qui n'entament en rien l'égalité d'essence des Seigneurs, une égalité d'honneur qui donne à chacun le droit de menacer la vie de l'autre, qu'il soit petit baron ou duc. Au fond, la dialectique du maître et de l'esclave n'a jamais réellement pu se jouer qu'entre maîtres, l'esclave n'ayant jamais accédé au droit de défier le maître. La crise millénariste, qui est à l'origine des Croisades, était donc avant tout une guerre civile entre féodaux. L'Eglise sut les manipuler en direction de l'appât du gain et de l'aventure nomade, si bien que les Croisades eurent pour principal résultat de favoriser l'esprit de centralisation royale par disparition massive des petits féodaux qui pullulaient dans les forêts d'Europe. La sainteté de Louis IX en a fait autant pour le développement de la monarchie absolue que les catherinettes de Louis XI.
Les Croisades confirment que depuis toujours, depuis l'Antiquité, c'est la guerre qui restait la principale thérapeutique contre l'inconscient nomade, ou du moins son régulateur. Jusqu'au vingtième siècle, la guerre restera l'apanage de la Noblesse, un droit absolu qui sera rarement transgressé même dans des situations difficiles, l'exception venant une fois de plus de la France qui réalisa la première conscription au cours de la Révolution, suivie de celles des deux Napoléon. Cette circonstance est d'ailleurs à étudier pour elle-même car elle fonctionne comme une sorte d'anoblissement mécanique des conscrits : ces conscriptions ont plus fait pour la réussite de la République que tous les textes législatifs et les discours à la Chambre, ne fût-ce que parce qu'à partir de la militarisation des Français sous la Révolution et sous Napoléon, le peuple était devenu soldat, prérogative aristocratique qui faisait d'eux des égaux et une force interne menaçante.
Il nous est difficile, aujourd'hui, de nous installer dans la culture de guerre, de comprendre ce fait incontestable que les générations d'avant la deuxième Guerre Mondiale n'ont jamais vécu en dehors de la perspective de la "prochaine guerre", véritable ciment des époques, à la fois repère spirituel et point d'investissement total des sociétés sédentaires. A tel point qu'il semble assez certain que le plus grand événement qui ait marqué le destin des pays européens au vingtième siècle est le fait que le budget de l'Education ait dépassé celui de la Défense à peu près partout. C'est au vingtième siècle que la guerre a été trivialisée, abaissée au rang de budget comme les autres et qu'elle a entamé pour de bon, semble-t-il, l'effacement de son prestige et de son utilité. Evénement d'importance, tant il reflète une crise de passage à autre chose, autre chose d'inconnu tant il est encore bien trop tôt pour se prononcer sur ce que sera cette autre culture, celle de la paix. Cette mutation n'est pas ignorée par tout le monde, et on travaille déjà, dans quelques bureaux de l'UNESCO sur cette hypothèse selon laquelle la guerre est en voie d'éradication dans l'esprit du monde.
L'EUROPE ETOUFFEE
Cela dit, ce sont bien les guerres qui ont porté le dernier coup à la guerre. Le dix-neuvième siècle fonctionnera comme une plaque tournante, un moment de saturation de la sédentarité qui représentait une masse critique que ne désamorceront aucun impérialisme, aucune aventure coloniale. Le siècle s'ouvre dans la perspective immédiate des guerres napoléoniennes qui se présentent alors comme une opération de modernisation d'une Europe encore partout dominée par le féodalisme. L'Angleterre, seule nation où le modèle féodal a réussi à s'imposer, jouera tout naturellement le rôle principal pour contrer ce mouvement en le poussant vers l'extrême brutalité, en le forçant à la guerre de conquête. Pendant ce temps naissait aussi en Allemagne le mouvement romantique, partagé entre cette volonté de modernisation et la jouissance d'une paix bourgeoise dont on trouve l'exaltation dans toute l'œuvre de Goethe ou de Hölderlin. Immanuel Kant, lui, se préparait à rédiger un écrit dont le sujet n'était rien de moins que la paix perpétuelle. Tout se passe donc comme si l'éthique sédentaire jouait son va-tout en Europe, la France avait trouvé la solution démocratique, l'Allemagne découvrait son attachement philosophique à la terre. Mariage presque parfait et qui aurait pu magnifiquement fonctionner, si la perfide Albion n'était venu troubler cet hymen avec l'aide d'une Russie encore dans les limbes de l'anarchie féodale.
Pourquoi mariage parfait ? Car cette solution représentait le dépassement dialectique des oppositions de principe entre démocratie et attachement au sol. La Révolution Française avait fait un miracle : imposer une éthique d'essence essentiellement nomade, l'égalité, a une société enracinée dans un sol selon la pire des inégalités. De l'autre côté du Rhin, le peuple allemand sortait enfin de son errance féodale-nomade, et découvrait ce qui allait devenir bien plus tard le Blut und Boden, le sang et le sol, quelque chose comme son identité dans la multiplicité des fiefs. Il faut lire une bonne biographie de Hegel pour découvrir à quel point déjà dans les années 1805, les Länder germaniques se vivaient dans une sorte de fraternité spirituelle. Les universitaires allemands existaient déjà dans une nation universaliste, et le marché des professeurs planait bien au-dessus des frontières internes. Sorti de son contexte sociologique, c'est à dire de ses implications sur le droit, cette découverte idéologique marque la stabilisation définitive de l'espace germanique et ouvre la perspective de l'unification. On peut rêver à une Europe dominée par les deux grands pays continentaux modernisés dès cette époque, et à toutes les horreurs qui auraient pu être évitées pour en arriver quand même à ce point ! Les romantiques ne s'y sont pas trompés qui ont soutenu comme ils purent ce projet grandiose. C'est que le romantisme en tant que tel peut être considéré comme l'entéléchie de l'idée sédentaire : l'homme de culture découvre le site qu'il habite, il découvre qu'il habite un site et s'interroge sur ce que signifie cet habiter. Cette première forme de l'écologisme contemporain est alors un moment de grâce collective dans une Allemagne florissante et belle. Mais ne nous y trompons pas, le vrai romantisme, celui des frères Schlegel comme celui de Goethe ou de Hölderlin, n'est pas constitué par des hymnes écologistes avant la lettre, il est d'abord une revendication de la vérité qui précisément gît en dessous des beautés que la nature expose sur la place publique. Il ne se mire pas dans les tableaux champêtres qu'affectionnait Marie-Antoinette, mais pose la question de l'écart entre la beauté qui nous entoure et le mal qui nous ronge. Hölderlin apporte sa réponse grecque parce qu'il y distingue la même fracture entre l'édifice humain du beau et la misère nécessaire du déclin. Redécouvrir le miracle grec ce n'est que reprendre le problème à zéro de cette discrépance essentielle entre la beauté de l'un et la souffrance du multiple. Or le nomade d'avant, si on le situe dans son habiter essentiel, c'est à dire planétaire, résout existentiellement cette contradiction. Il se démultiplie en tant que vivant dans une réalité qui est une pour lui, unité qui se reflète sur lui et efface la multiplicité que représente son mouvement. L'arrêt, au contraire, précipite l'être humain dans une multiplicité qui lui fera perdre sa propre unité, d'où l'hypothèse aujourd'hui dominante, selon laquelle la conscience serait née à ce moment-là, dans ce jeu de stop and go qui a commencé il y a environ six mille ans. Mais c'est bien mal connaître la conscience que de la reléguer au rang de simple conséquence, de simple effet d'un changement matériel. Nous y reviendrons à la fin de cet essai.
L'échec du Consul Bonaparte aura des conséquences sans limites. L'Europe va se transformer en une bouilloire dont la pression ne cessera de faire siffler balles et boulets à travers le continent tout entier. Elle étouffe. Elle va être contrainte littéralement de s'inventer des guerres-soupapes, nouveau concept seulement pour ceux qui ne voient pas la logique implacable qui lie les découvertes de l'industrie et de ses vastes capacités meurtrières avec la nécessité de les mettre en branle sur le terrain. A bien considérer, par exemple, la guerre de 1870 et son épilogue, on constate que ce ne fut qu'un exercice imaginé par Bismarck pour tester deux éléments de sa politique : l'industrialisation allemande galopante et la synchronie des différentes armées germaniques, preuve de la maturité allemande pour une unification qui sera effectivement le résultat le plus concret de cette guerre. C'est un trait romantique qui ne reflète en rien Hitler sous l'Arc de Triomphe, que de voir le chancelier donner l'Empire à son souverain dans le château de Versailles même : il lui tenait plus à cœur de donner à l'unification de l'Allemagne un cadre grandiose que d'humilier ainsi le vaincu. Bismarck aimait la France comme les Allemands d'aujourd'hui, d'une admiration étonnée mais sincère.
Cet étouffement progressif ne se faisait pas seulement sentir par les tensions militaires, mais aussi par l'évolution sociale de l'Europe du dix-neuvième siècle. L'instillation d'égalité qui suivit tant bien que mal la grande Révolution Française, devint un autre abcès de fixation pour l'Europe monarchique et féodale. Entre 1789 et 1918, la France était considérée par ses voisins européens comme une sorte de Cuba dont on attendait d'une part qu'elle s'écroule du jour au lendemain, et qu'on s'ingéniait comme on pouvait à précipiter cet écroulement. En envahissant la France, Bismarck n'a-t-il pas, en dessous des cartes visibles de son jeu, littéralement volé au secours de Napoléon III qui lui semblait le seul à même de contenir la peste républicaine ? Son retrait de France sans autre exigence qu'une indemnité de guerre que notre pays paiera rubis sur l'ongle en cinq ans, c'est à dire bien avant le terme fixé, montre bien que son but n'était pas d'affaiblir ou d'anéantir la France, mais de contrôler, autant que faire se pouvait, un jeu politique où le républicanisme menaçait de réussir et de contaminer toute l'Europe. La Commune de Paris a bien joué ici le rôle de rideau de fumée, dont le destin a totalement rassuré le Chancelier sur les intentions réactionnaires des nouveaux maîtres de la France, ces Versaillais qui allaient si vite nous donner une nouvelle République.
Dans son propre pays, Bismarck connaissait aussi des tensions montantes entre les représentants du nouveau Reich, c'est à dire les députés soumis à la monarchie Willhelmienne et ceux qui peuplaient en nombre croissant les sièges du Reichstag, les futurs socialistes. Le monde du travail parlait à travers toute l'Europe, et nos historiens feraient bien de revoir les thèses rebattues de la volonté d'hégémonisme ou de prépondérance nationale comme principaux facteurs de guerre. La vérité est que de Londres à Moscou en passant par Berlin et Paris, la question s'était déplacée vers les tensions internes et les moyens de les contenir. En Allemagne, l'évolution entre la guerre de 1870 et 1914 est parfaitement claire : la militarisation à outrance nourrie d'un nationalisme mal tempéré est la seule réponse à la montée fulgurante des socialistes au Reichstag. La droite républicaine et ce qui reste de monarchistes non masqués en font de même à Paris pendant qu'à Moscou on se prépare aux massacres de 1905. Même Londres n'échappe pas au phénomène, bien que son souci va d'abord aux évolutions du continent, une politique qui ne varie pas depuis le dix-huitième siècle. Bref, l'atmosphère devient étouffante à travers toute l'Europe et les gouvernements ont peine à faire passer la pertinence d'une nouvelle guerre franco-allemande tout en s'y préparant activement (voir les votes des budgets militaires entre 1895 et 1914).
RIMBAUD : LA CASSURE
Dans le contexte d'une telle théorisation qui se réclame du poétique, il est intéressant de s'arrêter un peu sur un exemple tiré du siècle dont nous venons de parler, et qui, pour des raisons évidentes, confirme radicalement la thèse d'un échec du sédentarisme. Nous y trouverons tous les paradoxes rassemblés, si magnifiquement rassemblés qu'il ne serait pas impossible d'affirmer que toute notre thèse pourrait se contenter de l'exemple de la biographie de Rimbaud pour se soutenir, sans autre référence. Oui, Rimbaud à lui tout seul a fait l'expérience consciente de ce qu'on pourrait appeler la ruine ou la pourriture des siècles immobiles. Nous n'allons pas refaire une biographie de ce prince des poètes, qui, comme on s'empresse de le dire à chaque fois qu'on l'évoque, tient encore aujourd'hui la corde de la célébrité, du succès sans phrase, et, on pourrait dire pour résumer qu'il monopolise d'une certaine manière et d'une manière originale, la notion de génie. Beethoven est un génie comme Léonard ou Descartes, mais Rimbaud est le génie absolu, le frêle adolescent dont a jailli un flot de beauté vraie sans qu'il y paraisse lui-même beaucoup, on dirait qu'il est la main même des Muses, le porte-parole d'un Dire de l'être.
Nous nous attarderons en revanche sur certains moments de sa vie sur lesquels justement peu de biographes se penchent sérieusement. Son engagement comme Légionnaire Batave en Indonésie suivi d'une désertion (on pense tout de suite à Ernst Jünger qui réitère le geste peu avant la Première Guerre Mondiale, sans que l'on sache d'ailleurs avec exactitude s'il existe une relation entre l'exemple de Rimbaud et l'aventure de l'écrivain - guerrier allemand). Et puis, bien sûr, ce revirement destinal que constitua son aventure dans la zone passionnante de la Mer Rouge, mais aussi son comportement ambigu lors de la Commune de Paris, quand son " cœur bavait à la poupe "au milieu des événements " abracadabrantesques ".
Non pas pour donner encore plus de détails sur tout cela, car on n'en possède pas, mais pour analyser et éclairer des décisions qui n'ont pas cessé de surprendre le monde littéraire et l'autre. Bien sûr on n'évitera pas une lecture de Rimbaud, mais une lecture qui figure surtout déjà dans la thèse générale de cet ouvrage auquel on aurait aimé pouvoir donner le beau titre de " Bateau Ivre ". Ce poème est le résumé dernier d'Atopie, faut-il le souligner ?
Ce qui fait scandale dans l'existence du jeune Rimbaud surgit d'abord de son parallélisme avec celle de Verlaine. Verlaine est le type même du provincial parisianisé. Lorrain comme lui, Rimbaud ne voudra jamais réellement jeter son ancre près du Léviathan de la Culture, vivre au cœur du mouvement littéraire qui porte, entre autre, le nom si évident de Parnasse. Rimbaud n'est pas mondain, Rimbaud n'est pas un arriviste de ces nouveaux métiers qui ont surgi de l'écriture, il ne cherche en aucun cas la Gloire littéraire. La pureté de son écriture est toute entière dans cette vérité, que le jeune Ardennais écrit pour hurler son être et pour rien d'autre, aucune finalité secondaire, même s'il se reconnaît comme poète, premier paradoxe qui l'amènera à fréquenter celui qui est " monté " à Paris pour la conquérir. Rimbaud rencontre Verlaine au cours d'une errance métaphysique qui commence, d'ailleurs tardivement par rapport à son œuvre, et cette rencontre est toute entière une rencontre humaine, et non pas littéraire. N'étant agrégé de rien, je ne suis pas en mesure de juger des ressemblances et des dissemblances entre les œuvres poétiques des deux hommes, je ne peux qu'affirmer que je ne vois qu'un seul trait qui unit les deux textes, celui du genre. Entre la poésie de Verlaine et celle de Rimbaud, rien, aucune comparaison possible, aucune possibilité de les mettre sous un même chapeau, sous une même rubrique stylistique ou autre, j'ai toujours trouvé assez con (pour tout dire le plus platement possible) l'invention des écoles et des courants, occupation assez vaine et surtout appréciée des cuistres, comme on peut le constater dans les commentaires Anglo-Saxons, friands de science littéraire. Non, la singularité de ces deux hommes se prouve, je dirais, par le mouvement, c'est leur écriture qui les distingue d'abord. Un exemple ? L'absence totale d'émotion chez Arthur. Comment pourrait-on comparer deux hommes dont l'un passe son temps à pleurnicher ou à boire sa vie, et l'autre à la fouetter d'héroïsme et de mépris pour les vices et la promiscuité ? Gageons que l'aventure homosexuelle que l'on prête aux deux hommes avait comme moteur aussi cet héroïsme dans le plaisir et la douleur qui caractérisa Rimbaud tout au cours de son existence, pas si brève qu'on veut bien le dire, interminable si on l'étale dans toute la richesse de ses expériences. Là où Verlaine est un simple cosmopolite à la mode, Rimbaud est déjà un citoyen universel, là où Verlaine se montre comme un simple consommateur malheureux du temps, Rimbaud chevauche tous les défis de son siècle, dont celui qui consiste à renoncer à la beauté contemplative, à la chaude position couchée dans le sillon de son talent.
Héros, Rimbaud avait pris très au sérieux le texte humaniste gréco-latin. Mais non pas pour se proposer de le prolonger ad libitum à l'abri des belles Lettrines dorées, mais pour le faire revivre dans la dimension du réel. Ce réel, il le rencontre enfant dans une conjoncture diabolique, celle de l'orphelin du Héros, fils de soldat, descendant d'un homme qui n'avait rien de la Noblesse nominale et tout de son privilège encore presque intouché de la guerre. Ajoutez à cela la solitude d'une mère toute entière dévorée par cette noblesse blessée (allitération fort intéressante au demeurant, il faudra y revenir) au milieu d'un désert, nous dirions culturel, où tout l'être de la Civilisation qui porte tout cela, le théâtre des opérations, se résume dans l'Ecole et son cher Maître et ami. La passion de Rimbaud, la première et fondamentale passion n'était pas la poésie, mais les Belles Lettres. Toute son excellence se manifestait alors dans ses magistrales versions latines et dans ses thèmes parfaits, il travaillait la langue morte comme s'il vivait dans les siècles antiques, preuve évidente de son amour pour les contenus, son admiration pour la passion elle-même qui vit encore dans les grands écrits de nos lointains Ancêtres. La poésie, a, semble-t-il, un autre statut. A supposer que le jeune lycéen se soit épris de la poésie par le biais des exemples littéraires antiques, c'est à dire qu'il se soit lancé dans une pure imitation du métier de poète tel que le décrivent les œuvres historiques, Rimbaud aurait écrit autre chose. Sans doute aurait-il cédé au désir naturel de refaire sa version de l'Enéide, comme l'ont fait les poètes classiques comme Dante, il en avait l'envergure, peut-être aurait-il réécrit entièrement l'Iliade, ce qui correspondait bien à sa donne existentielle de fils de héros.
Mais il ne l'a pas fait, que dans un court sonnet où le soldat dort déjà, deux trous rouges au côté droit. Première Illumination, Rimbaud prend conscience de la mort de la guerre : le fusil a tué la guerre, le Lebel n'est pas loin, s'il n'est pas déjà dans les cartons de l'inventeur (à vérifier). La poésie classique ne peut donc pas survivre, elle ne peut plus accompagner la réalité, la sous-tendre et la motiver, la poésie classique est obsolète, elle n'est même plus le son de l'olifant de Roncevaux, elle est morte comme la langue qui la profère. Le jeune homme tourne donc son regard vers un autre monde, tout bonnement le sien, celui des Siens, celui de sa Pénélope de mère, celui des Femmes à Genoux, et aussi, déjà, celui de Jules Verne et des imaginaires d'adolescents. D'adolescents certes, mais surtout d'adolescents de la Civilisation. Le Bateau Ivre condensera sans appel le voyage initiatique de cette Civilisation dont les auteurs quittent le ciel à reculons attirés par l'abîme marin. Alors, pourquoi continuer à faire semblant ? Après Bateau Ivre, que reste-t-il comme perspective d'existence ? Les voies royales de l'héroïsme des Hellènes et des Romains ont disparu depuis longtemps, forme et fond, coulées par l'aboiement des canons, ensablés par la médiocrité des consommateurs de temps, ces humanoïdes Chrétiens qui ont pris la relève des héros de Salamine. Il faut comprendre le sens exact d'Illumination. Il ne s'agit pas d'une inspiration subite ou d'un événement mystique, pas du tout, il s'agit d'une prise de conscience brutale de sa propre histoire, de la position qu'il occupe en tant que héros, dans un monde moisi par son immobilité, dans un monde qui s'est défait silencieusement, noyé dans son propre projet de soldat-laboureur. Rimbaud comprend qu'il est cuit, que son rêve est un enfantillage dépassé et qu'il ne lui reste aucune chance de s'accomplir dans son rêve antique et pioupiesque. Et pourtant, il reste une chance, là-bas sur les frontières coloniales, de jeunes Européens paraît-il, se battent pour conquérir, auraient reculé les limites de l'Empire cerné par les Indiens, exercent aujourd'hui même le beau métier de soldat au milieu des miasmes tropicaux. Alors pourquoi ne pas tenter le coup ?
Ici le commentaire prend le pas sur la réalité historique. Rimbaud s'engage dans la Légion Batave qui bataille, paraît-il, dans les eaux de l'Océan Indien autour des sept mille îles et îlots de l'Indonésie. Nous ne savons pas grand chose de ce qui lui arrive, mais nous savons ce que fut cette conquête de l'Indonésie par les Hollandais, la pire abomination dont l'Occident se soit rendu coupable au cours de ses conquêtes dites coloniales. Les récits et les documents sont fort rares, mais tous les historiens s'accordent sur la brutalité singulière de la colonisation néerlandaise. Lors des massacres des communistes, au moment où Suharto renverse son commensal Suekarno, le nombre de morts (près d'un demi million en quelques jours) effraye le monde entier. Les commentateurs iront chercher les exemples dans l'histoire de ce pays et ne trouveront que celui de la colonisation, massacre permanent et gratuit qui n'aura fait qu'inoculer la barbarie génocidaire des Européens à l'un des peuples les plus charmants et les plus civilisés du monde, l'Indonésie était une grande puissance avant le néolithique... Rimbaud s'enfuit écœuré et regagne miraculeusement la France, un retour aventureux qui n'a rien à voir avec la fin idyllique et paternelle de la désertion de Jünger en Algérie. Rimbaud s'engage mais paye cash en danger et souffrances diverses, il apprend son futur métier d'aventurier, il sait déjà que son salut n'est pas et ne sera jamais plus dans la poésie. Illuminations. Un voile sanglant s'est déchiré sur le monde, sur son monde. Rimbaud a perdu son pucelage ontologique. Désormais, tous les autres peuvent suivre. Il tente un moment les vices de l'époque, protégé par le libéralisme belge et britannique il s'essaie à la sodomie, la drogue et la boisson, sans conviction. Non, il n'est pas un Verlaine ventru et veule, il ne peut pas se résoudre à noyer son chagrin métaphysique dans les pintes de bière tiède de l'East End. Son Orient à lui est mort, ou peut-être seulement à venir, en cherchant bien, on trouvera une Indonésie plus vraie que la vraie, un espace de rodéo qui aurait quelque chose à voir de près ou de loin avec le mythe grec, avec les campagnes des Légions romaines.
La poésie ? Elle est loin dans l'esprit d'Arthur. Elle a tout perdu, elle n'est plus rien. On peut même se demander comment la France littéraire a pu conserver cette œuvre, une œuvre a ce point déchue dans l'esprit de son auteur. Non pas reniée, Rimbaud ne perd pas son temps avec les regrets ou les remords, mais simplement délaissée là où elle s'est arrêtée, faute de sens, de sens dans la vie du poète. D'un poète qui ne cessera pas d'être un poète parce qu'il cesse d'écrire, mais qui ne peut pas réduire son existence à la copie, à celle d'un copiste médiéval, enfilant les figures de style et les martingales rhétoriques. Il a déjà donné les plus géniales, celles qui écrivent le réel dans sa vérité la plus crue et la plus limpide, il n'a plus envie de se cacher derrière le buisson du beau pour donner à son existence un alibi assez solide pour continuer à vivre. Il aurait pu se suicider, à ce moment-là, en finir avec le non-sens de ce qui vient de se fermer dans son désir, mais le suicide était déjà au programme de son aventure indonésienne, or Rimbaud n'a rien d'un suicidé, il n'a aucune prétention à se " donner " la mort lui-même, il va faire ce qui lui reste à faire, partir et errer, errer dans la partie du monde la moins recherchée, entre des actions hasardeuses qui finiront par faire une petite boule de neige, un petit bas de laine qu'il n'aura même pas le temps de consommer.
O que ma quille éclate, o que j'aille à la mer !
Et sa quille - c'est l'interprétation d'un ami psychanalyste- c'était son genou, le membre qui va provoquer sa mort quelques années plus tard. Bien vu Jean Guir, la quille c'est bien le genou dans l'ancien vocabulaire des marins.
Le genou de la Civilisation, c'était son aspiration à la position sédentaire. Vraie ou fausse, peu importe. Je veux dire que l'idéal sédentaire, sédentaire-Chrétien faudrait-il dire, n'aura jamais été qu'une apparence, que les dehors d'un prétexte à Loi morale, au fond l'alibi permanent destiné à légitimer l'instinct despotique de nos aristocrates. Et l'exemple de Rome et de la Gaule est frappant : César vient " pacifier " ce qui est déjà depuis bien longtemps en paix, ce qui a trouvé les voies du sédentaire bien avant Rome, exactement comme l'avaient trouvé les Etrusques, floués par la tchatche romaine. Le sédentarisateur Rome, est un imposteur, un nomade qui a pris cette sédentarisation comme fond de commerce, un fond riche de profits juteux, de plus-values infinies de magnificence urbaine en retraites militaires confortables. Au fond les Romains, et puis ensuite les Francs, se sont bien moqué du monde avec leur Cité : Rome n'aura jamais eu plus de valeur que la yourte de Gengis Khan ou le Samarkande de Tamerlan, simples lieux de stockage du produit de leurs rapines. Et ce genou a éclaté en même temps que celui du poète. C'est pourquoi nous avons intitulé ce chapitre LA CASSURE.
La force et le génie de Rimbaud sont tout entiers dans cet être-prophétique de l'échec du Titanique Civilisation. Homme figé, gelé dans les contreforts des Ardennes où aucune chance jamais ne lui était ouverte de vivre ses passions d'enfants, que ce soit la mémoire fêlée d'un père absent ou la mémoire forte du texte des Humanités, Rimbaud s'est révolté contre cette condamnation de son destin d'homme nourri des valeurs de l'Univers à la consommation des valeurs de son territoire. Arthur a été séduit par le projet de la Commune de Paris, il semble même qu'il s'y soit engagé assez loin mais que son expérience batave (une expérience aussi politique que simplement militaire) l'ai mis en garde contre la grandiloquence et son autre la misère morale. Il a eu l'occasion de mesurer le gouffre qui sépare la beauté des idéaux et l'horreur des réalités, et son poème prouve qu'en pénétrant dans le Paris insurrectionnel, il pressentait déjà l'échec et l'issue fatale, une issue à l'indonésienne... mot pour mot. L'échec là est total, métaphysique : le bateau s'échoue sur le sable des fonds marins parce que la seule chance de jamais accéder au combat des valeurs antiques s'est évanouie, Monsieur Thiers a remis de l'ordre dans la consommation des Biens de ce monde, empêché les pires transformations, mutilé définitivement la créativité révolutionnaire des Français. C'est vrai, j'ai souvent insisté sur la mutilation du peuple germanique lors des massacres religieux conduits par Charlemagne et des révoltes successives écrasées dans le sang, mais je m'aperçois que cette manière d'analyser l'histoire humaine peut aussi parfaitement s'appliquer à notre pays, et notamment à propos des échecs successifs et décisifs aussi de la Montagne et de la Commune de Paris. J'aimerais encore y ajouter Mai 68, mais soyons sobres, et gardons quelques amis...
Suit alors l'aventure orientale d'Arthur, ce Tintin avant la lettre mais auquel Hergé a dû souvent penser, tant son œil est aiguisé dans la description de cet Orient si mystérieusement évident. En effet, la Mer Rouge c'est le lieu de la Guerre par excellence, on pourrait dire le centre géodésique de ce qui reste alors (et aujourd'hui encore, eh oui, comment expliquerait-on que le monde entier garde son regard braqué sur les épisodes des querelles israélo-palestiniennes ?) comme espace pour guerriers antiques, pour héros pas de BD, pour nostalgiques de l'aventure nomade, des razzias ludiques et tragiques et des abandons hédoniques sur les gazons des oasis. Arthur vise juste. Que se passe-t-il dans son esprit ? Quel est son projet ? Sait-il qu'il va finir comme négociant en tout et en n'importe quoi, qu'il va fonder une sorte de comptoir où le commerce se nourrit des complots et des vendettas incessantes entre patriarches pas encore convaincus que le commerce en tant que tel est leur vrai destin ? Nul ne le sait, on ne peut que conjecturer son dégoût pour le monde qui l'entoure, mais comme nous l'avons déjà souligné, Arthur n'est pas un émotif ni un sentimental, il analyse froidement les situations et ne décide rien en fonction de l'esthétique. Il vise juste en choisissant la Mer Rouge précisément parce qu'il analyse froidement la situation géopolitique de son monde : la Mer Rouge est et restera longtemps un espace de liberté totale. La convoitise pétrolière est encore loin et le conflit des Juifs et des Arabes seulement un vieux souvenir, certes prêt à se rallumer à la moindre alerte, mais pas opportun dans cette zone du commerce de la guerre par culture, de la guerre comme éthique de consommation (quel culot quand même). Rimbaud se fera lui-même Juif, le Juif d'Aden, serviteur zélé des passions tintinesques des cheikhs et des chefs de clans. Il ne peut pas entrer dans les querelles, celles-ci ne sont pas les siennes et il aurait l'air ridicule de s'en mêler. Non le grand Art pour lui est de mimer des Alliances avec les uns et les autres, de prendre parti tout en vendant ses fusils aux uns et aux autres. Enfin, on ne sait trop rien de ce qu'il fabriquait dans son oasis philosophique, il n'en reste pas moins qu'il fait sa pelote, et qu'en bon paysan ardennais, il prépare sa retraite sur le continent : " retour des colonies, prêt pour la politique ".
Au fond, Arthur est un jeune Français parti pour les Colonies. Il n'a pas choisi l'Afrique Noire parce qu'il se méfie à juste titre d'une conquête qui ressemblerait par trop à ce qu'il a pu voir en Extrême-Orient. Il préfère un monde encore dégagé de l'emprise des grandes puissances du moment, et dans lequel il ne jouera qu'un rôle d'étranger techniquement efficace, il inaugure au fond la position de conseiller d'une Coopération Technique privée et d'autant moins suspecte aux yeux des autochtones. Mais son objectif est tout ce qu'il y a de plus plouc : faire des économies, qui lui permettront entre autre d'entretenir les femmes de sa vie, c'est à dire d'abord sa mère, et rentrer en France couler les jours heureux d'un Ulysse qui a donné, risqué sa vie et conquis sa Rome à lui, le droit de s'étendre dans les frais valons de ses Ardennes natales, sans trou rouge au côté droit. Que voilà un mythe crevé, semble-t-il, un Dieu insulté ? Une légende meurtrie et trivialisée ? Pas du tout, Rimbaud demeure Rimbaud parce qu'il est tout simplement un homme comme les autres, un homme qui n'a pas pu accepter de construire sa vie sur un mensonge ou sur un libertinage culturel profitable, par instinct aristocratique. Arthur est resté honnête de bout en bout parce qu'il entendait rester maître de son destin, de rester un Homme Libre, celui qu'il avait découvert dans ses versions grecques et latines. Mais plus simplement, Arthur n'a jamais écrit pour faire de la littérature, Arthur a usé de son génie de la langue pour faire sortir les cris de son âme angoissée. Et ces cris étaient tellement déchirants qu'ils ont crevé la toile de la Culture du siècle sans jamais y appartenir vraiment, sans s'inscrire réellement dans la Tradition Poétique telle qu'en elle-même l'Anthologie de Monsieur Pompidou l'anéantit pour de bon.
Rimbaud est ainsi le symptôme le plus vivant et le plus complet de la crise qui secoue le siècle qui s'ouvre sur l'aventure nomade de Bonaparte et s'achève sur les préparatifs du Grand Massacre de Verdun. Les voltes délicates de son âme se lisent dans les voltes face de son existence, et il est vraisemblable que ce destin est comme le paradigme de la grande Cassure qui va déverser ses contenus empoisonnés dans le Vingtième Siècle. Il est comme la préfiguration de l'appel au nomade, ou du rappel du nomade dans ce fourvoiement des idéaux territoriaux, nationalistes et finalement fascistes : les soldats romains en campagne dormaient à côté des faisceaux, comme les soldats de 14.
LA REPONSE MILITAIRE : LES GUERRES DE NEANTISATION
Le nihilisme comme théorie philosophique avait largement précédé les actes qui allaient enseigner aux hommes du monde entier, l'art de transformer l'étant en néant. Or, sa catéchèse dans les élites franco-allemandes ne leur a pas permis de le prendre pour ce qu'il était, c'est à dire une parole prophétique. Le funambule du Zarathoustra tombe de son filin d'acier et ne s'en relève pas, c'est ce qui va arriver au peuple allemand. La volonté de puissance, elle, tombe à pic pour soutenir une politique d'état-major impérial, mais on ne saisit pas toutes les nuances de l'éternel retour. Pourtant, les deux catastrophes qui se préparent indiquent plutôt l'imminence d'un retour, qu'une progression indéfinie vers des lendemains glorieux. En tout cas, le malaise dans la civilisation n'a jamais atteint un tel degré, toutes les roues de la société grincent, les moteurs rugissent dans les soirs rougeoyant des aciéries où se fondent les sources du non-être, le cœur des capitales palpite de plus en plus frénétiquement, les gens allemands et les gens français sont partagés dans l'angoisse. D'un côté leur conscience leur peint un destin gris sur gris si la guerre n'éclate pas, de l'autre l'aventure d'une bataille dont on ne sait rien d'autre que ce qu'on fantasme, une sorte de Loto tragique mais dont on préfère contempler les numéros gagnants
Dans la coulisse des âmes, la joie de briser le temps du travail aliéné, ce temps qui tout en s'accélérant chaque jour s'est comme figé dans les fibres de l'acier, du bois et des textiles, dans les aiguilles meurtrières de l'horloge d'atelier, et dans les dettes sans fin des mois noyés d'alcool. Le socialisme est un raisin trop vert, trop tard venu pour modifier les représentations nationales, c'est à dire le vrai pouvoir et trop tard pour modifier les représentations que l'homme de la rue s'en faisait. Il suffira de quelques assassinats, ici et là, pour éviter toute surprise de dernier moment. Car l'âme est volatile en ces temps d'émotion, et un Jaurès n'aurait pas manqué d'au moins parvenir à retarder le pire. A se demander si ce Vilain qui l'a froidement révolvérisé n'était pas un agent de l'état-major en service commandé : il n'était pas question de retarder la fête d'une seule journée. Des deux côtés du Rhin d'ailleurs, on a été vite à la fête, l'orgasme s'amplifiant dans les gares décorées pour l'occasion, chacun fanfaronnant sur son billet gagnant. Ce fut une sorte de tabula rasa psychique, l'homme se dénudait d'un coup de son habit de civil(isé), les grandes vacances s'annonçaient magnifiques et glorieuses, d'où l'on reviendrait plein d'honneur et plein les poches. Et puis même si l'on n'en revenait pas, on serait débarrassé d'une existence qui ne valait plus qu'on la vive, socialisme ou pas. Jaurès était bien seul, ses propres troupes étaient gagnées par cette peste suicidaire qui fleurissait les fusils et gangrenait les esprits. Des mornes campagnes et des sombres banlieues fumantes s'élevait le chant de la liberté et du mouvement vers l'inconnu, vers des sentiers jamais foulés, des destins entièrement à refaire. Et on était tellement sûr de les refaire à sa taille, selon son désir sans limites où la mort ne figurait que comme un éclair de fatalité vite passé, si vite oublié dans le néant du loto perdu. Poète, mets-toi dans la peau de cet homme-là, écoute son cœur battre d'une joie qui vient d'effacer tous les rêves fatigués de la veille, tous les fantasmes si absolument trahis, toutes les perspectives de lendemains qui frustrent sans pitié jusqu'au tombeau, toute une machinerie de responsabilités qui épuisent cœur et âme, les enfants qui coûtent plus cher à mourir qu'à élever, les femmes de cette nouvelle vie de couple réduite à l'acquêt du tête-à-tête meurtrier, même Paris s'éloigne, cette gueuse bon marché où se mitonnaient les morts à crédit. Assurément, si le socialisme avait su faire battre les cœurs en 1914, si un futur plus égalitaire, plus confortable, plus eau courante, électricité, salle de bain, vide-ordures et congés annuels avaient possédé un poids spécifique poétique suffisant pour apporter l'émoi aux âmes nées dans cette France, aucune Chambre Bleue Horizon n'aurait pu se former si lâchement, si lâchement qu'on pense à la préparation clandestine d'un crime collectif. La civilisation française démissionnait d'un coup, en bloc, craquait devant le principe de plaisir, devant la jouissance immédiate et mortelle. La fête allait commencer, là, immédiatement, sans report, au bout de ce train chamarré de bleu, de blanc et de rouge.
Un rouge dont on allait connaître la véritable nature, là-bas, tout de suite au débotté dans l'assaut encore enthousiaste coiffé de rouge, pantalonné de bleu, véritable fleur de saison promise à une mort subite. On n'aura jamais assez raconté ce printemps violé d'un coup, à la hussarde, la grande émotion de l'avance éclair de Godzilla à travers les plaines champenoises, la proximité soudaine du monstre, angoisse encore jouissive des Parisiens qui avaient lieu de s'y croire, encore en 1914, taxis marnant jour et nuit pour réparer les grandes bêtises de l'état-major, lui le peuple de Paris, comme un demi-siècle plus tôt. Et puis le froid de l'automne qui se referme sur le plus grand malentendu du millénaire : ces hommes pensaient descendre du train pour bouger, courir sus, foncer sur l'ennemi, ravager son pays et ses villes, venger les charges des Huland à Reischshofen, violer ses femmes et faire du butin, les voilà d'un coup englués dans la glaise battue de pluie et d'obus, de marmites et de shrapnels, d'acier coupant, écrasant, s'enfonçant dans la chair, explosant les têtes scandalisées, tranchant mains et jambes, les jambes qui ne servaient plus qu'à sauter par-dessus les premiers cratères du plus grand labour de l'histoire des hommes.
Ces nomades d'un dimanche, trahis par l'univers entier, iront retourner leurs armes contre la terre elle-même, véritable auteur de cette trahison. Des millions de projectiles vont retourner la terre, raser les forêts, rendre stérile pour des décennies les terres qui donnaient tant. Il faudra trois-quarts de siècle pour que la Somme, la Lorraine et la Champagne, les riants valons de la Meuse retrouvent leur être de paysage, ces vastes espaces sont devenus en quatre ans le plus grand gisement d'un acier de grande qualité, même les quelques arbres qui ont survécu s'en étaient imprégnés, saturés, se consolant d'en être quitte des outils du forestier et du menuisier. Les hommes de la Grande Guerre se sont vengés désespérément de cette terre qu'ils avaient fini par vomir, de cette vie immobile qui se dressait devant leur futur comme un purgatoire définitif. Au fond des tranchées, ils retrouvaient dans son essence leur vie d'avant, cette immobilité glauque d'un destin auquel ils avaient cru un instant pouvoir se soustraire. Les y voilà maintenant, les voilà désormais au cœur même de son horreur.
L'autre peuple, les verts de gris casque pointus, avaient des consolations. Leurs trains couraient d'un côté à l'autre des théâtres d'opération qui s'étendaient entre la Champagne et le Caucase. Jour et nuit ils charriaient, selon les besoins, des soldats hébétés qui partaient au combat en sautant du train, sans même savoir dans quel pays ils étaient, Russie, Pologne, Roumanie, France ? Le peuple allemand s'exerçait déjà pour une autre guerre, pas si loin que ça et qui, celle-là, mettra en branle le monde entier, sur terre, dans les mers et dans l'air. Hitler était un très mauvais stratège, mais il avait eu la révélation du mouvement, il fallait des roues, des chenilles, des moteurs, des voies de chemin de fer et des routes, il avait compris qu'il fallait transformer tout le pays en machine de guerre. Les autoroutes ont été dès leur conception des voies stratégiques, les structures guerrières de la terre elle-même, la maîtrise du sol au service de l'assassinat collectif. Blut und Boden - sang et terre - avaient trouvé leur union intime. Là, dans les vallées riantes du Neckar et du Danube était née la toute première barbarie, cette alliance impossible entre le mobile et l'immobile, cette absurde sur puissance que conférait l'intégration des principes nomades et de la réalité sédentaire. Hitler avait réussi à mobiliser la terre elle-même, les océans et même le ciel.
Il ne pouvait donc avoir d'autres adversaires sérieux que ceux qui avaient aussi arraisonné la planète dans une envergure encore bien plus grande. Les Américains avaient déjà, eux, élargi leur champ stratégique aux dimensions du monde ayant jeté leur dévolu sur l'univers du Pacifique et du commerce extrême-oriental. Nous savons par ailleurs que ces Américains sont génétiquement des nomades, avantage non négligeable sur les Germains sédentarisés à l'intérieur de leurs frontières et surtout de leur langue. Leur inexpérience ne leur permettra pas de remonter le courant, ni dans la Première ni dans la Seconde Guerre Mondiale. Les vertus allemandes, déjà définies par le Grand Frédéric, esprit de décision et de persévérance, ne suffiront pas à remonter le handicap principal, l'ignorance des horizons inconnus, du changement et du mouvement permanent des paysages. L'opération Barberousse a bien été compromise par l'erreur de jugement de Hitler - infidèle à sa propre doctrine du mouvement il détourne ses blindés des sources de carburant pour jouer un poker absurde à Stalingrad - mais on explique moins bien l'ignorance des géographes du Führer incapables d'anticiper les boues printanières qui avaient déjà piégé Napoléon un siècle et demi plus tôt. Absence cruelle de la connaissance des terrains du monde, mépris technicien pour la mère des peuples sédentaires, la glèbe nourricière mais aussi, quand il le faut, la glèbe meurtrière. Ces soldats vigoureux et résolus se sont laisser déprimer dans les plaines décomposées exactement comme les poilus dans la boue des tranchées. La colle de la vie quotidienne resurgissait là où devait prévaloir le mouvement, l'aller de l'avant, l'envolée vers le rapt et le viol, le plaisir et la gloire.
Ces deux guerres ne furent pas des guerres au sens strict et traditionnel du terme. Depuis les Grecs, la guerre se caractérisait par l'affrontement entre deux ou plusieurs groupes, tribus, nations ou cités, toujours entre des hommes. Jamais encore avant 1914 la guerre eut un troisième partenaire silencieux et plus redoutable que l'ensemble des hommes, à savoir la technique, l'armement qui reléguait au musée des valeurs, le courage, la ruse, la ténacité et même l'esprit de sacrifice. Il y eut certes dans l'histoire passée des épisodes où une certaine inégalité technologique avait permis, par exemple aux archers anglais, de défaire l'adversaire par la surprise de la nouveauté, mais cette supériorité restait toujours dans la nature de l'instrumentation classique de la guerre, de l'arsenal connu. Au vingtième siècle il en alla tout à fait autrement, on ne connaissait ni les capacités de ravage des nouvelles artilleries ou des premières armes automatiques, ni celles des armes chimiques ou nucléaires. Armes automatiques, dépossession ultime du geste même de la guerre, l'homme devient lui-même l'instrument de l'outil et n'a plus d'autre ennemi que l'enrayage de sa mitrailleuse et le canon qui s'échauffe trop vite. L'homme était ainsi devenu une prothèse greffée à une machine et annexée à un plan dont la conception, l'exécution et le mérite ira d'abord aux ingénieurs de la guerre. Dans le ciel de l'Irak, les cartes étaient distribuées bien avant l'envol du premier missile. Bagdad était tellement convaincu de la supériorité automatique de la chasse US que Saddam Hussein a préféré mettre la sienne à l'abri dès le début du conflit. En termes militaires on pouvait déjà comprendre dès ce moment-là que l'Irak bluffait d'un bout à l'autre du scénario. Partout Saddam prétendait remplacer la technologie par l'héroïsme, sauf dans le ciel ?
Mais cette effroyable surprise n'aurait pas suffi à donner à 14 - 18 cette dimension galactique pour l'homme né encore au siècle précédant, dépourvu de toute résistance spirituelle autre que quelques religions agonisantes - et qui ne manqueront pas de se refaire une bonne santé dans le demi-siècle suivant - tellement sous-informés sur le lointain comme sur le proche, et d'une naïveté toute prête au sacrifice. Le piège absolu que représenta la Première Guerre fut la contradiction entre les stratégies de départ et leur échec immédiat : Français et Allemands se sont rués les uns sur les autres pour atteindre d'un trait le cœur du pays ennemi, les deux bolides se heurteront de front et tout le reste de la guerre sera, en un ralenti d'épouvante comme la conséquence du choc de deux trains lancés à pleine vitesse l'un contre l'autre. La force d'inertie de ce choc creusera des centaines de kilomètres de tranchées où s'entasseront pendant quatre ans les morts de la catastrophe. Les deux dépressions mouvantes s'étaient transformées en ce que Jünger nomma l'Orage d'Acier, métaphore qui donne toute la vérité du phénomène : alchimie fatale qui fonde en un seul élément ontologique la nature et la technique, la physis et la tecknè. Retour au doublet grec dont l'efficace dans l'histoire fut précisément de perlaborer le statut de l'homme nomade confronté à l'immobilité de la nouvelle nature qu'il s'était créée. La Première Grande Guerre enveloppe la seconde seulement au sens où tout était dit sur le malentendu d'un monde qui pensait pouvoir à la fois s'incruster dans la terre selon une logistique défensive quasi infinie et à la fois bondir au-dehors pour se saisir de l'ailleurs, un ailleurs tout aussi bien pétrifié dans la puissance de feu indéfinie. L'esprit nomade des états-majors et de toute la science de la guerre se heurtait de front à une réalité, à une nature technique, à une technique devenue naturelle, monde aussi immobile que les fronts de la Somme ou de la Champagne dont la nature et la fonction ne pouvaient plus se définir autrement qu'en action de néantisation. Au début on a pensé que la puissance de feu ouvrirait des chemins d'assaut, le temps mis à prendre conscience que c'était le contraire qui se passait, coûta inutilement la vie à des millions d'êtres humains.
Imagine, poète, l'homme pris dans une tourmente où il n'a même plus de chef tant le désarroi est total, plus de savoir, plus de possibilité d'évaluation et bientôt plus de volonté de penser l'action. Tu es là, les pieds enfoncés dans la glaise, attendant l'ordre de mourir dans une mise en scène que personne ne contrôle plus, tes officiers pensifs n'ayant plus que la colère pour assumer leur grade. Et puis cette fin humiliante pour ceux qui l'on vécue, lorsque les premiers blindés américains surent réinventer un semblant de mouvement, donner un coup de grâce virtuel à un peuple qui avait au moins su préserver son sol de toute destruction. Comment les Accords de Versailles auraient-ils pu se négocier sur une base plus humaine alors que toute la néantisation concrète s'est concentrée sur tous les pays sauf l'Allemagne ? Autrement dit, comment aurait-on pu éviter, vingt ans plus tard de finir une guerre qui n'avait jamais pris fin ni déterminé de vrai vainqueur ou de vrai vaincu ? Les historiens cesseront bientôt de distinguer ces deux guerres pour n'en faire plus qu'une, comme nous le faisons pour les guerres du passé, celle du Péloponnèse ou celle de Cent Ans. Tant pis pour les Années Vingt.
LA NAISSANCE DE LA BARBARIE
LA NAISSANCE DE LA BARBARIE
|
|
"Depuis trop longtemps, beaucoup trop longtemps déjà, les Allemands assistent à cet indigne spectacle. Leur unique excuse est leur conviction que toute forme inclut nécessairement un contenu, leur unique consolation que ce spectacle a beau se dérouler en Allemagne, il ne se déroule nullement au sein de la réalité allemande. Car tout cela est destiné à sombrer dans l'oubli - non pas cet oubli semblable au lierre qui recouvre les ruines et les tombes des morts au champ d'honneur, mais un oubli différent et terrible, qui démasque le mensonge de ce qui n'a jamais été, le dispersant sans laisser de traces en une stérile poussière."
Ernst Jünger, Le Travailleur 1932
Albert Londres Terre d'ébène.
|
Il n'y a pas de mot plus galvaudé que le mot barbarie. Et c'est normal. C'est normal parce que la barbarie en tant que telle n'est née que dans notre siècle, elle est enfin apparue dans son essence alors qu'on croyait la tenir en concept achevé. En réalité ce concept n'était qu'en germe depuis l'Antiquité où le barbaroi était celui qui ne parlait pas la langue. C'était l'autre, l'étranger, et à la lumière de notre analyse, le barbare était celui qui n'avait pas accepté de s'arrêter sur une terre fixe, ce qui correspond aussi pour les Grecs à l'établissement d'une loi universelle, d'un langage et d'une moralité commune. Tous les peuples sédentaires ont défini la barbarie de cette manière, à l'exception des peuples qui étaient restés ou redevenus nomades comme les Indiens des Amériques qui ne dépendaient plus d'un empire centralisé. A la lecture de Plutarque ou de Thucydide la notion de barbare s'éclaire d'elle-même, car les Grecs n'ont jamais considéré les Romains, les Perses ou les Egyptiens comme des barbares, parce qu'ils étaient des peuples sédentaires. Cela n'empêchait pas la guerre, mais déjà la guerre moderne, la guerre de conquête ou de défense. Pour Rome, les seuls barbares importants de leur histoire ont été les Goths, pour qui l'Italie était le terminus d'une longue migration. Il y en eut d'autres comme les Vandales et les Wisigoths qui ont attaqué des zones excentrées de l'Empire, la Gaule du sud, l'Espagne et le Maghreb, un Empire déjà bien affaibli par le dédoublement des capitales.
Ce mot de barbare, était donc le nom générique des rebelles au mouvement de sédentarisation tels que les tribus remuantes du Caucase, les Huns d'Attila ou la plupart des tribus germano - scandinaves dont les mœurs sont restées nomades très tard. Ce mot désignait aussi en Chinois tous les peuples nomades qui chevauchaient en permanence autour des empires, sans foi ni loi, ce qui permit une transformation morale du concept vers les notions de cruauté, de ruse mensongère, de déshonneur, bref, du mal. Le Christianisme s'empara évidemment du mot pour le déplacer non seulement vers la définition des peuples non convertis, mais encore vers les peuples chrétiens hérétiques comme les aryens. Ce qui permit aux armées orthodoxes de les massacrer à l'instar des infidèles avec une cruauté toute barbare. La véritable histoire des persécutions reste encore à faire, car les Romains n'y ont mis qu'une main très molle et ne sont responsables que d'une part infime des assassinats commis pendant sept siècles d'un bout à l'autre des Empires.
Cette définition restera jusqu'au vingtième siècle l'envers de l'image de la civilisation. Au point que la civilisation était devenue au dix-neuvième une idée-force, une idéologie aussi prégnante que la Foi catholique. Comme cette extériorité continuait de subsister aux quatre coins du monde, elle servit même à légitimer toute cette criminalité coloniale dont nous avons fait un tableau plus haut. La barbarie était assimilée en douce à tout ce qui échappait aux principaux dogmes en vigueur sous nos latitudes, y compris le scientisme, le culte des vertus occidentales et la philosophie rationaliste devenue académique. L'ethnologie internationale - il ne faut pas oublier le vaste travail fait par les Américains et les Allemands dans des conditions parfois plus intéressantes, notamment tout le travail sur les civilisations indiennes - tellement bien compris le malentendu qu'elle a fait trembler le cœur spirituel de l'occident en montrant l'inanité de cet anthropocentrisme. A tel point qu'elle est venue remettre en question, radicalement, les fantasmes d'une idée fondamentalement progressiste de la civilisation telle que nous l'héritons de leurs idéologues. Du structuralisme de Levy Strauss jusqu'aux thèses eschatologiques de Margaret Mead ou d'Alexandra David Neal, tout se repense aujourd'hui selon une échelle de valeurs au moins parfaitement égalitaire, voire inversée. Le travail des écologistes vient comme une cerise sur le gâteau des désillusions collectives sur le caractère unilatéralement progressiste de notre monde technique. Les robinsonades recommencent à fleurir comme aux meilleurs temps du dix-huitième siècle, lorsque la découverte effarante des manufactures et de leurs effets se mit à semer l'effroi dans la gentry anglaise. Comme à cette époque, on découvre aujourd'hui de nous motifs d'effroi face à une industrie qui s'empare des derniers bastions de la vie quotidienne et du destin des hommes. Ironie, ce hold-up est pratiquement achevé là où le progrès est supposé le plus avancé. L'occident peut se caractériser aujourd'hui par le plus haut degré de développement pour l'indice de liberté le plus bas tant nos destins sont tréfilés selon des règles implacables qui distribuent les individus entre des formes de salariat qui se différencient de moins en moins entre eux, mais constituent toutes la même aliénation profonde de toute liberté. Les libéraux ou néolibéraux ne périssent hélas pas de ridicule lorsqu'ils attachent la valeur de liberté à celle de l'entreprise. Leur instinct de liberté ne passe pas la porte de leur bureau directorial où ils s'emmerdent exactement comme tous les autres salariés.
Il faut penser combien le concept de barbarie s'articulant sur l'idée de civilisation a fait de ravages au cours des vingt siècles passés, et combien il en fait encore dans nos réalités politiques européennes. De Le Pen en France à Jörg Haider en Autriche, il se prépare des lendemains risqués pour une Europe encore dans les linges de la petite enfance politique, car le concept de civilisation contient en lui celui d'Europe et inversement, ce qui le rend tout à fait exploitable dans n'importe quel sens. D'autant plus que l'idée de barbarie, qui comme nous l'avons avancé n'avait jamais existé que comme idée et exploitée selon un réalisme certes criminel mais toujours rationalisé et rationalisable comme le crime lui-même, est enfin passée dans la réalité de son essence. Les fours d'Auschwitz furent les tours de cracking qui donnèrent ce distillat infernal, qui déposèrent au regard du monde ébahi la seule vérité du concept, le massacre industriel des Juifs, des tziganes et de quelques autres déviants. Nomades faudrait-il ajouter, car la Shoah fut, en effet, le point critique de rencontre entre deux cultures antinomiques et, mais c'est très retors et aussi difficile à saisir que l'attitude de Dieu dans la Genèse, la concurrence effrénée dans le même modèle. Dès l'aube du régime nazi, il y avait une fatalité pour les Juifs à l'aboutissement tragique que nous connaissons parce que Hitler avait réveillé les démons à peine refroidis du Drang, de ce qui s'appelait du temps de Guillaume II le pangermanisme, c'est à dire cette ruée barbare - c'est à dire nomade - des Allemands hors de leurs frontières. Or cet instinct brutal reproduit sous ses conditions particulières la praxis nomade, le refus de reconnaître un espace autre que le sien. Mais, et le nœud de l'affaire est là, il ne pouvait pas y avoir deux peuples nomades sur un même sol, les Juifs ne pouvaient pas survivre là où paissaient les blindés germaniques.
On peut encore voir cela sous un autre angle. Les Nazis pensaient fonder non seulement un nouvel homme, le surhomme, mais encore un nouveau monde, un monde en rupture totale, spirituelle, culturelle, politique etc.. avec le précédant, une véritable utopie. Ce projet était encore plus antinomique avec l'esprit d'un peuple qui n'a jamais pensé ni même tenté de penser la moindre utopie, pour la raison qu'il ne s'est jamais non plus enfermé dans une idéologie dure. Entre la foi et les impératifs rituels du peuple et du rester-le-peuple, il n'y a ni dogmes, ni doctrine, ni théologie. Le Judaïsme est une anti - utopie, un rejet de tout ce qui veut venir poser un autre monde, une eschatologie autre que la venue du Messie, une venue qui ne dépend en rien des humains, juifs ou non. Les Juifs formaient par ailleurs une menace d'autant plus grande qu'ils avaient fait leurs preuves dans la survie de leur existence, de leur manière d'habiter la terre, tantôt nomades, tantôt sédentaires, mais plus foncièrement nomades, errant à la surface de la planète sans revendication territoriale et sans nationalité propre. Ils étaient la résistance naturelle à tout projet millénariste, à toute mise en scène d'un salut universel, quel que soit son modèle. Dans la Russie soviétique, les Juifs n'ont évité le génocide que pour avoir mis eux-mêmes la main à l'utopie communiste, et aussi à la nature même de cette utopie fondée sur une idée universelle et non sur la supériorité raciale d'un peuple.
La barbarie est donc née en Allemagne, au lieu de la conflagration entre l'essence de l'appropriation sédentaire et conquérante et de celle de l'incertitude absolue quant à l'habiter du monde. Le vingtième siècle sera marqué par l'apparition du jeu des masses critiques, celle de ces modes d'exister et celle des matières nucléaires, et d'ailleurs exactement à la même époque. Heidegger avait vu juste en comparant la Shoah à l'agriculture industrielle, mais cette vision était insuffisante car il se trouve que c'est lui-même qui a montré à propos de la technique que l'homme avait réussi, en inventant l'atome et sa scission, à mobiliser pour la première fois dans l'histoire, l'énergie cosmique, une force qui ne figurait pas dans la panoplie des énergies naturelle, dans la physis grecque. Il aurait pu aussi ajouter que le génocide des Juifs avait aussi été une hybris du néant telle qu'elle n'avait jamais figuré dans la tecknè, dans les actions humaines. Il est arrivé que les Lacédémoniens massacrent leurs esclaves révoltés, mais les Spartiates n'ont jamais entamé une croisade mondiale pour exterminer tout être humain défini par le statut d'esclaves. Il est sans doute également exact que jusqu'au seizième siècle il a existé, notamment en Europe Centrale, de véritables guerres d'extermination, où l'objectif n'était pas la conquête d'un territoire, mais la disparition totale des peuples, précisément parce que les termes de leur statut nomade ou sédentaire n'étaient pas clairs. Or de telles guerres sont encore loin de la Shoah parce qu'elles étaient des guerres où le massacre était un objectif réciproque, la règle du jeu égale pour tous, c'était les mœurs de ce temps et pour un temps. Le génocide des Juifs fut une tentative d'éradication qui, si elle avait eu une chance de réussir aurait pu mutiler l'humanité en tant que telle et la faire disparaître définitivement par une sorte scissiparité en chaîne : les Nazis auraient dû se rendre compte progressivement que la particularité de leur modèle les laissait de toute façon seuls dans le monde. Même leurs alliés seraient tôt ou tard passés sous la hache des bourreaux, puisque la race des Seigneurs n'aurait jamais toléré le moindre métissage.
Masse critique d'inhumanité. Comment le peuple allemand en est-il arrivé là et quelles chances a-t-il d'en sortir, d'en faire un deuil efficace afin qu'il puisse reprendre sa place dans le concert des peuples. La première constatation historique est que l'Allemagne est pratiquement née par la violence religieuse. Charlemagne avait "christianisé" l'Allemagne non romaine en pratiquant une sorte de génocide qui ne se distinguait de celle des nazis que par le fait que les peuplades visées gardaient le choix de se convertir ou de mourir. En terme de barbarie ses méthodes n'avaient rien à envier aux pires cruautés modernes. Mais Charlemagne était lui-même allemand, et c'est là une autre caractéristique de la violence religieuse dans l'espace germanique : les barons rhénans qui commandaient les troupes de Charlemagne massacraient au nom de la religion du souverain, ceux du seizième siècle massacreront les paysans au nom de la Réforme et avec la bénédiction de son mentor Luther, alors que ces mêmes masses paysannes attendaient de la Réforme qu'elle mette fin aux injustices et à la corruption. Cujus regio, ejus religio : c'est en Allemagne qu'est né cet incroyable principe politique - tel prince, telle religion - le peuple n'a qu'à penser comme son prince et nos dogmes seront bien gardés et pourront même coexister : c'était le compromis qui mit un terme (très provisoire et très hypocrite) à la guerre de Trente Ans. Mais pourquoi la religion a-t-elle tenu une place aussi fondamentale dans la formation de la société germanique ?
La réponse est peut-être chez Tacite, le seul historien de génie qui fut témoin de la société germanique alors qu'elle n'était pas encore sortie de son état nomade, ou semi-nomade selon les critères de l'anthropologie contemporaine. La lecture de son petit livre intitulé "La Germanie" est un tableau ethnographiquement complet, un tableau qui rend compte du seul peuple heureux de l'Europe romaine, d'un peuple joyeux, spontanée, courageux et ludique. Tacite est frappé par la paresse générale de ces soldats-laboureurs entièrement dévoués à leurs femmes, reines incontestées du destin germain. Germania n'est pas un mythe, cette Marianne allemande est la trace mnésique d'une sorte de matriarcat parfaitement décrit par Tacite : la mère renvoyait au combat son fils blessé afin qu'il ne revienne surtout pas vivant. Admiration non voilée de l'historien qui se souvient de la grandeur grecque et romaine où ce principe était sacré. Malheur aux guerriers spartiates qui rentraient vivants dans leur patrie à la fin d'une longue campagne victorieuse ou non, toute la société se détournait d'eux et ils devaient subir une sorte de quarantaine sans pitié, cruellement surveillée par leurs propres familles ! Ces Allemands ne ressemblent en rien à ceux d'aujourd'hui, ils furent ce que nous désignons comme des bons à rien, mais des bons à rien qui tinrent en échec l'Empire jusqu'à ce que des Allemands eux-mêmes, ceux que la civilisation gallo-romaine avait fini par corrompre, se chargent, l'épée à la main, de dresser ce peuple fier et libre.
Choc frontal avec le Christianisme dans la fondation de la Germanie sédentaire. Tout est dit, mais l'on peut renverser les termes : sédentarisation sous les auspices de l'Eglise catholique, l'Allemagne est née à Bethléem. Voilà qui éclaire a contrario l'énigme de l'échec de Charlemagne, ce génocide pour rien ; quelle chance avaient ses successeurs de garder d'un seul tenant cette triple entité que représentaient la Germanie proprement dite, le couloir rhénan-bourguignon de romanité presque aussi ancienne que Rome, et les anciennes Gaules - car il y en avait plusieurs - si étrangère à l'une comme à l'autre ? L'ironie de cette affaire est que ce sont les barbares de la lointaine Franconie, la partie de la Germanie qui a résisté le plus longtemps au conquérant romain, qui étaient venus prendre les rennes de l'Occident gallo-romain. Nous avons déjà parlé de cette naissance adultérine de la France. Mais cet adultère donnera aussi la mise en coupe réglée du territoire allemand par ces cousins devenus des féodaux politiquement catholiques, en réalité les futurs mécréants de la nation la plus laïque du monde. Au fond, les Francs qui firent la France s'étaient comportés exactement comme ces Chinois prophétisés par Céline, terminant leur carrière de conquérants dans les caves de la Champagne, mais le vin ne semble en rien avoir fait fléchir la férocité de ces buveurs de bière !
Ici, il faut parler du Christianisme et de son rôle dans la romanité, car la religion catholique semble avoir joué le rôle principal dans la sédentarisation finale des aires romaines. Deux ordres de faits l'indiquent : le premier symptôme d'un changement en faveur de la stabilisation des Empires est le déplacement incessant des capitales. A partir de Constantin, Rome n'est plus dans Rome, mais aussi bien à Lyon, qu'à Cologne ou même, sous l'un des Empereurs les plus dévots, Julien, à Paris. Les Empereurs successifs de la Rome occidentale choisissaient leur résidence en fonction de leur goût, et sans doute aussi de considérations politiques bien difficiles à démêler aujourd'hui, ce qui a eu pour conséquence de provincialiser considérablement Rome elle-même. Le territoire devenait homogène, le souverain pouvait le signifier à partir de n'importe quel endroit. Deuxièmement, les Romains du Bas-Empire s'étaient attachés à remettre de l'ordre dans l'administration et dans le Droit, un effort qui aboutira au 6ème siècle à l'œuvre juridique de Justinien, un Code qui est une refonte totale du Droit romain. Bref, c'est le Christianisme qui donne le dernier coup de frein aux mouvements de Rome, un coup de frein matériel mais surtout spirituel : le paganisme romain est avant tout une religion mouvante et personnelle, elle n'est en rien dogmatique, et chaque Romain pouvait se construire sa propre doctrine, alors que le catholicisme est figé tant par la nature de ses dogmes que par son universalité affirmée, personne n'y échappe. Résultat, le catholicisme s'est mis à fonctionner à l'Américaine : chaque Chrétien pouvait dire à l'instar des GI's de la dernière guerre : - "je suis partout chez moi" -. Plus tard, l'Eglise deviendra l'alliée des centralisateurs et de la Monarchie absolue, Richelieu et Mazarin seront les artisans sans pitié de la centralisation universalisante dont nous avons parlé plus haut. A noter ici que Mazarin eut un adversaire dans sa propre chapelle, le cardinal de Retz. Le sort de ce prélat est du plus haut intérêt dans cette analyse, par ses actes et par ses écrits, il exhibe toutes les contradictions de l'état centralisateur. Son destin de soixante-huitard récupéré par l'état ressemble au comportement d'un gros saumon dans le filet qui vient de se refermer sur lui.
En résumé, l'Eglise donnera le coup de grâce aux derniers mouvements centripètes de l'Empire et sédentarisera les Romains de la manière la plus efficace, la spirituelle. D'abord en structurant Rome administrativement, ce qui lui valu une courte mais terrible persécution sous Dioclétien qui voyait d'un mauvais œil la puissance naissante des Diocèses et des Paroisses, une véritable Rome parallèle presque aussi riche qu'elle. L'Eglise et son empire sur l'homme du Moyen age seront les passeurs de la culture gréco-romaine à travers les siècles dits "obscurs". Bien sûr il ne fallait pas attendre des Pères qu'ils transmettent un message neutre et en quelque sorte laïc, en bons staliniens ils ont largement et sans pitié retouché la photo, brûlé l'hérétique ou le païen par trop provocant, allant jusqu'à caviarder certains auteurs qui avaient pourtant reçu l'imprimatur, comme Cicéron, parangon de la vertu des autres. Mais le plus grave n'était pas encore dans cette stérilisation, cet incendie de bibliothèques entières qui a failli même nous priver d'un Aristote et a fait disparaître l'essentiel des présocratiques. Comme le laisse entendre Heidegger, c'est par sa traduction du Grec ancien que l'Eglise a imposé ses dogmes à partir d'un glossaire conceptuel artistiquement retouché dans lequel toute la tradition s'est laissé enfermer jusqu'à Descartes et Kant.
Ce sont, au demeurant, des moines quasi nomades qui ont géré pendant quelques siècles cette tradition. A examiner les rares biographies que l'on connaisse, il apparaît que peu d'ecclésiastiques aient autant voyagé que les moines du huit au seizième siècle. De Guillaume d'Occam à Nicolas de Cues et Maître Eckhart, on ne voit que des soutanes sur les routes et les chemins de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, D'Autriche et d'Italie. Ce qui laisse au moins supposer qu'ils disposaient de certaines garanties de sécurité dans une Europe encore désintégrée en milliers de fiefs où le banditisme de grand chemin gardait la plupart du temps toute sa noblesse d'origine. Preuve que l'Eglise possédait un statut d'extra-territorialité qui la mettait largement à l'abri des uns et des autres, statut qui était aussi l'unité en marche de l'Atlantique au Danube. Cette Chrétienté nomade tissait l'être-là futur des nations, les principales cités de quelque importance étaient toutes reliées les unes aux autres par ces continuels va-et-vient de porteurs de questions doctrinales, de formalisation théologique et d'examen à la loupe de toute incursion de la philosophie qui n'aurait pas franchi les censures obligatoires. En politique, les moines prirent très tôt les places essentielles dans les entourages princiers, des places qu'ils garderont jusqu'à la Révolution Française dans notre pays, mais bien plus longtemps dans les autres nations européennes. Aujourd'hui encore, l'épiscopat joue un rôle politique important dans un pays comme l'Allemagne, protestants ou catholiques possèdent chacun un observatoire des médias, imprimatur moderne qu'il vaut mieux ne pas ignorer lorsqu'on est du métier. A partir de la conversion de Clovis, tout se passe comme si la souveraineté allait se distribuer sur deux plans : d'un côté les féodaux géraient leurs fiefs dans un ordre de suzeraineté qui culminait dans la royauté, de l'autre l'Eglise exerce le pouvoir spirituel, et coordonne ce qui était en train de devenir la société. La situation de l'Eglise ressemblait trait pour trait à celle qu'elle occupait dans la Rome antique, à la différence près qu'au Moyen - Age elle s'était intégrée directement au pouvoir politique, était devenu son ombre. La biographie politique du Grand Louis démontre avec éclat que sa tentative de fonder un territoire royal finit par échouer lamentablement dans une dévotion catastrophique. Les Méditations de Descartes forment un excellent résumé prémonitoire de cette évolution. Parties pour fonder la certitude du sujet de l'histoire, elles se heurtent finalement à la précellence de l'existence de Dieu. Manière amusante de lire l'histoire, un exercice qui pourrait être d'une grande fécondité dans une relecture comparative de Fichte et de Hegel.
La barbarie nazie est donc un produit étrange, elle trouve sa motivation profonde dans une tentative radicale de rejet du religieux, comme si l'Allemagne découvrait sa Révolution dans le déni de tout ce qui l'avait fondée et culturellement unifiée. En réalité, l'Allemagne moderne a réfuté dans cet épisode la notion même de son être de nation sédentaire, relié culturellement au reste du monde par la religion et la philosophie. Après l'échec de la Première Guerre et les conditions humiliantes du Traité de Versailles, elle s'est retrouvée devant un "être ou ne pas être" radical, qui fait penser au massacre des deux légions de Varus qualifié par Auguste comme la plus grande catastrophe de l'Empire à cause de la cruauté inouïe dont avaient fait preuve les Germains d'Arminius. D'un tel rejet culturel ne pouvait que jaillir la forme la plus fantasmatique du paganisme, celle que contient la notion judaïque d'idolâtrie. Hitler et son parti, c'était bien le veau d'or sur lequel converge toute la puissance libidinale de la communauté, qui décharge l'inconscient collectif de toutes ses tendances sadomasochistes en satisfaisant sa soif de vies humaines. Pour sentir à quel degré mythique le monde a tremblé pendant douze ans, il suffit de lire les premières pages du Paradis Perdu de Milton, le feu de l'enfer c'est cette guerre de cauchemar libéré par le Führer, et le monde de glace dans lequel se vautre Satan ce n'est rien d'autre que Auschwitz.
Cette naissance de la vraie barbarie, celle qui n'a jamais figuré que dans la Bible, est certainement à mettre au compte d'un passage à l'acte titanesque. La nostalgie de l'ordre ou du désordre ancien, la trace mnésique de l'hostilité primitive à la civilisation, qui s'identifie avec le refus du sédentarisme - doit gésir quelque part dans l'inconscient collectif de tous les peuples. L'Allemagne a fait l'expérience de l'irruption massive et sans frein de cet instinct de mort dans des conditions historiques extrêmes, mais rien a priori ne met les autres à l'abri de ce même retour du refoulé. Dans l'histoire réelle, il n'y a de barbare que les guerres. Celles-ci ont été effectivement le symptôme d'une crise entre deux modes d'être dans le monde, mais rien ne permet d'attribuer la supériorité morale à l'un ou à l'autre de ces deux modes. Ce n'est pas parce que le deuxième s'est attribué le concept de civilisation, qui au demeurant ne signifie pas plus que "état de ce qui est dans la cité", que le premier se disqualifie dans l'échelle des valeurs humaines. Ou alors il faudrait admettre que l'homme a été effectivement un démon, comme le prétend Hobbes, mais comme chez Hobbes, on ne voit nulle part comment ces démons ont pu, un seul instant, se concerter pour vivre ensemble. C'est bien pourquoi Hobbes fait de notre société une société génétiquement démoniaque. Pour admettre une telle chose il faut au moins être croyant, et encore, appartenir à une religion monothéiste et gnostique qui n'existe pas encore. Il n'est pas plus légitime d'ailleurs, de parer le nomade isolé de toutes les vertus du bon sauvage car l'on retrouve les mêmes contradictions que chez Hobbes, mais à l'envers. Pour que ces deux fictions aient un sens, il faut et il suffit de créer Dieu, mais il le faut absolument, car c'est Dieu seul qui peut légiférer du haut de sa transcendance, c'est à dire s'introduire en Tiers pour fonder la possibilité du social.
Au fond, la naissance de la barbarie n'est que l'approfondissement de la crise qui oppose depuis toujours l'homme qui refuse de s'enraciner dans un sol - le communisme est aussi une forme de ce refus dans son interdit de la propriété privée - et celui qui a fondé les cités et les espaces pour y puiser ou y configurer son identité. Le conflit identitaire est de retour, nous le savons tous, d'abord parce que la puissance de la terre a elle-même diminué, elle a elle-même perdu son identité parce que les termes de son parcours et de son appropriation ont changé, et ensuite parce qu'il vient alors à manquer à l'homme de la cité ce qui en fait un citoyen. La citoyenneté c'est désormais comme l'économie ou l'écologie, elle sera planétaire ou ne sera pas.
L'ECONOMIE : L'ILLUSION DU DEVELOPPEMENT
Pourquoi l'économie semble-t-elle prendre le relais de la guerre ? Désabusés, les peuples assistent aujourd'hui à la "guerre commerciale" ou à l'"Horreur Economique" avec le sentiment que cette forme de concurrence ne vaut pas mieux que l'autre. Pourtant le consensus général demeure aujourd'hui largement en faveur de la paix 'économique', alors même que l'on est saisi par l'angoisse que suscitent les impasses futures vers lesquelles semble voguer la société mondiale. Et c'est logique, après ce siècle de larmes et de sang.
Or il est vrai qu'il s'agit d'un véritable relais, c'est bel et bien l'économie qui exprime et satisfait la rivalité naturelle des êtres humains. Mais ce n'est pas un progrès, au sens d'une étape dans une progression vers je ne sais quel bonheur universel, la mondialisation n'a rien à voir avec la construction du paradis sur terre, idée que nos nouveaux libéraux ont un peu trop tendance à laisser passer dans leurs messages sous des formes certes déguisées. Pour bien saisir le rôle actuel de l'économie qui accompagne l'état sociétal de l'être humain, il faut voir l'économie comme une étape régressive d'une histoire peut-être cyclique de l'habiter la terre.
Dans la naissance de la civilisation, le commerce a été une étape transitoire nécessaire. De nos jours on n'étudie plus le passé, et notamment la préhistoire, sans référence aux échanges primitifs et aux aires et aux axes de circulation des populations. On peut avancer l'idée qu'avant les conflits guerriers, il y eût une longue période de transition semi-nomade et essentiellement commerciale. On sait aujourd'hui qu'au cours des deux cent mille ans qui ont précédé le Néolithique, les hommes pratiquaient déjà le parcours récurrent sur des axes reconnus, une pratique qu'atteste le commerce de matières premières sur un axe nord-sud qui va de la Scandinavie au bassin méditerranéen, notamment l'ambre et les métaux rares. De là à conclure que le commerce a été le facteur déclenchant de la civilisation, il n'y a qu'un pas, et c'est celui que tout le monde franchit allègrement, sauf nous. Nous restons fermes sur le fondement spirituel du sédentarisme et opposé à une quelconque causalité mécanique, climatique ou biophysiologique. C'est pourquoi nous voudrions suggérer que l'étape actuelle, le temps économique qui se profile devant nous, répète dans le sens inverse cette époque commerciale qui précède la fondation des cités du néolithique. Elle est le symptôme du retour de l'homme nomade, d'un changement essentiel dans l'habiter-le-monde de l'homme de demain. Mais elle est aussi le seul moyen d'y parvenir, comme le commerce aura sans doute été le seul moyen pour les hommes de la préhistoire de passer dans l'ère de la civilisation. Pourquoi un moyen, et pourquoi le seul ?
Etre un moyen signifie être la cause efficiente, comme dirait Aristote, mais signifie aussi être un milieu, une médiété comme dirait le même philosophe. L'économie est le milieu entre deux mondes : le premier monde est celui de l'homme qui marche et qui prélève sur son chemin les moyens de reconstituer sa force de marche. Dans ce monde, non seulement il n'y a pas de marchandises ou même d'objets d'échange, mais il n'y a pas d'échange. Le Potlatch, d'un mot amérindien qui signifie approximativement échange rituel, forme qui a précédé le troc, et qui se situe donc avant tout commerce, n'est pas un échange stricto sensu, mais un cadeau réciproque, source déjà d'une problématisation de l'échange, mais toujours ritualisé en vue d'éviter la violence. Il convient de s'attarder sur cette forme, car elle voisine déjà avec les formes plus évoluées de l'échange, précisément celles qui se rapprochent du commerce lui-même. Certaines "civilisations" dites primitives, et notamment les Indiens d'Amérique du Nord, entretiennent certains rapports d'ethnies à ethnies par le truchement du Potlatch, un échange de biens qui peut se limiter à un troc de complémentarité ou bien aller même jusqu'à servir à régler la délicate question des mariages exogamiques. Ces échanges se font en l'absence de tout équivalent général, c'est à dire de monnaie et donc d'une évaluation de valeur d'échange. Comme conséquence directe de cette absence d'un tel instrument économique, le Potlatch reste enfermé dans une pratique du don réciproque, c'est à dire d'une évaluation subjective du bien cédé par le donneur, un bien estimée à son tour par le receveur. Ici la rivalité s'inscrit à l'envers de celle qui règle le commerce ou la guerre, elle se joue dans la qualité supérieure du don que l'on fait par rapport à celui que l'on reçoit. L'éventuelle violence liée au Potlatch provient donc toujours d'une inégalité des dons telle que l'un des deux partis se trouve dans l'incapacité de rendre l'équivalent ou plus. Sans doute les rites qui en marquent très précisément les limites remplissent-ils une fonction régulatrice qui permet au Potlatch de fonctionner, étant entendu que notre sens du poétique n'est pas à même de juger d'une telle pratique sociale. On peut dénier à quiconque et même aux plus savants de nos structuralistes d'assigner une valeur universellement définissable à des formes de vie sociales dont nous n'avons aucun vécu intérieur. Analyser le Potlatch selon les valeurs de l'économie et selon quelques théorèmes de linguistique et de psychologie est loin de suffire à décrire le phénomène dans sa vérité propre. Ceci pour bien insister sur le fait que nous n'avons pas la prétention de parler du Potlatch "comme si nous y étions et si nous en étions". Pour cela il faut autre chose que les catégories de nos sciences anthropologiques ; il faudrait notamment une maîtrise impossible des phénomènes humains aléatoires, inhérents au ludisme universel capable aussi bien de fonder que de détruire une société. Mais le Potlatch est précisément ce moyen d'échange qui ressemble le mieux à un milieu, à un endroit où il se passe quelque chose de vital pour l'homme. Dans cette forme d'échange, ce n'est pas l'objet qui est premier, ni sa valeur, mais l'intention des donneurs, déchiffrée selon des règles qui ne se lisent pas forcément à travers nos évaluations habituelles. Si, par exemple quelque part dans les îles de la Sonde, on assistait à l'échange d'un sac de sel contre une automobile, on y verrait immédiatement un motif de conflit, sauf si l'on sait que les sacs de sel se transmettent comme dot depuis des millénaires et constituent l'équivalent général le plus précieux de ces populations. Cet exemple est passionnant car il donne à chercher comment comprendre que des êtres humains perpétuent de telles traditions en dépit des transformations du monde qui les entoure. A vrai dire, cet exemple pose un autre problème non expliqué, car ce rite autour du sel se pratique en plein Océan Pacifique, c'est à dire au bord d'une mer de sel. Il vaudrait mieux, dès lors, penser que la valeur de ce sel provient justement de tout ce que ces gens mettent en jeu afin que ce sel traverse les siècles alors qu'il suffit d'une goutte d'eau pour l'anéantir. Poésie. Affaire de sens, donc.
Dans ma poche, je tiens en permanence au chaud une pièce d'argent. Une pièce en argent, un peu difforme, plus très ronde, curieusement épaisse au relief complètement élimé où l'on peut encore distinguer - après avoir lu la fiche technique qui l'accompagnait chez le numismate - une tortue d'un côté, et un carré de Pythagore de l'autre. Il s'agit d'un statère d'Egine, une cité toute proche et très rivale d'Athènes, fort riche et que la grande ville démocratique mit quelques siècles à dompter, tant les Eginètes étaient puissants. Cette pièce me fascine et je la touche le plus souvent possible, en pensant au destin de cet objet si insignifiant en apparence. Je fabrique des rêveries en CinémaScope sur la naissance de la pièce, en commençant par la mine d'argent d'où sortait le métal où les esclaves avaient à peine le temps d'apprendre leur métier qu'ils périssaient sans piper mot, en me souvenant toujours que le fameux Thucydide, le génie des Alpages de l'Histoire, était propriétaire de l'une de ces mines-tueuses qu'il affectionnait de contrôler lui-même au détour d'une campagne de la guerre du Péloponnèse. Et puis je m'en vais par les mers avec ma pièce, je contourne, au fond d'une jarre rugueuse le cap Sounion en guettant les trières pirates ou la flotte lacédémonienne, piquant droit sur la Grande Grèce la peur au ventre de voir surgir le Licio, le terrible vent du sud qui ne manquerait pas de nous jeter impitoyablement sur les rochers du Péloponnèse. Nous mouillons à Corcyre (l'actuelle Corfou), nos alliés provisoires, nous reçoivent avec joie et ma pièce commence à rouler d'une jarre à l'autre, en passant par un trébuchet, au rythme des outres de vin et d'huile qui ne font ici qu'une brève escale avant de repartir pour les provinces d'Illyrie (de l'Albanie jusqu'aux confins de la Croatie). Les barbares n'ont pas encore apprivoisé la vigne. Mon statère nage au milieu de centaines d'autres pièces frappées d'un bœuf ou d'une grappe de raisin, ou encore rescapée d'une expédition en Egypte, d'un bel oiseau à bec courbe. Deux jours plus tard ma pièce se bronze au soleil de Syracuse où notre vaisseau est accueilli avec des cris de joie, ici on aime toutes les cités grecques sauf Athènes. Ce qui n'empêche pas ce rusé clérouque de rogner ma pièce en passant, il n'y a pas de petits profits. Et là, dans la rade la mieux protégée de la Méditerranée, nous coulons net, éperonnés par surprise par une pentecotore athénienne surgie du néant, nous sommes alors en 414 avant Jésus-Christ. Deux mille quatre cents ans plus tard, mon statère revoit la lumière du jour, par hasard, et prend le chemin de ma poche.
L'apparition de la monnaie, de l'équivalent général, c'est avant tout l'appauvrissement soudain de l'opération d'échange, une rationalisation qui ne dépend que d'un facteur, la vitesse de circulation, elle-même liée à la productivité, au nombre de points d'échange et à la vitesse qu'il faut pour s'y rendre. Imaginez, si vous le pouvez, le même scénario au mouillage de Corfou, sans la monnaie, sans mon statère. C'est un tout autre monde qui échange jarres d'huile, sac de froment ou outres de vin. L'escale prendra un mois, les navigateurs devront s'installer et il sera sans doute plus long de se mettre d'accord sur les échanges que de traverser les mers. Mais toute cette activité va créer le véritable commerce, c'est à dire non pas un simple échange de marchandises universellement évaluées selon des cours certes changeants mais connus tout autour du bassin méditerranéen, mais un travail de relation d'homme à homme, où le Potlatch affleure encore comme raison de l'échange. Les commerçants sont de vrais nomades qui sont chez eux à chaque étape, ils sont même intégrés partout où ils sont attendus, et les opérations de troc sont l'occasion d'être ensemble de toutes les sortes de manières d'être ensemble, y compris les mariages et les décès. Le commerce est encore un commerce entre hommes, le véritable sens de ce mot. D'une certaine manière l'échange de biens, car alors ce ne sont pas encore des marchandises, sont le prétexte du commerce, c'est à dire de l'être-en-paix-ensemble, et aussi de l'apprendre-à-gérer-la-paix, activité que l'on ne connaît plus dès qu'on a hissé les voiles. Dans ces phases primitives du commerce, les navigateurs sont avant tout des rescapés du danger. Ces rescapés sont sacrés parce qu'ils incarnent l'audace et aussi la science, on dirait des astronautes sur le pas de tir de la NASA. Ce qu'ils apportent dans leurs soutes est encore contingent, mais aussi précieux que des pierres ramenées de la lune car dans ce contexte il n'y a pas encore de flux de biens, mais des passages aléatoires, au gré des vents et du savoir-faire des navigateurs. L'arrivée d'une de ces trières, il faut imaginer des navires très hétérogènes dans leur conception et dans leur fabrication, souvent à la limite de la flottabilité, c'est le commencement d'une époque de fête et de poésie, où souvent il faut d'abord longuement mimer les choses pour se comprendre, et prendre soin de restreindre tout malentendu par de longs rituels et de longues palabres. Une escale devient une histoire, une histoire que l'argent va anéantir avec autant de cynisme que l'informatique anéantit les postes de secrétaire. Le vrai commerce va se défaire, détruisant le premier âge d'or des cités, étonnant que le mot même de commerce n'aie pas disparu dans cette aventure, car il ne désigne pas l'échange proprement dit de biens, mais la relation qui naît de cet échange. Cela est encore perceptible aujourd'hui dans certaines formes de commerce où le marchandage est de rigueur, et où le vendeur n'apprécie pas du tout que l'on paye sans autre forme de procès. Il considère cela comme une insulte à sa personne, qui disparaît dans l'opération et se transforme en étiquette. L'autre raison de son mécontentement est que, dans l'anonymat du paiement cash, l'on ne prend pas en considération ce qu'il y a en amont du bien qu'il vend, c'est à dire la vie même de l'artisan qui l'a fabriqué, de l'enchaînement vital entre la création et la présence immédiate de l'objet, bref le mépris pour les hommes qui apportent ces choses à la lumière de l'échange.
Dans nos idéologies souterraines, dans nos impressions fugitives, nous autres rationalistes et combattants des valeurs suprêmes, nous dissimulons souvent du mépris pour le commerce, Babylone et le bazar ne sont pas nos tasses de thé. Certes, mais cela provient d'un malentendu facile à analyser, c'est que nous projetons nos formes de commerce marchand sur des réalités historiques qui n'ont rien à voir avec celles-là. Les bazars du Moyen - Orient n'ont rien à voir avec nos hypermarchés ; notez, pour vous en convaincre, la puissance politique des bazars iraniens ou même algériens, ils ne reposent pas que sur la puissance des commerçants, mais aussi sur la place stratégique qu'offre ces lieux dans les sociétés qui n'ont plus que ceux-là pour se réunir et se parler. Lorsqu'on commencera à se réunir dans les hypermarchés pour parler, la révolution sera proche.
L'argent que nous venons de poétiser longuement, n'est hélas pas que poème. Il illustre ce qui porte le nom magique de développement, une illusion sans avenir car elle ne dépassera jamais, au résultat, ce que symbolise la Metropolis de Fritz Lang. Le concept de développement est né dans notre siècle, d'abord comme incitation imitative pour les pays non encore installée dans la nouvelle sédentarité, celle du confort et des habitudes machinales. Car malgré tous les efforts des capitalistes et des gouvernements à eux asservis pour développer la propriété privée des domiciles, l'homme est devenu réellement nomade dans son habiter. La sédentarité il la retrouve seulement dans les critères et paramètres de l'habiter n'importe ou. Particulièrement perceptible aux Etats-Unis, cette réalité gagne le monde entier selon une stratégie elle-même redevable à la mise en valeur, au marketing du concept de développement. Je me souviens encore des années soixante, où nous avions coutume en sortant de l'Alsace par le sud, de nous arrêter dans un bistrot de Baume les Dames, charmante bourgade située sur les bords du Doubs, uniquement pour rendre une visite religieuse aux Toilettes de cet établissement. Pourquoi ? Pure nostalgie que nous pouvions goûter dans cette province "de l'intérieur" qui n'avait pas encore développé ses WC, et où un beau mur recouvert de goudron, rendant quelques effluves très particulières et très connues de notre enfance, remplaçaient encore les cuvettes en porcelaine éclatante et inodores des Villeroy et des Bosch de notre Alsace surdéveloppée. L'homme n'habite plus sa terre depuis longtemps, les ruraux ne savent plus comment fleurir leurs villages pour se donner l'impression qu'ils collent encore à leur terre, malgré les nouvelles Mairies, les lotissements, les Maisons de la Jeunesse, les rues piétonnières, les néons, malgré tout ce qui a fait de leur village une sorte de banlieue lugubre et bientôt aussi anonyme que la ville. L'esprit du sédentarisme, qu'on pourrait résumer dans l'être-assis-ensemble-autour-d'un-feu pour parler des choses de la vie et de la terre, a été aspiré par les chasses d'eau et les garages, les postes de télévision qui achève cette opération de déréalisation locale, car le regard est comme détourné par l'écran de ce qu'il y a réellement à voir, tout près, à côté de soi, au lieu réel auquel le destin nous a destiné.
Le développement est une illusion pour une autre raison encore, en réalité la même qui se joue dans l'autre sens : dans les pays dits "en développement" on veut exporter ce même non-monde-là, cette même façon d'habiter la terre au-dessus de la terre, dans une chimère qui arrache l'homme au problème de ces racines qu'il a choisi, car dans cette opération ce n'est pas d'un degré de développement qu'on évolue vers un autre, mais on évolue en réalité vers un déni du choix originaire de s'arrêter sur une terre, sur LA terre, pour s'en arracher.
LA NOUVELLE ASPHYXIE DE L'EUROPE
Ceux qui auront lu un peu vite et un peu légèrement ce qui précède, ont le sentiment d'avoir eu affaire à l'un de ces messages écologisto-passéistes passé à la moulinette romantique des militants régionalistes qui prônent le retour aux vieilleries de leur localité linguistique, vestimentaire ou ce qu'ils appellent ridiculement culturel. Il n'en est rien. Il est question ici de tout à fait autre chose, à savoir de la contradiction qui fait silencieusement fureur déjà maintenant entre les valeurs nomades qui sourdent de la technique, et les valeurs sédentaires qui se défendent comme de beaux diables, pris dans le double-bind d'un habiter pour-soi et d'un habiter pour le mouvement des marchandises. Dans les décennies qui viennent ce sera le principal problème de l'Europe, que de trouver une solution psychologique pour sortir les citoyens européens de ce piège. Car ce qui se passe en réalité est la chose suivante : depuis deux siècles l'Europe a construit un espace pour la sédentarité initialement choisie. On a tout investi dans le projet pour l'homme de s'asseoir dans le jardin du monde, en s'efforçant de dessiner ce jardin le mieux possible et de le rendre aussi confortable qu'on peut l'imaginer en lisant la Genèse... Or, pour ce faire, l'homme a remis en mouvement un monde de la marchandise qui n'est rien d'autre que de l'humanité transformée, du travail. Ce mouvement n'est pas seulement horizontal, c'est à dire ce n'est pas seulement un mouvement qui transporte une marchandise d'un point à l'autre du globe, mais un mouvement qui s'attaque à la nature de ce que désire l'homme, qui change son être-au-monde, il transporte dans l'âme des besoins qui ont pris la place des anciens besoins, ceux qui étaient destinés à un habitat vrai de la terre, et dont le souci n'était en rien dirigé vers le comment de l'habiter, mais vers le pourquoi de la terre que l'on a choisi comme lieu de vie. Rome a commencé de décliner lorsque les délices de Capoue eurent pris le pas sur l'amour de la terre. Etre sédentaire, comme notre homme du Néolithique qui s'était assoupi sous un chêne, s'est aimer une terre, aimer comme on dit parfois avec trop de légèreté aujourd'hui qu'on a un "coup de foudre" pour un lieu, une maison, un appartement, une direction d'être par rapport au cadran du compas, de la nature du sol, des bruits environnants et de l'air qui s'engouffre par les fenêtres.
Ainsi, le processus de "deshabitation", d'expulsion virtuelle des lieux que nous avons choisis, provient d'abord de l'artefact des soucis intermédiaires du confort et de la représentation pour l'autre. Nous ne renions pas le confort, nous disons simplement que le confort appartient déjà à une autre problématique de l'habiter, à une perspective re-nomadisée de l'existence. Elle induit une standardisation de l'environnement de vie qui aliène à la terre sa singularité, c'est ce pour quoi on la choisit. Dans mon F4 de Bordeaux, je ne vis pas différemment que dans celui de Strasbourg, l'universalisation des objets du confort me renvoie sans cesse à une identité de plus en plus large, et à l'oubli définitif du motif pour lequel je me suis arrêté là plutôt qu'ailleurs. Il y a quelques années, je suis revenu sur les lieux de mon enfance, et j'ai du constater que mon immeuble avait été rasé, au point que je ne reconnaissais rien, ni du lieu où il se tenait ni du quartier dans lequel j'avais usé mes sandales et mes fonds de pantalon. Impression assez terrible, j'étais dans un état de désorientation que je n'avais jamais connu, un état de perte nouveau pour moi, et j'ai prononcé in petto cette sentence : - "tu ne dormiras jamais plus dans l'orientation, dans la lumière et les bruits que tu as connus ici pendant les seize premières années de ta vie" - Je pensais surtout au chant des oiseaux, fort nombreux dans cette rue si vivante de Mulhouse et qui fait l'une des couleurs les plus fortes de mes perceptions d'enfance, mais aussi au parfum de la torréfaction de café dont les fumets se mélangeaient si étrangement au parfum de ma mère.
Asphyxie. L'air me manquait, une mystérieuse composante de mon sens du temps et de l'espace avait disparu, comptabilité occulte de mes jours passés et de cette faillite d'un long commerce entre le monde et moi. Il fallait fermer boutique et passer à autre chose, mais quoi ? Il fallait admettre une sorte de mutilation définitive, un membre de ma mémoire et de mes rêves avait été coupé net, il fallait alors guérir en sachant que la douleur se ferait toujours perceptible, surtout dans ce "topos" intériorisé et disparu de la lumière du jour. Les deux guerres avaient laissé ma grande maison debout, la modernisation a eu sa peau, sans coup férir. Comment allais-je moi me moderniser pour ne pas laisser seules ces hirondelles affolées par mes milliers de scarabées, et ces rayons de soleil brisés dans l'été vespéral ? Cette cour pavée dont j'avais fait un univers ne le sera jamais plus, cette cave dont il ne reste qu'un douloureux labyrinthe mnésique n'accueillera plus son héros libertin, l'hôtel particulier d'en face mettra bien un siècle pour s'y faire, et la bâtisse ridicule qu'on a mis à la place de mon bel immeuble sera depuis longtemps réduit en poussière. On ne construit plus pour des siècles, car l'esprit de l'installation sur une terre a tout simplement disparu.
Vivre dans le sédentaire, c'est autre chose que de s'arrêter ici ou là. Vivre dans le sédentaire c'était construire pour des générations, pour des dynasties d'hommes et de femmes. Nos monarques ont réalisé ce projet avec beaucoup de talent, laissant leurs peuples errer de cabanes en taudis et de taudis urbains en HLM de toutes sortes. Les peuples avaient encore, au début de ce siècle, quelques millions de paysans que la fidélité au projet néolithique avait préservés, mais le mépris du nouveau monde pour les fruits de l'œuvre paysanne si ancienne a abattu ces survivants ruraux. - les nomades anglo-saxons ne sont-ils pas ceux qui ont inventé l'agriculture industrielle ? Cette sorte d'exécution a eu lieu d'une manière extrêmement perverse, il a suffi de contenir artificiellement les prix agricoles au plus bas possible au profit des prix industriels pour tuer cette attitude vitale dont les Grecs et les Romains avaient fait le critère de la citoyenneté. Aujourd'hui il n'existe plus que des rurbains, la plupart des vrais paysans gèrent leurs exploitations depuis la ville, même les régisseurs sont choisis parmi les nouveaux nomades venus du sud, ceux qui portent le beau nom d'immigrés.
Asphyxie. Car toute l'Europe vit dans ce malentendu explosif, sauf peut-être encore quelques dynasties au sang bleu, prêts à resurgir au moindre mouvement de crise dans tout l'éclat de leur puissance de lien avec le sol. Droit du sang, droit du sol : par son choix du sol, la France est bien ce lieu magique où le néolithique avait trouvé sa plus belle réussite, sa plus belle réponse à la question de l'être, Heidegger n'est pas seulement un philosophe français parce qu'il est lu et apprécié en France, mais parce que toute son œuvre est traversée par cette éthique de la proximité stable et immobile de l'homme et de son monde. En y réfléchissant, on pourrait peut-être faire cette découverte extraordinaire que le philosophe de la Forêt-Noire fut le pire ennemi du nazisme, tant la sédentarité de sa pensée s'opposait férocement avec le nomadisme militariste des idéologues du Reich. Ce n'est pas un hasard si ces penseurs de l'horreur ont tout fait pour se débarrasser de ce gêneur et lui retirer toute influence dans l'université allemande. Là-bas, de l'autre côté du Rhin, c'est le droit du sang, du sang que l'on emporte dans ses veines lorsqu'on se rue sur les pays voisins que l'on ne regarde plus comme un autre pays, mais comme une pièce de l'espace allemand récupéré par la force. Regardez ces Allemands du Don, ce groupe de "nationaux" qui vivent depuis des siècles en Russie et qui se redécouvrent Allemands aux lendemains de la Perestroïka. Les Huguenots qui vivent depuis Louis XIV en Allemagne ont-ils jamais revendiqué le retour dans la nationalité française ? Mais Frédéric le Grand, ce constructeur de terre, ce réalisateur de la part de calme dans l'âme allemande, n'a pas eu ces réflexes archaïques qui marquent les rédactions constitutionnelles bismarckiennes que même les socialistes de Weimar n'ont pas eu l'idée de réformer. Le droit du sang c'est le nomade qui n'a de relation qu'avec lui-même et sa dynastie, c'est le génos grec ou le clan qui ne revendique de l'étant que la part de ce qui lui est propre de sa naissance dont il n'a même pas le souvenir du lieu.
Voilà donc l'un des enjeux de la "construction européenne", Droit du sang ou Droit du sol ? Ce sont deux mondes qui s'affrontent, et pas seulement entre la France et l'Allemagne. Mais cet affrontement-là n'est que la partie émergée de l'iceberg, ces différents idéologiques ne sont rien à côté de la pression nomade américaine, dont la mondialisation n'est pas seulement une simple ouverture des frontières, mais une totale abolition de toutes les identités terriennes. L'ouverture des MacDo n'est pas tant désespérante parce qu'elles polluent le goût et la délicatesse de nos palais, que parce qu'elle chasse et détruit tout le travail d'installation des peuples dans leur histoire et dans l'histoire de leur relation à la terre. Je dis désespérantes non pas parce que j'y vois personnellement une catastrophe historique, mais une évolution majeure qu'il faut comprendre et par rapport à laquelle il faut se mobiliser non pas forcément pour l'affronter aveuglément, mais pour sortir cette évolution elle-même de l'aveuglement dans lequel elle a lieu et prendre les dispositions qu'exige notre volonté de maîtriser autant que faire se peut, notre destin. Sans illusions, car il faut bien admettre que tout cela se comprend trop tard, "la chouette de Minerve s'envole à la tombée de la nuit", mais le but n'est pas tant d'avancer naïvement et avec certitude vers la vérité, que de se contenter provisoirement d'éviter de refaire des erreurs qui se sont avérées fatales. Encore une fois, le lotissement industriel de l'Europe est la fin du projet sédentaire, parce que l'œuvre humaine a totalement quitté la terre. Détruire cette relation, c'est comme si on s'avisait de déplacer le Parthénon à Time Square ou à Central Park pour en faire une station de métro. La surface corrigée et le cours du terrain ont chassé tout le reste, ce reste n'a plus de place que dans une aliénation du projet, dans une sédentarité devenue pure immobilité de laquelle il est urgent de s'évader le plus loin et le plus souvent possible, voyez la prospérité des tour - opérateurs !
Le tourisme est bien cette réaction incoercible à cette agonie du rêve sédentaire.

IV
NOMADISME : LE RETOUR
On le voit bien, le nomadisme est de retour, le projet du néolithique est mort, en tant que tel, comme si un cycle était en train de s'achever dans l'histoire secrète de l'humanité. Le nomadisme est de retour sans projet nomade, seulement à travers cette immense restructuration de l'étant Terre mise en branle par les deux grandes catastrophes militaire de la première moitié de ce siècle. Cette structuration porte les noms creux de modernisation ou de développement, et l'on peut voir ce que la construction européenne a déjà induit de destruction des écosystèmes sédentaires dans le sud européens. Le plus beau de tous ces pays, la Grèce, est devenue méconnaissable à qui l'a parcourue il y a seulement quarante ans. Une telle infirmité pour la nation qui se veut le berceau de la civilisation et aussi le lieu d'attraction touristique le plus convoité, est d'une gravité absolue. L'Italie vit le même cauchemar, mais déjà se font jour de nouvelles réactions provoquées par le désarroi, déjà on imagine de nouveaux traitements pour le terrain, de nouvelles stratégies de développement qui se proposent d'éviter la pollution systématique des paysages et l'emprise totalitaire de l'activité immobilière. En Sardaigne les autorités travaillent en direction d'un développement "doux", le tourisme vert, tentative d'embaumer l'île dans son sarcophage bleu - Méditerranée en préservant l'agriculture, en exhumant les immenses richesse archéologiques comme pour exhumer les premières grandes réussites du projet sédentaire maintenant au crépuscule de son être. Au résultat, la sensation du danger est nette, tous les affairements écologiques montre à quel point le sentiment de culpabilité d'avoir laissé la relation à la terre entrer dans une telle déshérence domine aujourd'hui dans la conscience collective. Mais ce sentiment n'est déjà rien d'autre qu'un nouveau romantisme nostalgique d'une éthique décomposée, dont la nature même a été rayée de la mémoire des hommes. A écouter ces "protecteurs de la Nature", on voit bien que la culpabilité inconscience se déplace vers le centre du problème que constitue le comment de l'habiter-la-terre, c'est à dire du comment être-dans-l'Etre.
L'AFFLUX NOMADE
Car le nomadisme est depuis longtemps de retour, massivement. Les deux traumatismes guerriers de ce siècle, suivi de toute la kyrielle des guerres secondaires, coloniales, froides et chaudes, ont bouleversé d'un coup le train-train d'une Europe qui s'était, tant bien que mal, trouvé un équilibre entre une société enracinée dans son sol, et cette communauté occulte dont la vocation était d'assurer la dose d'expatriation nécessaire à contenir la pression nomade intérieure. Ces deux guerres ont comme tombé le masque de cette comédie à double face : d'un côté les sédentaires détruisaient par l'industrie la nature essentielle de leur motif d'être sédentaire, de l'autre les nomades des colonies qui à la fois fuyaient la décomposition naissante, et à la fois compensaient par le rêve qu'ils distillaient dans leurs métropoles, la douleur de l'aliénation issue du développement. Les dépaysements des voyages coloniaux recouvraient géométriquement le dépaysement qui gagnait l'âme des hommes et des paysages de l'Europe. Le romantisme n'aura rien été d'autre que l'expression littéraire de ce sentiment d'abandon d'une relation éclairante entre l'homme et sa terre. Les guerres furent donc des points de rupture, où cette indemnité morale n'était plus suffisante, car l'aventure coloniale elle-même n'était plus digne du rêve. Le message que les colonies adressaient à leurs métropoles était décevant, il ne parlait que de ce faux commerce qu'étaient l'échange de marchandises et l'exploitation développante des autres peuples. D'autant plus décevant que les impérialismes ne faisait qu'accélérer dans les métropoles ce développement néfaste, ce vandalisme environnemental, cela même qui minait la métropole, sans pour autant apporter aux autres peuples le moindre progrès. Pire, leur commerce n'a eu pour résultat, dans la plupart des cas, que la destruction parfois criminelle de la terre exotique. Ce fut le cas dans l'un des plus riches et des plus beaux pays d'Afrique Occidentale, la Côte d'Ivoire, où les Français ont détruit neuf millions d'hectares de forêt primitive sur douze. Comme pour la Grèce, ce pays est devenu méconnaissable en à peine un demi siècle. Evoquons encore cette catastrophique et prétentieuse erreur des Britanniques dans l'actuel Bangladesh. Là ils ont détruit l'équilibre millénaire du Delta du Gange sous prétexte de progrès technique, remplaçant les digues complexes et fragiles par des barrages modernes. Au résultat, ce pays doit s'attendre à chaque mousson à des inondations incontrôlables et meurtrières.
Combien de millions d'êtres humains les guerres ont-elles lancé sur ce qui restait des routes et combien de ces personnes ont-elles retrouvé leur site propre, la terre qu'ils possédaient ou habitaient avant ces guerres, les maisons où ils étaient nés, l'espace dans lequel ils s'étaient faits, le cépage de leur lignée ? Combien d'êtres humains ont découvert au cours de cette période que le voyage était non seulement un moyen de survie, de survivre au danger ou de le combattre aux antipodes, mais qu'il pouvait aussi être une éthique sur laquelle on pouvait construire un vivre, édifier un habiter-le-monde bien plus exaltant que celui des mornes ruines que leur léguait la folie des hommes.
EXODE
Quand les canons se sont tus dans les plaines de la Champagne, le monde se mit à grouiller, comme les poux annoncés par Maldoror. On pouvait se contenter de penser que ce grouillement n'était que l'immense mouvement de retour de tous ces êtres déplacés. Les Américains, les Canadiens, les Australiens et tous ces peuples qui se sont joints à la France pour contenir les hordes germaniques de 14 à 45, sont tous repartis en sens inverse, quand ils ne s'installaient pas sine die dans le provisoire des troupes d'occupation. Nos Français des colonies à la peau noire ou au teint halé, devaient aussi repartir, mais au fait, pourquoi ne pas rester, l'industrie était prête à les accueillir, la France reconnaissante et toutes ces sortes de choses : les Maghrébins auront leurs compounds près des fonderies et des aciéries, les Indochinois auront leurs quartiers réservés dans certaines grandes villes, ceux qui veulent rester, le peuvent. Bel élan de générosité, la République rétrocédait à ces faux immigrants mais vrais héros, les portions les plus sales et les plus pourries des villes afin que les capitalistes français puissent faire fructifier leur argent. La grande modestie revendicative de ce nouveau prolétariat d'aubaine tiendrait un peu en laisse la rage révolutionnaire des ouvriers de métropole. Et ça marche tellement bien que l'Office National de l'Immigration recrute à tour de bras dans les Aurès, en Oranie et dans l'Atlas marocain. L'Allemagne se relève trop vite de la guerre, avec une industrie entièrement modernisée avec l'aide massive des Etats-Unis, sa compétitivité est écrasante face à une industrie française obsolète, mais les patrons de chez nous ont trouvé la solution : l'immigration. Les bas salaires compenseront longtemps en France la vétusté du capital fixe. Bien sûr, lorsqu'on aura remonté ce handicap dans les années quatre-vingt, alors on chargera un certain Le Pen de faire le ménage, mais il est trop tard pour cette ultime infamie, les Français ne laisseront pas s'accomplir ce remake scandaleux de Nuit et Brouillard. N'empêche, l'épisode du Front National aura mis les feux de la rampe sur ce phénomène boomerang des colonisations, savoir l'immigration. Partout en Europe, les anciens colonisés se mettent à coloniser nos métropoles. De Londres à Lisbonne, les immigrés deviennent une partie importante de la population, leur intégration est devenue un problème politique majeur. Paradoxe, ces Africains avaient peut-être réussi bien mieux que nous leur sédentarisation avant que nous ne venions en faire des esclaves puis mettre la main sur leurs terres et leur destin. Disons que les Africains avaient trouvé une alternative au dilemme entre nomadisme et sédentarisme. Le climat et la qualité des sols africains leur a d'ailleurs fixé les limites de l'un et de l'autre. Paradoxe significatif : les nomades européens viennent décréter l'état de barbarie dans un continent sans guerre majeure, provoquant même des batailles coloniales qui font le même effet sur cet écosystème humain si fragile que les barrages anglais de l'ex-Pakistan Oriental. Démembrement des quelques dynasties indigènes qui règnent presque partout, anéantissement des structures de pouvoir complexes - les petites digues écologiques du Gange - et surtout remue-ménage des populations d'un bout à l'autre de ces nouvelles entités territoriales qui sont baptisées Afrique Occidentale Française, Afrique Equatoriale Française, sans parler de la Corne ou des territoires de l'Océan Indien et Pacifique ou d'Extrême Orient. Exemple célèbre, longuement décrit par Albert Londres dans son reportage réalisé en 1928, les migrations forcées de Haute-Volta (l'actuel Burkina Faso) vers la Côte d'Ivoire pour "sortir le bois", les transferts d'hommes et de femmes vers les chantiers des chemins de fer, des transferts où l'on mourrait autant que sur les chantiers eux-mêmes. Les derniers événements dans la région des grands lacs forment une bonne représentation de ce que pouvaient être les longues colonnes de "nègres" affamés, malades, mourant en marche ou sous la chicote du garde-chiourme. Bref, sans lyrisme, nous voulons seulement indiquer comment nous avons détruit tous les ordres d'existence, toutes les attaches des "indigènes" à leurs lieux de vie, tous les équilibres légers et souples de la subsistance humaine. Imaginez une alimentation qui dépend chaque année d'une autre parcelle de terre, car la terre africaine ne donne rien deux fois de suite, le gros de la nourriture ce sont les racines, qui sont plantées dans la forêt de manière aléatoire mais parfaitement repérées, un peu comme un champ de mines géré correctement selon les conventions de Genève. Eloignez le cultivateur de dix kilomètres de son village de torchis, il ne lui reste plus qu'à redevenir un nomade qui vit de cueillette et de chasse, quand il possède des armes.
Aujourd'hui, ces chemins de croix les amènent ici, sur notre continent. Ils franchissent sans états d'âme des milliers de kilomètres par tous les moyens, même dans les trains d'atterrissage de nos beaux oiseaux à kérosène. Les belles âmes s'empressent d'évoquer alors le sous-développement, la faim de nourriture, de culture, de "formation" et l'état lamentable de pays corrompus et mal gérés. Soit, mais nous préférons invoquer des motifs, des mobiles beaucoup plus précis, mais qui font mal à notre mémoire en raison de tout ce que nous venons d'esquisser du destin de ces peuples : désarroi destinal. Les nègres, ou les Maghrébins ou encore les DOM-TOMIENS, où peuvent-ils situer le sens de leur existence lorsqu'ils ont vécu les derniers siècles pour ainsi dire dans la main de l'occident, comme un jouet, dépouillés de toute autonomie, à peine une ombre négligeable du destin de l'Occident ? Ceux qui se permettent de critiquer l'impuissance des nations africaines à suivre l'exemple de l'occident se rendent coupables d'une extrême mauvaise foi. D'abord parce que personne ne leur a laissé le choix de suivre une voie qui ne serait pas exactement la nôtre. Que signifie par exemple de sédentariser cette multitude de peuples, tous semi-nomades, selon des frontières abstraites dessinées sur un coin de table, à Berlin en 1885, par des Européens enivrés de colonialisme et de ruées sur le cuivre du Katanga, l'acajou de Côte d'Ivoire ou le diamant d'Angola ? C'est n'importe quoi, dirait-on de nos jours, un n'importe quoi qui se montre comme un mépris total, comme un véritable déni d'existence. Mais le discours qui se tient aujourd'hui sur l'Afrique est encore bien pire, tant dans ses intentions que dans ses effets sur le continent noir. On ne peut guère reprocher à des peuples mal ficelés dans des structures politiques archaïques de se comporter comme de simples brigands, d'autant qu'ils auront eu le courage de mettre en marche une énorme machine, lourde, inconfortable, dangereuse et pour la plupart à perte. En revanche on se comporte aujourd'hui dans le plus pur style : rien appris rien oublié, dans un esprit tout à fait équivalent à celui des colonisateurs, mais sans objet. La presse occidentale, et cela est vrai pour l'ensemble des pays dits développés, parle du continent africain d'une manière généralement insultante pour qui sait écouter. On dirait que cette arrogance constante, qui veut mesurer l'existence des Africains à l'aune de ses propres infamies a pour but de se venger d'un échec retentissant. Au demeurant, les Africains eux-mêmes ne sont pas pour beaucoup dans cet échec, car la décolonisation a plutôt comme véritable théâtre la concurrence féroce entre l'Amérique et l'Europe. D'une part les Américains sont littéralement ravagés par la culpabilité liée au massacre des Indiens, tellement ravagés qu'ils n'arrivent pas réellement à en prendre conscience. La Sainte Barthélemy possède une bien plus grande valeur symbolique de remords que ce génocide qui continue d'occuper un curieux statut dans la conscience mondiale, parce que les Américains n'ont pas encore seulement commencé d'en faire le deuil. D'autre part, pour être réaliste, la stratégie anti-colonialiste américaine en Afrique - qui commence dès le dix-neuvième siècle et dont le plus beau symbole reste le film célèbre African Queen, qui met aux prises Humphrey Boggard et Katharin Hepburn - a pour objectif premier de stériliser les sources de matières premières du continent. Les premières multinationales de l'histoire étaient des cartels qui contrôlaient au niveau mondial la production des matières premières, ce qui fait qu'aujourd'hui encore c'est à Paris et Londres que s'établit l'essentiel des cours boursiers de ces produits. Or les Américains avaient la haute main sur ces premiers mastodontes de l'économie mondiale, il n'était donc pas question que l'Europe leur taille des croupières à partir de cette fabuleuse montagne de matières premières que représente encore aujourd'hui le continent africain. Cette histoire occulte a son épilogue dans le présent, car les Américains ont gagné sur toute la ligne. Lorsqu'en effet les Européens eurent fini par accepter de guerre lasse cette décolonisation-piège, ils pouvaient encore espérer comme De Gaulle que la coopération pourrait venir remplacer l'exploitation directe du continent, mais là encore les Yankees veillaient au grain. En l'espace de trente ans ils réussirent à monopoliser dans les organisations prétendument internationales comme le Fond Monétaire International ou la Banque Mondiale, l'ensemble du crédit qui tient à bout de bras la plupart de ces pays que l'on n'ose pas dire pauvres car ce serait un trop grand mensonge. Il faut savoir qu'à l'origine, et encore aujourd'hui, ces organisations internationales sont étroitement contrôlées par Washington, même si une certaine coquetterie ironique pousse parfois le Département d'Etat à mettre à leur tête des patrons français.
L'AFFLUX NOMADE
Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, a encore subsisté à travers le vaste monde une sorte de statut quo issu de la Grande Guerre. Allemands et Français se sont dépêchés de rentrer, qui dans sa grande cité, qui dans son village ou son hameau. Les Africains et les Asiatiques qui avaient survécu aux offensives meurtrières, furent renvoyés chez eux, et exceptées les troupes qui furent envoyées quasiment en secret sur les nouveaux fronts anti-bolcheviques de l'Est et celles qui resteraient en Rhénanie pour contrôler l'application du Traité de Versailles, tout le monde rentra dans ses foyers. Les seuls mouvements qui agitaient les océans, les grandes routes et de plus en plus l'air lui-même, étaient le commerce et la mise en coupe réglée des colonies africaines et asiatiques. Entre les deux guerres, l'immigration se réduisit à l'afflux sporadique des Juifs fuyant les pogroms russes et polonais, et ceux qui préparaient la Shoah en Allemagne. Mais l'Europe elle-même s'est comme assoupie dans un recommencement douloureux pour tous, les maladies, la famine générale, les troubles politiques et économiques accéléraient le repli de chacun dans ses frontières et sur ses propres problèmes politiques. Pas grand chose de "roaring" dans les "twenties" d'une Europe qui soigne ses plaies en préparant le cataclysme suivant. Mais la pression s'accumule partout, la soupape italienne lâche le premier signal. Ces incorrigibles Romains pensent revenu le temps de leurs exploits antiques et Mussolini ne se fait pas prier pour exploiter une veine poétique qui n'a pas d'autre but que de distraire une population miséreuse, à peine rassérénée par une victoire à laquelle elle a quand même pu participer. Comme si l'ensemble du continent roulait en fait sur la lancée aveugle de la Grande Guerre, les forces cinétiques comprimées dans les frontières firent leur effet : l'Europe devint une chaîne de guerres civiles. D'Italie jusqu'en Espagne, les peuples se divisaient et s'affrontaient, mitose violente qui allaient accoucher brutalement dès que l'Allemagne aurait fait la démonstration de sa nouvelle puissance dans le ciel des Asturies. La vérité de la boucherie de 14-18 avait encore à se manifester comme pure néantisation du monde, débarrassée de tous ses buts de guerres, de sa logomachie politico-diplomatique et des bavardages pseudo pacifistes et universalistes.
La question n'a pas vraiment été éclaircie de savoir qui était partie prenante dans ce dessein d'un ultime Ouragan sur le monde. Si le désir d'Hitler s'affichait fort clairement quant à sa volonté de moudre le monde, comme pourrait l'avoir dit Jünger, les plans secrets des autres, leur volonté à peine déguisée, à peine inconsciente d'en faire autant, remplissait les arsenaux de Stockholm à Rome. On savait, et pas seulement les états-majors car les peuples ont souvent plus de sensibilité à la situation réelle que des militaires fixés sur des lignes stratégiques et tactiques immédiates, on savait que la "der des der" était fatale, inévitable. Cette expression française contient tout le principe de la destruction radicale et prophétise, non pas l'espoir d'une victoire définitive des uns ou des autres, mais la fin du monde, ou celle de la guerre elle-même. La Grande guerre avait révélé ce qu'il fallait savoir pour imaginer ce que pourrait être une nouvelle conflagration : les Français en particulier avaient toutes les raisons de traîner les pieds lorsque le moustachu aura lancé ses hordes sur les Ardennes. Car à ce moment-là, ce fut précisément seulement la conscience la plus aiguë de la volonté de détruire qui avait une chance de triompher. Dans l'hexagone, personne, à part quelques romantiques malades comme Drieu La Rochelle ou Céline, n'avait encore songé à se faire Hara-Kiri au cours d'une partie de roulette russe galactique.
L'Allemagne avait condensé la pression issue de Verdun. Dans le désespoir du plus-rien-à-perdre, perfidement alimenté par les puissances voisines et lointaines, les Allemands avaient sorti de leurs armoires l'ancien habit de barbare que les Romains avaient taillé pour eux quelque deux mille ans plus tôt. Les élucubrations passées aux actes de Mussolini synchronisaient la pulsion allemande aux canons de la mythologie historique, formant le décor adéquat et pertinent de cette métamorphose ou de cette régression. Le second grand mouvement de population du vingtième siècle allait donc prendre son départ tout naturellement dans l'espace des Européens les plus sédentaires redevenus en quelques années les nomades modernes. Modernes car enfermés dans le sens général du sédentaire, et ainsi conduits à se définir en dehors de toute morale d'une collectivité qui dépasserait la leur. Car, fait remarquable et toujours passé sous silence ou peu commenté, les Allemands avaient en même temps reconstitué leur communauté ; ils auront été dans ce siècle, le seul peuple à réussir à se recoudre dans l'ordre communautaire, ce qui ne manquera pas d'avoir de puissantes conséquences à très long termes. Modernes donc, comme ces nomades attardés, condamnés à la prédation pour survivre car privés d'espace. Privés d'espace tout court, puisque l'Allemagne de 1939 était déjà un pays surpeuplé selon les normes moyennes européennes, mais aussi privé de l'espace nomade en soi, celui qu'ils redécouvraient comme leur dans les fantasmes de conquêtes.
Et ce mouvement-là n'allait plus jamais s'arrêter. A partir de 1945, la mutation allemande aura gagné toute l'Europe. En s'écroulant dans la poussière, le rêve prussien d'un monde satrapisé par les Germains, avaient en réalité contaminé l'esprit du monde : le rêve d'une satrapie était devenu le sens général des choses reçu par chacun en partage dès le berceau. Il faut comprendre ici la chose la plus difficile à comprendre : le déraillement du sens, un déraillement pareil à celui du néolithique, un retour de flamme décisif, une percée dans la conscience - ou une anamnèse soudaine de ce lointain passé. Au fond du fond du monde, depuis la brousse nigériane jusqu'aux steppes argentines, hommes et choses trouvent une nouvelle application à ces étranges machines qu'ils ont imaginé pour franchir l'espace, pour voyager. Si l'on excepte l'exemple américain, pour les raisons que nous avons déjà exposées, les moyens de transports dans le reste du monde, s'étaient toujours tenus jusque là dans une finalité modérée et limitée. Les réseaux de chemins de fer issus du dix-neuvième siècle, illustrent assez bien ces limites parfois calquées sur les zones de l'exogamie, sur les limites extrêmes du déplacement que toléraient les tribus pour se marier. Les moyens de transports recoupaient les besoins de la vie sédentaire, comme aujourd'hui le RER permet aux Parisiens tout simplement d'organiser leur survie. Dans ces temps-là, quelques rares individus, les Paul Morand, André Maurois, Cendrars ou Gide, voyageaient. Montaient dans les wagons, les carlingues et les Paquebots pour rien, pour voir, pour éteindre leur ennui, pour se déplacer, circuler, franchir des espaces jamais explorés pour autre chose que la guerre ou le commerce. Le regard littéraire anticipait l'instinct collectif de circulation qui allait se condenser dans l'objet-fétiche du monde contemporain, l'automobile. Désormais la marchandise la plus précieuse serait cet instrument de voyage fantasmatique qui ouvrira la scène la plus hideuse de la comédie humaine. Car c'est un piège qui allait se refermer sur ces peuples soumis à cette nouvelle pression spirituelle : l'automobile allait devenir le plus fidèle allié des forces d'enracinement sédentaire. En effet, la découverte de cette autonomie de circulation déclenche deux phénomènes contradictoires : d'un côté le miracle rend indiscutable le fait qu'on y investisse le meilleur du social, aux dépens de tous les autres secteurs de la vie, notamment de la nourriture. Les usines fleurissent partout et en nourrissant le fantasme, créent une dépendance radicale, car entre-temps le véhicule se voit condamné à servir en auxiliaire de cette industrie elle-même. On fabrique et vend des automobiles pour permettre aux gens de se rendre aux usines qui les fabriquent ou qui dépendent de cette stratégie globale d'investissement. La boucle est bouclée, le rêve s'est brisé dans l'œuf, ni la voiture ni ses héros n'auront jamais connu l'essence de sa vocation première. Les victimes de cette supercherie n'auront pour se consoler qu'à devenir les fans de la Formule 1 ou les spectateurs par média interposés du Paris-Dakar, lointain rejetons des expéditions en Chine.
Or l'automobile va fonctionner et fonctionne bien aujourd'hui comme paradigme premier du sens de l'existence, au point d'habiller esthétiquement les classes sociales et culturelles comme si les carrosseries étaient devenus les secondes peaux ou de nouveaux vêtements de l'être humain. Comme naguère il allait aux chaussures, le premier regard va toujours à l'auto, car l'auto contient toute la virtualité convoitée. A sa solidité, on rêve, comme devant les Chaussures de paysans de Van Gogh, à l'universalité de son usage, aux millions de mesures d'espace qu'on pourrait franchir à telle ou telle vitesse. Devant une Mercedes qui compte 24 chevaux fiscaux, on se voit à Pékin ou à Tombouctou, on se voit dans l'âme cachée de ce tas de ferraille, dans la dérive enivrante et aléatoire intégrée dans les formes et dans le désir reflété par le design. Donc, on peut juger l'autre d'après les nuances offertes par le design. Rien de plus ridicule de nos jours, que ces énormes monstres en forme de Jeep que l'on croyait réservés aux pistes du Sahel ou aux Ranch texans ; mais quel habillage, quel beau morceau de rêve à portée de main ! Il suffit d'exhiber ces carrosseries que d'habiles artistes ont conçues d'une rusticité toute contrefaite pour devenir quelqu'un d'autre que ce pékin qui passe sa vie entre son bureau et sa boîte de nuit. La véritable âme de nomade surgit dans les sillons profonds creusés à même les bandes de roulement de leurs pneus géants. A leur profondeur on devine le drame de l'ensablement dans les dunes du Hoggar, et les dangers des bourbiers du poto-poto tchadien. Les chromes éclatants rappellent que les vents du désert polissent eux-mêmes les calandres des nomades imprudents. Hélas, la grande masse de ces jouets dont le seul prix dissuade leurs propriétaires de passer à l'acte, finira comme tous les autres véhicules à moteur à explosion dans les casses de banlieue sans être jamais sorti des réseaux les plus banaux des cartes Michelin. Mais le fantasme aura connu un début d'assouvissement, l'aventure se sera signalée dans sa forme sinon dans sa réalité, et la vanité aura trouvé son compte pour le temps que cela durera et pour autant que la société y participe de tous ses clins d'œil complices.
Cette tragi-comédie, qui s'achève en cette fin de siècle par tous les maux qu'on attribue aujourd'hui à cette belle invention, n'est qu'un reflet, un vague symptôme de ce qui se joue en l'homme. Par toutes sortes d'illustrations exotiques, les médias tentent bien de maintenir intact la pertinence du rêve mécanique du déplacement aléatoire dans ces drôles de machines. Mais de Ushuaïa à Paris-Dakar, le cœur n'y est plus, le spectacle n'est pas la chose et Guy Debord a eu bien tort de diaboliser comme il l'a fait cette fameuse société du spectacle. Dans la "communauté désœuvrée" de Jean-Luc Nancy, il se prépare beaucoup de choses dans chaque tête. Les individus, livrés et formés à leur individualité, conçoivent des projets dans leur for intérieur, des projets encore privés d'aboutissement immédiat parce que les forces d'inertie tiennent toujours jusqu'à la dernière limite, et parce que ces projets eux-mêmes contiennent en eux toutes les imperfections de la rêverie névrotique. Mais la cadence est donnée, la ligne générale nourrit désormais non seulement les fantasmes, mais la technologie elle-même, les milliards de dollars coulent vers l'Idée qui naquit une nouvelle fois dans la tourmente du siècle.
Nous y reviendrons plus longuement dans le chapitre suivant, car cet afflux du nomadisme ne se joue encore que dans une praxis sociale absurde et sur le mode virtuel ou théâtral. Dans ce même monde, un autre nomadisme bien réel celui-là, s'est mis en branle en sens inverse du mouvement de la colonisation. Les semi-nomades d'Afrique et d'Asie sont partis à l'assaut des métropoles de la sédentarité purifiée par la décolonisation. De ces pays, la France, l'Allemagne, l'Italie etc.. ne partent plus que les hommes d'affaires et les touristes, nomades encore virtuels mais déjà sous la fascination du nouveau principe de la circulation aléatoire.
Perdu dans la savane, Tiémoko rêve, lui aussi. Il rêve un paradoxe : se défaire de sa liberté pour l'échanger contre celle qu'offrent tous les simulacres de la liberté des occidentaux. Voyez-le, là-bas, accoudé au bar improvisé de son village que baignent les derniers rayons du soleil. Il est là depuis la grande chaleur de midi, sa pêche du matin a tout juste permis à sa femme de se procurer un poulet, et entre deux bières il y pense et salive un peu. Mais son esprit est ailleurs, selon le beau mot de Pessoa, il souffre d'intranquillité. Son regard passe bien au-dessus des tables et des convives ses frères, il médite le pire et tout le monde sait que Tiémoko va partir. Mais le jeune homme, il vient d'avoir vingt-deux ans, boue d'impatience, en réalité. Son inquiétude tient davantage d'une tactique de dissimulation vis à vis de ses compatriotes qu'il entend bien abandonner à leur sort pour aller là-bas vers La Mecque de l'aventure et du bonheur facile. Autour de lui, la monde a perdu sa cohérence, le temps s'est arrêté au mauvais endroit, là où le bus ne passera plus jamais. Il se souvient parfois de tout ce bonheur d'enfant noir, jeté dans la vie comme au paradis, exténuant la moindre brindille de tous les plaisirs qu'elle offrait, chevauchant la savane au milieu de ses petits camarades si beaux et si rieurs. Ah qu'est-ce-qu'on a ri ! Comme on se moquait du rat palmiste débusqué dans son trou, du Missié blanc qui devenait tout rouge de colère, du gendarme toujours ivre mort battu par ses femmes et qu'on trouvait le matin inanimé près de l'ancien corps de garde. Tiémoko avait fait le boy pendant quelques années, et ce furent les années les plus drôles de sa vie. Il se souvient du jour où missié blanc lui avait demandé de mettre un clou de girofle dans la sauce des rognons, et de la figure de la tablée des missiés quand ils goûtèrent le plat où mon boy avait vidé la boite entière de clous de girofle en les plantant soigneusement dans l'oignon. Une autre fois, la madame lui avait demandé de plumer le canard et de le mettre au frigo, et Tiémoko l'avait fait, le canard bougeait encore quand madame le découvrit au fond du Frigidaire à pétrole. Mais aujourd'hui tout ça était du passé. Dans son village on ne riait plus guère, on buvait surtout beaucoup de bière, et les femmes s'évertuaient à faire encore pousser ici ou là quelques racines pendant que les hommes grimpaient essentiellement aux palmiers pour en extraire le dolo, ce vin exquis qui devenait aussi de plus en plus rare dans ce pays de plus en plus sec. Tout foutait le camp, même les blancs qui étaient devenus lointains et ennuyeux. Il fallait aller voir pourquoi, pourquoi ces anciens colons si joyeux et si plein de vie avaient commencé de s'étioler au soleil de l'Afrique, et ne demandaient plus qu'à rentrer chez eux après avoir fait leur pelote de plus en plus problématique aussi à finir. Plus rien ne l'attachait ici, ses copains finiraient tous par faire comme lui, par partir et risquer le pire. Car Tiémoko savait tout. Il savait que la France, ça allait être dur au début, dangereux, comme il faudrait ruser avec la loi, travailler dur pour rien et se faire tout petit jusqu'à ce que la chance se manifeste. Ces derniers temps, le flot des aventuriers partis déjà il y a quelques années, refluait vers le pays, et ces hommes qui revenaient en charter n'étaient plus que des loques qu'il fallait abreuver de bière européenne pour leur tirer les vers du nez. Tiémoko avait appris toutes les leçons, il saurait faire, il réussira, lui.
Et les Tiémoko furent des centaines de milliers. Aux contingents que l'Office National de l'Immigration avait importé légalement jusque dans les années soixante-dix, venaient s'ajouter des centaines de milliers de clandestins. De Tunis, Alger, Tanger, Dakar ou Bamako, ils arrivaient par toutes les plages, par tous les cols de montagne, entassés dans des camions parfois, rarement raflés par les gendarmes, enfin couchés sur un matelas en plastique quelque part dans le dédale des ruelles de la Médina parisienne. Et puis les uns iront sur les chantiers dès le lendemain, encore épuisés par ce convoi Nacht und Nebel, mais les patrons attendaient, tout était organisé, les dettes signées, la corde au cou pour quelques années. Les autres ont encore un peu d'argent, ils vont attendre, prendre le vent, ils veulent réussir vite, apprendre, se former, devenir d'autres hommes, devenir comme le blanc, comme ces autres africains qui, là-bas en Amérique vivent comme tout le monde, peuvent s'enrichir, peuvent même devenir de grands hommes politiques, ceux-là croient encore au miracle. Au mieux ils figureront parmi les grévistes de la faim de l'église Saint Bernard, ils se feront au culot, une place au soleil. Mais quel soleil ! Très vite ces nomades d'un nouveau genre attraperont toutes les maladies de langueur des sédentaires. Ils prendront le métro au petit matin, gris de fatigue et de désespoir, ayant trop vite compris que le jeu n'en avait pas valu la chandelle, mais qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Le jour où on les prendrait, ils seront presque contents de se faire rapatrier gratuitement, même avec une prime qui leur permettrait au moins d'ouvrir un petit commerce, là-bas, au village, et sortir de ce cauchemar climatisé et donc inhumain
Le vingtième siècle sera devenu le siècle des exodes. D'un bout à l'autre de la planète les peuples dits pauvres se sont mis en route pour la richesse la plus proche, pour le site fantasmé où leur existence pourrait se mettre, elle aussi, en mouvement. Du Mali au Mexique, de la campagne chinoise aux frontières de la Russie ou de l'Ukraine, la conscience s'est réveillé d'un va-tout du rien à perdre découvrant du coup l'allégresse de la césure. On y puisera d'incroyables énergies et il en naîtra des odyssées dont les récits sont encore à faire dans la future littérature des valises en carton. De quel poids pèsent nos commentaires, ce voyeurisme qui se nourrit du même racisme dans la haine que dans la compassion, à côté de ces millions d'aventures les plus audacieuses les unes que les autres. Il est de bon ton, dans les gazettes, de pleurnicher sur ces mouvements de populations en les maquillant sémantiquement en de nouveaux esclavagismes. Quelle pitié, quel mépris pour l'homme, quelle arrogance indécrottable face à ces femmes et ces hommes qui franchissent toutes les nouvelles Mers Rouges, sans Dieu et sans même un Prophète pour renforcer leur foi. D'abord ils jouent leurs patrimoines, puis dans les soutes des rafiots ou des poids lourds, ils se tassent humblement, attendant d'abord la souffrance et la mort, et quand ils ont de la chance ils sortent de la nuit de la clandestinité en se frottant les yeux, sur le pavé qu'ils vont conquérir, sans coup férir, rien à perdre, tout à gagner, le courage initie à la réussite. Le courage du néant et celui du travail sont une seule et même chose, Monsieur Hegel, et comment en serait-il autrement puisque sans un dur labeur aucun maître ne peut vaincre. Sur-le-champ de bataille il n'y a pas que du courage de part et d'autre, il y a du travail, de la technologie et de la discipline.
D'ailleurs nous, nous les "riches", nous ne faisons que croiser ces "malheureux", eux à fond de cales, nous sur le pont des premières, en route pour nos dépaysements, nos cérémonies vacancières qui sont depuis longtemps devenu le supplément de travail périodique, le rite épuisant de la réussite de l'idée de jouissance qui se termine immanquablement par un surcroît de manque. Mais nous savons bien que c'est de ce manque que jaillit la culpabilité qui assurera, à la rentrée, la remise en marche sans faute de la machine à stress, du chevalet de torture. Ainsi, deux flux se croisent, ballet fracassant mais que rien ne révèle sinon parfois l'écho d'un crash d'avion surchargé ou de la mort d'une cargaison de clandestins versés dans un précipice pyrénéen. Les statistiques affirment que ces mouvements provoquent annuellement la mort de quatre cent mille personnes, un petit génocide Rwandais, mais les agents de l'Insee sont-ils vraiment partout où meurent de faim et de soif ceux qui ne sont pas abonnés à Europe-Assistance ? Bof.
LA MONDIALISATION MARCHANDE
Ce sont toujours les objets du désir humain qui échappent les premiers aux cadres dans lesquels ils ont été conçus. Ainsi la marchandise. Domestiquées par l'histoire de la sédentarisation du monde, les matières dites premières - et premières elles sont - sont devenues humblement les chiens de garde des peuples assis entre leurs champs et leurs usines. Les marchandises ont cependant dès l'origine, cette double identité sédentaire et nomade parce que si elles demandent un cadre fixe où elles sont produites, elles doivent aussi s'échanger pour gagner et conserver leur identité. Par conséquent elles voyagent en même temps qu'elles se tassent et s'entassent dans les recoins des huttes ou des entrepôts. Par la répétitivité des opérations d'échange, par l'automatisation progressive des itinéraires et des moyens et par l'étroitesse initiale des zones d'échange, on a pu longtemps ne rien voir de ce tourisme fantastique de la marchandise, tourisme dont on retrouve aujourd'hui les traces jusque dans les périodes les plus lointaines de la préhistoire. Au point qu'un doute surgit sur l'appartenance fondamentale de la marchandise à un monde spécifique, sédentaire ou nomade. En réalité la mondialisation telle qu'elle est mise en scène aujourd'hui révèle la totale neutralité de la marchandise dans ce domaine, elle se signale plutôt toujours comme avant-garde ou comme alibi de l'homme pour aller le plus loin possible, pour circuler comme ces fourmis qui traversent des milliers de kilomètres à travers les forêts de l'Amazone en longue colonnes disciplinées
Cependant, l'occident a cru pouvoir monopoliser l'argent, c'est à dire l'âme de la marchandise. Tant que les valeurs d'usage n'entrent pas dans le circuit MAM, marchandise-argent-marchandise, elles ne sont pas des marchandises. Les capitalistes ont donc cru pouvoir contrôler depuis leurs capitales, l'essence de ce qui semblait échapper à leur logique de l'immobile. C'est pourquoi la frappe de l'argent est le signe et la substance absolue de la souveraineté : valable pour un fief grand comme le Luxembourg ou pour un continent comme l'Amérique du Nord, la monnaie a sa source dans le centre du pouvoir et de là elle rayonne comme vecteur de cette souveraineté. Entendons-nous bien, comme vecteur, pas seulement comme symbole, sauf à rendre au symbolisme toute sa puissance cachée.
Aussi faut-il comprendre par, exemple, que la marchandise des Empires n'a jamais été une véritable marchandise. Concrètement mondialisée depuis les conquérants portugais et espagnols, elle est restée longtemps un objet de simple pouvoir de troc inégalitaire qui renforçait à chaque opération le monopole occidental de l'argent. La verroterie était l'objet du désir immédiat des Autres, mais en aucun cas le représentant d'un équivalent général comme l'or ou l'argent. D'abord précisément parce que l'or ou l'argent n'étaient équivalent généraux que pour l'un des termes de l'échange. Ainsi avaient déjà fait les Phéniciens, les Grecs et les Romains, avant les Vénitiens et les Hollandais, ainsi s'étaient-ils tous déjà creusé leur propre tombe avant de découvrir l'autre circuit AMA, Argent-Marchandise-Argent, la production spéculative de la marchandise absolue, l'argent. Dès lors, les aventures des marchandises à travers le monde ne menaçaient plus personne : la valeur était toujours au même endroit de la terre, en Occident, le sédentaire était assuré tant que nos coffres se remplissaient de la substance arrachée aux quatre coins du monde, parce que finalement il ne restait plus qu'une seule marchandise, l'argent lui-même. Aujourd'hui on produit, on élève et on trait une monnaie comme on fait pour le lait des vaches. Mais cette époque aussi est appelée à laisser la place à une autre forme d'échange.
Or justement la figure du nomadisme ne s'est pas embarrassée de scrupules pour surgir intacte des failles creusées par les guerres qu'elle a elle-même fomentées, et la marchandise, la vraie, pouvait prendre son envol décisif, celui qui allait corrompre toute la structure culturelle de l'Occident. Difficile à comprendre ? Soit, essayons d'être plus clair. La sédentarité est un retrait, ou un repli derrière des frontières où s'arrêtent de part et d'autre les mouvements des êtres humains. Dans cet intérieur, fixé pour l'éternité, les valeurs d'usage sont condamnées à se socialiser, c'est à dire à se transformer en marchandises. Car si cela ne se produisait pas, il se créerait une entropie violente et centripète qui ferait éclater les frontières d'un seul coup. Cela s'explique du fait que le désir qui se propose ces valeurs d'usage est un désir contraint par l'immobilité de son destin : la fameuse valeur d'usage est en vérité une valeur d'évasion, le fantasme succédané de la jouissance nomade. Dans le parcours du vrai nomade, il n'y a ni valeur d'usage, ni usure, il y a manducation, c'est à dire digestion du monde tel qu'il est, sans hiérarchie de valeurs. Cette manducation répond très bien à la figure de la jouissance mortelle telle qu'elle est définie par la psychanalyse, c'est à dire la jouissance sans report et sans calendrier. Mais, demanderez-vous, pourquoi les valeurs d'usage produites dans le monde sédentaire doivent-elles se charger de cette autre valeur qu'est la valeur d'échange ?
S'il y a forcément de la valeur, c'est seulement parce qu'il peut se trouver des différences déterminantes par rapport à la force du désir : mon Empire pour un cheval ! Ca c'est une situation exceptionnelle, mais là où l'usage s'enferme dans une valeur c'est qu'il y a répétition de l'usage dans une régularité suffisante pour établir des critères et des équivalents généraux. Le pain est un produit dont on "use" tous les jours, presque à la même heure et dans une quantité pratiquement identique et de toute façon mesurable. Allez donc mesurer la valeur d'un sanglier abattu par hasard au cours d'une battue avec celle d'un litre d'eau dans une savane sèche ? Le sel a été l'or des déserts à cause de sa répartition irrégulière dans le monde, et cela malgré l'énorme quantité existante. Autrement dit cette question : comment faire de l'économie dans un monde mouvant ? Toute économie est liée à la Cité, là où le désir est coupé du mouvement aléatoire, situation dans laquelle ce même désir s'invente la culture, c'est à dire la représentation du mouvement. Jeux, théâtre, philosophie sont les images du mouvement essentiel, du monde se mouvant par lui-même, c'est à dire de l'essence mouvante de la réalité. Cette essence est mise en danger dans la sédentarité comme praxis, et, pour paraphraser presque à l'envers Heidegger, c'est le mouvement qui est mis à l'abri par la pensée, et non pas l'être. L'être parménidien est l'essence de la représentation civique du repos, dont la relativité a fait litière, mais dont Aristote n'était pas dupe lorsqu'il identifie repos et mouvement comme deux modes du même. Le mouvement de la marchandise est donc par lui-même un risque fondamental pour la civilisation de l'immobile car dans son mouvement il sort de toute culture. C'est ce que l'on vit aujourd'hui dans l'opposition entre économie - argent et culture-art.
Je répète : il n'y a pas d'économie sans argent, ce qui signifie que tant que le financier subsiste seul de son côté, il n'y a pas économie, mais troc, exploitation, pillage. Le dollar exerce sur les marchés cette sorte de domination qui stérilise la marchandise en tant que telle parce que la monnaie américaine s'empare de son évaluation hors toute considération d'usage, de valeur d'échange ou de valeur marginale. Le marché, en réalité, ne peut pas se réaliser tel qu'il est défini par quelqu'un comme Adam Smith, parce que les valeurs d'usage restent captives d'une marchandise plus puissante que les autres. Il y a bien longtemps que les marchandises du monde, toutes les marchandises s'expriment en dollars. Mais voilà que naissent d'autres "dollars", le Yen, le Deutsch - Mark, et maintenant l'Euro. La souveraineté mondiale se dilue à partir de l'établissement de ces nouveaux pôles monétaires, c'est à dire de ces nouveaux pôles de souveraineté.
Et dès lors, la marchandise se remet à exister en tant que telle à travers le monde, c'est à dire qu'elle redevient neutre dans son essence, aussi bien sédentaire que nomade, elle n'est plus la verroterie espagnole ou la cotonnade hollandaise échangée contre l'or ou le travail humain. Je me souviens d'un séjour en Côte d'Ivoire qui remonte à 1958. A cette époque les "tombeurs" d'arbres, c'est à dire les bûcherons qui abattaient les géants de la forêt ivoirienne, étaient tous originaires du Burkina-Faso, nommé à cette époque encore la Haute-Volta. On les recrutait là-haut dans les villages affamés pour les amener en camions sur les chantiers où il fallait d'abord les nourrir pendant au moins trois semaines avant qu'ils soient en mesure de soulever une cognée ou de manier une machette efficacement. Puis, après deux ans de bons et loyaux services, c'est à dire lorsqu'ils étaient proprement épuisés par le travail et la maladie, on les renvoyait chez eux dans les mêmes camions (ils en feront des films dans quelques années, du genre Nuit et Brouillard). Mais cette fois ils avaient moins de place sur les banquettes car ils venaient de dépenser toutes leurs maigres économies, chacun avait qui son rouleau de cotonnade, qui sa machine à coudre d'occasion, bref, ils venaient de réalimenter le circuit du capital colonial pour une nouvelle tranche de vie. De débiteurs du patron forestier, ils allaient se faire débiteur du marché mondial du tissu, alors qu'ils avaient vécu jusque là dans l'insouciance la plus complète de ce qu'ils portaient comme vêtement. C'est ainsi que l'on crée un "débouché". Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'il leur aura fallu deux ans de travail quasi forcé pour se former un capital totalement illusoire car ne reposant sur aucun désir propre : la cotonnade était une invention coloniale, elle n'appartenait ni au désir des blancs eux-mêmes, ni à celui des populations "indigènes" qui n'eurent guère d'autre choix que celui de s'habiller enfin comme leurs maîtres.
La mondialisation, c'est donc un phénomène beaucoup plus complexe que cette simple extension des échanges au plan de la planète. C'est, en fait, la véritable naissance du marché mondial, le moment venu où la marchandise s'émancipe enfin de la tyrannie des monnaies, au fur et à mesure que les monnaies entrent réellement en concurrence. Ce qui se passe depuis la naissance de l'Euro est tout à fait manifeste d'une nouvelle donne monétaire. Parti de très haut par rapport au Dollar, l'Euro a perdu en un an près de 20 % de sa valeur. En d'autre temps et pour d'autres monnaie, on aurait hurlé au krach, à l'effondrement, à l'amorce d'une faillite inflationniste semblable à celle des années vingt en Allemagne. Mais tout le monde fait semblant de rien, ne pipe mot, comme s'il fallait avant tout garder son sang-froid en se disant que tout était normal et que ce n'était qu'un réajustement naturel d'une monnaie dont on avait artificiellement fixé le taux de change au départ. Et certes, c'est bien de cela qu'il s'agit, mais il faut ajouter que c'est le résultat final qui est intéressant, c'est à dire le cours qui va finalement se stabiliser. Or il semble que ce cours soit tout simplement équivalent à celui du dollar. Ce résultat prouve donc que le phénomène monétaire mondial est en train de subir une crise d'identité profonde : en s'égalisant du point de la valeur d'échange, les monnaies, en réalité, disparaissent purement et simplement en tant qu'élément du circuit AMA, et la mondialisation pourrait bien se caractériser par un retour à une forme d'échange ressortissant du circuit MAM. Cette régression, car c'en est une, manifeste simplement la régression annoncée par Karl Marx du capitalisme. En redevenant marchandise MAM, les valeurs d'usage reprennent leurs droits car le A leur est devenu égal ou nul, la monnaie ne peut plus exercer sa tyrannie propre, reflet du despotisme politique concret de son émetteur parce que les despotismes se sont réciproquement annulés, démontrant de manière éclatante le caractère réellement politique de l'économie. En même temps naît le marché vrai, celui d'Adam Smith, cette main invisible qui s'autorégule parce qu'il s'est établi une égalité radicale entre les désirs des peuples et les objets du marché : l'impérialisme économique et politique c'est donc avant tout une manipulation du désir telle qu'elle permet à une nation d'exploiter les pulsions d'autres peuples à son bénéfice. Dès lors que disparaît cette possibilité, car le médium et représentant de cette mainmise du désir s'annule en tant qu'inégalité politique, les valeurs d'usage qui émergent sur le marché recommencent à s'échanger dans une logique de troc qui symbolise cette main invisible parce que cette main n'est pas manipulée par un cerveau central mais par des désirs qualitativement égaux. Le sédentarisme, - ou vaut-il mieux parler de la "sédentarité ?" - aura été une fantastique expérience de discipline pour le désir humain, une expérience sans doute nécessaire dans le contexte de la socialisation de plus en plus totale de l'espèce humaine. Il n'y a guère de différence entre Gilles de Rais et un sérial-killer d'aujourd'hui, la seule et essentielle différence, c'est que le seigneur vendéen agissait ouvertement donnant à son désir la force de sa loi : c'est toute la différence entre une souveraineté despotique et le pouvoir démocratique. C'est aussi cette différence qui agit sur la mondialisation économique, où les données s'éclaircissent sans cesse et dans laquelle s'installe une transparence uniquement liée aux changements politiques qui se font jour en même temps qu'elle. Internet est le lieu symbolique de cet éclaircissement, de cet assainissement du marché, de la naissance d'un monde où la liberté pourra à nouveau se conjuguer avec le libéralisme.
INTERNET OU L'ESPRIT NOMADE
Bien sûr que ce n'est pas un hasard si l'un des grands moteurs de recherche du Web porte le nom de Nomade. Son concepteur a saisi l'essence de ce réseau mondial, essence qui réside dans sa mondialité même. Est mondial ce qui n'a pas de frontières, la mondialité repose dans la sphéricité, c'est à dire dans l'infini des possibilités de déplacement. Il n'y a donc rien de plus nomade qu'un moteur de recherche, du moins en principe car il est évident qu'il y a un zonage de fait : les sites américains dominent encore absolument la toile, elles forment un bloc condensé qui attire automatiquement n'importe quelle recherche. Pour un site en langue européenne, il y en a quelques milliers en anglais, et cette situation est appelée à durer encore très longtemps. C'est pourquoi Internet reste encore un programme, plutôt qu'une réalité.
LA CONVERSION : Pourtant, quelques traits se dégagent déjà qui en font une sorte d'horizon unique de l'action humaine, le premier objet qui rassemble et dirige globalement le souci, dans un sens comme dans l'autre. Il y a encore quelques mois, les adversaires de la pratique informatique en général et d'Internet en particulier, souriaient encore d' une manière assez condescendante lorsqu'ils abordaient ce sujet. On pouvait sentir un sentiment de grande sécurité face au défi qui les cernent, leurs mains et leurs stylographes semblant peser encore de tout leur poids dans l'ordre de leur pratique quotidienne. Depuis quelques temps cette belle assurance semble se transformer en une sorte de hargne dépitée, où l'on perçoit déjà le découragement et la défaite prochaine. Les "progrès" de la technologie de la communication s'impose toujours de la même manière : l'homme découvre une pratique nouvelle, le téléphone portable par exemple, y décèle immédiatement tous les défauts pratiques et esthétiques, toute l'obscénité d'une technique qui se permet de coller à ce point à l'intime, et puis, après avoir résisté pendant quelques mois, se déclarent vaincus et deviennent des partisans résolus et souvent fanatiques de la nouveauté.
La conversion elle-même ne tient plus du tout du hasard ni du simple bon vouloir du futur internaute. Autour de lui, son monde, celui auquel il a confié depuis longtemps son destin, s'y est mis sans lui demander son opinion. A l'usine, au bureau, dans tous les médias et dans toutes les conversations l'idée du réseau magique se répand à vive allure, c'est comme une marée montante, ignorante de tout obstacle, qui afflue en remplissant tous les creux, tous les interstices, en bouchant progressivement toutes les issues. Dans quelque direction que l'on se tourne, on se retrouve nez à nez avec cette possibilité dont on discerne au fur et à mesure la dimension et les enjeux. Car Internet n'a pas besoin de génies du marketing pour s'imposer déjà comme la marchandise absolue, comme on imagine que se sont imposés respectivement l'eau courante, le gaz, l'électricité et toutes les formes du transport. Internet s'installe directement dans la strate du besoin, ne laissant pas le temps au désir de se déterminer. Le plus souvent le désir est subverti parce qu'il représente justement tout ce qui s'oppose encore à l'idée menaçante qui semble se tapir derrière le réseau. Une fois de plus l'homme est comme arraché à lui-même par son propre jouet, converti de force à une nouvelle pratique qui se présente cette fois comme un défi chaque fois individuel. L'eau, le gaz ou toutes les autres découvertes étaient des problèmes d'emblée collectifs, qui allaient se résoudre collectivement et ne représentaient en réalité qu'une pratique de consommation dont l'usage serait simplifié par la spécialisation du travail. Pour Internet il n'en va pas de même. C'est toute une formation que chacun devra assumer s'il veut pénétrer dans la structure et dans le fonctionnement de la Toile. Les générations qui ont raté le train de l'informatique parce qu'elles étaient décalées par rapport à son développement devront se résigner à rester devant la porte, ou bien fournir un effort tout à fait individuel pour parvenir à s'y intégrer.
La récente histoire de l'informatique montre que les procédures se simplifient chaque jour et on peut se dire qu'il sera bientôt aussi facile de s'en servir que d'ouvrir un robinet. Or cette impression est trompeuse car si la complexité effective disparaît en effet dans des systèmes d'exploitation de plus en plus confortables, elle n'est pas annulée pour autant, mais se terre dans des strates de plus en plus profondes où elle continue de s'offrir à l'herméneutique comme le Talmud s'offre à l'interprétation de la Bible. Du fond de leur code source et de leur DOS, les structures régissent tout le fonctionnement et le néophyte ne tarde pas à prendre conscience de la superficialité de ses connaissances et de sa pratique. Par conséquent, le danger de la Toile ne se trouve pas du tout dans un partage inégal de son accès, même si l'économie s'impose encore aujourd'hui comme le discriminant principal. Le véritable danger réside dans les fractures qui vont s'opérer à l'intérieur de l'usage d'Internet, c'est à dire des niveaux d'efficacité - de véritable pouvoir - individuels. Mutatis mutandis la situation est comparable à cet usage du Latin qui était l'apanage des médecins à l'âge moderne, parce que les grands Traités de médecine étaient encore rédigés dans cette langue morte devenue code secret dont Molière s'est si bien moqué. Et on peut mentionner ici le phénomène du pouvoir "jeune", cette situation nouvelle où les enfants ont déjà pris le pouvoir informatique, pendant que les parents s'en défendent encore au point que le dialogue finit par se tarir entre les générations. Le rajeunissement forcené du salariat auquel on assiste depuis trente ans est directement lié au développement de l'informatique parce que l'informatique requiert la jeunesse de la mémoire. Il y va de l'apprentissage d'une langue, et même de plusieurs, apprentissage qui s'avère nécessairement plus pénible pour des personnes âgées. Par ailleurs, l'acculturation de base n'est plus un critère d'intelligibilité et le QI d'un individu n'entre pas immédiatement en jeu dans l'usage de l'instrument informatique. On en veut pour preuve que l'ordinateur s'est répandu absolument partout, de l'usine à l'université, dans l'indifférence totale des compétences de départ. Un jeune carrossier commence son apprentissage en s'initiant à l'ordinateur, autant pour la facturation que pour la gestion des stocks. Première conséquence de cet instrument, la "productivité". L'ordinateur, mais c'est une banalité, établit de lui-même des rapports entre les choses qui annulent littéralement la nécessité du travail. Il suffit d'imaginer le nombre de reçus et de bordereaux qui se suppriment d'eux-mêmes lorsqu'il suffit de transférer un chiffre sur une ligne pré inscrite sur un écran. Et pas seulement cela, car le chiffre reporté déclenche en même temps un logiciel qui prend en charge le contrôle des stocks, se charge de la commande immédiate des pièces manquantes et rétablit ainsi en permanence l'équilibre rompu. Cette constatation est banale, mais elle implique des conséquences incalculables dont la principale est la contrainte pour tous de s'y conformer, de s'y adapter, d'en apprendre l'usage minimum, l'alphabet pratique.
Or, face à une semblable contrainte, rappelons qu'il aura fallu presque un demi siècle pour que les êtres humains fassent l'apprentissage du transport par chemins de fer, et autant pour le téléphone et l'électricité. Ce n'est, et ce ne pourra être le cas de l'informatique et de son pendant Internet : la loi d'adaptation à ces deux instruments est d'airain et la vitesse de cette adaptation est un paramètre vital du succès. On peut, aujourd'hui, se demander si la conscience de cette nécessité est suffisante en regard du mouvement de la réalité économique, politique et sociale, car aucun domaine n'échappe à ce formidable formatage, comme si la réalité toute entière aspirait en la condensant sous la forme binaire, toute la logique du monde dans les directoires informatiques. L'accélération patente de tous les mouvements de restructuration économique, les fusions qui se multiplient dans le désordre, les bourses qui se sont habituées à un bouillonnement permanent, tout cela n'est que la figure visible d'un bouleversement ontologique : les centres de décisions ne se regroupent pas, cette fois, pour gagner plus d'argent et de profit, mais simplement pour survivre, seulement pour continuer d'être présent dans les nouveaux flux de richesse. La toute récente fusion des deux grandes banques allemandes Deutsche Bank et Dresdner Bank donne une impression d'absolue puissance, ce sera la plus grande force financière du monde etc.. La vérité est que ces deux anciennes banques n'ont pas le choix parce qu'il y va de leur survie : la technique les a progressivement privé des ressources les plus essentielles car les entreprises n'ont plus besoin de leurs services qu'elles peuvent assumer elles-mêmes. Résultat ces banques vont être bientôt réduites à un service "client" bien modeste, pour lequel il faudra reconsidérer toute l'énormité des infrastructures si coûteuses et des personnels pléthoriques. C'est un peu comme si dans un corps humain, la circulation sanguine prenait du jour au lendemain de nouveaux chemins, se mettait à emprunter de nouvelles artères et de nouvelles veines et que le corps dût, pour survivre, opérer un mue soudaine et précipitée. Que d'échecs en vue, dans une telle agitation, quelle approximation dans les calculs n'aura-t-il pas fallu accepter pour aller vite, pour ne pas rater les correspondances de l'histoire immédiate.
Et cette histoire immédiate n'est que celle d'un retour précipité vers l'avant-néolithique, vers le nomade. Ce retour est le retour des flux continus, des marches forcées où le désir n'a pas le temps de s'inscrire dans l'objet car cet objet est liquide et aléatoire : pour l'instant, Internet est le seul récipient qu'ont trouvé les hommes pour contenir la marchandise mondialement liquéfiée : c'est la nature nouvelle de la marchandise qui exige un tel contenant, ce n'est pas ce nouvel instrument qui produit la liquéfaction des objets du désir. Il faut donc cesser de considérer l'informatique comme une découverte linéairement installée dans l'histoire de la technique et qui produit ses effets, mais plutôt considérer que c'est la transformation des relations humaines qui ont conduit à improviser une nouvelle technologie. Informatique et Internet sont des modes d'adaptation, et c'est ce qui explique leur caractère dramatique de nécessité. Il en a sans doute été de même pour les grandes inventions des siècles passés : si les hommes ont couvert la planète de rails et de routes, ce n'est pas parce qu'ils ont découvert cette possibilité parmi d'autres, mais parce que la nature des échanges l'exigeait impérativement, parce que la nature des relations entre les hommes et les peuples ne pouvaient plus s'en tenir au rythme des échanges courants. Faut-il aller jusqu'à penser que le capitalisme tout entier n'est que l'histoire de cette liquéfaction de l'objet du désir, la compulsion de l'objet vers sa fluidité ? D'autres répondront à cette question, mais il est déjà établi dans la définition marxienne du capitalisme, que ce dernier n'est que l'expression d'une histoire des rapports de production. Or cette histoire n'est pas celle de la matière qui s'organise d'elle-même en rapports humains, mais celle de rapports humains qui se servent de la matière pour être ou pour se développer. Ce n'est pas la manufacture qui crée la dominance capitaliste mais la dominance en tant que telle qui crée la manufacture. Il suffit de se placer dans la situation de la création de l'une de ces premières manufactures pour comprendre qu'il aura d'abord fallu placer les futurs prolétaires dans des conditions de dépendances telles qu'ils n'avaient en réalité aucun autre choix que d'accepter de s'intégrer dans un troupeau de travailleurs. Etant entendu que ces prolétaires provenaient d'un cadre paysan dont le destin ne pouvait se comparer à ce qu'allait devenir celui d'un salarié de l'industrie. L'exode rural contient à ses deux extrémités la vérité du capitalisme, mais non pas en termes de lutte contre la nature ou je ne sais quel progrès technique, mais en termes d'asservissement, de réduction à l'esclavage industriel. Mais cette industrialité de l'esclavage n'est en rien induite par la nature et la quantité de matière traitée par les esclaves, mais par la dimension industrielle du désir du capitaliste ! L'objet du capitalisme n'est pas le capital, l'objet du capitalisme c'est la dominance, terme que je préfère à celui de souveraineté car il se cantonne dans l'animalité de cette forme de maîtrise. Encore une fois, l'industrialisation de la mort des Juifs par les nazis est, en vérité, la fin ultime de l'industrie, et ce parce qu'elle a révélé la nature exclusivement animale de la pratique industrielle, du capitalisme. Evidemment, cette animalité n'a pas grand chose à voir avec le monde animal, elle ne représente que le négatif de l'humain, c'est à dire le manque à être humain, ce que les morales de tous bords indiquent sous le concept de mal.
L'informatique et Internet appartiennent bel et bien à la lutte des classes. Or la lutte des classes n'est rien d'autre que la substance même de l'histoire, une histoire qui n'a jamais eu besoin du capitalisme pour avoir lieu : le capitalisme ne fait que succéder à l'absolutisme monarchique, il n'était donc pas étonnant qu'il dût se hisser aux dimensions de cette souveraineté. L'industrie était pour la bourgeoisie le seul moyen de battre la Noblesse sur son propre terrain, elle n'avait pas d'autre objet. Comprenons : la Monarchie absolue n'est pas une forme progressiste d'une évolution aveugle et nécessaire, elle est une figure accidentelle du désir de dominance, la plus bestiale et la moins humaine, moins humaine que toutes les figures précédentes de l'histoire humaine. Le Dix-Septième siècle a été pour l'Europe, et surtout pour la France, un véritable pré-Auschwitz dont témoignent les massacres de nature tout à fait identique à ceux commis en Pologne dans les années quarante. En témoigne même les plus grandes destructions de l'environnement naturel, puisqu'à la fin du règne de Louis XIV la forêt française avait pratiquement cessé d'exister. Les besoins de la guerre et de la marine carcérale de Louis avaient anéanti les hommes et les arbres dans une même indifférence. Le concept du comportement industriel était né, celui de la sauvagerie à laquelle ne pourra répondre un siècle plus tard que la sauvagerie de la Terreur. Le climax industriel reste Auschwitz, le moment culminant de cette logique de la dominance animale, une dominance au demeurant seulement fantasmée dans le désarroi de l'émergence du politique. Ce politique, nous le rappelons, répond à la fixation sédentaire des peuples, non pas comme une calamité accidentelle, mais comme l'épreuve de l'humanisation, une épreuve loin d'être achevée.
Internet est donc à la fois une excroissance de détresse, une sorte de chromosome mutant de l'ensemble du fonctionnement de l'activité humaine, et à la fois la direction fléchée vers le retour au statut nomade de l'être humain. L'apparition de la machine intelligente et son développement sans freins signifie sans retour possible la suppression du travail, le passage vers une nouvelle praxis vitale et de nouvelles relations entre les êtres. La communication, ce concept fourre-tout, va se révéler être beaucoup plus que ce que les sémiologues ou les sémanticiens en pensent aujourd'hui. La communication est sans doute la nouvelle forme de la conscience, une forme dégagée des frontières de l'ego cartésien. Il n'est sans doute pas possible d'en dire grand chose, sinon que la communication va impliquer de toutes nouvelles données pour la conscience : une information en temps réel, une multiplexie permanente des liens, de quoi alimenter qualitativement et quantitativement la responsabilité de l'Homme. Déjà maintenant la médiatisation des événements telle qu'elle se fait, l'information journalistique telle qu'elle se pratique, fait subir à la conscience un élargissement horizonal critique, c'est à dire une ouverture de l'horizon lui-même telle qu'elle pourrait bien modifier en l'approfondissant l'Aletheïa des Grecs, la vérité comme simple éclaircie de l'étant. L'étant virtuel, tel qu'on se le représente aujourd'hui, est sans doute possible la nouvelle essence d'une Aletheïa dont l'horizon est repoussé au-delà de frontières non-perçues jusqu'ici. Nous disions plus haut que Internet était une excroissance de détresse, pourquoi ?
En botanique, on dit que lorsqu'une plante est menacée par une pollution, elle développe des pousses de détresse qui lui permettent de multiplier rapidement la quantité de semence reproductive et donc les chances pour l'espèce de survivre à la pollution. C'est donc de cette survie qu'il est question dans l'aventure apparemment gratuite du réseau Internet. Nous avons essayé de montrer le caractère fatal de cette invention, fatal dans son développement, dans son accaparement de l'ensemble de l'activité humaine, dans la formidable centralisation qu'elle implique, cette fin ultime de tous les autres agrégats, qu'ils soient politiques, territoriaux, religieux ou métaphysiques. Il faut imaginer un instrument qui reprend sur lui toute l'instrumentalité en tant que telle, par quoi tôt ou tard passeront toutes les velléités d'action. Il s'agit en effet d'une véritable redéfinition du champ de l'action humaine, de l'action la plus triviale à la plus sublime. Cette redéfinition doit "sauver", c'est à dire donner les possibilités de maîtrise, non pas de la matière ou des données scientifiques objectives, ce que l'informatique a pris en main depuis très longtemps, mais de la transcendantalité elle-même, de l'esprit humain. Internet est devenue une sorte de plate-forme de l'expérimentation consciente du sens, de son questionnement permanent. Pour la première fois dans l'histoire humaine, le réseau rend possible, grâce à l'universalité de ses langages, la transparence du dialogue universel. D'un coup les parois fragiles des langues s'ouvrent à un monisme du langage tel qu'on l'imagine précéder la Tour de Babel, car Internet est une langue, un langage universel en devenir. En réalité, l'homme ne fait que découvrir, à travers cet instrument, l'universalité cachée du langage, un moment affectée par la découpe sédentaire du réel. Les langues nomades peuvent vivre normalement sur une portée universelle, mais elles se mettent à se singulariser dès qu'elles s'arrêtent à l'intérieur de certaines frontières. Il reste que les racines profondes demeurent communes et prêtes à fleurir dans un champ à nouveau libéré de ces frontières. On peut penser Internet comme le nouveau Temple, comme les appartements de la Reine, comme le centre nerveux d'un monde qui se met en place sans tolérer le moindre retard. Dans "Le Travailleur", Ernst Jünger utilise la notion de figure, concept obscur qui veut rendre compte d'une force transcendante qui exhibe ses figures à travers l'histoire, en dépit de toutes les velléités humaines de les ignorer ou de les éviter. Ainsi l'homme doit-il s'inscrire dans la figure du Travailleur, une idée que l'auteur très controversé puise dans son expérience militaire de la guerre de 14. Combien Jünger aura été déçu ou agacé par le retour, après la Seconde Guerre Mondiale, du "bourgeois", cet élément contraire au Travail et au Travailleur, on ne le saura jamais. Et pourtant, Internet a beaucoup de traits communs avec la figure d'un instrument qui pourrait bien remodeler la relation de l'homme et du travail, à condition de voir dans ce travail non pas cette sorte de négatif finalement hégélien qu'évoque Jünger dans son dépassement dans la mort anonyme, mais un travail radicalement nouveau. Si on postule que les tâches de la survie peuvent être entièrement prises en charge par la machine, alors ces tâches tombent du répertoire du souci humain, elles disparaissent en tant qu'alibi du vécu spatio-temporel, et le vrai travail commence. La figure du Travailleur peut surgir dans son universalité, sans pour autant détruire la singularité originaire et téléologique. Car le miracle d'Internet c'est bien celui de la liberté de l'individu, liberté d'en être, en tant qu'être singulier, ou de garder sa singularité à l'écart. Dans les deux cas, le danger est grand, et rien ne permet de sous-estimer l'une ou l'autre attitude. Cette liberté préfigure une réalité somme toute banale et éternelle dans la société humaine, les forces du travail (au sens Jüngerien) prendront la responsabilité du monde, de ce qui sera monde pour l'homme, cependant que les forces "bourgeoises" ou plébéiennes se cantonneront dans la position des spectateurs, de ceux qui "souffrent" le monde, en portent la malédiction et alimentent les forces du mouvement de transformation. Il n'y a pas moins de noblesse dans l'une ou l'autre de ces attitudes parce qu'elles son complémentaires. Et cette vérité deviendra de plus en plus visible au fur et à mesure que le "travail" dévoilera son essence en vérité ludique.
LE SENS CACHE DU RESEAU
Le Web est un instrument d'une extraordinaire efficacité qui à termes est appelé à devenir le lieu unique de la praxis sociale, politique et économique. A ce titre on ne peut le comparer à rien de ce qui a surgi dans l'histoire de la technique. On pourrait peut-être extrapoler de l'histoire de l'industrie une notion qui comporte certains éléments d'une telle totalité, celle de production. Une telle extrapolation ne se justifierait, au demeurant, que si on admet que toute l'activité humaine est passée dans la "production" au sens grec du terme : l'industrie n'aurait finalement joué que ce rôle de rassembleur de l'action humaine dans le sens du produire. Mais c'est un peu court, car si l'industrie a bien failli s'emparer de toute la réalité vécue par les hommes, et cette tentative d'arraisonnement (au sens de Heidegger) n'est sans doute pas terminée, son histoire présente est marquée par une contre-offensive pratique et idéologique forte. La production matérielle tente partout de se désindustrialiser, de quelque manière que ce soit, et même dans les ateliers situés au cœur même du dispositif industriel, cependant que la vie cherche avec énergie et détermination à donner à l'Art un statut dominant.
Cette curieuse histoire présente ne tient pas à la volonté des artisans de l'industrie que nous sommes devenus tous autant que nous sommes, (car nous avons même fini par penser industriellement) mais d'une mutation de cette volonté elle-même. La dichotomie nature et culture a fait son temps et l'on ne peut plus aujourd'hui envisager la relation de l'esprit et de la matière comme on le faisait au début de ce siècle. Le sens de l'immanence a définitivement pris le dessus, la matière a depuis longtemps revêtu un statut scientifique à partir duquel elle est devenue douteuse quant à une différence radicale avec nous, nos corps et nos esprits. C'est l'unification théorique qui a fait de la matière un grand vide chargé d'énergie vibrante qui a marié l'homme et son corps-esprit avec la matière. Le panthéisme de Spinoza est entré dans les chaumières et peu à peu la matière prend corps, devient le même corps que le nôtre. C'est pourquoi on ne peut plus la traiter "brut de décoffrage", dans l'indifférence de sa présentation et représentation. Le produit industriel est désormais soumis à la loi du vivant auto-conscient et cette conscience exige de plus en plus souverainement d'être présente dans le produit. Cette conscience est le savoir de son efficace, mais aussi de son innocuité et de la dignité de sa forme : le produit doit trouver son degré d'harmonie avec l'être humain, il doit, au fond, finir par s'articuler sur l'homme comme l'œil ou l'oreille ont fini par doter l'animal humain d'un pouvoir nouveau.
Dans ce contexte, Internet va reprendre l'antique fonction du grenier pour la soudure. Depuis Sumer, les hommes ont consacré une grande partie de leur temps à rassembler ce qu'on pourrait qualifier, au fond, de déchet du temps. Les scribes de Babylone n'ont cessé de dupliquer par l'écriture toutes les actions réelles, les enregistrer pour, semble-t-il, pouvoir se les représenter à nouveau, à côté des actions réalisées. Le registre des actions, c'est aussi la Bible, Le Livre qui rend présent une seconde fois le cours des événements qui ont émaillé le temps de l'existence des tribus juives. Et c'est le livre tout court, la bibliothèque rassemblante des totalités diverses, celles de l'histoire, de la science, de la religion, des savoir et des souvenirs, bref tout le compendium des choses humaines, les encyclopédies de l'exister et des mondes laissés derrière lui par l'Homme depuis qu'il écrit. Internet va donc reprendre cette fonction de stockage rassemblante pour la soudure, mais pour quelle soudure ? Quelles saisons humaines exigent de l'homme qu'il mette en réserve toutes ces choses pour quel usage ultérieur ? Pour les céréales il est facile de répondre qu'il faut réserver du blé pour le temps où la terre ne donne pas. Mais quels sont les besoins de l'esprit qui font qu'il faille stocker des biens d'un temps à l'autre, d'un présent à l'autre ? Et quelles sont les saisons de l'esprit qui ont besoin de la représentation, de la marque profonde et indubitable, de l'écriture qui témoigne a posteriori de l'existence, de l'avoir été ?
Internet, de par sa nature propre, de par la virtualité de son essence, nous donnera des esquisses de réponses à ces questions. La probabilité la plus certaine est que le développement du réseau virtuel accompagne ou s'identifie avec le retour au nomadisme dans son essence, c'est à dire aussi à une civilisation orale, une civilisation du refus de la répétition, du graphe, de la marque infamante de l'écriture. Les céréales de la soudure n'avaient pas pour fonction première de permettre aux hommes de survivre mais celle de suspendre le cours du temps, suspension qui, entre autres effets, a eu celle de prolonger la vie.
Il faut tenter d'imaginer le nomadisme primitif comme le vécu d'une absolue fluidité des événements, un époque du merveilleux mémorisée comme âge d'Or parce que la rationalité du monde se partageait entre pépite et chaos : ce monde n'était pas perçu comme œuvre d'aménagement ou de transformation, mais de lieu absolu où le destin était inscrit le long des sentes et des rivières, de manière certaine et définitive. S'arrêter quelque part, se mettre "à la place de la nature" pour créer ce qu'on ne devrait, en fait, seulement y rencontrer, ce choix aura été une fantastique subversion de la position morale de l'homme. Cette attitude subversive, qui peut, au fond, se définir comme le passage de la prédation à la production, explique le développement exponentiel de la violence, la naissance d'un dualisme explosif et coextensif à tous les domaines de l'existence - ici il faut dire Da Sein, l'être-là - de l'homme. Mais nous reviendrons sur ces expressions ontologiques. Ce qu'il faut retenir ici, dans le chapitre qui traite d'Internet, c'est la promesse d'une sortie de ce dualisme, sous la forme d'un retour ou d'un dépassement, cela reste du domaine spéculatif. Mais ce qui est sûr c'est que le réseau ouvre à une nouvelle fluidité de l'étant, à un nouveau chaos naturel chargé de pépites où l'or et les nourritures terrestres ne joueront plus qu'un rôle symbolique, un autre champ s'étant entre-temps ouvert à l'Homme, celui du sens. Qu'on le veuille ou non, qu'on le souhaite par des voies inconscientes ou qu'on le craigne au point de passer son temps à tenter d'exorciser la toile dont certains serveurs avaient choisi le sobriquet de Mygale, Internet deviendra le grenier du sens. Ce grenier aura comme attribut nouveau et essentiel d'être unique, correspondant ainsi au caractère unaire de la réalité humaine. La première conséquence pourrait bien être la mutation du statut des Sciences au sens antique, une sorte de retour à l'unicité de la connaissance. Au fond, Internet représente d'abord une canalisation de l'énergie connaissante, des mouvements de l'esprit humain, une canalisation naturelle vers un espace commun. La Toile ne deviendra pas seulement la Bibliothèque Universelle - et nos technocrates de la Culture seraient bien inspirés de tenir compte de cette perspective - mais elle deviendra aussi l'Atelier Mondial des esprits. Elle le deviendra fatalement parce que l'économie générale de l'espace l'exige ainsi que la persistance ontologique du caractère transcendantal de l'esprit. S'ajoutera à ce paysage spatial l'élaboration intellectuelle en temps réel avec en corollaire le déclin de la doxa, la véritable forclusion des idéologies.
Comment caractériser de telles perspectives ? Primo, en se gardant de penser qu'il y va d'un changement fondamental, d'un tremblement de terre historique, car nous sommes déjà engagés dans la réalité du réseau, depuis plus longtemps que ne le pensent ceux qui n'en connaissent pas l'histoire. L'origine secrète, en effet, a précisément été le partage des sciences par-delà les frontières et même les frontières de la Guerre Froide, cet engagement est donc ancien. Secundo en se gardant de toute eschatologie morale et culturelle parce que le danger croît en même temps que les moyens du salut, affirmation logiquement conforme à l'expression poétique de Hölderlin. Car Internet est aussi un champ de mines, et de mines à puissance nucléaire : la centralisation d'un esprit agissant en temps réel représente un grand péril, non pas parce qu'il se pourrait que la machine prenne soudainement une indépendance hostile à l'homme, mais parce que l'homme lui-même devra savoir en prendre quelque chose comme le contrôle de manière centralisée, c'est à dire, sans doute, par le biais du réseau lui-même. La démocratie pourrait bien se voir soufflée comme une diaspora un soir de grand vent, ce qui resterait alors sur la tige de l'histoire ressemblerait à un enfer glacé.

V
LA PHILOSOPHIE DE LA MUTATION
NECESSITE ET CONTINGENCE
La première question philosophique qui se pose dans le sillage d'un tel récit ou d'une telle fiction, est celle de sa nécessité ou de sa contingence. L'homme subit-il une sorte de cycle à la manière de l'éternel retour ou des cycles d'Empédocle ? Ou bien se pourrait-il qu'il y ait une logique volitive, une véritable Histoire de cette errance ? Notre récit ne laisse guère de doute, c'est bien l'Homme qui a vécu cette aventure, vivre ayant ici la signification du vouloir le plus pur, le vouloir où l'Homme a affûté dans une certaine direction une humanité depuis toujours présente. Etre homme a toujours été un devenir, un devenir inscrit dans le jeu et dans la mesure que l'homme cherchait à prendre de son autre, l'étant. Etant par excellence, la mort n'a sans doute pas été spontanément présente dans les débuts de l'espèce, au sens où on peut lire aujourd'hui encore dans l'animal le bonheur parfait de l'inconscience. L'âge d'or s'est toujours déroulé sous nos yeux, et le succès de l'iconographie animalière ne trompe pas sur les formes de jouissance nostalgique que l'on peut en retirer, anthropomorphisme fantasmatique qui reste inévitable dans cette sorte de contemplation.
Nous retrouvons donc un autre saut de l'humanité, celui qui sépare l'animal de l'homme. Mais là-dessus, nous n'avons rien à dire, car rien ne prouve que l'homme n'est pas resté l'animal qu'il a toujours été. Il existe bien des thèses anthropologiques qui s'avancent à introduire une gradation entre l'animal le plus proche du minéral jusqu'à l'homme qui ne serait que la forme parfaite de l'animal, ce qui, au fond est une définition très traditionnelle dans la philosophie classique, antique ou moderne, tant qu'elle est restée dégagée ou en marge de l'ontologie théologique d'essence chrétienne. Pourtant, il y a quelque part une transition que nous révèlent presque toutes les formes symboliques commentées par l'ethnographie ou même la science des profondeurs, la psychanalyse. Les traces mnésiques en sont lisibles de la manière la plus claire, il n'est même pas utile de faire de longues recherches, il suffit de se référer aux grands traumas du vingtième siècle pour voir autre chose que des traces, à savoir une véritable résurgence pathologique de l'état animal primitif de l'être humain. Retour à la Shoah, décidément un révélateur d'une grande fécondité : ce qui s'est joué dans la pensée de l'anéantissement des Juifs est ce qu'on pourrait appeler une rechute brutale dans l'instinct de prédation. Je rappelle que, dans le passé, la pratique de l'éradication des peuples a fait partie de la panoplie des comportement politique et guerrier. En ce sens, la Shoah n'est pas une horreur nouvelle et ne saurait jouir d'un statut particulier dans l'histoire humaine. Ce qui en fait la nouveauté c'est que la volonté d'anéantissement a porté, cette fois, non pas sur un peuple défini par des frontières, mais par l'esprit. Hitler n'est pas comparable à Timour Lang, à Tamerlan, parce qu'il s'est attaqué au monde symbolique et non au monde réel. La gravité est ici totale au sens où il a voulu éradiquer non pas des personnes seulement, mais une composante de l'esprit des hommes en général : il a voulu pratiquer une sorte de lobotomie universelle et cette lobotomie se classe immédiatement du côté de l'animalité telle qu'elle est symbolisée par la culture. Les récits des méthodes de cette "réduction à rien", traduction littérale de Vernichtung, rapportent tous que ce qui dominait dans les camps était la puanteur. La "merde" était le fond esthétique, le principe même de la méthode qui consistait à symboliser la destruction déjà opérée, la décomposition des corps vivants, le dasein porcin des Juifs avant même qu'ils ne disparaissent pour de bon. Pour les bourreaux cette mise en condition était certainement essentielle car le spectacle devait légitimer la solution finale : le plus difficile pour les Nazis a été le problème des corps.
D'abord le problème technique. La première méthode avait été en 1942 de faire en sorte qu'une grande quantité de Juifs meurent pendant leur transport, à charge pour la population civile de les enterrer comme elle pouvait. Mais cela ne réglait pas du tout la question car cette opération devait concerner des millions d'êtres humains, et d'autre part, c'était surtout la nécessité d'une rationalité technicienne qui ne pouvait se contenter d'une méthode fondée sur le hasard de la mort accidentelle : les Juifs devaient être tués, abattus, et on ne pouvait pas les laisser seulement mourir, il fallait leur enlever la moindre chance de mourir par eux-mêmes. Il fallait construire la mort des Juifs. Les architectes nazis feront donc bâtir ce que Heidegger a si bien nommé les "fabriques de cadavres". Car le véritable drame qui se nichait au cœur de ce projet, était double : il fallait trouver une méthode pour se débarrasser des cadavres dont le nombre n'aurait rien à voir avec les quantités habituelles de corps décédés sur un champ de bataille ou dans une catastrophe. Symboliquement cette destruction était un défi de la plus grande importance, car la croissance du nombre prévu de morts signifiait en réalité la croissance de la question elle-même de la présence DU corps juif en tant que tel, un peu à la manière de Ionesco : les Juifs allaient s'imposer après coup d'une manière aussi scandaleuse qu'au cœur même de la vie. Ils allaient déborder le réel allemand dans la mort même. Il fallait donc trouver un moyen de "consommer", stricto sensu, cette production de chair humaine morte, pour donner à toute l'opération un sens qui figurait quelque part dans la moralité allemande en tant que telle, c'est à dire le principe industriel. Pour peaufiner, sans mauvais jeu de mots, cette philosophie pratique, on aura même tenté de tirer des "produits" de cette chair abattue, quelques savonnettes et de la peau tannée, suprêmes alibis d'une raison de la bestialité. Les expériences pseudo scientifiques auxquelles les Allemands se livrent alors sur les corps de Juifs vivants n'ont rien qui les différencient de la vivisection pratiquée dans les laboratoires de l'industrie contemporaine. Cela, on le savait, mais peut-être n'a-t-on pas assez insisté sur les présupposés moraux de toutes ces horreurs : sur quelle base morale, car chez l'homme il y a toujours une base morale, le tissu d'une mise en scène ne tient pas sans ce qu'on entend par morale, c'est à dire ce qui change les mœurs.
Or, la morale nazie a une provenance et une finalité. La provenance se situe quelque part, non pas dans les théories délirantes d'Hitler lui-même ou de Rosenberg ou encore de Goebbels, mais dans la théologie figurale d'Ernst Jünger. Ontologie difficile dont on peut retenir l'existence de deux pôles : le bourgeois et la Figure du Travailleur. A la manière de Walter Benjamin, Jünger se livre à une sorte de phénoménologie de son temps, une phénoménologie symbolique qui affirme lire dans la société naissance la disparition de l'individu au bénéfice de la Figure. Concept difficile, la Figure pourrait correspondre à ce qui apparaît dans la réalité en marge de la conscience, contre elle, comme l'empreinte d'un projet métaphysique qui échappe totalement à l'individu et mobilise à son insu la masse ou les masses. Le Travail, avec un grand T, devient l'essence voulante du monde lui-même, et ne sert que ses propres fins, la conscience individuelle étant condamnée à disparaître dans la risée générale. A priori donc, la volonté, le choix et la liberté sont exclus de ce phénomène total, c'est le terme qu'utilise Jünger, et par-là même totalitaire. Mais ce n'est pas si simple, car cela ressemblerait fort à n'importe quelle théologie plus ou moins matérialiste, une sorte de Gnose sidérurgique, pour reprendre la tonalité fondamentale de l'esthétique jüngerienne. Non, car notre théoricien est un vrai héros, décoré par le Kayser en personne de la plus haute marque de gloire militaire allemande, il fait parti des neuf vrais héros allemands de la Grande Guerre. Or un héros ne peut pas se désister de son action ; aussi Jünger voit-il le nouveau réalisme héroïque dans l'acceptation lucide de la Figure montante, dans une "collaboration" sans failles, au mépris de tout instinct de survie. On pourra dire ou insinuer que l'écrivain et entomologue Jünger avait, aux lendemains de la défaite de 18 à sauver sa qualité de Héros National, à lui préserver une noblesse qui n'avait rien à attendre des événements de Weimar et du monde environnant, où le pacifisme et l'instinct bourgeois semblait prendre sa revanche. Mieux, à lui conférer une noblesse théorique où devrait s'éclairer la rationalité de son comportement dans les tranchées de Langemarck où il se distingua de nombreuses fois. Pour Jünger, un héros n'est pas un individu qui joue son ego à la roulette russe, le héros ou le soldat est la quintessence de la Figure du Travailleur, c'est à dire d'une sorte de dératiseur d'individualité bourgeoise au bénéfice d'un monde de Titans.
Par conséquent il suffit de désigner les rats pour savoir ce qu'il faut faire pour collaborer à la Parousie de la Figure. Le rat, c'est le Juif, on connaît la suite. Evidemment, Jünger n'avait pas en vue tous les détails concrets de ce qu'allait devenir l'action pratique des Nazis, et ne désigne nulle part les Juifs comme les représentants de l'être bourgeois ou quelque chose de ce genre. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, l'écrivain, quelque peu marri par la responsabilité philosophique qu'il portait malgré tout avec quand même une belle ambiguïté, a toujours méprisé l'antisémitisme bestial de ses compatriotes. Pour lui, aucune politique n'était à même de désigner les rats, la Figure se chargeait dans tous les cas de leur élimination sans que l'homme, celui de l'individualité des Droits de l'Homme ait à intervenir consciemment. Mais le mal était fait, cette représentation mystique non seulement séduisait la ganache germanique, mais légitimait ce que Jünger appelle "la potence et le bûcher" dans son livre principal, Le Travailleur. Face au "daltonisme humanitaire", Jünger estime que "ce qui importe n'est pas que nous vivions mais qu'il redevienne possible de mener dans le monde une vie de grand style et selon de grands critères. On y contribue en aiguisant ses propres exigences" (Le Travailleur Ed Christian Bourgois pp247).
Ce qu'il faut retenir de ce message idéologique que plus tard son auteur refusera de mettre en relation avec les événements concrets du Troisième Reich, c'est bien sûr la notion de rat. Car pour l'essentiel, la thèse est brillante, elle figure parmi les toutes premières ontologies qui prennent en compte l'apparition du technique comme vecteur métaphysique et non plus comme un quelconque fruit apriorique de la Raison Pure, ce en quoi il avait une avance théorique, même sur Heidegger. Là où le bât blesse, c'est que son anti-kantisme le pousse beaucoup trop loin, non pas vers le mépris de la vie, mais vers le mépris de la vie humaine, vers la transformation en animaux d'une partie des hommes. La mort humaine y perd son caractère sacré, fondateur de l'humanité elle-même, au nom d'un Plan supérieur qui se veut essentiellement humain. Un surhomme vaut bien six millions de Juifs. Faute de logique et faute tout court qui vaudront à Jünger un exil intérieur qui ne cessera qu'au crépuscule de sa propre vie lorsque deux Chefs d'Etat passablement défraîchis par l'histoire récente, Kohl et Mitterrand, vinrent à son chevet lui rendre sa gloire.
Le retour de l'homme-animal coïncide donc avec ce que nous avons appelé plus haut la naissance de la barbarie. Jusque-là concept politique, la barbarie devient réalité tangible dans la désignation des Juifs comme animaux d'abattage, ce qui n'a jamais figuré dans les Annales de l'histoire humaine. En même temps, l'humanité en tant que telle, autant les Allemands que le monde qui s'est détourné de la vérité comme il a pu au nom des intérêts supérieurs de la guerre et de ses conséquences, a régressé vers une animalité de fait, mais une animalité qui n'était pas celle des Juifs abattus, mais bien celle des Nazis, redevenus dans le délire totalitaire, des fauves inconnus à ce jour, tuant pour tuer, sans même la pulsion du prédateur. Ou bien, si, mais une prédation d'un autre ordre, le déchirement de l'humain, l'anéantissement de son essence. " Soit dit en passant, le vêtement bourgeois sied à l'Allemand d'une manière particulièrement désastreuse. Cela explique qu'on le "reconnaisse" à l'étranger avec une sûreté infaillible. La raison de ce phénomène très frappant tient au fait qu'il est dépourvu au plus profond de lui-même de tout rapport à la liberté individuelle et du même coup à la société bourgeoise". (Ibid, pp 162) Tout est dit, l'Allemand est le médium de la Figure, il est le bras armé du Destin de la technique comme réintégration de l'Homme dans la grandeur de l'être.
Au beau milieu du carnaval de la lutte des classes du début de ce siècle, le dégoût pour le bourgeois n'a rien d'original. En 1933, le fasciste pouvait tranquillement l'assassiner sous les yeux du prolétaire sans provoquer son ire, il pouvait même joyeusement en augmenter le tirage de ses livres. Il y a donc un parti pris dans le vocabulaire de Jünger, parti pris qui se glisse dans l'idéologie socialiste héritée du XIXè siècle, attirant ainsi une nombreuse clientèle. C'était, comme le soulignait Hanah Arendt dans son analyse du totalitarisme, la méthode classique d'amalgame des fascistes. "Der Arbeiter", titre du livre qui signifie tout simplement Le Travailleur, est un véritable masque qui annonce le thème de la lutte des classes en prônant immédiatement une eschatologie sociale. Or "une vie de grand style", à bien y regarder, n'est rien autre que le rétablissement des Stände, des états critiqués par l'auteur. Ce concept d'état recouvre un profond malentendu, car il signifie à la fois la tendance de la bourgeoisie à se constituer en état, en Allemand il faut entendre par-là quelque chose comme une corporation, et à maintenir la fixité de ces états, et à la fois ces états sont le propre des formes politiques anciennes, monarchie, féodalisme, des formes particulièrement présentes dans la réalité allemande décentralisée de tout temps. Or Jünger raisonne toujours dans le registre de la nostalgie de ces états anciens, de leur grand style. En se reportant à son autre ouvrage de fiction politique bien plus tardif, Eumeswill, on constate qu'en fait la Figure a pratiquement disparu au profit d'un individu, l'anarque, sorte de demi-dieu agissant hors des lois, mais toujours pour un commanditaire qui est aussi un commensal. Ce glissement a certainement sa cohérence dans le dispositif global de Jünger, mais toujours dans cette hiérarchie historique qui secrète des héros et des rats. Aussi, s'agit-il toujours chez cet anthropologue d'un nouveau genre, de peindre des évolutions naturelles, aussi bien les concrétions géologiques que les mutations génétiques ou bien encore les strates des productions culturelles et religieuses souvent comparées à des strates géologiques. L'œil d'esthète reprend toujours le dessus pour se faire le peintre et non l'homme d'action ni le théoricien, sauf à reprendre la théorie au sens ancien de simple vision du déroulement de la réalité. Ces remarques ont pour objet de montrer à quel point la liberté ou la volonté est, en fait, totalement absente de la moralité de Jünger. Elle ne surgit que comme la mise en scène du héros lui-même, c'est à dire de Jünger, Chevalier Noir ou Cosaque de ce siècle dont la liberté n'a jamais consisté en autre chose de d'accepter librement la mort dans le dernier combat, dernier combat qui représente la vie elle-même, la vie n'est jamais qu'un ultime combat. Mais nulle part cette vie n'est plantée comme culture, c'est à dire comme projet se projetant dans une forme transcendantale. Si la Figure avait besoin pour surgir d'un homme à forme de rat, elle n'hésiterait pas à demander que l'homme soit réduit à un rat. C'est ce qui s'est passé à Auschwitz et on n'a pas fini d'en parler.
Cette longue analyse du système de Jünger ne devait servir qu'à montrer combien notre idée de l'homme saisi entre nomadisme et sédentarisme est au antipodes de l'idée de Figure, et d'abord parce que la liberté est le cœur de son essence. Jamais, postulons-nous, l'homme n'est tombé d'un état à l'autre, il a toujours choisi de passer vers autre chose, en prenant tous ses risques et en tirant toutes les leçons de ses essais et de ses échecs. C'est cela même qui fait l'humanité, même s'il devait s'avérer que l'homme se soit trompé, que la somme de ses erreurs s'avère un jour fatale pour l'espèce. Il y a un côté eschatologique chrétien chez cet Allemand qui se prétend Athée, où la Figure relève l'être humain de lui-même et lui propose son plan à la manière d'un démiurge ou de ce qu'il appelle lui-même les Titans. Ici, pas question de salut, cela n'est pas au programme de l'homme et n'a jamais fonctionné que comme élément-système des logiciels projectifs. Pendant les Croisades, le salut a joué le rôle de ce que les anglo-saxons appellent incentive, motif, stimulant, tout près de la notion de stimulus. Il n'est pas étonnant de trouver ce mot abondamment présent dans les systèmes informatiques. En revanche, il est tout à fait incroyable et contradictoire de voir un "homme d'honneur", ou un homme de l'honneur comme Ernst Jünger, s'en remettre, malgré bien des contorsions philosophiques, à la volonté transcendante de ce qui chez Heidegger porterait le nom d'Envoi de l'Etre, mais dans un tout autre sens. Dans le long commentaire humain sur la liberté, sur le Bien et le Mal, il y a toujours à l'arrière plan l'idée d'une excellence possible et certaine chez cet être fini qu'est l'homme. On ne dit jamais que l'exercice même de la liberté n'est que poésie, c'est à dire un Dire qui échappe à tout régime de certitude ou de vérification scientifique. Depuis la naissance de l'Artiste, c'est à dire depuis l'esthétique philosophique de Kant et de Hegel, on reconnaît cette liberté comme fonds de l'Art en regard de sa provenance divine. Ce n'est pas pour rien que Heidegger finit toujours par rejeter tout le sérieux de la présence humaine du côté de la Parole et de la Poésie, car en réalité il n'y a pas le choix. C'est aussi, d'une certaine manière, la position de la psychanalyse qui met tout son poids sur la singularité, créant un monde humain parfaitement chaotique dans son essence, c'est à dire poétique dans sa réalité.
UNIVERSALITE ET SINGULARITE
Reste à savoir comment s'articule cette liberté. Est-elle enfermée dans l'universalité du langage ou bien dépend-elle d'un topos à chaque fois singulier, mais alors comment pourrait-on encore parler de langage universel ? La question serait insoluble si on s'empêchait de se poser cette autre question : le langage est-il universel ? Depuis Jacques Lacan cette dernière question n'en est plus une, mais déjà au Moyen Age Guillaume d'Occam et ses disciples, les nominalistes, avaient découvert l'absolu de la singularité, c'est pourquoi le nominalisme a droit de cité envers et contre l'absurdité qu'il semble représenter. En effet, dire que le mot est la vérité ou bien qu'il la contient, n'est plus absurde dès lors qu'on focalise son attention sur l'usage du langage. Lacan montre sans appel que le mot du dictionnaire n'est qu'une approximation grossière d'un sens jamais présent en tant que la définition proposée. Le langage, au contraire, est un tissu stratégique à chaque fois singulier, où le sujet exprime dans chaque signifiant un signifié singulièrement orienté dans la trame du discours selon sa stratégie ontologique. Que la généralité soit possible, prenant dans la spéculation philosophique l'aspect de l'universalité, n'enlève en rien à l'expression, au speach-Act, sa force individuelle et son poids spécifique et singulier. Cette généralité ne fait qu'exprimer les forces relatives des singularités dans le discours général, les mots sont les armes privées les plus redoutables.
Voilà qui soulève cependant de terribles questions nouvelles, auxquelles notre époque est plus que jamais confrontée, et pour la première fois avec en main toutes les cartes pour y méditer et y répondre... stratégiquement. En effet, comment imaginer le politique sur la base d'une absence d'universalité linguistique ? C'est tout le problème que Freud analyse indirectement dans deux textes célèbres : " Inconscient Collectif et Psychologie des Masses" et "Malaise dans la Civilisation". Sa réponse paraît sibylline mais elle rejoint comme par hasard notre vision de l'histoire et de la liberté car elle s'arrête sur la contingence de l'effet de la psychanalyse. A savoir, la psychanalyse est le seul événement qui puisse interrompre le cycle infernal du renforcement du Surmoi collectif qui vient renforcer la violence dans la civilisation. Mais, elle peut aussi ne pas, elle peut échouer. Comment ? De deux manières simples, mais ici ce n'est plus Freud qui parle, la cure psychanalytique peut échouer en tant que telle, on sait qu'il est dangereux de se lancer dans cette voie difficile et a priori sans espoir. Mais là n'est pas le pire, car la psychanalyse pourrait aussi ne pas être choisie comme éthique sociale, comme élément du politique, exactement de la même manière que dans l'histoire, les hommes ont choisi la science, ont choisi l'école et la transmission du savoir.
Ici s'énonce l'exigence d'un retour à la solitude constitutionnelle de l'être humain. C'est logique puisque notre métaphysique occidentale et son pendant le capitalisme ont programmé l'individu comme aboutissement social et politique de la réalité humaine. La psychanalyse se révèle ainsi être la découverte des outils psychiques de cette mutation hors de la symbiose sociétale porteuse de malentendus sanglants. Car le paradoxe est que c'est la pusillanimité, la terreur elle-même issue de l'affadissement du sentiment individuel orchestré par le Christianisme, qui a produit les moments les plus horribles de la violence historique. La peur est bien, comme l'affirmait Roger Chambon, le motif premier des actes humains, mais selon notre récit, cette peur est devenue ce qu'elle est dans l'entre-deux de l'essence nomade réfugiée dans l'âme et la fixité pratique du corps dans le temps et l'espace. L'angoisse définit parfaitement ce tremblement de l'être dans l'Etre, position entre-deux-chaises que l'homme a tenté dans un incroyable poker historique.
La politique actuelle illustre cette situation d'une manière frappante, notamment dans la contrainte dans laquelle elle se trouve constamment d'utiliser le mensonge. Ainsi le stalinisme, dont on pourrait dire qu'il est le résumé de ce que l'on appelle la Realpolitik, a construit toute sa politique autour de la planification, c'est à dire autour d'une véritable OPA sur le futur à laquelle rien ne l'autorisait. Dans le schéma des plans quinquennaux, le Plan remplace Dieu, il distille un imaginaire du bonheur futur, et malheureusement cette méthode est non seulement devenue l'âme de toute politique, mais s'est encore étendue à la prévision économique devenue l'auxiliaire des gouvernements. Or, à examiner l'histoire récente, il n'est pas difficile de remarquer que la plupart des prévisions n'ont jamais fonctionné autrement qu'en incitant les agents et l'opinion à s'y soumettre afin de les rendre réelles. Les médias jouent ici un rôle central en véhiculant auprès du public ces stimuli psychologiques qui déclenchent en fait ce qui devrait aller de soi. C'est ce qu'on appelle la manipulation et c'est pourquoi elles ne font jamais long feu, quand bien même les prévisions s'avèrent justes parce que le dispositif a marché assez correctement. L'exemple le plus comique se joue en ce moment même en France où la prévision de Jospin se réalise pratiquement mieux que prévue, mais où en même temps le crédit de Jospin diminue au fur et à mesure qu'elle se vérifie. Cet hiatus n'est pas une anomalie, car le public sait lire la manipulation du temps et de l'espace, car c'est ce qu'il fait tous les jours en se soumettant au tripalium de la quotidienneté elle aussi inventée comme normalité en elle-même monstrueuse.
L'origine de cette contrainte à la manipulation n'est rien d'autre que la sublimation ou la spiritualisation de l'aller-de-l'avant nomade. Cet aller-de-l'avant des temps originaires - mais nous ne souhaitons pas accentuer ici la vérité de l'origine, ou la valeur ontologique de l'archaïque, il est possible que l'époque nomade d'avant le néolithique ait été précédée par une autre civilisation sédentaire et cela ne change rien à notre propos - la marche, donc, des nomades intègre en elle-même le calcul temporel, elle ne se fixe logiquement rien d'autre comme objectif que la présence du présent : le nomade existe dans sa marche autant que dans son repos. Ce caractère particulier du nomadisme s'est réveillé à l'aube du vingtième siècle par l'invention des moyens de transport et notamment l'automobile, devenue l'objet qui est à lui-même sa propre fin entre les mains de cet homme si... singulier ! La circulation sans but a certes pris tous les masques que l'on a pu inventer, exclusion des lieux de travail de la ville, dispersion des tribus et des familles, usage du temps dit de loisir, sport de la vitesse et records dont Jünger disait qu'ils devaient mesurer à chaque instant l'énergie disponible dans la société. Or, la jouissance morbide reste malgré tout ce qu'il y a de plus évident dans la pratique de cette errance moderne. On peut se demander, par exemple, si les congés payés ont été inventés pour le repos des travailleurs ou bien pour leur permettre de se livrer à cette nouvelle errance, d'autant que ce goût collectif laissait entrevoir toute une nouvelle industrie à laquelle on ne s'attendait pas, même pas encore très récemment. La réponse est dans le travail que représente aujourd'hui sous diverses formes la possession et l'utilisation d'une automobile. Jamais dans l'histoire de l'humanité l'homme n'avait produit une marchandise elle-même productrice de marchandises par le travail de son propriétaire : c'est comme si un bien devenait son contraire, c'est à dire contrainte et manque, l'outil défait ce qu'il est sensé faire à la place de l'artisan. Mais comme la peur, le manque est l'une des clefs de la compréhension du monde actuel : l'objet petit a n'est pas un accident psychique, il fait partie du plan, ce que nous avons essayé de monter plus haut.
En même temps que la psychanalyse, sont nées la sociologie et toutes les visions mécanistes et végétatives de l'humanité, comme les machines désirantes reliées par un rhizome et autres représentations résolument sociétales de l'être humain. La première remarque est stratégique, elle porte sur le fait que l'Histoire présente ou propose toujours deux solutions. A l'époque de Saint Augustin déjà, et plus tard à travers toute l'histoire du Christianisme, c'est à une dualité fondamentale qu'on a affaire, et affaire à choisir son camp et non pas simplement à penser dans son coin sans conséquence : grâce ou pas grâce ? En clair : le Chrétien est-il sauvé par la seule grâce à lui concédée par Dieu quel que soit son comportement, ou bien le Chrétien a-t-il une chance de s'en tirer en pratiquant la vertu ? Ces deux questions sont en réalité des choix fondamentaux proposés par les théologiens dans le cadre de la pratique de la souveraineté c'est à dire de la politique. En effet, tout oppose les deux versions quant à leurs implications regardant la gestion ou le gouvernement des peuples. D'un côté nous avons des êtres humains divisés en deux classes, l'une pourvue de la grâce et l'autre non pourvu pour l'éternité, c'est à dire d'office condamnée à l'enfer, âme perdue et donc méchante ante festum, née méchante par... la grâce de Dieu. Saint Augustin fut de cette tendance, vieille fidélité au schéma idéaliste de Platon, mais un schéma devenu lui-même difficile à gérer dans le cadre du monothéisme, quoique pour Saint Augustin le drame n'était pas bien grand tant était prégnant l'aristocratisme romain. Saint Thomas, tout imbibé du réalisme aristotélicien, ne pouvait pas souscrire à une telle représentation du destin humain. Dans son esprit le mouvement prend le pas sur la fixité, l'existence sur l'essence, et le pécheur peut toujours par un acte de repentir et de vertu, regagner la confiance et l'amour de son dieu. On voit jusqu'où peut aller cette distinction, mais l'histoire du catholicisme lui-même, déchiré entre jansénisme et le Molinisme des Jésuites, comme le sera le Protestantisme entre Luthériens et Réformés, reflète en réalité toute l'histoire du politique en tant que tel.
Ici encore surgit le motif de l'universel et du singulier, et ce dans une accumulation de paradoxes amusants s'ils n'étaient pas tragiques. Le motif platonicien de la métempsycose qui aboutit à la grâce augustinienne est fondé sur la singularité : chaque être humain porte son destin en propre et son voyage dans le pays des ombres est un sentier absolument unique où se joue la qualité de sa réincarnation. Or dans ce plan, il manque un dieu qui aime ou n'aime pas, le sujet est donc livré à la responsabilité de son comportement moral dans la vie concrète, dans la caverne. Logiquement Saint Augustin aurait dû en tirer la conséquence inverse de ce qu'il a fait, car le sujet de Platon est responsable et donc il peut influencer le sens de sa réincarnation, de même que le Bouddhisme propose une sorte de dialectique ascendante par laquelle l'individu peut finalement se dégager de la nécessité de la réincarnation elle-même. Mais Saint Augustin était un aristocrate de corps et d'esprit, il devait d'une part introduire la pièce Dieu sur l'échiquier, et d'autre part le pécheur dans sa singularité, une singularité dont il ne peut pas sortir et donc qui le condamne dès sa création. C'est donc Dieu qui le crée tel qu'il ne peut que rester mauvais ou bon dans sa singularité devenue une prison. Il y a là tout l'édifice théorique nécessaire pour fonder la Réforme, expressément orientée vers la singularité du rapport entre l'homme et Dieu, même si la dualité finit quand même par s'imposer.
A l'inverse Aristote raisonne en espèces et en formes se mouvant vers la perfection, en entéléchies. Sur cette base, les théologiens ont donc la liberté de considérer d'une part les Chrétiens comme une classe homogène, universelle, et par conséquent leur attribuer un destin commun initié par le baptême. Cette vision ne manquera pas de renforcer la xénophobie chrétienne à l'égard des non-baptisés, xénophobie tellement forte que même les Protestants se verront contraints au baptême ainsi que toutes les sectes se réclamant de l'Evangile. D'un autre côté cette universalité de pacotille - le baptême - implique une liberté insupportable en termes politiques. Il faut donc inventer un subterfuge pour gérer une telle société, une subordination théologale qui sera le Droit Divin. Comme Luther plus tard, les théologiens insisteront sur le fait que les princes sont les représentants de dieu sur terre, pour leur bonheur comme pour leur malheur. Le roi sera le représentant unique de la singularité augustinienne avec tous ses pouvoirs et toute sa responsabilité. Au résultat, toutes ces idéologies religieuses et apparemment purement théologiques, vont donner des assises concrètes très réelle à la politique telle qu'elle se dessine en Europe au cours du Moyen age, de la Renaissance et jusqu'à nos jours. Dans le débat républicain, nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour qui indique d'un côté une soumission à l'impératif libéral du sujet singulier tel qu'il est défini par le Jansénisme le plus sauvage, entre-temps recuit à la sauce anglo-saxonne, et de l'autre la fidélité au système de la définition de l'intérêt général par le souverain désigné par le suffrage universel, système qui intègre la dimension du progrès par le mouvement garanti de l'éducation et de l'égalité des chances. L'actuelle idéologie du consensus révèle une hésitation catastrophique pour la République fidèle à l'esprit de sa naissance. En effet, d'un côté le législateur entend garantir la justice de la loi, mais de l'autre il lui affecte un prix aléatoire que représente le consensus autour de cette loi. Le législateur perd ainsi sa raison d'être car il n'est plus qu'une instance de proposition ayant perdu son pouvoir de sanctionner l'exécutif puisqu'en réalité l'exécutif a renoncé à imposer les lois. Ici se confondent pour notre malheur deux phénomènes totalement étrangers l'un à l'autre, le déclin de l'état et celui de la République. Le paradoxe n'est qu'apparent car la République a toujours conservé par - dévers lui le pouvoir de modifier sa Constitution dans tous les sens nouveaux qui s'ouvrent avec le progrès. La démocratie anglo-saxonne prétend avoir réduit l'état à sa plus simple expression, ce qui n'est vrai que pour autant que l'on ferme les yeux sur l'appareil parallèle à l'état qu'est le système de la Justice américaine. Si on le prend en compte, on découvre qu'il engage la société dans une quotidienneté où le citoyen est pris en tenaille entre la justice et le politique proprement dit. Il suffit de penser à la pyramide que forment, dans un état ou un comté américain, le pouvoir judiciaire et le pouvoir proprement politique, quelles que soient leurs origines démocratiques, et ce principalement parce que la Justice américaine est essentiellement jurisprudentielle. Cela signifie que les décisions des juges sont plus importantes que la loi elle-même, que l'usage est plus fort que le Droit.
Mais, question, comment la République pourrait-elle modifier sa constitution dans le sens du déclin de l'état sans tomber dans le schéma jurisprudentiel anglo-saxon ? La seule réponse possible reste encore le développement de la démocratie directe. Nous disons développement parce que la démocratie directe pose un problème de compétence technique et morale. Sa faisabilité ne pose, en revanche, aucune difficulté grâce à l'informatique. Demain tous les citoyens pourront voter de chez eux, répondre quotidiennement à des questions législatives et, pourquoi pas, voter les lois. Mais que l'on ne s'y trompe pas, le résultat ainsi obtenu n'aura rien à voir avec le consensus : il reflétera toujours l'opinion d'une majorité en face d'une minorité, alors que la philosophie du consensus est précisément de faire disparaître cette opposition, c'est à dire le jeu républicain du changement social, de la Révolution continuée, opposée au conservatisme foncier de la démocratie anglo-saxonne. L'enjeu de la République n'est pas la gestion d'une société inégalitaire en fonction de critères minimalistes de charité publique, il reste la transformation de la société dans le sens d'une autonomie de plus en plus grande de l'individu et la suppression finale de toutes les dépendances réciproques qui pèsent sur sa liberté. La République est un projet historique, et non pas un modèle entre d'autres d'administration des peuples.
HABITER ET ETRE
Se sédentariser, c'est d'abord avoir en vue l'habiter. En s'arrêtant de marcher, en passant d'un monde mouvant à l'immobilité d'un paysage, on choisit de placer son corps dans une certaine position, de limiter ses mouvements dans un rayon déterminé, en se retirant de l'illimité du mouvement, en abandonnant l'infini de la découverte. Il est clair que dans cette opération le souci fondamental et initial a complètement changé : il est passé d'une finalité qui ressemble à l'imitation du temps qui passe, à ce qui nous est plus proche, à savoir la position contemplative dont le but semble être ou avoir été d'arrêter le temps. De cette hypothèse on peut conclure provisoirement que c'est le rapport au temps qui motive le geste d'arrêter une errance dont on peut dire qu'elle annulait le sentiment temporel en suivant, sur les chemins non tracés de l'espace, l'évolution de ce qui allait devenir le temps, c'est à dire les astres et les saisons. Le passage à la position sédentaire correspondrait donc à la naissance de la temporalité. Tout ce qu'on peut observer dans les époques concernées l'atteste, la mesure du temps est la toute première religion des hommes du néolithique.
Cette découverte de la temporalité en tant que nécessité de mesure, s'avère en même temps comme perte d'un rapport essentiel au temps - et à l'espace - rapport immédiat au sens de la certitude sensible développée par Hegel dans son premier chapitre de la Phénoménologie. Ici on peut comprendre comment sont liés certitude et savoir, certitude et connaissance : le co de connaissance, le cum latin qui est le même que celui de conscience sont les traces de l'aller-avec comme savoir absolu ou identité. Car aller-avec a le sens d'une proximité constante, certes pilotée par l'homme avec une science parfaite de ce qu'il maintient dans la proximité. Lorsque donc l'homme s'arrête en se détachant de l'aller-avec, il se hâte de mettre à l'abri la science qui est la sienne dans le temple des dieux, les dieux étant ceux qui possèdent ou ont possédé cette science absolue. Une remarque en passant, le monothéisme marque un affaiblissement de cette maîtrise, en tout cas une perte de la conscience des enjeux initiaux : dans l'aire méditerranéenne on a oublié la finalité originelle de Babel, Babel pouvant être décrite comme la métaphore de l'épisode où les hommes se sont arrêtés pour passer à autre chose. L'accident linguistique de Babel, la multiplication des langues, peut valoir comme la conséquence de l'impureté de l'action : ce qui entre dans le temple, ce qui est retiré de la nature, de la physis, n'est plus seulement le bien ancien, le temps et l'espace comme identité et comme relation à l'être, mais aussi déjà les objets de la nouvelle préoccupation des hommes, les produits de la contemplation - métaphoriquement on pourrait dire l'idolâtrie - en un mot l'art. Car dès lors tout est devenu art. L'habiter nouveau a dans toutes ses actions le souci de la contemplation, il tente de rassembler des objets essentiellement contradictoires : la jouissance retirée des objets sans cesse embellis, la culture de l'immobilité, et aussi ceux de la science du mouvement conservée dans les tabernacles. C'est l'essence de la crise comme mise en contact critique d'éléments contradictoires mais complémentaires dans leur pouvoir explosif. La contradiction réside dans leur identité, exactement comme l'uranium 235 mais à l'échelle de la cause, c'est à dire l'échelle du désir qui a commandé toute l'opération. Autrement dit, lorsque les hommes se sont arrêtés, la pureté de leur intention était totale, à savoir enrichir leur science absolue de leur rapport à l'être, c'est ce qui correspond au mythe adamique. Or il y a contradiction entre connaître et pouvoir au sens où la connaissance détache l'homme du pouvoir (les deux arbres de l'Eden). Plus clairement, l'héroïque aller-avec le temps et l'espace de l'âge d'or était un ne-pas-tenir-compte-de-la-mort et de la souffrance, mort et souffrance qui allaient accéder à l'apparence en même temps que tous les autres objets contemplés. Le mythe adamique répond de manière univoque à la question de la liberté, l'arbre de la Connaissance est en vérité l'arbre de la liberté. Milton le révolutionnaire n'a pas manqué de le souligner par des accents qui ne trompent pas sur son intention évidente de réhabiliter Satan.
Ce qui se passe donc au néolithique, ou plutôt ce qui commence là, c'est un prodigieux freinage, un peu en catastrophe, comme si le mouvement global avait atteint à ce moment-là un état chaotique incontrôlable. Rentrer les données astronomiques et mathématiques dans le temple, de même que les richesses et la nourriture, c'était au fond une opération de sauvetage. L'Homme-Babel anticipait une catastrophe naturelle qui n'avait rien à voir avec un déluge ou un tremblement de terre - construire eût été alors une contradiction - mais une catastrophe psychique ou spirituelle. Plus simplement il prend conscience de la possibilité d'habiter la terre autrement, d'une manière qui révèle souffrance et mort afin de l'initier à la lutte contre ces deux fléaux. La souffrance et la mort sont a priori l'affaire de l'Etre : mourir en chemin est naturel, c'est la loi de la marche, cette mort ne suscite aucun langage parce qu'elle est synchrone ou en rythme avec le mouvement des êtres et des choses. Cette naissance de la mort n'est pas le produit d'une évolution physique ou biologique, elle est la découverte d'un fleuve dont l'autre rive est devenue visible. Un autre habiter-le-monde se profile comme une prodigieuse hypothèse d'éternité et d'infini : mais on est loin des eschatologies religieuses ou politiques, ce nouveau sentiment d'éternité n'est que la parousie de la relation à l'être : c'est le premier sentiment d'appartenance à l'Autre, d'appartenance de l'Autre à soi et de soi à soi. La conscience de soi. Cet éclair de lucidité, c'était cela la catastrophe imminente, le vertige que les prêtres auront bien du mal à masquer sous la théologie des Autres divins ou de celle du Grand Autre Dieu.
Pourtant, l'autre mythe de la mise à l'abri de la nature, celui de l'Arche de Noé, contient un avertissement : oui nous nous abritons sur une nef, nous nous arrêtons ensemble dans une maison, mais elle flotte, elle est en mouvement. L'Arche a donc une double fonction, conserver d'une part la vie naturelle en l'abritant, mais aussi conserver le mouvement de cette vie, détermination qui appartient au passé nomade, à la marche descendante de l'Eden vers les plaines de Galilée. Mais les hommes n'écouterons pas cet avertissement, ils veulent s'ériger dans l'immobilité divine elle-même, ils veulent expérimenter l'immobilité de l'Etre. Babel, par la suite, devait défier la puissance destructrice divine par sa seule hauteur, rendre un nouveau déluge parfaitement inoffensif, début de l'attitude eschatologique humaine, début de la civilisation technique proprement dite. Tout est là : la volonté transgressive de s'exclure du mouvement pour imiter l'immobilité ontologique du monde, pour s'y conformer et pour en tester la jouissance. La pyramide égyptienne est l'illustration la plus éclatante de cette volonté d'atteindre coûte que coûte l'immobilité parfaite, absolue : le tombeau du Pharaon était le lieu du Divin, de l'intégration finale dans l'Etre, dans la fusion avec lui.
Au fond, les hommes du néolithique avaient surpris un secret au détour d'un de ces chemins qui n'allaient nulle part. Ils avaient saisi l'identité de l'étant en tant que représentant de l'Etre, en tant que son double apparent. En même temps ils pouvaient postuler que tout mouvement n'était qu'apparence et que la "vérité", en tant qu'Aletheïa, c'est à dire en tant que dévoilement, résidait essentiellement dans l'immobile. Qu'est-ce à dire, dévoilement ? Il faut comprendre du jargon heideggerien que l'Etre, disons pour parler vite la totalité, se dévoile dans l'étant. C'est dans la parousie de l'étant que l'homme apprend l'Etre, ou apprend qu'il pourrait y avoir autre chose que les étants, ou que l'étant. Voyez la remarquable ambiguïté de ce que nous percevons : d'un côté le monde offre un magnifique tableau de stabilité, de majestueuse présence calme, et c'est dans son esprit qu'il faut chercher l'idée étrange que tout se meut, que les astres et les planètes tournoient dans le firmament. D'un autre, le monde immédiat que nous affrontons, celui du vivant, est un pur tourbillon, vibrionnement permanent et mouvements de toute catégorie. Il n'y a que du mouvement. Pour comprendre donc ce paradoxe d'un monde immobile en mouvement, de quoi damner cent Galilée aux alentours du seizième siècle, il fallait faire partir l'un de l'autre, le mouvement du repos et le repos du mouvement. Pensée la plus difficile, car elle n'a pas de fondement autre qu'une théorie compliquée, celle de la relativité.
LE RESEAU - RACINE
Les hommes, donc, s'arrêtent et se rassemblent, forcément. Forcément car l'énergie cinétique des courses engagées qui s'épuise dans le freinage met un point de rupture avec l'ordre individuel de la course. Les hommes se rencontrent accidentellement et doivent donc inventer l'être-ensemble, là où ils se sont arrêtés. D'où, d'un bout à l'autre de la planète, des foyers de rassemblement qui vont s'organiser pour exister dans le même espace et par rapport aux autres espaces qui se sont constitués en même temps. La décision sédentaire a une première conséquence de grande envergure historique, le morcellement de l'espace humain. Cet espace humain va se concentrer en certains points aléatoires, mais ces concentrations devront retrouver coûte que coûte un ordre d'existence, de distribution des êtres qui soit analogique à l'ordre parfait du mouvement permanent. Faire l'économie d'un ordre ce serait alors introduire le mouvement anarchique dans la concentration, rendre impossible l'habiter ensemble, conséquence naturelle de la sédentarisation. La conséquence prévisible serait la disparition de l'espèce. Il faut immédiatement inventer les instruments destinés à éviter l'entropie sociale galopante : ce seront dans l'ordre l'érection des temples, la guerre et la religion. Temple, guerre et religion ne sont que des paramètres d'ordre de l'exister pour des humains qui ont choisi de sortir de l'individualité naturelle, naturelle au sens d'archaïque, car nous verrons que la Nature n'est que le symbole de l'origine, la Physis est "ce dont est ce qui existe" selon la phrase bien connue d'Anaximandre.
Or, la mise en place d'une telle organisation va aboutir à ce que nous appelons une "société", c'est à dire un système de dépendance réciproque qui va heurter de front l'instinct de liberté originel de l'individu nomade : on pourrait presque dire que la concentration d'humains en un lieu est l'équivalent d'une expérience carcérale pour toute une société. Les premières villes sont, sans aucun doute, les premiers camps de concentration de l'histoire humaine. Avec une différence fondamentale, c'est qu'il n'existe pas, a priori, d'administration de ces geôles nouvelles et qu'il faudra trouver rapidement un dérivatif des passions de la rivalité, ce sera la guerre. Le premier geste de paix de l'être humain aura sans doute été de s'inventer un ennemi, commun. De cette universalité de l'ennemi dépend, en premier lieu, la cohérence de la société : ces ennemis s'appelleront les barbares. Mais, cette remise en ordre des mécanismes de prédation - car il ne s'agit pas d'autre chose, le nomade était un prédateur libre, œuvrant dans le chaos des rencontres - désormais la prédation est une discipline collective dont la victime est géométriquement repéré. Aujourd'hui encore, au fin fond du Gabon, dans le plus petit village de brousse, existe un Corps de Garde, une case publique où s'installent pour la nuit les gardiens du lieu, car l'hostilité est circumgénérale : tout ce qui entoure le village est a priori d'essence adverse, même à l'intérieur d'une même ethnie. Ce qu'on appelle pompeusement tribalisme, est toujours un tropisme local et non pas une consanguinité fantasmatique (ou ethnographique...). Nous verrons dans l'histoire qui suivra, que l'autre prédation, la chasse, la pêche et la cueillette, vont aussi changer de régime et de nature : on va passer d'une prédation aléatoire à l'industrialisation de l'exploitation des ressources vivrières, l'agriculture va soumettre à son ordre l'arraisonnement des biens animaux et végétaux. Les êtres et les choses vont s'agréger dans des ordres précis, fonctionnellement orientés, créant ainsi des réseaux de complémentarité fonctionnelle. L'être individuel accède à une culture de sa nature, il va s'enraciner dans un même terreau existentiel ordonné selon les critères qui réussiront à s'imposer dans le cadre de la guerre, de l'économie et de la religion.
L'attitude qui consiste donc à "sociologiser" l'être humain, à en faire un collectif relié par des racines communes, un rhizome comme dit Deleuze, n'est pas dépourvue de pertinence, mais il ne faudrait pas faire de cette détermination passagère un phénomène originel. Car l'homme a sans doute eu autant de mal à se greffer un tel rhizome qu'il en a aujourd'hui à venir à bout de la dépendance réciproque qui s'est développée sur ces racines. L'histoire combinée de l'homme nomade et de l'homme sédentaire, c'est cette recherche des positions possibles dans la réalité et leur affinage dans le sens de leurs résultats. Il faut donc prendre la création des villes comme une invention réussie et riche de conséquences, mais dans l'optique du nomade et dans sa visée originelle. Les hommes du néolithique ne se sont pas arrêtés par fatigue ou par nécessité vitale, ils ont lancé une figure de leur relation avec la réalité. En ce sens on peut comprendre la métaphore de la Figure de Jünger, mais jamais dans une généalogie de l'obscure, dans une histoire de la Figure transcendante qui s'impose malgré l'homme et contre lui. On en veut pour preuve, et nous l'avons déjà souligné, que les premiers citadins de l'histoire se sont voués à l'enregistrement scrupuleux de ce qui se passe, inventant l'écriture parce qu'il fallait un cadre méthodique à l'expérience ainsi lancée. Ici la méthode constatée atteste du caractère expérimental des événements, et ce qui passe pour le miracle grec n'est, en réalité que le crépuscule de tout cet affairement philosophique du monde. A partir de là, le réseau-racine va produire ses effets occultants, produire l'oubli du plan, l'oubli de l'éclat de lumière qui est à l'origine de la taille de la pierre.
Or, cet éclat de lumière n'est rien d'autre que la conscience humaine, il est la naissance de son individualité en tant qu'étant, le surgissement du phénomène humain lui-même. Du jour au lendemain l'homme apprenait son originalité, son unicité et sa différence. Trois principes qui vont continuer de rougeoyer sous les cendres du brasier initial et se transmuer en une vision éthique du sujet qui n'a plus rien à voir avec la communauté expérimentale du début, mais qui contient l'essence de l'intuition initiale dont le moteur est la question de l'Etre. Ce réseau-racine, la société en tant que telle, deviendra la plate-forme expérimentale d'un nouveau réseau, le terreau de la croissance du réseau-fleur, le réseau entéléchie ou l'entéléchie de l'Homme
LE RESEAU - FLEUR
Que peut bien signifier l'entéléchie de l'Homme ? Selon l'idée classique d'Aristote, l'entéléchie serait l'achèvement de sa nature, le terme de la forme atteinte dans le mouvement de la génération et de la croissance, en un mot, l'épanouissement de la forme elle-même. Pour Aristote, cette forme est universelle et éternelle comme l'idée platonicienne, il n'y a pas d'homme historique, pas d'être en devenir au-delà de son propre destin individuel, destin qui parvient ou non à son entéléchie. C'est pourquoi sans doute, Aristote a toujours privilégié une image médiane de l'humain, une sorte de moyenne qui dans sa morale portait le nom de médiété. L'homme idéal était un poudaios, un riche citadin, moyen en tout, dans sa morale, dans sa justice, dans ses passions et dans ses actions. Une telle représentation correspond assez bien à une représentation utile de l'homme appartenant au réseau-racine : son individualité elle-même doit être médié, c'est à dire rester "sociale", comparable aux autres sans qu'il n'apparaisse d'excès d'aucune sorte. La démocratie est le secret politique de cette vision car elle enferme tout événement dans la comparaison et dans la mesure. Le débat démocratique n'est rien d'autre que l'établissement constant d'une mesure, d'une médiété qui pour beaucoup de commentateurs comme Nietzsche par exemple, aura pesé sur l'histoire en tant que la médiocrité du bavardage social. Or ce bavardage est tout ce qui reste de la fondation des sociétés, il n'est pas leur produit, il n'est pas leur effet malvenu, il n'est pas non plus leur vice de forme, il est le commentaire permanent du réel, il est le registre de ce qui arrive lorsqu'on s'arrête. Ce commentaire, à l'origine, n'est pas fait pour rire ni pour passer le temps des scribes et des princes, mais pour voir si l'expérience vaut le coup, si on peut continuer et comment continuer. Ce bavardage, c'est aussi la culture de l'homme sédentaire, c'est la culture de son intuition initiale qui avait misé sur l'immobilité pour se donner plus de chance de comprendre sa question de l'être. Au résultat de son histoire, l'homme social bavardant entre individuellement dans la question, il n'agit plus seulement en tant qu'élément social d'un plan social, il n'assume plus seulement la fonction sociale à lui dévolue par le hasard dans le brassage des conflits réels et discursifs, il devient autonome dans le traitement de la question qui à l'origine était une question collective.
Une telle autonomie est avant tout éthique. Elle ne peut pas signifier que l'homme peut désormais apporter individuellement sa réponse à la question de l'être, ce serait stupide. Mais cela veut dire que l'homme a trouvé légitimité à s'emparer individuellement de la question et que désormais il est homme au maximum de sa forme possible, il est devenu insoupçonnable et donc libre. Pour risquer une métaphore osé, on pourrait dire que chaque individu est théoriquement devenu un élément de réflexion de la lumière, exactement comme un élément de panneau solaire. Comme le photo capteur, l'individu reçoit et métabolise la lumière, la lumière de sa conscience, mais aussi la lumière de la conscience collective inscrite dans la culture. Pourquoi aujourd'hui et pas hier ? La question est mal posée, car d'une certaine manière l'homme n'a jamais cessé de réaliser cette opération de métabolisation de ses états de conscience, sinon il n'aurait jamais eu l'idée de modifier son attitude éthique, son éthos au sens de l'habiter-le-monde, il ne se serait jamais arrêté pour voir si l'immobilité est bien le lieu de l'alethéïa, de la parousie du vrai. Ce qui change dans le temps de l'histoire, c'est précisément ce qu'a apporté la décision de s'arrêter et de vivre en commun, de fonder des sociétés qui partagent le souci de la lumière, ou du moins s'attachent à fonder une représentation commune, un consensus sur le Dire de l'être. Sa symphonie. L'être n'est pas symphonique parce qu'il se partage entre mille éléments conflictuels, il ne l'est que dans sa célébration par cette myriade mouvante et instable. Au fond, l'homme a construit des temples et des cathédrales dans un seul et unique but, celui d'apprendre à chanter. Au fond des océans se tapissent des coquillages dont les couleurs sont de véritables hymnes à la vie. L'homme, lui, ne naît pas avec son chant dessiné sur sa peau, mais justement avec dans l'âme l'idée du laid, l'idée du plus ou moins beau, du plus ou moins approprié à la fête de l'être, il se retrouve un peu comme l'ordonnateur des élégances de la réalité, mais sans instructions préalables, sans cesse exposé au risque de se tromper.
Le réseau-fleur est un épanouissement, un crépuscule du vivre humain dont les couleurs chatoient déjà dans le monde dit virtuel. La sédentarité contenait en secret un obstacle fondamental et redoutable, c'est la séparation. S'arrêter ne pouvait pas signifier s'arrêter tous ensemble, même s'il y a dû y avoir une sorte de plan global humain, mais devait aboutir au cantonnement des uns et des autres. L'élaboration de la question de l'être, le sujet propre de l'arrêter-pour-habiter-autrement, éclatait en même temps que les groupes humains. Le nomadisme avait au contraire l'avantage de brasser constamment les peuples, de les universaliser d'office dans une communauté d'esprit et de projet. A partir du moment où l'on prenait le risque de s'arrêter aux couleurs d'un lieu, à prendre la lumière spécifique d'un topos déterminée, on prenait aussi celui d'hypostasier sa vérité, d'en faire un critère universel dont l'évidence devait s'imposer à l'espace tout entier. Ainsi naissaient le nationalisme de l'esprit, l'attachement aux idoles départementales et les massacres de l'intolérance. Il fallait donc faire le chemin en sens inverse, trouver dans le "bavardage historique" le moyen d'en finir avec la séparation topologique et rétablir les canaux de communications naturels. C'est désormais chose faite. Désormais, le monde entier peut virtuellement se parler, se proposer à nouveau de nouveaux projets, préparer peut-être un nouveau néolithique. Un tel projet n'est concevable que dans l'universalité, et l'histoire montre ce que coûte l'absence de coordination et d'accord sur ce genre de décision.
Ce chapitre, intitulé Habiter et Etre, propose une dichotomie là où il n'y en a pas : habiter et être sont bien le même, et en ce sens, une inflexion dans l'habiter-le-monde implique aussi une inflexion dans l'être, ou dans l'être dans/de l'être. Cette inflexion ne nous est pas connue puisque la connaissance est elle-même une inflexion de l'habiter qui ne lui permet pas de prendre sa propre origine pour objet : l'être donne à voir et commande le connaître pour ses propres fins et selon sa propre origine. On peut alors se demander ce que cette autre dichotomie sédentaire/nomade vient apporter comme lumière supplémentaire sur l'être. Pourquoi une histoire du mouvement des hommes pourrait-elle à elle seule éclairer le destin de l'humanité ou son sens perceptible. D'abord cette représentation n'a pas une telle prétention, elle ne fait que s'attacher à récapituler les épisodes de ce qui constitue le fond de l'intuition occidentale du mouvement. Le paradoxe veut que les hommes ont d'abord dû s'arrêter pour saisir cette vérité dynamique car dans la course nomade le monde était d'abord l'immobile et sa vérité semblait résider dans le stable, dans l'état, dans l'être résistant sous la main mais constamment disponible. Cet en-soi inépuisable de la présence pleine a été expérimentée à l'aube de notre histoire et à nouveau pressenti à son crépuscule avec la phénoménologie et l'ontologie fondamentale. Mais entre-temps cette dualité implicite du mouvant et de l'immobile s'est dissoute en des séries annexes de dualités en tous genres qui vont du manichéisme le plus primitif à la casuistique la plus pointue sur la fatalité plus ou moins décisive de la grâce divine ou encore des oppositions sophistiquées des structures et des superstructures, des formes et des contenus, du sens et de la signification, du signe et du signal. Habiter et Etre aura voulu plus simplement laïciser le débat sur le destin de l'être humain, le laïciser non pas au sens de le soustraire aux représentations et aux pouvoirs discursifs des églises, mais philosophiquement. Cela veut dire éclairer rationnellement ce qui s'est toujours présenté sous les masques d'autres conflits, imaginaires ceux-là, entre des sujets et des êtres fantasmatiques, entre les valeurs qui s'y rattachent par un bout ou par un autre, entre tout ce qui a pu et dû s'inventer pour combler la plénitude de la course permanente, cette praxis immédiate de ce qui allait devenir la théorie suprême, celle de l'energeia, de ce que nous avons traduit aujourd'hui par force ou énergie. L'autonomie énergétique faisait partie des privilèges nomades au sens où les hommes du néolithique ne dépendaient directement que de l'énergie qu'ils produisaient chacun pour soi. La longue parenthèse qui passe par la dépendance réciproque et le partage de l'énergie, va se refermer par une nouvelle autonomie énergétique, celle que le travail du technique aura transformé en autonomie absolue au sens où les sources de l'énergie ne seront plus compromises dans l'aliénation humaine mais techniquement réinstaurée comme les fontaines miraculeuses des contes de fées.
P A R O L E S
Nous ignorons l'histoire des hommes nomades. Nous avons certes réussi à repérer ici et là leurs itinéraires, leurs courants de circulation et à déterminer grossièrement ce qu'ils faisaient. Mais nous n'avons pas de représentation de l'évolution de cette période et nous n'en connaissons ni les grands moments ni les crises profondes qui ont abouti à de nouveaux choix. En revanche, une telle connaissance nous est donnée pour l'autre période humaine, celle où l'homme a tenté de construire le monde dans la stabilité des horizons fixes, dans les paysages. Un paysage c'est littéralement la transformation de l'horizon en pays, pays comprenant en son sein le sens de l'habiter : un horizon inhabité ne peut pas être un paysage, car il n'est pas paysé. Payser le monde est donc cette vaste opération entreprise par l'homme au néolithique, une opération dont le sens dépasse radicalement le marquage territorial des animaux par son caractère de permanence. Elle fut tellement différente d'un réflexe naturel que cette entreprise a fini par prendre le nom de civilisation. Le plan initial n'était rien moins que de transformer le monde en une vaste cité appelée à devenir le lieu de la parole, le lieu où les hommes se regardent les uns les autres comme objet de leur intérêt et de leur souci, le lieu du partage.
Et ce plan a magnifiquement fonctionné. Il a donné lieu à un épanouissement sans pareil, une débauche de beauté a envahi les points du globe qui jouèrent le jeu, et ce qui en reste est devenu cela même qui nous meut aujourd'hui, seulement pour voir quelque chose, pour conserver la certitude qu'il existe vraiment quelque chose, quelque chose d'humain. Quand des milliers de touristes franchissent chaque jour les portes du Château de Versailles ou les portails des cathédrales, ils viennent se recueillir sur ce qu'ils sont. Ils viennent considérer avec émotion le point atteint par la volonté unifiée des hommes dans cette colonisation spirituelle de la réalité. Ils constatent avec effarement que les pierres de Borobudur ou d'Angkor-Vat sont taillées exactement de la même manière que celles de la cathédrale de Strasbourg ou des pyramides mayas. Ainsi peuvent-ils se rassurer sur l'universalité des choses, c'est à dire sur l'identité de l'être humain partout et toujours. Sans doute la période sédentaire qui s'achève a-t-elle connu des moments de plénitude tels que nous pouvons à peine l'imaginer. Le romantisme n'a pas été un accident ou une maladie séculaire : d'un côté il a été la manifestation du bonheur de l'Europe arrivée à son acmé d'un monde paysé. Hölderlin est celui qui a su dire cette conscience d'une nouvelle inscription de l'homme dans ses forêts, ses vallées et ses villes. D'un autre côté, le romantisme est aussi et surtout le moment du sérieux de la vérité, la révolte de quelques philosophes et poètes comme les frères Schlegel ou Goethe contre la langue de bois héritée des falbalas du Dix-Huitième siècle féodal allemand si décalé par rapport à la Raison française, à ce que Marx appelait le chant du coq gaulois.
Mais ce monde a été détruit de fond en comble et rien ne le fera plus exister naturellement ou artificiellement. Tout au plus pourra-t-il entrer dans le virtuel de la culture exactement comme tous les événements qui ont jalonné notre histoire et qui en ont fait la trame culturelle. Cette destruction n'avait rien d'accidentel, elle était programmée par le choc prévisible entre la technique et la mentalité paysée qui avait atteint son plus haut point. Ernst Jünger a eu raison sur ce point, il était nécessaire que le monde paysé disparaisse sous ce qu'il appelle le "chantier permanent". Mais ce chantier n'est pas une structure vide de plus qui doit structurer la nouvelle réalité, mais seulement le symptôme du retour du mouvement de l'errance spirituelle. Car on avait oublié que l'errance nomade allait de pair avec une errance spirituelle, était la même chose, et que l'aventure de la civilisation n'aura été qu'une gigantesque mise en ordre, la création d'un alphabet de l'âme tel qu'il ne pouvait pas s'installer en l'homme de la course. Le danger de la compulsion existe bien réellement aujourd'hui, compulsion de répétition du dix-neuvième siècle, perceptible dans les attitudes épistémologiques positivistes qui s'imposent dans tous les secteurs. Et donc le danger de la répétition d'une nouvelle autodestruction, d'un nouvel autodafé inutile. Pourtant certains symptômes indiquent que le projet de la guerre en tant que telle n'est plus possible. En constatant en son temps que ni la guerre ni la paix n'étaient plus possibles, Heidegger prenait conscience de cette volte de l'histoire où la violence quittait les grandes voies de circulation pour les sentiers qui ne vont nulle part. Le terrorisme et les guerres civiles indiquent le retour d'une violence diffuse, aussi diffuse que celle à laquelle avaient affaire les nomades. L'ordre nomade reprend ses droits, et si cet événement est bien perçu ici et là par quelques hommes attentifs, il n'est pas encore parvenu au stade d'une idéologie consciente et n'irrigue donc pas encore l'action humaine comme il le devrait. La tâche présente réside principalement dans l'ouverture de nouvelles routes, l'assouplissement des conditions paysées de la vie humaine et la libération d'une nouvelle aventure updatée, comme on dit en informatique, aux acquis de l'histoire de l'homme-citoyen.
L'HOMME DEMAIN
Rien de plus vain que de vouloir créer la fiction d'un homme futur, de dessiner un profil qui pourrait représenter les nouvelles formes d'être de l'être qui vient de traverser quelques millénaires sous la dénomination d'homme. Les grands historiens ont une tendance naturelle à penser l'homme dans une indifférence à peine écornée par quelques analyses fines de type freudien. C'est la mesure qu'il est, en vérité, quasi-impossible à dépasser. Pourtant, tout ce poème historique a tenté de montrer les nouvelles possibilités de symbolisation sans lesquelles l'animal symbolique qu'est l'homme court le risque de rentrer dans l'ordre scientifique ou gnoséologique ou de périr dans l'anarchie de la jouissance sans bornes. Il n'est d'ailleurs pas sûr que ces deux formes d'avenir ne soient pas fortement liées. On peut déjà déceler dans les premières tendances de la pratique d'Internet ce double courant de l'exactitude et de l'hédonisme, de l'héroïsme et du désespoir. L'univers entrevu dans la parenthèse nazie est bien cette totalité faustienne où la science se retrouve entièrement au service de l'instinct de mort, moment du paradoxe ultime où entropie et négentropie se confondent dans une même pulsion. Il faudra un jour méditer sur la nature des forces symboliques qui ont permis à toute une partie des hommes de s'opposer à l'avènement de cet univers dont le modèle est loin d'avoir été abandonné longtemps encore après que les canons se soient tus.
Alors en quoi nos quelques pauvres concepts, au demeurant déjà longuement travaillés par d'autres philosophes, peuvent-ils apporter de nouvelles énergies de symbolisation, et comment pourrait-on alors décrire ce à quoi peut rêver, au mieux, l'homme d'aujourd'hui de son réel de demain. Nomadisme et sédentarisme, en fait n'existent pas. Il n'existe rien qui ressemble à une doctrine nomade ou son contraire, et c'est précisément cette doctrine manquante que nous avons essayé de tracer, à partir de ses propres traces déjà inscrites entre les lignes de notre histoire et de notre manière de la symboliser. Mais quel est l'intérêt de la présentation d'une nouvelle dichotomie et d'une nouvelle dialectique dont on voudra comme ailleurs façonner et vendre la résolution réconciliante sous forme de nouveaux dogmes ?
L'intérêt est précisément qu'il ne peut s'agir de dogmes, que le problème est précisément que toute dogmatique est morte et qu'il fallait trouver à faire sans, pour arriver quand même à la symbolisation du réel. Car le dogme est lié à l'autorité, il figure de manière violente le monarchique qui divise les hommes en classes et en castes. Le comble du tragique n'est pas que l'homme soir soumis aux séquelles du meurtre primitif du Père, mais que cette vérité elle-même ne soit rien d'autre qu'un dogme, c'est à dire un symbole de l'inéluctable nécessité de la sujétion. Partout où ce symbole agit encore, le réel tient, mais il ne fait que tenir et l'humanité se trouve précisément dans cette phase où tout ne fait plus que tenir, alors que les chaînes, les cordes et les ficèles qui assemblent encore le tout sont au bout de leur usure, où la figure du Maître est tellement ridée qu'elle prend le visage de Frankenstein. Là encore les Juifs nous indiquent l'autre possibilité, le traitement adogmatique du réel, son herméneutique nomadique, dans l'espace et dans le temps. Le secret de la résistance millénaire du peuple de Moïse est celui d'avoir toujours su contourner la tentation du dogme au profit du commentaire renouvelé du Texte aléatoire, déjà commentaire de commentaires. Pendant ce temps, le monde chrétien coulait ses dogmes dans le plomb des balles et l'acier des canons, parce que les frontières faisaient tourner les vérités en mensonges et les mensonges en vérités. Le peuple juif forme, en lui-même déjà et depuis longtemps, la seule société sans classes qui ait jamais existé, malgré la distribution tribale de certaines fonctions et de certains privilèges.
Derrière l'image rassurante de l'économie triomphante se dissimulent évidemment les véritables images du monde, les formes cruelles des relations symboliques monarchiques, de ce qui constitue en fait les restes de la tyrannie du père primitif, celui que les Juifs ont prudemment relégué dans un non-lieu intouchable avec toute sa méchanceté au lieu de faire semblant de lui faire la peau. Le nomade et le nomadisme n'ont jamais été pour l'homme une manière aléatoire ou " naturelle " d'exister, ils ont été des choix conscients et volontaires pour régler la question du Père : pas de Patrie, pas de Père, pas de Père, pas de Patrie, voilà tout le secret qui se perdra sous les fondations des Babylone de notre époque qui s'achève, si elle le veut. Ces Babylone n'ont pas manqué, d'ailleurs, de refaire surgir la question qui a dû précéder le choix de la course nomade, c'est bien l'urbanisme capitaliste qui a entamé le plus vaste et le plus violent comput de la question de l'égalité et de la justice, ces deux valeurs se sont frayé un chemin à travers leur déni pratique pour devenir ou redevenir les moteurs des nouveaux changements. Cette fois dans leur forme mathématique, c'est à dire dans leur forme transcendantale symbolique où il n'est plus possible d'en nier la pertinence.
|
|
TABLE DES MATIERES
1 - NEOLITHIQUE : TERMINUS
Genèse
Caïn et Abel
Herméneutique biblique et culture orale
2 - LE STOP AND GO OCCIDENTAL
Athènes et Rome
3 - LES BRAS MORTS DU NOMADISME
Territoire et monarchie absolue
Les empires ou la joie retrouvée
L'aventure américaine
L'aventure coloniale
4 - LA VRAIE CRISE DU MONDE SEDENTAIRE
L'Europe étouffée
Rimbaud : LA CASSURE
La réponse militaire : les guerres de néantisation
La naissance de la Barbarie
La réponse économique : les illusions du développement
La nouvelle asphyxie de l'Europe
5 - NOMADISME : LE RETOUR
L'afflux nomade
La mondialisation marchande
Internet ou l'esprit nomade
Le sens caché du réseau
6 - PHILOSOPHIE DE LA MUTATION
Nécessité et contingence
Universalité et Singularité
Habiter et Etre
Le réseau - racine
Le réseau - fleur
PAROLES
L'HOMME DEMAIN
|
|
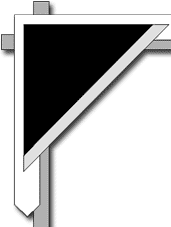



![]()
![]()
![]()
![]()
![]()