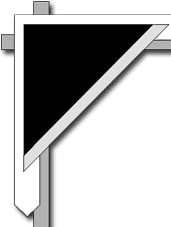
|

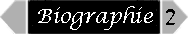
LE TEMPS DES CERISES
Mes déplacements à Paris sont devenus de vrais calvaires. La névrose d’angoisse dont j’ai hérité au Val de Grâce m’a rendu totalement claustrophobe et le métro est une épreuve limite. Je me rendrai compte quelques mois plus tard que cette phobie s’accompagne d’un vertige dont je n’avais jamais souffert auparavant, comme quoi la psyché est un objet comme un autre, fragile et soumis aux mêmes aléas que le corps le plus palpable. Cette infirmité mettra des années à s’estomper sinon disparaître complètement et le Valium deviendra aussi nécessaire à ma vie que l’eau ou l’air. Lorsque vient l’heure de dormir mes cheveux se hérissent de peur ; le fantasme de la solitude sidérale qui m’avait explosé à la figure dans ma chambre d’hôpital m’envahit jusqu’à ce que le médicament fasse son effet. Etrange angoisse, toute intellectuelle et absolument rationnelle : ni hallucination, ni monstruosités ni phobie, seulement une espèce du savoir, le se-savoir seul dans l’univers, mais à un degré que je n’avais jamais connu, encore qu’il vaudrait mieux écrire senti. La crise commençait toujours de la même manière, je me sens projeté à l’autre extrémité de l’univers, au-dessus ou plutôt au cœur d’un vide sans limite qui pourtant semble à chaque fois s’élargir et me rapprocher d’un bord mortel, celui de la folie. Mon angoisse était devenue la peur panique de devenir fou, de perdre tout repère de sens dans la réalité. Etrange sensation, mais mon orgueil en prenait un coup à chaque fois, le Valium se présentant alors comme le compromis qui me permettait de survivre à la crise. En fait, ma socialité était en train de se dissoudre sans que je ne sache comment gérer ce phénomène. Avec le temps l’intensité de l’angoisse diminuera considérablement jusqu’à disparaître pour parfois ressurgir par surprise, mais comment décrire la souffrance liée à tout cela ? Je ne peux que répéter cette phrase qui me vint automatiquement à l’esprit au pire instant de la première crise : « heureusement, il reste la drogue ». J’y voyais mon salut, c’est à dire le seul moyen d’éviter le suicide, l’imitation de papa, il allait falloir que je me procure des sources de ces substances sans pour autant aliéner ma liberté, ce qui allait être une condition sine qua non de ma relation aux substances dites toxiques.
J’étais d’autant plus heureux de quitter la capitale pour rentrer dans mon Mulhouse natal, cette étrange ville qui me poursuivra encore longtemps. Ce retour ressemblait à un réveil en gueule de bois, comme si les cinq années que je venais de passer n’avaient été qu’une vaste cuite d’où ma conscience n’émergeait que de temps en temps non pas pour cesser de boire mais pour changer de boisson. Je n’ai aucun souvenir du voyage en train qui m’a ramené en Alsace, ce moyen de transport était devenu en quelque sorte ma résidence secondaire et je ne faisais plus attention, je n’éprouvais plus ce plaisir inouï qui m’avait saisi lors de mon premier grand départ pour l’inconnu. L’inconnu, oui, c’est de l’inconnu que je revenais et j’allais rentrer dans le connu, dans une pratique de l’existence que j’avais oublié et dont j’avais oublié tout ce qui m’en avait chassé et le peu qui la rendait vivable. La seule perspective qui faisait passerelle entre l’inconnu et le déjà-existé étaient mes copains que j’allais retrouver, même Jean m’avait annoncé son retour de Saïda et nous allions donc nous retrouver à Mulhouse comme dans les années cinquante, aux prises avec le même ennui et la même absence d’avenir. Il allait falloir faire preuve d’imagination pour survivre à cette chute vertigineuse entre l’aventure quotidienne et l’horizontale immobilité de l’existence sédentaire, légale et de surcroît sans doute laborieuse, entachée de travail, cette activité que nous avions condamnée au même titre que la militaire. C’est curieux, direz-vous, car nous avions passé les dernières années à travailler sans nous en rendre compte, comme si ce que nous avions fait là-bas en Algérie ou moi en Suisse et en Belgique, ça ne comptait pas. Il y avait, cependant, quelque raison de ne pas désespérer. L’espoir était venu avec les dix premiers numéros de l’IS, l’Internationale Situationniste, une revue qui nous avait tous fascinés et dont nous attendions ce qu’on appelle ironiquement les « lendemains qui chantent ! ». Les mots de Debord, Vaneigheim, Jorn, Constant, et de tous ceux qui parfois n’ont écrit que quelques lignes dans les pages de L’IS, nous enchantent. Ils tranchent brutalement avec le stalinisme dont nous avions vécu les conséquences sur le terrain, parlent enfin de la vie quotidienne sans théoriser comme le faisait alors Henry Lefebvre du haut de sa chaire strasbourgeoise, ouvrent des vannes soudées depuis des millénaires par les idéologies, par l’idéologie en tant que telle. Et puis nos amis les plus proches, Théo Frey et sa sœur Edith y publient alors leurs premiers textes. Bref, la lutte peut continuer au moment où la France commence enfin à se taire sur la scène mondiale avec la fin de ses guerres coloniales et s’endort jusqu’au fameux éditorial de Viansson-Ponté dans le Monde qui se voit contraint de diagnostiquer : « La France s’ennuie ».
Novembre 1965. Mulhouse dort comme d’habitude. Les cheminées d’usine se sont faites rares et les bulldozers défoncent déjà toute la zone Sud, appelée à devenir l’espace universitaire et la couronne d’Habitations à Loyers Modérés, les futurs citées « à problème ». Je prends possession de l’appartement que maman met à ma disposition, un quatre-pièce style résidence dans un immeuble de quatre étages à Riedisheim qui vient d’être achevé. Madame Hoeffler, notre ancienne bonne (ce mot me fait toujours un effet irritant lorsque je me vois contraint de m’en servir, mais tel était le cas et je ne vois pas comment ni pourquoi je travestirais les faits) m’attendait sur le pas de la porte avec les clés et les instructions de maman pendant que je découvre le cadre existentiel que ma mère se préparait pour sa retraite. Je retrouve notamment les meubles qui avaient disparus dix ans plus tôt, stockés dans un garde-meuble largement pillé par mon frère aîné toujours à court d’argent car à court d’alcool. Mais les meubles essentiels sont là : le bureau Empire de papa avec son fauteuil restaurés, des sièges Voltaire que ma mère à achetés sans doute par esprit d’imitation de sa sœur qui passait son temps à meubler ses innombrables possessions et à y investir tout l’argent qu’on ne voulait pas déclarer au fisc. Pour le reste, ma mère a fait simple et confortable, rien à dire. Je découvre aussi les armoires à trésor que mon père avait ramené de Paris en 1939, deux sortes de coffres-forts en acier de la marque Kraft, la dernière entreprise où papa tenait la fonction de directeur commercial. L’un était large et impressionnant, de couleur rouge et consacré aux papiers importants et aux objets précieux, l’autre beaucoup moins prestigieux, relégué dans ce qui devait devenir ma chambre et qui servait dans mon enfance à contenir tous les objets qui se rapportent à la santé, pharmacie, objets de contention corporelle (corsets etc..), et puis des « choses » qui me faisaient rêver car il était par trop évident qu’elles se rapportaient au comportement sexuel de mes parents. Ne riez pas, mais je n’oublierai jamais ces poires en caoutchouc qui ont servi de contraceptif approximatif jusqu’à la légalisation de la pilule et auxquelles, sans doute , j’avais échappé par quelque ruse de spermatozoïde déjà doué pour tromper l’ennemi. Madame Hoeffler me répète à l’envi que la chambre de ma mère était zone interdite, ainsi que ce qui passait pour le bureau. Pour la première fois de ma vie j’ai accès à la télévision dont je ne ferai pas grand usage, de toute façon mon passage dans ce petit nid pour fin de vie ne durera pas longtemps, et voici pourquoi.
A peine arrivé à Mulhouse, je reprends contact avec les « copains ». Jean doit arriver dans la semaine, retour de Saïda, en compagnie de Richard ; nous allons former un trio surréaliste pendant quelques mois agités qui vont marquer le début de la décomposition des grandes amitiés de l’adolescence. Or Jean ne peut pas envisager d’aller vivre chez ses parents, avec lesquels il n’entretient plus que des relations de strict nécessité (vous allez me demander ce que ça veut dire, mais je n’en sais rien moi-même sinon que nous sommes allés ensemble une fois dans la villa familiale, rendre une visite sans objet, mais qui m’a permis de faire la connaissance de ce couple et de leurs deux filles qui semblaient considérer leur demi-frère comme un parfait étranger). Il était donc à la rue, et il m’a paru tout naturel qu’il vienne partager le confort que m’avait offert maman, d’autant qu’il y avait assez de place, il n’était pas question que je prenne au sérieux les tabous imposés par ma mère. Au demeurant cette question ne se posait même pas et j’associais intimement l’auteur de mes jours à ce geste d’hospitalité toute naturelle, hospitalité qu’il avait été le premier à m’offrir en Algérie lorsque je me suis retrouvé dans le Sud aux lendemains d’une période. Las, en quelques semaines la nouvelle est arrivé à Abidjan, relayée par la bonne qui venait faire le ménage (en réalité m’espionner pour le compte de ma famille) et Maria, la bonne Maria n’a pas hésité une seconde à jeter son intraitable rejeton à la rue une bonne fois pour toutes. Mais n’allons pas si vite. A Strasbourg s’étaient installés les nouveaux situationnistes, formant un groupe qui allait préparer des événements dont le retentissement serait d’amblée nationale et internationale. Théo Frey et sa sœur Edith, Jean Garnaud et Mustapha Khayati formait le noyau dur (c’est à dire reconnu et adoubé en quelque sorte par Debord) autour duquel gravitait une constellation de jeunes étudiants prêts à passer à l’action sur leurs ordres. Le fait d’appartenir à l’IS conférait à mes amis, semblait-il, un pouvoir extraordinaire auprès de jeunes candidats comme Vayr-Piova ou Schneider, des éléments qui feront docilement ce qu’on leur dira de faire jusqu’au moment où ils seront eux-mêmes en mesure de trahir ceux qui n’étaient que des représentants vite rejetés par le Pape Guy-Ernest. A mon arrivée à Mulhouse, je reçois un message faisant état de l’impatience de Guy Debord de faire ma connaissance. Ce devait être assez vrai, car Théo m’avait fait une publicité d’enfer, et par ailleurs l’IS n’avait pas de contact avec les milieux de résistants à la guerre d’Algérie, résistance qu’elle prônait depuis le premier numéro de la revue. Comme j’attendais le retour de Jean, je prends rendez-vous à Paris pour la semaine suivante. Avant de prendre la train nous arrive encore une mauvaise nouvelle : la Poste a égaré un énorme coffre de Jean, coffre qui contenait l’essentiel des œuvres artistiques que nous avions bricolées, des enregistrements poétiques et des œuvres plastiques de Jean qui faisait preuve de génie dans tout ce qu’il touchait. A cela s’ajoutaient les photographies qui vont nous manquer pour l’éternité. Jean n’obtiendra même pas de dédommagement, résultat de son mépris pour les fonctions sécuritaires des assurances et confiance naïve dans le service public dont le pourrissement avait depuis longtemps commencé. Bref, c’est le cœur lourd que je monte dans l’interminable semi-omnibus qui relie Mulhouse à Paris. Emu quand-même par la perspective de rencontrer l’auteur des textes qui m’avaient tellement frappé et, je l’avoue, réellement enthousiasmé. La douche n’en sera que plus froide.
|

|
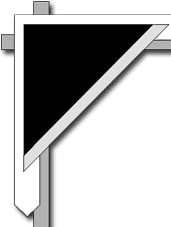

![]()