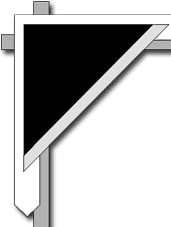
|

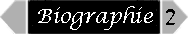
FRERE JACQUES
Il habitait rue Saint Jacques. Mais il fallait dire rue Jacques, ou bien, pour la petite ruelle perpendiculaire, celle où se trouve la librairie de la Vieille Taupe, la rue des Fossés Jacques. C'est dire que dans l'Histoire que reconnaît Guy Debord il n'existe pas de Saints, mais plutôt seulement des Jacques, les laboureurs et les vignerons de l'Europe du 16ème siècle. Vingt-neuf ans après, ma première rencontre avec lui me laisse rêveur. Elle me paraît illustrer mieux que toutes les anecdotes qui pourraient suivre, le fossé qui sépare, sans doute depuis des siècles, deux catégories de citoyens aussi attachée l'une que l'autre à la République Révolutionnaire. Comme Marat et St Just , ou comme Lafayette et Robespierre, ils ne se rencontrent que le temps d'une fête, quand ils arrivent à se rencontrer.
Décembre 1965, je sirote un Vichy-fraise au café du Luxembourg, j'ai rendez-vous avec Debord à 16 heures. Vers 17 heures je commence à m'inquiéter, et comme d'habitude, l'impatience m'ouvre l'appétit, je commande des tripes mode. A la troisième fourchette surgit Théo Frey, vieux copain de Lycée, membre de l'Internationale Situationniste depuis quelques mois et donc le go-between de cette rencontre. Il s'excuse pour Guy, me laisse une adresse, 93 rue Soufflot, on m'attend dès la fin de mes tripes. Dix minutes plus tard je remonte la rue qui mène au Panthéon, contourne deux fois le monument, pas de 93 rue Soufflot. Trois quart d'heure plus tard, Debord déboule furax au bistrot où je retourne me réfugier, on m'attend rue Jacques, mes explications ne semblent pas le convaincre. La glace ne se brisera jamais. Pourtant mon ami l'intermédiaire m'avait assuré de l'enthousiasme de Debord à me rencontrer, moi, l'ami de son ami et résistant à la guerre d'Algérie. Voire de l'admettre au sein de l'Internationale. Au total, j'ai été situationniste pendant environ quatre heures trois-quarts, mais c’était bien suffisant. Le soir nous étions attendus chez la sœur de ma future épouse, Hélène Dagens et son mari, savant physicien et personnage étonnamment sympathique au milieu d’un groupe de gens à la mine sérieuse et compassée. L’alcool détend quelque peu l’atmosphère et à la nuit tombée, nous décidons d’aller dériver entre la Place d'Italie et le Marais, où vit Rieser et où je rencontre Vaneigem joyeusement surpris de me revoir et qui me donne un exemplaire manuscrit de son premier livre qui aura tant de succès « Manuel à l’intention des jeunes générations ». Mais en chemin je commets un impair, semble-t-il. Rendu gai par l’alcool j’avise une 2CV stationnée près du boulevard St Michel et propose à mes camarades de les faire avancer sur quatre roues, le principe de la dérive n’interdit rien de ce genre. Mais lorsque Debord se rend compte que j’arrive à ouvrir sans encombre le véhicule et à le mettre en marche, petite compétence qui me reste de ma « formation » de clandestin, Debord se fâche littéralement, sans raison. Je renonce donc à la 2CV et nous continuons à pied. J’observe Guy Ernest à la dérobée, je ne sais plus du tout à qui j'ai affaire. Pourtant, j'avais tout lu. Notre relation était morte-née. Elle aurait pu renaître pendant Mai68, sur sa demande, mais pour moi, nous le verrons, il était trop tard, j’étais vacciné contre les deux pires choses au monde, l’hypocrisie et la bêtise. Je me suis longtemps interrogé sur cet incident et sur l’attitude de Debord ce jour-là. Ce dont je suis sûr, c’est que c’est l’incident de la 2CV qui a déclenché quelque chose d’irréversible dans son jugement à mon égard. Cela tombait d’autant plus mal que je déteste moi-même tout ce qui touche au vol et aux délits de ce genre, mais il ne s’agissait évidemment pas d’un vol, mais d’une volte de la dérive qui a déplu à celui qui devenait ainsi le Pape de la soirée. Je me pose aussi des questions sur la possibilité des dérives à plusieurs, mais la vérité est qu’il ne s’agissait pas d’une véritable dérive, mais d’un simple mode de déplacement choisi par le Pape lui-même avec notre accord bien entendu. Une autre conclusion qui m’a frappé sur le champ concernait le caractère autoritaire et capricieux de Debord. L’échec de la rencontre elle-même, c’est à dire le malentendu sur l’adresse qu’il me donna au Café du Luxembourg, fait partie d’une dimension structurelle de mon destin : les actes manqués des autres me frappent avec une régularité étonnante, comme si Autrui, comme dirait Lévinas, ne me « voyait » pas, ou refusait de me regarder, ce qui aboutit immanquablement à l’échec des rencontres. Il y a là peut-être un peu de mythomanie de ma part, mais je suis trop rationaliste, c’est à dire trop formé à une distanciation spontanée de tout ce qui m’arrive pour me prendre pour Dieu. Cela dit, l’incident de la dérive n’eut pas de suite immédiate, et il ne fut pas question d’exclusion, d’autant que ma relation avec Raoul Vaneigem s’annonçait sous les meilleurs auspices. A cette époque il campait chez Rieser qui survécu longtemps aux purges successives, mais je dois avouer qu’il ne me fit aucune impression, plutôt celle d’un étudiant fêtard sans grand relief. Autant mon empathie pour Raoul avait été immédiate à Bruxelles lors de notre première rencontre, autant Rieser me laissa de glace, comme ce fut le cas de Garnaud dans le groupe des « menteurs » de Strasbourg. Enfin, ces remarques sont de peu d’importance tant il est vrai que le Deus ex machina de l’IS restait Guy Ernest. A distance et bien après son suicide, j’ai cherché ce que la rumeur en avait fait. Dans les années quatre-vingt dix, le caprice médiatique parisien ne cessait de tourner autour du mythe situationniste.
Coup d'oeil dans le Quid 1994 à Guy Debord : surprise ! 281a, quatre lignes avant Debray Régis. 281a : je cherche et trouve sous la rubrique Quelques Mouvements Littéraires, sous-rubrique XXème siècle et Situationnisme, le texte suivant : "Groupe formé en 1957, animé par Guy-Ernest Debord (séparé en 1952 du lettrisme d'Isidore Isou, publie en 1967 La Société du Spectacle) ; fonde l'Internationale Situationniste (12 numéros entre 1958-69) ; critique la société de consommation, dénonce la dictature de l'image, marque les événements de mai 1968".
Du coup, je continue pour Régis, la logique de l’alphabet fait parfois des apparentements étonnants. Là il y a plus de choses, 297b et 932c. Dans l'ordre : 297b . Il a droit à la rubrique Auteurs nés après 1900, je lis :" Debray Régis (J. R) (1941) l'Indésirable, La neige brûle (F 1977), Le Scribe (1980), la Puissance et les rêves, les Empires contre l'Europe, l'Europe des masques (1987), Que vive la République (1988), Tous Azimuts (1989), A demain De Gaulle 1990, Vie et mort de l'image (1992). Avant de continuer, une remarque : Debord a bien plus de titres à son actif que celui cité par le Quid, cela ne semble pas lui conférer la qualité d'auteur. Poursuivons, 932c : Sous la rubrique Bolivie : "1967 le Français Régis Debray arrêté, 27-4 condamné à 30 ans de prison (libéré 23-12-70), l'Argentin Ernesto Guevara (dit Che) exécuté 9-10".
Au total une douzaine de lignes pour deux personnages qui me paraissent résumer tout ce que j'ai rencontré, sur mon chemin, de ce qui reste, dans notre siècle, de la grande histoire Sociale française, avant l'effondrement tragi-comique du socialisme de gouvernement. Debord et Debray, Jacques Roux (1) et La Fayette, l'histoire de France bégaie comme toutes les autres, sur le ton mineur ou en farce comme disait Marx. Or ce bégaiement là, ces deux existences, dont une seule s’est achevée, ces deux personnages condensent, un peu comme les activistes de la Bande à Baader le Bundschuh, le droit fil de l'épée révolutionnaire française. Apparemment bien ébréchée.
Pourtant, Guy Debord me paraît être un Frondeur avant d'être un sans-culotte. Il reste toujours plus proche des ennemis de Mazarin que de ceux de la noblesse de Coblence, quoiqu'il en dise lui-même. Mais ce que Debord avait lui-même compris et qui me paraît absolument vrai, c’est que la Fronde est loin d'être une farce, un simple épisode de la naissance de l'absolutisme ou de l’écrasement des derniers obstacles à l’unification politique de la France, comme le dit le livre d'école. On pourrait même dire, pour faire vite et audacieux, que la Fronde est l'échec anticipé de la Révolution, alors que la Révolution est la réussite définitive de l'absolutisme. Ruse de la Raison, ou de l'Histoire, encaissée au passage. En résumé, Richelieu et Mazarin dépècent la France selon les pointillés de la Res Extensa cartésienne. Cette remarque n’a strictement rien à voir avec les thèses à la mode et à la Furet sur le transfert du totalitarisme ludovicien dans l’esprit de la Révolution Française. Nous y reviendrons forcément. Pour l’instant j’essaye d’analyser psycho-géographiquement et historiquement la véritable nature de l’absolutisme, concept qui se joue dans notre présent prétendu démocratique aussi durement et avec les mêmes conséquences qu’à l’époque de sa naissance.
L'absolutisme, ce n'est pas d'abord la toute-puissance d'un seul homme sur tout un territoire, c'est plutôt la toute-puissance du territoire sur l'essence même de la souveraineté. Pour les ministres du siècle des Modernes, il faut d'abord détruire le territoire comme multiplicité vivante, aseptiser partes extra partes le fameux pré-carré. Les frondeurs, de leur côté ne cherchent pas, avant tout, à défendre leurs privilèges. La meilleure preuve en est que le Roi Louis, pour en finir avec ce désordre soixante-huitard, rachète cette noblesse remuante à coups de nouveaux privilèges, chaque siècle a le Grenelle qu'il peut. En réalité, la noblesse frondeuse s'accrochait à un vieux combat, entamé deux siècles plus tôt par les grands seigneurs contre Louis XI, grand initiateur de l'absolutisme. Charles Le Téméraire, le duc François II de Bretagne surtout, seront des adversaires bien plus coriaces que les La Rochefoucault ou les Conti. Pour ces vrais seigneurs féodaux, la royauté était une abstraction romaine, un simple titre sans portefeuille, une valeur spirituelle accordée par le Pape. Tant que le Roi s'en tenait à la gloire qu'il tirait des Saintes Huiles, tout restait dans l'ordre de l'histoire. Mais à partir du moment où les huiles commencèrent à s'étendre territorialement, la nature de la royauté changeait du tout au tout. Les règles du jeu n'étaient plus respectées. Les territoires perdaient les uns après les autres (et il y aurait à faire toute une histoire de la grande poussée sudiste protestante qui est à l’origine du succès des Bourbon et qui pourrait s’expliquer par l’homogénéité originelle du Sud visigoth liée aux massacres des Cathares : le sang éponge les différences spirituelles, les singularités ontologiques) leur individualité psycho-géographique, toujours déterminée par les individualités souveraines.
Pendant la Fronde les périodes alternent : droit des Edits royaux , Lettres de cachets et Remontrances des Parlements d'un côté, droit du jeu de l'autre. Le droit du jeu est le retour à la case départ des acquis politiques, le chacun pour soi des deux camps. On peut alors s'affronter, s'entre tuer librement, sans modifier d'une molécule la donne politique, affective, morale, en un mot sans laisser de traces dont il faudrait plus tard nourrir la mémoire. Seules comptent les victoires et les défaites sur le terrain, comme au bon vieux temps. Tel membre de la Fronde peut, le même jour, se battre en duel avec un officier proche de Mazarin, le tuer et dîner avec le Cardinal comme si de rien n'était. L'interdiction des duels va d'ailleurs de pair avec la prise en main absolutiste seulement parce que les duels maintiennent, en permanence une sorte de droit du jeu entre seigneurs. Le duel est un symbole intolérable pour la monarchie absolutiste, pire, un danger dont il faut débarrasser les douves du Palais Royal. Au demeurant, aucun code d'honneur, aucune règle de jeu, aucun droit ne met de bornes à la haine, parfois féroce du monarque. Avec Louis, les moeurs, la vrai coutume de la noblesse se transforme en étiquette. Ceux qui osent affronter cette première grande "médiatisation" de la vie, le paient de mort ou de Bastille. Les destins de Gilles de Rais (ancêtre réel du cardinal de Retz) ou du Marquis de Sade ne sont que le reflet des excès dont le pouvoir central se sert pour étendre sa juridiction et l’universaliser. Bref, la Fronde est une Révolution qui oppose les petits producteurs de souveraineté locaux aux Monarchies multinationales qui tissent leur réseau par alliances matrimoniales, contraignant, au passage, les peuples et les féodaux à contribuer à l'expansion de leur domaine en finançant les guerres de succession. L'économique joue là son rôle d'explosif : l'humiliation ne vient pas du grignotage militaire du territoire par les forces royales mais de l'usage mercantile de la souveraineté. La monnaie remplace l'épée. La souveraineté fondée sur la force et le droit du jeu ne peut donc pas cohabiter avec un régime qui tire sa force de l'argent. Au début de l'âge féodal, les trésors royaux ou seigneuriaux ont une fonction de représentation, il ne s'agit pas de valeurs d'échange, le mercantilisme est la véritable pierre philosophale des monarchies. Peut-être cet éclairage permet-il une certaine réconciliation avec la théorie des structures marxiennes. Les monarchies européennes, en effet, vivent et se développent en même temps que le capitalisme, parfois à l'avant-garde, comme les Italiens ou les Hollandais, parfois elles sont les lanternes rouges comme les Habsbourg ou les rois de Bavière . Richelieu, Mazarin, Turgot et consort comprennent la valeur-or du territoire à peu près au milieu de ce développement historique, une position qui leur donne un énorme avantage tactique par la place médiane qu'occupe la France. Au 17ème siècle, Paris peut jouer contre les capitalistes anglais et hollandais, puis inverser ses alliances pour se retourner contre les demeurés espagnols ou autrichiens. Versailles va jouer de toutes les cordes entre ces inégalités pour tirer son épingle du jeu et rafler la mise. Dont acte à la mort de Louis le quatorzième.
En fait, les droites françaises puisent leurs spécificités bien plus en arrière que ne le pense René Rémond. Nulle doute, par exemple, qu'un Philippe de Villiers agit et raisonne dans le droit fil des anciens petits seigneurs locaux. Son insolence antirépublicaine ne fait que cacher sa profonde haine pour toute monarchie centralisée. A l'inverse, ceux que l'on nomme les "bonapartistes", Seguin, Pasqua et autres, sont les héritiers directs de la Révolution triomphante, véritable conclusion du développement de l'absolutisme ; certes pas celle de la Montagne, ni même celle de la Gironde, mais celle du Directoire et du Consulat. Leur nationalisme sourcilleux puise autant dans le patriotisme dantonien que dans l'universalisme impérialiste de Bonaparte. Mieux, les droites et les gauches ont des racines bien plus profondes et plus mêlées qu'il n'y parait à travers une histoire qui se contente trop souvent du baptistère conventionnel et des problèmes de légitimité post-napoléoniens. A gauche, il existe bien ce sentier ignoré dont parle Walter Benjamin à propos de Brecht, une voie qui mènerait de Spartacus à Lénine en passant par le millénarisme européen et le théâtre de Shakespeare. Mais c'est trop schématique, la fin des idéologies ne tolère plus une analyse qui se contente de couper la société historique en deux, sur le modèle du maître et de l'esclave hégélien, se reproduisant linéairement selon la dialectique de production de la richesse. Non. Les idées révolutionnaires de 1789 sont consubstantielles à des luttes plus anciennes que celle du Tiers-Etat contre la Noblesse. De même, la diversité des droites ne s'explique que par cette opposition entre noblesse féodale et noblesse monarchique. Les historiens reconnaissent volontiers que c'est la noblesse qui a été le facteur social le plus actif dans l'éclatement de la grande Révolution. Talleyrand, Mirabeau ou Lafayette illustrent parfaitement ce qu'on prend pour un double jeu et qui n'était qu'un remake tardif de la Fronde. Ces gentlemen se trompaient d'époque, sauf peut-être Talleyrand qui, à l'instar de Retz, se contente de jouer son propre jeu non sans avoir très sincèrement désiré la chute de la monarchie.
François II de Bretagne, le cardinal de Retz, Talleyrand ou Jacques Roux, l'histoire de France façon Mallet-Isaac n'en fait pas grand cas. Cette Histoire-là est tirée à quatre épingles, intelligible par communication pédagogique. Elle ne peut pas faire problème. Où irait-on ? Il faut sché-ma-ti-ser, pour citoyenner correctement, c'est à dire, comme le suggérait Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques, alphabétiser pour faire de bons contribuables. Pareil pour notre actualité, une minute, une idée, dit mon rédac-chef.
Debord, il faut l'avoir connu, nouant et dénouant des fils invisibles, affectifs, surtout affectifs, mais aussi politiques et esthétiques. Parisien jusqu'à l'âme, Guy-Ernest est profondément internationaliste, cosmopolite. Comme Retz, aussi Italien que Mazarin, Debord ne connaît pas de frontières nationales, la seule frontière qu'il connaît s'appelle "pas de dialogue avec les cons". Le "groupe" qu'il fonde en 57 est une Internationale dont la majorité n'est pas française, mais belge, danoise, américaine, britannique et italienne. Quelques années, deux ou trois, avant mai 68, Guy Debord charge l'Internationale de Français, c'est le commencement de la fin, les Italiens ne sauveront pas l'une des plus belles frondes intellectuelles du siècle. Car Debord avait inventé la fronde spirituelle, l'art de tuer les faux-monnayeurs de la pensée, de miner la monarchie des faiseurs et des manipulateurs d'idées. Combien de vénérables caciques, d'Edgar Morin à Henri Lefèbvre, sont morts dans les articles et notules de la revue de l'Internationale Situationniste ? Comme Retz, mais à lui tout seul, Guy-Ernest bataillait alors contre la Cour à coups de libelles plus empoisonnés les uns que les autres. Une tactique unique dans les gauches françaises et dont seuls se servaient les De Bonald ou les Joseph de Maîstre pour mieux conjurer les idéaux démocratiques. Ah Guy, pourquoi l'I.S. n'a-t-elle pas continué cette tâche fondamentale, faire le vide de la connerie, il y en a pourtant, du travail, aujourd'hui plus que jamais !
Le "situationnisme" évidemment, n'existe pas. Le mot n'est qu'un avatar médiatique sans intérêt. Seuls existent des situationnistes. En 1957 ils proviennent, pour la plupart, des métiers artistiques. Cinéma, le premier et seul "métier" de Debord fut la mise en scène, architecture, peinture, le grand bailleur de fonds des années difficiles était Asger Jorn, poésie ou parfois seulement l'amitié, art suprême. On pourrait faire une filiation entre les surréalistes et les situationnistes, en passant par le mouvement artistique COBRA (Copenhague/Bruxelles/Amsterdam) auquel appartint Jorn entre autre et le mouvement lettriste plus parisien. Mais Debord renie férocement une telle filiation, il a une folle ambition, créer une armée d'archanges. Non pas des surdoués théoriques ou des fous de la Praxis, pas une nouvelle race d'éclaireurs du peuple ni une nouvelle avant-garde, il a, vous le concéderez facilement, déjà donné dans ce domaine. Ce dont rêve Guy, mais je dois écrire ceci au passé, c'est un groupe d'hommes entiers, cohérents disait-on dans l'entourage. Une cohérence morale, pas de corruption ni de trahison , une amitié fidèle mais non aveugle. L'intelligence était plus importante que la morale, à condition qu'elle fût révolutionnaire, c'est à dire sans compromis avec le "vieux monde".
Etre situationniste est donc difficile, en particulier lorsqu'on vit aux frontières du monde marchand. Car la cohérence doit être totale entre vie professionnelle et personnelle, entre activités quotidiennes et action "militante", si ce mot peut être utilisé ici. L'origine artistique du mouvement de Debord incline à la définition fausse, souvent retrouvée, selon laquelle le situationniste est un homme qui doit faire de sa vie un art. Cela est d'autant plus faux qu'un trait a été tiré non seulement par Debord lui-même sur l'Art en tant qu'Art, mais que dans la généalogie situationniste il y a un certain Dada dont les situationnistes ne renieront jamais rien, et moins que tout la destruction dadaïste de l'Art. Il faut trouver autre chose, et cette chose est une utopie humaniste, peut-être la toute dernière de ce siècle, l'idée que des "égaux", au sens de St Just, pouvaient se rencontrer. Mais des "égaux" déjà très inégaux, moralement impeccables, intellectuellement irréprochables, absolument cultivés ou au moins nantis d'un désir extraordinaire de culture. Et pour compliquer le tout il fallait des êtres autonomes en tout, capables de vivre isolés, décidés à rester en situation quoiqu'il arrive. Mais qu'est-ce donc qu'une situation ?
A bien y réfléchir, je ne l'ai jamais bien su et ne prétends pas le savoir. Pourtant, il y a des indications un peu partout, dans les textes, les conversations, les actions de Strasbourg en 66-67 et surtout la participation de Guy-Ernest à mai 68 à Paris. Une situation est le contraire d'un Dasein, d'une existence condamnée à la déréliction, au malheur de la conscience et aux tourments de la passion trahie. Passion est d'ailleurs le maître-mot de Raoul Vaneigem, le théoricien qui a en quelque sorte "habillé" la pensée irréductible de Debord. Pas toujours du meilleur goût, car la situation ne m'a jamais paru déterminée par le débridé des passions. Ex-auteur de roman porno et ex-nègre du Reader's Digest, Vaneigem brosse avec lyrisme la Praxis révolutionnaire, mais son libertarisme reste toujours un peu trop près du libertinage bourgeois. Plus précis et plus froid, un texte d'André Frankin de 1960 : la situation s'inscrit d'abord dans une "histoire sans temps morts". Sur fond d'une liberté due au communisme immédiat - pour les situationnistes la transition socialiste vers le communisme est superflue en regard du développement technique - l'individu doit retrouver le monde caché, celui des hasards planifiés par le hasard voulu. La réalité peut alors retrouver sa densité et son poids de subjectivité : il faut réinvestir le monde de cette subjectivité, le reconstruire pour des aventures individuelles et collectives permanentes. La "dérive", cette pratique chère aux premiers situationnistes et progressivement abandonnée comme pratique expérimentale, décrit mieux ce qui se cache derrière le concept de "situation". Dériver, c'est se livrer aux contenus psycho-géographiques du paysage, à ce qui, déjà, a été investi de manière situationniste dans l'urbanisme des vieilles villes. Le vieux Paris, Amsterdam, sont des lieux d'élection où les passions non encore neutralisées par la technique et le capitalisme ont dessiné des rues et des édifices en ce sens surréalistes, qu'ils ne s'inscrivent nulle part dans la rationalité objectiviste ou positiviste de la destruction technique du monde.
Peut-être encore plus précise dans ses indications, cette citation de Nietzsche du même article de Frankin : "Zarathoustra est heureux que la lutte des castes soit passée. Que le temps soit enfin venu d'une hiérarchie des individus. Sa haine pour le système démocratique de nivellement n'était qu'au premier plan . De fait, il est très heureux qu'on en soit là. Désormais, il pourra résoudre son problème". Le moment choisi dans la passion de Zarathoustra est historique. Dans ces années soixante, l'aristocratie de gauche se paye un peu d'illusions. Elle pense d'une manière un peu arrogante, c'était sa forme d'héroïsme, que la démocratie occidentale est établie. Or cet établissement n'est pas pensé comme but atteint, mais comme base de départ, comme affaiblissement définitif de la société en tant que système de dépendance réciproque : la démocratie n'a qu'une vertu historique pour les situationnistes, celle de libérer l'individu des castes et des communautés. Au fond, Debord et ses amis font leur l'analyse d'Ernst Jünger dans son Travailleur. Les castes aristocratiques et bourgeoises cessent rapidement de déterminer la société dans son ensemble, les hommes nouveaux, travailleurs ou Titans, entament une nouvelle histoire, celle du troisième millénaire. Seule différence, de taille, c'est que là où Jünger anéantit définitivement le sujet au profit des Titans, les situationnistes le rétablissent dans tous ses droits. Au fond, et c'est pourquoi la Fronde n'est jamais loin, Guy Debord rêve d'une nouvelle noblesse humaine, sans classes, mais avec les mêmes risques d'assomption des inégalités qu'à l'époque lointaine du droit du jeu. Autre maître-mot des situationnistes : le meneur de jeu. Le jeu est la seule dynamique qui peut remplacer la guerre d'une part, la concurrence économique de l'autre.
Le piège est diabolique car les axiomes sont bons. Mais le déroulement du passage au monde des joueurs ou des Titans ne suit pas le rythme de la planification des situationnistes. Les revues de l'I.S. se présentent très vite comme une rubrique nécrologique des situationnistes exclus. Les uns pour avoir accepté tel chantier d'architecture, les autres pour avoir craqué lors d'une dérive ou simplement pour avoir menti. Comme Jünger en 1933, Debord arrivait trop tôt et trop tard. Trop tôt parce que les pouvoirs bourgeois se sont condensés en une conjoncture internationale mortifère et stérilisante. Les situationnistes le crient, d'ailleurs, à chaque page, l'équilibre de la terreur Est-Ouest est devenu le Hic Rhodus Hic Salta des révolutionnaires. Ceux-ci doivent se déterminer à la fois contre la société bourgeoise démocratique et contre le stalinisme, ce que les situationnistes sont parmi les tout premiers à faire. Trop tard parce que la jeunesse française et européenne a également senti ce petit vent de liberté, elle a aussi repéré les faiblesses paralysantes de la démocratie des Droits de l'Homme. L'audace des étudiants de mai 68 s'explique par cette intuition qu'il suffisait encore d'un petit coup de pied pour faire tomber l'édifice. Mais il a seulement vacillé, et les situationnistes se sont perdus dans ce vacillement. La "situation" de 68, cette soudaine victoire sur la non-vie, sur le principe de survie régissant jusqu'alors la moindre parcelle de temps social, cette fête tourne la tête aux plus lucides. Guy-Ernest investit tactiquement dans le monde des étudiants, puisqu'il est parfaitement exact d'affirmer que le tremblement de terre social de mai 68 est préparé et presque planifié par les situationnistes. Ils reconnaissent dans la conjoncture universitaire le chaînon fragile du système, comprennent bien avant 68 que les jeunes bourgeois des facs sont promis à un avenir prolétarisé. Ils intègrent le pourrissement de la problématique du savoir face au marché, ils savent que c'est là que tout va craquer. Leur (notre) intervention à Strasbourg en 66-67 est la campagne militaire révolutionnaire la plus remarquable du siècle, elle reste à analyser en détail. Triomphe mortel pour l'I.S. car les "égaux" n'étaient pas au rendez-vous, Debord se retrouve à la Sorbonne aux prises avec la machinerie classique des intrigues en rien différentes de celles menées avec le brio que l'on sait par son lointain mentor, le cardinal de Retz, sans paille au chapeau.
|

|
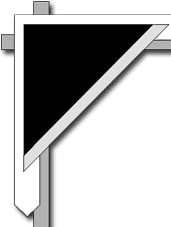

![]()