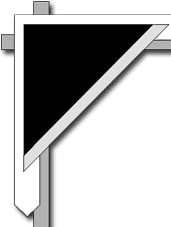
|

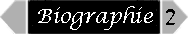
ELEGIE A UN RAT DE CAVE
Avant de reprendre à un point du passé, il faut parfois retourner en arrière et prendre une sorte d’élan pour pouvoir continuer. Colette, elle s’appelait, une petite shampouineuse de 18 ans qui m’avait dragué quelques semaines plus tôt au Moll, le fameux Moll que le lecteur attentif devrait connaître, le café où se mitonnait notre adolescence explosive. Au bar, comme ça, genre –« tu viens ? » - sans équivoque cependant, une simplicité qui m’est allé droit au cœur. Elle pourrait faire partie d’une esquisse du paradigme de mes relations avec les femmes. Comme celle qui suivra quelques mois plus tard et qui me révélera des années plus tard, que, m’ayant aperçu dans un amphithéâtre de la fac, elle glissa à sa copine discrètement en me montrant du doigt : -« celui-là, il me le faut » -. L’homme propose et la femme dispose. A ses risques et périls. Dans les faits, Colette ne me connaissait en rien, elle ne voyait qu’un jeune blondin qui avalait des fluttes de mousse de Lutterbach, plaisir perdu depuis longtemps, vraiment perdu. Autrefois on ne buvait pas la bière, on mangeait la mousse, et les tournées se succédaient à toute vitesse car les quantités de liquide étaient faibles.
Ce fut la période du « t’as cent balles ? ». J’ai du mal à structurer le passé de mes relations avec le besoin, exceptée la faim qui m’a longtemps accompagné et que j’ai pour ainsi dire apprivoisée. A soixante-cinq ans, je n’aurai plus jamais peur de la faim, j’en ai même fait une amie, un plaisir. Il m’aura fallu quelques décennies importantes dans la vie d’un individu pour découvrir que la faim était l’un des plus grands plaisirs de la vie. Je ne peux donc que sourire lorsque j’entends parler de la famine, de tel ou tel grève de la faim et surtout de cet argument stupide qui veut que l’immigration du Sud a comme principale cause ce besoin si pressant paraît-il. Oh nul doute qu’il le soit dans l’imagination des téléspectateurs qui, à l’instar des Romains amateurs de cirques, se plaisent à suivre les « souffrances » bidons des figurants des jeux télévisés. La vérité est que tout le monde a oublié ce qu’était la faim, la vraie faim , celle de vérité, la faim ontologique, le besoin pressant de trouver la raison d’être là où on se trouve. Un bon –« mais qu’est-ce que je fous là ? » fait bien plus mal qu’un creux à l’estomac, mais les requins de l’économie ont trouvé les ersatz qu’il faut, ils meublent le milieu, le fameux « environnement » mot détestable, je ne sais pas pourquoi, sinon qu’il insiste sur la centralité de l’homme dans le réel. Il y a l’homme et SON environnement. Le là est devenu le point central d’un entourage d’objets et d’êtres disposés selon des architectures et des urbanismes de plus en plus sophistiqués. Encore un mot prodigieusement intéressant pour les sémanticiens honnêtes : la sophistication est le passage de la réalité par le sophisme. C’est assez mal exprimé, il faudrait dire le modelage sophistique de ce qui nous entoure. L’exemple assez drôle est l’expression « mobilier urbain », les choses qui prétendent donner à une ville la qualité d’un domicile privé cohérent où tout le monde se sent comme chez soi, à quelque endroit qu’il se trouve et quelle que soit son occupation du moment. Le sophisme est dans le mensonge ou le mirage qui se dégage de l’ensemble, le style. En France l’affaire a été confiée à un monopole qui unifie ce style au plan de la nation ! Pas une gare sans le même distributeur de journaux, pas une ville qui dispose de ses propres arrêts de tram ou de bus, tout ça a été vendu à l’esthétique d’un seul homme qui « fait » la France d’aujourd’hui. La France est un vaste domicile unifié, unaire, où dominent les mêmes couleurs et les mêmes formes. Si on la traverse en dormant, on se retrouve à l’arrivée au même point qu’au départ, tandis que passer de la gare de Milan à celle de Gênes, par exemple, est une aventure certes difficultueuse, mais passionnante. Hélas, les Italiens sont sur la voie du même style, celui de l’absence de style comme disaient les situationnistes. Mais au fait, c’est exactement le résultat auquel sont parvenus les Américains….
Mais je digresse encore. Les vaches maigres s’annonçaient très maigres. Aucun d’entre nous n’avait de job, et on n’invente pas les revenus avec du vent ou des belles paroles. Or, j’ai du mal, j’y reviens à présent, j’ai du mal à me souvenir par exemple du manque de tabac, manque qui pourtant aurait dû figurer parmi les souffrances les plus marquantes pour le drogué que j’étais, fumant jusqu’à deux paquets de cigarettes blondes parmi les plus chères. Colette ? Cabillaud et Dolphi qui travaillaient avec des bons salaires ? Sans doute, Jean, Richard et moi vivions à crédit sur les potes, encore que Richard, et c’est là que nous allons mourir de rire, avait encore des relations étroites avec son père qui tentait de sauver son palais en gérant un magasin de fringues minable qui acheva d’ailleurs de le ruiner. On avait trouvé un plan génial : le père de Richard nous embauchaient pour reprendre les travaux sur le château en construction, en échange de quoi nous avions de quoi remplir nos estomacs, ce qui était l’essentiel. Je crois vous avoir déjà décrit le surréaliste projet de papa Marachin qui avait non seulement acquis quelques bons hectares de terrain qui aujourd’hui valent des millions d’Euro, mais déjà fait couler le béton du gros œuvre et même installé deux pièces isolées par des pans de nylon transparents où il campait en compagnie de son fils qui trafiquait encore ici et là avec des gens assez louches. Le Steinway souffrait dans la zone la plus protégée de ce chantier aujourd’hui mangé par la brousse telle qu’elle sait se manifester dans cette région si surprenante. Sans certitude j’avance l’hypothèse que Richard servait de rabatteur aux frères Schlumpf qui étaient en train de constituer la plus incroyable collection de vieilles autos, collection devenue entre-temps le plus grand musée d’Europe après une bataille syndicale mémorable, dont il sera peut-être question plus loin, quoique…C’est à dire qu’il repérait où il pouvait des carcasses, ou parfois des exemplaires en bon état, de vieilles voitures. Je me souviens de quelques Delahaye magnifiques et surtout de la Quinze Chevaux H avec laquelle il était venu me sauver la mise à Genève, vous vous souvenez certainement de cet épisode chaud. On a accusé les deux gredins « d’abus de biens sociaux » ; ce qui revient à détourner les bénéfices de leurs usines textiles pour acheter ces joujoux et les retaper. Il faut reconnaître qu’ ils étaient largement en avance sur l’engouement ultérieur du monde pour ces anciennes machines qui n’intéressaient guère le consommateur moyen, et même haut de gamme. Je ne parle évidemment pas de ceux qui cherchaient des Rolls du début du siècle ou des rarissimes connaisseurs qui roulaient en Armstrong-Sideley, la dernière voiture anglaise dont le poste de pilotage était encore séparé de la carlingue, immense salon où régnait un silence absolu et où on pouvait se servir du champagne sorti du frigidaire recouvert du même makoré que le tableau de bord. J’ai eu la chance d’en voir une et de m’en servir ; son propriétaire, une connaissance bâloise, s’en servait pour faire de la contrebande de produit made in Hong-Kong, style calculettes électroniques et mini-transistors ! Vous pouvez vous imaginer la tête et l’état d’esprit des douaniers voyant débouler ce joyaux de la Belle Epoque. La seule voiture semblable que j’ai pu contempler aura été l’une des anciennes Rolls de l’Empereur du Japon, exposée un certain temps dans le musée d’entreprise de Mercedes à Stuttgart. Il avait une sorte de téléphone qui le reliait au chauffeur auquel il donnait les ordres sans jamais avoir le moindre contact avec lui. Bref, il y avait là, pour nous, une source obscure de revenus qui nous payait sans doute notre tabac et nos bières dont nous étions également friands et sans laquelle nous aurions eu plus de mal à vivre que sans aliments destinés aux flux gastriques.
Nous nous présentons donc, Jean et moi, rue Pascal, petite ruelle, encore que le mot ne soit pas approprié car il s’agit plutôt d’un chemin assez vaguement goudronné et dont la seule fonction était de permettre aux belles limousines du voisinage de s’engouffrer dans leurs garages invisibles, noyés dans la luxuriance du Rebberg, la montagne aux cerfs sans cerfs, piedmont du Tannenwald, Wald sans un seul Tannen, paradoxes qui devait servir de prétexte à moqueries du vulgum pecus, quand-même écrasé par la beauté de ce quartier réservé. Mulhouse a quelque chose de Johannesburg ou de Prétoria, une plaine de compounds pour prolétaires ouvriers et la colline de rêve qui domine les mille et une cheminée et clochers qui ont longtemps formé la structure pratique et théorique de cette ville pour relégués de l’existence. Je l’aime, cette zone de terreur acceptée depuis des siècles, où la demande mondiale a longtemps tiré un trait sur la lutte de classe tant l’or coulait en barres dans les salles basses des banques. La CGT avait même obtenu, Dieu sait comment, un lopin de cette terre aristocratique pas très loin de la rue Pascal ; la dictature du prolétariat s’annonçait ambitieuse, loin de cet instinct de survie qui donna lieu à la fameuse équation stalinienne du socialisme + l’électricité. Ici on verrait, le moment venu, ce que la haine de la bourgeoisie peut se proposer d’instaurer d’encore mille fois plus doux que la chambre de luxure de la Grande Catherine. Encore ne faut-il pas oublier la cruauté qui fit de Mulhouse le Manchester français du XVIII me siècle ; j’ai vu des poilus pointer à la Fonderie quarante ans encore après avoir été soigneusement gazés sur les sentiers d’Ypres et troués de shrapnells sur toutes les parties de leur corps. Le mari de notre bonne Madame Hoeffleur n’a jamais connu les joies de la retraite avant qu’un poids-lourd ne lui règle son compte à la sortie de son usine qu’il distinguait encore à peine entre les douleurs de son crâne défoncé et le vertige des vestiges du gaz moutarde. Je crois me souvenir ne l’avoir jamais entendu prononcer une seule parole, la seule motivation qui devait le retenir encore debout étant ce bon Kiravi à 12 degrés que ses deux garçons montaient par caisses au second étage du taudis à la Dickens où en ce temps-là on parvenait encore à survivre. Les murs de l’obscure cuisine brillaient de la crasse séculaire qu’il était devenu impossible à peindre ou à carreler, il n’y avait plus qu’à frotter pour donner aux couches de graisse leur patine vieille d’un demi-millénaire. Ces maisons, en effet, dataient toutes du quinze et seizième siècle, révélant sous la saleté et les débordements de végétation sauvage des architectures qu’un journaliste un peu fou a bien tenté, mais en vain, de sauver des pelleteuses du progrès.
Je le dis haut et fort : En rasant la Grand-Rue, Emile Muller n’a pas seulement trahi les miens, il n’a pas seulement anéanti mon enfance et ses chants d’oiseaux, il a sectionné la partie essentielle de l’âme de sa commune. La Grand-Rue, devenue un non-lieu, c’était comme si on pouvait imaginer Paris sans les Champs-Elysées. Est-ce possible ? Pas si impossible que cela, car cette immense avenue a bien changé en quelques années et les Parisiens de jadis qui survivent encore, ne peuvent éviter une sorte de mélancolie en passant devant les MacDonald et autre fast-food qui polluent ce majestueux axe Est-Ouest que viendra déverrouiller quelques années plus tard la grande Arche imaginée par un Mitterrand plus génial dans cet aspect des devoirs républicains que dans celui de la politique de tous les jours . A Mulhouse, il y avait de surcroît une injustice flagrante dans le choix de ce qui devait disparaître : d’un côté, le côté gauche selon l’alignement Nord-Sud était occupé par le dernier lumpenprolétariat intra-muros, tandis qu’à droite existait la culture, la bibliothèque, la religion, chapelle des Chevaliers Noirs de l’Ordre Teutonique, et un assemblage d’hôtels particuliers et d’immeubles bourgeois. On a rasé gratis…..à gauche. Dans l’immédiat le scandale qui s’annonçait n’a ému personne d’autre qu’un intello un peu cinglé mais qui avait sa rubrique dans le quotidien number One du Haut-Rhin, l’Alsace. Il signait Patrice et avait réussi à faire classer un portail du quinzième siècle monument historique ; du coup blocage, plus de bulldozers ? Pensez-vous, j’ai encore pu voir cette invraisemblable connerie qui a consisté à isoler le portail, sorte d’arche en grès soutenue par deux colonnes , au milieu d’un chantier de démolition. Car l’arche n’était qu’une concession dans le vaste projet de restructuration des voies de circulation mulhousiennes. A bien y réfléchir ce n’était pas une restructuration mais les pseudopodes d’un projet immobilier qui aura ses conséquences sociologiques à peine quelques années plus tard, la construction de la fameuse ZUP, Zone Urbaine Prioritaire. Vous aurez compris qu’Emile avait décidé l’édification d’un vaste Sarcelles aux limites extrêmes du ban mulhousien, zone qui jouxterait à terme la zone universitaire de notre bonne sous-Préfecture qui n’aurait jamais rêvé d’une véritable université. Elle possédait déjà son Ecole de Chimie, comme vous le savez, et son Ecole de Filature. Mais les sciences humaines n’étaient pas représentées, et pour cause, elles ne le seront d’ailleurs jamais, excepté le minimum vital des langues étrangères.
Il fallait donc ouvrir en quelque sorte Mulhouse comme on ouvre une boîte de conserve et creuser une vaste tranchée bien avant que les petites autos sorties de la toute nouvelle usine que Peugeot avait construit sur les coupes claires de la plus belle forêt de l’Est de la France, coupes qui allaient avec le temps se transformer en plus de forêt du tout, seulement un rideau d’arbres dissimulant des kilomètres de bâtiments d’où on éjectait des milliers de cent, deux cents, trois cents, quatre cents etc séries de Peugeots. Garantis pièces et main d’œuvre. Ils ont donc ouvert, explosé, découpé, dynamité, fait disparaître pfuit… en laissant ici et là quelques bosquets où s’anémiaient lentement les dernières fraises des bois et trompettes de la mort que nous récoltions jadis selon un rite annuel qui formait une pierre angulaire de la structure des plaisirs paysans et prolétaires de la famille maternelle. Je n’oublierai jamais ces boîtes à lait en aluminium remplies de fraises, de myrtilles et de framboises que nous dévorions le Dimanche soir en revenant de la cérémonie de la cueillette annuelle, tout à fait identique du point de vue rituel à la recherche du muguet aux premiers jours du mois de mai précédés par les jonquilles de Gérardmer en avril. Le souvenir de ces rythmes que ma mère n’a jamais cessé, tant qu’elle a vécu avec nous, de respecter scrupuleusement, réveille souvent la douleur provoquée par l’anéantissement gratuit de ces immenses bonheurs de l’existence réduits à de petites choses qu’étaient les délices de ces dons de la nature gérés par la vigilance de la Tradition. Même mon grand-père, rendu autiste par une existence dont le sens n’était pas évident, se réveillait lorsque se profilait à l’horizon la saison des girolles et des cèpes dont il était particulièrement friand et dont il connaissait des gisements d’une richesse inouïe dans la grande forêt où passait les trains dont il gérait une partie du trafic, tantôt pour la SNCF, tantôt pour la Deutsche Reichsbahn qui n’a jamais manqué de lui verser jusqu’à son tombeau la part de retraite qu’elle lui devait.
Digressions en série. Envahi par la honte du mauvais écrivain. Mais tant pis, la vérité finira bien un jour par monter à la surface du texte comme se forme la mousse en haut des foudres en chêne, la mousse du raisin qui fermente. Il y aurait un intérêt certain à examiner ces digressions et leur place dans le dispositif du texte, observation qui devrait fournir des données substantielles sur la stratégie inconsciente présente dans mon écriture et a contrario des vérités cachées non négligeables. Mais il faut avant tout, désormais éviter les digressions et avancer dans le récit, car si je continue à ce rythme, il me faudra bien plus de trois tomes pour venir à bout de mon projet de vous confier le sens de mon existence. J’en étais donc venu à ce moment difficile où, abandonnés une nouvelle fois par nos parents, condamnés à la cloche de bois et affamés jour et nuit, le père de Richard nous proposa de « travailler » pour lui en échange de nourriture. En me repassant le film des événements à partir du jour où nous nous mettons au travail, il me revient ce mal de ventre qui n’épargna aucun d’entre-nous, excepté le papa de Richard, provenant du rire qui s’empara de nous et ne nous quitta plus jusqu’à ce que la cause elle-même cessa d’agir. En effet, le travail que Monsieur Marachin nous confia contenait dans sa définition une dimension d’un surréalisme que je qualifierais carrément de keatonien. Avec le plus grand sérieux, papa Marachin avait changé ses plans concernant le futur chauffage de son immense datcha. Plus question de chauffage central au fuel, plus question de chauffage électrique ou à gaz, l’ancien cheminot avait opté pour le top du top qui venait d’entrer sur le marché : le chauffage par soufflerie. Les avantages étaient, certes, multiples : rapidité donc économie de la mise en chauffe de l’immeuble, possibilité donc de fractionner rapidement le chauffage, bref, le nec plus ultra. Mais cette merveille avait un grave défaut, un défaut qui allait coûter très cher à l’heureux propriétaire de ce terrain en or pur. Ce défaut résidait dans l’architecture du bunker, une structure qu’il fallait entièrement modifier pour permettre d’installer la soufflerie et la distribution de l’air chaud. Pour bien comprendre le problème il suffit de penser à ces tunnels d’aération que l’on peut voir dans les films d’action où les héros sont souvent contraints de se faufiler dans un espace extrêmement réduit mais suffisant pour laisser passer un homme de corpulence moyenne.
Résultat désopilant pour nos esprits épris de logique simpliste : le travail qu’il nous confia pouvait se résumer à de la pure destruction ; il consistait en effet à creuser des trous rectangulaires de taille respectable dans un béton dur comme de l’acier. L’épaisseur des murs ajoutait à la difficulté et la pénibilité (quel vilain mot) d’un travail qui nous faisait heureusement tellement rire que nous en oubliions les coups de marteau ratés, les ciseaux lourds et instables pour des apprentis du bâtiment. Pour ma part, j’avais assez d’expérience pour rendre mon travail assez productif, mais mon ami Jean n’avait que sa force herculéenne pour compenser son manque de pratique dans ce genre de sport qui laissait, le soir venu, de grosses cloques se développer à la base des doigts de la main objets de tortures qu’il fallait interrompre si fréquemment que le patron se rendit vite compte que notre rendement était plus que médiocre et que les caisses de bière lui coûtaient les yeux de la tête ainsi que les choucroutes qu’il passait la matinée à nous confectionner avec, je dois reconnaître, un talent hors du commun. Pour comble de malheur, les « bleus » qu’il nous confiait pour repérer et tracer les futurs conduits de chaleur, n’étaient pas cohérents, et bien des ouvertures durent être rebouchés au béton dans de grands éclats de rire qui ne plaisaient qu’à moitié à notre employeur improvisé. Le travail ne fut d’ailleurs jamais achevé, et un autre épisode mit fin à notre collaboration dans une hilarité qui remplaçait bien souvent notre faim de jeunes hommes en pleine santé et notre soif de boissons indispensables comme accompagnement de travaux aussi durs que ce que nous étions censés accomplir.
Richard, en effet, s’était improvisé avec le plus grand sérieux carreleur de salle de bain, et lorsqu’on s’est fait une idée des dimensions gargantuesques des salles d’eau de ce château, on peut imaginer du génie qu’il faut pour recouvrir de carreaux au millimètre des dizaines de mètres carrés de béton rugueux et, il faut bien de dire, aussi médiocrement coulé que détruit par nos coups de marteaux. Richard, cependant, y parvint en des délais extraordinairement courts, et nous fûmes réduits au sérieux pendant au moins une nuit devant le résultat rayonnant de cette salle de bain digne du Ritz ou du Hilton Cinq Etoiles de la Porte Maillot. Le malheur, ou son contraire comme on voudra, voulut que la vision qui nous attendait le lendemain fut celle de l’Apocalypse : tous les carreaux avaient suivi leur pente naturelle, qui selon Aristote devait les conduire vers leur lieu naturel, à savoir le sol. Richard avait tout calculé, sauf le degré d’adhérence de ces plaquettes de faïence qui s’étaient détachées les unes après les autres sans que nous ne nous soyons doutés de quoique que ce soit. Et pour cause, car entre-temps nous avions trouvé un nouveau logement soutenu par un projet aussi grotesque que les travaux d’Hercule auxquels nous allions rapidement échapper. Mais rapidement encore un mot sur l’humour situationnel qui nous avait tant aidé à supporter ce passage difficile de nos existences ballottés, affamées, assoiffées et surtout sans avenir aucun. Ce qui avait maintenu ce rire qui nous étranglait pour ainsi dire à chaque instant, c’était l’absurdité camusienne de la situation : nous étions nourris pour détruire, à coup de marteau et de perceuses, ce que le papa de Richard avait mis des années à ériger en chargeant et déchargeant des tonnes de béton qu’il maniait à lui tout seul. Ce futur palais de la musique d’avant-garde était d’avance condamné à ne jamais devenir l’objet que se représentait le père qui alimentait une foi sans faille à l’égard du génie de son fils, génie sans doute incontestable, mais qui ne verra sans doute jamais le jour publiquement, même si sa dernière compagne tentait de rassembler les quelques enregistrements, pratique à laquelle Richard se refusait radicalement, ce qui laisse de lui quelques traces et le souvenir, peut-être, dans la mémoire de quelques habitants de ce petit village où il allait jouer de l’orgue, des concerts qu’il donnait gratuitement et qui ne représentait sans doute dans la sensibilité des paysans de cette commune qu’un talent aussi subliminal que le Saint Esprit auquel ils avaient été initiés dans leur enfance. Mais notre destin n’avait pas fini de nous jouer des tours de plus en plus surréalistes, à moins qu’il faille dire que nous devenions de plus en plus fous et que nos actes s’éloignaient chaque jour un peu plus du sens commun. Mais le rire était là, et les quelques jeunes gens de la bonne société qui nous connaissaient du Lycée, se montraient de plus en plus perplexe en nous contemplant, hilares et, on aurait presque dit, heureux. Un nouveau projet était né ainsi, du néant, le Deus ex-Machina restant Richard, maître des lieux que nous avions quitté pendant de si longues années tandis qu’il restait un habitant actif, actif dans la musique, actif dans une existence énigmatiquement occulte dont provenait nombre d’actifs et de passifs dont nous eûmes à rendre compte.
Au fondement de ce nouveau projet, logiquement, la musique, seul véritable ciment qui nous unissait tous les trois plus quelque satellites qui se montraient de temps en temps par pure curiosité, mais aussi, il faut le reconnaître pour nous sortir momentanément de la famine et de la soif. Richard, décidément nanti d’un entregent mystérieux, avait trouvé tout près de la Gare de Mulhouse une immense cave d’un bâtiment célèbre autrefois comme siège de l’entreprise Alfred Wallach, charbonnier milliardaire et philanthrope, dont il existe aujourd’hui un grand nombre de réalisations urbaines destinées à embellir et à apporter à la population prolétarienne de cette ville-usine, un peu de culture et de confort moral légèrement décalé par rapport à l’intoxication permanente que répandent les dizaines de clochers d’église que l’on peut encore voir quadriller tout l’espace en parallèle avec les cheminées d’usine, qui n’ont pas encore toutes migré vers la banlieue où les appellent le progrès et la construction des autoroutes de contournement d’un futur Mulhouse rugissant de milliers d’automobiles construites sur place et consommées de même. Pardon pour ces phrases dont la longueur est la seule qualité de comparaison possible avec le style de Proust… D’autant que je n’ai pas l’impression d’avoir réussi à épuiser tout le comique, mieux tout l’hilarique, si on veut bien me passer ce néologisme, des situations que nous avons affrontées à cette époque. Tant pis, tout le monde ne peut pas s’appeler Rabelais, mais je l’affirme, les temps que nous traversions dans ces années-là, encore qu’il faudrait dire ces mois, car rien de tout cela n’a duré très longtemps, étaient des temps dont les seuls représentations comparables pourraient se trouver dans le cinéma américain des temps du muet, avec Laurel et Hardy, Buster Keaton et bien entendu, Charly Chaplin. D’ailleurs, on pourrait analyser ces analogies, car elles ne sont pas seulement comiques, elles révèlent sans doute des parallélismes historiques plus sérieux, Mulhouse m’étant toujours apparu comme le Far-West français, en l’occurrence le Far-East, devenant avec notre apport culturel vivant, une sorte de Hollywood pour initiés, en fait un véritable lieu pour les Situationnistes que nous étions sans en revendiquer le statut.
La cave ! C’est une saga où pendant encore plusieurs semaines, nous allions nous alimenter avec du rire avec un grand R, tant les faits absurdes et irrationnels s’empilaient jour après jour. Elle était pourtant magnifique, notre cave, lieu où l’on stockait, sans doute vers les années 1900, des tonnes d’anthracite de haute qualité, le charbon de seconde qualité s’entassant sur les vastes espaces qui entouraient la propriété située tout au long des principales voies de chemin de fer. Mais elle était propre comme un sou neuf. J’ignorais d’ailleurs totalement comment Richard avait négocié ce bail qui nous autorisait non seulement à séjourner dans les lieux, c’est à dire à nous en servir comme domicile provisoire mais encore à les transformer en boîte de nuit réservée au Jazz, musique par rapport à laquelle nous avions quelques compétences à montrer comme preuve du réalisme de notre projet. Belle, elle était notre cave, n’ayant qu’un seul mais grave défaut, à savoir une humidité qui suintait des murs d’une épaisseur toute militaire. Il fallait agir, et le technicien que j’étais trouve évidemment la solution sans tarder, solution tout à fait extraordinaire comme d’ailleurs son prix qu’il fallut faire avaler à papa Marachin, effaré par des dépenses qui venaient s’ajouter à celles qu’il continuait d’effectuer pour son château, apparemment en panne, mais dont il n’était pas question d’interrompre la construction. D’ailleurs notre projet jazzistique avait pour but la réussite économique, ayant constaté sur la foi d’un rapide marketing, que Mulhouse manquait notablement de lieux de rencontres culturels, musicaux et surtout destinés à la jeunesse laissée au plus complet abandon par une sociologie prolétarienne d’un côté et lointainement aristocratique de l’autre. La Commune, quant à elle, était gérée par des Mulhousiens-types, c’est à dire par ces descendants de paysans vivant autrefois dans la grand couronne de la petite République suisse et auxquels le rattachement à la France fut comme la levée d’une déréliction totale, les autorités moitié républicaines, moitié seigneuriales, ne s’y intéressant que pour la levée de l’impôt ou l’implantation d’ateliers externalisés qui travaillaient dur pour les grandes entreprises de la capitale française du textile. Mon propre arrière-grand-père possédait deux ou trois machines à tisser qui tournaient jour et nuit, mobilisant femmes et enfants jusqu’au moment où la conjoncture mit fin à cette forme d’exploitation laissant le service public prendre la relève afin d’éviter de mettre le feu et le sang à des régions d’une pauvreté impavide. Ce qui fit de mon grand-père un cheminot, et de son frère un ouvrier de l’entreprise Cusenier, fabricant d’un produit dont les parisiens durent supporter matin et soir l’une des toutes premières publicité d’avant-garde : qui ne connaissait pas, encore dans les années soixante, les fameux Dubo, Dubon, Dubonnet, qui tapissaient les murs de toutes les stations du métro parisien ? Voilà le genre de liens que les sociologues méprisent sans tenter d’évaluer les effets réciproques d’un banal mais génial contrat de publicité de taille géante signé entre une ville quasi inconnue de la France et la capitale qui s’attribuait l’essence même de toute réalité française. Mais peu importe, Mulhouse souffrait depuis des siècles d’un tel déficit de bonheur social qu’en 1965, la moindre idée de véritable culture, soulevait immédiatement l’intérêt des édiles tout près d’être gagnés par une panique politique naturelle, eût égard à la pression qui s’accumulait dans les couches ouvrières encore solides et unies de cette vaste prison industrielle d’où sortaient entre autres, les fameux Manurhin, ces pistolets qui circulaient presque ouvertement dans les ateliers de la prison de Fresnes, alors la plus grand enceinte carcérale de France. Encore une de ces phrases interminables ! Mille excuses, je vous adresse et vous laissant vous reposer le temps de rassembler des idées déjà prêtes à céder la place à des digressions sans fin sur la sociologie de Mulhouse et de ses environs.
Mon idée, donc, était géniale, tant du point du vue technique qu’esthétique : je proposai rien moins que de couvrir tous les murs d’une mince pellicule de toile plombée, technologie à peine moins toxique que l’amiante et certainement encore plus difficile à manipuler. Cela se présentait sous la forme de rouleau de un mètre de largeur sur dix mètres de longueur, d’un prix exorbitant, et dont la pose nécessitait non seulement une compétence de tapissier qui ne me faisait pas défaut, mais encore d’une patience et d’un soin, deux qualités qui n’étaient pas des plus répandues et qui me valurent des conflits semi-sanglants avec mes « collaborateurs » apprentis, qui me laissèrent d’ailleurs, faire l’essentiel d’un travail qui ne vit jamais la fin. N’empêche, ça avait de la gueule une fois posé sur l’encadrement des soupiraux et sur des murs aux dimensions assez harmonieuses pour le lieu dont nous rêvions, et qui pour le moment nous servait d’hôtel, un hôtel bien spartiate, sans le moindre confort, nos lits s’étant réduit à une petite série de sièges d’automobiles récupérés par Richard dans les stocks de casseurs de Citroën dont il était très proche. L’idée esthétique était, je le dis sans modestie, géniale : la cave était formée de piliers soutenant des arcs romans, on se serait dit dans une série de chapelles donnant les unes sur les autres, et les soupiraux distribuaient une lumière étrangement riche pour ce qui n’était après tout qu’un sous-sol. Mon idée était de transformer ces murs, ces piliers et ces arcs en un seul véritable lingot de plomb, auquel le vernis dont je comptais recouvrir les feuilles de ce métal ingrat, allaient donner une impression de métal précieux. Au demeurant, les premiers résultats confirmèrent mon ambition et soulevèrent l’enthousiasme au point que papa Marachin se mit à nous livrer lui-même, après les avoir financés bien entendu, les lourds rouleaux de plomb au grand étonnement du seul commerçant de Mulhouse qui vendait ce produit destiné en général à l’isolation de partie architecturales dans certaines entreprises dont les murs étaient menacées par l’humidité. Il fallait, peut-être peut-on encore puisque j’avais pris la précaution de vernir sur plusieurs couches les feuilles dont la teinte originale était d’un gris métallique du plus bel effet. L’idée esthétique se réalisa au-delà de mes espérances et la cave finit par donner l’impression qu’on avait creusé l’ensemble dans une masse de métal brillant et sombre. L’alliance de ces deux nuances reflétait parfaitement notre état psychologique. Chacun d’entre-nous brillait dans son domaine, Jean était le dieu de la batterie, Richard jouait comme Chopin en personne et je m’étais même mis au cymbalet, instrument électronique qui me permettait de jouer de la basse sans savoir manipuler les cordes d’une contre-basse, j’avais assez de connaissance des claviers de piano pour plaquer les trois ou quatre accords dans le rythme que l’on me demandait. Sans grand talent, il faut l’avouer. Car le projet était grandiose : nous allions former un orchestre de Jazz, et à cette fin nous fîmes venir de Strasbourg un tout jeune homme d’à peine 16 ans, trompettiste de talent qui deviendra des années plus tard le trompette du groupe Onoma dirigé par un philosophe de mes connaissances, Rodolphe Burger, un groupe qui aura plus que son heure de gloire et notre ami Bix (c’était son surnom fabriqué à partir de son nom Biquel et de la mémoire de Bix Beiderbeck, le grand trompettiste américain blanc qui aura été la grande exception dans le jazz réservé, selon certains puristes racistes, aux « blacks » américains. Je n’oublierai jamais l’arrivée de Bix dans notre cave encore en chantier, où nous faisions notre popote sur un poêle à charbon, sans la moindre casserole ou autre ustensile de cuisine. Je crois d’ailleurs que ce jour-là nous eûmes au menu des pâtes cuites dans une boîte de sardine vide, contenant encore un peu de l’huile qui permit aux coquillettes frétillantes de ne pas coller trop ostensiblement au fond de la boîte de conserve qui servait à tout, sauf au nescafé dont aucun de nous ne pouvait se passer dès le réveil de plus en plus pénible au fur et à mesure que les murs se couvraient de la matière métallique empoisonnée. Pour notre bonheur et surtout pour notre salut, Jean et moi découvrons un logement presque gratuit, mais dépouillé du moindre confort ; cette chance nous sauva sans doute la vie, le saturnisme n’attendant pas le rythme des années pour s’attaquer à la qualité du sang qui coulait dans nos veines. De plus, l’aventure de la cave se termina par un fiasco terrible, car le père Marachin arrête de payer le loyer du jour au lendemain et nous nous retrouvions à la rue, sans foyer et sans projet. C’est ainsi que nous découvrons notre nid rempli de rats et de divers insectes suspects, mais situé au pied du quartier chic du Rebberg et dans une arrière cour qui nous procura ce que nous avions appris à aimer par-dessus tout, à savoir le calme et l’absence de bruits de moteur.
Comme il fallait vivre, je me mis à chercher du travail, et dans ces temps-là, il suffisait de se baisser pour en ramasser. Ma première tentative est sans appel : la Préfecture me mettra tous les bâtons possibles et impossibles dans les roues pour trouver un travail à Mulhouse. La première tentative sera exemplaire, Peugeot qui vient d’installer ses immenses usines en pleine forêt de la Hardt, souvenir d’enfance et lieu de naissance de ma mère, son père étant à cette époque garde-barrière en pleine forêt, gardant un chemin forestier.
Ma mère n’a jamais oublié les cinq ou six kilomètres qu’elle effectuait à pied pour aller à l’école de Bantzenheim, et pour en revenir, à travers la forêt, tout comme le petit chaperon rouge, hiver comme été, se tordant les chevilles sur les traverses en fer ou sur le ballast en pierre noire des Vosges. Nous étions dans les années 1910-11, à quelques mois de la plus grande catastrophe humaine jamais vécue et dans laquelle mon grand-père Emile se démarqua de son frère Joseph en restant fidèle au Kayser et en conduisant les trains des armées d’un front à l’autre pendant quatre ans, cependant que Joseph déserta dès son arrivée en Norvège où il rejoignit les rangs des Alliés, terminant la guerre sur un bâtiment miraculeusement épargné par les ravages opérés par les premiers sous-marins allemands, les plus redoutables. Lorsque le 11 novembre 18 fit retentir la cloche de l’armistice, mes deux ancêtres se retrouvèrent à Bantzenheim devant une choucroute bien garnie et des bouteilles amoureusement épargnées par les soins de cette famille de semi-paysans, mon arrière-grand-père gagnant l’essentiel de son revenu chez DMC pour qui il tissait, tissait, tissait, jour et nuit, ce qui faisait de lui un quasi bourgeois du village, avec maison donnant sur l’église à laquelle toute la famille est restée fidèlement attachée jusqu’aux événements coloniaux et leur culture amorale, qui ont pénétré jusqu’au cœur le plus bigot de la fratrie, celui de maman.
Peugeot me reçoit les bras ouverts, le besoin de main d’œuvre dépasse tout ce qu’on pourrait imaginer aujourd’hui. Je me contentai de demander un poste d’OS, ouvrier spécialisé, autrement dit le bas de l’échelle, mais la Direction ne comprend pas que mon ambition s’arrête là, moi, détenteur du Premier Baccalauréat, ce qui valait, à l’époque, à peu de chose près une licence d’aujourd’hui. On me fait donc passer une journée entière de tests psychologiques, on m’envoie même chez un neurologue pour me soumettre à un électroencéphalogramme, c’est dire les moyens dont disposait cette entreprise pour filtrer son recrutement. Tous les résultats dépassent largement les critères d’admission à l’encadrement, et on me préparait déjà un bureau lorsque le dernier obstacle à franchir me fait trébucher : la Sous-Préfecture de Mulhouse me « donne » à la Direction générale et le contrat qu’on m’avait préparé ne sera jamais signé, on me fit savoir par téléphone que ma candidature est finalement rejetée. Total a également besoin de technico-commerciaux et comme chez Peugeot mon profil les intéresse, même scénario, même résultat. Ce sera finalement l’entreprise Clemessy qui me donnera du travail, cette fois sans scrupules comme OS. A l’époque Clemessy était encore une PME d’électromécanique qui fabriquait des moteurs électriques et restaurait des coffres de commandes électriques blindés très sophistiquées utilisées dans les mines de potasse d’Alsace, secteur où on me confia un premier job dur, sale et certainement dangereux pour ma santé. Il s’agissait de nettoyer les coffres qui remontaient du fond avant démontage, c’est à dire enlever à l’aide de brosses électriques la croûte de sel qui enrobait littéralement les armoires blindées. Même pas un masque en papier ! La Sous-Préfecture n’a certainement pas failli à sa mission, mais le PDG de l’entreprise en pleine expansion était un drôle de gaillard dont j’appris bien plus tard que son crime le moins grave avait été une collaboration plutôt bienveillante avec les autorités d’occupation. La tension entre une grande majorité de collaborateurs et une minorité de gaullistes durera longtemps après la guerre, et en 1965, malgré quelques condamnations (dont certaines dans ma propre famille) exemplaires, De Gaulle dût attendre de reprendre le pouvoir pour mettre au point une stratégie de revanche contre cette majorité qui représentait la droite dite « centriste » qui avait son équivalant jusqu’au sein du gouvernement. Clemessy n’avait donc cure des avertissements des autorités et avait le sens de l’aventure individuelle. Bonne pioche, car en deux mois j’avais doublé la productivité de mon atelier et fait un bond dans les promotions. Mon travail fut si favorablement évalué par la Direction, que je jour où j’annonçais ma démission, après avoir obtenu le Bac en entier et une bourse d’étude maximale, on fit tout pour me décider à rester, m’ouvrant sans hésiter les portes des bureaux. Politique qui porta ses fruits, Clemessy ne tarde pas à devenir numéro un dans la téléphonie et dans les industries électroniques annexes. On fit son deuil de mon départ car j’étais décidé à faire deux choses : rejoindre mes amis situationnistes à Strasbourg et entamer des études, ayant estimé que mon Bac ne valait pas plus que le certificat d’Etudes quelques années au paravent. Il me fallait donc une licence, n’importe laquelle pourvu qu’elle m’ouvre automatiquement les portes de l’enseignement, histoire de n’avoir pas à me soucier de trouver du travail s’il fallait un jour s’y résoudre pour faire une carrière. Au fond, j’étais un aventurier au petit pied, bien prudent et pas décidé du tout à jouer les Zorro pour des prunes. J’affirme néanmoins qu’à aucun moment l’idée ou le concept de « retraite » n’a effleuré ma conscience, et nous, car à cette époque le « Je » n’avait pas cours forcé, nous pensions tous ne pas dépasser la trentaine dans cette existence dénuée de tout intérêt et juste bonne à être bue au mètre dans les grands bocks de bière entrecoupés de petits verres d’eau de vie de toute sorte.
Curieux lorsque j’y repense, ces choses ne prenaient pas grande place dans la vie de tous les jours, même dans le cours général du temps long (le mois et pire, l’année entière, équivalence d’une éternité vécue comme éternité, c'est-à-dire comme immobilité du temps. Je crois que la jeunesse, avec ses maladies et ses passions, l’ennui et le bouillonnement de la libido, se déroule comme temporalité intemporelle : le jeune n’a aucun sens du temps. Autant le « petit » trépigne pour aller plus vite dans le temps, il veut se coucher avec les grands, il veut passer en tout pour un plus grand qu’il n’est et jalouse ses aînés, autant le jeune ne se rend compte de rien. Le jeune vit d’une manière végétative, la sève accomplit sont parcours sans heurts avec les aiguilles de la montre, quelles que soient les forces déchaînées par les objets du désir ou du besoin. Ce que je veux dire c’est qu’à Dix-Huit ans et pendant plusieurs années, le temps n’est jamais présent comme obstacle concret, comme dans l’enfance ou dans la vieillesse. Comme je peux parler des deux expériences, je peux affirmer que le temps s’alourdit avec l’âge, tout en s’évanouissant par ses performances de vitesse. Maladies, douleurs permanentes, fatigue non voulue, celle qui vous cloue sur place sans recours, changement dans les rythmes du désir (sexuel, alimentaire, psychique en général – je ne sais pas trop à quoi je fais référence ici , mais il doit y avoir quelque chose – de mort aussi, désir permanent, absolument identique à l’envie de dormir qui, ellle aussi, devient obsédante et vous fout la vie en l’air ainsi que vos relations avec les autres), tout cela donne au temps un tour chaotique où l’on recherche tantôt avec désespoir des rites de conciliation, tantôt vous fait remonter vos anciennes révoltes, votre rébellion de jeunesse. Bref, on balance entre le Dernier Tango à Paris et le Vieil Homme et la Mer. A l’instant où j’écris, je me soutiens du rêve ancien revu et corrigé par Hemingway, à savoir la voile aventureuse comme sortie de scène pudique et, pour moi hédonisme suprême, le plaisir de la tempête qui serait un jour la dernière. Il y a aussi les perspectives post-mortem qui agacent. Les images du corps mort et de ce qui peut lui arriver distillent une sorte particulière d’épouvante. La mort en elle-même n’est rien, et on a bien assimilé la démonstration d’Epicure. Mais la suite ? Le Feu me paraît faux, un erreur de cultures où la démographie commande cette forme de liquidation du volume corporel. Reste deux solutions, ou deux formes d’acceptation que le monde vous bouffe des pieds à la tête, les vers ou les poissons. Pour ma part j’avoue n’avoir aucune préférence, malgré le beau vers de Rimbaud sur les noyés qui descendent « à reculons ». L’image d’une mâchoire de requin mastiquant sans conscience, c’est ça qui est terrible, votre propre chair, encore fraîche, fraîchement noyée, pas mieux que les asticots qui prennent leur temps. Donc il faut devenir kantien et compter sur le sublime du coup de bôme qui vous envoie KO dans les flots déchaînés pour passer l’éponge sur ces fictions hollywoodiennes. Ca me fait penser à notre moniteur de voile qui est décédé de cette manière, exactement comme dans le scénario qu’on raconte à propos de la mort d’Eric Tabarly, mais en voulant sauver son père qu’il avait entraîné dans une aventure stupide pour des raisons d’argent, toujours l’argent, relier Calvi à Marseille par force Dix avec un petit 8 mètres qui tenait à peine la mer. Mais il fallait que le navire soit au port de Marseille pour les stagiaires pressés.
Ce coup de bôme j’ai cru l’avoir reçu un jour, à une dizaine de milles de Calvi, justement ; j’avait barré toute la nuit par force 8 à 10, mais sur une mer plate avec vents rasants, qui ne laissent apparaître de déferlante que toutes les sept vagues. Quand on le sait, tout va bien, on regarde dans le rétroviseur et on donne un petit coup de moteur en suivant le vague au travers. Sinon c’est le mât dans l’eau, au mieux, au pire un beau chavirement avec un mât en moins si on a laissé traîner trop de voile. Vers cinq heures du matin Myri, qui avait été malade toute la nuit et dormi le reste, montre le bout de son nez dans le cockpit où je n’en peux plus. Elle propose de prendre la barre, chose inimaginable en temps normal, elle n’avait jamais barré par plus de force 3, mais la fatigue aidant, je craque à l’idée d’un café chaud et d’une cigarette. Assis devant ma table à carte je commence à allumer ma blonde lorsque je me mets à tomber du dixième étage de ma maison, me fracasse contre le bordé illuminé par une boule de feu aveuglante. Mais la conscience est plus rapide que n’importe quoi, elle me dit –« ça y est mon gars, tu y as droit, c’est la fin pour toi, laisse-toi aller, vas, pas besoin de te rebeller » - et je plonge dans le cirage. Entre-temps la baille de location, un Feeling finalement pas si mal que ça, s’était redressée, et Myri ne s’était rendu compte de rien !!! Je ne comprendrai jamais cette épisode de ma vie de marin. En fait elle a parfaitement redressé le navire dont le mât prenait un bain, et continué la route approximative que je lui avais donnée. Et puis, non , j’étais bien vivant, mes yeux se rouvrent et je rampe vers l’échelle de coupée en appelant au secours, borborygmes évidemment pas entendue par mon équipière qui, vue en contre-plongée, semblait même prendre son pied comme je ne l’avais jamais vue. Finalement elle m’aperçoit et prend lentement conscience qu’il s’était passé quelque chose (il faut s’imaginer la situation : un bateau qui chavire de 90°, vous fait passer de la station verticale à l’horizontale au-dessus du vide creusé par ce changement de position. Comme j’étais assis du mauvais côté , je suis littéralement tombé de l’autre côté directement sur la partie fraîchement opérée de ma colonne cervicale, ce qui laissait beau jeu à ma conscience pour me convaincre de la fin imminente de mon existence terrestre. Quatre mois au paravent, en effet, un neurochirurgien de grand talent m’avait laminectomisés, c'est-à-dire sciés, mes 7 vertèbres cervicales réduites à 6 par la fusion des deux premières, pour laisser respirer ma moelle épinière comprimée par une étroitesse « cannalaire » congénitale et aggravée par l’arthrose. Quelle idée de prendre la mer quelques mois seulement après cet acte de bravoure qui avait duré douze heures, sauvé la vie et raidi ma nuque à la Erich von Stroheim de la Grande Illusion. Or non seulement l’incompétence de mon équipière ne m’a pas tué, mais elle m’a, si j’ai bien compris par la suite, décoincée cette partie de la colonne vertébrale qui ne bougeait pratiquement plus depuis l’opération. Vous savez, pour parler à quelqu’un qui se trouvait derrière moi, il fallait que je tourne tout mon corps, mouvement de gymnastique qui de surcroît vous donne un air important tout à fait indésirable. Bref, j’avais si peu souffert réellement du KD, knock down du Feeling, que la douleur foudroyante qui s’était réveillée, elle, sans pudeur, ne m’empêcha pas de rentrer le navire dans l’abri de l’Île Rousse, pas du tout prévu pour les voiliers, mais où mes dernières forces me permirent quand-même de rapprocher suffisamment le bateau du quai pour qu’un pékin fort sympathique et qui avait tout compris saute à bord et termine le boulot. Les pompiers étaient déjà là et sur la route de Calvi les antalgiques qui étaient déversés par voie parentérale dans mes veines assoiffées, me permirent d’oublier toute cette histoire et de m’endormir écœuré par cet amoncellement de chances, contraire à toutes les lois de la Raison Pure.
Pourquoi vous ai-je raconté cette histoire avec tant de détails digressifs que c’en est dégoûtant ? Retournons en arrière pour comprendre. Je crois que nous parlions de la temporalité dans les différentes parties de l’existence, mais au paravent je décrivais ma situation à Mulhouse pendant les quelques mois qui séparèrent ma sortie de prison de la reprise de mes études après un Bac réussi par pure chance, car je n’ai strictement rien préparé, me fiant à ma culture déjà supérieure à celle d’un jeune candidat à ce diplôme qui, lui aussi , a perdu sa valeur tout en restant indispensable, une situation qui mérite une analyse, mais pas tout de suite. Pour l’instant je vais revenir aux faits. Engagé par Clemessy , où je gagne exactement le Smig avant une augmentation surprise et rapide qui nous rendit un peu de confort dans notre existence de tous les jours, d’autant plus que Jean avait aussi trouvé un job dans une entreprise beaucoup moins appétissante qui fabriquait des batteries d’automobiles : ambiance chimiques, acides etc… Sans parler de l’allergie radicale de Jean à toute forme de commandement. Cela dit nous vivions à peu près correctement, ayant ce qu’il fallait pour dormir, boire, manger et fumer. Ici se place un épisode répugnant mais indispensable à la bonne compréhension de mon parcours. L’état, c'est-à-dire la Police, la Gendarmerie et toutes les forces que j’avais pour ainsi dire défié pendant plusieurs années d’exil, ne l’entendaient pas de cette oreille, et ne comptait pas me laisser jouir tranquillement du modeste train de vie que j’avais eu tant de peine à mettre sur pied. Ils montèrent donc un piège minable, qui ne donna aucun résultat, mais leur permit seulement de noircir un peu plus les pages de mensonge de mon « sommier », faisant de moi un personnage répugnant, porteur de toutes les tares et décidément condamné à vie à rester en-dehors de toute fonction publique. Je crois l’avoir déjà mentionné, mais le fameux Casier Judiciaire contient en fait non pas une partie, non pas deux parties, mais 5 parties, dont la plupart sont secrètes et non consultables par n’importe qui. Le piège aurait pu s’avérer machiavélique et déboucher sur une catastrophe personnelle pour moi et pour tout le reste de ma vie, mais c’était sans compter sur mon QI exceptionnel car tout allait se décider autour d’un raisonnement qui mettra fin à la tentative d’intoxication systématique tentée par des gens qui me voulaient tout sauf du bien. Car il s’agissait bien d’intoxication au sens propre du terme. La méthode était resté la même, on me met pour la Xième fois une jeune femme dans mon chemin, une certaine Mimi qui ne payait pas de mine mais qui avait pour elle précisément un certain degré d’intelligence qui ne manque pas de me séduire et sans voir de raison de me méfier, j’ouvre ma porte à ses allées et venues. Sans savoir comment la chose est venue sur la table, la jeune rousse, ni jolie ni laide, avec seulement une petite lumière d’intelligence dans le regard, suffisant pour me désarmer psychologiquement dans une situation où je n’avais au demeurant plus rien à craindre, me propose de la drogue. Mine de rien elle sort de son sac une boîte de comprimés dans lesquels je reconnais ceux que ma tante m’avait donné avait ma plongée dans Fresnes, un produit pour lequel j’avais un souvenir reconnaissant et hédonique. C’était du Palfium, une morphine de synthèse qui faillit tuer un ancien coureur du Tout de France qui avait fini pas avaler cinquante comprimés par jour, ce qui indiquait un taux d’addiction peu commun.
A l’époque je travaillais dur à l’usine Clemessy et l’idée me vint de me servir utilement de ce produit dont Mimi m’assurait la fourniture gratuite en faisant état d’une relation particulière avec un médecin qui ne lui refusait rien. Cette idée était de me servir du Palfium pour effacer dès le vendredi soir les effets de fatigue et de stress de ce travail somme toute pénible, et au début tout se passa comme prévu. Et ça marcha au-delà de toutes mes espérances : pris dès le vendredi soi, un seul de ces comprimés me plongeait dans une euphorie qui me soulageait d’un seul coup du poids de cette forme d’aliénation que représentent des heures passées à répéter les mêmes gestes sans relations directes, ni de connaissance ni de pouvoir avec la totalité du processus dans lequel je n’occupais que la place d’une « phase » parcellaire et insignifiante. Si les cadres de Clemessy avaient procédé autrement, si on m’avait initié à la réalité de ce que je faisais et si on m’avait ouvert des perspectives intellectuellement crédibles et intéressantes, rien n’interdit de penser que j’aurais pu choisir d’inscrire une carrière dans cette entreprise promise par ailleurs à un brillant avenir. Mais les si ne remplacent pas la réalité et le Palfium m’encourageait à supporter semaine après semaine l’attente de la décision du CROUS que j’attendais depuis ma réussite surprise du Baccalauréat. Il se produisit alors un phénomène classique et que j’attendais sans panique : au bout d’un mois il fallut passer à deux comprimés pour obtenir le même résultat, puis trois, et lorsque je dus en venir à écraser quatre de ces minuscules petites rondelles dures comme pierre, je décidai d’en finir avec cette pratique. Mon calcul était simple. A cette allure – en trois mois j’étais passé de un à quatre comprimés – il me faudra très rapidement des quantités dont je n’aurais aucune garantie de fourniture malgré les promesses répétées de Mimi. Mais je voyais encore beaucoup plus loin, je voyais mon existence tout entière soumise à ce besoin chimique et aucune caverne d’Ali Baba remplie de Palfium pour assouvir une nécessité qui était condamnée à devenir de plus en plus tyrannique. C’est pourquoi je parle de QI, c’est bien un sordide calcul qui m’a « sauvé » du piège machiavélique que l’on m’avait tendu afin de me détruire de toutes les manières possibles. J’avoue, et cela me peine de le faire, qu’à aucun moment je n’ai alors soupçonné le piège, les agents chargés de gérer cette sorte de liquidation ont su se faire passer pour des jeunes gens aussi largués par l’existence que je l’étais à l’époque. Ce que j’ignorais et que j’ignore encore aujourd’hui, c’est de savoir si le petit-fils de général qui m’avait initié à l’héroïne lorsque j’étais encore pensionnaire du Val de Grâce faisait partie du complot déjà à cette époque ou s’il s’est agi là d’une coïncidence sans rapport. Aujourd’hui, après avoir fait les comptes de tout ce qui s’est tramé dans mon dos pendant toutes ces années, et au-delà, je parierai plutôt pour une première tentative qui a échoué, sans tout à fait échouer, car au fond on me faisait le coup classique de la pute qu’on accroche à une drogue pour mieux la contrôler et l’épisode du Palfium n’était que la seconde tentative de me liquider moralement et physiquement, curieuse vengeance d’une République que je ne pensais pas mue par des sentiments aussi vils. Bref, le complot Palfium échoua car j’arrêtai net d’avaler cette saloperie qui ne demandait qu’à envahir chaque fibre de mon corps et de mon esprit. Mimi et son acolyte dont j’ai oublié jusqu’au prénom disparaissent alors comme ils étaient venus. D’ailleurs les événements vont se précipiter à partir de décembre après la réception de l’acceptation de ma bourse d’études, décision qui allait m’obliger à rejoindre la capitale de l’Alsace que je connaissais déjà fort bien et où m’attendaient les situs qui me pressaient depuis ma sortie de prison de les rejoindre définitivement. Cet épisode peu appétissant n’aura duré que quelques semaines et je n’aurai vent de sa qualité de complot à la Retz qu’en Mai 68, lorsqu’une amie aura eu entre ses mains mon dossier policier secret, document qu’on lui a remis pour la dégoûter définitivement d’un personnage qui jouait à l’époque un rôle éminent dans les événements de Mai68. Là encore le piège n’a pas fonctionné, car l’élément le plus « dégoûtant » faisait mention de relations homosexuelles, ce qui, de nos jours passerait plutôt pour héroïque… comme tout le reste d’ailleurs.
Nous sommes en janvier 1967 et il me faut trouver à Strasbourg un logement, m’inscrire dans une faculté selon les exigences du contrat implicite à la bourse que me concédait le Crous. Côté logement les situs avaient déjà préparé le terrain et on me proposa immédiatement de reprendre un taudis occupé par deux néo-situs (expression qui désigne les candidats qui doivent encore passer sous quelques fourches caudines avant d’être inscrits dans le grand Livre de Guy Ernest Debord). L’un des deux réussira in extremis à devenir non seulement un situ reconnu mais même une sorte de dauphin dont Debord n’aura pas besoin puisqu’il décidera de dissoudre l’IS avant de se retirer totalement de toute activité autre que l’écriture. Ce personnage, aujourd’hui décédé, paix à son âme, était un certain Joubert qui tentera de faire survivre l’IS bien après sa dissolution en publiant entre autre une sorte de fanzine Situ dont j’ai oublié le titre mais qui n’était pas médiocre et aurait mérité un autre destin. Joubert ressemblait à Debord d’abord par son cynisme affiché et une intelligence rarement prise en défaut. Il traînait aussi derrière lui ce style de la saleté insolente que seul un enfant de le bourgeoisie peut assumer en supportant tous les inconvénients liés au laisser-aller du corps et de ce qui l’enveloppe. Ces négligences allaient très loin et un jour je rencontre Khayati affligé d’une monstrueuse chique qui déformait son visage à manquer de le reconnaître. Négligemment je laisse tomber qu’après une expérience comme celle-là je m’étais décidé à me brosser les dents régulièrement et que faute de respecter ce rite, je me retrouvais toujours avec une bouche pâteuse. Il me répond du tac au tac, -« moi c’est quand je me lave les dents que je me sens la bouche pâteuse » - je me suis cru sur l’Agora d’Athènes en train de bavarder avec Chrisippe ou Diogène et j’ai bien ri de la répartie irréfutable de ce grand situ.
Plusieurs événements allaient me marginaliser par rapport au groupe de buveurs de bière que constituait la section strasbourgeoise de l’IS et parmi eux le sentiment de retrouver le comportement des courtisans de métier que j’avais connus dans mon passé militant. Les propos et les intentions déclarées rampaient littéralement devant l’image du Dieu Debord, et cela se ressentait surtout par le fait que mes amis les plus proches ne mettait aucun frein à la flagornerie permanente dont ils étaient l’objet. Ils avaient ainsi désigné un certain nombre de d’étudiants qui avaient accès à leur table de temps en temps et qui servaient d’hommes de main en cas de besoin. La prise de l’AFGES par les situs a été effectuée en fait par des non-situs candidats et qui le resteraient pour toujours. On peut citer Schneider, Vayr-Piova ou même Joubert qui n’étaient que des exécutants et n’auront accès au repère de la rue Jacques que bien après, pendant et après les journées de Mai68. Ces courtisans étaient pilotés par le groupe resseré de Khayati, Théo Frey et sa sœur Edith, Jean Garnaud et l’intello de choc, traducteur de Hegel et plus tard Professeur d’Université le discret Herbert Holl que la vie quotidienne absorbera le premier sous ses formes triviales du mariage et de la fonction de reproducteur. A cet aspect de la vie du groupe il faut ajouter une ambiance continuelle d’intrigues et de renversements permanents d’alliances qui devaient aboutir à terme à une purge qui n’allait pas tarder.
L’événement majeur qui allait décider de mon attitude définitive par rapport au groupe fut un fait-divers débile mais qui me révéla d’un coup la nature politique des relations qui (dés)unissaient ces jeunes gens et me remplit d’un dégoût qui a pour conséquence de raréfier mes apparitions dans les bistrots où se réunissaient les maîtres de cette avant-garde qui ne réussit jamais à échapper à cette image d’intellectuels révolutionnaires, possesseurs de la nouvelle Bible idéologique que peu de gens étaient capables de lire et de comprendre. En fait, beaucoup de choses se jouaient autour de la simple compréhension de la démarche des situationnistes qui avaient déjà une histoire qui remontait aux années cinquante et qui disparaissent pratiquement totalement à partir de l’épisode strasbourgeois. La lecture de la revue était tout sauf facile, car à une culture générale et politique minimale s’ajoutait la nécessité d’acquisitions lourdes telles la lecture de Marx, de Hegel et de leurs épigones. Imaginez le destin d’un tel impératif aujourd’hui, à commencer par la culture générale, les notions les plus simples de la philosophie et des sciences humaines y compris les mathématiques qu’un rapport trouble avec le lacanisme rendait encore plus abstrus. Bref, l’intelligence – définie par Debord au cas par cas et dont la définition pouvait s’étendre jusqu’à l’absence complète de la moindre connaissance solide, à condition qu’une telle inculture soit compensée par un trait de caractère qui plaisait au pape, et pas toujours des plus ragoûtants. Vayr Piova a fini par séduire Guy Ernest par son cynisme sans scrupules de futur truand. Voici donc l’incident qui me coupa définitivement de tout désir de faire partie de la constellation Debord, le personnage lui-même m’ayant déjà, souvenez-vous, fait comprendre qu’aucune empathie ne s’était créée entre nous, bien au contraire.
Je viens de perdre quelques pages écrites hier par manque de vigilance, oublié d’enregistrer.. En fait, ça m’arrange car le récit sera plus court et l’événement en lui-même ne méritait pas tant d’efforts. Replaçons le décor : les situs passaient l’essentiel de leur temps dans deux ou trois bistrots où ils remplissaient de grandes tablées d’authentique membres de l’IS, et d’une petite foule de copains et de candidats qui à l’occasion se transformaient en hommes de main lorsqu’il s’agissait de passer à des actions que l’IS ne voulait pas revendiquer directement, mais laisser dans un brouillard propice à tous les bruits de couloirs. Janvier 67 est un peu l’acmé de ce groupe dont la hiérarchie, car hiérarchie il y avait, se décline à peu près ainsi : Khayati (soupçonné depuis longtemps comme espion direct de Debord), Théo Frey et sa sœur Edith qui supportaient de moins en moins bien cet œil de Moscou qui avait eu, de plus, la prétention d’être le seul auteur du best-seller situationniste « De la Misère en Milieu Etudiant ». Pour ma part je ne peux pas témoigner sur cette affaire car pendant que ces messieurs écrivait leur pamphlet, je brossais les armoires électriques couvertes de sel. Venait enfin un personnage un peu marginal mais de loin le plus sympathique et le plus cultivé du groupe, à savoir Herbert Holl. J’oublie, et pas pour rien, Jean Garnaud, le futur mari d’Edith et futur fonctionnaire aujourd’hui à la retraite comme son épouse. Au plus proche de ces personnages, les deux guignols dont j’ai longuement parlé lors de mon exécrable aventure dans les Vosges en leur compagnie, à savoir Fischer et Dolphi qui s’étaient également installé à Strasbourg entre-temps, le premier pour faire une licence qu’il mettra des années à finir et le second pour jouir d’une invalidité qui lui permettait de gagner de quoi vivre en travaillant un jour et demi par semaine. Mais leur rôle se limitaient à alimenter la rigolade en permanence, les intrigues de palais, et de jouer les portes-flingue pour Théo auquel ils devaient leur « promotion » à la table des princes de la Fronde. En fait, j’ai pu établir des années plus tard que Théo se servaient de ces deux sbires pour s’approvisionner gratuitement en livres et en disque à Mulhouse dans la grande surface qui allait devenir plus tard la FNAC. Je crois avoir déjà fait état de mon mépris pour ce comportement devenu courant et même à la mode dans ce milieu de faux rebelles. Vingt ans plus tard, l’un d’entre eux et non des moindre avait réussi à mettre au point un système de « sortie » de marchandise de la FNAC de Strasbourg qui lui permit de rassembler la totalité de la collection de la Pléiades. Venaient ensuite une autre série de courtisans recrutés dans les cours de Henry Lefebvre et qui deviendront les véritables exécutants des « coups » que la presse nationale attribuera sans le moindre contrôle à Guy Debord et aux membres de l’IS malgré leur propre dénégations.
A cela il faut ajouter une toute petite notule théorique : les situs se targuaient d’une liberté totale dans le comportement, le vol à l’étalage n’étant qu’un aspect trivial d’ un « esprit libertaire » absolu qui ne souffrait aucune limite. Elle fut cependant atteinte pour moi, le jour où un sbire dont je n’ai pas encore parlé, à savoir le seul proche de Khayati, Nasri, un Tunisien qui deviendra haut fonctionnaire de l’ONU après avoir bâclé quelques diplômes volontiers délivrés par Lefebvre qui, à l’époque, n’avait pas encore rejoint les intellectuels massacrés par Debord dans la revue de l’IS où il finira dans les poubelles de l’histoire, à l’époque donc où ce personnage me menacera de mort devant une tablée de situs hilares et complices. La cause de ce surprenant incident était le commencement d’un flirt, la veille, avec sa compagne officielle, liaison que je ne connaissais même pas, la jeune Françoise, surnommée très justement Framboise, pensant comme moi disposer de sa liberté sexuelle et sentimentale. Khayati ayant décidé visiblement de soutenir le point de vue de son ami tunisien, tout le monde suivit cette décision et je quittai cette assemblée la rage au ventre. Les deux Arabes n’en restèrent pas là puisque Framboise me signifia mon licenciement la larme à l’œil. Sacrés situationnistes. De ce jour, je cessai de fréquenter régulièrement ces assemblées de beuverie où on discutait d’ailleurs rarement de théorie, les réunions « sérieuses » se tenant dans l’un ou l’autre domicile des « historiques » du groupe. Je ne prétends pas être témoin de la vérité concernant la rédaction du texte sur les étudiants qui fit tant de bruit et connu des centaines de tirages bien longtemps encore après Mai68 et dont Théo s’était réservé une bonne quantité d’originaux dont il tira de grands bénéfices. Je me souviens cependant d’une séance, vers la fin de 1966, dans l’appartement qu’occupaient Théo et sa sœur rue de Bruxelles (détail que je donne à l’intention des personnes concernées si ce texte leur tombe un jour sous la main) et où l’on rédigeait bel et bien en commun un chapitre entier de cette Misère en Milieu Etudiant. Si ça se trouve, je pourrais bien avoir avancé l’une ou l’autre idée pendant cette séance privée. Cette circonstance fait que j’ai toujours nié l’affirmation imposée par Debord dès 68 selon laquelle ce libelle avait été écrit entièrement par le seul Khayati.
Revenons à moi. Janvier 1967, nanti de mon inscription comme étudiant en Sciences Economiques, je fais connaissance de la patronne du Crous, l’institution chargée de gérer les bourses, les cités et les resto U. Elle me parcourt des yeux d’un air gourmand, mon dossier l’a mise en appétit et je n’aurai jamais à me plaindre de ses décisions me concernant. Comme un idiot je néglige de demander un logement, j’aurais pu obtenir une rallonge à ma bourse qui était déjà au maximum malgré les revenus pharaoniques de ma mère. En fait, j’avais fait la preuve que j’avais vécu de manière indépendante depuis des années et légalement cette circonstance suffisait pour me permettre de prétendre à ce que l’état attribuait de plus consistant aux étudiants nécessiteux. Une sorte d’ange gardien me suivra pendant des années aussi bien au Rectorat qu’au Fisc qui me traita toujours au mieux de mes intérêts. Cette protection occulte ne laissait pas de m’intriguer, mais je ne saurai jamais le fin mot de l’histoire. Il devait quand-même y avoir, dans l’un ou l’autre bureau d’un haut-fonctionnaire un homme qui avait été sensible aux choix que j’avais fait par rapport à la guerre d’Algérie. Je ne dirais pas la même chose des autorités locales, des élus communaux et départementaux qui me prirent immédiatement dans leur collimateur et ne me lâcheront plus jusqu’à ce que je disparaisse en 1969, licence de Philosophie en poche et sous la contrainte d’un chantage honteux de ma compagne dont il va falloir maintenant que je vous parle.
Danièle me repéra dès ma première entrée dans l’immense amphithéâtre où Lucien Braun faisait son « cours » d’esthétique. Je mets le mot esthétique entre parenthèse car je n’ai jamais considéré cet enseignant comme à sa place dans la faculté de philosophie. On y reviendra. Or elle était placée à l’autre bout de la salle et c’est donc à la fin du cours qu’elle croisa mon chemin et m’entrepris sans prendre de gants. A vrai dire elle n’était pas la seule à m’avoir dévisagé pendant le cours, car mon aspect vestimentaire et capillaire faisait de moi un étudiant hors normes. Mes salaires de chez Clemessy m’avait permis de me payer un caban bleu marine très élégant et surtout très original, le caban sera à la mode seulement quelques années plus tard. Caban, jean délavé sur bottes américaines (pas des Santiag, mais celles de l’armée, le genre de chaussures que n’importe quel fille ou garçon des temps présents doit posséder dans sa garde-robe. Bref mes cheveux blonds et longs sans affectation donnait une note romantique à une allure plutôt rogue et méchante. Je me sentais à l’aise pour la première fois de ma vie. Les cinq années que je venais de passer m’avaient débarrassé d’un fatras de complexes et d’une timidité cachée mais bien réelle. A l’armée et en prison j’avais puisé assez d’agressivité pour remplacer en moi le père dont j’avais été si longtemps vidé, éviscéré, escroqué, bref la violence ne me faisait plus horreur dans le registre du quotidien. Elle gardait toute sa laideur morale et esthétique mais mon corps avait été souterrainement préparé à prendre sa part de relationnel sans me plonger dans la panique héritée de mon enfance passée trop brutalement d’un régime de surprotection dont je n’avais même pas conscience aux brutalités de la rue et de l’école, même bourgeoise. C’est d’ailleurs parmi les plus riches d’entre eux que j’ai fait mon expérience la plus traumatisante de la violence pure, douloureuse et surprenante dans son absurdité. C’était chez les Jésuites, une fois de plus je dois me poser la question paranoïaque : jusqu’où les « bons » Pères n’avaient-ils pas plus ou moins télécommandé cet attentat où j’ai failli perdre l’usage d’une oreille. Ca s’est passé sur un stade où la soif nous avait fait déboucher nos gourdes et, comme à chaque fois, ce geste déclenchait le jeu de l’eau, aspersion réciproque parfaitement ludique, et au moment où j’allais mettre fin à ma participation à ce jeu vraiment innocent tant il faisait chaud en ce Juin 55. C’est à ce moment-là que je reçu sur mon oreille gauche un swing d’une force invraisemblable : au-dessus de moi je pus distinguer à travers les trente-six chandelles provoquées par le choc le rictus haineux d’un condisciple que je croyais bêtement appartenir au petit carré de mes amis et auquel j’avais même rendu visite dans son village natal que je connaissais bien, le Bonhomme, où son père, Monsieur Rinaldi, dirigeait une entreprise du bâtiment assez prospère. Rinaldi est devenu entre-temps, le Tapie de l’Alsace centrale et amassait sa fortune avec, sans aucun doute, la brutalité qui avait caractérisé son coup de poing, geste qu’il faudra ajouter à la liste de ce à quoi peut aboutir l’éducation jésuitique. Lorsque des décennies plus tard je tentais de le contacter pour un reportage sur sa carrière de self milliardaire, il refusa sans même me prendre au téléphone, mépris, arrogance, méchanceté et bêtise incurable, autre conséquence de la cooptation par les Pères d’un simple homme de main qui n’aurait certes rien d’autre à apporter à l’Eglise que son argent, mais c’était déjà largement suffisant.
J’ai encore mal à cette oreille parfois et ne suis pas loin de penser que cette agression hypocrite, car l’ambiance était vraiment au jeu et non pas à la bagarre qui était extrêmement rare au Collège, voire inexistante, avait été planifiée de très haut. Les Pères avaient ce genre d’attentats à leur actif, ils contrôlaient admirablement les pulsions de violence de ces adolescents. Ils n’étaient certes que de jeunes aristocrates français, et n’avaient rien des Allemands, c'est-à-dire que le duel ne faisait pas partie de la formation à une certaine forme de « virilité ». A St Clément il n’y avait pas d’autre élève Törless que moi. Cette politique pacifique devait être une lointaine trace de la mentalité de Mazarin et de Richelieu qui cultivaient une véritable haine pour le duel, pratique qui renforçait l’indépendance d’esprit des féodaux qu’il fallait mâter. C’est pourquoi on encourageait en revanche les pseudo affrontements au polochon ou à l’eau comme au stade. Cette pédagogie a dû former une élite très particulière parmi les élites du reste du monde, et je pense en particulier aux Allemands et aux Anglo-Saxons qui ne conçoivent pas de pédagogie sans une dose régulière et forte de violence. Il n’y a pas longtemps que l’on a mis fin aux duels dans les établissements privés germaniques et en Amérique, le défoulement s’opère à travers les sports dont la brutalité est effrayante. La remontée du rugby dans le paysage sportif français marque peut-être un tournant dans cette tradition de douceur qui va très bien avec la « doulce France » : nous rattrapons notre retard…Que dire encore des éducations nippones, par exemple, ou singapourienne, où l’on pratique encore la punition par la canne sur les parties sensibles, ou encore les civilisations dominées par l’esprit de la Charia. Bref, en méditant ce tout petit incident, on peut tirer des conséquences historiographiques non inintéressantes sur l’Esprit des peuples au vingtième siècle. Il est vrai, par ailleurs, que le peuple de France n’avait plus l’esprit à la guerre à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la Première lui avait, une fois pour toute rouvert la conscience et la mémoire sur le massacre engendré par les aventures napoléoniennes qui avaient désertifié nos campagnes. Mais j’ouvre cette parenthèse pour ce qui concerne ma propre relation à la violence et non pas de digresser encore et encore sur l’histoire de l’Europe et du monde.
J’ai toujours haï la violence, aussi loin que je remonte dans mon enfance, je me rappelle avoir toujours fui toute sorte de bagarre, dans les cours de récréation, dans les rues et même à la maison où mon frère cadet, comme je l’ai déjà longuement décrit, me sadisait comme il pouvait. Cela ne manqua pas de poser le problème du courage, valeur qui figurait encore, à cette époque, en tête des vertus premières, comme au temps de Rome ou d’Athènes. Et comme notre éducation ne manquait pas de se centrer presque automatiquement sur cette valeur, les occasions ne manquant jamais dans les diverses disciplines d’une culture générale, ce concept me posait de graves questions. Etais-je un lâche ? Cette question devint vite une hantise à laquelle il fallait trouver réponse, encore fallait-il trouver un registre sur lequel donner consistance ou réalité à une réponse possible. Théoriquement mes réponses étaient assez cohérentes, ne déparant guère de la thèse classique de St Thomas, où la témérité et l’audace sont considérées comme des péchés et le courage essentiellement centré sur la résistance à la tentation et la défense des valeurs cardinales. Je n’avais aucun mal à mépriser la brutalité de mes camarades de classe, violence abstraite et pure exhibition de force à laquelle je me suis toujours dérobé en accumulant contre moi des haines que j’ignorais réellement. Mais je n’ai fait la découverte de ce processus que bien plus tard, dans des expériences comme celle de Framboise ou encore avec Béatrice dont un ex-amant et ex-mercenaire au Katanga m’agressa un soir, ou plutôt me contraignit à l’agresser par pure chevalerie, l’issu d’un combat avec ce parachutiste au chômage ne faisant aucun doute. Inutile d’ajouter que le combat fut bref et me permit de sauver l’honneur avant de me sentir réveillé par un verre d’eau glacé. A vingt ans je lis tout Gandhi et sors archi-pacifiste de cette lecture. Mais ce pacifisme était de nature politique et ne venait que confirmer au plan de l’histoire l’efficace du mépris dans lequel je tenais la violence. Les inflexions tactiques que j’ai réussi à donner aux événements de Mai 68 à Strasbourg est un fruit de cette méditation de Gandhi. Dans les affrontements politiques, la non-violence produit un vide qui désarme l’adversaire, car de deux choses l’une, ou bien il se démasque en exerçant sans retenue la puissance des armes – il découvre d’un coup la vérité de ses objectifs – ou bien il recule en cherchant la voie de la négociation. Nous y viendrons lors des événements de Mai 68 qui se préparaient déjà dans les Winstubs de Strasbourg.
Danièle Paulen devint ainsi ma compagne sous les conditions à cette époque « naturelles » d’une liberté totale de chacun. A cette époque je fréquentais à Mulhouse une jeune eurasienne du nom de Béatrice (Je tairai son nom de famille par respect pour son destin ultérieur et m’abstiendrai de donner des détails sur son origine et sa vie malgré leur intérêt réel. C’est un exemple de ce qu’une biographie qui veut aller jusqu’aux limites de l’exposition doit se donner comme limites et je m’en tiendrai là). Il s’installa donc une alternance dont je dû constater rapidement le caractère douloureux pour Danièle. Je quittai rituellement Strasbourg pour Mulhouse le vendredi soir en stop pour passer le week-end avec cette jeune fille qui plaça en moi, à mon insu, des espoirs de plus en plus concrets d’un avenir commun et exclusif. Le dimanche soir, c’est elle qui me payait le billet de train pour mon retour sur Strasbourg où m’attendait une Danièle en pleurs de semaines en semaines plus agressifs et plus outrageants pour nos conventions initiales. La conscience et la mémoire sont curieusement muettes sur certaines questions et je ne saurais affirmer si le statut que j’avais clairement affiché à Strasbourg quant à ma liberté était aussi clairement établi à Mulhouse. Je peux difficilement imaginer le contraire, car la liberté dans le domaine de mes relations avec les femmes était devenue une seconde nature de ma vie affective. L’échec de mon « grand amour » avait détruit, me semblait-il alors, les racines de toute possibilité de m’attacher définitivement à une personne, de lui consacrer consciemment le reste de mes jours. Malgré ses dénégations, Béatrice savait qu’à Strasbourg je vivais avec une, voire parfois plusieurs partenaires, mais voulait l’ignorer tout en construisant autour de ma personne un environnement dont je finis pas soupçonner la finalité. Elle commença par louer un autre appartement, nettement plus confortable et se transforma en véritable femme d’intérieur, me gâtant de bonnes choses et de divertissements comme la musique et le cinéma grâce à l’argent qu’elle commença à gagner comme secrétaire dans un service public où elle fit carrière. Bref, elle créa une situation qui lui permettait de croire, de se persuader que ma véritable existence se passait pendant ces week-end consacrés aux restaurants, au sexe qui semblait la laisser indifférente, et à notre installation de plus en plus bourgeoise au sens d’une insertion devenant chaque semaine un peu plus évidente pour elle. Ici je dois avouer que je ne pris pas garde à ces évolutions, et j’interprétais son comportement comme des décisions concernant sa propre existence, car sa situation familiale était devenue intolérable pour des raisons que je dois taire comme je l’ai dit plus haut. En fait, je pensais alors que cette jeune femme organisait sa propre vie et n’était pas en train de préparer un nid qui pourrait un jour devenir un domicile conjugal. Naïf comme toujours, je ne lui avais pas caché que mon désir avait toujours été d’avoir des enfants, mais l’échec de ma vie sentimentale avait mis un point final (qui s’avérera provisoire des années plus tard) à cette idée de procréation. Mais n’est pire sourd que celui qui ne veut point entendre, et Béatrice s’installa silencieusement dans un programme copulaire ad libitum. Je veux dire par là qu’elle préparait silencieusement une véritable relation conjugale tout en effaçant soigneusement de son esprit tout ce qui pouvait lui rappeler les conditions de notre rencontre au bar du Moll, l’endroit où quelques mois plus tôt j’avais rencontré de la même manière la petite Colette qui vécu à mes côtés l’aventure de la colonie de vacance et dont je me séparai un jour sans raison particulière et sans drame.
Je ne ferai pas court sur ce sujet, car si je connais la notion et le sentiment de remords, c’est à cause de ce qui suivra deux années plus tard, quand Béatrice en sera venue à penser que notre relation était devenue une promesse de quasi mariage et que je décidai alors de la quitter pour suivre Danièle qui avait décidé de me forcer à choisir entre elle et sa rivale mulhousienne. Nous viendrons chronologiquement à ces événements qui furent apparemment douloureux pour ma jeune compagne eurasienne, mais avant de poursuivre, je dois ajouter que le problème de mes relations érotiques, car il n’est pas question ici de parler d’amour, étaient pour moi parfaitement secondaires, sinon qu’il manifestait à cette époque une dimension réelle et structurelle de ma personnalité qui m’interdit l’idée de vivre seul. Je pourrais encore digresser longuement sur l’état d’esprit général de la jeunesse et donc des jeunes filles à cette époque pré-soixante-huitarde, mais l’analyse se fera presque automatiquement au vu des faits et pas toujours, hélas, dans le sens que l’on pourrait penser. Le profond désir de liberté qui fit gronder la jeunesse bourgeoise de 68 n’a certes pas été l’apanage des mâles, mais les femmes n’ont que très rarement vécu cette bataille de la même manière que les garçons. Je veux citer pour exemple du malentendu qui persistait entre les genres, celui de la compagne d’un camarade mulhousien qui se pendit à Strasbourg, prise dans le double-bind (piège à double-entrées) d’un amour passionné pour un garçon qui était loin de reconnaître chez la femme un égal réel. Trop lucide pour son temps, Françoise, puisqu’elle portait aussi ce prénom, avait compris trop tôt qu’elle ne pourrait jamais vivre avec cet homme fruste et brutal quoique fréquentant l’université. Il se montra d’ailleurs totalement indifférent à une mort que la jeune femme mit pourtant en scène dans sa chambre à lui, comme pour lui faire prendre conscience à tout jamais de sa responsabilité. Mais Françoise était une exception car la grande majorité des jeunes filles n’étaient qu’à moitié conscientes de leur condition de relative servitude par rapport aux hommes. Même Edith, la propre sœur du « grand » « situationniste » Théo Frey, se plia à l’oukase de son frère lorsqu’il fut un jour question que je la fréquente et que ce projet s’avéra ne pas lui plaire pour des raisons de tactique interne à l’Internationale Situationniste : il voulait « marier » sa sœur à son plus proche disciple, Jean Garnaud, ce qui finit par se réaliser au-delà de ses espérances mais bien loin des principes éthiques de cette bande de jeunes désespérés. A l’heure qu’il est, le couple en question jouit en parfaits béotiens d’une retraite de fonctionnaires fort éloignée des ambitions révolutionnaires de ces jeunes gens des années Soixante. Comme quoi les politiques dites « de succession » n’infestent pas seulement les familles princières. Inutile d’ajouter que tous ces petits événements de la vie quotidienne avaient fini par dissoudre jusqu’au dernier cristal, mon admiration pour l’IS et ses membres qui ressemblaient davantage au personnel du Directoire qu’aux héros de 1793. J’en fus même dégoûté lorsque je fus confronté à leurs actions ridicules de petits vandales frustrés qu’ils se permirent pendant les journées de Mai 68. Car ce fameux mois de Mai se rapprochait, et les Situationnistes strasbourgeois avaient déjà fait parler d’eux jusque dans la presse nationale par des actions du style entartage et jets de tomates sur des assemblées de mandarins universitaires, et surtout par la publication lors de la rentrée de 1966 de la future petite bible pour étudiants qui leur rappelait « (Leur) misère en milieu étudiant ». Je n’ai pas pris part à ces petits scandales qui provoquèrent curieusement l’intérêt des grands médias nationaux de l’époque, à l’exception du devenu fameux coup d’état qui permit aux sbires des situs de prendre l’AFGES, l’Association dite des étudiants strasbourgeois en pleine déliquescence.
Je soupçonne une manipulation en règle par les situs de Paris, qui avaient de l’entregent et savaient se faire suivre par l’œil de Big Brother quand il y allait de son intérêt. Ces actions permirent aussi aux Situs de se faire dans l’opinion des étudiants les pères spirituels de Mai 68, ce qu’il est difficile, voire impossible de nier, même si tout fut fait dès la fin des événements pour effacer toutes les traces de leur présence dans les faits. Les livres les plus pointus sur Mai 68, dont celui de Joffrin, font à peine allusion à leur présence en insistant sur l’aspect le moins intéressant de leur action, à savoir la tentative de prise de pouvoir de Debord à la Sorbonne. Non, la vérité de leur influence sur Mai68 est dans les idées qu’ils ont répandues dans les deux années qui ont précédé et surtout le coup d’état par procuration qui leur donna le pouvoir financier que représentait la Présidence et le Secrétariat de la MGEN, source de toutes sortes de détournement, de « perruque » dont de bien sinistres et minables petits hold-up sur des biens matériels dans les locaux mêmes de l’Assurance des Etudiants . A cette époque la MGEN avait le monopole et la MGEL n’existait pas encore, la main basse sur l’administration de cette complémentaire étudiant, leur a d’ailleurs permis, immédiatement de régler la facture de la première édition de la « Misère », édité à Cinq mille exemplaires et imprimés chez un sympathisant de Haguenau. Je m’en souviens pour avoir trimballé des cartons remplis de ces petits livrets qui allaient connaître une fortune qui n’a jamais faibli jusqu’à nos jours. Les exemplaires de cette livraison se vendent à Bruxelles chez les bouquinistes à un prix tout à fait exorbitant, ce qui prouve que les produits des situationnistes sont bien devenus des marchandises malgré leurs rites d’exorcisme et leur prétention affichée de ne pas entrer dans le système des copyright. Théo possède à l’heure qu’il est, une bonne réserve de ces lingots de papier dont il peut toujours se servir de monnaie d’échange pour des objets de l’une de ses nombreuses marottes de collectionneur. C’est l’une des grandes différences qui nous sépare, Théo et moi et ce, à partir d’une base sociologique relativement commune de petit bourgeois de la grande cité industrielle du Haut-Rhin. Je me souviens de la maison de son père à Pfastatt aussi vide et nue que l’appartement de ma mère après le décès de mon père. Or pour ma part, je n’ai jamais ressenti le moindre désir de garnir ce vide, même si comme tous les enfants de cette époque, j’ai soigné pendant quelques années mon herbier et mes petits stocks d’insectes qui me fascinaient par leur beauté. Théo c’était tout à fait autre chose : son enfance et son adolescence avaient été dramatiques, sadisé par un père qui était en même temps son instituteur et qui commençait chaque journée d’école par un châtiment infligé à son fils pour montrer qu’il était indemne de tout népotisme et à la fois pour contraindre son engeance à travailler suffisamment pour être toujours le Premier de la classe. Un tel père n’aurait jamais toléré que son fils ne fût pas le meilleur, le plus intelligent et le plus naturellement destiné aux études les plus raffinées de son temps. C’est pourquoi Théo fit de la philosophie, matière qui, dans les années cinquante, était encore la discipline reine de l’enseignement du second degré. Il eût de surcroît la chance d’avoir parmi ses professeurs de faculté deux individus illustres, dont l’un ajoutait de vastes connaissances en économie-politique à une ontologie grignotée par le simplisme de la dialectique marxiste et influencée par la montée des sciences humaines et des « Visions du Monde » idéologiques qui flirtaient depuis longtemps avec les textes de Debord. Il s’agissait de Henry Lefebvre qui terminait sa carrière universitaire à Strasbourg rattrapé par l’âge (encore qu’il continua par la suite à donner des cours à la Sorbonne jusque fort tard dans une vie qui s’acheva tout près des cent ans d’existence. Or son vrai maître d’étude, le Professeur qui suivait particulièrement l’évolution intellectuelle de quelques étudiants choisis, était un autre illustre philosophe qui se distingua en Mai 68 par un départ en fanfare pour le Canada après avoir condamné de la manière la plus dure le mouvement étudiant. Professionnel de la philosophie, Gusdorf était surtout un historien de la discipline ; en témoigne une œuvre prolifique dénuée de la moindre idée originale et qui, à l’instar d’une école française en fort mauvais état, s’ingéniait à slalomer entre le « fonds » classique de la philosophie universitaire et platonicienne, dans la lignée dominante tenue à cette époque par Ricoeur et ses deux cauchemars qui, il est vrai, rongeaient gaillardement la Science hégélienne, à savoir le Marxisme et la psychanalyse. Récemment, mon vieil ami Jean-Marie Wagner, illuminé par une sorte de mysticisme esthétique qui se passionnait pour les jardins de la Renaissance, me vanta le « Gusdorfisme » comme une véritable philosophie, chose impossible tant cette « philosophie » était toute entière traversée par une position chrétienne, et donc théologique, sans fards.
Je reprends cette biographie après pratiquement deux ans d’arrêt. On me pardonnera donc si un anachronisme ou une légère incohérence se manifestait dans la compréhension de ce qui suit. Mais si j’ai bien compris, j’en suis à la veille, ou presque de Mai68 (je choisis cette manière de représenter l’expression car elle me plaît) et c’est là un chapitre important de ma petite existence, car c’est à cette époque qu’elle, cette existence, s’est un peu hissé au-dessus du panier général en montrant de quel genre d’initiative et d’esprit d’à propos elle était capable. La mémoire est chose fragile mais je peux me souvenir avec précision comment ce fameux mois de Mai 1968 est entré en mouvement pour nous, étudiants de Strasbourg et parlant de philosophie dans les locaux hideux et même pas confortables de l’Esplanade, une faculté qui s’appellerait plus tard l’USHS, raccourci dont j’ignore encore aujourd’hui le sens exact et qui en dit long sur ce qu’était devenue l’Alma Mater, si : Université Des Sciences Humaines de Strasbourg. C’est encore pire que le simple acronyme, il suffit de penser à ce que sont les Ressources Humaines dérivant des Sciences dites Humaines, pour comprendre ma répulsion pour ce langage « post-moderne ». Donc nous étions en cours de Philo-géné, avec notre professeur « principal », Philippe Lacoue-Labarthe (paix à son âme, cet homme, qui a été mon ami vient de décéder après une vie pas très heureuse malgré le fait qu’il soit devenu un Grand Homme de la philosophie et de la littérature, et ce bien qu’il ait toujours refusé d’admettre qu’il était philosophe. La porte s’ouvrit donc avec un certain fracas et un étudiant se précipita dans notre salle en brandissant un message provenant de la Centrale de l’Unef (le syndicat des étudiants le plus représentatif à l’époque) et qui était un manifeste de protestation contre l’arrestation à Paris d’un groupe d’étudiants qui s’étaient battu avec un commando du GUD, la formation fascisante de Le Pen, alors lui-même agitateur d’extrême-droite. On dit d’ailleurs que c’est dans ces bagarres qu’il perdit un œil, mais cette question doit rester obscur pour l’histoire, du moins tant qu’il vivra. Nous étions de ce fait sommé de réfléchir à l’action que nous devions mener pour contrer cette ignominie du gouvernement et cette réflexion fut de courte durée puisque dans l’heure nous fûmes en grève illimitée, pour commencer… Nous rédigeâmes donc sur le pouce une réponse à la question du syndicat, exigeant la libération immédiate et sans condition de nos camarades parisiens (parmi lesquels figuraient la plupart des étudiants qui vont créer le mouvement du 22 Mars, en souvenir d’une bagarre avec le Ministre de l’Education Peyrefitte dont la fille avait été un peu bousculée à la piscine de l’université de Nanterres. Peu de Français savent que ces incidents de lèse-ministre dont la fille de Peyrefitte était au demeurant complice sont en fait la véritable origine de Mai68 au sens où le Ministre dépité s’est retourné contre les étudiants en les faisant arrêter pour tout à fait autre chose.
Mais le choix du gouvernement avait été catastrophique de mettre sous les verrous de jeunes fils de famille qui n’avaient pas eu d’autre tort que de combattre les derniers fascistes de la République : ce fut un tollé immense et souvent passé sous silence. Nous ne pouvions tout simplement pas comprendre le comportement de De Gaulle dans cette affaire, lui l’antinazi par définition. Bref, nous nous arrêtâmes à cet instant précis d’être des étudiants et devînmes ce jour-là des Soixantuitards pour le meilleur et pour le pire.
Le meilleur ne tarda pas, car les événement vont se précipiter. Comme d’habitude le gouvernement tente toutes sortes de manœuvres de diversion et perd du temps à répondre à ce qui est devenu un Ultimatum national de facultés de tous horizons que le téléphone unit pour la première fois dans leur histoire. Pour Strasbourg, le télégramme qui arrivera rue de Varennes contient une condition originale : les signataires exigent, en plus de la libération des étudiants, l’Autonomie de leur Université. On ne sait pas bien par qui et comment cette clause a été inventée, mais le mot autonomie n’avait pas encore sa mauvaise réputation d’extrémisme pas toujours de gauche, et le mot plaisait à tous, sauf à moi. Le plus drôle, dans la mesure où l’on peut parler de drôlerie, c’est que cette condition fut acceptée par le Ministère (entre-temps passé dans les mains d’Edgar Faure) et Strasbourg aura été la première Université Autonome, ce qui ne manqua pas de poser de graves et difficiles problèmes de gestion bien après les événements : comment un simple télégramme peut se transformer en texte ayant force de loi, étant entendu que la réponse du gouvernement avait été étudiée et votée par le Parlement où Edgar Faure a longuement pris la défense des étudiants et de leur désir d’autonomie universitaire. Il savait ce qu’il faisait, car le pot aux roses fut finalement découvert et l’on appris par le « haut » que la fameuse condition d’autonomie pour l’Université avait été ajoutée par le Doyen lui-même, le sieur Livet, très content de jouer un tour à ses collègues et qui savait exactement ce qu’il faisait, ce qui était rare en ces temps de confusion. En fait l’Autonomie était taillée sur mesure pour une Université riche, dans une région riche et qui cesserait de dépendre du bon vouloir d’un système centralisé à Paris et qui exerçait une dictature économique inacceptable sur les régions si inégales du pays. Voilà ce que pensait l’esprit d’égoïsme qui régnait alors sur la France, chacun pour soi et nos vaches seront bien gardées, on a souvent et trop oublié ce témoignage d’un état d’esprit déjà largement empoisonné par les principes de privatisation et de séparation inhérents au capitalisme le plus crasse. C’est paradoxalement en Mai68 que cet esprit qui ravage aujourd’hui l’humanité entière trouve ses premières expressions apparemment secondaires mais si justes.
Ce jour du 2 ou 3 mai, je ne sais plus exactement, rapportez-vous au livre de Joffrin qui est quand-même ce que j’ai lu de plus sérieux, pour la précision des dates, marqua le changement de statut et d’aître dirait Heidegger de l’universitas classique. Rien ne sera plus comme avant ce jour où les étudiants ont commencé par se regarder surpris de leur propre audace pour se réveiller chaque jour de ce mois miraculeux, un peu plus audacieux et un peu plus libres d’esprit que la veille. Et pourtant le premier symptôme est paradoxale, jamais les amphithéâtres et les aulas ne seront aussi chargées et aussi actives ; même lorsque l’occupation des locaux battront leur plein, on travaillera comme jamais dans l’espace de cette institution consacrée au savoir.
Mais l’heure est venue pour moi de montrer ce que je sais faire, à savoir rien moins que l’histoire. Passé la surprise face à leur propre audace, les étudiants se trouvent en 24 heures en panne d’idées. Que faire maintenant, à part la grève jusqu’à ce que le gouvernement remette en liberté nos camarades parisiens ? Attendre ne suffit plus, il y a une telle accumulation de non-dits et d’impensés qu’il faut s’exprimer le plus vite possible. Et ce sera le libre marché des idéologies et des Livres Rouges censé tracer une piste pour l’action. Les sit-in sont inaugurés comme méthode de rassemblement avec sonorisation électronique, ce qui modifie considérablement l’efficacité des dialogues qui s’installent vaille que vaille. Or l’action démange cette masse de jeunes qui se réveille soudain en adultes pressés de montrer ce dont ils sont capables. Aussi se dessine-t-il un mouvement en direction d’une première manifestation : il faut attaquer les représentants régionaux du pouvoir, on pourrait occuper le Commissariat de police ou la télé ? Et c’est le premier départ pour la Rue de la Nuée Bleue siège de la police. En chemin je mets de l’ordre dans mes idées pendant qu’à mes côtés on parle déjà de détourner la manif vers la Télé, convaincu que cette attaque n’a aucun sens. Mais j’attends sagement l’arrivée du cortège au but qu’il s’était fixé. Sur place un premier rang de trois ou quatre inspecteurs complètement dépourvus et un peu paniqués, derrière eux trois ou quatre uniformes d’hirondelles les yeux exorbités de peur. Tout le monde hésite car l’occasion n’est pas mauvaise, cinq mille étudiants n’auraient fait qu’une bouchée de ce petit local et de ses occupants, mais ensuite que faire d’une telle occupation ? Attendre que des compagnies de CRS viennent nous déloger avec pertes et fracas ? Ridicule, aussi je décide de jouer le tout pour le tout, la solution m’est apparu très simple : je bondis sur la première fenêtre du commissariat me trouvant ainsi à même de m’adresser à l’ensemble des étudiants (le journal local publiera une photographie de cet instant le lendemain) et en trois phrases pétantes je hurle que cette attaque n’a aucune chance d’apporter quoi que ce soit et que la seule chose que nous ayons à faire est d’occuper nos propres locaux : le mot d’ordre de l’occupation naît ainsi et fera le tour de France en quelques heures et coups de téléphone. Le visage des flics se détendent et me regardent avec reconnaissance, ils me resteront fidèles des années plus tard lorsqu’un incident ou l’autre viendront émailler ma vie quotidienne, comme cette rafle dans un bistrot où je buvais une bière et que je fais un scandale mémorable en refusant d’obtempérer. Bref, les étudiants se remettent en route, direction la Fac, quelques-uns parlent encore de prendre le chemin de la Place de Bordeaux où se trouve la télé, mais cela ne se produira pas. Les quelques milliers de jeunes étudiants qui se jour-là s’étaient mis en route pour l’être, vont se retrouver en moins d’une demi-heure dans l’espace d’une fête qui va durer deux mois. Avant de prendre possession de mon futur domicile (cette nuit-là je dormirai sur le tapis de la Présidence de la Fac), je file au département philo avec un texte que j’avais concocté la veille et que je veux ronéotyper et transformer en tract. Dans les bureaux je trouve le Directeur Lucien Braun et Philippe Lacoue-Labarthe, un prof très proche et entièrement dévoué aux étudiants en colère. Les deux hommes m’offrent de m’aider et c’est Braun en personne, futur Président de l’USHS, qui tournera la manivelle de la ronéo pour imprimer mes libelles. En gros le texte ne disait qu’une chose : cette affaire n’est pas la Révolution car des fils de bourgeois ne peuvent pas faire la révolution, mais c’est l’occasion de s’emparer du temps pour faire la fête, occuper une université condamnée à produire des chômeurs et profiter de cet intermède de liberté pour parler et jouir. Philippe rajoute en PS : « Défoncez tout, défoncez vous ! »
L’épilogue provisoire de cette journée mémorable viendra vers deux heures du matin, au milieu d’une nuit de véritable orgie, où le cannabis circulera librement et où les étudiants et les étudiantes vont déchaîner une lubricité joyeuse et bruyante, moi-même je ferai l’amour dans un escalier avec une inconnue qui me le rappellera des années plus tard. En effet, conscient de l’enjeu, le Doyen de la Fac de Lettre, le sieur Livet, arrive en compagnie du Recteur en personne nous rendre une visite impromptue. C’est moi qui les reçois, la tête enfumée mais très conscient et parfaitement capable de négocier avec des personnes qui viennent tenter de nous mettre à la porte. Je leur propose d’abord de se joindre à nous en buvant un verre et en fumant un joint, puis devant leur air amusé je leur expose sans ménagement les faits : nous occupons l’Université et personne ne nous en chassera, la loi interdit en effet à l’autorité politique de violer le sanctuaire de l’Alma Mater. Le Recteur Bayen sourit. Il a l’air détendu et ne se sent pas obligé de prendre l’attitude effarouché de Livet, un malin, celui-là même qui avait réussi à faire inclure dans le télégramme des étudiants la clause de l’autonomie. Mais cette complicité implicite, si je puis l’exprimer ainsi, le coince à présent, et il lui est difficile de hausser le ton face à des étudiants dont il épouse pratiquement les griefs. Les deux hommes, accompagnés par un horde d’appariteurs, font donc bonne figure, convaincus que nous dégagerons les locaux universitaire dès le lendemain et nous quittent en se forçant à sourire. La nuit est loin d’être terminée.
Le lendemain, les deux ensembles de bâtiments de l’Université de Lettres de Strasbourg sont occupés par des étudiants qui vont désormais y dormir, y manger et y préparer la « lutte ». L’ancienne partie, Place Brant, sera choisie pour y recevoir ce que nous appellerons le QG, une grande salle au rez-de-chaussée où quelques longues tables rassembleront une poignée d’étudiants qui représentent tout une diversité de conglomérats, le Secrétaire de l’Unef qu’on oubliera très vite, et des représentants des divers courants de la grande Gauche française, depuis le parti communiste jusqu’aux Mao spontex, ces derniers viendront plus tard en force, mais n’influeront jamais sur les événements autrement qu’en exhibant leur soit-disant solidarité avec les ouvriers. Moi je ne représente que moi-même, prêchant à qui veut l’entendre que toutes les familles qui prétendent régir le mouvement doivent être dissoutes et leurs idées mises au rancart jusqu’à nouvel ordre, la vie du mouvement doit se décider au sein des étudiants dans leur masse et ne doit pas provenir de quelque état-major politique ou syndical. Pour nous « les situationnistes » il n’y a que les staliniens et nous, à savoir un mouvement qui ne prétend pas se connaître lui-même mais qui attend tout de l’action et de l’initiative de chacun. Pour nous encore, il n’y a à ce moment-là que des valeurs qui nous servent de repères, mais nous n’avons aucun prétention à quelque gouvernance que ce soit. Un seul critère pour l’action : elle doit toujours surgir de l’échange de parole, du dialogue inter-étudiants, de ce qu’on appelle aujourd’hui en hommage forcé pour Mai68, la concertation.
Une autobiographie c’est étrange car ça s’étire dans le temps, dans ce qu’on appelle, faute d’un mot plus clair, le temps. En s’étirant ainsi dans l’espace du temps, beaucoup de choses changent de nature. L’ambiance, pour commencer et donc les raisons ou les motivations pour la poursuivre. Je viens de l’interrompre pendant plusieurs mois, plus qu’une année, et je n’ai aucun enthousiasme pour continuer. J’avais certes de bonnes raisons présentes de ne plus écrire, je ne pouvais tout simplement plus le faire tant ma santé occupait l’essentiel de mon...temps. Je ne suis d’ailleurs pas encore tout à fait sorti d’affaire car l’heure est lourde et solennelle. Il y a maintenant un an j’ai pris une décision lourdissime pour la réalité de mon existence (intéressante cette expression), j’ai entamé et mené à bien un multiple sevrage de l’ensemble de ce que l’on pourrait mettre sous le concept de substances toxiques, à commencer par le tabac, mais comprenant aussi l’ensemble des médicaments dont la morphine, les tranquillisants et les somnifères. Le pari, car c’en est un, est de commencer une vie qui s’était arrêtée en 1954 lorsque je me suis mis à fumer comme un adulte, puis une seconde fois en 1961 lorsque s’est déclarée ma première maladie du tube digestif. Les risques sont donc grands, car ils ne concernent pas seulement le corps avec les conséquences dans les processus de dégénérescence que l’esprit que je ne veux ni ne peut isoler de ce corps, co-appartenance à l’étant oblige. Mais ce qu’il y a de plus important en ce présent de décembre deux mille sept, c’est ce sentiment d’inutilité de tout ce travail qui consiste à retracer ce que les techniques historiographiques sont parfaitement capables de trouver par elles-mêmes dans quelques millénaires : mon travail biographique, qui avait une ambition historique lorsque il a été entamé ne me satisfait plus du tout. Rien ne surgit. Voyez : nous sommes déjà en janvier 08 et je n’ai rien écrit depuis des semaines : ma mémoire ne veut plus parler ? Peut-être, mais je pense surtout que je ne vois pas ou plus comment valoriser mon témoignage dans un futur lointain. Ce texte servira de regard oblique à quelque doctorant qui fera une thèse dont les décideurs de l’époque tireront bien une motivation ou une autre pour cimenter leur idéologie. J’ai presque envie d’en finir tout de suite avec cette biographie.
Bof, continuons malgré tout, un témoignage ne se refuse pas, surtout que la question en cours est de la plus haute importance (je rigole, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre car Mai68 n’est pas plus important qu’un tas de détritus. Mais c’était bien et il n’y a pas eu beaucoup d’événements qui m’ont fait aussi chaud au cœur que ces quelques semaines où le temps s’est pendu et nous a foutu une paix royale).
Je suis vraiment un peu salaud, car cette époque, véritable épokè pratique et théorétique, a été comme un modèle de praxis sociale, de démocratie avant tout qui fonctionnait sans institutions et sans autorité : Mai68 est peut-être l’instant de la réussite du geste antique de la sédentarisation, le moment où l’homme a réussi à exorciser la condamnation inhérente à la position sociale, seulement pressentie par Rousseau qui avait peur de trop parler, lui le parvenu. Aujourd’hui, quarante ans après, tout le monde cherche à faire des « bilans », à discerner ce qui s’est inscrit et qui subsiste dans le présent, alors que cette révolution, car ce fut une révolution mais seulement en termes d’utilité historique, n’aura été qu’elle-même, un événement fait de coïncidences et de vertus qui se sont conjuguées en réponse à la bêtise de l’autorité. On entend d’ailleurs les peurs se manifester un peu partout dans les médias où l’anniversaire ne sera pas manqué, d’autant que le nouveau Chef de l’Etat, le président bling-bling-Sarkozy semble avoir un compte personnel à régler avec ce qui l’a marqué à l’occasion de ces semaines car il n’avait alors qu’une dizaine d’années et ne pouvait donc pas être partie prenante. C’est donc à travers ses proches et ce qui leur est arrivé qu’il a vécu Mai68. Mais comme je dis toujours, la sagesse vient toute seule, mais son usage s’apprend douloureusement et pas toujours. Sarkozy n’apprendra jamais à la fermer, quitte à se contredire sans la moindre pudeur, son « talent » de politicien réside tout entier dans cette tchatche qui vient aussi bien de Hongrie que du Maghreb.
En fait, à bien y réfléchir, Mai68 aura été le poing sur la table d’une génération de jeunes étudiants, étudiants dans tout le sens de ce mot qui remonte au Moyen-Âge, qui ont crié très sévèrement « la connerie ça suffit ». Et ces conneries c’était aussi bien les guerres dont la France venait à peine de sortir que l’opinion veule et d’une médiocrité absolue, prête à consommer toutes les merdes qu’on allait lui servir, aussi bien dans le domaine intellectuel que matériel. Et ça a marché ! Ils ont eu une peur terrible, au point de rameuter autour de cette angoisse des calibres comme celui de Malraux, mais le pauvre n’était plus, il faut le savoir, que l’ombre de lui-même, atteint par la maladie et bourré de morphine jusqu’aux oreilles. Et puis sont geste n’a qu’une seule explication, sa fidélité pour le Vieux, cet autre croulant qui traitait les Français de veaux tout en se félicitant de leur connerie et de leur docilité. Mai68 a été un terrible pied de nez, pendant lequel nous nous sommes sérieusement interrogé, nous demandant ce qu’on pouvait bien faire pour changer la vie. La Révolution ? Il n’y avait que les imbéciles et les drogués d’idéologie à la petite semaine qui y croyaient et nous nous efforcions avant tout de dissuader nos compagnons de croire à une telle utopie. La révolution est toujours, soit une utopie réelle, soit un simple drapeau qui doit cacher une infamie, pour les uns et pour les autres, c’est selon. Mais Mai68 n’a jamais eu l’ambition de révolutionner quoi que ce soit. Aussi avons-nous en général été cohérents avec cette lucidité : nous passions notre temps à discuter, organisant des séances où les étudiants travaillaient comme jamais ils n’avaient travaillé dans les amphithéâtres, les classes vides ou même les aulas où s’activaient les propagandistes de tout poil. De temps en temps je passai dans les couloirs pour arracher les trop évidentes conneries communistes ou LCR collées au mur, sous les menaces du genre –‘toi j’aurai ta peau’ – on ne plaisantait pas, surtout dans la peau d’un étudiant communiste reconverti trente cinq ans plus tard en adjoint socialiste à la Mairie de Strasbourg. Je ne vous dis pas lequel car il y en a eu plusieurs dans le cabinet de Trautmann, dont le Premier.
C’est donc le moment où jamais de raconter un détail passé inaperçu dans les comptes-rendus de cette fête qu’on a publié dès le lendemain, inaperçu parce qu’il appartient à l’histoire occulte, c'est-à-dire réelle de Mai68, tout comme le détail que tout le monde connaît aujourd’hui, celui du revolver dans la poche de Chirac allant négocier avec les syndicats. Donc, j’avais une copine en philo qui n’était autre que la fille du futur Préfet de Police de Paris, et ancien pote au général, grand pourfendeur de terroristes OAS lors des années noires, l’alors Préfet de Région Alsace Lenoir. Marie-Christine avait fait philo pour remplir ses obligations de bonne fille à papa, un vieux baroudeur d’Algérie qui avait pris à la fin le parti du général contre ses propres copains de la Grande Guerre et qui n’avait pas que fait la chasse aux tueurs de l’OAS mais qui les avait fréquentés, chassés, sauvés, trahis, bref un personnage bien dans la façon France Grand Siècle. Au résultat, les gens de l’ex-OAS, mais à quelle date peut-on fixer la véritable fin de cette organisation qui poussait encore hier des cris d’admiration pour Le Pen ?, ces gens-là faisait la queue devant le bureau de Monsieur Lenoir pour en obtenir le droit secret d’en finir avec les meneurs de l’université de Strasbourg, donc moi. En finir signifiait rien moins que m’abattre, me liquider comme ils ont sans doute liquidé Monsieur Henry, alias Curiel. Le diabolique père-Préfet, excusez pour le mauvais jeu de mots, avait décidé de museler sa fille qu’il soupçonnait à raison d’être une gauchiste masquée, en l’enfermant tout simplement dans les bâtiments de la Préfecture de Colmar et en allant jusqu’à lui confisquer son passeport. Par bonheur il lui restait le téléphone qui lui a permis de m’informer régulièrement de ce qui se passait en haut-lieu, notamment le passage dans la capitale du Haut-Rhin du général en route pour Baden-Baden en pleine nuit. Et donc aussi des menaces qui planaient sur nos têtes. Aussi la situation se tendit-elle soudain vers le 15 du mois de mai et je fus averti que les chiens allaient être lâchés et qu’il fallait prendre quelques précautions : ce qui est remarquable en l’occurrence est le fait que je fus pratiquement le seul menacé, les ex-OAS avait des dossiers remarquablement à jour et je les crains encore aujourd’hui. Merci Marie-Christine. Je me suis donc caché pendant une semaine environ chez un vague camarade de classe mulhousien, fils de notaire qui possédait une villa splendide dans le quartier chic du Rebberg, jusqu’au jour où l’alerte fut levée par un coup de téléphone de la militante Lenoir, le père n’avait pas donné son accord et je ne risquais, paraît-il, plus rien. A mon retour je pus constater que je n’avais rien manqué d’essentiel, le mouvement « se cherchait » et sans ma présence j’étais convaincu qu’il n’irait pas loin sinon nulle part. IL fallu donc pour commencer que je calme les ardeurs syndicalistes de mes compagnons du QG ; ces idiots s’étaient laissés manipuler par le patron de la CGT de Strasbourg, le sieur Keller qui se permis de venir tenir un meeting devant la Fac, place Brandt. Pénible souvenir, où il a fallu se crêper le chignon avec les soi-disant représentants du prolétariat que nous savions achetés de tout temps par un patronat corrompu et corrupteur. Dire qu’il aura fallu attendre ces derniers mois pour voir surgir du néant, et pour quelle raison ?, un certain Gauthier-Sauvagnac, exécuteur des grandes œuvres charitables du patronat et qui transportait un peu partout des valises bourrées de millions d’Euro au nom de l’UIMM, le syndicat des patrons-métallos !!!!! Les autres patrons, ceux de la CGT, de FO et des autres ont dû sentir passer le boulet, mais ce n’était, semble-t-il qu’un tir de semonce, histoire de dissuader les dirigeants syndicaux de mettre de l’huile sur le feu. Les patrons n’ont jamais réellement caché qu’ils achetaient les représentants des salariés, le tout étant de le faire savoir avec méthode et modération, juste ce qu’il faut pour que ça soit efficace. Le grand public n’a pas besoin d’être informé, et pour cause…
Cette anecdote ne sortira pas de si tôt, mais aujourd’hui elle tombe en même temps que la thèse selon laquelle De Gaulle aurait ourdi l’écrasement, ou l’échec simplement, du mouvement étudiant (devenu entre-temps ouvriers-étudiants) en demandant au Kremlin d’intervenir, non pas militairement, bien sûr, mais en faisant pression sur le Parti communiste français et par ce moyen sur le syndicat majoritaire à l’époque, la CGT. Fallait pas être très voyant à l’époque pour se rendre compte de l’hostilité absolue du PC à l’égard du mouvement étudiant, qu’il a tenté de museler dès le commencement, et à ce moment stratégique je dois pouvoir affirmer qu’à Strasbourg au moins mon influence a été déterminante pour refuser le diktat de la CGT. Je me souviens très clairement que mes amis étudiants ne comprenaient pas grand-chose à l’attitude des syndicats, mais il suffisait de leur expliquer la mécanique politique qui se dissimulait derrière tout cela, plus le fait que personne dans la Gauche française ne croyait plus en une possibilité révolutionnaire, comme si la Révolution était un événement prévisible ou calculable, pour qu’ils comprennent rapidement la manœuvre. Je retiens aussi précisément de cette époque la grande présence d’esprit des étudiants au fur et à mesure que les événements déconditionnaient leurs croyances, leurs habitudes quotidiennes et leurs actions routinières et répétitives. Le répétitif, ennemi numéro UN, urbi et orbi. L’hypothèse De Gaulle ne m’intéresse nullement, ce n’est pas avec des gesticulations comme celle qui consiste à ameuter des forces aussi inexistantes sur le terrain que les communistes français qu’on peut décider de l’histoire. Je pense le Général cependant assez machiavélique pour avoir pris des précautions du côté de ceux pour qui il n’avait que du mépris, mépris fort justifié si l’on se réfère aux révélations récentes (2008) de Gauthier-Sauvagnac, le Monsieur chèques ou espèces du Patronat, chargé d’acheter selon la conjoncture les responsables syndicaux qui avaient un semblant d’influence sur les salariés. Mais je veux qu’on ne me prenne pas pour un gogo, cette vénalité répugnante des représentants du prolétariat n’était pas décisive, elle ne fait que refléter la profonde pourriture de l’esprit même du prolétariat français, sa propre criminalité intrinsèque qui se révèle dans l’Histoire chaque fois que leurs petits privilèges de merde ou leur corporatisme court quelque danger ou que des étrangers osent venir manger dans leurs plats. Le Pen tient une grande place dans le cœur de nos « ouvriers » et on en retiendra que le léninisme est donc contraint de s’appuyer sur cette moisissure pour former et conscientiser les masses mondiales. Ben mon colon.. Ces derniers temps je regarde une série de sketchs assez originaux dans un PAF de plus en plus nul, qui s’appelle Camera Café. Il s’agit de la description assez juste (dans la mesure où la justesse ne rend compte que de ressemblances apparentes) de l’ambiance qui règne en cette époque dans les entreprises (ça me rappelle entre-autres celle qui régnait à ARTE, ma dernière station dans le Golgotha du travail). Les sketchs ont tous lieu, ce qui permet de grandes économie de finances pour tourner ce produit, devant la machine à café de l’entreprise, située dans ce qu’on appelle le « lieu de détente ». On peut y vivre ou apprendre tous les dessous crapuleux des relations internes cyniquement mis en scène. La nouveauté c’est le cynisme qui ne critique pas tant le nouvel « esprit » qu’il ne le légitime par une banalisation quotidienne. En fait, à examiner ce produit idéologique, on se demande s’il se veut une critique de notre société ou bien une sorte de mise en condition culturelle de ceux qui le consomme. Ce qui serait une sorte d’accomplissement absolu de ce que Debord appelait la société du spectacle : la morale et le divertissement au lieu de la morale ou le divertissement. Caméra Café tire un trait sur le vrai résultat des Accords de Grenelle, ce long pourrissement du milieu ouvrier satisfait de ses « Trente Glorieuses » et du nouveau fétiche de sa vie quotidienne, l’automobile. Quand la réalité contraindra les gouvernements à serrer la vis brutalement sur l’utilisation de ce cauchemar sur quatre roues, alors les masses de travailleurs se soulèveront enfin.
Ici je dois bien me poser une question théorique : pourquoi le prolétariat (théorique) s’est-il laissé ouvriériser ? Pourquoi ces pseudo-opprimés devraient-ils représenter l’essence du prolétariat ? Quelle mouche a piqué Marx, mais je pense que ce sont ses successeurs qui ont figée cet aspect de la théorie, pour donner à ces prolétaires-là, finalement les mieux lotis si on les compare aux crève-la-faim qui peuplent certaines zones du monde aujourd’hui encore. Oh je connais mon bréviaire hé hé ! Je connais toute la thèse de la socialisation des valeurs et toute la dialectique des formes de production, mais ce que je ne comprends pas c’est pourquoi Marx fait mine de prendre les hommes contraints de cultiver la terre pour survivre pour des minus habens comparés aux ouvriers de l’industrie ? Ce qui me semble clair c’est que toute sa théorie de l’idéologie est tout simplement fausse : l’idée de structure est une idée elle-même purement idéologique, au sens où elle doit réifier la volonté de la bourgeoisie de « créer » une classe intellectuellement dominée par une autre. Autrement dit cette volonté doit se durcir le plus absolument possible en conditionnement des masses. Alors ce principe peut aussi jouer de classe à sous-classe. Ce débat a fait toute la différence entre le communisme soviétique et le communisme chinois ou Tiers-Mondiste. Je me souviens de mes discussions avec le Che : pour lui la théorie dite orthodoxe, et donc ouvriériste, n’avait aucun intérêt, sinon de défendre la NEP, la réforme stalinienne qui ouvrait sur le « socialisme en un seul pays », pays censé diriger la révolution mondiale certes, mais par l’exemple seulement. Il était écoeuré par ce qui se passait à Cuba car il voyait où mènerait immanquablement la politique d’alliance avec Khrouchtchev. A ce sujet je remarque que l’Union Soviétique n’a joué aucun rôle dans la révolution cubaine, contrairement aux Etats-Unis qui ont aidé Castro et ses copains. En France, le plus ridicule était que les maoistes, féru de théorie remaniée par le grand Timonier, et donc favorable aux paysans, défendait un ouvriérisme rigoureux, surtout pendant la période chaude de Mai68. Ma question est très importante, car elle porte sur un racisme sociologique latent. Ce racisme postule quelque chose d’assez ignoble du genre : les ouvriers sont plus vertueux que les paysans, naturellement attirés par la corruption de la propriété privée etc … le baratin qu’on connaît bien et qui fait des ravages. Plus vertueux et plus intelligents. Mais la question éclate : quel culot ne faut-il pas pour juger ainsi de la nature humaine ? Bien sûr, dans la tête déjà sociologique de Marx il existerait des lois (ou des structures) qui commandent aux individus selon leur classe. Mais qui est Marx lui-même pour en juger ? Oh je sais bien, il se classe parmi les inclassables qui sont à l’origine des grands changements dans les structures, à l’origine de la révolution .. Plaisanterie, il n’y a jamais d’intelligences à la racine des révolutions, il y a des sentiments comme la colère ou l’ennui, et de la volonté qui se dévoile soudain là où on ne l’attendait pas. Mai68 à cet égard serait une exception dans la mesure où les Situationnistes ont lourdement chargé d’intelligence la barque, et cela déjà deux ans avant les événements. Il faut aussi signaler à propos de ce mai-là que la classe politique n’a pas échappé à l’ennui qui plombait la « société » française sauf que dans son camp on ne connaissait pas de réponse originale à ce mal.
28 Mars 2009 : Nouvelle reprise de ce texte avant mise en ligne sur Internet.
Récemment j’ai fait la remarque à propos des thèses de Marx selon laquelle l’industrie n’avait aucun titre particulier à se définir comme la structure matricielle de l’Histoire (pour qui aurait encore une foi quelconque dans ce concept). On se souvient que, comme chez Aristote, Marx pense les époques historiques bien séparées et relativement hermétiques les unes par rapport aux autres, mais il se produit dans le raisonnement la même incohérence que chez Aristote : la forme présente, c'est-à-dire industrielle du capitalisme est considérée comme toujours déjà présente dans l’origine. C’est le fameux problème de la structure et de sa genèse, ou des genèses. Comment une structure peut-elle passer dans la genèse ? Et l’inverse, une structure produire, à un moment donné, une genèse ? En fait, je ne vais pas me fatiguer avec tout cela, toute l’amphigourie marxienne ne parviendra pas à me faire faire semblant de distinguer par quelque tour de passe – passe scientifique, des sub-stances dans la réalité. Des sujets cachés sous la roche du manifesté du genre forme agricole ou industrielle, des formes qui devraient trouver une puissance hiérarchique dans la réalité humaine. Il n’y a pas plus de prolétariat d’avant-garde que de beurre en broche. Si l’on veut sauver cette catégorie sociale, il faut la définir uniquement par son aliénation et le fait qu’elle soit privée de moyens de production. Ce qui n’est pas le cas uniformément pour les ouvriers dont le pouvoir d’épargne peut parfois leur permettre des acquisitions de capital que le paysan sans terre ne pourra jamais s’offrir. Je ne suis pas loin de penser que c’est la dialectique hégélienne qui a trompé Marx, l’obligeant à des contorsions théoriques destinées à trouver des médiations entre l’aliénation absolue, celle de l’homme sans ressources et le mouvement de la lutte de classe qui ne peut pas s’imaginer à partir du dénuement complet. Le socialisme est un avatar du même genre, destiné à permettre à l’imagination d’accepter des compromis suffisants pour passer à la forme ultime le communisme. Sans parler du contenu moral de cette dialectique du Maître et de l’esclave : il faut dé-barbariser le paysan car on le juge d’office et d’origine barbare, faute de quoi on ne pourra jamais accéder à une société fondée sur la vertu.
|

|
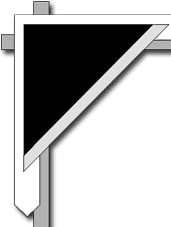

![]()