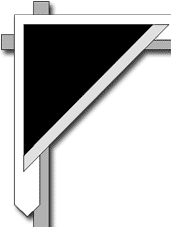
|

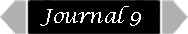
Lundi 18 août 2003
La démocratie du ventre
Par quel bout faut-il prendre la question des OMG, Organismes Génétiquement Modifiés ? Le point de vue désormais classique dans les médias est celui de la science et de l'utilitarisme : les OGM sont-ils utiles pour affronter les défis soulevés par la démographie galopante et les famines qui frappent ici et là, ou bien sont-ils dangereux, à court, moyen ou long terme ou non ? Comme le danger prend toujours la première place, c'est donc cette dernière question qui prend le devant de la scène et nous assistons à une corrida qui se tient à la fois dans plusieurs arènes. D'abord dans les laboratoires, qui, lorsqu'ils sont en plein air comme cela paraît indispensable dans de nombreux cas, le maïs entre-autre, sème la terreur dans les populations qui craignent de voir l'environnement des parcelles expérimentales infectées par les semences de ces OGM. Inquiétude parfaitement justifiée tant que l'innocuité totale de la chose elle-même n'est pas démontrée dans l'espace et dans le temps. Il faut savoir que le véritable danger est la disparition par substitution de toutes les semences naturelles selon une logique de la dominance génétique introduite dans les OGM. Il y a de quoi avoir peur. Dans dix ans, les agriculteurs seraient alors totalement dépendants, pour leurs semences, des grandes entreprises qui en détiennent les brevets et donc le monopole.
Cette bataille est la plus spectaculaire mais non pas la plus importante. L'arrestation et l'emprisonnement de personnages comme José Bové ne font qu'alimenter l'info-spectacle sans rien apporter de concret aux consommateurs, aux citoyens. Le second affrontement a lieu entre les lobbies des entreprises transnationales qui sont les seules à posséder les moyens de procéder à des recherches qui aboutissent à des résultats concrets, et les grandes institutions politiques dont dépend l'agrément qu'il leur faut pour mettre leurs produits sur le marché. Ces affrontements, feutrés et inconnus du public car les journalistes manquent de curiosité et de courage, sont assez décisifs car ils se passent à des niveaux qui échappent déjà aux pouvoirs des gouvernements nationaux : les grandes communautés régionales comme l'Europe, le NAFTA, l'ASEAN, le MERCOSUR et toutes celles que j'oublie. Dès lors que Bruxelles a décidé d'autoriser l'importation, la mise en culture et la vente des OGM et des produits agro-alimentaires dérivés de ces OGM, tout est pratiquement joué, les gouvernements n'ont plus la main et doivent, d'une manière ou d'une autre (notamment en jetant ignominieusement en prison des militants hostiles aux OGM), se plier au Diktat de l'Union Européenne.
Heureusement il reste un dernier domaine où a lieu un affrontement de beaucoup plus intéressant, celui qui peut opposer ou non les consommateurs et les producteurs d'OGM. La première offensive des producteurs d'OGM, immenses conglomérats à structure de cartel, a tourné court au grand dam des transnationales prêtes à inonder les marchés de leurs produits. Les grandes régions sont restées prudentes et ont opposé, sinon leur veto, du moins des conditions telles que la mise en marché devenait difficile, voire impossible : la labellisation des produits OGM, l'étiquetage informatif, est un obstacle pratiquement infranchissable pour l'agro-alimentaire qui voudrait bourrer ses marchandises de produits dérivés des OGM. Tout, en ce moment, tourne donc autour du comment et du combien il faut informer le consommateur sur la nature de ce qu'il mange. Car, les OGM ont fait un flop gigantesque, fort coûteux pour les entreprises coincées entre les quantités d'argent investies et les délais de rotation des capitaux. Les consommateurs ont dit non dans leur grand majorité, et laissé sur les rayons des grandes surfaces tous les produits suspects, dénoncés à temps par les associations de défense des consommateurs. Fort heureusement pour ces entreprises dont l'objet initial est la chimie ou la pharmacie, il y a une solidarité sans faille entre le système banquier, financier et boursier sur cette planète, solidarité qui provient, je ne rigole pas, de la puissance de ces transnationales dans les " familles financières ", les groupes qui en réalité dirigent le monde. Au résultat, il y a assez d'argent au frais pour gagner du temps afin de parvenir à régler le problème au plan politique, par la force s'il le faut, comme on le voit sur la plateau du Larzac.
La seconde offensive qui se déroule en ce moment paraît donc tourner en faveur des grands groupes, soutenus en douce par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agricole, pour des raisons étranges, dont la seule repérable sont les juteux contrats passés par les multinationales avec le service public français pour peser sur le monde agricole et pour faciliter les expérimentations-bidons, car il n'y a plus d'expérimentation à faire, les inventeurs des OGM ont déjà tout fait, et savent tout, le bien et le mal, le dangereux et le non-dangereux. Tout ce que fait l'INRA - c'est un ancien journaliste spécialisé dans l'agriculture qui écrit ici - c'est de la poudre aux yeux et du travail de lobbying auprès des organisations et des associations d'exploitants agricoles. Pourquoi la Confédération Paysanne, petit syndicat minoritaire est-il en pointe dans ce combat ? Parce que la FNSEA, le petit joujou de tous les gouvernements de droite est totalement gangrenée par les perspectives juteuses liées aux OGM : les coopératives agricoles elles-mêmes ont tout intérêt à jouer le jeu des OGM, car elles deviendraient un véritable troisième pouvoir entre l'agriculteur et la finance. Elles pourraient enfin se passer de la mutualité qui les lie aux exploitants et devenir des entreprises commerciales privées comme les autres. Même les jeunes militants des FDSEA savent cela, et ils se réveilleront bientôt. Je n'en doute pas un instant.
Mais alors que faut-il penser dans tout ce complexe d'intérêts tantôt complémentaires, tantôt opposés ? Ce n'est pas la bonne question, à mon avis. La bonne question est celle-ci : comment peut-on à l'échelle des politiques, quelles qu'elles soient, prendre des décisions aussi cruciales pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation de la planète en outrepassant la démocratie comme on le fait aujourd'hui. On dirait qu'il y a désormais deux mondes : le premier est composé de la structure financière servie par les techniciens, les savants et les politiques. Le second est le monde des consommateurs, les gens qui demain n'auront plus le choix de manger et de donner à manger à leur enfants ce qu'ils considèrent comme bon et sans danger. Le premier monde a pour le second le plus profond mépris, un mépris qui signifie à ces manants qu'ils sont des cons et que de toute façon on se fout de leur avis. Pardon pour ce langage, mais c'est un style qui va bientôt courir les rues comme du temps du Père Duchêne, le journal révolutionnaire publié par Hébert. Au fond pourquoi se voiler la face, ce langage s'entend, selon les informations publiées dans le Canard Enchaîné, déjà dans le lieu le plus majestueux de notre pays, à savoir le Palais de l'Elysée. Alors… Les lois qui vont régir notre alimentation, sans tenir le moindre compte de notre goût, de nos souvenirs, des productions les plus inutiles et les plus jouissives de notre imagination, notre plaisir pour tout dire, mais aussi de nos peurs et de nos hantises, ces lois vont, comme on dit, passer. Quel pouvoir nous reste-t-il ? Nous les avons élus, ces Messieurs qui aujourd'hui et demain vont nous ignorer comme une guigne, comme ils ont fait mine d'ignorer que des milliers de vieux étaient en train de mourir sous le soleil de la canicule. Et puis, ils ont tellement peu de pouvoir que s'en est à pleurer, ils ont passé les trente dernières années à baisser leurs pantalons face au marché mondial et aujourd'hui ce dernier n'a plus rien à craindre d'eux.
Et pourtant, je dis à tous ces messieurs qui décident de notre futur alimentaire, je leur dit : Attention ! Vous allez dans le mur, et entraîner avec vous des choses bien plus importantes que vous n'êtes vous-mêmes. Croyez-vous, avez-vous le culot ou l'inconscience de croire que l'espèce humaine est à ce point affaiblie intellectuellement et spirituellement qu'elle va se laisser traiter comme vous traitez déjà les animaux eux-mêmes ? Vous comptez nous nourrir avec de la farine d'os ? Vos OGM sont ce qu'ils sont, nous nous en fichons, ils ne sont que votre volonté de profit, et même si en vérité ils étaient réellement inoffensifs, nous n'en voudrions quand-même pas. Depuis quarante et quelques années, vous avez réussi pas mal de gros coups, celui de la voiture qui vous a permis de nous transformer en troupeau ruminant le long des autoroutes et en vaches à lait pour gros salaires, celui du tourisme de masse qui nous a transformés en voyeurs et en prédateurs arrogants, celui du commerce qui nous a changé en robots pour grandes surfaces, détruisant tout l'écosystème urbain qui faisait l'humanité des villes devenus des terrains vagues du vivre. Je pense sincèrement que les OGM forment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, car la première tentative l'a déjà montré, personne n'en veut de votre saleté, personne ne veut des conséquences de ces saletés pour l'avenir, des conséquences tout à fait comparable à celles de tout ce que vous avez concocté ces dernières décennies sous la férule frénétique des Anglo-Saxons. Vous avez tout avalé, le fordisme, le macdonaldisme et la piraterie entrepreneuriale. Vous avez tout détruit, la culture révolutionnaire et laïque, la défense résolue et concrète des trois valeurs de notre République que vous bégayez à n'importe quelle occasion sans même savoir de quoi vous parlez, la liberté, l'égalité et la fraternité. Vos OGM nous n'en voulons pas parce que vous nous les imposez de la manière la plus despotique qui soit, vous démasquant ainsi pour de bon. Nous aussi nous nous démasquerons, le jour venu : très exactement le jour où vos produits arriverons tels quels dans notre grande surface de quartier. Préparez-vous à les voir pourrir sur place, sur les rayons, dans les frigos et vieillir dans les congélateurs, car personne ne vous les achètera. Nous danserons sur votre ruine comme d'autres ont dansé sur les ruines de la Bastille. Tant pis pour vous, il ne fallait pas toucher à notre ventre, c'est là qu'il y a aussi notre courage et nos tripes.
Mardi 19 août 2003
…that have been arrested or have been killed !
…que nous avons arrêtés ou descendus !
Les derniers mots de l'extrait de la conférence de presse de Bush choisi par CNN à propos de l'arrestation du super-terroriste Hambali en Thaïlande. En fait le Président affirmait goguenard qu'ils, les services secrets américains, avaient désormais décapité aux deux-tiers le réseau du mal qui agressait le monde libre et en particulier les Etats-Unis. Lus comme ça en titre, ce papier, ces mots ne disent pas grand chose, il faut les avoir entendus, et il faut avoir vu la moue de GW Bush martelant avec gourmandise et avec un clin d'œil entendu le mot : killed. Que nous avons tués. J'ai traduit par " descendus " justement parce que ce prétendu représentant du peuple américain parlait exactement comme le dernier des parrains de la mafia, à des complices ravis de recevoir ce tableau de chasse. C'était un troupeau de GI's.
J'ai été profondément choqué par ce langage et le métalangage qui se dégageait du personnage se pavanant comme un dindon souriant devant un étalage d'uniformes aux quels, visiblement, il n'était pas de trop de rappeler ainsi qu'il valait mieux tirer d'abord et discuter ensuite. On se dirait dans le plus mauvais western spaghetti des années soixante. L'angoisse que je ressens ne provient pas directement des paroles de ce Picrocole de Maison Blanche, mais plutôt de l'environnement qui met un tel comportement en valeur, y compris la chaîne de télévision qui a choisi cette petite phrase terrifiante et je dirais même terroriste. Une chose est désormais claire : la réponse que fera le gouvernement américain à toute attaque terroriste, sera une réponse terroriste, et le traitement réservés aux suspects enfermés à Guantanamo ou dans les geôles inconnues d'Afghanistan et d'Irak, le montre sans ambiguïté. Or, l'éthique internationale à laquelle l'humanité a été conduite de force par les quelques catastrophes cosmiques et barbares qu'elle avait déclenchée elle-même, est formelle : terroriste ou pas, chaque être humain a droit au recours à la justice. Toutes les suspensions de législation pour des raisons de " force majeures " ont toujours été condamnées à juste titre par les peuples sains d'esprit, et le fait de répondre au non-droit par le non-droit est ce qu'il y a de plus condamnable et de plus dommageable à l'humanité toute entière. Car les paroles de Bush nous engagent nous aussi, nous qui acceptons muets, les crachats de serpent de personnages qui devraient représenter cette justice et la fidélité au droit démocratique.
D'autant plus que ces hâbleries ne trompent que les gogos. Prétendre avoir anéanti les deux-tiers des forces terroristes dans le monde est une farce ignoble et un mensonge que les Américains vont payer très cher. Mon expérience me permet d'affirmer fermement que ce Hambali, à partir du moment même où il a été arrêté, a perdu tout intérêt pour la lutte anti-terroriste. Les Américains n'hésiteront certainement pas à le torturer comme nous autres Français avons torturé en Algérie, mais cela ne servira strictement à rien, car quel que soit le rang de ce barbu, même s'il était réellement le bras droit de Ben Laden comme on s'empresse de le proclamer, cela ne changerait rien au fait qu'il existe des milliers d'autres Hambali prêts à prendre la relève dans l'instant qui suit son arrestation. Et les services secrets américains le savent pertinemment, comme ils savent d'ores et déjà ce qui les attend encore en Irak dans les mois et les années à venir. Ils le savent et l'ont toujours su, car leur plan me paraît de plus en plus clair. Tout le monde, en effet, semble croire au conte de fée servi par les médias sur ce qui se passe réellement sur le terrain, et ces historiettes présentent la situation comme une " grande déception surprenante " de la part des coalisés face à la mauvaise volonté des Irakiens. Moi je n'en crois pas un mot, et je suis absolument convaincu que Bush et son état-major de faucons affamés ont manœuvré exactement comme ils le voulaient dans le but cynique de substituer leur terreur à celle de Saddam. La seule chose qui les intéresse est le pétrole et son contrôle absolu, c'est pourquoi d'ailleurs la résistance qui se manifeste tous les jours, dans un silence de plus en plus étouffant des médias, vise désormais les pipe-lines de pétrole, mais aussi d'eau potable, histoire de montrer au peuple des rues que les Américains n'arrivent pas à la cheville de Saddam qui a réussi à faire fonctionner ce pays dans les pires conditions, celles de la guerre contre l'Iran, celles de la Première guerre du Golfe et puis celles produites par l'embargo criminel de l'ONU, je dis criminel et je le pense, car j'accuse la communauté internationale d'avoir pris fait et cause contre un Chef d'Etat sans lui laisser la moindre chance d'être jugé objectivement, et cela en provoquant les conséquences prévisibles d'un appauvrissement et d'un affaiblissement du peuple irakien lui-même, cependant que, à l'instar de tous les décideurs du monde entier, Saddam continuait à vivre comme un nabab.
Et encore, que sait-on réellement de sa vie. Celle de l'un de ses fils a défrayé la chronique intérieure et internationale, c'est vrai, mais Saddam Hussein lui-même ne sembla pas avoir été l'un de ces satrapes qui ne songe qu'à collectionner les voitures de luxe et violer des enfants en se gobergeant. Pas son genre. Le co-fondateur du Baas était un militant à dimension historique, et le piège que lui ont tendu les Américains au sujet du Koweit l'a éliminé aussi brutalement que Henry IV fut assassiné dans sa chaise à porteur. Rien ne change sous le soleil, et il faut rappeler la vérité de l'enchaînement des événements pour comprendre tout ce qui se passe : la manière dont Saddam a été trahi n'a rien à envier aux méthodes de trahisons d'une Médicis ou d'un Guise, attirant les Protestants dans le lieu du guet-apens de la Sainte Barthélemy. Il faut sans cesse rappeler que tant que Saddam était le défenseur de l'occident laïque et proche des intérêts pétroliers des uns et des autres, personne n'a jamais rien eu à lui reprocher, ni son coup d'état contre Kacem ( applaudi parce que Kacem avait des tendance communistes ) , ni les premiers massacres ethniques auquel la guerre contre l'Iran l'avait déjà contraint une première fois. Ensuite seulement, lorsqu'il s'est avéré que ce monsieur devenait malgré toutes ces infortunes trop puissant et qu'il risquait de devenir aussi dangereux qu'un Nasser face aux familles de féodaux de l'Arabie, alors on lui a tendu le piège du Koweit, province irakienne qu'on le veuille ou non, qu'il avait promis de rendre à son peuple vivant dans la misère de l'après-guerre à quelques distances du luxe inouï étalés par les Koweitis. Oui, je le rappelle, c'est une sous-secrétaire d'état américaine, une femme prête à tous les mensonges, qui, quarante-huit heures avant l'attaque du Koweit, a rassuré Saddam qui lui faisait part de son intention de s'emparer du Koweit, lui laissant entendre que cette affaire ne provoquerait aucune réaction de la part de la communauté internationale. On a vu ce qui a suivi. Et puis, réfléchissons. Juste une question en passant, comme ça. Après la première Guerre Mondiale, la Turquie était pas bien, mais alors pas bien du tout. Son Empire était en miette, elle avait fait le mauvais choix avec le Kaiser, et puis nouz'otes, les vainqueurs, on est venu se partager le gâteau, enfin la croûte, les bords assez larges de l'Empire, là où le goudron sortait à gros bouillon du sable frais, ce goudron qui salissait tout là-bas, et dont nous étions prêts à nous occuper. En Irak il était le plus visible, le désert brûlait la nuit, comme ça tout seul, et pour construire Babylone il y a quatre mille ans, on se servait de cette saleté pour cimenter les briques en porcelaine bleue. C'était beau, mais salissant, ah ça, quelle saleté ! Quelle saleté que ce pétrole irakien. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a inventé des pays, comme ça, pour se partager le goudron, pour fâcher personne. Toi tu prends l'Iran, l'Irak, la Palestine, enfin ce qui passait pour la Palestine, nous (Wilson et Roosevelt) on prend l'Arabie, enfin on prend, c'est pas exactement ça, on signe des accords avec les chefs de tribus nomades et on leur donne en échange des dollars en liasses. Nous, les Français, on a pas eu de chance, on a mal choisi parce qu'au Liban et en Syrie il y avait pas grand chose de noir sous la terre, mais nous on a des amis là-bas, et ça, ça fait des jaloux. Vous vous souvenez de Mitterrand, allant en personne à Beyrouth ? Avant lui il n'avait eu que le général De Gaulle qui était passé par là, et encore il était en mission dans les services du Deuxième Bureau, dans les années vingt.
Alors les Bush et les Blair, fermez vos blaires. Tous coupables et vous n'avez pas fini de payer pour vos ignominies. Je viens d'entendre une brochette de journalistes anglo-saxons parler de tout ça, et j'ai été atterré par l'esprit de ces " personnes ". Oh, ils reconnaissent les erreurs des gouvernements, il reconnaissent même les fautes, mais savez-vous ce qu'il pensent des Irakiens ? Ils en pensent ceci : donnez leur de l'eau, de l'électricité, des salaires et des jeux et ils seront contents. Voilà ce qu'une journaliste de l'un des plus grands quotidiens britanniques pense en son fort intérieur des peuples autres que le sien : des veaux, comme disait aussi De Gaulle. Pas un moment l'un ou l'autre de ces médiatiques n'aurait seulement osé suggérer que les Irakiens n'ont peut-être pas apprécié d'être envahis comme ils l'ont été, tués comme ils l'ont été, dépouillés de leurs abris, de leurs usines et de leurs biens comme ils l'ont été. Déshonorés. Non, l'honneur n'est pas une valeur irakienne, c'est fait pour les Britanniques qui honorent leur plus grands hommes. Quelle honteuse comédie chauvine que ce sondage qui est sorti aujourd'hui sur la BBC après des semaines de battage sur le thème : quel est le plus grand Britannique de l'Histoire ? Et savez-vous de qui il s'agit ? Newton passe en premier, grand savant, certes, mais ce qu'on ne dit pas de ce grand savant, c'est que c'était un demi-fou, superstitieux et plus intéressé par l'alchimie et la religion que par les sciences proprement dites. Mais bon, Newton, pourquoi pas, mais en troisième position, tout de suite derrière le colonialiste raciste Churchill, vous savez qui on trouve ? Non, vous ne le savez pas, enfin ceux qui lisent ce journal régulièrement ne le savent que s'ils ont regardé la BBC aujourd'hui : DIANA. Voilà, à deux place devant Shakespeare ! Loin devant Darwin et à des années-lumières de John Lennon, rêveur à lunettes assassiné pour avoir trop aimé la paix, comme son modèle Ghandi dont il avait évoqué le destin tragique la veille de son propre assassinat. DIANA ! Le conte de fée, la religion du spectacle et de la monarchie. Beurk, où vais-je encore trouver l'énergie spirituelle pour continuer de respecter ce peuple dont le comportement en Irlande me scandalise depuis que je suis né à la conscience de l'histoire.
Alors le paradoxe pour finir, pour vous rappeler comment la " Communauté Internationale traite ses dossiers depuis la mort de Mitterrand, dont on peut tout dire, sauf lui dénier le génie de l'histoire de sa planète : En Afghanistan l'ONU est en train de devenir une FINULE-bis, cette armée de l'ONU sans pouvoir, payée pour garder les frontières entre le Liban et Israël et financer la survie des centaines de milliers de Palestiniens réfugiés dans ces régions. Dans ce pays, l'Afghanistan, vaste montagne coincée entre des zones qui sont autant de sanctuaires pour les Talibans qui vont pourrir la vie des Afghans encore pendant des années, l'ONU va faire du surplace comme au Liban, dépensant l'argent du monde inutilement. Mais légitimement. En Irak , en revanche, l'ONU n'a aucun pouvoir et n'en aura pas, parce que l'Amérique de Bush (il y en aura peut-être une autre après lui, on parle déjà de la démission prochaine de Colin Powel, le seul homme politique à peu près propre dans cette administration de copains et de coquins) Bush donc,empêchera jusqu'au bout la Communauté Internationale de faire son boulot, et pourtant là, en Irak, elle pourrait le faire, bien et vite, les Irakiens n'attendent que cela. Mais les autres ils veulent le pétrole, et ils le veulent à n'importe quel prix, même si ça doit coûter aussi cher au peuple Irakien que dix Saddam Hussein rassemblés. Que leur chaud cette vie de soldat qu'ils perdent chaque jour, ce sac de plastic noir qui débarque là-bas à Philadelphie attendu par des parents qui commencent à en avoir marre des mensonges du gouvernement. Je partage leur rage, leur désespoir et leur malheur, je pleure avec eux pour ce jeune Américain tué là-bas pour rien, pour un drapeau plié en cinquante sous les yeux trempés de larmes de la mère. Voilà un drapeau qui ne mérite même plus le feu de la colère, tout juste la pisse du mépris.
Mercredi 20 août 2003
Quand l'Elysée se réveille.
Lorsque le 14 août dernier j'ai produit sur cette tribune un texte incendiaire sur l'incurie du gouvernement dans le traitement des conséquences de la canicule sur les personnes âgées, la bombe venait à peine d'exploser et il faudra quand-même attendre presque une semaine avant que le chiffre inouï de Cinq Mille décès dus à la canicule ne soit annoncé et reconnu par les responsables politiques de la santé. On ne connaîtra jamais le nombre exact de personnes mortes cet été à cause de la combinaison de leur âge et de la température ambiante mais la pyramide des âges va connaître une de ces encoches provoquées généralement par les grandes épidémies ou les guerres. L'Inserm, l'Institut National de Statistiques et de Recherche Médicales, finira pas récolter tous les chiffres de France et l'an prochain, peut-être, pourrons-nous faire un véritable bilan de ce qui s'est réellement passé cet été. Encore faudra-t-il que cet organisme officiel consente à livrer à la presse les chiffres en question, et qu'il se trouve des journalistes qui s'y intéresseront encore à ce moment-là. Moi-même je n'y manquerai pas, soyez-en convaincus d'avance et sans doute sera ce le cas si une nouvelle canicule devait montrer le bout de son nez.
D'autant plus qu'à l'heure qu'il est des personnes continuent de mourir des suites de cette vague de chaleur, pour certain les effets se font sentir avec un certain retard, mais il est évident que leur organisme a souffert en produisant des conséquences irréversibles. Même moi, alors que la chaleur a daigné retomber depuis trois jours, je suis physiquement affaibli et je subis selon les caractéristiques propres de ma symptomatologie, les effets de ce régime thermique infernal. D'où la sobriété de ma chronique d'aujourd'hui car j'ai hâte de regagner mon lit pour me reposer. Je ne poserais donc qu'une seule question : pourquoi le Château garde-t-il le silence ? Comment se fait-il que le gouvernement se soit déjà réuni en catastrophe, que le premier bouc émissaire soit tombé (le Directeur de la Santé a démissionné sans que personne ne sache exactement pourquoi) pendant que le Ministre de la Santé promène ici et là son langage de Tartuffe et que notre Président de la République n'ait pas encore ouvert la bouche ? Il est peut-être en vacances.
Non. Personne ne sait où il est. Brégançon ? Îles Maurice ? Palace de la Côte d'Azur ? Mais ce soir il a fait entendre sa voix : il a suffi de deux massacres dont un pour que notre Président se sente concerné par l'actualité. Et moi contraint de poursuivre ma chronique au lieu d'aller me reposer. A Bagdad un attentat particulièrement meurtrier a détruit le siège de l'ONU, pendant qu'à Jérusalem un Nième bus sautait en faisant vingt morts et quelques blessés graves. Pour Israël Jacques Chirac ne dira rien, mais pour Bagdad, impossible de se taire. Il prendra donc séance tenante sa place dans le tollé international contre les terroristes qui ont osé s'en prendre à la représentation de l'ONU en Irak, tuant le beau Sergio de Mello, baroudeur mort en baroudeur. Bien sûr, il ne pouvait pas deviner qu'il serait visé par ceux qui continuait dans le pays apparemment vaincu à se battre contre les Américains. Il a eu tort. S'il avait réfléchi il aurait pris des précautions car cet acte qui semble desservir les ennemis de Bush en dressant contre les auteurs de l'attentat toute la communauté internationale (mais dites-moi ce que recouvre cette expression bidon ?), y compris Chirac. Erreur. Sans doute le Conseil de Sécurité va-t-il se réunir pour dresser un bilan et condamner cet acte ignoble contre une institution qui n'était venu que pour aider le peuple irakien. Mais il manque beaucoup de rouages dans la tête de ces gens. Ils ne pensent pas, tout simplement.
Mais d'abord le passé : comment les coalisés ont-ils pu s'imaginer un instant qu'il suffirait de faire tomber la statue creuse de Saddam Hussein dans le centre de la capitale pour se déclarer vainqueur, alors que les troupes des envahisseurs n'avaient jamais quitté un instant les grands axes de circulation du pays ? Ils se sont déclarés vainqueur d'un pays qu'ils ne connaissait même pas, ou du moins pas autrement que par images satellites interposées : ils ne connaissait qu'un Irak virtuel qu'il jugeaient et comparaient à n'importe quelle autre zone du monde, en fonction de leurs critères de " développement ", d'urbanisme et de puissance industrielle. Une fois que leurs missiles auraient tout cassé, sauf le dispositif pétrolier, alors la guerre était gagnée. Bien sûr, en annonçant dès le lendemain que leurs troupes rentreraient à la maison dans les semaines qui suivaient, ils mentaient sans vergogne. Pas idiots à ce point, ils savaient parfaitement qu'ils ne tiendraient le pays qu'en l'occupant militairement tout le temps qu'il faudrait. Personne ne peut imaginer un instant que les stratèges du Pentagone puissent avoir cru qu'il en irait autrement au vu des événements. Saddam Hussein a refusé la guerre, il n'a rien fait pratiquement, s'il y avait eu de véritables batailles pendant l'avancée sur Bagdad, on en aurait eu vent, et des images, tout était prêt pour le show. Quelle déception ! les quelques quatre cents GI's qui sont morts là-bas au cours des opérations, ont été décimés par une arrière garde fort bien organisée et que se retirait en bon ordre, en laissant d'ailleurs un nombre convenable de morts ici ou là. Mais personne ne me fera croire que l'état-major US et britannique ne se sont pas arraché les cheveux à l'issue de la non-bataille de Bagdad. Rien ne s'était déroulé comme prévu, et le brave ministre de l'information irakien qui annonçait encore la contre-offensive alors que les premiers tanks américains entraient dans la ville, s'est bien moqué des médias et des officiers supérieurs de l'armée coalisée.
Souvenez-vous, il disait toujours : nous gagnerons, car nous allons mettre en batterie une arme non conventionnelle, les Américains allaient être surpris par une ruse de dernière minute, et puis rien. Rien du tout. S'ils avaient bien écouté, les envahisseurs auraient d'abord entendu que le porte-parole de Saddam ne disait rien quant au délai dans lequel les coalisés auraient à affronter cette ruse. Depuis quelques mois, la guérilla qui s'amplifie leur ouvre enfin les yeux. Pour ma part je n'ai pas un instant admis la thèse selon laquelle Saddam n'était qu'une sorte d'Idi Amin Dada, prêt à fuir au premier coup de feu pour aller finir ses jours dans un palace avec piscine et geishas à volonté. " ON " le lui avait offert bien avant l'ouverture des hostilités et son refus aurait dû donner à penser. Non, Saddam a préparé une contre-offensive à long terme, très long et très douloureux terme, bien pire que le fameux embourbement vietnamien, car au Vietnam il était possible du jour au lendemain d'en finir avec la guerre tant elle était sans intérêts vitaux pour l'Amérique. Elle n'avait rien à perdre à Saigon alors que le pétrole irakien est devenu une nécessité vitale, d'autant plus vitale désormais qu'on a investit des milliards de dollars pour envahir le pays et prendre le contrôle des robinets d'or noir. Pas moyen de faire machine arrière, si l'administration Bush prenait une telle décision, elle n'aurait plus qu'à plier bagage et laisser l'opposition démocrate s'installer dans ses bureaux sans même attendre les prochaines élections.
Alors pourquoi l'ONU ? Deux raisons évidentes. La première est une raison médiatique, car cet attentat démontre de manière éclatante que l'Amérique, que les 150 000 soldats qui sont encore là-bas, défendent mieux l'Institut du Pétrole que l'hôtel où était installé l'ONU. Suis-je idiot, ou bien deux ou trois Sherman n'auraient-ils pas suffi à protéger les alentours de ce bâtiment, prêt à tirer sur n'importe quel véhicule suspect, et dieu sait si une bétonneuse fonçant à toute vitesse avait de quoi être suspecte. Mais non, il n'y avait pas les tanks qui auraient fait la différence et fait sauter le camion avant qu'il n'arrive dans l'espace fatal. Les troupes américaines sont donc fautives, et je pense que les rescapés ne vont pas manquer de le souligner et de faire monter la mayonnaise. Deuxième raison : attaquer l'ONU c'est dire à la " communauté internationale " qu'il est trop tard pour qu'elle respecte ce qu'elle est et qu'elle intervienne pour jouer les nurses alors que son job était d'empêcher la coalition de se former et la guerre d'éclater. Trop tard pour la communauté internationale, maintenant ça va se passer entre les coalisés et nous, et si d'autres pays se trouvaient soudain la fibre batailleuse, cela ne ferait que faire monter les enchères et multiplier les massacres. Bien sûr, Saddam fait un pari risqué mais l'enjeu et le désespoir sont à la mesure de ce qui va maintenant se passer.
Nous ne saurons pas grand chose de la vérité de ce qui va se dire dans les couloirs et les bureaux du grand bâtiment de l'ONU à New York, mais il est sûr que les choses vont être extrêmement compliquées pour tout le monde, et d'abord pour Bush, car il ne faut pas oublier que Bush veut garder l'Irak pour lui, et pour lui seul. Alors comment pourra-t-il faire appel aux autres nations du monde sans modifier radicalement ses exigences, et donc mécontenter le lobby dont il dépend ? Cet attentat est un chef d'œuvre de stratégie, car il met tout le monde au pied du mur quant à l'avenir de l'Irak et de son pétrole. Il y a quelques semaines, j'avais écris dans un forum de Libé, je crois, un papier disant qu'il ne restait à Bush et à Blair qu'une seule solution : retirer entièrement leurs forces armées et la remplacer par une force internationale qui aurait tout pouvoir pour reconstruire l'état et le pays, exactement comme en Bosnie ou au Kossovo. D'ailleurs, pourquoi en irait-il autrement dans ce pays ? Nous verrons bien quelles décisions prendront les coalisés et les autres, mais ça va prendre beaucoup de temps, et pendant ce temps, la contre-offensive de Saddam, soigneusement calculée, ne vous y trompez pas (pour une fois je peux bien prendre le ton et le style de mon confrère Alexandre Adler) fera chaque jour un peu plus de dégâts, un peu plus de morts, et fera monter un peu plus la colère d'un peuple qui connaît un désarroi qu'aucun autre peuple au monde n'a jamais connu, même pas le Libéria. Bravo Bush, bravo Blair, vous avez bien chanté : dansez maintenant.
Ce matin je me suis levé aux aurores nacrés comme disait le général Bigeard avant d'envoyer le " GO " à ses parachutistes au-dessus du plateau de Saïda, et j'ai écouté la première édition de l'interview quotidienne de Tim Sebastian. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir Sergio de Mello, ou plutôt son fantôme, en sa compagnie, rediffusion d'une émission datant d'Avril, bien avant que le Kouchner brésilien ne se soit installé pour son malheur à Bagdad. Une fois de plus j'ai dû admirer le travail de Tim qui n'a pas lâché un millimètre de terrain dans ses questions sur le rôle de l'ONU et sur le fait que le " bidule " semblait tout tolérer de la part de Bush : Guantanamo, le monopole sur l'Irak, le droit de juger n'importe qui n'importe où, bref de se moquer totalement des efforts de tous ceux qui ont encore foi en une organisation qui transcenderait les nations. Exemple : " comment pouvez-vous tolérer le traitement réservé aux prisonniers de guerre relégués à Guantanamo sans défense et sans la présence de vos représentants ou de ceux du Tribunal de La Haye ? " - Réponse : " j'en ai parlé au Président Bush, et il m'a donné l'assurance qu'il allait revoir le dossier " - Tim n'a pas fait de quartier sur le rôle que l'ONU allait jouer à Bagdad, et il faut bien reconnaître que Sergio n'avait à sa disposition que de vagues espoirs de voir son organisation associée à la formation du nouveau gouvernement irakien, sous la main de fer de Washington. Son installation à Bagdad a été, c'est malheureux pour lui mais c'est ainsi, un pas de clerc, une manœuvre qui dès le départ était condamnée à rester sans lendemains, exactement comme je l'écris plus haut. Le plus grave, c'est que cette erreur de manœuvre est une manière grave de prendre les Arabes et leurs alliés musulmans du monde entier pour des imbéciles en présentant l'ONU non pas comme leur propre organisation au même titre que celle de tous les autres pays, mais comme un bidule au service de deux pays, au fond prêt à collaborer avec eux, malgré le délit flagrant qu'a constitué leur mépris des décisions du Conseil de Sécurité. Bush et Blair pourront prétendre ad libitum que la résolution 1441 leur donnait tous les droits, cette affirmation est une imposture et l'ONU se devait, non pas de collaborer avec les occupants, mais de les poursuivre en justice. Voilà toute la faiblesse des Schroeder, Chirac, Poutine et compagnie, s'arrêter en chemin et faire toute chose à moitié. Le pire à présent, est que l'ONU est définitivement discréditée aux yeux des peuples du Moyen-Orient, beau résultat.
En regardant attentivement le visage énergique de Sergio, j'ai eu une sorte de peur inexplicable. Chaque question de Tim montrait que les USA se comportaient de plus en plus ouvertement comme le dernier des états fascistes, et Sergio encaissait, alors que son aspect était celui d'un " winner ", de ceux qui font avancer l'histoire par leur courage physique et moral. A la fin de l'entretien j'avais la sensation désagréable qu'on avait liquidé un gêneur. Il m'a fait penser à Raoul Wallenberg, ce Suédois assassiné pour avoir sauvé des milliers de Juifs en Europe Centrale. Que va faire l'ONU maintenant ? Envoyer Kouchner ? C'est possible, lui aussi fait partie des baroudeurs qui ne rechignent pas à prendre des risques. Ces derniers temps il a eu le don de m'énerver dans ses prises de positions sur à peu près tous les dossiers, comme s'il était en train de tourner sa veste à droite, ce qui ne m'étonnerait pas de la part d'un homme courageux mais intellectuellement velléitaire. En tout cas si tu y vas, Bernard, (j'ai mes raisons pour tutoyer ce très ancien camarade), ne refais pas les erreurs de Sergio, encore que la seule erreur qu'il ait faite aura été d'obéir à Kofi Anan en allant s'exposer inutilement à Bagdad et en offrant à Washington sa propre garantie vis à vis des Irakiens. C'était cela l'erreur de l'ONU, car en s'installant en Irak, elle donnait en quelque sorte l'absolution à l'invasion des coalisés, elle l'enregistrait comme fait accompli et comme cadre légitime de sa propre action. Or cela est et restera impossible tant que l'Amérique continuera d'occuper ce pays.
Jeudi 21 août 2003
Post-scriptum
Il faut de temps en temps récapituler sans passion, c'est la technique du briefing et du débriefing. L'attentat contre l'ONU, qu'on pourrait appeler la " mère " de tous les attentats, est un événement entièrement nouveau. A entendre les commentaires des chaînes de télévision et des radios, on se rend compte qu'il est tellement nouveau qu'il n'est compris par personne. Les " experts " balbutient ici et là quelques explications sans consistance aucune et surtout sans aucun cadre stratégique. Ils ne savent pas placer cet action dans une continuité causale, se contentant de pratiquer la redondance moralisante et la négation absolue, en renvoyant les adversaires de l'invasion de l'Irak dans le vaste Enfer du mal, entrant ainsi de plein pied dans l'idéologie manichéenne du Président américain.
Or sur ce point même, j'ai fait remarquer hier qu'il y avait une certaine légitimité morale pour le clan du " mal " de s'en prendre à l'ONU à Bagdad, parce que cette dernière a réellement dérogé à son devoir moral initial. Ce devoir n'était et n'est pas par principe, de servir de nurse alimentaire ou même culturelle là où des nations détruisent ce qui est existe, mais primo d'empêcher par tous les moyens que des nations entrent en conflit armé, essence même de la mission de l'Organisation des Nations Unies, secundo d'arbitrer juridiquement les conflits qui naissent malgré son action, c'est à dire à cause de son impuissance à les empêcher. A cela on va me répondre que le réalité est plus forte que la théorie et qu'il fallait aider le peuple irakien par tous les moyens, y compris ceux qui sont stockés sous la responsabilité de l'ONU. Moyens matériels, financiers et intellectuels. Mais cette fois, la mort de Sergio de Mello symbolise un tournant de l'histoire de l'ONU : cette institution ne peut pas continuer de se laisser instrumentaliser unilatéralement par le même groupe de grandes puissances, elle doit s'autodéterminer par rapport à la multiplicité des nations et opposer la rigueur des vertus qui l'ont fondée à la réalité des rapports de force. Ce qui s'est passé à Bagdad révèle la radicalité des enjeux en cours : venir dans les bagages de l'armée américaine faire du travail humanitaire, c'était et ça restera sans doute :
- légitimer l'agression des coalisés
- coopérer avec les forces d'occupation et donc
- les laisser maîtres du destin futur de l'Irak.
Comment sortir de ce piège ? Il n'y avait qu'un moyen pour éviter une telle catastrophe qui n'a pas seulement détruit quelques bâtiments et tués quelques personnes, mais cette fois détruit d'un coup la crédibilité de l'ONU. Ce moyen était politique et se situait au plan du Conseil de Sécurité qui aurait dû tirer les conséquences du passage en force des coalisés, et s'en désolidariser radicalement, voire les " mettre à pied " de l'institution elle-même. Pourquoi ne sanctionne-t-on jamais que quelques pays isolés qui n'ont pas d'autres pouvoirs à l'ONU que de rassembler autour d'eux quelques voix de l'Assemblée Générale où l'argent américain achète en permanence toutes les majorités dont il a besoin ? Cuba, la Libye, la Corée, l'Irak ne sont que quelques exemples de ces pays régulièrement punis par le Conseil de Sécurité, alors que le pouvoir dont disposent 5 grandes puissances les met à l'abri de toute mésaventure. Je pose une question : combien d'ingérences américaines dans le monde entier, du Chili jusqu'à la Libye (carrément agressée militairement), en passant par des dizaines de Nicaragua, de Honduras et de Guatémala, je ne parle même pas du Vietnam qui fut un véritable crime contre l'humanité sans cause de guerre et sans légitimité, combien de ces agressions ont été punies, seulement définies pour ce qu'elles étaient par le Conseil de Sécurité ? Aucune. Pendant plus de trente ans on a assisté à un fantastique paradoxe d'une ONU méprisée par Washington qui ne payait même plus ses cotisations et où Washington continuait de faire la loi. Ce qui s'est passé hier à Bagdad est la première conséquence réelle de cette histoire d'une organisation corrompue et impuissante à accomplir ses véritables missions.
Reste à présent à tenter de prévoir ce qui peut se passer. Kofi Anan a déjà averti que cet attentat ne changerait rien à sa politique d'intervention en Irak, mais je suis persuadé qu'il faut prendre cette déclaration cum grano sali, c'est à dire en y ajoutant des nuances encore sous-entendues. Il ne peut pas ignorer que s'il ne change rien au statut des occupants de l'Irak et s'il se contente de retourner là-bas pour y poursuivre les multiples tâches parfaitement secondaires de Sergio de Mello (Kouchner prépare déjà ses valises), la décomposition de l'image de l'ONU au Moyen-Orient ne pourra que s'accélérer. Pourtant il a sous les yeux le désastre de la politique qui a été menée dans les Balkans où les pouvoirs de l'Otan et des grandes puissances a abouti à transformer l'ex -Yougoslavie en plaque tournante de la grande délinquance internationale, du blanchiment de l'argent sale, du trafic de drogue, de femmes et d'enfants. Il n' a donc pas le choix : ou bien il exigera des coalisés l'abandon de l'exclusivité du pouvoir au profit du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale de l'ONU, ou bien il mènera l'ONU vers son déclin définitif, sa dégradation définitive au rang d'une vulgaire ONG, et d'une ONG qui ne bénéficiera même pas du préjugé favorable de la neutralité. Elle continuera donc d'être agressée partout dans le monde, au même titre que les intérêts des coalisés.
A l'instant, Tim discute avec le Directeur de l'Aide Internationale de l'ONU et lui sert mes arguments les uns après les autres, y compris cette constatation que l'ONU est au plus bas de sa carrière. A quoi son interlocuteur n'avait pour toute réponse que l'éternelle ritournelle qui consiste à dire que tant qu'il y aura du sous-développement, il y aura de l'instabilité. Toutefois, il reconnaît que l'ONU ne pourra reprendre ses activités normalement en Irak que nanti d'un nouveau mandat. C'est ce que je disais hier, les Américains et les Anglais doivent lâcher le morceau, donner le pouvoir à la Communauté Internationale en Irak sous une forme ou une autre, à condition qu'il ne soit pas trop tard, car qui va les croire encore maintenant, qui va donner une valeur quelconque à un mandat qui ne sera en définitive qu'un bout de papier concocté par le Conseil de Sécurité sous la maîtrise d'œuvre de Washington ? Au fait, en quoi pourrait consister un " nouveau mandat " ? Et d'abord pourquoi " nouveau " ? Je ne sache pas que les Américains et les Anglais possèdent le moindre mandat, ils n'ont aucun mandat, ils sont en rupture de légalité totale et ce malgré leur interprétation fallacieuse de la Résolution 1441 en leur faveur. L'ONU n'a mandaté aucune armée pour renverser Saddam Hussein. C'est donc un mandat vraiment politique qu'il faut envisager, c'est à dire un contrat entre un maximum de Nations décidées à contrôler la construction d'un nouvel état irakien, et le sort de la richesse principale du pays.
Et là nous atteignons le cœur du problème : les Américains et les Anglais sont allés en Irak pour s'emparer du contrôle du pétrole, de sa propriété et de son exploitation, prétextant pour un délais indéterminé qu'ils ne font que se rembourser du coût de la guerre qu'ils ont engagée contre Saddam Hussein. A ce train-là, les Irakiens ne sont pas prêts de voir un seul dollar de leur pétrole, l'occupation elle-même coûtant aussi cher sinon plus que les quelques jours de conflits. Alors question : un nouveau mandat va-t-il mettre des conditions au retour de ce pétrole au peuple irakien, du genre cité plus haut, ou bien ce mandat contiendra-t-il comme article premier que tout le pétrole irakien servira à la reconstruction de l'Irak et exclusivement à ça ? Tant qu'une telle résolution ne sera pas votée à New-York il est pratiquement certain qu'aucun autre pays ne va se risquer à aller aider les coalisés à maintenir la sécurité en Irak, car chaque jour va devenir plus dangereux, le peuple ayant parfaitement compris les données de ce qui se passe en ce moment. Si les Irakiens font sauter les pipe-lines, c'est parce qu'ils savent que ce qui passe par ces tuyaux ne leur rapporte pas un fifrelin, malgré les discours mensongers de leurs occupants.
La volonté d'hégémonie c'est ça. Le fils Bush préparait cette affaire déjà bien avant le onze Septembre 2001. Le seul tort des terroristes aura été d'attaquer les premiers, mais on ne connaîtra jamais le fin mot de l'attentat des Twin Towers, non pas que l'on dût forcément rendre l'administration Bush complice de cette horreur, mais qui connaît le jeu auquel se livraient les services secrets américains dans les pays où ils savaient que se préparaient les grandes actions terroristes ? Tout le monde est de plus en plus convaincu que ces services en savaient beaucoup plus long qu'ils ne l'ont admis et il existe même des preuves qu'on était au courant des préparatifs d'un attentat d'envergure à New-York. Je dis cela parce que le résultat apparaît seulement maintenant : Bush voulait sa guerre en Irak, elle était facile et juteuse, et elle ne devait être qu'une étape vers d'autres conflits et d'autres main-mises. Et rien ne dit que sa stratégie ne s'accomplit pas exactement comme il le veut, malgré tout ce qui peut arriver dans ce pays comme cet attentat d'hier contre l'ONU. Colin Powel est en train de discuter avec Kofi Anan, et leur sujet de discussion est précisément ce nouveau mandat destiné à convaincre d'autres grands pays à se joindre au maintien de l'ordre en Irak. Il est prévisible que le sage Powel trouvera un compromis avec Anan, mais ce compromis ne franchira pas le seuil de la Maison-Blanche, et nous verrons très bientôt le Secrétaire d'Etat réellement démissionner : ce sera le signal, le moment où Bush tombera le masque et le commencement de l'isolement de la coalition dont même Blair aura du mal à se retirer, s'il en a le courage et s'il est encore au pouvoir. Après cela, l'ONU tombera réellement à son plus bas niveau, et le monde retournera à la situation d'avant 1914. Comme je le pense depuis longtemps, vous pouvez retourner lire mes chroniques depuis 1999, l'Europe sera le cœur de la future reconstruction de tout cet édifice, lorsque les USA auront dilapidé toute leur puissance aux quatre coins du monde. Ce sera un choc pour tout le monde, mais vous verrez que le protectionnisme économique a du bon, et l'Europe se refera une santé grâce aux folies d'un pays qui a perdu le sens commun. Il est regrettable que la pusillanimité de gens comme Chirac et Schroeder nous fassent perdre un temps précieux, les Belges ont depuis longtemps compris et leurs prises de positions reflètent l'avenir réel de l'Europe. Je ne parle pas des complices idiots de Bush comme Berlusconi et Aznar qui paieront très bientôt leur trahison de l'Europe. Les peuples italiens et espagnols les ont pratiquement déjà virés.
Samedi 23 août 2003
Les racines du mal.
Titre pompeux mais ambitieux. J'aime me lancer dans une spéculation comme dans une sorte de corrida dont je ne sais pas qui sortira vainqueur. Il m'est arrivé d'échouer, et dans ce cas je n'ai jamais diffusé, mais il se peut que beaucoup de mes lecteurs se soient trouvés en profond désaccord avec mes spéculations, mais le réseau est bien silencieux, même lorsqu'un site comme celui-ci, j'en fait plus haut la publicité, marche bien et possède un lectorat plus qu'honorable. Lorsqu'on sait que les lecteurs de la presse nationale ou locale lisent en moyenne 5% de leur journal, et encore seulement les titres et les chapeaux, je n'ai pas à rougir des statistiques qui me parviennent sur le nombre de pages visitées chaque jour. Mais, suffit pour la pub ! Les racines du mal.
Il y a quelques jours je suis allé sur le forum de Libération, vous savez ce journal qui ne sait pas sur quel pied danser, tantôt franchement de gauche, et tantôt, en général dès que la gauche est au pouvoir, d'on ne sait de quel bord mais sûrement d'opposition. Les forum des médias sont très révélateurs de leur politique éditoriale et de leur loyauté déontologique, et j'affirme ici hautement que les parloirs virtuels les plus huppés, comme ceux de Libé et de France-Culture sont tous censurés, et censurés de la manière la plus cynique qui soit. Je ne parle pas, évidemment, de censure de textes diffamatoires ou orduriers, ce que je comprends fort bien, mais bel et bien de textes tout court, à contenus certes politiques et critiques, mais qui ne plaisent pas, tout simplement. Je ne suis pas le seul à m'en plaindre, croyez-moi, et je limite au maximum la fréquentation de ces lieux. Mais cette fois j'y suis allé pour y coller ma chronique sur les OGM que vous avez pu lire il y a quelques jours, et si mon texte a été accueilli avec sympathie par la plupart de ceux qui ont réagi, il s'est trouvé un mauvais coucheur pour s'indigner de ma saute d'humeur contre les ravages de l'automobile, du tourisme, de ce qu'on appelle désormais la " malbouffe " et, bien entendu, les OGM.
J'ai donc réfléchi à cette réaction. Après tout chacun peut avoir son opinion, et en attaquant par exemple l'usage et le développement de la voiture, je me mets à dos des millions, voire des milliards d'amoureux de cet engin meurtrier. Oui, des amoureux ! Pourquoi cacherais-je que j'ai aussi aimé la voiture, pas en elle-même comme objet fétiche, mais comme possibilité de me ruer sur les routes désertes des années cinquante et soixante. Je me souviens très exactement du jour et de l'heure à laquelle j'ai compris mon erreur, c'était en juin 1971, à huit heures du matin, lorsque j'ai débarqué à Marseille en provenance d'Algérie où je venais de passer deux ans. Les rues de la cité phocéenne s'était remplies de cloportes colorés. Renault venait de sortir la Renault 5 et Peugeot ses 2O5, et les Français semblaient tous avoir hérité, c'était les dernières années des trente glorieuses. Ce fut le seul moment de toutes ces années tant célébrées par les économistes où j'ai eu la sensation que la France était devenu un pays riche, étalant sa richesse sous les couleurs chatoyantes de ses carrosseries. Il est vrai que je débarquai d'un pays où la voiture était encore un privilège de riche. Bref, en débarquant je pris d'un coup la mesure de la catastrophe, et plus je remontai vers le nord, plus me devenait évident que quelque chose d'essentiel venait de se passer qui dissimulait des perspectives plus qu'angoissantes. L'erreur que nous avions tous commis lorsque les états européens se sont mis à " démocratiser " l'automobile, WV en Allemagne, la Deuche en France, était de ne pas nous rendre compte que cette démocratisation était le faux-nez d'un apocalyptique instinct de profit qui n'avait pas pour but de libérer l'homme de la fixité de sa condition, mais de le projeter dans un mouvement dont il allait cesser rapidement d'être le maître. Le grand Jacques Tati a été à peu près le seul à comprendre instinctivement le " quia absurdum " de toute cette affaire. Il n'a pas seulement compris que l'automobile était en train de prendre le pouvoir sur les passions humaines (ça c'était encore Mon Oncle), mais il avait compris que la voiture allait entièrement remodeler l'existence et la manière d'habiter le monde en fonction d'une spirale sans fin qu'on appelle aujourd'hui la croissance et qui est devenu la nécessité essentielle de la stabilité des sociétés humaines. Le mouvement allait atteindre la totalité de la réalité ; la réalité entrait en mouvement dans le sillage des mouvements initiés par les deux grandes guerres. Je me répète encore, mais les autoroutes de Hitler avaient été conçues dans des buts stratégiques de guerre et après 1945, cette guerre a simplement changé de nature. Statistiquement, la voiture a tué en France depuis 1960, environ 500 000 personnes, presque toute une génération, et blessé et handicapé près du double, alors que la seconde guerre mondiale n'a fait au total que 240 000 victimes.
Car ce qu'il faut rappeler aux jeunes générations, c'est que l'automobile a entièrement remodelé l'environnement au point que la relation initiale entre l'homme et la machine s'est inversée, l'homme perdant le pouvoir au profit de la machine. Urbanisme, aménagement du territoire, décentralisation des lieux de travail, exode rural dû au choix industriel au dépens de l'agriculture (le gel du prix du pain a plus sûrement tué l'agriculture que la construction européenne, mais évidemment l'un allait avec l'autre puisque le choix de pénaliser l'agriculture au profit de l'industrie a été un choix largement européen), destruction systématique des paysages, tout était fait pour assurer et durcir la contrainte à l'automobile. Il ne saurait être question d'omettre ici les conséquences lointaines, et aujourd'hui si proches, de la décision de réorganiser l'existence autour de cette animal sans âme, à savoir l'exploitation sans limites des gisements de pétrole au prix de la création et de l'entretien d'une anarchie politique dont nous n'avons pas fini de payer la facture. Ni de souligner en passant que ce qui se passait sur terre avait son équivalent dans l'air et sur les océans qui allaient, eux aussi, payer le prix fort pour cette folie qui n'avait absolument rien de fatal.
Argument contraire : l'externalisation des usines a permis la dépollution des villes. C'est d'un drôle, pour deux raisons : primo lorsque les nouvelles usines ont commencé à pousser dans nos lointaines banlieues, elles ont en même temps cessé de produire elle-mêmes leur énergie et se connectaient simplement au réseau EDF, résultat : plus de cheminées comme celles que j'ai encore connues dans mon enfance, plus de pollution industrielle. Secundo la pollution issue des pots d'échappement est venue remplacer molécule pour molécule celle des fumées d'usines. Quelle blague ! En 1989, la ville de Strasbourg était au bord de l'asphyxie pure et simple, le tramway n'a pas été un luxe car même le Maire de droite qui tenait la ville avait décidé d'installer un métro souterrain. Mais pendant trois décennies, Monsieur Pierre Pflimlin, ex-Président du Conseil et Maire de la ville, ne ratait pas, dans n'importe lequel de ses discours, une allusion à la nécessité de développer l'industrie automobile. Le résultat a été la quasi destruction de tout le réseau de transport en commun et une situation dramatique en terme de qualité de l'air. Je n'ai pas fini de régler mes comptes avec cette satanée voiture, mais je couperai court, car le procès serait vraiment trop long. Il faudrait analyser la baisse drastique du pouvoir d'achat que représente aujourd'hui l'obligation de posséder un véhicule pour trouver un emploi, baisse jamais compensée par une augmentation parallèle comme ce fut le cas en Amérique. En France c'est : démerde-toi, sans parler de l'impôt devenu naturel qu'est devenu la taxe de parking et celle sur le carburant. Non, l'essentiel est devant nous, dans l'avenir presque immédiat : les usines produisent des centaines de milliers de voitures par jour à travers le monde, et ces voitures doivent être vendues parce que cette industrie est devenue un pilier de la croissance dont elle a elle-même programmé la nécessité. La consommation de cette production implique une croissance qui est voie de disparition, disparition dont la crise dans les transports aériens est le témoin le plus évident. Quant à ce qui fait tourner les moteurs, à savoir le carburant, sa raréfaction programmée ne peut qu'entraîner une hausse illimitée de son coût et rendre la voiture à son statut d'objet de luxe qu'elle avait au début de sa carrière.
Autrement dit encore : aucun développement durable n'est envisageable sur la base d'une politique de développement constant de la production de véhicules automoteurs. La Suisse a été le seul pays a conserver une double structure de circulation pour ses citoyens. Pendant quelques décennies cela lui a coûté cher en manque à gagner pour entretenir les réseaux de transport en commun. Mais aujourd'hui les résultats sont là et le problème de l'automobile pratiquement maîtrisé car elle est retournée à sa fonction première, le loisir. Les Suisses n'ont eu qu'un seul tort, c'est de s'être laissé aller à défigurer leur pays avec leurs autoroutes, mais ils n'avaient guère le choix dans le contexte économique européen, ce qui ne les a pas empêché de légiférer sévèrement sur les transports par poids-lourds, il suffit d'aller regarder les glaces de Grindelwald dont le bleu légendaire s'est transformée en une masse grisâtre farcie de minuscules escarbilles de goudron sortis tout droit des pots d'échappement des moteurs diesel. Crève-cœur symbolique et macabre. Ici le réchauffement de la planète attribué à la production massive d'oxyde de carbone serait presque une délivrance, une belle prairie vaudrait bien mieux que cette glace au charbon.
Contre-argument ? Le plaisir de conduire, de s'enivrer de vitesse sur les autoroutes, de reconquérir un petit coin de l'existence où réside encore un risque, cette composante essentielle de l'existence humaine. La " Fureur de Vivre " avait un très sérieux fondement ontologique, car tout en critiquant la vie des adultes de leur temps, les jeunes s'emparaient de ce que leurs parents produisaient pour le détourner en exutoire à leurs passions déjà bridées par la réalité de leur avenir. En mourant au volant d'un bolide en pleine jeunesse, James Dean a immortalisé cette tragédie du double-piège que représente l'automobile. Aujourd'hui les jeunes, et en particulier ceux des banlieues, se procurent des voitures comme jadis on recherchait les meilleurs chevaux, les meilleurs montures pour parader et aussi charger sur les champs de bataille. L'industrie du cinéma repose à quatre-vingt pour cent sur l'utilisation de cette substitution des automobiles au chevaux des Westerns. Mais tout cela est condamné à demeurer de plus en plus confiné dans le spectacle, car la saturation des espaces de circulation impose une répression de plus en plus drastique. Chaque gouvernement veut gagner des vies humaines sur les routes et sur les autoroutes, et à cet effet, il rogne à chaque fois un peu plus de liberté et un peu plus de chance de pouvoir laisser s'épanouir ce besoin du risque. Or le risque, s'il n'est pas entièrement assumé par la pensée, est un instinct dangereux qui ne peut que conduire au pire des choix existentiels. Voyez ces jeunes Américains s'envolant tout joyeux vers les sables irakiens pour en découdre et pour exposer leur jeune existence au risque de la mort. Comme en 14, ils s'attendaient à tout, sauf à laisser leur vie quotidienne s'enliser dans le néant d'une occupation vide de sens pour eux dans un pays d'où la mort leur adviendrait comme une fatalité non désirée.
J'en termine là pour cet article de bazar qu'est l'automobile et je reprendrai la question des racines du mal demain, dans un autre domaine, encore que tout soit lié, bien entendu. Si j'ai oublié un contre-argument, dites-le moi, nous en reparlerons…
Dimanche 24 août 2003
Les racines du mal II
En commençant cette deuxième partie de cette prétentieuse analyse des racines du mal, je me rends compte du danger qui menace tout commentaire de ce genre, et ce danger s'appelle la sociologie. Il est tellement facile d'oublier l'individu, qui, envers et contre tout ce qu'on a pu écrire de lui, de sa place dans la " société ", de son insertion dans des mécanismes aveugles et collectifs, bref dans les logiques des masses sociales, n'a jamais cessé un seul instant d'exister. C'est dire la masse de souffrance qui s'accumule dans autant de consciences qui, trop souvent craquent et se lancent dans un processus d'anéantissement, quel qu'il soit, la névrose ou la folie, l'autodestruction, un simple massacre familial ou une guerre. Qui peut me dire si GW Bush n'est pas en train de conduire son pays à la catastrophe seulement parce qu'il a un compte à régler avec son père, avec le père qu'il a en lui et qui lui donne des ordres intérieurs, fantasmatiques, passibles d'une psychothérapie ? C'est dans cette persistance, envers et contre tout, de la conscience individuelle, que réside la difficulté, l'impossibilité même de faire de l'histoire, de prétendre faire un récit de ce qui arrive : car il n'arrive rien, ou disons que ce qui arrive ne concerne à chaque fois qu'une seule et unique conscience, souffrance, joie, bonheur ou mort. Toute la vie est comme la mort : elle se passe dans la solitude de la conscience. Alors comment additionner toutes ces aperceptions singulières de ce qui est et de ce qui se passe pour rendre raison des transformations massives du monde ? Le roman aurait eu cet immense mérite de faire un tel compte rendu, et les tout grands romanciers y sont parfois parvenu. Mon exemple favori est Dostoïevski qui jamais, dans la moindre de ces propositions ne parlent des individus sans les marquer de leur singularité. Et voyez le résultat : aucune vision prétentieuse de l'état russe de son époque, aucune théorisation du destin collectif, seulement un regard sur chacun, disons pour être honnête, le génie qu'avait Dosto pour passer en revue tous les états de conscience et les mettre en scène dans le chaos le plus total. Relisez l'Idiot, c'est une fresque mais une fresque muette, humble et pour cela seulement elle est belle. La plupart des romanciers au contraire, nous servent des modèles sociologiques, comme Balzac ou Flaubert, déjà contaminés par la culture industrielle de l'humain. Même Faulkner, ce Shakespeare américain, travaille avec des modèles déjà fordiens de l'homme, celui du Sud, le noir ou le blanc, la pute ou le maquereau, l'aristocrate ou le bourgeois d'argent, des catégories dont l'alchimie est parfois de nature à donner une ambiance, mais guère davantage. Alors quand on en arrive au spectacle hollywoodien c'est lamentable, on entre directement dans une machine toute faite qui ne sait même plus cacher l'endroit où elle veut vous mener.
Alors comment continuer autrement qu'en mettant en avant d'abord et avant tout ma propre mémoire de ce que j'ai vécu de cette décomposition du monde. Je vais vous donner une image de ma vie, et cette image mérite les caractères gras car jamais je n'ai su exprimer cette choses aussi clairement :
présent dès l'origine, l'objet de mon désir s'est progressivement évanoui en même temps que s'ouvrait pour moi le pouvoir de le combler.
Me fais-je bien comprendre ? La vie, dans mon enfance, était la vie, la vie se suffisant elle-même à elle-même et ne demandant rien d'autre que de se reproduire dans l'ordre dans lequel je la recevais alors. Jamais alors, ma conscience ne se torturait au sujet de la transformation de ce présent immobile et parfait, des changements dont dépendraient ma fortune ou mon infortune. Mon enfance n'a pas connu de dressage mental en direction de l'ambition d'être plus que les autres, plus riche, plus beau ou plus puissant. Elle a connu un océan étal de présence auquel je n'avais nul désir de me dérober. Et puis, soudain, c'est lui, l'océan présent qui s'est déchaîné autour de moi. Mon adolescence a été la tourmente et le désarroi face à cette tempête imprévisible, et tout ce que je pouvais opposer à ce monde de plus en plus obscur, cette nuit de plus en plus haute et distante, c'était de lire, c'était de m'évader hors d'un présent qui avait commencé à bouillonner tout autour de moi. C'est à ce moment-là que le monde se mit à danser le boogie-woogie du développement ou de la croissance. Mon quartier se remplissait de machines en tout genre sans que je m'en aperçoive autrement que lorsque ma mère fit l'acquisition d'un comptoir réfrigéré pour son magasin. Il y avait de plus en plus de nouveaux modèles d'automobiles, mais rien d'alarmant. La seule nouveauté qui venait faire trembler mon corps et mon cœur était la musique qui nous venait d'outre-Atlantique. Le jazz venait donner le ton et le rythme de tout ce qui allait suivre, de ce qui s'était déjà vécu là-bas du Sud au Nord de l'Amérique et qui nous prenait à la gorge, je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi. Pourquoi nous sommes-nous pris de passion pour le jazz ? Avions-nous quelque chose en commun avec les nègres du Sud ? Quelle continuité pouvait-il y avoir entre ce qu'exprimait cette musique à la fois brutale et mélancolique et ce que nous ressentions, nous, les paumés de la guerre ? Qu'avions-nous de commun avec les esclaves sortant de leurs trous pour amuser les blancs et prendre leur argent et un peu de droit d'exister ?
Mais vous voyez comment s'organise tout de suite les questions : avions-nous, étions-nous ? Alors que chaque soir, dans mon lit, je fermais mes yeux tout seul sur moi-même, que chaque matin j'affrontai seul le temps de la journée qui venait. Ce temps était certes largement paramétré par un ordre social auquel il ne serait que bien plus tard question d'échapper, mais dans l'instant je n'étais jamais que moi, combinant mes actions selon une mathématique assez compliquée qui devait associer diverses fonctions dans la famille et à l'extérieur pour faire un ensemble que je pouvais assumer. Avec de plus en plus d'évidence et de permanence, s'imposait la question sempiternelle : allais-je y arriver ? Allais-je arriver à me glisser, moi, entier, dans les remous du big bang qui s'ouvrait autour de moi en gerbes énigmatiques ? Je crois que la pire des sensations de cette époque qui culmina autour de mes vingt ans fut la perplexité, un désarroi que je masquai par une sorte de cynisme suicidaire, en ne pensant déjà plus qu'à une seule chose partout où je me trouvai, partout où je m'installai pendant quelques temps : où est le chemin de repli ? Par où puis-je prendre la fuite ? La question de savoir si je pouvais agir dans ce monde, agir sur lui, modifier le cours de ce qui commençait à se ruer partout, ne se posait même pas : fuir, je ne pensais qu'à fuir.
Bien sûr la fuite tombait bien avec la guerre d'Algérie, j'avais un alibi en or, ne pas me salir, ne pas me rendre complice du crime colonial, même si cette désertion avait déjà été programmée depuis longtemps, bien avant que je ne pris connaissance des horreurs auxquelles se livrait l'armée française dans cette colonie et ailleurs. Nous étions encore au lycée, nous avions quinze ans et nous, vous voyez je dis encore nous mais cette fois vous comprendrez la nature singulière de ce nous, nous distinguions dans l'uniforme militaire, devenu quelque chose comme le destin qui nous attendait tous, toute la machinerie qui ailleurs dans la vie se mettait en route, et alors nous avons dit ensemble : non. Ce serment collectif me liait très personnellement, dès qu'il fut prononcé les autres ne comptèrent plus, ils feraient ce qu'ils voudraient. Cette affaire était devenu un défi entre ma conscience et moi, ma parole et ce que j'allais en faire. Ma parole dans le regard et dans les oreilles des autres, certes, mais cela n'avait que peu d'importance, j'avais à me gérer moi-même d'abord et tout seul.
Nous semblons loin de notre sujet, revenu à je ne sais quel anamnèse quelque peu narcissique, mais il faut bien que je trouve un chemin vrai qui me mène, étape par étape, à la reconnaissance de ces racines du mal. La description de ce passage personnel n'est que la description du passage entre deux mondes, le monde de l'immédiat après-guerre qui avait repris son cours immobile mais qui dissimulait une parturition d'un nouveau monde dont la menace portait de nombreux masques dont celui de la guerre coloniale. En réalité, le monde fermentait dans ses entrailles où se développait un monstre qui ne tarderait pas à prendre tout le champ de la réalité. Qui connaissait le véritable sens de ces guerres coloniales ? Qui, à ce moment-là était assez lucide pour n'y voir que ce qu'elles étaient, c'est à dire des lambeaux de chair pourrie de l'ancien monde qui cédaient la place au monde moderne dans le plus parfait chaos. A ce moment-là, tout ne paraissait pas si chaotique, il y avait encore la guerre froide qui semblait dominer de sa logique tout ce qui se passait ici et là. J'étais pris dans les remous de cette logique et j'en apprenais tous les jours le fonctionnement, et pourtant rien ne me paraissait assez convaincant pour que j'accepte de m'y perdre en allégeances qui me donnerait une place, même invisible, dans le mouvement profond de ce qui avait lieu. Je n'acceptai que de me perdre moi-même pour moi-même parce que je voyais partout le mensonge, le chaos des paroles contradictoires et des promesses qui n'allaient nulle part. Bref je me retrouvai à la case départ de mon adolescence, mais cette fois avec la contrainte de trouver une place où je pouvais faire durer mon existence. Gagner ma vie, comme on dit.
L'errance continua donc encore longtemps. Je me mis à tourner autour du monstre qui bétonnait l'espace en millions de mètres cubes sans trop m'en apercevoir car je passais alors mon temps dans les pays dits en voie de développement. En Guadeloupe, à cette époque, il fallait encore cherche l'hôtel Médirien, qui était à peu près le seul " gratte ciel " digne de ce nom, et encore. Je ne parle pas de Montserrat, où je vivais, où les seuls bâtiments en dur étaient quelques villas et les banques, le reste était encore en bois et les routes ne dépassaient pas deux mètre cinquante de large. En passant à San Francisco, j'ai été surpris par la crasse et la taille réduite du périmètre des gratte-ciel. Partout ailleurs l'anarchie du capitalisme immobilier en faisait une ville à moitié en ruine avec ses immeubles condamnés par la spéculation et les terrains vagues en attente d'acquéreurs, sans parler des immeubles squattés par des hordes de hippies et des black ou china towns qui reproduisent sur place l'urbanisme des pays d'origine. Après cela je peaufinai ma cure de décors archaïques pendant trois ans au Gabon, dont deux en pleine brousse, bonheur intégral dans une sorte de gros village que la moindre pluie transformait en un bourbier rouge auquel on s'habituait comme à beaucoup d'autres choses. Jamais le moindre sentiment de manque, d'absence de choses essentielles, rarement ma vie fut aussi pleine et empreinte de vrai bonheur et si mon épouse d'alors avait vécu les mêmes sentiments, je crois que j'y vivrais encore malgré la modernisation qui, paraît-il, a aussi atteint ce petit coin de paradis. On peut même le trouver sur Internet ! Mais je n'ai pas peur, là-bas les choses sont avant tout éphémères, surtout lorsqu'elles ne sont que des imitations du monde des blancs. Goudronnées en 1978, je suis à peu sûr que la latérite a repris le dessus et que c'est toujours de la tôle ondulée qui relie le petit aéroport à la ville.
C'est donc à mon retour au bercail que je pus constater toutes les dimensions de la catastrophe. Où était passé l'objet de mon désir ? Non seulement j'allais, par les circonstances difficiles de ma vie, rentrant malade et sans emploi en Europe, me voir aux prises avec la reconstruction d'une carrière, trouver un emploi, installer et nourrir ma petit famille qui allait s'agrandir quelques mois plus tard, mais il fallait encore trouver à tous ces efforts une raison qui dans la réalité se réduisait à la qualité plus ou moins stable du fonctionnement. Autrement dit la vie était partie, elle s'était vidée d'elle-même, absentée, je devais trouver minute après minute des passerelles pour passer d'un épisode à l'autre, pour remplir tout ce qui n'était pas travail, soins des enfants et soucis d'argent perpétuels. J'ai eu pourtant une chance inouïe avant d'affronter le cœur de cette réalité vide, j'ai pu vivre à l'écart de la grande ville dans un petit village de montagne où mes beaux-parents possédaient une maison secondaire, et ce fut un sas de décompression bienvenu entre la poésie africaine et l'industrie urbaine du vivre.
Nous y sommes, je trouve l'expression assez juste, l'industrie du vivre. La vie s'est industrialisée en profondeur. C'était comme si une peau protectrice de l'existence se dissolvait au contact de la nouvelle rationalité de l'existence et que les rouages du fonctionnement apparaissaient à nu, sans protection et la plupart du temps sans le moindre lubrifiant. Mon naturel extraverti, simple, gai et spontanément naïf me mettait à l'abri de bien des heurts directs avec le monde que j'avais à conquérir pour trouver une place, et ma jeunesse me conservait encore une énergie assez combative pour tout assumer jusqu'aux carences de celle qui était censée me soutenir. Observez ici l'abîme qui sépare deux êtres que la sociologie va classer dans les mêmes colonnes : mon épouse n'attendait que le retour dans la ville pour laisser se déchaîner toute l'énergie accumulée par les années de frustrations et notre famille ne tarda pas à éclater, pendant que je déployais des efforts sans limites pour concentrer toute mon ambition sur l'amour qui pouvait lier les quatre êtres qui formait cette famille ! Malentendu sur toute la ligne, ratage complet, pas de famille, pas de bonheur familial, rien. Sounds and fury and meaning nothing. Et pendant ce temps, dehors, le monstre grossissait de jour en jour. La ville était devenue un vaste parking à véhicules à moteur, suants et puants, les rues n'étaient plus que des vitrines de commerce, les personnes étaient des touristes, des vrais venant de l'autre côté du Rhin, et des faux venant de l'intérieur d'eux-mêmes pour se donner une contenance. On pouvait encore s'agréger à quelques tribus d'amateurs de théâtre pour s'évader dans un art vivant de sa caducité, puisque nous étions tous devenus caducs, mais même au TNS, le répétitif fonctionnel avait implanté son virus. La vie se retirait de partout, donc, même des bistrots qui faisaient notre consolation de jeunes étudiants. A la place des chaises de brasserie aux barreaux recouverts d'une fine couche de crasse qui faisait une patine chaude et humaine, ils avaient mis des sortes de trônes à l'allemande, en faux-vrai bois vernis et chantournés, du kitch pour culs larges et bien nourris. La bière descendait dans les verres sans laisser d'auréoles, de l'une d'entre-elles je disais qu'elle était meilleure à vomir qu'à boire. En fait je crois que déjà je parlais de la vie elle-même, celle qui avait été programmée par l'industrie et qui produisait maintenant ses effets partout dans l'air, sur terre et dans les cœurs.
Je commence à comprendre cette chose incroyable, c'est que le velours de la vie, cette graisse naturelle qui recouvre la réalité de l'enfance comme la substance qui protège les ailes des oiseaux, cette énigmatique lien de toute chose est exactement ce que l'industrie détruit et ce à quoi elle se substitue impitoyablement. Cela porte le nom de confort, mot mystérieux à résonance militaire car il ne signifie que le fait de rendre solide une place à défendre. Confort provient sans aucun doute des mots latins cum et fortis, avec force. Nous retrouvons là le fin mot de la métaphysique d'Aristote qui identifie l'être à l'energeia, à savoir la force. Voilà où se joue exactement le choix métaphysique dont nous parlions plus haut : le confort est la volonté de " prendre par la force le séjour sur cette terre ". C'est pourquoi il n'y a rien de ridicule dans le désir exprimé par quelques générations qui ont vécu des climax, des points trop élevés de cette conquête, rien de risible à vouloir retourner à la simplicité de la nature dans son être le plus simple, primitif. En mai 68, la France venait de remporter une victoire inouïe sur cette nature primitive, elle avait non seulement fabriqué la bombe atomique, elle, ce petit pays que l'on croyait rayé de la carte depuis 1945, mais elle avait dompté cette bombe pour produire l'énergie et faire tourner partout les moteurs du confort et de la circulation. La conscience collective la plus aiguë et la plus vigoureuse était dans le cœur de la jeunesse étudiante, et cette conscience s'est trouvée comme frappé par cette vérité. La critique de la société de consommation aura été la cristallisation des symptômes d'angoisse libérés par cette réalité soudaine. L'industrie fabriquait un nouveau revêtement de l'être, une sorte de gant de caoutchouc qui recouvrait toute forme, lui dérobant son authenticité mnésique, c'est à dire pour les jeunes nés dans les années 45, le souvenir du velours naturel de la vie, de la vie autonome, de la physis se produisant sans fil électrique et sans carburant.
Bien entendu, cette épluchure de l'être était aussi interprétée comme éradication de la liberté de la chose, de sa soumission aux impératifs du fordisme : la matière et les hommes se faisaient face devant une chaîne de production à laquelle ils étaient tous deux menottés. Cette image géniale avait été prophétisée par Chaplin et avait fait son chemin dans les analyses culturelles des années cinquante et soixante. Raison pour laquelle les artistes ont été les précurseurs de la révolte. Les dadaïstes qui se réunissaient dans les tavernes de Zürich, les surréalistes et les lettristes suivis par les Situationnistes provenaient en ligne directe du domaine de l'art. Ces derniers étaient ce qui restait du mouvement Cobra (Copenhague-Bruxelles -Amsterdam) dont le chef de file était Asger Jorn. Guy Debord lui-même était un anti-artiste dont toutes les œuvres sont l'illustration de cette arraisonnement de l'Être par la technique. Je comprends maintenant sa fascination pour Alphaville, le film de référence de Godard, qui résume en fait pratiquement tout ce que je viens d'écrire. En beaucoup plus flou mais en beaucoup plus beau. Le triomphe du général De Gaulle, même ses extravagances coûteuses comme Bull, celles qui font aujourd'hui encore rêver le monde entier comme Concorde, ou encore celles qui ont fortifié l'Europe comme Ariane, cette victoire à la Pyrrhus aussi éclatante qu'ignorée en tant que telle, avait brutalement écorché la mémoire d'avant l'atome et d'avant le langage binaire. A cette date de 1968, la France combinait dans sa rigueur républicaine tout ce que les grandes puissances produisaient dans le chaos libéral, et le tableau n'en était que plus saisissant et plus porteur d'angoisse. Elle, la France, était redevenue la grande puissance mondiale grâce à l'ordre républicain qui donnait aux efforts industriels cet aspect de jardin de Versailles dans lequel l'esprit du grand siècle se retrouvait avec son négatif totalitaire masqué. D'où aussi l'insolence de sa jeunesse, " sûre d'elle-même et dominatrice " qui avait en face d'elle les générations battues, coupables et forcément réduites au silence.
Les OGM sont les lointains descendants de ce qui a produit le mouvement écologiste allemand, à savoir le nucléaire + le pacifisme lié au sentiment de culpabilité des enfants de nazis. Mais le danger matériel que représentent ces créations faustiennes de l'homme ne forme pas l'essence des questions qu'elles soulèvent. Celle-ci est à chercher dans la nudité et dans la solitude que laisse derrière elle ce ravalement de la réalité. Aujourd'hui l'homme se rue vers les terres vierges et les forêts maternelles pour retrouver ce qu'il ne sait pas qu'il recherche, et c'est là son drame. Le mouvement de l'ancienne nature était un mouvement libre en soi, les lois de Newton n'avaient rien à voir avec la situation de l'homme, elles n'étaient qu'une forme de plus de la liberté d'observer le ciel. Son poème. Le mouvement de la technique, c'est à dire celui de l'industrie, lui, s'est emparé de tous les champs de cette liberté poétique. Il est vrai qu'il ne faut pas se laisser piéger par un fatalisme scientiste qui remplacerait le fatalisme religieux : la technique est une aventure dans laquelle l'homme a mis en jeu sa place dans l'autre moi, celui de la nature. . Le tapis qu'il a déroulé sur la totalité ne manque donc pas d'offrir aussi les chances à l'être humain de reprendre la main malgré la coupure du cordon primitif, et c'est d'ailleurs là tout le défi du présent. L'homme a " conforté " son existence, il doit à présent retrouver la nature de sa nouvelle place dans ce confort et son sens. Mais pour ce faire, il devra plus que jamais tourner ses yeux vers le lointain passé où les grandes décisions furent prises de dépouiller l'Autre à notre profit exclusif. La question mystérieuse qui nous ronge tous au fond de nous-mêmes est si simple : est-ce que tout ce que nous avons fait jusqu'ici valait-il la chandelle ? Lorsque nous aurons brûlé de notre progrès le dernier arpent du Bon Dieu, aurons-nous trouvé quoi mettre à la place d'autre que nos désirs et nos sentiments de plastic ? Car le risque, le seul risque est bien là, c'est de nous transformer nous-mêmes en plastic, de nous en prendre à notre propre nature comme je sens que je m'en suis pris à la mienne. Mon agueusie n'est pas que physiologique, elle est animale au sens de la provenance de l'âme : je ne sens plus rien par le nez et par mes papilles gustatives parce que j'ai exposé mon corps à tous les poisons et à toutes les manipulations chirurgicales, mais mon âme est tout aussi orpheline de son objet principal, le désir de vivre. Et en cela je ne pense pas me différencier beaucoup de vous tous. Voyez comme l'odeur de la poudre recommence d'enivrer la moitié de l'humanité, voyez comme la guerre revient activer de ses prétextes foireux le seul désir qui reste lorsque tous les autres ont disparu, celui de la mort.
Mardi 26 août 2003
Les racines du mal III
Quel titre idiot ! Sa naïveté me fait honte. J'ai dû concevoir cette expression dans un instant de faiblesse intellectuelle ou dans cette hâte qui me pousse ces dernières semaines à écrire sans arrêt, à noircir l'écran de mon pc pour évacuer tous les jours quelque chose sur le réseau. Je n'étais pas si dupe que cela du caractère un peu ridicule du sujet que j'allais développer, des difficultés que j'allais rencontrer à le développer et même de la possibilité d'un échec. Je parlais même de corrida, hé bien, oui c'est une corrida à laquelle j'aimerais bien mettre un terme, mais où est l'animal qu'il faut que j'achève ? Où est le MAL dont je prétends mettre à nu les racines ?
La cause du débat était cette controverse sur les OGM, mais j'ai rapidement centré l'analyse sur une question beaucoup plus vaste qui mettait en question ce qu'on appelle communément le progrès technique et les facilités apparentes que nous nous sommes octroyés pour séjourner sur cette planète. Pour ne pas me perdre dans des jugements de valeur idéologiques qui prétendent se vérifier par un simple exposé théorique, je me suis impliqué personnellement, j'ai essayé de vous faire partager en quelque sorte l'évolution de mon regard sur le monde, ce que j'ai vu et ce que je vois, et donc de réduire mes propos à une réflexion et une esthétique qui ne prétend en rien rendre compte d'une vérité universelle. Il aurait donc mieux valu que j'intitule tout cela " les racines de mon mal " et basta. La conclusion de la deuxième partie de mon exposé a quelque chose de mélodramatique. Il est si facile de se saisir de la partie la plus malsaine et la plus sanglante de l'image que nous rapporte aujourd'hui le discours général, médiatique et théorique, pour vomir son propre malaise de manière élégante, de lui donner un masque et une " allure ". Au fond du fond, de le légitimer sur le dos des autres, de " l'Histoire ", de ces forces aveugles dont nous sommes les jouets dès la naissance. Au cours de mes vagabondages parmi les femmes et les hommes qui comme moi ont vécu dans le refus de ce qui se passait autour d'eux, je dois avouer que j'ai souvent dû côtoyer beaucoup de gens que je pensais névrosés, beaucoup d'individus dont les mobiles me semblaient le plus souvent ressortir à la psychopathologie. C'est pourquoi je n'ai jamais fait long feu dans ces regroupements de naufragés. C'est aussi pourquoi je me méfie vivement de ma propre Weltanschauung, de mes propres visions du monde. Ce n'est pas un hasard si je me trouve parmi la minorité qui résiste à tout ce qu'entreprennent les autres, la majorité, et je prends donc sur moi, sur mon histoire, sur mon caractère, mes faiblesses et ma névrose. Je me considérerai donc comme un raté de ma génération, et j'irais jusqu'à avouer que les ressemblances entre les jugements que je porte sur les choses avec ceux de beaucoup de mes semblables ne sont qu'un pur hasard ou une faiblesse de plus pour me réfugier finalement dans cette sorte de groupe ou de multitude-là. Je cesserai donc désormais de parler de " racines du mal ", comme si j'étais un prêcheur du quatorzième siècle. A la poubelle cette manière théologique de m'exprimer, d'user, comme je le prétends si souvent, de ma liberté de pensée et d'expression. Vidons, vidons, comme disait Maître Eckart, notre prétentieux intellect de ses vérités et de ses systèmes de vérités, il faut apprendre à vivre seul avec son dieu ou avec son diable.
Mais faut-il pour autant se taire ? Non. Je reviens à ma position de départ, la liberté de parler, de crier, de hurler mon malaise, ma colère, mes rages, sans avoir à les justifier autrement que par ma propre échelle de valeurs, ma propre sensibilité et par les chimères qui se construisent dans ma tête. Ce n'est pas facile, croyez-moi, mais depuis que je me suis mis à écrire, et en particulier ces " confessions " périodiques, j'ai toujours refusé de mentir quitte à passer pour un fou comme le pensent de moi en silence beaucoup de mes " amis ". Mais il faut bien reconnaître qu'il y a tant de choses à rejeter de ce qui a été fait et de ce qui continue de se faire qu'il y faut quelque chose comme de la folie pour oser s'y attaquer et n'en pas démordre. Ainsi en va-t-il par exemple de ma haine pour la publicité, oui de la haine, je ne trouve pas d'autre mot pour décrire mon sentiment chaque fois que je me trouve confronté à un exemplaire de cette pratique de mensonge et de manipulation. J'analyse ailleurs longuement ce qu'est, pour moi, la publicité, à savoir non pas seulement la promotion des marchandises, ce qui jadis s'appelait la réclame, et qui peut avoir son utilité en tant qu'information de ce qui se fabrique et se vend, mais aussi la mise en scène du monde qu'ILS veulent nous faire construire et habiter. Ici je me contenterai de souligner combien la publicité a depuis longtemps outrepassé les limites de toute moralité, identifiant la femme et sa beauté aux marchandises à vendre. Pire, la publicité se sert en dépit de la loi, qui ferme les yeux ici comme ailleurs, d' enfants de tous âges pour pervertir de la manière la plus honteuse le regard que l'on porte sur les produits de l'industrie de l'homme. D'un côté la société se fend d'un discours pompeux et hypocrite sur la pédophilie, cependant que les metteurs en scène des spots télévisés rivalisent de cynisme pour se servir de l'image de l'enfance dans des postures qui n'ont rien à envier à celles que ces mêmes vidéastes infligent aux femmes et aux hommes. Mais ce n'est pas tout, la publicité me pourrit ma culture, ma musique, ma peinture, se sert de Mozart pour vendre des yaourt et de Vermeer pour faire saliver les amateurs de chocolat. Il s'agit là d'un crime de lèse-art que personne ne songe à dénoncer, qu'il se produise in fine une confusion chaotique entre le beau qu'on a eu tellement de mal à conquérir dans notre culture et les marchandises, cela se passe dans la plus grande indifférence. Tout le monde se fout qu'il me soit devenu impossible d'écouter Nabucco sans qu'il ne s'y superpose automatiquement la faciès hideux de Le Pen ou d'entendre la Neuvième de Beethoven en voyant défiler des flacons de shampoing. Tout ça c'est ce qu'on appelle du vandalisme, mais un vandalisme légal, car par ailleurs on ne tolère pas ces jeunes taggeurs, qui revendiquent souvent avec raison le titre de grapheurs, aillent barbouiller les façades de béton blême de notre nouvelle architecture. A propos de cette publicité, la République se sait elle-même coupable : Malraux et quelques autres hommes de qualité avaient réussi à éradiquer de nos paysages français cette forêt de panneaux publicitaires qui polluaient nos routes et nos villes, ils avaient aussi fait des lois. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Toute cette merde s'est remise subrepticement en place et il n'est plus de carrefour où ne se dressent deux, trois panneaux coulissants, au demeurant parfaitement dangereux pour leur pouvoir de distraire les conducteurs de véhicules.
La publicité, cette manne, nous la payons de notre poche sous les prétextes les plus hypocrites. Qu'elle finance par exemple le mobilier urbain, ce qui est déjà hautement douteux, ne change rien au fait concret que tout cela a un coût bien réel pour les producteurs de marchandises. Alors c'est bien une partie du prix de ce que nous achetons qui est incorporée dans cette peste visuelle et auditive. Aucune casuistique d'économiste véreux ne pourra me convaincre du contraire ni m'attendrir en me faisant miroiter la création induite par la publicité de tout un secteur d'activité, d'emplois et de revenus. Tout cela est aussi pervers que la nature même des objets que l'on met au compte du progrès.
Avant d'en finir avec ce sujet qui me rend malade et me déprime, car je ne vois même plus de chemin de repli, je ne vois même plus comment je pourrais fuir tout cela sans suivre l'exemple de ces quelques fous qui sont allés jouer les ermites en Ardèche, il faut que je parle des médias et en particulier de celui que je connais le mieux pour y avoir collaboré pendant plus de vingt ans de ma vie. J'emploi à dessein le mot de collaborer car, même si ma carrière n'a été qu'une longue suite de batailles contre la chefferie des chaînes où j'ai exercé le métier de journaliste, j'avoue que le simple fait de travailler dans ce secteur est devenu de la collaboration avec l'occupant. Là aussi j'ai déjà donné, et il n'y a pas si longtemps que cela. Je vous dispenserai donc des analyses que j'ai déjà délivrées ici. Je me contenterai de résumer tout ce qui se passe dans cet outil des gouvernements et des grandes entreprises par un seul mot : le mensonge. Je voulais traiter du mensonge au début de cette troisième partie de cette réflexion, mais finalement il valait bien mieux qu'il vienne en conclusion, car le mensonge est devenu une sorte de milieu ambiant dont au fond peu de citoyens sont encore dupes. Dans mon enfance, le mensonge était le plus grave des péchés, la plus grave de toutes les transgressions. Aujourd'hui il n'est plus que ce à quoi chacun de nous participe plus, moins ou pas du tout, mais sans encore songer que l'on pourrait agir pour y mettre fin. C'est à quoi je m'atèle ici dans ONeON qui signifie, je le rappelle, l'étant en tant qu'étant, ce qui ne veut pas dire autre chose que : la chose comme elle est, c'est à dire sa vérité. Je ne suis pas très fier du traitement que j'ai infligé à ce titre idiot, sauf peut-être de mon texte numéro II auquel j'avais confié un peu de ma poésie. Je ne regrette cependant pas celui-ci, car c'est un texte de combat, et je veux que l'on comprenne, qui que l'on soit à lire ces lignes, sympathisant ou adversaire, que ONeON est un journal de combat. Il y a quelques siècles on mourrait pour beaucoup moins que pour tout ce que j'écris ici. A la vitesse à laquelle la République régresse ces dernières années, il se pourrait bien qu'il m'arrive plus vite que je ne pense d'en payer le prix fort. Je n'attends que ça.
Samedi 30 août 2003
Penser. I
Mon nouvel ami Laurent m'a envoyé hier cette citation de Bertrand Russel : "
Many people would sooner die than think. In fact they do.
" Traduction : "
Beaucoup préfèreraient mourir que penser. En fait, c'est ce qu'il font
Voilà une pensée qui fait penser, et qui mérite aussi qu'on la pense. Voyez-vous, la pensée c'est quelque chose qui nous traverse, elle n'attend pas la volonté de penser, elle n'attend pas notre feu vert pour se manifester quelque part dans notre conscience. Cette pensée-là, que j'ai rencontrée après de longues méditations des lectures de Martin Heidegger, a pour moi le poids de la vérité, d'une réalité enfin rencontrée après de longs errements sur ce qu'était cette activité tantôt passive, tantôt active, du moins dans sa manifestation. Ce statut de notre esprit par rapport à la pensée, vue en somme comme maîtresse de la situation psychique, a un petit air mystique, voire théologique. Il ne nous empêche pas en revanche d'imiter le procédé de la pensée elle-même sur la pensée. Je m'explique : moi aussi je peux décider de traverser une pensée de part en part, découper dans l'univers des idées telle pièce, telle partie qui se risque dans une position isolée et que ma " pensée " va traverser, exténuer, tâcher en quelque sorte de prendre à son propre piège, ou plutôt de la faire revenir presque de force à son origine, à ce point de départ qui en principe nous échappe. Le là d'où elle vient. Je " pense " d'ailleurs que cet exercice est l'essence même du travail philosophique.
C'est ce que je vais donc tenter de faire avec la pensée de Russel, qui nous est familière à nous autres philosophes, non pas parce que nous avons lu Russel, mais parce cette idée, cette pensée est au fond extrêmement banale, c'est un lieu commun de comptoir. Rien de plus commun que la répugnance de l'homme pour toutes les tâches que requiert la pensée, ou le penser. L'homme a toujours marqué une préférence très prononcée pour l'habitude, attitude ou comportement qui peut se définir comme une sorte de contraire du penser : là où règne l'habitude, la pensée n'a plus cours, même s'il y a dû y avoir, à un certain moment, mobilisation de la pensée pour construire une habitude. Dans sa Dissertation sur l'Habitude, Félix Ravaisson écrit, écoutez comme c'est beau : -"
En descendant par degrés des plus claires régions de la conscience, l'habitude en porte avec elle la lumière dans les profondeurs et la sombre nuit de la nature
"
1
- Et de conclure vers la fin : - "
L'habitude est donc renfermée dans la région de la contrariété et du mouvement. Elle reste au-dessous de l'activité pure, de l'aperception simple, unité, identité divine de la pensée et de l'être ; et elle a pour limite et fin dernière l'identité imparfaite de l'idéal et du réel, de l'être et de la pensée, dans la spontanéité de la nature
". Si on s'amusait à reprendre les termes de Russel en les mélangeant avec ceux de Ravaisson, nous pourrions écrire que l'homme préfère mourir que de parvenir à l'identité de sa pensée avec l'être, anéantir sa conscience plutôt que d'arriver à l'aperception simple et à l'unité de ce qu'il est avec ce qui est. Pour un métaphysicien chevronné, il y a quelque chose de contradictoire dans tout cela, car qu'est la mort sinon cette identité de la pensée avec l'être, cette identité dont l'imperfection dans la vie en fait précisément le cœur ou l'essence de la souffrance ?
Mais revenons sur terre. Pourquoi l'homme répugne-t-il tant à l'action de penser ? Cette répugnance a été et demeure tellement flagrante dans notre vie de tous les jours, qu'il semble tout naturel que les individus qui acceptent de consacrer quelques années de plus à penser, du moins à des activités intellectuelles plus longues que les autres, finissent par bénéficier de privilèges que personne ne remet en question. Un médecin de ville gagne parfois plusieurs dizaines de Smig, mais personne n'y voit à redire : il a pensé tellement plus et tellement plus longtemps que moi, pauvre smicard qui n'a pas dépassé le Brevet d'Etudes Secondaires ! Tant pis pour moi. Premier obstacle donc, l'effort, un effort particulier qui porte sur la mobilisation de l'esprit et de la mémoire, toutes choses que la majorité, selon Russel, préfère laisser reposer et ne pas activer. Et donc de préférer une sorte de " mort sociale ", un statut inférieur qui contient de par son infériorité que rien ne peut dissimuler, quelque chose de morbide, oui, une sorte de mort-vivante. Les crises sociales peuvent se décrire comme le moment d'un sursaut, où le conditionnement accepté, les œillères qu'on a préférées à l'horizon de la vérité, où l'humiliation consécutive à l'ignorance atteignent une masse critique. Dans ces moments-là apparaissent les enjeux de l'ignorance, une ignorance soigneusement entretenue par les pouvoirs qui ont tout à y gagner. Marx a passé sa vie à écrire à l'intention des " pauvres d'esprits ", afin de leur donner un outil de référence pour mettre un ordre dans le flot de ce qui se pense malgré les efforts déployés pour ne pas penser. Il voyait aussi dans l'étude un travail qualifié non rémunéré, et donc un investissement pour l'avenir, pratiquement un risque capitalistique qui méritait, le moment venu de son application, un salaire supérieur aux autres. Dans la quantité de travail social incorporé dans une valeur d'usage, il y avait un temps qualifié de l'ingénieur dont le temps d'étude doit être pris en compte pour en établir la valeur spécifique et donc un salaire naturellement supérieur. Ce sur quoi il faut insister ici, est le fait que celui qui étudie opère un report de jouissance, il capitalise du savoir sans être payé, et souvent même en payant lui-même ses études. Il accepte de prendre le risque de " perdre du temps " sans être rémunéré pendant que les autres échangent déjà leur travail contre un salaire.
Bien entendu, Bertrand Russel ne parle pas directement de ces formes-là du penser. Russel fait allusion à la pensée qui interroge directement le sens de l'existence, pour parler vite. Mais il ne me paraît pas possible de disséquer l'activité intellectuelle, le travail de l'esprit, en plusieurs formes de pensées indépendantes les unes des autres. La pensée scientifique et technique procèdent originellement d'un seul et même penser, elles n'en sont que des formes particulières que l'on peut choisir d'isoler pour des raisons de structuration théorique ou pour des usages techniques. Mais l'usage technique lui-même est aussi une option de la pensée, et elle l'est à un tel point que contrairement à ce que l'on pense généralement, ce n'est pas la technique qui dépend de la science, mais c'est la technique qui requiert le développement de la science, c'est le choix métaphysique d'exploiter techniquement la nature qui mobilise l'usage et le développement de la science. Cette exploitation de la nature est, en réalité, le mode choisi par les Grecs pour dévoiler l'Être, pour " en rendre raison ", ce qui renvoie à des années lumières de l'idée triviale d'une technique au service du " confort " et de l'allongement sans fin de la vie humaine. C'est pourquoi il n'y a pas trente-six pensées, il n'y a pas telle pensée à côté d'une autre dont l'essence serait entièrement différente, comme par exemple la pensée d'un professeur de philosophie et celle d'un ingénieur : en réalité ces deux modes du penser n'en font qu'un seul. Dans les débuts de la rationalisation de l'enseignement, en gros à l'époque de Napoléon, il allait de soi qu'on ne pouvait former d'ingénieur sans au préalable les initier à la philosophie. L'élite de l'élite encore de mon temps, dans les années quarante et cinquante, étaient les élèves les plus brillants qui non seulement étudiaient à fond le Latin, le Grec et la philosophie, mais tout autant les sciences les plus diverses. Le citoyen complet, celui qui par la suite pourrait être chargé des plus grandes responsabilités par rapport à la collectivité était un homme complet, dont la culture ne souffrait aucune lacune et pour qui la devise célèbre : " Science sans conscience n'est que ruine de l'esprit " avait tout son sens. Etait le sens même de leur statut élitaire. Or, c'est dans notre présent que cette exigence de l'harmonie des savoirs se fait sentir le plus gravement et le plus essentiellement. Du maniement de l'atome à celui du génome, les savants portent désormais une responsabilité telle qu'ils n'en ont jamais portée dans l'Histoire humaine. Comme le rappelle Heidegger dans sa conférence sur la Technique
2
, il y a une différence absolue entre l'énergie provoquée par la fission nucléaire et celle qui fait tourner les ailes des moulins à vent. Comme le charbon ou le pétrole, la première est accumulée, tandis que le vent va et vient donnant ce qu'il veut à son rythme, celui de la nature. Or l'accumulation est le lieu du danger, il suffit de songer au processus qui conduit de la pechblende, le minerais d'uranium, au plutonium, dont le seul nom fait frémir ceux qui en comprennent la signification technique.
Reste une question simple : peut-on ne pas penser ? Dans mon Quizz, je pose cette question dont toutes les réponses collectées à l'heure qu'il est, sauf une, ont été oui. La pensée la plus profonde de Parménide, et sans doute la pensée la plus essentielle de tout le questionnement métaphysique qui nous soit parvenu à travers les millénaires disait ceci :
être et penser sont le même.
D'où il faut conclure que l'existence n'est pas seulement le fait pour n'importe quoi d'être-là. On ne peut pas dire de la pierre, de l'arbre ou du fleuve qu' ils existent seulement parce qu'ils sont là sous nos yeux.. Non. L'existence est l'essence de la position humaine dans cet ensemble de phénomènes précisément parce que son être est inséparable de la pensée. Ex-sister, signifie pour simplifier, être en-dehors, à côté, et cet en-dehors est celui de la conscience qu'interroge inlassablement la réalité qui l'entoure, et qui, de ce fait la provoque à son tour au questionnement de cette réalité. Dans l'imaginaire collectif, la science et la technique ont pour tâche de transformer la nature en domicile particulier pour l'homme, c'est à dire à assumer une eschatologie historique, un salut nommé Progrès. Roger Bacon, moine anglo-saxon du douzième siècle, avait le premier lancé cette idée selon laquelle le travail de la science expérimentale avait pour objet de " réparer " les dégâts causés par la chute originelle. Le Salut de l'homme pourrait passer par la science, c'est à dire par une connaissance de plus en plus absolue de la création divine. Et à cette fin il fallait envisager d'entrer jusque dans le dessein de Dieu, c'est à dire de se mettre à sa place, de prendre sa place. Depuis le Cogito c'est chose faite, même s'il fallut encore attendre la sentence de Nietzsche sur le destin fatal de la divinité pour prendre conscience de notre définitive solitude de maître de la nature.
L'idée que l'on puisse ne pas penser est une imposture. N'en témoigne que le flot d'idées plus ou moins confuses qui ne cesse de traverser notre conscience. La raison en est simple : penser c'est être-là, précisément devant l'Autre, face à du non-moi et cette position ne cesse à aucun moment de faire problème. Le créationnisme monothéiste a tenté une opération habile en soi, qui consistait à condenser toute l'altérité en une entité transcendante, c'est à dire hors de toute atteinte : Dieu (et sa Création) prenait en lui tout le questionnement des consciences, formulait une réponse globale sous la forme d'un non-recevoir piloté par les théologiens. Pour me servir d'une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, la transcendance est comme une coupure électrique qui met la source de l'énergie hors de notre portée et nous en protège. L'altérité est ainsi neutralisée et chaque question qu'elle ne cesse pourtant de soulever, est comptabilisée dans la transcendance et ainsi renvoyée dans une réponse ou une non-réponse globale. Il suffit de croire. Croire est le seul moyen de ne pas penser, il n'y en a pas d'autre si l'on passe sur les moyens habituels de s'oublier soi-même, d'affaiblir par l'autodestruction notre lucidité. La place qu'a pris le vin dans la liturgie romaine catholique ne témoigne que d'une seule chose, c'est que les inventeurs du catholicisme, les " Pères " de l'Eglise, acceptaient d'avance l'idée d'un Chrétien ivrogne. L'ouvrage qui valut à Sebastian Franck, réformateur hérétique de l'époque de Luther, la méfiance et la haine de ses pairs portait sur la Trunkenheit, l'ivrognerie. Sa première expérience de pasteur d'un petit village lui avait démontré que la Réforme n'avait rien changé dans les mœurs déplorables de ses semblables. Peut-être ignorait-il que le premier ivrogne de son Eglise était Luther lui-même.
Mais je n'ai toujours pas répondu à cette question essentielle : pourquoi peut-on en arriver à préférer la mort à la pensée ? Ce n'est pas une question académique car elle répond indirectement à la question de savoir pourquoi les hommes font la guerre. La guerre n'est pas la mort lente des ivrognes ni le faux-fuyant du croyant, elle seule offre l'occasion d'en finir pour de bon avec l'être-là, tout en conservant au-delà de la mort, une forme d'existence honorifique, de jouer avec l'oubli en restant le plus longtemps possible présent dans la mémoire des autres, de ces autres qui sont tout le problème. Au fond, tuer et mourir à la guerre est une manière forte d'annoncer une fin de non-recevoir à la vie, fin de non-recevoir qui peut devenir toute une culture comme nous le montre l'histoire des hommes depuis qu'ils ont eu la curieuse idée d'en enregistrer les épisodes sous la forme de l'Histoire. Pourtant, cette culture de guerre qui réglait proprement la destinée de chacun, a trouvé son impasse dans sa propre extension à la possibilité de l'anéantissement complet de l'humanité. Depuis Hiroshima et Nagasaki, c'est la transcendance toute entière qui est en jeu, le sort de la création de Dieu elle-même. Russel pensait à cette mort-là et nous y pensons tous sous la forme de fantasmes spectaculaires qui hantent les salles de cinéma et les écrans de télévision. Nous y pensons aussi dans les termes de la science de l'environnement qui nous menacent d'un événement transcendant dont la responsabilité nous incomberait cette-fois entièrement. Nous avons remplacé l'inconnu qui avait tout créé, nous avons pris sa place, mais non comme le pensait Bacon pour reconstruire le Paradis, mais pour assouvir notre refus de penser. Russel avait raison de penser que pour la majorité la mort était préférable à la pensée, et nous voici parvenus au seuil du risque majeur de voir cette préférence triompher définitivement.
Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Relisez le texte qui précède, il raconte en fait ce que Heidegger entend par l'oubli de l'Être. En modifiant totalement notre mode d'habiter ce monde, c'est à dire en créant cette super-Alliance qu'a été l'invention de l'homme et de la Cité, nous avons aussi décidé de nous approprier le tout, fasciné par le modèle d'un dieu unique maître du destin, et qui répondait à toutes les questions de la pensée qui nous traverse sans nous demander notre avis. Nous voici donc maître de notre destin, non seulement maître et possesseur de la Nature, mais propriétaire de forces qui dépassent la Nature qui a vu naître notre espèce. Mais ce faisant, nous n'avons fait que faire reculer les frontières de ce qui ne cesse de nous interroger, nous avons confondu la connaissance de l'objet avec la connaissance de l'être. Question : en interrogeant sans cesse l'objet, nous avons bien fini par découvrir ce que nos yeux ne pouvaient voir, et produire des énergies qui n'existent pas dans la nature. Mais avons-nous progressé de même dans la connaissance de l'homme et dans la production de nouvelles valeurs ? On ne peut pas nier que le siècle des Lumières ait produit la Déclaration des Droits de l'Homme. Même les Grecs n'avaient pas été aussi généreux avec l'être humain en tant que tel. On doit aussi reconnaître qu'au lendemain de la guerre la plus dévastatrice que les hommes aient menée, ils aient confirmé en l'élargissant et en la perfectionnant cette Déclaration devenue celle de l'Organisation des Nations Unies. On connaît le nombre incalculable de clauses restrictives qui en définitive conservent aux états de nombreux pouvoirs antinomiques avec les principes de la Charte. Mais l'esprit de cette Charte a reçu pour la première fois une base juridique à partir de laquelle il est devenu possible de poursuivre la lutte pour la paix, la justice et la dignité humaine. Je n'en veux pour preuve que la création du Tribunal Pénal International chargé de juger les crimes contre l'humanité ainsi que l'influence de plus en plus importante d'organisations comme Amnesty International.
(à suivre)
1 Félix Ravaisson, De l'Habitude, Edition Vrin, Paris, 1988, réédition d'un article paru en 1894 dans la Revue de Métaphysique et de Morale.
2 Martin Heidegger, Essais et Conférences, nrf, Gallimard, 1976, " La Question de la Technique ", page 9 et sq.
Lundi 1er septembre 2003
Penser. Fin.
Reprenons la pensée de la pensée par un autre angle afin de mieux comprendre l'affirmation de Bertrand Russel sur la préférence humaine pour la mort plutôt que la pensée. Nous avons d'abord constaté que penser ne dépendait pas de nous : nous pensons en permanence que nous le voulions ou non. C'est ce qu'on appelle autrement encore le flot d'idéation. Les désordres de cette idéation sont diagnostiqués par la médecine psychiatrique comme des pathologies qui peuvent aller de l'angoisse au délire. Autrement dit la pensée est une fonction du corps tout à fait comparable à d'autres fonctions comme la sudation ou le transit : la pensée évacue quelque chose qui pénètre par des ouvertures communément conçues comme la perception, la sensibilité ou l'affection, ou encore l'imagination. Mais ces catégories sont toutes suspectes car elles appartiennent à des taxinomies, à des classifications artificielles pour la plupart issues de la scolastique. Ce ne sont que des mots qui recouvrent approximativement à la fois des états de conscience et à la fois des systèmes de représentation de la psyché. La psyché elle-même étant un concept qui désigne tout ce qui se présente en nous comme vie immatérielle, même si certaines manifestations comme l'émotion ou la peur peuvent provoquer des effets physiologiques comme on le sait. Comme il y a un équilibre des fonctions physiologiques, produisant des effets considérés comme normaux, on peut donc penser qu'il existe aussi un équilibre des fonctions psychiques ayant pour conséquence une normalité reconnue par tous comme telle. Les excès de l'une ou l'autre fonction, ou leur prédominance sur le tout de la vie psychique, sont communément considérées comme des névroses ou des psychoses, selon leur degré de gravité, c'est à dire la grandeur de l'écart entre le comportement de l'individu malade et le comportement normal, statistiquement constatable.
Se pose à présent un nouveau problème, ou une nouvelle donnée de l'analyse qu'on ne saurait évacuer de notre recherche sans commettre une faute grave. Nous avons précédemment décrit les états psychiques comme étant les conséquences d'apports extérieurs en les comparant même aux éléments que nous ingérons habituellement pour entretenir notre corps et dont nous rejetons les parties non assimilées. Or pour la pensée les choses ne sont pas aussi simples car dans les apports extérieurs figurent le langage et la pensée des autres la plupart du temps systématisées et devenues de surcroît des critères de normalité. Le Christianisme a distillé pendant des millénaires une façon de penser dont le refus impliquait nécessairement une anormalité non seulement diagnostiquée comme telle, mais punie selon une gamme de châtiments dont la mort faisait couramment partie. On ne pense donc pas seulement ce que le monde vous donne spontanément de lui-même, comme si nous vivions seul au milieu de la nature, mais on pense avec les mots et les pensées des autres, et la plupart du temps contre ces apports dont la logique n'est pas évidente et ne correspond que de manière caricaturale avec la logique propre à chacun, avec la singularité de sa pensée. Ainsi je peux me souvenir assez clairement de ce philosophème de base que nous enseignent en tout premier les prêtres chargés de catéchiser les enfants, c'est à dire les infanses, ceux qui ne savent pas parler. Cette vérité de base claironnait à travers la classe la relation " évidente " entre la beauté de la nature et le fait de sa création par un être parfait. Il était logiquement impossible d'attribuer la perfection des choses et des êtres au hasard ou, mais à l'époque on ne prononçait pas encore ce mot même s'il était déjà couramment enseigné dans l'université, à l'évolution. Faut-il ajouter que cette éducation est déjà un enseignement, c'est à dire la pose d'une marque, une impression dans le livre encore vierge de l'esprit de l'enfant. Et cette marque, que je comparerais volontiers avec les marques au fer rouge qu'on applique sur les jeunes animaux d'un troupeau pour attester de leur appartenance, est un geste accompli par l'adulte, par le maître, par la puissance temporelle qui domine de toutes ses hauteurs l'infirmité initiale du petit de l'homme. De quelles ressources dispose cet enfant face à la Parole qui lui est ainsi assénée ? Elle ne lui est d'ailleurs pas réellement assénée, elle lui est offerte sous le masque de l'amour, sentiment qui est le milieu naturel du petit de l'homme. Pourquoi s'y refuserait-il ? Pour quelle raison refuserait-il ce don amical ?
Pardon pour mon retour sur scène, mais j'avais bien précisé au début que je me refuse à théoriser au nom des autres. Je ne parle que de ce que je sais, ou crois savoir, nuance que je veux bien admettre. Lors donc que le premier de ces prêtres me livra cette sorte d'axiome, je fus saisi par la légèreté de l'argument et lui demandait de qui il tenait pareille vérité. Sa réponse tourna autour de l'évidence de la perfection des choses et de l'impossibilité pour quelque hasard que ce soit de parvenir à un tel résultat. Mais devant ma résistance, fondée que la présence du mal, il dût en venir à l'aveu de la révélation, aggravant ainsi son cas car il me parlait magie quand je lui parlais (déjà) raison. J'avais sans doute, par rapport à mes petits camarades une bonne raison de me méfier ainsi de ce discours, car je venais d'assister au suicide de mon père, et j'étais donc loin de pouvoir participer à l'enthousiasme général que devait susciter la réalité ambiante. Le mal avait frappé sous mes yeux et la perfection dont on me rabattait les oreilles n'avait guère de sens, même s'il est vrai aussi que la poésie et la beauté de la nature ne me laissait pas indifférent. Je tente d'expliquer ainsi ma réaction qui fut bien solitaire au milieu de mes camarades, et de montrer comment cette différence de traitement de ma sensibilité et de mes affects avec le leur me mettait hors jeu, me renvoyait dans un isolement pensif dont je ne sortirai jamais. Pourtant, la force de ma jeunesse aidant, et l'oubli habilement géré par mon entourage de la figure ou de l'absence de la figure du père, fit que je tombais finalement dans leurs filets discursifs et absorbai leur pensée et le système qui la sous-tendait. Il fallut attendre, mon anamnèse douloureuse de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, pour que toutes ces marques pédagogiques, tout ce conditionnement sur lequel je reviendrai, se dissolvent d'un coup, me laissant sans dieu et sans prêtres, et du coup sans société.
Car c'est cela le conditionnement de la pensée, la mise en condition de recevoir le monde sans faire appel à une pensée singulière, à ma propre force de répondre aux messages du monde : ils avaient pensé le monde pour moi et peut-être sans cet accident tragique qui marqua plus profondément que tout mon âme, serais-je mort de cette mort latente qu'est la croyance. Je ne sais pas, mais quand je compulse ici et là les biographies de ceux qui ont refusé de recevoir le message chrétien tel quel, je découvre toujours un hiatus originel, un moment de la vie de ces hommes où se manifesta une contradiction flagrante entre le discours ambiant et la réalité de leur existence. Voyez même Saint-Augustin, Rancé ou même la plupart, je dis bien la plupart des grands Saints de l'Eglise, le début de leurs existences de privilégiés avaient tous été marqués par la débauche naturelle des nantis. Tous des Madame Pernelle, avertis à temps par la dyspepsie et les maux afférents aux excès en tout genre. Ma belle-mère me disait toujours que les grands débauchés faisaient les bons anachorètes, paroles que je n'ai jamais oubliées même si elles m'étaient adressées directement. Et puis, il est peut-être vrai que je sois devenu une sorte d'anachorète, mais encore plus seul alors que le derniers des ermites, seul car sans dieu pour me sauver de ma mort à venir.
Penser selon la parole de Russel, ce n'est donc pas seulement laisser agir l'idéation naturelle qui nous traverse de manière réactive aux événements du monde dans lesquels nous sommes pris. Penser c'est aussi et d'abord s'opposer au
déjà pensé
, reprendre sur soi le travail depuis le tout commencement, commencement qui n'est pas facile à trouver car le temps passe vite, et les discours se succèdent auxquels il faut se mesurer et ainsi trouver sa propre mesure des choses, le legs que notre propre ontogenèse finit par déposer en nous comme la mesure singulière de toute chose, mesure que nous avons désormais à défendre, à défendre contre les autres mais aussi contre nous-mêmes. La conscience de soi n'accepte pas la finitude d'un discours clos. En témoignent les travaux de Kant bien au-delà de ses trois Critiques et qui en remettent bien des aspects en question, et de bien des grands penseurs qui ont refusé de s'installer dans leurs découvertes comme le fit un Hegel, parvenu aux honneurs les plus élevés et aux certitudes éternelles. L'une des grandeurs de Nietzsche aura été le refus de s'installer dans un système, alors même qu'il en rêvait jour et nuit. Point de système, point de doctrine. La solitude du doute jusqu'au bout, quand bien même l'extase viendrait récompenser comme un miracle la souffrance du penser vrai. Qu'est-ce que l'extase ? Au plus trivial on pourrait répondre que les drogues conduisent à des états extatiques, c'est à dire à une euphorie parfaite qui harmonise le soi avec l'autre, le moi avec le monde. Et ce n'est pas faux. Le chamanisme a toujours fait appel aux drogues pour augmenter l'intimité que l'on peut atteindre avec tout ce qui vous entoure. Mais la pensée n'a pas intrinsèquement besoin de drogue pour atteindre une telle intimité, elle se suffit à elle-même tant il est vrai qu'être et penser sont une seule et même chose.
Lucrèce n'a pas de métaphores assez dramatiques pour décrire l'arrivée sur terre, la naissance d'un nouvel être, d'un enfant innocent et dont le premier témoignage de ses sentiments est un cri de détresse. Et pourtant, parvenus à l'âge adulte, nous cultivons tous une nostalgie puissante pour notre enfance. Elle devient, au fil des ans, le modèle de ce que nous avons perdu, un position extatique spontanée tellement forte qu'elle transcende les pires circonstances de la vie. Et pourtant, la philosophie et la psychologie méprisent en général l'état d'enfance, le décrivant comme l'âge de l'absence de langage et donc d'ignorance absolue, de vide spirituel. L'Eglise elle-même ne reconnaît pas l'humain dans le nouveau-né tant qu'il n'a pas été marqué par le premier sceau de son appartenance au troupeau des fidèles, le baptême. Dans son Discours de la Méthode, Descartes lui-même n'a pas de mots assez durs pour stigmatiser la faiblesse intellectuelle des enfants qui reçoivent n'importe quelle éducation de manière totalement passive et insiste sur la longue attente qu'il a dû subir avant de prendre en main sa propre pensée. Or ce raisonnement est fallacieux, car l'enfant n'a aucune relation dialectique avec le discours dont on l'abreuve, ou alors, comme je l'ai montré dans mon exemple personnel, il entre dans un débat qu'on attend pas de sa part, parce que la fable des éducateurs comporte une faille dans son existence elle-même. Pour revenir à mes souvenirs, je peux affirmer le plus sincèrement du monde que la mort de mon père marqua une fêlure profonde dans l'extase qui faisait alors le fond de mon existence. Entre-temps, ma mère avait pris en main mon éducation et l'avait dirigée vers cette facilité de l'être-là chrétien. Malgré les souffrances que m'infligeait le gouffre que je voyais grandir entre les pulsions de mon instinct et le salut que l'église a su revêtir si habilement de la beauté de l'art, je parvins à nouveau à l'extase ce jour où en pleine adolescence je fus reçu comme communiant à part entière. Oui, le jour de ce que nous appelions la " Grande Communion ", j'ai vécu une transe mystique, j'avais intégré jusqu'au fond de mon âme le discours eschatologique et l'espoir du salut éternel. J'aurais fait un bon chrétien si du fond de mon inconscient n'avait surgi à peine quelques mois plus part l'image de mon père pendu à une poutrelle de notre cave par un fil de fer. Or les circonstances dans lesquelles je fis cette anamnèse tragique n'étaient pas innocentes, car dans le Collège de Jésuites où ma mère avait cru bon de me faire poursuivre mes études, sans doute dans avec le désir secret de me voir entrer en religion, je fus confronté avec ce qui fit la haine de Pascal pour les Jésuites, avec l'hypocrisie d'une congrégation dont les objectifs n'avaient rien de mystique. Ils me manquèrent de respect dès le premier jour, ils manquèrent de respect pour l'étranger que j'étais dans ce milieu de jeunes aristocrates destinés à devenir l'élite du pays. Il détruisirent ainsi mon illusion qui perdit brutalement tout avenir. Cette perte était la perte de mon père et c'est pourquoi je le fis remonter cette nuit-là de mon inconscient où l'on avait enterré le mensonge des circonstances de sa disparition.
J'ai bien conscience d'une certaine fatuité de ce récit récurrent, mais il me semble important à qui sait le lire et en comprendre la logique. A quinze ans j'avais traversé deux époques extatiques, celle de ma petite enfance qui, aujourd'hui encore, forme le fond de mon désir de continuer à exister, et puis ce succédané de bonheur spirituel que fut la foi. Ce qui se passa après dans mon âme s'appelle la déréliction. Plus rien, plus rien que la soif de comprendre tout en assumant sans limites mes instincts de jeune homme débordant de colère et de déception. Mais je ne m'étends une fois de plus sur les contenus intimes de ma mémoire que pour rendre compte de ce que peut être l'extase. L'extase pure de l'identité naturelle du nouveau-né, dont les Juifs affirment qu'il possède au moment de sa naissance la totalité de la connaissance, l'identité avec l'être. Et puis l'extase que procure la crédulité magnifiée par les rites solennels et la tromperie de l'art, car l'Eglise catholique en particulier a su prendre le monopole du beau effectif, pour ainsi dire branché sur l'ontologie. Comment résister à toute cette mise en scène qui vient combler pour la plupart un quotidien sinistre et blême. Architecture, peinture, musique et même rhétorique, tout est condensé pour charmer, séduire et bien manifester toute la différence entre cette anti-chambre de la vie éternelle et le sordide parcours de la vie réelle. Encore et toujours j'interroge ce mystère de l'érection des cathédrales au milieu du fumier des villes médiévales. La seule réponse que j'ai trouvée, est que cette épopée, dont le commencement n'est autre que l'érection des temples de l'Antiquité, est un geste de brigandage ontologique : les maîtres des sociétés à peine nées, les maîtres des essences du vrai et du faux n'avaient pas le choix, ils devaient matérialiser le centre du réel, en somme réunir dans le temple toute la beauté de ce qu'ils rejetaient en créant la cité et en abandonnant l'intimité que la vie nomade implique avec la beauté naturelle. Dans les temples et les cathédrales se trouve la représentation de ce que les hommes ont résumé de ce qu'ils abandonnaient en se regroupant en société. D'où le sentiment du merveilleux, d'où l'enchantement qui saisit celui qui franchit la porte de ces constructions chargées de contenir les seules choses réellement réelles, comme Dieu est, dans la théologie la seule véritable réalité.
Mais ce n'est pas fini. L'extase n'est ni le privilège de l'enfance, ni celui d'une crédulité qui peut bien devenir cette chose grandiloquente qui se nomme la Foi. Crédulité ou pathologie, car mon propre parcours peut se retrouver dans beaucoup d'autres, comme je l'ai déjà signalé, ceux entre autres de Thérèse d'Avila ou de Saint Jean de la Croix voire les conversions tardives de St François, jeune débauché repenti. L'extase connaît d'autres sources, ou pour mieux m'exprimer, l'homme peut atteindre l'extase par un autre moyen, et ce moyen n'est pas celui qui aboutit au satori, ce court-circuit de la conscience, mais tout simplement la pensée elle-même. A ce point j'hésite, car la pensée est devenue sous la domination toute puissante de l'hégélianisme, le chemin de croix du concept. Au fond le Savoir Absolu de sa Phénoménologie de l'Esprit, qu'est-ce sinon l'extase ? Sinon la boucle qui se referme, sans se refermer tout à fait faute d'interrompre l'auto-production de l'Être par l'Histoire ? Alors est-ce par le travail du concept ou bien par le rejet du concept, comme l'enseignait Maître Eckart, par l'acceptation de la Docte Ignorance ou par le retour herméneutique aux origines mêmes des concepts, comme l'enseigne Heidegger ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai connu une autre extase, radicale et pour ainsi dire infinie.
On se représente toujours l'extase comme un état de conscience passager, comme un climax de son être-là qui finit toujours par se dissiper et vous renvoyer dans votre déréliction essentielle, dans votre état d'abandon et de solitude
mortelle
1. Mais je ne vois plus les choses ainsi. L'extase est un événement fondateur d'une relation nouvelle entre la conscience et ses objets. Qui a connu l'extase est devenu un autre homme, il est rentré dans cette intimité dont je parlais plus haut, il est entré dans une sorte de fraternité avec l'Être que rien ne peut plus rompre. Car l'Être lui est apparu dans sa nudité et dans sa simplicité. Il n'y a là aucun miracle, il n'y a là aucune rencontre mystique entre une conscience et un Être suprême où un personnage magique, il y a seulement la découverte fulgurante d'une identité de l'homme, de l'homme qui pense et de l'être qui est pensée. Et cela ne change rien à la vie elle-même, l'extase n'est pas une lampe d'Aladin qui vous ouvre à l'immunité ou au privilège de ne plus endurer la facticité du temps et du destin. Tout continue comme avant, c'est d'ailleurs étrange comme sensation, car c'est comme si votre vie se déroulait sur deux plans distincts. Vous savez et vous ne savez pas, vous pouvez tout et vous ne pouvez pas plus qu'avant. Il y a quelque chose dans cette situation qui ressemble à la position de Dieu face au destin : il n'y peut rien. Allez donc passer du bon temps à lire la théodicée de Leibniz et vous serez fasciné par la tranquillité d'âme et l'humour avec lequel le philosophe, dont la gloire fut si grande et qui finit si misérablement, traite de ce problème. Au fond, Dieu est dans la position extatique, il a choisi la meilleure des combinaisons possibles de bien et de mal en créant ce monde-ci plutôt qu'un autre, et maintenant il assiste à son déroulement, mais il ne peut plus rien y changer. Leibniz a connu l'extase, c'est évident, il est passé de l'autre côté du mur de la réalité et il a pu visiter les coulisses. En visiteur pensif.
Et après ? Après, il ne reste qu'une seule chose à faire, il n'y a plus qu'une mission qui vous incombe par quelque moyen que ce soit, en parler. En parler par la théorie, l'art et la poésie, d'autres actions que détermine la chose qui vous a été révélée en même temps, le fait que l'extase est à la portée de tous, à la portée d'autrui, en parler. Cette extase devient le sujet patent ou latent de toute parole et cette parole doit d'abord servir à protéger la vie qui fait le don de cette réconciliation. Oui, l'extase est une réconciliation totale, elle vous dispense de l'analyse et de la compréhension parce qu'elle est l'ultime compréhension. Cette compréhension est l'amitié qui vous unit désormais à la réalité, quelle qu'elle soit, elle est le sujet le plus riche pour l'écriture, elle vous ouvre les portes à des savoirs que l'Être vous glisse par-dessous la table avec un clin d'œil, à la voyance du présent, simple répétition de ce qui a toujours été et qui toujours sera. Oui, c'est vrai, c'est un cadeau magnifique, mais il vous laisse impuissant à en user, comme Dieu face à sa création.
1
C'est bien pourquoi les extases religieuses sont de fausses extases, car elles s'appuient sur un Être substantivé, une personne nommée Dieu et qui transcende le monde et sa fausse réalité.
Mardi 2 septembre 2003
Temps et mémoire.
France-Culture a rouvert son robinet ce matin après un silence qui en dit long sur l'inscription de cette antenne dans le rituel social, pas plus capable de rompre sa routine en fonction de ce qui advient dans le monde que le gouvernement lui-même. J'avais accusé le gouvernement de laisser mourir nos vieux par négligence, pire, par sentiment de la légitimité rituelle de la vacance du pays pendant ces deux mois de l'été. C'est exactement ce qu'on définit par sclérose. La France est un beau pays plein de bonnes intentions et qui résiste tant bien que mal à l'esprit pragmatique anglo-saxon, mais c'est un pays sclérosé, comme paralysé par son calendrier et impuissant à se mobiliser en-dehors de la routine prévue des événements répertoriés dans le calendrier lui-même. Les incendies se passent en été, donc les forces qui doivent combattre le feu travaillent en saisonnières, c'est marqué dans le plan, sur le calendrier, et s'il y a des bavures ou des échecs, ils sont toujours à mettre au chapitre des insuffisances chroniques ou accidentelles des budgets. Notre cher Bennassayag que nous aimons tous, dernière petite mouche du coche qu'on tolère en souvenir d'une radio combattante, m'a fait rire jaune ce matin en demandant avec une imperceptible ironie que s'il fallait tout mettre en œuvre pour conserver les productions d'un média, ce devait être celles de France-Culture. Rires.
Le sujet était la mémoire collective à propos de laquelle le directeur de l'INA venait apporter le terrible témoignage d'une décomposition accélérée de tous les documents audio et vidéo stockés dans son institut, chargé comme on le sait de gérer cette mémoire collective. Il faut savoir que tous les médias sont contraints pas la loi de transférer leurs bandes à l'INA dans un délais, je crois, de quatre ans. Pendant ces quatre ans le média peut diffuser et rediffuser librement ses émissions, reportages et enregistrements divers. Par la suite ce trésor va à l'INA et devient une marchandise payante, ce qu'on a pudiquement tu ce matin. Cela signifie que le média qui a produit un documentaire devra y aller de sa poche s'il veut le rediffuser plus de quatre ans plus tard. Je ne vous parle pas des tarifs qui empêchent concrètement les médias de se servir de documents anciens, comme par exemple les images des deux grandes guerres. Il est vrai que celles-ci, pour la plupart, sont stockées par l'armée elle-même, qui pratique des prix exorbitants, en fait dissuasifs. Pour avoir souvent négocié des images d'archives avec le SIRPA, le service de l'armée qui s'occupe de ces choses, je peux vous assurer que nous ne sommes pas prêts de voir des films entiers sur la bataille de Verdun pourtant filmée en 35mm de très grande qualité (des deux côtés du front, en Allemagne les archives se trouvent à Mayence) du début à la fin. Ainsi la vérité de l'histoire gît quelque part dans d'immenses caves climatisées, mais personne, hormis quelques privilégiés du sérail, n'y aura accès avant quelques dizaines d'années, lorsque les ondes de la causalité politique auront disparu comme un électrocardiogramme plat. Encore, je me demande s'il se trouvera un jour un état assez courageux pour étaler en public ce qu'un
état
a été et est donc capable de faire.
Mais ce n'est pas le sujet proprement dit. Le sujet c'est la mémoire, et je voudrais donner une petite leçon de philosophie à ces messieurs qui me semblent étudier ce sujet d'un œil borgne. De leur point de vue le problème est tout entier dans l'option des décideurs du présent de conserver ou de ne pas conserver les documents qui attestent des événements. On ne sort pas des critiques classiques qui tournent autour de la censure sous toutes ses formes, y compris la destruction des témoignages et la falsification du passé. Le totalitarisme qui se dessine dans nos sociétés " postmodernes " contient en puissance ce danger, déjà palpable dans l'absence de moyens mis à la disposition des agents chargés de conserver ces documents, de voir notre mémoire pour ainsi dire scotchée, bâillonnée. Bref, nous ne laisserons pas de traces, alors que nous pouvons encore consulter aujourd'hui le Code d'Hammourabi, vieux de plusieurs millénaires. Notre époque court le risque de devenir un blanc d'histoire par négligence, plus ou moins volontaire, alors que les moyens de conservation, de leur côté, sont de plus en plus sûrs et de plus en plus pratiques grâce à la miniaturisation.
Le procès n'est pas inutile, j'en suis sûr, mais il ne voit qu'un seul aspect du travail de la mémoire : ce que nos commentateurs de ce matin n'aperçoivent pas, c'est le danger de la disparition de la mémoire elle-même parce que la place de l'homme dans le temps aura changé du tout au tout. Comment un pareille chose peut-elle avoir lieu ? Réponse : par la disparition du présent de chacun. Comment le présent peut-il disparaître, c'est une absurdité ! Non, ce n'est pas une absurdité, c'est même une réalité que des millions d'êtres humains ont vécu d'abord de l'autre côté du Rhin où les gens allemands étaient priés de vivre dans le futur Reich millénaire, de même que dans la Russie stalinienne où la condition inchangée de moujik de goulag n'était que la voie royale vers le petit paradis des peuples. Question : le capitalisme, relayé par nos gouvernements " démocratiques ", procède-t-il autrement ? Quel est l'objet de cette " croissance " dont on nous rabat les oreilles ? Ne vivons nous pas comme des candidats à la vraie vie, au Progrès, au futur quoi ? Le processus frénétique que le capitalisme a lancé pour précariser la vie des gens de partout dans le monde, n'a-t-il pas pour résultat de détruire le présent de chacun ? De quel présent peut jouir un individu plongé définitivement dans les aléas de son employabilité ? Employabilité qui est radicalement condamnée à décliner avec le temps, avec l'âge qui n'attend pas et qui est conditionnée avant tout par la docilité, c'est à dire par l'abandon de toute dignité, le règne de la peur, en réalité le vrai terrorisme. Marx avait pressenti jusqu'où irait le capitalisme, c'est à dire quelles limites il est prêt à franchir pour asseoir son pouvoir au niveau de la planète. Dans les Grundrisse, cet écrit dense où Marx ne mâche pas ses mots il dit ceci : -"
" Si l'économie politique se dilate en une énergie cosmopolite universelle, qui renverse toute barrière et tout bien pour se poser elle-même en lieu et place comme la seule politique, la seule universalité, la seule barrière, le seul bien, elle rejettera nécessairement au cours de sa dilatation son hypocrisie et apparaîtra dans tout son cynisme ".
Pour qu'il y ait un passé, pour que la notion de futur ait un sens, il faut un présent. C'est pourtant simple à comprendre : si votre être ne s'arrête jamais dans aucune présence, étant toujours dans l'attitude de l'attente et de la inquiétude du lendemain, alors sur quoi va s'accrocher sa mémoire ? Quels seront ses souvenirs ? Déjà nos enfants s'oublient eux-mêmes à une vitesse que je ne peux même pas comprendre parce qu'il n'arrive rien dans leur quotidien d'autre que de la consommation à le petite semaine de jouissance médiocre.
Même Jean-Claude Guillebaud pour qui j'ai toujours eu une grande admiration précisément pour ses visions prophétiques sur le sort de la société humaine s'y est trompé. Le problème n'est plus dans le rangement, la classification, l'entretien et l'enregistrement des documents du présent : il n'y a pas, il n'y a plus de présent. Cette vérité est loin d'être neuve, elle figure dans les textes de Debord, de Morin et de Baudrillard qui ont compris depuis longtemps la fumisterie que constitue la futurologie et tout cet affairement autour de l'avenir du monde. Nous sommes bel et bien dans un présent simulé, dans un simulacre de présence d'où nos êtres et la singularité de leurs destins s'est évaporée. On sait depuis longtemps que tous ces discours, y compris celui de ce matin, n'ont pas d'autres finalité que de faire passer ce non-présent auquel nous sommes acculés. Alors je me répète, pas de présent, pas de passé. Descendez un peu de votre piédestal d'intellectuels et fixez vos yeux patiemment sur les émissions de variétés, au lieu de vous retirer dans la culture d'Arte ou de France-Culture qui se complaisent dans les promenades touristiques culturelles et esthétiques d'entomologistes. Ces émissions se construisent aujourd'hui pour la plupart sur le mode de l'anamnèse : on invite quelques vedettes qui constituent la plus grosse partie du budget, on sélectionne des archives qui concernent ou non les invités du jour, et passez muscade ! Mais question : de quoi s'agit-il ici ? D'une émission d'histoire de la variété avec une logique de questionnement sur l'évolution et les changements, les transformations de la société dite " du spectacle " ? Que nenni, il s'agit de pur répétitif, il s'agit de combler l'absence de présent, c'est à dire de la puissance et de la volonté de mettre à la disposition des téléspectateurs un véritable présent de la culture populaire, ce serait bien trop cher, mais simplement de bricoler en présence ce qui n'a toujours été que ce que vous présentez aujourd'hui. Les émissions d'hier étaient déjà de la nostalgie en conserve. Autrement dit, on tourne en rond. Ce cercle vicieux est encore plus patent dans les nouvelles émissions dites de télé-réalité. Les lofts et autres Star Academy nous invitent à participer à cette sorte de dressage à la précarité et nous illustrent épisode après épisode la véritable situation de l'individu privé de présent et entièrement dépendant des facteurs habituels de la précarité. Ces enfants qui se démènent pour arriver au bout du processus de tri ne vivent aucun présent, si ce n'est les petits contrats annexes dont on ne parle pas mais qui leur assurent un petit pourboire pour avoir accepté de jouer le jeu de la victime expiatoire hebdomadaire. Je frissonne en les voyant déjà dans soixante ans, dans leur maison de retraite, contemplant les images usées de leur gloire éphémère et attendant le rien de leur mort. Pauvres enfants, déjà morts. Pauvre Jean-Alain avec ta sensibilité si forte que tu sentais tout ça, et même si forte que personne n'osait te toucher, tu étais trop présent et la présence, mon coco, c'est ce qui prend la lumière sur un plato et c'est ce qui fait de l'Audimat. Tu t'es bien fait baiser, avec peut-être assez de conscience pour donner une illusion de vérité à la haine que tu affichais.
Pour qu'il y ait une mémoire à sauvegarder, il faut nécessairement que cette mémoire ait un contenu, voilà tout le problème. Ce qu'il faut arriver à concevoir, c'est un bouleversement culturel tout à fait comparable à celui qui ouvrit à la pratique de l'histoire et au respect de la mémoire, essence de la pensée. Car c'est de cela qu'il s'agit : on ferme le magasin de la Culture parce qu'on a cessé de tolérer la pensée. L'exemple le plus effroyable dans mon esprit est celui du tourisme culturel. Les tour-opérateurs vous construisent un itinéraire qui semble vous faire voyager dans le temps, celui des Pharaons, des Grecs ou des Romains, et en effet vous allez contempler les pyramides, le Parthénon ou les ruines de l'empire romain. Mais au cours de ces longues promenades sur le Nil ou autour du Péloponnèse, où êtes-vous, vous ? Quelle est votre relation existentielle avec ce que vous contemplez ? Êtes-vous là, au pied des tombeaux des rois parce qu'il y a en vous une question essentielle à laquelle vous cherchez une réponse par rapport à ces tombeaux, êtes-vous vraiment présent dans ce présent-là, ou bien êtes-vous un passant, vaguement curieux de voir des objets que vous ne connaissiez que par la fable ? Vous vouliez voir les objets des contes de fée de votre enfance, mais vous-mêmes, là, devant Chéops, vous n'êtes plus là, vous êtes tout entier dans votre douleur d'un temps oublieux du bonheur de la vraie présence. Voilà en partie ce que j'appelle ailleurs l'usure de l'Être. Notre présent est d'une telle pauvreté qu'il ne nous reste plus qu'à exploiter les gisements du passé, les gisement de ce qui fut de la présence dans l'Histoire et qui fut notre propre présence dans ce monde, présence qui s'évanouit tous les jours un peu plus. Pendant plus de trente ans j'ai lu les " bons " journaux, écouté religieusement France-culture, j'avais même accepté la fatalité de la répétition. Que voulez-vous qu'un média invente de neuf chaque jour, surtout s'il n'est qu'un relais des pouvoirs ? Grâce à mon logiciel de Reuters, je pouvais presque anticiper le conducteur de Jean Lebrun le matin et prévoir l'identité de ses invités. Aujourd'hui c'est encore pire, il ne se passe plus rien du tout sur cette antenne, presque plus rien que des ritournelles archi-entendues et archi-connues : de la répétition de rien. Alors à quoi bon mettre tout cela en boite ? Cela a-t-il un sens de mémoriser du néant ? Dans le temps les rédacteurs en chef demandaient à leurs journalistes de leur " sortir quelque chose ". C'était impératif et cela avait un sens, il fallait trouver du vrai dans le brouillard de la communication, trouver le présent sous sa forme réelle à n'importe quel prix. Aujourd'hui nous avons droit au bulletin d'information, le résumé de ce que fournissent les agences de presse, et puis à des commentaires d'experts. Lorsqu'un scandale éclate, ce n'est jamais la presse qui en est à l'origine, exception faite du Canard Enchaîné, seul hebdomadaire qui " sort " encore quelque chose de temps en temps.
Le mépris des autorités pour la conservation de la mémoire est donc la même chose que leur mépris pour ce qui constitue le présent : il n'y a rien à conserver, et c'est ce que l'on pourrait désigner sous l'expression : disparition de notre civilisation. Ce que Heidegger nommait si justement le " fonctionnement " est cette espèce de portée musicale monotone que nous livre chaque jour ceux qui sont chargés d'en enregistrer la facticité, je ne sais pas comment dire autrement. Exemple : en page deux, vous trouvez une pissette (petit article de quelques lignes) qui rapporte le vol à la tire qui a eu lieu à tel endroit, à telle heure et par tel jeune depuis sous les barreaux. Point. Point barre, comme on dit de nos jours. Où est le présent de toute cette affaire ? Il n'est nulle part, il se joue tout au plus dans le jury qui va hâtivement classer le délit dans une catégorie et sévir en conséquence. Que savons-nous de tout ce qui a fait advenir ce petit délit, devenu fonctionnement policier et judiciaire ? Rien. Le présent de ce jeune voyou n'intéresse personne, ni son avenir, il est une fonction de la machine sociale qui fait partie du bas de la page deux du quotidien. Et puis plus rien. Quel intérêt y-aurait-il à enregistrer un tel témoignage ? Il suffit de se reporter aux statistiques, il suffira dans mille ans de le faire car il n'existera rien d'autre pour en parler, pour dire quelque chose de plus que ce que je viens de décrire. Mais ça, ce n'est pas du présent. L'histoire, notre histoire, cette ridicule et romanesque paperasserie que nous avons entassée et qui nourrit tant de monde aujourd'hui, c'est le processus de dissolution de la présence.
De la présence de l'homme. Mais qui sait encore ce que cela veut dire pour un homme d'être présent ? En prison on ne vous demande pas de répondre " présent " lorsqu'on fait l'appel, parce qu'on sait que " présent " ne veut plus rien dire, alors on vous hurle votre nom et vous répondez par votre prénom : on a plus de respect pour l'être humain dans les geôles que dans la vie courante. C'est que les raisons pour lesquelles vous êtes en prison sont des raisons fortes, des preuves de votre refus de fonctionner, de laisser broyer votre présence par la nécessité des chiffres de la sécurité, de l'équilibre, de la croissance et de la circulation en rond du temps. Circulez, il n'y a rien à voir, vous dit-on, car c'en est fait de l'immobilité d'une présence vraie, alors vous brisez la loi et tout s'arrête au moins pour vous et pour un certain temps vous arrêtez de fonctionner. Et en plus vous gagnez le respect des autres, sous la forme de la peur, peut-être, mais qu'importe puisque c'est devenu le dernier moyen. Alors voilà, cessez de nous bassiner avec votre manie de vouloir mettre cette époque en fiches. Vous avez besoin de fiches pour donner un alibi à vos métiers et à votre existence, car vous ne vous suffisez pas à vous-mêmes, mais ne vous faites pas d'illusion, dans quelques temps, dans un délai plus bref que vous ne pouvez l'imaginer, ces fiches ne vous serviront plus à rien car elles seront vides. Vides comme vos âmes délabrées par l'ennui et l'attente du dernier soupir, du dernier soulagement.
Dimanche 7 septembre 2003
De la Justice à la Croissance, un itinéraire globalisé.
Vous ne connaissez pas Sir Ludovic Kennedy ? Dommage ! Un Sir qui prétend que la justice française vaut mille fois la justice britannique ? Et qui nous apprend au passage que un pour cent des 55000 taulards anglais, soit 550 personnes emprisonnées sont innocentes ? Certitude statistique confirmée par une longue carrière consacrée à l'étude des erreurs judiciaires en Grande Bretagne. Pour les anciens lecteurs d'Antémémoires, cette information n'est pas une nouveauté, mais ce que Sir Ludovic nous a décrit la semaine dernière, dans Hard Talk, cette fois gentiment cornaqué par David Jessel, vaut le détour. Car Sir Ludovic a passé sa vie à tenter de sauver des condamnés de la corde et à la prison et à étudier les défauts de la justice de son pays.
Ma critique de la justice anglo-saxonne reposait jusqu'à présent sur la toute-puissance de la jurisprudence au dépens de la loi. Ce qui est vrai, car les cabinets d'avocats américains passent le plus clair de leur temps, non pas à chercher des preuves de l'innocence de leur client, ou à leur trouver des circonstances atténuantes, mais à trouver des cas semblables, jugés ici ou là, où ont été invoqués avec succès tel amendement ou tel application de la loi, ou encore utilisées ou interdites telles procédures en telles circonstances. Exercice qui se fait dans les deux sens, l'accusation et la défense. Exemple : dans le beau film de Sidney Lumet qui s'appelle Verdict, un juge interdit au plaignant d'utiliser la photocopie d'une preuve dont l'original avait été maquillé par une infirmière sous la contrainte d'un chantage au licenciement. Et ceci parce que l'avocat de la défense exhibe à la dernière seconde un jugement rendu dans un état lointain quelques décennies plus tôt, jurisprudence qui donne au juge le pouvoir de décider de rendre cette photocopie caduque. Or comme celui-ci est corrompu et favorable à la défense, il interdit donc que l'on tienne compte de ce document qui donne entièrement raison au plaignant. Dans le film le jury ne s'y laisse heureusement pas prendre et tout finit bien, mais dans la réalité, cela ne se passe pas toujours ainsi.
Or la critique de Sir Ludovic va beaucoup plus loin : pour lui, la justice britannique est une simple joute entre deux partis, l'accusation et la défense, la loi et même la jurisprudence ne jouant qu'un rôle de figuration dans la plupart des affaires. En gros cela se passe ainsi : la police enquête, donne ses conclusions et le juge les présente au jurés qui décident. Point. L'accusation de Sir Ludovic repose sur le fait que les juges n'ont aucune raison de se méfier de la police, il manque une tierce puissance indépendante de la police et du Parquet, à savoir notre fameux
Juge d'Instruction !
Celui-là même que tant de politiciens voudraient voir liquidé dans notre beau pays de France. Ce dernier a la fonction d'un sas entre l'accusation et la défense. Il est le troisième œil qui surveille la procédure depuis le premier jour jusqu'à la remise de ses conclusions, à moins qu'il n'ait décidé d'un non-lieu au paravent, ce dont il a aussi le pouvoir. Non seulement il surveille la procédure, mais il peut demander des suppléments d'enquête et requérir l'aide de la police pour entreprendre de nouvelles recherches et rouvrir l'enquête. Ce personnage surveille l'ensemble de la procédure et veille à la bonne foi des enquêteurs. Sir Ludovic nomme notre système curieusement une justice inquisitoriale ! Evidemment cette Inquisition est le mécanisme qui recherche la preuve de la culpabilité et qui n'accepte pas de reposer entièrement sur la bonne foi des policiers et des juges.
Car au résultat, il suffit de travailler correctement au corps le suspect choppé au petit bonheur la chance et lui faire signer, par une belle nuit de pleine lune, des aveux en bonne et due forme, dont la rétractation n'aura jamais la moindre valeur, alors qu'il est vrai que de tels aveux peuvent être rétractés dès la première audition chez nos bons juges d'instruction, et donc donner lieu à un supplément d'enquête. De l'autre côté de la Manche des aveux sont des aveux, et si le juge ne se retourne pas lui-même contre les policiers, le suspect devient le coupable. Or, comme le souligne Sir Kennedy, en Grande Bretagne, les juges sont aveuglément solidaires des policiers, résultat, on pendait et on emprisonne des innocents à la pelle. Des condamnés à perpétuité innocents ont même fait des années de rab parce que le juge a décidé qu'on ne ferait pas de test ADN et qu'il fallut attendre le départ ou la retraite du fonctionnaire de cette juridiction pour que son remplaçant en décide autrement, ce qui n'est même pas assuré. Pour conclure, je dois avouer avoir été sidéré par cette autocritique qui ne remet pas seulement en question la Justice britannique, mais toute sa prétendue démocratie qui repose en définitive sur une tradition orale, sans Constitution écrite, ce qui permet toujours, en dernier ressort, de faire fonctionner à plein régime la Monarchie à l'intérieur des murs mêmes de la Chambre des Communes. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé lorsque cette Chambre a décidé à une quasi unanimité de voter la guerre en Irak, un vote dont la majorité des députés n'ont pas fini de se mordre les doigts à l'approche des prochaines élections.
Le Royaume Uni est un pays étrange. La notion de droite et de gauche est toute récente, et le bipartisme classique opposait jusqu'à la création du parti Travailliste en 1906 la bourgeoisie commerçante des Tories à l'aristocratie financière des Whigs, nous avons tous lu les aventures de Disraeli aux prises avec le whig Gladstone, le Premier Ministre qui a vécu la plus longue carrière politique sous Victoria, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, comme par hasard, les descendants des Whigs, à savoir les Libéraux, reviennent à la charge et pourraient bien renaître de leurs cendres dans un électorat entièrement largué et qui a bien du mal à distinguer la gauche travailliste de la droite Tory. Ce serait, mutatis mutandis comme si l'UDF, ce rassemblement centriste d'ex-légitimistes, allait reprendre lui aussi du poil de la bête aux dépens de tout le monde, mais surtout de la droite bonapartiste dite gaulliste. Je suis même tout à fait persuadé qu'un pareil retournement de situation ne gênerait nullement notre Président et que malgré tout ce qui l'oppose à Bayrou, le Henri IV du Béarn, il n'hésiterait pas une seconde à lui confier Matignon si le vent venait à tourner en faveur des troupes centristes, chose qui pourrait bien arriver lors des prochaines élections régionales. De mon point de vue, je pense que ce serait tout bénéfice pour la France, car les centristes, à quelques exceptions près comme Jacques Blanc, sont plus fiables dans leur opposition au Front National que l'UMP, parti fantôme, sans idéologie précise, sans stratégie globale et qui se consacre entièrement au calcul électoral dans lequel il me paraît tout à fait prêt à intégrer des représentants de l'extrême-droite, ne vient-on pas, en très haut-lieu d'offrir de magnifiques pantoufles onusiennes à Charles Million, ex-traître de l'UDF ? Précisément . Il est vrai qu'originairement, les centristes représentent le reliquat de la bourgeoisie collaborationniste que l'on a vu revenir au pouvoir au début des années cinquante, mais l'UDF est une nébuleuse dont l'atout est la souplesse. Elle représente des tendances dures du libéralisme comme celle de Madelin, mais aussi une forte tendance humaniste qui, à l'instar de son leader Bayrou, a décidé de substituer au panache Blanc de l'honneur féodal dont il est issu, celui de l'humanisme et de la culture, nouvelle noblesse, qu'on le veuille ou non, de notre République sarkosizée.
Ce mouvement de retour vers le centre n'est plus un mouvement lisible seulement dans telle ou telle nation, il est devenu une composante de la dynamique européenne. Les Allemands ont aussi leurs libéraux, dont l'argument principal est la liberté, même si cette liberté est historiquement liée à la toute-puissance des Junkers, l'ancienne noblesse prussienne. Comme l'histoire est drôle quand-même ! Le parti libéral allemand, écrasé depuis quarante ans entre les social-démocrates et les Chrétiens-Démocrates, représente finalement le seul parti qui a les racines historiques les plus profondes. Il représente certainement encore dans les fantasmes des Allemands, les Stände, ces formations sociales étranges qui ne sont ni des corporations, ni des partis politique, ni un émanation de la noblesse, mais un mélange de tout cela. Si ce parti survit malgré les pires défaites, et même récemment le suicide de Max Möllemann, l'un de leurs ex-leaders charismatiques mais corrompu, c'est qu'il possède une forte plus-value symbolique. Son obstination à prôner la défense de la liberté (et du libéralisme bien sûr) mais aussi les Droits de l'Homme, son courage à prendre position dans les dossiers les plus délicats comme l'immigration, le racisme et l'antisémitisme et même la justice sociale, lui confère aussi un panache qui finira par payer dans une Allemagne et une Europe désenchantée par les impératifs du marché unique et du Traité de Maastricht.
Les droites comme les gauches européennes ont du souci à se faire côté libéral, mais de Blair à Jospin il ne faut pas hésiter à dénoncer le cynisme d'une Realpolitik défaitiste suspendue aux chiffres de la croissance, alors que le tournant du siècle, s'il parvient à le prendre, tiendra tout entièrement dans le renoncement à la fatalité de la croissance. Hier encore, j'ai pris connaissance du programme de ma fille en économie de la section STT, et j'ai dû parcourir des paragraphes entiers consacrés à la rareté et à la pénurie comme moteurs de l'économie. En 2003 ! Bien évidemment, je comprends que tout le système capitaliste repose sur ce dogme, car c'est un véritable dogme qu'il faut croire et dont il n'existe aucune preuve tangible autre que la pauvreté artificiellement entretenue dans les pays dont on a brisé le propre développement comme l'Inde stérilisée par les Anglais, ou exploités de manière à les placer dans des positions de dépendance dont on tire les bénéfices politiques grâce aux subventions à usage essentiellement politique. La pénurie naturelle est la plus belle invention de l'économie politique bourgeoise et il est dommage que même Marx s'y soit laissé prendre, fasciné par la différence déjà perceptible entre ce qui existait et ce que l'industrie allait créer. Mais ce que créé l'industrie, ce n'est précisément rien d'autre que la pénurie elle-même : en transformant toue chose en marchandise, je dis bien toute chose y compris bientôt l'eau et l'air, le capitalisme a élevé une barrière entre les dons de la nature et le désir de l'homme. Comment comprendre la pénurie lorsqu'on observe qu'un grain de blé en donne quarante à quatre-vingt chaque année ? J'en reviens toujours à la démystification radicale que constitue le livre de Georges Bataille
1 sur cette pénurie qui ne se comprend que parce que nos sociétés détruisent à des fins religieuses et idéologiques le surplus qui ne cesse de s'accumuler dans nos greniers. Le coût des recherches et de la fabrication des armes atomiques, et des autres, doit représenter à lui tout seul la totalité des richesses que l'Espagne a pillées dans toute l'Amérique entre le quinzième et le dix-septième siècle. Jetez un coup d'œil banal sur les dépenses militaires que le Congrès américain vote sans broncher jour après jour pour la guerre irakienne. Le luxe de la Jet-society toute entière, avec ses possessions mobilières et sa logistique ne représente qu'une fraction ridicule des dépenses militaires qui ravagent notre planète dans tous les sens du terme. C'est ce que Bataille appelait la " consumation " par opposition à la consommation. Aux lendemains de la dernière grande guerre, les experts de l'ONU avaient pu calculer que toutes les économies que permettrait la fin de l'économie de guerre pourrait suffire largement à enclencher un processus de développement planétaire qui mettrait fin sans difficulté aux inégalités dont n'est pas responsable la nature, mais les impérialismes qui, non seulement ont surexploité le Tiers-Monde, mais détruit la base de son autarcie alimentaire au profit d'une dépendance commerciale de leurs propres produits.
D'ailleurs je suis persuadé que la grande majorité des citoyens du monde que l'on torture chaque jour avec le mot croissance, se demandent avec angoisse ce qu'il peut bien vouloir dire. La Seule réponse qu'on peut leur faire c'est le chantage qu'on peut lire tous les jours dans nos quotidiens : croissance = emplois. Croissance = dépendance de la part d'esclavage que l'on veut bien distribuer en échange du droit d'exister. C'est aussi la dépendance des produits qu'on a réussi à rendre aussi indispensable que le pain. Précisément pour avoir seulement accès à l'esclavage il faut posséder une automobile et la nourrir de tous les frais qu'elle occasionne, et payer les impôts qui permettent de défigurer l'espace dans lequel nous vivons en déployant d'immenses et infinis rubans de béton et de macadam sur quatre, six ou huit voies. J'arrête là, car le trou d'ozone n'est pas loin, alors qu'on s'est éloigné de quelques années-lumières du problème de la justice, titre de ce texte interminable. Mais tant pis, c'est ainsi, le monde est devenu une machine qui marche globalement et dont chaque élément est relié à tous les autres. Il faut que ce lien devienne réellement le monde du développement durable, terme qui contient la critique directe du concept de croissance, car développement ne signifie pas en lui-même croissance, il n'est que le mouvement perpétuel de la nature qui ne cesse de se développer. C'est à nous de trouver le cadre durable dans lequel cette croissance trouve son équilibre définitif sans qu'il soit nécessaire que la richesse totale du monde, son PUB, Produit Universel Brut, n'augmente d'un iota. Désormais il n'y a plus qu'une seule richesse qui devrait être soumise à l'impératif de la croissance, c'est le PIUR, le Produit Intellectuel Universel Raffiné.
1
Georges Bataille, la Part Maudite.
Mercredi 10 septembre 2003
Chère Dany,
Dany, tu ne liras pas cette lettre puisque depuis hier tu n'es plus qu'un peu de poussière dans une urne que Pascal va trimbaler je ne sais où. Mais ça ne fait rien, l'Être a les yeux qu'il faut pour le faire à ta place et Pascal un certain droit à ton regard, un certain droit de faire comme si c'était toi qui lisait ce que j'aurais tellement aimé t'écrire avant que la mort ne t'emporte. Je m'adresserai donc à toi, Dany, comme si tu avais encore tes yeux si douloureux pour faire ce que tu ne faisais presque jamais, lire des lettres. Mais au fond, qu'est-ce que j'en sais ? Hier lors de cette cérémonie si bien préparée par ton mari, tu sais, tu peux être contente, malgré le curé qui me faisait grincer un peu les dents de l'âme, tout a été parfait et tu es partie comme une reine. Comme cette reine que tu savais être quand tu redressais la tête avec colère en lançant des regards courroucés par les mille manières que la vie a eu de te léser, la vie et les autres, dont moi. Quand j'ai dit hier à Pascal que je m'en voulais à mort de t'avoir tant négligée dans ces derniers mois de ta vie, il m'a tendrement consolé, il m'a interdit de ressentir quelque remords que ce soit. Aussi, je t'en veux de m'avoir trompé pendant si longtemps, comme tu as trompé tout le monde, en me cachant la vérité avec tes éclats de rire qui sonnaient si juste. Ou bien alors j'avais les oreilles bouchées lorsque tu m'appelais au téléphone, ce dernier objet qui te reliait encore au monde d'autrefois, je n'entendais que ce que je voulais entendre pour ne pas prendre vraiment conscience que tu allais nous quitter, que tu nous appelais au secours parce que tu sentais venir la faucheuse, en douce, dans le brouillard des diagnostics surréalistes de la faculté. Comme tu as su donner le change pour nous laisser en-dehors de tes angoisses, claironner jusqu'au bout la vie comme tu l'as fait toute ta vie. A t'entendre au téléphone je finissais toujours par penser que l'horreur qui te mangeait vivante ce n'était que quelques petits bobos à côté de mes douleurs aussi morphineuses que les tiennes. Le pire, c'est que tu claironnais la mort autant que la vie, et là-dessus nous étions tellement d'accord toi et moi, tellement d'accord pour quitter ce monde qui ne nous méritait ni toi ni moi. C'est sûr, il y avait les enfants, les tiens et les miens, et ils sont encore pires que nous avons été, tellement plus abandonnés que nous devions rester encore le plus longtemps possible. Mais tu peux être tranquille, j'ai vu Carla donner le sein à ta petite-fille, comme si la vie venait se glisser comme une liane sauvage entre les pierres du château de la mort, et Dona, grand et fort, avec la sérénité de ceux qui savaient ce que tu endurais, il reflétais ton propre soulagement.
En remontant l'allée qui conduisait au crématorium, j'ai eu cette métaphore qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit que toi et moi étions du même arbre, deux feuilles voisines depuis si longtemps, qu'en regardant mes mains et mon corps je voyais bien que l'automne était déjà bien avancé avec ses taches brunes et ses crevasses alors que toi tu étais encore si verte, si vivante et si gaie. Il est vrai que je ne t'avais plus vue depuis presque quatre ans, mais tu étais la seule amie de toujours qui toujours m'appelait, restait toujours attentive à ne pas perdre mes numéros de téléphone. Bref, pour moi tes " bobos " te rendaient encore plus vivante, et puis tout d'un coup je te vois lâcher ta branche, tomber encore verte, d'un coup, sans prévenir. Décidément je n'arrive pas à me consoler de moi-même, de ma culpabilité, de cette négligence et cette volonté cachée de ne pas entendre ce que j'aurais dû entendre et faire ce que j'aurais dû faire.
Lorsque Pascal m'a annoncé que tu nous avais quitté pour de bon, il m'a proposé d'aller te contempler encore une fois quelques heures avant l'incinération et je t'en demande pardon car je n'ai pas pu. Je me suis inventé toutes sortes d'excuses, mais la vérité est que je sais combien la mort détruit vite ce qui est et ce n'est pas toi que j'aurais vu mais une Bernadette Soubirous quelconque, cosmétisée pour paraître. Comme ça je garderai de toi l'image qui me reste de toi, assise en fumant dans mon fauteuil de la rue Ehrmann, éclatant de rire à chaque phrase alors même que tout dans ta vie ne cessait de t'accabler. Je dis bien tout, Dany, car nos existences ce n'est pas de la tarte. Ou bien disons les choses autrement, il n'y avait que l'existence qui nous faisait rire, et notre amitié c'était surtout ça, être ensemble pour rire l'existence et lui rendre cet hommage. Pour le reste, tu disais comme moi, je m'en fous. En éclatant de rire.
Dors bien.
Jeudi 11 septembre 2003
Le développement durable.
L'Europe ne connaîtra pas le destin de la Grèce antique qui a cherché pendant plus de dix siècles à devenir une entité nationale, à s'unifier de l'intérieur et non pas sous la domination d'un Macédonien qui n'appartenait pas à l'Hellade primitive. La tentative d'Alexandre n'a pas appartenu à l'histoire des Grecs ni à l'esprit que partageaient malgré la haine qui les sépara si longtemps les Doriens et les Ioniens. Hitler fut à sa manière l'Alexandre de l'Europe, mais malgré toute la barbarie de son action il appartenait au cœur de cette Europe. En un sens très mystérieux, il a créé une situation historique qui a permis aux Européens d'exorciser les démons dont les Grecs ne sont jamais parvenus à se débarrasser. La Shoah fut cet événement qui a conduit toute l'Europe dans le fond de l'abîme du néant de la moralité, et cette expérience cathartique a valu comme sa prise de conscience d'elle-même. Pourtant, la dépendance étroite qui s'était installée entre les nations européennes et les Etats-Unis en a fait un chantier de l'américanisme par rapport auquel ne résistèrent que très peu d'entre-elles. La France eut cette chance et ce privilège de retarder l'invasion culturelle de cette Macédoine moderne qui vient à peine de découvrir son Alexandre de pacotille. Et puis l'Amérique fut elle-même contrainte de jouer la carte européenne, de transformer notre continent en un vaste glacis militaire entre le communisme et son ennemi mortel qui avait son quartier général à Wall-Street. Elle misa donc elle-même sur une unification qu'elle comptait bien conserver dans des limites raisonnables, une Europe des Nations qui resteraient encore pour des siècles une simple idée sans contenu concret. Quelques hommes résolus, de Schumann à Mitterrand et Kohl changèrent le cours des choses et on vit naître une Europe inattendue, nanti d'un marché unique et même, horreur suprême pour Wall-Street, d'une même monnaie. L'antique névrose d'échec s'évanouit enfin, après de multiples tentatives manquées, l'occident naissait enfin sur son propre sol. Au trois-quart détruite, l'Europe de 1945 ne manqua pas l'occasion de se reconstruire rationnellement même si ici et là subsistèrent encore longtemps des bras mort de l'ancien monde. Elle devint la zone du monde la plus convoitée par le monde, non seulement parce qu'elle avait su conserver envers et contre toute la barbarie de deux guerres l'essentiel des témoignages de sa culture, mais parce qu'elle était devenu le continent le plus efficace et le plus confortable. Elle s'était donnée toutes les chances pour être un jour peut-être le lieu expérimental de ce qu'on appelle sans trop savoir de quoi en parle, le développement durable. Nous allons tenter ici de dresser les grandes lignes d'un projet qui advient aujourd'hui à la conscience, qui vise par mégarde l'espace qui ne peut pas être le sien, à savoir le monde qui cherche encore son " développement ", parce qu'il est l'aboutissement logique et positif d'une aventure métaphysique qui s'achève, l'Europe elle-même.
Quel contenu en effet donner à une expression à laquelle personne, à ma connaissance, ne s'est encore risqué à donner une définition précise. La notion est devenu un fourre-tout de revendications morales et politiques qui ne se posent jamais qu'en négatif de l'état des choses présent. Procédons donc pour commencer par élimination. Développement durable ne peut pas vouloir signifier croissance continue, car on aurait alors utilisé le mot croissance, il n'y avait aucune raison de mettre développement à la place de croissance. Et puis posons tout de suite une question simple : est-ce que le monde croît ? Aucun astrophysicien n'oserait répondre directement à cette question, même si la thèse de l'univers en expansion tient en ce moment la rampe. Et il faut ajouter que univers en expansion ne signifie aucunement croissance du monde. L'expansion doit être considérée comme l'allongement des espaces qui séparent les objets célestes, et même si cet allongement devait avoir pour corollaire l'agrandissement proportionnel de ces mêmes objets, cela n'aurait pas encore la valeur d'une croissance intrinsèque du monde, mais seulement d'une augmentation globale du volume de toutes les choses qui composent ce monde, et cela ne changerait donc rien aux rapports qui existent entre ces objets. Pour être plus clair, posons que le volume de la sphère mondiale augmente de 10% en un temps T, cela aurait pour conséquence de faire augmenter en même temps d'un même pourcentage le volume de tous les objets et de tous les êtres présents dans ce monde. Il n'y aurait donc rien de changé au résultat final dans les relations existantes entre les objets et entre les êtres. Nous pouvons donc conclure que le monde ne croît pas, ne peut pas croître. Ce qui pose tout de suite la question corrélative : pourquoi la croissance économique serait-elle une nécessité absolue de toute économie ? Il y a certes des inégalités entre des zones économiques et d'autres, mais l'inégalité n'implique pas, par elle-même, la nécessité d'une croissance à tout prix, elle demande tout au plus une volonté de partage et de réduction des inégalités, volonté dont je ne comprends même pas qu'elle ne s'impose pas comme une simple évidence sans discussion.
Pourquoi, dans ces conditions, a-t-on choisi le mot développement en lieu et place de croissance, expression que semblent avoir adopté les discours politiques de toutes tendances. L'expression " développement durable " ça fait bien dans une phrase même si on ne sait pas quel contenu précis y mettre. Bien sûr, dans l'esprit de tous, le mot développement a pris tout simplement la place du mot croissance, mot quelque peu usé et dont les quelques remarques que je fais plus haut montrent en effet la fragilité. En réalité, la croissance n'a de sens que dans un contexte de concurrence, et de concurrence effrénée comme ce fut le cas pendant la guerre froide où la croissance occidentale devait démentir le théorème marxien de la paupérisation. Ce mot est en quelque sorte contaminé par les déterminations qui ont entouré les conditions économiques de la guerre froide ; je dis contaminé puisque même s'il a semblé pendant quelques années que la paupérisation était en effet vaincue en Occident alors qu'elle redoublait (en apparence) dans la zone communiste, le retour galopant de cette paupérisation invite plutôt les idéologues à éviter de continuer à faire usage d'un langage qui correspond à cet épisode. C'est pourquoi Monsieur Raffarin parlera tout aussi bien de développement durable que José Bové, même si ces messieurs ne parlent pas du tout de la même chose.
Alors que peut vouloir dire développement. J'ai fais quelques allusion dans le texte précédant en énonçant entre autre que le développement était un mouvement naturel des êtres vivants, un processus dont le sens n'était pas forcément unilatéral et linéaire, c'est à dire dans le sens positif de l'augmentation ou de l'ascendance. Un processus peut être cyclique, comme l'est celui de la vie, et on peut dire que la vie se développe selon un cycle qui va de la naissance à la mort : le développement ne s'arrête pas à l'acmé de l'individu, mais il le conduit ensuite aussi vers son déclin et sa disparition. Développement n'a donc a priori rien à voir avec croissance dont le sens d'augmentation ou d'agrandissement serait univoque : le contraire de croissance porte le non de décroissance sans ambiguïté possible. On doit donc percevoir dans la substitution du mot développement au mot croissance une volonté de dissimulation ou disons la pose d'un bémol dans l'expression de l'esprit de conquête quantitative qui caractérise le capitalisme. Il demeure pourtant dans le concept de développement, l'idée qui faisait fond dans la réflexion sur l'avenir économique des pays dits aujourd'hui " en voie de développement " après que l'expression " sous-développé " ait perdu de sa légitimité ou de son élégance, le sens premier de croissance. Un pays en voie de développement est un pays qui est dans un processus qui le pousse vers la croissance, c'est à dire en termes simples vers l'enrichissement, c'est à dire l'augmentation de ce qu'il est convenu d'appeler le produit intérieur brut. L'expression développement durable n'a donc pas le même sens lorsqu'elle est employée par un représentant du capitalisme ou par quelqu'un qui en ferait la critique.
Venons-en au mot " durable ". Déjà dans son œuvre de 1933, Le Travailleur,1 Ernst Jünger condense une idée qui me paraît aussi partagée que le bon sens cartésien : le monde doit sortir du chantier permanent qui le caractérise depuis des siècles et surtout depuis les grandes destructions des deux dernières guerres. La puissance à durer doit devenir une dimension de toute chose, aussi bien de l'environnement général, l'urbanisme, l'architecture et les infrastructures, que des objets les plus humbles dont l'usure n'est devenu une nécessité qu'à travers les nécessités du marché capitaliste. Chacun de nous possède encore chez lui ne fût-ce qu'un couteau qu'il tient de son grand-père et qui possède quelque chose comme la qualité de l'éternité. Simplement parce qu'il a été conçu et fabriqué pour durer le plus longtemps possible, mieux, pour prendre sa place dans l'inventaire éternel des objets nécessaires. J'ai déjà parlé ailleurs de mon admiration pour l'architecture simple des maisons modestes que l'on peut trouver partout dans le bassin méditerranéen. En Corse en particulier ou en Sardaigne, on trouve des maisons que l'on sent immédiatement construite pour des siècles et pas seulement pour le temps d'une ou deux générations. Les murs construits en pierres non taillées simplement posées les unes sur les autres sans mortier inspirent une telle solidité, une telle pesanteur naturelle qu'ils semblent indestructibles. On trouve partout ailleurs de telles constructions qui semblent se jouer du temps par leur structure adaptée au terrain. Je pense notamment aux fermes vosgiennes dont les murs ont une triple épaisseur, l'une de pierre et de mortier, une autre qui n'est qu'une simple couche de terre qui a une fonction à la fois thermique et à la fois d'absorption de l'humidité et puis un manteau extérieur de briques crépi qui permettent au tout de respirer. Le tout est évidemment d'une épaisseur impressionnante et d'une solidité faite pour abriter des générations de paysans. On peut aussi citer les maisons paysannes de la Lozère, célèbres pour leurs lauzes, en fait les mêmes pierres plates que celles utilisées en Corse, mais aussi des tuiles en fines plaques d'ardoise qui rendent les villages de cette région si discrets et si pimpants à la fois dans le paysage montagneux du Causse.
Voilà des exemples qui expriment l'esprit de durabilité qui est curieusement absent dans la plupart des Palais construits à partir de la Renaissance. Il suffit par exemple de visiter les milliers de maisons aristocratiques italiennes à Rome ou à Naples, pour s'apercevoir que cette durabilité n'était pas le souci des architectes et des constructeurs. En fait l'architecture des mansions britanniques ou des palazzi italiens étaient déjà pénétrée de l'esprit capitaliste qui repose d'abord sur la rotation du capital et le renouvellement de la demande. Que dire des immeubles bourgeois ou populaires du dix-neuvième et du début du vingtième siècles, dont les structures solidement conçues finissent pourtant déjà en poussière sous les boiseries desséchées. En fait, ce sont déjà de simples HLM. Entrez au hasard dans l'un de ces splendides immeubles de la Rue du Vingt Septembre à Gênes, enfilade de palais les plus cossus vus de l'extérieur les uns que les autres. Il y a alors deux possibilités, ou bien l'immeuble vient d'être vraiment restauré, et alors vous êtes vraiment dans un palais princier, ou bien, peut-être juste à côté, l'immeuble végète depuis un demi siècle, et ressemble à une ruine mélancolique aux marbres ébréchés comme de vieilles assiettes et à l'éclairage chétif d'une ampoule nue à quarante Watts. Dès le troisième étage, l'eau ne parvient plus que par un mince filet, bref on se croirait dans un squat du Bronx. Gênes est le berceau du capitalisme, c'est donc ici que prit naissance le processus qui devait conduire à la nécessité de faire disparaître la durée comme paramètre des valeurs d'usage que l'on fabriquait ou que l'on échangeait. Les premières marchandises étaient d'ailleurs des marchandises idéales, puisqu'il s'agissait de matières premières rares comme les épices ou les étoffes, choses que l'usage promettait à une disparition rapide. C'est cette disparition qui garantit la reproduction du cycle de fabrication et d'échange, alors qu'un objet éternel stériliserait pour ainsi dire le marché. Si le même grain de poivre suffisait à parfumer éternellement les mets que l'on cuisine, le marché du poivre disparaîtrait très vite.
Avec le capitalisme se déployant sur toute chose, sur l'espace, la terre, les objets de la technique, et maintenant aussi la culture et même l'esprit, tout est devenu d'essence renouvelable. Je m'exprime mal. Le capitalisme a introduit en toute chose le gène de la reproduction nécessaire, il faut que tout puisse mourir, se désintégrer, disparaître, pour que le capitalisme lui seul puisse survivre afin de reconstruire inlassablement le même monde, enfin le même succédané de monde, périssable selon une logique calculée en fonction du renouvellement et de la croissance du capital. On ne laissera bientôt plus deux générations connaître le même monde, deux générations fréquenter le même espace, respirer les mêmes odeurs et entendre les mêmes chants d'oiseaux. Dans notre imaginaire naturel, nous naissons dans un monde immuable dont le charme et la beauté résident d'abord dans leur puissance à défier le temps. Regardez les touristes se bousculer Place Saint Marc ou aux pieds des Pyramides, que viennent-ils contempler sinon ce qui leur manque, l'éternité dans le présent ? Vous allez me dire, je vous entends déjà, que le monde évolue ! Mais que signifie cette idiotie ? Depuis Rome, en gros, avec quelques nouveautés sorties au Dix-Neuvième et au Vingtième siècles, on sait comment construire un monde stable, beau et confortable. Regardez une villa romaine du deuxième siècle AJC et une villa de Hollywood, quelle différence essentielle y-a-t-il entre les deux, à part quelques écrans cathodiques et le bruit des moteurs ? Rien. Regardez, ou imaginez Babylone, la plus belle ville qui n'ait jamais existé sur terre, et vous vous demanderez pourquoi on ne refait tout simplement pas Babylone, en définitivement solide, en indestructible comme on sait faire aujourd'hui ?
Parce qu'on ne veut plus rien créer d'indestructible, parce qu'il faut un prétexte pour faire travailler des hommes au profit d'autres hommes. Il y a quelques années, presque vingt ans, un constructeur irlandais a eu l'idée de construire la voiture parfaite et inusable, et il l'a fait. J'ai oublié son nom mais cette objet a été fabriqué à quelques milliers d'exemplaires, et comme il coûtait très cher évidemment, le marché s'est tari rapidement. Mais il ne s'est pas tari seulement à cause du prix, mais parce qu'il ne respectait plus la représentation des hiérarchies. Vous rendez vous compte ? La logique de la Rolls Royce et des Ferrari contrariée au profit d'un parc monotone d'objets roulants identiques ? Plus moyen de se hisser au-dessus des autres dans la vitrine du présent ? Mais le pire c'était évidemment le spectacle d'un principe inacceptable : la possibilité pour un objet de durer éternellement, de saper les fondements de la dynamique de croissance et de changement permanent. De montrer qu'on pouvait le faire, comme on pourrait fabriquer des ampoules électriques éternelles dont le brevet moisi dans un coffre de Philips à Utrecht ou Eindhoven. Un monde éternel dans lequel seule la vie végétale, animale et humaine auraient encore pour ainsi dire droit au mouvement, celui de la reproduction. Au début du vingtième siècle, on dit que les décideurs ont fait le choix de l'industrie aux dépens de l'agriculture, laissant filer les prix de l'une et gelant les prix de l'autre, car évidemment on ne pouvait pas tout financer. C'est faux. C'est à dire c'est vrai et faux à la fois, c'est vrai car il est vrai que les prix agricoles ont été gelés au profit des prix industriels, mais c'est faux parce qu'on a imaginé une industrie IDENTIQUE dans son principe à l'agriculture, c'est à dire soumis au changement constant, au rite de la récolte, et surtout à la consommation destructrice, néantisante dirait Sartre. Au lieu de construire des objets industriels en fonction de leur durée, on a très vite compris qu'il fallait tout construire en fer-blanc, en toc, c'était la politique qui a fait la fortune de l'Allemagne de la fin du Dix-Neuvième siècle, capable de vendre des objets nobles comme les stylos ou les briquets dans le monde entier sans même faire de dumping, elle vendait de la camelote, ce que fait la Chine aujourd'hui dans le vaste empire de l'Asie et bientôt chez nous.
La camelote, voilà le mot fatal. Oh, il y a des hauts et des bas, car le peuple innombrable et vicieux des consommateurs se rebiffe parfois, et la concurrence qui résiste malgré toutes les manipulations monopolistiques, permet de retarder le moment fatal où le marché n'offrira plus que de la camelote. Les Japonais par exemple, se sont vengés de leur écrasement militaire en produisant des marchandises incomparables et en contraignant l'industrie occidentale à en faire autant, retardant ainsi le processus. Mais le temps de la camelote viendra si rien n'est fait, et si l'idée d'un monde fixe, stable, solide et confortable pour tous ne fait pas son chemin. Jünger disait qu'on allait entrer dans une période de " lissage " lorsqu'on sera sorti de la chantiérisation du monde d'après les destructions nécessaires. Voyez ce qui se passait en 1933 dans la tête d'un philosophe allemand : il fallait tout détruire pour certes reconstruire, mais l'idée-mère était la destruction du vieux monde, comme si la vieillesse des choses et du monde d'en faisait pas l'essence même, la garantie ontologique de la légitimité et du sens. Le même Jünger, sortant titubant des ruines fumantes de son Allemagne, n'a plus rien fait d'autre par la suite que de voyager pour contempler ce qui subsistait de plus ancien, pour jouir de la vue de tout ce qui était vieux, perdu et déchiré entre sa vision prophétique d'un monde qu'il ne verra jamais et celle bien tangible des anciens modèles qui ont tant fait leurs preuves. Je me souviens d'un texte dans l'un de ses carnets à propos de Kyoto, cette ville antique et pourtant toujours refaite à neuf, inchangée et pourtant constamment entretenue et reconstruite. C'est comme la Suisse avec ses motrices électriques des années quarante qui continuent de tirer les trains simplement parce qu'on les a entretenus après les avoir conçues pour l'éternité. J'y reviens constamment à la Suisse, parce que ce pays a été épargné, et que ses villes sont des chefs d'œuvre et des lieux absolus de bien-être. Si ce petit peuple a le courage de lutter contre les cloportes à pneus, il peut faire de son espace un paradis sur terre. Mais nous aussi pouvons le faire, tout le monde peut cesser de casser, d'user pour rien, d'acheter et de vendre pour transformer et gagner du profit seulement par ces opérations, se fichant éperdument de ce qui advient du lieu où les hommes habitent et vivent.
Le développement durable, allez appelons-cela comme ça, est le seul avenir possible pour l'espèce humaine. Car dans sa rage de transformer, de gaspiller pour faire du profit, d'exploiter au-delà de tous les besoins réels les terres, les mers et même l'atmosphère, cet idiot d'homme n'a pas vu toute la fragilité réelle de ce qu'on lui a offert si généreusement. Comme un gamin stupide et brutal il a saisi la réalité comme une poupée barbie et lui a fait subir les derniers outrages, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus un seul cheveux, jusqu'à ce que ses membres pendouillent, désarticulés et inutiles. J'en arrête là pour aujourd'hui, mais je reviendrai sur ce sujet car tout est loin d'être dit et pensé sur les enjeux d'une telle transformation. Il y a une chose que l'on peut dire sans se tromper, c'est qu'à l'exception de quelques zones du monde privilégiées par l'histoire, la planète a été malmenée de plus en plus anarchiquement au fur et à mesure que la puissance humaine grandissait. Rien n'est pensé au-delà du rond-point budgété aujourd'hui par le conseil municipal et détruit demain par un autre pour d'autres raisons et d'autres chèques. On pense dans son coin, pour soi. Pis que ça, le gouvernement français actuel propose de démembrer le pays pour mettre un comble à cette anarchie, alors que des générations de rois se sont échinés à unifier, à simplifier, à ouvrir les espaces à la Raison universelle. Pauvre raison, devenu la putain de la compétition capitaliste. Mais justement c'est là-dessus que je reviendrai, sur la compétition, cette insatiable objet de l' instinct de tueur qui domine le catalogue des états mentaux formés aujourd'hui dans nos écoles elles-mêmes. Je tâcherai de répondre à cette question : par quoi remplacer cette compétition mortelle, sanglante et génératrice de malheur qui se prétend la loi du réel au nom d'un Bien qui ne se suffit jamais à lui-même ni aux hommes.
1Ernst Jünger, Le Travailleur , Ed Bourgois, Paris, 1989.
Samedi 13 septembre 2003
Le développement durable (suite)
La circonstance est bonne, puisque l'Organisation Mondiale du Commerce va tenir sa conférence annuelle à Cancun, un nom qui dit quelque chose à propos d'une grande tentative de Mitterrand pour obtenir de la communauté internationale une remise de dette substantielle pour les pays dits en voie de développement. On se rappelle aussi que de belles promesses ont été suivies de peu d'effets. Comme d'habe. L'un des dossiers qui va brûler tout au long des travaux qui ne seraient, selon l'ex-patron de l'OMC que la préparation de la conférence de l'an prochain où devraient se sceller les dossiers importants, est celui des subventions agricoles. L'exemple que tout le monde montre du doigt est celui du coton qui, il faut le dire, est particulièrement gratiné : les subventions du gouvernement américain à ses planteurs de coton s'élèvent à quatre milliards de dollars, c'est à dire à peu près au montant du budget du Mali. Mali qui est un grand producteur de coton et qui crève très vite pour la raison bien simple que les subventions américaines (et européennes, mais moindres) maintient le prix mondial du coton à 15 cents le kilo, et que le prix de revenu au Mali et en Afrique en général s'établit à 16 et au-dessus. Résultat les cotonniers africains perdent de l'argent chaque année et la pauvreté se développe dans l'un des pays en voie de développement qui pourrait très bien " décoller " si on le lui permettait, c'est à dire si on supprimait les subventions qui permettent de faire un dumping tout simplement illégal au regard des règlements de l'OMC. Si cette organisation fait son boulot à Cancun, et arrive à contraindre l'Amérique et l'Europe (pour la viande notamment) à supprimer les aides artificielles aux exploitants agricoles, alors l'Afrique a une chance de salut. C'est aussi simple que cela. Je vous rappelle que les prix mondiaux de ce genre de denrées, comme aussi le café, le cacao ou les céréales s'établissent les uns au fameux Club de Paris, cénacle de négociants aussi officieux que l'OCDE mais tout aussi efficace, et, bien entendu, à la toute aussi fameuse bourse au grains de Chicago. Bonjour le maïs du Mexique, pourtant dans la zone de l'Alena, pacte de libre-échange avec l'Amérique, mais pacte qui ne change strictement rien aux ravages que font les subventions gouvernementales que touchent les maïsiculteurs et autres céréaliers californiens et texans.
La première conclusion que l'on peut tirer de ces quelques informations c'est que le développement durable c'est d'abord et avant tout la simple survie des producteurs. Il faut bien s'imprégner l'esprit de la réalité qui fait que les trois quarts de la population de l'Afrique en particulier, mais il faudrait aussi signaler l'Amérique du Sud et une partie de l'Asie comme les Philippines par exemple, crèvent tout simplement de faim et d'absence du minimum de couverture sanitaire et sociale. Espérance de vie au Niger : 44 ans. Ailleurs où cette dernière s'était un peu allongée ces dernières décennies, elle redescend à vive allure et au Mali, par exemple, la mortalité infantile reprend ses vieilles habitudes que nous avons nous-mêmes connues il n'y a pas si longtemps. Faute de médicaments, d'hôpitaux etc..etc.. Ajoutez à cela la corruption des gouvernements locaux qui jouent le jeu des puissants. Au Mali, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire pendant des décennies, le coton est soumis à un monopole d'état, monopole qui décide de tout, y compris des méthodes de cultures et de la marque de pesticides qu'il faut acheter, enfin pour lesquels il faut s'endetter jusqu'à ce que toutes les cautions soient bouffées par la banque et que l'exploitant se retrouve dans quelques cabanes de bambou avec quatre femmes et 24 enfants. Heureusement que leur nombre recommence à être limité par le phénomène naturel du décès précoce !… Ce monopole constitue par ailleurs malheureusement un argument de poids des Américains pour expliquer la misère des cotonniers, et Washington ne cesse d'exiger une privatisation magique qui s'est mise en train, mais qui ne change strictement rien au problème.
C'est donc une affaire Nord-Sud classique. De concurrence Nord-Sud où le perdant est forcément toujours le même étant donné le fossé financier qui sépare les deux. Car en Amérique comme en Europe, ce sont les contribuables qui financent les subventions agricoles parce qu'ils en ont les moyens. Je ne vois pas comment le gouvernement de Bamako pourrait en faire autant avec un PIB du calibre malien. C'est donc aussi une affaire désormais de respect des règles du jeu, établi par les puissants eux-mêmes mais pour des secteurs autrement plus importants et avec lesquels ont ne peut pas plaisanter, celui de l'industrie et des services comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière chronique. Mais voilà, vous vous souvenez, fidèle lecteur que je ne crois pas à l'économie en tant que réalité séparée, or pourquoi l'Amérique et l'Europe continuent-elles à subventionner leurs exploitants agricoles malgré le fait que l'agriculture demeure secondaire ? Pour des raisons strictement politiques : ni Bush, ni Chirac ne peuvent se mettre à dos les exploitants agricoles de leurs pays pour la bonne raison qu'il s'agit de leur électorat de base. En Amérique même les Démocrates mangent du pain de la subvention, comme en France le seule ministre populaire parmi les socialistes fut celui de l'agriculture, habile à défendre les intérêts des exploitants à Bruxelles. Pour rester froidement réaliste, il y a ce que existe et qu'on ne peut pas remettre en question autrement qu'en provoquant une crise, à savoir des équilibres politiques qui, malgré leur précarité, garantissent une stabilité que les PVD sont loin de pouvoir se payer. Et il y aussi les conséquences matérielles concrètes de décisions prises par le capitalisme il y a déjà longtemps, celles notamment qui ont fait de l'agriculture un secteur secondaire. Imaginez que le prix de la baguette avoisine les cinq Euros, ce qui serait encore largement en-dessous ce que qu'elle coûterait si on calculait tout cela en francs constants, et vous comprendrez en même temps qu'avec votre revenu il serait difficile de manger et en même temps de rouler même en Clio. Pour comprendre il suffit de regarder votre budget et de mesurer la place qu'y tient votre alimentation : un cinquième ? peut-être pour les plus riches un quart du revenu ? Et le reste ? Le reste va à l'industrie, (automobile et ménagère), à l'immobilier et aux services ; ne pas oublier les banques, les assurances et les impôts, sans parler des loisirs, must occidental aussi vital dans l'esprit des gens que le pain. C'est donc là un déséquilibre et une injustice incroyable à l'égard des paysans qui ont dû se battre pour obtenir réparation sous forme de subventions, ce qui n'a pas empêché le secteur de fondre littéralement en cinquante ans des six septièmes : il y a cinquante ans, il y avait encore quelques trois millions et demi de paysans actifs en France, aujourd'hui il en reste à peine cinq cent mille. Vous allez me dire que ce phénomène est comparable avec ce qui se passe en Afrique aujourd'hui ? Oui, à condition de préciser que la société africaine n'a rien à offrir aux victimes de l'exode rural que la misère la plus noire, le retour à une économie de l'autarcie à minima dont on ira même jusqu'à les chasser en leur arrachant par le biais de l'endettement ce qui leur reste, à savoir leur terre.
Que faire avec cette situation ? Machiavel répondrait : on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais Machiavel était un homme profondément pessimiste quant à la capacité des hommes à modifier en profondeur les conditions de l'exercice du pouvoir et donc de la citoyenneté. Ce n'est pas étonnant étant donné les conditions de l'Italie dans laquelle il a vécu, sorte de patchwork de principautés ravagées par le brigandage et passant de crises politiques en crises politiques, une habitude qui, comme il le remarque sans le dire explicitement comme beaucoup d'historiens, commence avec Marc-Aurèle, c'est à dire le dernier Empereur romain légitime et vertueux qui avait su conserver la cohérence républicaine de l'Empire. Machiavel avait en revanche beaucoup d'admiration pour la France, qu'il voyait un peu comme je vois aujourd'hui l'Europe. Il y constatait tout ce qui faisait défaut à son pays démembré et en ruines, c'est à dire une politique qui contenait une stratégie à long terme, celle de l'unification, stratégie qui était maintenue de souverain en souverain envers et contre tous les obstacles et tous les prix à payer, y compris celui du mal. S'il avait vécu jusqu'à Hitler, il aurait approuvé sa politique qui, dans le fond, était fidèle à l'ancienne stratégie de l'unification de l'Europe à tout prix, mais il aurait également tout de suite compris qu'elle était vouée à l'échec car la réalité avait changé, l'environnement de l'Europe n'était plus le même et comprenait deux puissances monolithiques et qui ne songeaient toutes deux qu'à prendre la relève de l'hégémonie européenne anéantie par la guerre.
La question est donc, qu'en est-il aujourd'hui ? En 1939 il y avait, disons, des paris à prendre pour parler comme Drieu La Rochelle. Actuellement il y a dans le monde deux pôles relativement stables et assez unifiés pour songer à entreprendre une stratégie à long terme. Je veux parler de l'Europe et de la Chine. Car l'Amérique c'est engagée dans la crise d'elle-même. En ce moment où j'écris, les Américains voient chaque jour se modifier le regard que le monde porte sur eux car les récentes décisions qu'ils ont prises pour répliquer à un événement erratique, aussi erratique que le coup de glaive hasardeux dont parle Machiavel qui pouvait trancher d'un coup le cours d'un règne et provoquer la crise générale, ces décisions ont effrayé le monde entier et rendu cette grande démocratie méconnaissable. Si on analyse ce qui s'est passé depuis le 11 septembre 2201, on peut dire que l'Amérique a répondu par une guerre à un coup de glaive donné par un ex-prétorien frustré. Une guerre qui n'est que le commencement d'une série parce que les raisons invoquées pour légitimer a posteriori cette faute vont continuer à travailler toutes seules. Comment s'évader d'une explication qui consiste à dire qu'on a attaqué Saddam Hussein pour détruire un despote ? Cette logique ne vous lâche plus et elle vous entraîne en quelque sorte toujours plus loin, vers des despotes tout aussi effrayants, comme ceux qui dirigent la Chine par exemple, comme le rappelait si justement une militante alter-mondialiste à la BBC ce matin. Tout le monde a l'espoir de voir un Démocrate prendre la place de Bush l'an prochain, mais, est-ce si sûr que cela, et ensuite, est-ce que ce changement serait à lui seul capable de renverser le mouvement ? Je ne le pense pas et un président démocrate ne pourrait rien changer au cours des événements. Contrairement aux idées reçues, le capitalisme américain forme un état dans l'état beaucoup plus rigide que n'importe quel état européen. Il suffit de rappeler le statut de l'agriculture et surtout les engagements financiers et industriels que représente l'entrée en guerre. En ce moment, l'état américain ne vit plus que de promesses de redressement du déficit galopant par la reconstruction de l'Irak ! C'est dire si la situation est dramatique, quand on sait que la première pierre de cette reconstruction n'a même pas encore été posée plus de quatre mois après la dite fin de la guerre. Et pour cause. Bush fait appel à l'ONU, et à l'argent de ses membres, il sait pourquoi.
Quelles perspectives ? La presse française m'énerve beaucoup ces derniers temps, car on glose sur le déficit budgétaire français sans jamais donner la moindre référence sur le déficit des autres pays de l'Union. Que le Luxembourg soit en positif ne m'intéresse pas. Mais qu'on me donne une échelle complète des états budgétaires des Quinze et on verra. D'autant que ce que personne non plus n'analyse ni ne commente, c'est la nature réelle de ces déficits. Une petite phrase du Canard Enchaîné de cette semaine a de quoi affoler : - " …car avant longtemps l'Europe ne sera pas la seule à lui (à la France) demander des comptes " -. Qui va demander des comptes ? Le FMI ou le consortium de banques qui prête les sous ? On aimerait savoir, ce sont là les vrais secrets d'état dont personne ne moufte un mot, même pas Emmanuel Chain, l'ogre de l'économie médiatique. On sait (Chirac dixit déjà il y a longtemps) que la France débourse environ 1 milliard de Francs par jour seulement pour le remboursement des intérêts de la dette. A qui verse-t-elle cet argent et pourquoi les banques qui perçoivent ce fric s'offusqueraient-elle d'en palper encore plus ? Par ailleurs, ces banques sont en partie françaises, donc leurs bénéfices sont taxés et donc les bénéfices qu'elles font avec les sous de l'état aussi. Qui peut m'éclairer sur cet imbroglio qui me paraît une fois de plus ne faire que cacher des intérêts politiques ? Dans d'anciennes analyses sur la politique budgétaire de l'état français, j'avais souligné que la dette elle-même travaillait dans l'intérêt des Français, au moins en partie, puisque ce sont des prêteurs français qui alimentent les caisses de l'état. Dans le temps cela s'appelait la rente. Les rentiers sont morts mais pas la rente. Où va la rente ? Alors on va me rétorquer légitimement que cette dette est très largement internationale. Bon. Mais elle est d'abord européenne, non ? Elle alimente des " rentiers " européens, non ? Les plus grandes banques sont encore européennes, en y comptant bien sûr le Royaume Uni, mais les Pays-Bas, la Scandinavie et l'Allemagne possèdent quelques entreprises financières gigantesques. Une grosse partie de la dette circule donc en rond dans la zone européenne : je serais très étonné de voir un rentier européen se plaindre de toucher une partie du milliard chaque jour, je pense même qu'il est prêt à en prendre beaucoup plus, c'est à dire aussi à en prêter. Que signifie alors cette hystérie de discipline budgétaire ? La réponse est simple : le privé veut s'emparer de toutes les prérogatives des états, et les droites mondiales sont là pour appliquer le programme qui mène à cette anéantissement des pouvoirs des démocraties. Point à la ligne. C'est le programme du FMI qui fait crever de faim un bon tiers de la planète au nom de cette politique de désétatisation de la réalité sociale. Autrement dit les critères de Maastricht ne sont là que pour détruire ce qu'on prétend construire, à savoir l'Europe politique. D'ailleurs Chirac et Raffarin n'ignorent rien de tout cela, et c'est pourquoi ils se payent d'arrogance dans cette passe difficile. Machiavel traduirait cela en disant que les méchants peuvent être amenés à faire usage du bien pour conserver leur pouvoir, et il est à prévoir que les politiques à court et moyen termes des deux locomotives européennes, la France et l'Allemagne, vont se " gauchir " de plus en plus par rapport au Traité de Rome et à ses descendants, oukases du FMI et donc de Washington. Arrêtons de faire du FMI et de la Banque Mondiale un instrument multilatéral : ce sont des institutions où les Américains font la loi parce qu'ils possèdent assez d'actions pour non seulement bloquer toute tentative de changer de politique, mais pour imposer la leur. Le pauvre Monsieur Wolfensohn, le vertueux directeur de la Banque Mondiale, voulait en finir avec la paupérisation des PVD : il a vite déchanté. Je ne suis même pas sûr qu'il soit encore à ce poste. A noter une chose très drôle en passant, c'est que Chirac se paye la tête des Républicains américains en justifiant son déficit par la baisse de l'impôt sur le revenu, autre moyen des droites mondiales pour privatiser la réalité sociale.
Le principe fondamental de Machiavel est : si les choses sont ainsi…alors… Dans le prochain numéro nous tenterons donc de développer le " alors " de la situation présente par rapport à ce concept que nous traitons ici, celui de développement durable. Mais il s'agira vraisemblablement avant tout de géopolitique. La tension qui augmente entre la réalité sociale européenne qui a ses exigences concrètes : " les choses sont ainsi ", et la volonté de puissance des agresseurs de cette réalité va provoquer une crise ouverte à caractère politique masqué par les phénomènes économiques dont se sert habituellement la politique, protectionnisme, fiscalité, budgets etc… Jusqu'à présent, mes analyses se sont avérées justes, envers et contre le " bon sens ". Personne à ma connaissance n'avait prévu la fissure transatlantique dont rien ne peut plus freiner l'approfondissement, ni le retour du protectionnisme économique. Actuellement ce dernier demeure masqué par un faux multilatéralisme de façade, mais en réalité, le problème des subventions de toutes sortes, de même que le grave problème des paradis fiscaux dont usent et abusent les Etats-Unis, forment un protectionnisme de fait dont les victimes demeurent les PVD. Ce protectionnisme reste aussi, il faut le dire, le dernier rempart de l'Alliance transatlantique car il arrange tout le monde. Or il se trouve dans " les choses sont ainsi ", que le problème des subventions est aussi devenu un problème interne à l'Europe par rapport à son élargissement : les pays de l'Est ne pourront pas les tolérer mieux que les Maliens, il faudra donc nécessairement trouver une solution entièrement nouvelle. Je n'en vois qu'une seule, c'est l'option pour un protectionnisme plus large de l'Europe et son repositionnement par rapport à la carte mondiale et surtout au choix de la prééminence de l'industrie. Le développement durable va prendre son sens dans le choix pour une nouvelle forme d'industrie qui devrait à terme cesser de pénaliser en permanence l'agro-alimentaire. Au fond, nous allons refaire le coup des Japonais à grande échelle : protéger notre marché industriel pour le transformer qualitativement tout en réduisant progressivement la part qu'il occupe dans le PNB en abandonnant la fausse politique de croissance qui consiste à limiter la valeur d'usage des produits industriels pour maintenir la demande sur le marché. A l'instar de l'agriculture depuis un demi-siècle, l'industrie se mettra à la dure expérience du déclin et de la restructuration : un comble : industrialiser l'industrie. L'Europe sera la première nation au monde à industrialiser l'industrie, exactement comme les Anglais ont été les premiers à industrialiser l'agriculture. Mais de l'autre côté, cette politique de refroidissement industriel devrait engager un réchauffement de l'activité agricole, et donc aussi modifier la géopolitique des partenaires. Afrique et Amérique Latine contre Amérique et Japon. Nous serons d'ailleurs contraints, je pense, d'abandonner aussi toute solidarité politique avec les USA qui me paraissent condamnés à se lancer dans des aventures de plus en plus hasardeuses en Extrême-Orient. Comme dit il y a longtemps, nous allons devenir la neutre Suisse du monde, raison pour laquelle j'ai bon espoir que la Suède nous rejoigne demain dans le train de l'Euro. Mais on peut se tromper sur les détails.
Jeudi 18 septembre 2003
Le développement durable III.
Bon la Suède a choisi l'isolement, autrement dit elle regrette son adhésion à l'Europe comme le Royaume Uni et le Danemark. On fera sans eux. Ce qui exclut le hasard dans ces décisions, est le fait que ces trois pays soient relativement prospères, encore faut-il définir ce qu'est la prospérité. Il est vrai que le chômage est bas et les budgets confortables. Encore faut-il, du moins pour la Grande Bretagne et la Suède, voir ce qui se cache derrière. Aucun siècle n'a été aussi prospère que le Dix-Neuvième, mais dans quelles conditions pour les travailleurs ? Etrange sentiment. Je ne sais pratiquement rien de la Suède. Il m'est arrivé de la traverser rapidement pour m'attarder plus longuement en Norvège, pays semblable, où j'ai eu une surprise immense, celle de constater que je me trouve presque dans un pays médiéval. A Oslo, ville grise et cossue, il y a beaucoup de cyclistes et quelques Rolls Royces. Presque que des cafétérias où on ne mange que des tartines, et presque aucun restaurant digne de ce nom. J'en ai cherché un et eu l'audace d'y aller manger, mais j'ai en même temps mangé presque tout mon budget de voyage. Bref, il y a dans cette Scandinavie si sociale et tout et tout, un petit air de Moyen-Âge du consumérisme qui, au demeurant, fait plaisir à des anti-consuméristes comme nous, mais qui trahit quand-même des mœurs pour le moins aristocratiques. Je pense à ce film extraordinaire, Festen, où cette société (dans ce cas danoise) est superbement décrite : un château avec son seigneur et sa cour, et les communs, en-bas, le peuple des cuisines et des écuries. En haut le Château Margaux, en-bas le coca-cola. Et puis rappelez-vous les Fraises Sauvages.. Il y a bien d'autres exemples dans ces pays où, comme en Suède il faudra encore attendre quelques mois avant la séparation de l'Eglise et de l'état. Tout cela est d'autant plus étrange que ces pays ont des économies à très forte valeur ajoutée, c'est à dire de très haute technologie.
Ces pays ont beaucoup de ressemblance avec la Suisse et condensent l'une des contradictions de l'Europe contemporaine : d'un côté une société ultra-moderne du point de vue de son économie et de ses institutions politiques (ce qui ne fait que confirmer le diagnostic de Rousseau qui réservait la démocratie aux pays de petite dimension), de l'autre des sociétés hiérarchisées au point de ressembler à des oligarchies, oligarchies très repliées sur elles-mêmes dans une stagnation purement nationaliste. Leur générosité connue envers les PVD (pays en voie de développement) ne change rien à leur égoïsme essentiel, c'est à dire à leur refus de partager le destin du continent dont ils ont choisi par nécessité mercantile de faire partie institutionnellement. Exception faite de la Norvège dont le cas est moralement encore plus minable étant donné la richesse exceptionnelle que lui fournit son pétrole récemment mis en exploitation. Mais ce paradoxe ne fait qu'éclairer mieux le problème européen et celui de son " développement durable ". En effet, tous les pays que je viens de citer ont opté depuis longtemps pour certaines formes de développement durable, et se refusent au vertige des chantiers permanents. D'où leurs craintes face aux autres pays européens qui ne cessent de se moderniser, ce qui concerne en réalité surtout le Sud, à savoir le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, sans parler des nouveaux arrivants de l'Est et du Sud, Chypre et pourquoi pas, le Maghreb ?
Les procès moraux faits aux uns et aux autres, surtout à la France, ne sont pas légitimes, car ces pays ont tiré beaucoup de bénéfices des sacrifices structurels consentis notamment par la France qui n'a pas fait les choix les plus avantageux pour elle (l'abandon de l'industrie lourde contre des avantages dans l'agriculture dont j'ai déjà parlé plus haut). Par ailleurs la rationalisation de l'économie européenne ne s'est pas accompagnée d'une rationalisation politique et financière, et ici le mot rationalisation devrait être remplacé par le mot solidarité, étant entendu que la solidarité n'implique pas la charité, mais un contrat rationnel d'assistance mutuelle. Au résultat, la Scandinavie européenne profite largement de son adhésion au marché unique, tout en préservant des privilèges particuliers qu'elle conserve en l'absence de solidarité élaborée politiquement. Sans union politique il ne peut pas y avoir de partage solidaire d'un destin collectif, or la monnaie, je le rappelle pour la nième fois, est l'effigie d'un état politique. Continuer à posséder une monnaie singulière tout en prétendant appartenir à l'Europe n'a donc aucun sens, ou plutôt c'est se foutre de la gueule du peuple. De la Grande Bretagne, de la Suède et du Danemark on ne peut pas dire qu'il s'agisse de pays européens, mais seulement de pays qui ont un accès privilégié au marché de la zone Europe. Sans Madame Thatcher, les choses en seraient autrement à l'heure qu'il est, et nous parlerions d'égal à égal avec la plus grande puissance depuis au moins deux lustres, car c'est l'exemple londonien qui explique les réticences danoises et suédoises. Il faut ajouter à cela que la bonne santé économique de ces pays rétifs à la monnaie unique s'expliquent par ce refus de partager le destin commun qu'implique l'Euro. Il y a d'ailleurs une contradiction énorme dans ce refus parce que la monnaie est supposée (partout ailleurs que dans mes analyses) n'être qu'un instrument économique : les trois pays ne peuvent donc en aucun cas invoquer l'état politique des autres pays pour légitimer leur refus, or c'est ce qu'ils font. Au demeurant, les déficits français et allemands, sans parler des autres dont on ne dit rien, sont récents et en partie dus à l'absence du soutien politique des trois pays en question. A l'époque où les rebelles décidaient de ne pas adhérer à l'Euro ils ne pouvaient pas invoquer le manque de vertu des autres parce que tous les pays étaient à jour, sauf peut-être la Grèce, ce qui indique d'ailleurs la solidarité des onze autres pays à l'égard de ce pays qui a des difficultés millénaires et peu de ressources propres.
D'où aussi le retard apporté au projet européen lui-même qui EST un projet de développement durable de facto. En effet, l'essence du projet européen n'est pas la création d'une super-nation du type de l'Amérique, mais la création d'un espace d'ouverture continue et de libre circulation des biens et des personnes dans cet espace sans cesse agrandi mais aussi sans cesse mis à niveau. Au fond l'Europe reprend concrètement sur elle le projet de l'ONU dont l'égalité entre les nations était l'un des fondements moraux. Les sacrifices consentis par les pays nantis de l'Europe à l'égard de ses membres à l'origine démunis (Espagne, Portugal, Italie, Grèce qui doivent leur décollage à la solidarité européenne et dont certains font preuve actuellement d'une ingratitude insensée et scandaleuse) sont fondés sur l'idéal d'égalité économique, idéal qui fait partie de l'idéal républicain français mais qui figure aussi dans la Constitution allemandie élaborée sous l'influence déterminante des Alliés au lendemain de la guerre. Le refus d'adopter l'Euro s'identifie donc d'abord avec le refus de partager les aléas de la solidarité politique qu'il implique. C'est pourquoi je dis et je répète qu'étant donnés les conditions dans lesquelles s'est construite l'Europe, c'est à dire grâce à un transfert sans retour de richesses du Nord vers le Sud, c'est à dire grâce à un véritable don, il est injuste aujourd'hui de confiner chacun dans son destin économique et budgétaire. Si la France et l'Allemagne n'avaient jamais déboursé le moindre sous pour l'Europe, investit d'énorme quantité d'énergie financière, ces deux pays pourraient sans aucun doute faire valoir des états financiers d'un tout autre ordre. On oublie trop vite que ce qu'on appelait la locomotive de l'Europe, à savoir l'axe Bonn-Paris, était avant tout un moteur de développement pour le reste de l'Europe, y compris la perfide Albion qui s'est soustraite dès le départ aux règles du jeu que je viens de décrire. Et dire que nous continuons de verser des compensations immenses au Royaume Uni au prétexte qu'elle possède une agriculture capable de s'aligner sur les prix mondiaux alors que nous aidons nos agriculteurs à se moderniser grâce aux subventions légitimées par la toute-puissance de l'industrie. Mais ce n'est pas tout, car Bruxelles partage aussi le gâteau industriel, et Londres a notamment obtenu sans que personne ou presque ne le sache, le quasi monopole de la construction navale militaire sans rien lâcher sur Airbus ou d'autres secteurs encore plus sensibles, ce qui achève de ruiner nos chantiers navals de Saint Nazaire, de Cherbourg, Brest et Toulon. Nous contribuons à moderniser leur industrie tout en continuant à leur faire l'aumône au nom d'une injustice qui n'en est pas une.
Si vous avez le courage de lire le premier texte de la tribune libre de ce site, vous trouverez un point de vue beaucoup plus pessimiste que le mien sur l'Europe et le monde. J'ai la faiblesse de penser que les efforts que nous avons réussi à consentir jusqu'à présent et qui vont aller en augmentant encore dans les mois à venir, triompheront finalement de l'égoïsme des quelques pseudo-membres de l'Union Européenne. Les milieux financiers de ces pays le savent qui poussent à l'adoption de l'Euro pour la simple raison que leurs monnaies flambent et vont à moyen terme rendre leurs marchandises invendables : même pour leur clients naturels, à savoir européens. S'ils continuent dans cette voie, l'Europe de l'Euro se tournera de plus en plus vers l'Est et l'Orient par la force des choses et non pas par choix politiques. Si les portables suédois sont condamnés à devenir deux fois plus cher que les portables chinois, les états de l'Europe ne se gêneront pas pour entreprendre des négociations bilatérales avec la Chine pour éviter de payer en Couronnes ce qu'ils pourraient payer en Yuan. L'agonie de l'OMC ne s'explique pas autrement que par la volonté des uns et des autres de reprendre une liberté de manœuvre économique dont ils ne peuvent plus se passer au nom d'idéaux falsifiés dès le départ. Londres, Stockholm et Copenhague risquent de payer cher leur choix de rester à la marge de la véritable Europe, leurs votes à la Commission ne suffiront jamais à contrecarrer des projets qui feront peu de cas de l'orthodoxie multilatérale. Il leur restera toujours le choix de quitter le bateau, mais quelle catastrophe économique représenterait leur sortie du marché unique européen ! De même à l'intérieur de la zone Euro, les dérogations aux règlements libéraux se feront nécessairement de plus en plus nombreux et nous verrons bien si le gouvernement français laissera mourir Alsthom au profit de Siemens, un sacrifice dont je suis sûr que même le gouvernement de Berlin ne veut pas. Ce redoublement d'efforts est perceptible par un léger vent de paix sociale qui commence à souffler sur des pays aussi remuant que la France. Répétez avec moi : l'Euro est la réalité palpable de la souveraineté européenne. Depuis que Bruxelles et Francfort ont eu le culot de lâcher cet obus sur le marché mondial, l'Europe est devenue l'Europe. Stop ! Arrêtez de vous fasciner sur les journaux télévisés français, ils ne disent rien , rien , ils font comme si tout continuait de se passer entre l'Elysée, Matignon et les Français, et puis entre Paris et Bruxelles de temps en temps. Tout ça est archi faux. La réalité est ailleurs et la politique du remplaçant de Monsieur Raffarin commencera à donner quelques indications plus précises. L'arrivée sur scène de ce Monsieur ne saurait tarder.
Vendredi 3 octobre 2003
Le Départ ?
Il ne faudrait pas que ce que je vais écrire passe pour une provocation à la mort, mais je me pose de dures questions ces derniers temps. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'écriture m'abandonne. La source qui coulait naturellement semble se tarir et en même temps je suis de plus en plus mal dans mon corps. D'étranges fièvres me terrassent d'un coup puis repartent pour refondre à nouveau sur leur proie dans un ballet infernal. Aujourd'hui pour la première fois j'ai fait un parallèle entre ma stérilité littéraire et une vraie menace sur ma vie. Soit dit en passant, je méritais un pareil avertissement car j'envie parfois ceux qui sont déjà partis. A présent, je ne rigole plus. Pourtant à l'instant j'entends des bruits éternels, un chant d'oiseau qui me plonge dans cette mystérieuse joie que procure le sentiment de la persistance de l'être. Je ne sais pas si l'espèce humaine a changé depuis des millénaires, mais je sais que la nature émet les mêmes sons depuis que je suis né. Ces derniers temps je me demande comment il est arrivé que je quitte le monde immédiat du désir, de l'ambition. A quel moment, peut-être depuis le commencement, je me suis réfugié sur une plate-forme intellectuelle critique, critique de tout et impuissant à recevoir un sens général positif du comportement de mes semblables, à me solidariser avec leurs lubricités et leurs désirs. Comment c'est arrivé. J'ai l'impression que ma vie aura été une éternel départ de toute chose. Il y a bien eu les rêves éblouissants de l'enfance, rêves qui forment encore aujourd'hui sans doute le fond de ce qui me reste d'énergie à lutter pour rester vivant. Et puis l'adolescence n'aura été qu'une longue souffrance, un désarroi permanent où je sentais commencer la série des refus et des départs. En analysant à posteriori ce qui est arrivé, je me rends compte que le monde qui était le mien me laissait tout simplement tomber. Dans les moments cruciaux, personne ne me parlait réellement, j'étais déjà devenu un problème parmi les autres, un objet politique dans la famille et dans toutes les autres sortes d'entourage, dont il fallait régler " le cas ". Mais moi-même je n'étais nulle part. Alors j'ai pris ma vie en main tout seul. Pour résumer je dirais que j'ai vécu par anticipation la modernisation du monde : je suis devenu à l'époque des monstres industriels fixes un prototype de la flexibilité et de la précarité. L'abandon dans lequel m'a laissé ma famille est exactement la même chose que l'abandon dans lequel entrent aujourd'hui les peuples soumis à l'évolution du capitalisme. Ce matin je dois me taper le discours d'un Monsieur de la Faculté, un certain Robert Castel qui nous parle de tout cela comme monsieur Jourdain fait de la prose. Tout ce qu'il raconte, tout ce que vous avez entendu ce matin sur France-Culture si vous écoutez encore cette radio, tout cela se trouve dans Antémémoires depuis des années. Pour moi toute l'analyse de l'insécurisation de la société est devenue une banalité qui appelle tout au plus l'action, si on investit tout dans le politique. Mais ce monsieur Jourdain vous ferait perdre votre temps à lire son livre promu par France-Culture, tout ce qu'il contient vous le savez, vous le vivez tous les jours et n'avez nul besoin de le voir sous la forme littéraire et pseudo scientifique.
Ce matin, je suis encore entouré de ces odeurs nauséabondes que lâchent les sueurs de la fièvre provenant des mélanges de médicaments et mon esprit est toujours englué dans une semi-conscience, mais j'entends mon ami Bennassayag (j'espère que son nom s'écrit ainsi) parler du problème neumber ouane : le long terme et la croissance zéro. En fait du développement durable, ce dont j'ai essayé, sans doute très mal, de parler dans trois de mes récentes chroniques. Bennassayag nous offre une problématique intéressante : la contradiction qu'il y a entre la démocratie qui renouvelle sur le court terme le personnel du pouvoir, et la nécessité de gérer le long terme pour préserver la planète. Autrement dit les politiques sont dans l'incapacité permanente de faire faire au peuple des sacrifices nécessaires pour le long terme sans courir le risque de perdre les élections suivantes. Je pense qu'il s'agit d'un faux problème qui se dénonce de lui-même puisque le politique qui vise d'abord sa réélection est par définition un homme de peu de vertu. En revanche lorsqu'un homme vertueux, je peux penser au général De Gaulle par exemple pourquoi pas et malgré mes griefs personnels à son égard, prend de tels risques, ils passent par-dessus les considérations électorales et se forcent le passage dans la réalité du futur politique. Il est donc triste de constater que des sociologues même bien intentionnés, spéculent sur l'histoire comme sur une putain que l'on s'arrache d'une élection à l'autre. Si Jacques Chirac ou même son fou de Raffarin faisait seulement une fois preuve de vertu, je serai là pour les soutenir. Mais l'absence de vertu personnelle et de vertu politique est devenu le milieu moral normal : l'amoralité fondamentale du réel social que secrète le nouveau design de la gestion du travail et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous n'avons pas besoin d'arguments : chacun de nous connaît l'ampleur des dégâts en regardant simplement par sa fenêtre, nous avons besoin d'hommes vertueux, philosophiquement détachés de la bêtise et des ambitions les plus sordides. Ce qui ne cesse de m'étonner est le cynisme avec lequel les grands de ce monde affichent cette bêtise et ces ambitions ridicules.
Il y a quelques mois j'avais encore un peu d'espoir de voir les figures de ce pouvoir français contraints à la vertu par la situation européenne, et puis je dois constater que cette pourriture morale se donne en spectacle en Europe même, Europe qui va s'en prendre au peuple français au lieu de punir cette racaille politico-financière elle-même. Tout le monde sait qu'aucun salarié d'aucune de ces entreprises litigieuses comme Alsthom n'est coupable, mais ce seront eux les victimes et aucun responsable de l'entreprise ou de l'état ne souffrira dans sa chair surprotégée par des fortunes de mafieux répartis dans le monde entier. Oh , je ne vais pas m'étendre là-dessus, je voulais seulement rappeler que le vrai problème de l'histoire est celui de la vertu des hommes qui la font, et cette vertu de peut pas naître sua sponte de la nature des choses, elle naît de l'effort philosophique pour comprendre l'incompréhensible, seul moyen de parvenir au mépris des risibles plaisirs dont le plus sinistre est celui de faire souffrir. J'ai cru entendre ce matin, sur la même onde citée, une analyse intéressante celle-là sur le plaisir sadique que les politiques retirent de leurs décisions sécuritaires. Oui, j'en suis sûr, rien qu'à voir le visage de Monsieur Sarkozy, je suis persuadé qu'il nage en plein bonheur, celui de faire chaque jour un nombre plus grand de victimes, de détruire des vies, de répandre le malheur dans les rues, dans les cités, dans le pays entier. Ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas ce personnage en particulier, mais le fait qu'il représente le modèle du politique de demain. Il est comme moi un prototype, mais lui ne sait pas encore que son imitateur s'appellera Himmler. Encore que…
Samedi 4 octobre 2003
Tavernier Bertrand.
Je crois vous avoir déjà révélé que je rêvais de parler avec Bertrand Tavernier et son comédien-fétiche Philippe Noiret. Sans parler des autres. Ce matin j'ai regardé pour la deuxième fois " Le capitaine Conan ", et je me suis demandé comment on pourrait peindre l'univers de Tavernier, l'univers humain, j'entends. En cherchant j'ai fait une découverte intéressante : l'humanité de Tavernier c'est un tas de charbon, bien noir, que du noir mais avec quelques lumières par-ci par-là, ce qui m'a fait penser à un foyer à peine rougeoyant, en train de s'éteindre, mais qui conserve au fond de lui un cœur de feu qui perce ici et là, par éclats, vite recouverts de cendres, vite noircis. Le style, en particulier dans Conan, beaucoup moins dans Coup de Torchon qui paraît beaucoup plus linéaire et construit, est celui de Céline. Un style grondant et cynique, bordélique et grâce à ça très fort, on dirait parfois qu'il obtient par l'image des paragraphes entier de Mort à Crédit, tant il s'essuie les pieds sur l'ordre, la logique et le monde normal. Bien sûr, Conan c'est la guerre où tout semble permis, et pourtant je ne pense pas que le monde guerrier de Tavernier ressemble au vrai monde de la guerre de 14. Il peint au couteau des situations un peu hollywoodiennes avec du matériel français et tout cela nous donne une sorte de monde réel, mais un monde réel qui n'est pas encore tout à fait là, seulement en train de venir au jour. Coup de Torchon ressemblerait alors davantage au Voyage au Bout de la Nuit, avec un anti-héros fatigué par l'évidence du mal.
Mais d'où vient une telle vision du monde ? Voilà ce qui m'intrigue. J'ai le soupçon d'un vertige dans lequel serait pris le metteur en scène pour radicaliser sans cesse davantage la réalité du mal. Du mal dans l'homme bien entendu, mais un homme qui reste malgré tout pascalien, mi-ange, mi-démon. Français. Tavernier serait une sorte de Franju contemporain, mâtiné de méchanceté Chabrol. Chez ce dernier la méchanceté gauloise ou celte est bien plus palpable parce qu'il cantonne tous ses personnages dans la subjectivité la plus parfaite (quand c'est une réussite, car Chabrol c'est aussi parfois Chabrot et en bon Alsacien, je n'aime pas mélanger le vin et la soupe). Chez lui, les sujets sont méchants, chez Tavernier ce sont des classes sociales qui ne sont d'ailleurs jamais présentées comme logiquement contradictoires, mais entrecroisées en un vrai bordel sociologique. Il aime par exemple les sang-bleus à l'épée raide et aux mœurs dépravées, souvent contre des cohortes bêtement vertueuses. L'anti-héros de Coup de Torchon ne peut être qu'un aristocrate décavé digérant mal l'oubli des Croisades ou le cocufiage qu'elles ont représenté pour la plèbe nobiliaire. Mais son truc c'est d'exaspérer les extrêmes : d'un côté un bourgeois intello déchiré entre les vertus chrétiennes et les vertus de la République, de l'autre le prolo surdoué, le Père Hébert qui se révèle dans l'action et arrache ses galons au couteau, mais qui crève dans la déréliction spirituelle. Il a servi à ça, et puis il est mort. Une manière qu'a eu notre République de traiter ses citoyens, ou plutôt de s'en servir. Tavernier est pourtant un fin analyste de la décomposition de cette République, décomposition ou illusion. Plus on remonte dans le temps, moins on a le sentiment que notre République n'ait jamais existé. Je ne sais pas si ce metteur en scène a déjà traité des sujets d'avant 1900, mais ce serait intéressant de voir quel regard il porte sur les fondations de notre état. Un petit Zola ? Toutes mes excuses si c'est déjà fait, mais je ne suis plus cinéphile depuis plus de trente ans, et je n'ai aucun ordre dans ma culture artistique. Décomposition ou illusion, voilà la vraie question. Je commence à regarder mes amis avec compassion, qui pensent défendre les valeurs de la République alors qu'elle n'est pas encore née. Le bras de fer entre les vertus religieuses et les vertus républicaines est pratiquement achevé au bénéfice de l'Eglise puisque plus personne ne sait ce que sont les vertus qu'exige la République. Tout le monde est persuadé au contraire que la vertu réside toute entière dans les fumées de la charité chrétienne : ONG - Resto du Cœur - Telethon en tout genre - caritatif de lundi à dimanche - pièces jaunes - Amnesty International - Greenpeace et j'en passe, tout cela c'est le triomphe de la charité chrétienne et l'échec de la Raison républicaine. Les compradores romains du premier siècle sont devenus les transnationales qui, tenez-vous bien, ont réglé les factures de nos guerres passées et désormais se remboursent au centuple : hé oui, réfléchissez, la guerre ce sont les peuples qui la font avec l'argent des riches. Les deux dernières guerres n'ont pas ruiné les riches, elles ont ruiné définitivement les peuples, leur ont ôté pour longtemps même le pouvoir de décider de la guerre. S'il y a parmi vous un économiste, je lui pose cette question : est-il si idiot d'affirmer qu'un Euro vaut dix fois moins que cent sous ? Il y a ici plusieurs ellipses pour lesquelles je vous présente toutes mes excuses, mais je suis trop fatigué encore pour développer ce sujet. Ce sera fait tantôt, comme on dit.
Mais pour en revenir à Tavernier, un dernier mot. Je hais les critiques de quoi que ce soit. Et il ne s'agit pas ici de critiques mais d'une méditation sur un regard. Je sens une toute autre richesse derrière ce qui peut ressortir d'une œuvre aussi bonne qu'elle puisse être, et je ne renonce pas à rencontrer in vivo Tavernier Bertrand. Dans une taverne, par exemple !
Dimanche 5 octobre 2003
Requiescat ou la poursuite du sylvicide.
Comment peut-on saigner du bois ? Je saigne le bois des forêts d'Afrique et d'Amérique. Quelle
indolore souffrance. Il semble que mon existence toute entière soit placée sous le signe ou
sous le courant de cette hémorragie depuis ma naissance. En 1941 l'Alsace était allemande, et
mes parents ont certainement fêté ma naissance avec du café provenant de Côte d'Ivoire où
ma parentèle coupait déjà le bois. Albert Londres a rencontré en personne le patriarche de
cette branche familiale en 1928, le décrivant comme parcourant la brousse en mocassins et Cadillac
pour vérifier si les trains des billes coulaient sans heurts le long du Bandama jusqu'au
Port de Grand-Bassam. J'ai encore vu ce port en 1958, un océan d'acajou, de bossé, d'iroko, parfois
de billes si lourdes qu'elles flottaient sur deux autres billes sans quoi elles coulaient à
pic, le makoré entre-autre, le bois des cercueils de San Francisco. Le makoré qu'il faudrait
écrire Makoré pour la majesté de son être, j'en ai vu tomber un immense, à cette époque on trouvait
encore des billes de plus de trois mètres de diamètre. A l'époque j'en avais eu le souffle
coupé seulement par la grandeur de l'acte, mon oncle avait organisé un spectacle "à la main",
l'ancienne méthode de la hache, mais les tronçonneuses chantaient déjà leur musique morbide.
Hier l'émission de Ruth Stegassi parlait une fois de plus de cette forêt qui disparaissait en fumée
marchande. Je savais "qu'ils" avaient déménagé au Cameroun et au Gabon, après avoir tondu les
neuf douzième de la forêt ivoirienne (jugera-t-on un jour la mémoire de Félix Houphouet Boigny
pour cette haute trahison dont l'usufruit lui permit de se faire construire une clinique privée
des palais et des cathédrales grotesques ?). Et maintenant j'entends d'ici les moteurs rageurs
abattre comme du bétail les derniers hectares de forêt primordiale comme disait un ami
gabonais et le rugissement des grumiers halant vers la mer le produit du crime. "Avant", ces pays
d'Afrique centrale n'étaient pas assez rentables à cause du relief et de l'absence de grands
fleuves. Maintenant que l'AOF est chauve, tous se précipitent sur l'AEF. Et quand je dis tous,
je donne à Ruth une petite précision, c'est bien tous, même les Libanais qui en ont assez de
vendre des casseroles, des clous et des machettes. Pas seulement donc, les grands groupes anciens
clients des ci-devants Delmas Vieljeux, aujourd'hui Vincent Boloré, mais une nuée de petits artisans
du sylvicide.
1958, la vierge est encore là, la haute futaie, sorte de ventre maternel chaud, protecteur et
contrairement à ce qu'on pense, propre comme un jardin français ou une forêt allemande. J'ai
dix-sept ans et un sentiment mélangé de puissance devant cette destruction festive et d'incompréhension.
Je comprends si mal que les miens me virent, heureusement, j'aurais pu faire une carrière
dans le sylvicide, kapo en chef de l'anéantissement végétal. Et si "ils" m'avaient quand-même
coopté, malgré mes ami-ami avec les nègres et mon peu d'audace à criailler le burnous ? Car
on devenait très rapidement très riche, mais j'étais tellement con qu'il fallait m'expliquer
ce qu'était devenir riche alors qu'il suffisait que je consulte les étiquettes des Chateaux bordelais qui
défilaient sur les tables. Je reste suspect à moi-même, peut-être ais-je seulement été con ?
Aujourd'hui je ne peux plus écouter ces écolos me parler de ces massacres, leurs mots ouvrent
des plaies qui n'existaient pas. Penser à ces billes nues, sans leur aubier, comme
arrivant à Auschwitz, rouler vers les pays où en ferait des clotûres de jardin ou des lambris
de chalet de montagne. Même plus des cercueils ! Des lits de sipo peints en blanc pour bébé ?
Et ils parlent de législation ! Ces pays ne respecteraient pas les législations pourtant
existantes sur l'exploitation forestière : la soumission de la beauté du monde aux critères
de renouvellement des volumes de bois ? Transformer la forêt d'Afrique en forêt canadienne ou
suédoise ? Vous avez déjà vu ce qu'ils appellent forêt en Suède ? Des kilomètres d'allumettes
géantes, récoltables à 60 cm de diamètre pour le papier-cul, et ça repousse et ça repousse, comme
dans nos montagnes vosgiennes, au fond, hein ? Pas partout dans les Vosges, seulement en Alsace.
De l'autre côté du Bussang, j'ai encore vu des sapins bicentenaire, et ça jette, ça remémore,
ça dit notre histoire de constructeurs de galères pour...billes coloniales et "charbon". Mais
je ne suis pas naïf comme certains vertstueux de France-Culture, je suis certain que la vierge
n'est pas plus vierge que notre forêt vosgienne, qu'elle a été tracée, plantée, cultivée et aimée
pour des centaines d'années, comme nos maisons d'antan étaient construites pour dix générations.
L'homme a tout fait, tout créé et tout transformé dans ce monde, et lorsque les Blancs sont
venus raser la vierge, ils ont tout simplement volé le bien des nègres en croyant, ou en
faisant mine de croire - allez, mon oncle sortait d'une très grande Ecole - que l'on venait
prendre leur mauvaise herbe. Pour leur faire de belles plantations.
Le sylvicide se poursuit. Les chiens hurlent, la faucheuse passe, et bientôt quand vous
survolerez le Cameroun et le Gabon, et aussi la Centrafrique et le Congo, vous ne verrez plus
que du jaune verdâtre, de la savanne si tout va bien, un désert de latérite si le désordre
politique se perpétue comme avance la tonsure des collines. Omar ! o Omar ! J'ai formé trois générations
de jeunes gabonais et j'aime ta forêt, et j'aimais l'isolement d'Oyem six mois par an et le
silence des moteurs. Tu es aujourd'hui le Vieux de l'Afrique, le fils adoptif d'un grand
homme, Léon Mba, qui n'était même pas de ta tribu et qui t'a fait roi parce qu'il était un vrai
républicain et qu'il te pensait juste et intelligent, ardent défenseur des grands projets qui
n'ont jamais ou presque vu le jour. Tu ne vas rien faire pour défendre ta forêt parce que la
Kenecot ne veut pas que tu exploites ton minerais de fer ?
Tu vas laisser les dérouleurs de billes limer jusqu'à la trame le coeur de ton pays ? Au Cameroun
en Guinée Equatoriale, les moteurs ronflent à la demande internationale, et j'ai même appris
qu'ils se sont enfoncé jusqu'à Minkébé. Minkébé la ville sacrée des Fang devenue chantier
d'abattage pour la dernière vierge d'Afrique. Et tu laisses faire ? Minkébé, tu l'avais fait
rayer de la carte pendant ta guéguerre avec ces mêmes Fangs, et ce trait de plume l'avait
protégé des machines. Aujourd'hui la terre y saigne comme partout en Afrique, Caterpillar découpe
ta forêt comme un boeuf, en quartiers rentables et non rentables. Et que devient la forêt des
Abeilles ? L'impénétrable vierge où périssent parfois des aviateurs malchanceux ? Elle bourdonne
aussi du ronflement des tronçonneuses ? J'arrête, j'ai trop mal car sur ces images vécues, se
superposent celles de l'Amazone qui se décompose comme un géant criblé de balles. Attention
Omar, on posera un jour peut-être à ta mémoire la même question que pour Houphouet, étais-tu coupable ou seulement
responsable ?
Mardi 7 octobre 2003
Retour sur scène.
Curieux cette habitude que j'ai prise de mettre des titres à mes chroniques ! J'ai eu bien tort, car je me prive ainsi d'une liberté dans la liberté qui faisait sans doute aussi le charme de ce que j'écris ici. J'ose dire de telles choses car j'ai la statistique pour moi, na ! Retour a donc une signification très subjective, ce titre fait référence à ma guérison physique qui a fini par arriver et qui se manifeste d'abord en moi par la reprise du cliquetis de mon clavier de PC. Ce que j'écris n'est d'ailleurs jamais que du cliquetis, un peu comme la musique de celui que ma compagne appelle précisément Cliquetisman, à savoir un certain pianiste de charme pour salon de thé middle class. Moi mon salon ce serait plutôt un de ces amphis dans lesquelles nous conférions pendant les chauds mois de Mai 68. En passant, il me vient à l'esprit l'idée ou la constatation a posteriori que jamais les étudiants n'auront autant travaillé réellement que pendant ces semaines hors-temps social. Personne n'a fait de compte-rendu de ce qui s'est dit dans les salles et les amphis, et on se trompe en pensant que ces jeunes ne faisaient qu'imiter les meetings de la Mutu où on se contente d'écouter les leaders syndicaux ou politiques pour se rassurer.
Ce matin j'ai d'ailleurs déjà fait une partie de mon pensum quotidien, puisque désormais je fais aussi des brèves, histoire d'évacuer rapidement les montées d'adrénaline que me procure les bruits de la radio et de la télévision. Ici, au contraire, je peux redevenir moi, et apprendre à rester fidèle à ce qui se passe réellement dans l'homme que je suis. Et aujourd'hui je vais vous faire un aveu : je suis obsédé par la mort, pas par la peur de mourir mais par le désir d'en finir après tant d'années que je dois considérer tantôt comme des années d'enfer, tantôt comme des années de rab que je n'avais pas demandé lorsque j'étais encore dans la demande. Sûr, le traumatisme de l'été me fait réfléchir comme tout le monde, finir comme ces pauvres gens, non, jamais. Mais ce genre de dégoût ne m'a jamais convaincu, et je serais plutôt du type anti-euthanasie tant me paraît précieux le capital de conscience humaine. La vie des gens, c'est comme une somme d'argent que le destin collectif dépense comme il veut, en guerres, en négligences politiques et sociales, en crimes, avec cette différence abyssale que chaque conscience est aussi riche et aussi immense que le tout des autres. Je commence à comprendre le problème des rationalistes qui était la corrélation des monades pensantes, corrélation qui prend tout sons sens dans la vie collective ou en communauté. Tant que je suis seul, nomade, ma conscience est toute puissante, totalement libre de faire le monde qu'elle veut. Dès que je me rapproche des autres, je dois négocier ma vision parce qu'il y a une tendance de la volonté subjective à s'étendre au-delà de ses propres limites. La finitude n'est rien d'autre que cette nécessité de se corréler les uns aux autres, et donc la reconnaissance de cette finitude n'est en rien un parti-pris religieux ou métaphysique, mais simplement un acte, je dis bien un acte de bon sens.
L'idéalisme rationaliste me fascine en ce moment, parce que je travaille sur Renouvier et ses satellites, et je comprends enfin pourquoi nos universités des années soixante à aujourd'hui cantonnent leur enseignement dans la critique de la philosophie allemande : le rationalisme gène. Il gène tout le monde, les marxistes et les grenouilles de bénitier parce qu'il fait exister l'individu, la volonté personnelle et le libre-arbitre. Choses que toutes les métaphysiques transcendantales ne peuvent admettre ou digérer, sauf comme toujours Spinoza et les Eléates, en fait des rationalistes absolus. Nietzsche fut le pain béni pour un siècle où ce rationalisme gagnait du terrain partout en Europe, en France comme en Allemagne et ailleurs, il a écrasé de son poing de paysan tout l'édifice laborieusement construit par ceux qui pensaient, à juste titre, se contenter de cueillir les fruits du travail des grands idéalistes qui les ont précédés. Le nihilisme n'aura été rien d'autre que l'arme secrète de tous les Vatican du monde, un prêche destiné à la dissuasion nucléaire contre la moralité. Résultat : deux guerres épouvantables qui ont brisé toute résistance rationnelle. Mais on avait oublié que la Raison s'était réfugiée dans les choses, elle avait déjà acquis une vie propre dans la technique et s'il est toujours possible de manipuler les consciences humaines et leur souffrance, on ne peut pas remettre en question les finalités inscrites dans les objets de la teknè. Ce qui fait qu'aux lendemains de ces effroyables tentatives de génocide, le monde n'est pas apparu seulement comme un champ de ruines, mais comme une structure prête à recevoir tout en neuf, une structure prête à se reproduire, reproduisant ainsi le désir qui était présent avant, au moment où la technique avait encore pour finalité le Progrès. L'homme piégé par le progrès, c'est marrant. Mais si je me rappelle bien l'après-guerre, l'ordre républicain n'a jamais aussi bien fonctionné que dans ces années où la mémoire était encore toute fraîche pourtant des atrocités et du n'importe quoi moral de l'état, des autorités et même de l'Eglise ! C'était la force des choses. Aujourd'hui, cette force a perdu sa finalité, son " avant " n'existe plus, on ne construit plus un monde pour le meilleur mais seulement pour sa vente et sa rente. Grand danger à peine compensé par le retour de la Raison dans le langage et dans la conscience du plus grand nombre. Ce matin j'ai comparé ce plus grand nombre à des comédiens mobilisés pour jouer des pièces du genre RTT oui, RTT non. J'ai conclu qu'il ne faudrait pas que les metteurs en scène oublient que ces gens ont pris l'habitude d'enlever leur culotte pour un rien. A bon entendeur.
Mercredi 8 octobre 2003
Terminator.
Je me contenterais volontiers du titre aujourd'hui à propos de ce qui va de soi lorsqu'on met en relation ce mot avec cette date. Mais bon je suis là pour commenter alors commentons. L'Autrichien musclé a donc gagné son pari qui me rappelle cet empereur du cinq ou sixième siècle, originaire de Croatie et qui avait été élu par les légionnaires stationnés en…Autriche, uniquement parce qu'il avait plus de deux mètre vingt et qu'il était capable de tuer à peu près n'importe qui. Il n'a pas fait long feu malgré sa force et peut-être que ma comparaison est un peu exagérée, mais après ce qu'on a vu avec Reagan, je crois qu'il est impossible d'exagérer quoi que ce soit. La société du spectacle vient donc une fois de plus de pousser l'un de ses héros sur la scène politique, mais, cette fois il y a quand-même quelques circonstances qui donnent à réfléchir, et pas des moindres. Alors que l'Amérique se lamente déjà sur le fait que le pauvre Schwarzenegger ne pourra jamais se présenter pour le poste de président parce qu'il n'est pas né sur le territoire (ce qui ne saurait décourager un Tribunal Fédéral bien intentionné), il est temps de montrer pourquoi de toute façon il n'aurait aucune chance de réitérer l'exploit de celui qui a plongé la planète dans une tourmente qui est loin de prendre fin.
Mais avant d'en arriver là, il faut quand-même rappeler l'une ou l'autre chose, et notamment que c'est la première fois qu'un " recall " a lieu en Californie qui fait partie des quelques états qui possèdent dans leur constitution une disposition qui permet de telles élections anticipées. Voilà donc un exemple extrême de ce qu'est le fédéralisme américain, avec d'autres inégalités pires encore comme la peine de mort qui frappe ici et se retient là. Les Américains ne sont pas égaux devant la Loi, ce qui permet au crime de fleurir comme nulle part ailleurs. Secundo la cause de cette élection anticipée, qui est plutôt l'annulation d'une élection qui date d'à peine un an et demi, est d'ordre économique !!! Cela ne doit scandaliser que moi, car tout le monde trouve normal qu'on renverse un gouvernement pour cause de définit budgétaire. Alors je me demande ce qu'on attend pour renverser Raffarin et sa bande, car en termes de déficit, son gouvernement se pose là. D'autant plus que l'on connaît parfaitement l'origine de ce déficit qui n'a rien à voir avec les compétences du Gouverneur mais qu'il faut chercher dans les conséquences de la bulle spéculative du Nasdaq, la bourse qui a fait, un moment, la fortune de la Silicone Valley, région nord de la Californie qui ne s'est jamais remise de l'effondrement du marché boursier du High Tech. J'attends avec impatience les mesures de Terminator pour redresser la barre avec l'impression que les Californiens vont la sentir passer et sans doute regretter pour longtemps d'avoir cédé à la fascination de la gonflette. Tertio, il me paraît évident qu'il s'agit d'une manœuvre désespérée des Reps pour sauver la barque surchargée par Bush et qui va couler corps et bien dans les prochaines élections. D'ici là, Schwarzi aura eu largement le temps de faire la preuve de son incompétence, enfin de celles de son entourage qu'on est allé pêcher dans celui du dernier gouverneur Républicain de Californie, et ça date !
Bon, les choses sérieuses maintenant. Qui est Terminator ? C'est un Autrichien. Je n'ai rien à dire sur ses opinions, persuadé qu'il n'en a à peu près pas, et qu'il est un bon citoyen de Graz, nanti d'ambitions à la mesure des exercices qu'il faut accomplir pour développer une bonne musculature. Cela dit, en tant qu'Autrichien, il appartient à l'une des républiques les plus raffinées d'Europe, république qui tient en laisse depuis des années un authentique fasciste et dont la sociologie sort rapidement de la soupe de plomb dans laquelle l'avait plongée la collaboration massive avec le nazisme. Alors question : comment un homme, formé à l'école républicaine peut-il envisager la " gouvernance " à l'américaine ? Je ne mets pas en question son QI, connaît pas, mais il semble assez évident que son engouement pour la politique date réellement d'avant-hier, et qu'il n'a pas de grandes notions de ce qu'est la vie politique américaine. Par ailleurs il a une image immense à gérer, la seule chose qui le fasse être, ce qui exclut de facto qu'il se laisse conduire dans les méandres de la " démocratie " américaine qui ne manquerait pas de ternir cette image beaucoup plus vite qu'il n'a mis à la fabriquer. Comparons avec Reagan, puisque la comparaison semble bonne. Hé bien, contrairement à Terminator, Reagan n'était qu'un acteur de seconde zone, en tout cas jamais une star. Il faisait déjà de la politique syndicale du temps de Mac Carthy, et ne s'est pas découvert une ambition présidentielle du jour au lendemain. Or le boulot de gouverneur n'est pas vraiment le genre de fonction qui produise de l'image jour après jour. Le gouvernorat de Reagan n'a pas fait les Unes des médias. Seul Chirac a su gouverner Paris pendant de longues années tout en restant présent sur le petit écran grâce à ses petits copains et grâce au statut particulier qui fait de Paris à la fois une commune et un département. Bref, l'Autrichien, qu'on ne tardera pas à appeler ainsi comme on l'a fait de l'Autrichienne, va avoir à gérer l'absence de caméras permanentes. Au début ça va marcher, bien sûr, mais je ne donne pas deux mois au nouveau Gouvernator pour retourner dans l'ombre d'une fonction d'où il ne sortira plus que de temps en temps pour gracier ou non un condamné à mort. Et ça, ça ne plaira certainement pas à Terminator. Le Last Action Hero n'est pas prêt à accepter de devenir le héros des actions invisibles et je ne vois pas très bien où il va retrouver le talon du ticket qui doit le ramener à sa réalité.
Jeudi 9 octobre 2003
SECU : TOUS DES MENTEURS
La Sécu est un vrai cauchemar pour les journalistes, au point que pas un seul n'est en mesure de faire son travail proprement sur cette question. Chiffres, politique locales et lessivage, finalités, tout leur échappe par quelque bout qu'ils tentent de prendre le problème.
Les Chiffres : depuis des semaines toutes les ondes nous assènent des chiffres invraisemblables sur un fond rhétorique qui ne laisse place que pour une seule pensée : nous les citoyens sommes endettés à hauteur, selon certaines estimations, de 14 milliards d'Euros. Cent milliards de Francs et le compte est bon, allez ! QUI a vérifié ces chiffres ? OU peut-on vérifier ce chiffre ? QUI a fait la démarche d'expliquer clairement ce chiffre ? Personne et nulle part. A l'école de journalisme on vous apprenait, dans le temps, à vous servir du gros bouquin publié chaque année par la Documentation Française et qui s'appelle les Comptes de la Nation. Tous les chiffres sont-ils là ? Non. Les Comptes de la Nation sont un livre comptable, c'est à dire qu'il rapporte fidèlement ce qui rentre et ce qui sort. N'ayant plus les moyens pour me le payer, et vous pouvez être sûrs qu'il n'y a pas deux rédactions en France qui le possèdent et le mettent à la disposition de leurs journalistes, je ne peux que me souvenir des heures que j'ai passé pendant des années à essayer de mettre cette comptabilité en relation avec l'actualité : impossible. En gros c'est simple, ce livre très officiel et qui ne peut pas mentir, ne ment pas. Mais il ne fait que donner des chiffres comptables sans la moindre explication ni le moindre détail. Exemple : la Caisse Maladie rentre tant et tant de milliards de cotisation et dépense tant et tant de milliards. Déficit, tant et tant. Je crois qu'on va même jusqu'à vous donner la part patronale et la part des salariés, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est la part des patrons qui ne payent pas, qui n'ont jamais payé, qui ont mené leur barque avec ou sans la complicité des gouvernements centraux et locaux et ont coulé sans avoir jamais assuré leurs responsabilités URSSAF. Les syndicats, eux, ont les chiffres, mais ne les sortent que dans leur stratégie propre, dans leurs secteurs choisis et dans les corporations qui les intéressent momentanément. Jamais ils n'ont osé, et ils ne peuvent pas le faire à cause de leurs divisions, faire l'addition de la dette du Patronat, qui est un océan d'Euros. Nous les salariés, je peux vous garantir que nous payons rubis sur l'ongle tout au long de notre vie.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce quel le sport national, encouragé par les syndicats de PME-PMI, qui consiste à faire tourner une boîte pendant deux ans, c'est à dire pendant la période de dispense de charge, puis à la fermer brutalement pour la rouvrir ailleurs à zéro, nous coûte en cotisations patronale une fortune chaque année. Vous y additionnez les dispenses de charges décidées au plan régional ou local pour attirer les entreprises, les charges qui ne sont tout simplement pas payées par des patrons rarement poursuivis parce qu'il n'y a pas de personnel pour les poursuivre, et encore les non-cotisations des salariés au black et vous obtenez une somme mystère que personne n'a jamais à ma connaissance cherché à rendre publique. Oh, il est vraisemblable que quelque part à Bercy et même aux Hautes Etudes, il y a des rapports dans les tiroirs qui reflètent assez bien tout cela, mais c'est top secret, et ces rapports vous ne les connaîtrez jamais. TOUS DES MENTEURS, intentionnels ou par omission. Ce matin la Sécu était le sujet de France-Culture. Je n'ai pu écouter que pendant une demi-heure environ, et qu'ai-je entendu ? Des conneries sur notre " système de santé " qui est à revoir entièrement et bla bla bla et bla bla bla. Tout le monde est coupable, les citoyens en premier, bien entendu, ensuite dans l'ordre les médecins, puis les laboratoires et enfin l'état ! Incroyable alors que normalement l'état n'a RIEN à voir avec la Sécu étant donné qu'il s'agit d'un organisme paritaire que je ne sache pas que l'état à pris définitivement en charge. Pourquoi y met-il son nez ? Parce qu'il faut bien une autorité pour aller piquer l'argent dans la poche des citoyens, et que pour cela, il n'y a que le législateur et les services de police.
Voyons à présent le " système ". Le système est une lessiveuse, car vous l'ignorez peut-être, mais nous sommes entrés dans l'ère des lessiveuses financières. Alors comment ça marche ? C'est simple, les patrons et les syndicats laissent la dette enfler et ils peuvent le faire grâce aux banques qui banquent sans broncher, puisqu'elles savent qu'en dernier ressort il y a tout un troupeau de mouton à tondre pour rentrer dans ses fonds, capital et intérêt. Avec la complicité de l'état. La lessiveuse c'est simple : La Caisse emprunte aux banques ou, si elle le peut, à la Caisse de Dépôt et Consignation qui, elle, se retourne de toute façon vers les mêmes banques. Or, ces banques appartiennent toutes à des groupes financiers dont les grands laboratoires et les grands fabricants d'appareils médicaux (le total de ces deux rubriques constituent l'essentiel de la dette) sont les plus importants actionnaires. Autrement dit, les laboratoires se donnent à eux-mêmes leur propre argent augmenté du bénéfice des opérations et des intérêts bancaires. Le centre névralgique du système s'est l'Hôpital, bien sûr, et les hôpitaux font depuis plusieurs décennies maintenant comme tout le monde, ils privatisent tous les services annexes : hôtellerie, lavage, entretien, informatique etc… Ce qui a fait passer la journée d'un malade d'environ 300 f en 1965 à 3000 f aujourd'hui (en francs constants, bien sûr). Ce qui fait de notre " système de santé " une énorme lessiveuse, mais l'image ne me plaît pas, car cette lessiveuse ne se contente pas de nettoyer l'argent, mais elle le multiplie, elle le fait gonfler comme de la levure en faisant gonfler la dette, dette exclusivement supportée par les salariés, le patronat comme on l'a vu paye quand il veut et comme il veut, y compris sans doute les grandes entreprises qui ont des comptabilités tellement complexes qu'il faut au moins deux ans à une équipe d'experts-comptables pour en faire le tour.
J'en finis avec la finalité de ce cauchemar, parfaitement évitable. Car ce que vous avez compris comme moi, c'est qu'il est arrivé à la santé depuis longtemps ce qui est arrivé à l'eau et qui va arriver à l'électricité, aux transports, au gaz et à tout ce qui était du ressort de la collectivité et du service public. Le démantèlement de la République, voilà le mot final de ces crises qui forment notre terrorisme à nous, le terrorisme d'état dont nous sommes et serons de plus en plus ouvertement les victimes jusqu'à présent consentantes. Latifundia delenda sunt : il faut détruire les grandes propriétés, c'était le mot d'ordre des républicains romains qui voyaient la République vendue morceau par morceau aux grands propriétaires latifundiaires. Il faut détruire les groupes financiers dans lesquels un petit actionnaire minoritaire peut décider de tout parce qu'il est actionnaire majoritaire dans la ou les banques qui financent le groupe. La dette de la Sécu ne provient pas des malades, elle est fabriquée de toute pièce par des acteurs privés qui parasitent le système de santé avec la complicité des politiques. La seule chose qui est restée naturelle dans cette histoire de la santé des Français, et cela vous pouvez le constater dans ce grand livre dont je vous ai parlé, les Comptes de la Nation, c'est que les gouvernements de gauche parviennent parfois, comme dans les années 80, à l'équilibre et même à des soldes positifs dans la branche maladie. Pourquoi ? Parce que les gens sont moins malades dans l'ambiance de gauche que dans celle de droite. Lequel de nos gentils journalistes va aller nous faire une beau documentaire sur cet étrange phénomène ? Aucun. Moi si on me payait, je pourrais le faire, mais personne n'achèterait ni ne publierait mon rapport, alors…
Samedi 18 octobre 2003
La question de l'Amérique.
On devrait dire les questions de l'Amérique, mais j'ai voulu simplifier et désigner seulement cette question : le monde est-il devenu américain, la puissance de cette " nation " lui donne-elle tout pouvoir sur le monde, comme on aurait pu dire, du temps d'Auguste que le monde était romain ?
A deux tout récents événements qui permettraient de répondre positivement à cette question, vient de s'ajouter le piteux comportement des trois derniers opposants qui comptaient encore à savoir celui de la France, de l'Allemagne et de la Russie. Du moins en apparence, car l'affaire de la résolution de l'ONU que viennent d'accepter ces trois pays demande réflexion. Les deux événements auxquels je fais allusion sont caractéristiques de la politique impérialiste américaine pour ce qui concerne leur zone d'influence comprise dans la doctrine Monroe, c'est à dire les Amériques. On a vu ainsi Washington soutenir sans honte et ouvertement l'opposition vénézuélienne qui demandait par des manifestations violentes la démission du Président Chavez. Je me demande d'ailleurs encore aujourd'hui comment ce rude bonhomme a réussi à échapper à cette sorte d'attentat qui le menaçait de l'intérieur et de l'extérieur. Si l'Amérique Latine trouve demain un chemin vers un monde auquel nous autres, républicains, n'osons même plus songer, ce sera en grande partie dû au courage et au génie de Chavez. Non seulement il a résisté à tous les dangers, et dieu sait si l'opposition, aidée par tous les services secrets américains, a bien imité les Chiliens de 1973, mais il a osé, récemment, aller serrer la paluche à Fidel Castro, devenu lépreux depuis quelques années maintenant, même sur France-Culture. Cette radio de service public, devenue radio d'état, continue de parler de GW Bush comme d'un homme politique qui a droit à tous les égards malgré l'accumulation de crimes contre l'humanité à côté desquels ceux de Castro ressemblent à des bonnes actions, et dégueule, jour après jour, sur Cuba et son gouvernement. Mais c'est un phénomène que j'appellerais la " Glücksmania ", c'est à dire un mouvement de compulsion lié à un sentiment de culpabilité tellement ancien qu'à l'instar d'une selle desséchée, il n'arrive plus à passer. Glücksmann est douloureusement hanté par son péché de jeunesse stalinienne et ne sait plus comment se purifier (ce qui est impossible, car on ne peut pas avoir été stalinien et cesser de l'être, c'est triste mais c'est ainsi), France-Culture n'arrive pas à se débarrasser de la hantise de ces programmes qui osaient regarder Cuba d'un autre œil que Washington et ses valets. Bravo donc, Hugo Chavez et bonne chance pour la suite.
Or voici que le peuple bolivien se soulève exactement comme le " peuple " du Vénézuéla contre son Président qui veut brader le gaz, la principale richesse du pays et en plus priver les paysans de leur principal revenu, la culture de la coca. Réaction de Washington ce matin : Halte là, nous soutenons le président constitutionnellement élu, point basta. Que pourront faire les Boliviens contre l'autorité du Président " légitime " aidé par le Pentagone et la CIA ? C'est ce que nous verrons dans les jours à venir. Mais vous avouerez que ces deux exemples peuvent laisser perplexe le moins fanatique des républicains, le plus mou démocrate que l'on puisse imaginer. Ce n'est ni plus ni moins qu'une politique despotique qui décide selon ses intérêts du destin des autres. La Doctrine Monroe a la vie dure. Mais je me sens assez guilleret pour ce qui concerne le continent latino-américain, car de Lula à Chavez et quelques autres, le trouve que les affaires tournent plutôt dans le bon sens.
Et puis ce matin on apprend qu' ILS ont obtenu l'unanimité au Conseil de Sécurité pour leur Résolution concernant l'Irak. Même Chirac, que j'avais félicité ici même pour le courage qu'il a montré en refusant d'aller en guerre au son de la trompette yankee, a signé. De même que ses deux acolytes allemands et russes. Bon, il faut voir ce que contient cette résolution, présentée comme un fantastique succès américain, et il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les trois ex-opposants se sont finalement résolus à approuver le texte. Je viens d'entendre d'abord qu'apparemment cette résolution n'oblige personne à payer ou à envoyer des troupes, ce qui n'est déjà pas mal. Il s'agirait, mais nous le saurons dans les jours à venir, d'un blanc-seing tout à fait platonique qui signifie que la Communauté Internationale ne s'oppose plus à ce que la " Coalition " des guerriers qui ont démoli l'Irak continuent d'en gérer la " reconstruction " et de contrôler la situation politique. Bof, je ne sais pas s'il y a de quoi fouetter un chat, surtout lorsqu'on connaît le destin ordinaire d'une Résolution de l'ONU qui est de rester lettre morte. Les trois européens ont-ils voulu sauver l'ONU, donner à Koffi Anan une chance de sortir le machin de son rôle d'enregistreur des décisions américaines ? Je ne sais pas, mais je suis à peu près sûr que Bush a mis tout son poids dans la balance, c'est à dire qu'il a montré toutes ses dents à ces trois trublions, et il n'est pas impossible que ce spectacle leur ait fait peur. Ce qui serait au moins inquiétant. Cela donnerait un petit air de Munich à cette nuit agitée qui s'achève par le soulagement bruyant de ceux qui viennent d'annexer l'Irak, se proposent d'en faire autant de la Syrie, de l'Iran, de la Corée du Nord et de tout ce qui bouge, quoi.
Jusqu'à présent, mon scénario (plus ancien que le Onze Novembre) se déroule comme prévu, c'est à dire que le fossé Atlantique se creuse cependant que l'unification politique de l'Europe s'accélère. Le fait que Schroeder ait donné carte blanche à Chirac pour le représenter à Bruxelles est ce qu'on appelle un saut qualitatif dans l'évolution européenne. Cela signifie très exactement que les Français et les Allemands ont des intérêts désormais communs, vraiment communs. Jusqu'à une époque pas si ancienne, Berlin avait plus d'affinité avec Washington qu'avec Paris, malgré toute la pompe gaullienne, giscardienne et mitterrandienne pour montrer le contraire. Cette fois, je pense que les choses ont radicalement changé, ce qui me fait espérer que la décision prise au Conseil de Sécurité n'est qu'un piège à con, comme on dit, c'est à dire une manière de laisser les Américains penser qu'ils sont toujours les patrons, ce qui ne mange pas de pain même si les projets européens ne correspondent pas du tout aux desiderata de la Maison Blanche. Par ailleurs, 2004 sera année électorale aux States, et il y a fort à parier que ce sera la fin de la carrière de Bush et de son clan. Alors à Paris, Berlin et Moscou on a raison de penser à ce qui va suivre ce crash politique prévisible et qu'aucun Schwarzenegger ne parviendra à empêcher. A ce propos je viens de voir sur CNN la première image de Bush donnant une chaude accolade à Schwarzi devant quelques centaines de fans, ce qui me confirme dans l'idée que cette candidature est une idée du clan Bush. Lorsqu'on ne sait plus quoi faire en politique, on se tourne vers les arènes. L'Amérique est riche en jeux de toute sorte, mais malheureusement le pain manque à des dizaines de millions de citoyens, sans parler de leur couverture sociale ou de leur retraite. Et, pauvre Bush, même le Sénat devient méchant qui refuse d'admettre que les dépenses militaires soient classées dans le budget, devenant ainsi des dettes supplémentaires pour l'administration en quasi faillite.
Alors, revenons à la question première. Pax Americana ou pas ? Il y a dans le monde un certain nombre de casus belli prêts à fonctionner du jour au lendemain, sans parler des causes mobiles et accidentelles comme le crash d'un avion militaire américain descendu par un missile égaré. Le tout premier est Taïwan. Cette île de la Mer de Chine, que l'on appelle le porte-avion des USA, est un paquet de dynamite prêt à sauter, de même que Hong Kong et la Corée du Nord qui vient encore ce matin de dire qu'elle est prête à montrer ce dont elle est capable si on doute de sa puissance nucléaire. Il y a ensuite quelques îlots toujours prêts à servir de détonateur lent ou rapide, selon les besoins. Il y a d'abord les Kouriles, pomme de discorde apparente entre Moscou et Tokyo, mais qui à ce titre demeure un risque pour les relations russo-américaines. On se souvient du Boeing 747 abattu par les Mig russes au-dessus de cette zone, faisant quelques quatre cents morts, parmi lesquels une petite centaine de spécialistes de la CIA installés dans une annexe spéciale de l'avion. Mes îles préférées sont les Spratleys, anciennement dénommées îles Paracels. Il s'agit en fait de quelques rochers à fleur d'eau sous lesquels on peut toujours soupçonner l'existence de fabuleuses réserves de pétrole pour en faire un trésor d'Ali Baba. L'importance des Spratleys ne provient cependant pas de là, mais du nombre de pays impliqués, c'est à dire qui en revendiquent la propriété. Vietnam, Chine, Indonésie, Malaisie, Singapour aussi je pense, et puis le Myanmar, ex- Birmanie, pays des gentils généraux qui maintiennent en prison la méchante Prix Nobel de la Paix Hang Seng Su Shi. A la Maison Blanche on a donc le choix. On peut appuyer sur n'importe lequel de ces boutons pour déclencher l'Apocalypse.
Or, si je pense que c'est bien dans les espaces que je viens de décrire que se passera l'explosion, je crois que les causes seront, elles, ailleurs. L'Amérique est en train de créer un front anti-occidental comme il n'en a jamais existé. La Conférence des Etats Islamiques qui a commencé hier va nous montrer à quel point les conneries de Washington ont pour ainsi dire ressuscité la tension que libère la religion musulmane dans ses phases de conquête. Mais pour la première fois dans l'histoire mondiale, nous risquons d'assister à une guerre de religion entre deux religions de même contenu théologique. C'est fabuleux, non ? Comment cela ? Je viens de découvrir dans une étude de Charles Renouvier, philosophe rationaliste du 19ème siècle une passionnante thèse selon laquelle l'Islam ne serait qu'un arianisme exacerbé. Or la plupart des sectes évangéliques américaines ne sont que des résurgences lointaines des hérésies combattues par le Catholicisme, dont l'arianisme fut sans doute la plus puissante. Les ariens furent les grands perdants du fameux Concile de Nicée qui, en 325 après JC, a décidé des dogmes fondamentaux de l'Eglise, c'est à dire de l'ensemble des évêques (évêques = episcopoï = surveillants) qui " surveillaient " les Chrétiens répandus dans tout l'Empire Romain depuis que Constantin avait fait du Christianisme la religion de l'état romain. Le dogme de la Trinité, c'est à dire de la divinité du Christ, fut adopté contre celui des ariens qui refusaient d'admettre que le dénommé Jésus était de nature divine. Les Musulmans pensent exactement comme les ariens, que le Christ n'est qu'un homme, prophète certes, comme Mahomet, mais seulement un homme. Et un tel dogme change tout dans l'influence qu'il exerce non seulement sur la liturgie, mais évidemment sur les mœurs et la politique des collectivités qui l'adoptent. Ajoutons à cela que la plupart des passagers du Mayflower et donc des milliers d'Européens qui ont émigré vers l'Amérique, étaient des Chrétiens hérétiques et poursuivis comme tel par tous les pouvoirs catholiques ou assimilés. Parmi eux, les ariens continuaient de dominer, car l'arianisme implique un égalitarisme naturel cependant que le dogme de la Trinité permet la légitimation des princes et de leur droit divin.
Exceptionnel ironie et paradoxe de l'Histoire. Tellement exceptionnel que je me demande si cette sorte de double négation n'est pas un résultat, c'est à dire si elle ne fait pas partie d'une évolution logique. Je ne crois guère en général aux évolutions progressives et aux évolutions rationnelles dans l'Histoire, mais cette étrange conjoncture qui se prépare, à savoir cette croisade à l'envers entre l'Islam et l'Amérique et qui risque bien de passer au-dessus de notre vieille Europe, où de la contourner par l'Asie dont une immense partie s'est laissée séduire par l'Islam, me paraît entrer dans une certaine logique. Celle-ci impliquerait une autre idée, tout aussi étrange, à savoir que la laïcité, qui est précisément ce qui pourrait mettre l'Europe à l'abri de ce prochain orage, est en réalité liée au catholicisme comme sa conséquence, ou comme la conséquence de son impuissance à se réformer. On sait que dès 1517, le premier pape, Adrian 6, qui eût à affronter Luther et les princes allemands, s'était empressé de reconnaître tous les torts de la papauté et du catholicisme en général, et avait promis un Concile destiné à faire le ménage dans l'Eglise. Ce pape mourut trop vite, un an plus tard, et n'eût pas le temps de réaliser cette réconciliation politique avec l'Allemagne qui aurait pu aboutir à des modifications dogmatiques importantes, et Rome demeura Rome. Le Catholicisme ne chercha jamais plus à se rapprocher des réformés, et s'adapta aux heurts et malheurs des guerres européennes de Charles Quint jusqu'à l'époque moderne. Au 19ème siècle, en France, elle fit pire encore, elle tira tout ce qu'elle put de profit de la Restauration, ou des restaurations successives pour humilier un peu plus chaque jour (voir la construction de la Basilique de Montmartre en expiation du crime de la Commune de Paris) le peuple apparemment vaincu. Le résultat fut la Troisième République et en 1905, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, chose impensable dans l'ordre universel, si impensable que même les Protestants d'Europe continuèrent à associer leurs églises aux états auxquels elles appartenaient. La Suède a décidé de la séparation de son église de l'état pour l'an 2004. En Allemagne, les églises ont une place dans tous les rouages de l'état et des médias. Mais la laïcité a travaillé en profondeur les peuples d'Europe et je suis assez confiant de voir notre future Constitution européenne exempte de toute référence à l'au-delà. Un dernier mot sur cette laïcité. La laïcité n'est pas l'interdiction des religions, elle est sa relégation dans les affaires intimes de chacun, au fond elle est l'essence même de la liberté de penser. Loin d'être une idée neuve, elle était la réalité spirituelle de l'Antiquité, et aussi celle de grands Empires comme la Chine dont les gouvernements ne s'occupèrent que très rarement de religion. Ils ne s'en occupèrent que dans les conjonctures où la puissance du clergé bouddhiste devenait un danger politique interne. Aujourd'hui, il n'y a guère de pays plus laïque que la Chine, car le communisme a fini par se désintéresser de la question religieuse et chacun peut aller faire brûler les cierges qu'il veut dans les grottes de sa préférence.
Mardi 21 octobre 2003
Capitalisme or not Capitalisme ?
Décidément la BBC ose, comme dirait El Kabbach, elle ose tout, y compris remettre en question le capitalisme. Depuis quelque part dans un bâtiment proche de la City, cet antenne a le culot de mettre en question ce que l'on croyait depuis longtemps devenue l'évidence, une telle évidence que Mitterrand a rayé des mots d'ordres du socialisme le combat contre le capitalisme.
Mais hélas il faut bien constater la pauvreté du débat engagé en deux partie, la première pour l'attaque et la seconde pour la défense du… capitalisme. Alors essayons honnêtement de résumer cet affrontement, si on peut appeler cela un affrontement. Tout cela se passe entre ma chère Lise Doucet de Hard Talk, que vous allez commencer à connaître depuis que je vous en parle et que je vous conseille de regarder fidèlement car c'est sans doute la meilleure émission de télévision qui existe actuellement dans le monde, rien que ça, et deux représentants du pour et du contre.
Le contre, puisque Lise a choisi de commencer par le contre (ce qui est un choix éditorial pourrait-on critiquer, puisque cela revient à laisser le dernier mot à l'adversaire). Un jeune homme dont je n'ai pas pu relever le nom, mais qui est fort connu de l'autre côté du Channel pour ses positions théoriques socialistes. Thèse : le capitalisme paupérise le monde. Au fond, toute la critique actuelle du capitalisme tourne autour de l'échec de la politique d'après-guerre qui a consisté à tout faire pour démontrer que Marx a eu tort de prophétiser la paupérisation absolue (devenue entre-temps relative) du monde sous la férule du capitalisme. Et de donner des chiffres que tout le monde connaît sur l'extension de la pauvreté en Afrique, en Amérique Latine et même jusque dans nos propres démocraties. A quoi notre chère Lise n'a pas eu beaucoup de mal à aligner une série d'arguments sur le partage mondial de la richesse qui s'opérait sous l'empire du marché. L'enrichissement de l'Asie qui contraignait l'occident à faire des sacrifices, exemple la Corée du Sud, hier encore pays misérable au nième rang de la misère, aujourd'hui sept ou huitième puissance mondiale, etc.. Réponse ultime : dans quelles conditions et à quel prix pour nos propres prolétaires ? Précarisation des destins humains, régression sur tous les acquis sociaux, et paupérisation continue pour des continents entiers comme l'Afrique frappés de surcroît par la maladie auquel le capitalisme refuse les médicaments qui pourraient sauver des millions de vies humaines. Bref on a tourné en rond sur ce thème, mais je n'ai rien entendu sur une dynamique théorique, sur la véritable essence du capitalisme dont notre socialiste ne retient que la parole d'Adam Smith disant que le capitalisme était un système dans lequel il y avait des pauvres destinés à vivre au service des riches.
S'il n'avait dit que cela ! L'autre personnage, chargé de défendre le capitalisme était absolument délicieux à voir et à entendre. Une dame dans la cinquantaine bien tassée, tranquille comme une adorable mamy, mamy qui avait passé son existence dans les bureaux du FMI, de la Banque Mondiale et dans les divers cabinets des ministères (conservateurs) de sa Majesté. Evidemment, Lise n'a pas résisté à citer la phrase d'Adam Smith en ouverture d'interview, citation qui a fait sourire notre égérie du capitalisme qui n'a pas eu de mal à signaler que de telles citations possèdent des contextes et qu'il ne suffisait pas de les utiliser à sa guise pour juger leur auteur. Exact. Cela dit, l'argumentation de la dame ne manquait pas de force. Son argument était que le capitalisme était bien le seul système capable d'enrichir les hommes du monde entier et d'amener ce qu'on appelle le Progrès, à condition qu'il soit politiquement accompagné. La paupérisation, dont Lise ne faisait pas cadeau, serait due aux mauvaises conditions politiques dont souffrait le capitalisme. A un certain moment, elle a failli dire qu'on ne pouvait rien " contre " la démocratie qui bouleversait sans cesse les données du marché et qu'il fallait bien faire avec des nations qui ne respectaient pas les règles du jeu capitaliste, dumping, protectionnisme etc… la rengaine, quoi. Donc, l'OMC et rien que l'OMC, mais une OMC réglo, qui ferait appliquer comme la déesse Justice elle-même les règles du vrai capitalisme.
Quelle pauvreté dans le capitalisme et dans l'anti-capitalisme ! Comme si le capitalisme était autre chose qu'une invention farfelue d'un certain Karl Marx, alors que le monde allait son train d'enfer, sans demander son reste. Pour répondre à ce qu'est le capitalisme, j'ai presque envie de vous montrer une de mes croûtes qui représentent trois maisons alsaciennes, une vraie croûtes, sauf que l'idée qui a surgit dans ma perception de ces trois baraques m'a pour ainsi dire porté à la contrainte d'en rendre compte picturalement. Qu'avaient-elles de si particulier, ces masures du 16 ou 17 ème siècle ? Une seule, l'une d'entre-elles était pour ainsi dire authentique, elle portait son âge dans toutes ses imperfections anti-capitalistes et dans toute sa beauté paysanne, alors que les propriétaires des deux autres maisons à colombage avaient suivi le temps du capitalisme, ils avaient fracturé le temps comme des voleurs, vandalisé la réalité en remplaçant des vitres en verre étalé par du vitrage en verre étiré ou, pire, par des faux carreaux colorés à bordure dorée. La terre mélangé de mortier et de papier journal était devenu des briques masquées par du béton à son tour coloré aux couleurs supposées de l'ancien temps ! Quelle horreur ! Autour de ces monuments chaudement rénovées à l'intérieur au point de ressembler à des intérieurs de villas contemporaines, des jardinets nickel, aux couleurs de joie supposée offertes par les fleurs et un beau grillage en plastic jaune du plus bel effet. Voilà le capitalisme, ma chère Lise, mais pour que tu comprennes cela, il faudra sortir de ton empirisme british, de ton capitalisme génétiquement intégré dans ta culture, que dis-je dans la structure de ce qui te tient lieu de pensée.
Toi lise, tu nous avances des chiffres du présent, tu gémis sur le sort des miséreux sans te douter qu'on ne fait que ça depuis des millénaires sans parler de capitalisme. Toi, l'autre avocate de Wall-Street tu parles d'une justice des pratiques commerciales, cause de milliers de guerres depuis le néolithique, et tu crois que l'OMC, ce supermarché de la camelote américaine, va nous apporter cette justice du véritable capitalisme ! Quelle triste rigolade ! Et vous prétendez traiter la question du capitalisme ? Sans même qu'aucun de vous, sauf peut-être le petit socialiste tristounet, n'ait lu le Capital et compris ses nuances qui n'ont rien à voir avec ce que vous nous en dites les uns et les autres ?
Mais soyons plus précis, puisqu'il faut l'être :
il n'y a pas de capitalisme
. Et d'un. Il n'y a pas de capitalisme car ce mot ne recouvre qu'une tentative de rationalisation post festum, après-coup, de tous les crimes politiques commis sous son label, l'écrasement des peuples, l'anéantissement de leurs possibilités d'existence libre de toute dépendance et de toute servitude. Le capitalisme est de part en part un phénomène politique, ce que la dame qui ne démordait pas de la positivité de cette théorie n'était pas loin de reconnaître, mais il fallait faire un effort et ne pas prendre les téléspectateurs pour des imbéciles. Le capitalisme est cela même qui empêche l'existence d'un marché pur de toute manipulation, du vrai marché dont parlait Adam Smith. Et pourquoi cela ? - Oh combien de fois ne l'ai-je pas rabâché ici dans ces chroniques ? - ¨Parce que les états ont des monnaies qui sont comme leurs canons ou leurs missiles, des armes qui faussent constamment les véritables données du marché. Mais je vais encore une fois faire un effort pour vous faire comprendre encore mieux comment ça marche, cette histoire de monnaie, effigie du pouvoir politique, symbole actif de l'action réelle qu'exerce un pays sur un autre.
Il n'y a plus de capitalisme au sens d'Adam Smith, parce que du temps de ce bon monsieur, il y avait une monnaie mondiale, l'or, et son siècle et celui qui a suivi ne furent pas pour rien les âges d'or du commerce international et mondial : pourquoi ? Parce qu'il y avait un étalon universel de la valeur d'échange, comme du temps des Grecs dont la monnaie étaient devenue un moyen d'évaluation universel. Le temps présent se caractérise par l'absence totale de monnaie universelle, et si on vient me dire que le dollar est l'étalon mondial des échanges, je pique ma colère habituelle car le dollar fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut, ce qu'aucun équivalent général comme l'or ou l'argent ne peuvent faire lorsqu'ils figurent dans les colonnes mouvantes des bourses. Oh le dollar aussi bouge dans ces mêmes colonnes, mais derrière ses mouvements, il y a les décisions de Monsieur Volcker ou de l'actuel président de la Fed, comme disent les initiés. Lorsque ce monsieur, dont le nom me reviendra, décide la hausse ou la baisse des taux, le dollar se métamorphose, et adapte les besoins immédiats de l'empire américain à la conjoncture mondiale dont l'Amérique se fout, pourvu qu'elle s'en sorte. Bon, il est vrai que depuis la naissance de l'Euro, les choses ne sont plus aussi simples qu'avant, mais justement, monsieur Greenspan, ça y est j'ai retrouvé son nom, manœuvre précisément pour affaiblir les positions européennes, soit en renforçant l'Euro, ce qui handicape le commerce extérieur européen, soit en l'attaquant de front (comme il a fait pendant les deux premières années sauvagement avec la ferme intention de liquider l'Euro qui a résisté), c'est à dire en l'affaiblissant, ce qui handicape de l'autre côté le marché financier européen. Comment ? Tout simplement en faisant fuir l'argent ailleurs, et là où va l'argent, va la prospérité. Bref, ceux qui peuvent faire bouger le dollar (politiquement), peuvent foutre la merde, excusez l'expression, sur l'ensemble du marché mondial. On dira que c'est le capitalisme puisque Marx lui-même disait, à juste titre, que l'argent était aussi une marchandise, et qu'à ce titre elle avait aussi le droit à se mettre en concurrence avec les autres. Sauf que l'argent est une prérogative de l'état, et donc échappe au capitalisme lui-même, c'est à dire aux mouvements des richesses privées. Et toc !
Mais pour en finir, je vais revenir à mes maisons. Vous comprendrez, ou vous sentirez mieux ce que je veux dire, lorsque je dis qu'il n'y a pas de capitalisme. Mon tableau représente donc trois maisons, dont la plus ancienne qui est presque devenue une ruine, est au premier plan, elle attire tout le regard, effet recherché par le peintre. Et pourquoi produit-elle cet effet ? Parce qu'on y perçoit le temps humain. Or le temps humain est ce qui est en train de disparaître corps et biens par le phénomène de ce qu'on appelle à tort le capitalisme. Le phénomène de la capitalisation de la réalité, c'est à dire de sa transformation en capital, entraîne progressivement la disparition du temps humain, du présent : toute la réalité devient planification du futur en vue du profit. Dans la vieille maison, on peut percevoir le désir charmant de donner à la fenêtre de la cuisine, un aspect particulier avec, déjà à cette époque, le souci de laisser à cette ouverture de la maison, une faculté particulière de s'ouvrir partiellement pour laisser sortir la vapeur sans pour autant tout ouvrir en grand, parce que la chaleur était une marchandise chère. Mais, plus expressives sont les solives ou les poutres qui forment le colombage, colombage qui dans les deux autres masures ont été entièrement refait au carré, en pin laminé et traité. Non, dans ma maison, enfin celle de mon copain, les colombages contiennent toute une histoire d'inégales découvertes, de changements en cours de construction, de bricolage temporel parce qu'on ne visait pas le profit ou seulement une habitabilité déterminée par le marché immobilier, mais la durée la plus longue possible pour les générations à venir. Il faut voir l'épaisseur des solives en châtaignier, ce bois inaltérable qui grisonne comme nos cheveux sans perdre de sa solidité et qui promet des millénaires de présence tranquille. Bien sûr, comme dans les cases gabonaises, la matière qui remplit les vides du colombage sont, elles, conçues pour être entretenues régulièrement, dans ces maisons seuls comptent les colombages, comme une structure éternelle que l'on peut habiller comme on veut au cours des siècles. Et mon copain a fait du beau boulot, il a fait des " glaces " (cela s'appelle ainsi) d'un rose tendre qui donne à sa baraque un air pimpant sans lui enlever son âge vénérable qui inspire le respect. Le capitalisme, c'est ce qui a balayé cette philosophie de la vie pour en faire une machine à extruder du profit quoi qu'il arrivent aux humains qui fourmillent autour de la machine à extruder. Leur présent n'a aucune importance, et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui sous le nom sophistiqué de " précarité ".
Un dernier mot, quand-même. Le mot capitalisme vient de capital qui signifie à l'origine bétail. C'est donc un concept d'éleveurs nomades, capital = cheptel. Ce dont il faudrait parler aujourd'hui, c'est du fait que ce sont les hommes qui sont devenus le cheptel. Il y a eu une perversion de la réalité qui fait que le souci de l'homme n'est plus de s'installer dans la réalité pour la questionner, car elle ne va pas de soi, mais d'installer des machines à avaler le temps humain, une machine qui va interdire bientôt à tous les hommes de seulement songer à s'installer, avec tout ce que comporte cette notion d'installation. Ma compagne est institutrice de maternelle, et son expérience quotidienne lui a depuis longtemps enseigné que le capitalisme ne permet même plus aux parents d'être là pour leurs plus jeunes enfants. La terreur engendrée par la rareté du travail et par sa gestion scandaleuse déchire les familles, les couples, détruit tout ce qui fait l'homme autre que l'animal. Le " capitalisme " n'est pas la conséquence du protestantisme, mais alors pas du tout. Il est au contraire le fils direct du principe de la Trinité catholique qui contraint l'être humain à abandonner son propre destin au profit de celui d'un autre. La soumission à la divinité du " Seigneur " implante dans le cœur de l'homme le gène de la soumission en tant que tel : le capitalisme n'est rien d'autre qu'une forme historique de la Mafia, et encore de la mauvaise mafia, de celle qui dérogea elle-même à ses propres principes de liberté qui en étaient les racines originelles en Sicile. Capitalisme or not capitalisme ? Fausse question. Mafia or not mafia, bonne question.
Mercredi 22 octobre 2003
Du combat de journaliste.
Encore Hard Talk, encore Tim Sebastian. Décidément, je devrais me faire payer pour la publicité que je fais à cette émission, mais au fond, si toux ceux qui ne cessent de parler de la Bible ou de l'Evangile devaient se faire payer, ça coûterait fort cher au Vatican. Donc ce matin notre cher Tim avait en face de lui Monsieur l'ambassadeur du Kazakhstan, l'attaquant comme d'habitude bille en tête sur les atteintes nombreuses et scandaleuses aux Droits de l'Homme signalés un peu partout dans ce pays, ex-membre de l'URSS, ancien silo à missiles nucléaires à longue portée, et surtout ancien parking pour goulags en tout genres. Tim avait ce qu'on appelle des biscuits plus qu'il n'en fallait. Des rapports d'Amnesty International, de l'OCDE, du Conseil de l'Europe, de Reporters sans Frontières et j'en passe. Bref, on arrête, on torture, on assassine, on se débarrasse de journalistes embêtant en les faisant accuser de viol, tout y passe, viva el Kazakhstan !
Alors Monsieur l'ambassadeur, lui, chapeau ! Quel sang froid, quelle cruauté non dissimulée derrière un regard de glace surplombant des cernes qui n'ont rien à voir avec la maladie et un sourire éclatant. Le personnel politique de ce pays se brosse les dents tous les matins avec la pâte dentifrice que vous connaissez bien. Mais alors la puissance de dénégation ! Incroyable. Rien n'est vrai, tout est inventé - d'ailleurs le Pentagone le reconnaît, il y a des progrès dans le respect des droits de l'homme - on ne fait que des faux procès à ce pauvre pays qui sort du stalinisme le plus dur, qui a servi de rampe de lancement à la foudre nucléaire, de goulag, de poubelle de l'Union Soviétique, et l'on voudrait que du jour au lendemain on devienne des saints ? Tim : mais vous pouvez tout arrêter tout de suite : les arrestations , les tortures, les assassinats. Quels assassinats ? Mais vous savez bien, ambassadeur (plus de Monsieur), récemment on a carrément poussé un journaliste de l'opposition sous un camion au vu et au su de tout le monde ! Faux, archi-faux, un véritable accident, ça n'arrive pas chez vous en Angleterre des accidents de ce genre ?
Bref, j'ai zappé, j'en avais assez entendu et j'avais acquis la certitude que pour une fois, Tim n'en sortirait rien du tout, mais alors rien. Donc je me suis demandé, mais alors pourquoi diffuse-il quand-même cette interview ? Réponse approximative, pour montrer. Montrer le mensonge vivant, souriant, chaudement complice d'une indignation humaniste pour des crimes dont il sait très bien que c'est son propre gouvernement et donc lui aussi qui portent toute la responsabilité. J'ai zappé parce que je me sentais envahi par une sourde angoisse. Je me demandais, encore une fois, à quoi rimait exactement le jeu de Tim. Il savait parfaitement qu'il n'obtiendrait rien d'autre que des dénégations, rien. Alors, autant nous faire une émission plus courte et nous dire simplement ce qui se passe réellement au Kazakhstan, et puis basta. Non, Tim veut montrer les monstres qui mentent, nous mettre face aux salauds qui n'ont qu'un seul recours, le mensonge et encore le mensonge. Et puis, si encore c'était la première fois que j'assiste à ce genre de dialogue, mais deux émissions sur trois nous donnent la même image de deux monologues parfaitement distincts, sans aucune réciprocité ou je ne sais pas, sans que quelque chose ne craque de part ou d'autre. Si, l'autre jour, je vous en ai parlé, j'ai vu le Premier Ministre de Singapour. Au moins lui, il disait : oui nous faisons tout cela, mais nous sommes élus à 59 % démocratiquement.
Finalement je pense que Tim s'y prend mal. C'est la méthode qui n'est pas la bonne. Ca me rappelle les interviews de Le Pen où à chaque fois je me disais que le journaliste était le dernier des crétins parce que les questions étaient toujours ailleurs que là où elles stagnaient, c'est à dire dans les faits. C'est la méthode empirique anglo-saxonne qui n'est pas la bonne. Tim ne devrait pas s'arque bouter sur les faits et seulement les faits - facts only facts - il devrait demander à ses petits monstres ce qu'ils pensent philosophiquement de ces traitements auxquels ils soumettent des êtres humains. Moi j'aurais demandé à l'ambassadeur : savez-vous comment ça fait quand on vous arrache des ongles ? Comment pouvez-vous justifier l'assassinat de Untel par rapport à votre religion, musulmane je crois ? Pourquoi avez-vous besoin de vous débarrasser des gens qui osent vous critiquer ? Peut-être avez-vous du plaisir à faire tout ça ? Oui oui, ça doit être ça, ça vous fait plaisir. Je me souviens, à propos de Le Pen, je n'ai jamais entendu aucun journaliste lui demander de quel droit moral il se permettait de lancer sa chasse aux immigrés. Comment il pouvait justifier philosophiquement, en tant qu'homme le fait de traiter les étrangers comme des animaux. Personne ne lui a jamais demandé s'il n'était pas simplement un sadique, qui fait une carrière politique en cultivant le sadisme latent en chacun de nous ? Qui promet le futur sanglant et réjouissant des salles de tortures, de viol et de meurtres gratuits ? Combien de militants de ces partis néo-nazis ne songent qu'à ça, le ça de la psychanalyse désossé sur une table de boucher ? Il y a ceux qui tablent sur un avenir politique qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs, mais il y a surtout ceux qui attendent la grande fête des crochets sanglants et des camps de concentration. Voilà, Tim, ce qu'il faut dire à Monsieur l'ambassadeur du Kazakhstan : votre gouvernement est un ramassis de sadiques, de malades mentaux, de bouchers sans scrupules. Pas des gens qui s'accrochent au pouvoir par tous les moyens, mais des gens qui tirent leur raison de vivre et leur plaisir de ces crimes. De Pol Pot à Ben Laden, c'est tout du pareil au même. Ils se plaquent un masque politique et religieux sur la tronche et par derrière ils prennent tout simplement leur pied de malades mentaux. Des malades qui arrivent à fasciner tous ceux qui ne demandent consciemment ou inconsciemment qu'à profiter des mêmes passe-droit sur la bête humaine.
Mais, sans doute ce genre de question serait-elle mal prise, mal digérée et donc dangereuse. Je me souviens que Le Pen avait l'habitude de fixer du regard le journaliste qui lui posait des questions un peu trop embarrassantes et de finir par lui dire : - " je me souviendrai de vous, je n'oublie jamais un visage " -. La menace, c'est le plus sûr des moyens pour dissuader les curieux. Allez Tim, encore un effort pour te rapprocher de l'essence des choses. Arrête de croire que toutes ces atteintes aux Droits de l'Homme ne sont que des tentatives pour étouffer je ne sais quelle opposition qui a des yeux pour voir les rues remplies de troupes prêtes à ouvrir le feu. Regarde comment ça se passe au Myanmar, ex-Birmanie. D'un côté un peuple désarmé, hagard, dont la vie s'est réfugiée dans le regard brûlant de souffrance, de l'autre des soldats gras, souriants, avec des uniformes flambants neufs qui à eux tout seuls font fuir les masses, même s'il n'y avait personne dedans. Non je déconne, mais c'est la vérité. Ces fumiers prennent du plaisir à transformer l'homme en animal de bât, en poupée qui saigne quand on tranche dedans. Ah le fumet du sang, la jouissance des cris et des larmes. Allez Tim, relis ton Shakespeare, le seul Anglais qui ait compris quelque chose à la nature humaine, et laisse tomber tes soupçons fumeux et ta courtoisie de salon. Je t'aime bien malgré tout, parce que je vois bien que tu souffres de ce que tu sais, mais alors mets-toi réellement dans la peau de ceux dont tu décris les souffrances, et tape, frappe, gifle, crache et arrête de nous laisser croire que tu as devant toi des êtres normaux, des hommes. Courage collègue. Si tu veux, je viens te donner la main et t'aider à leur appliquer le traitement qu'ils méritent. Mais, je sais ce que tu vas me dire, et c'est ceci : - " mais si je fais ce que tu me conseilles de faire, alors je n'aurai plus personne sur mon plateau " -. Oui, personne. Mais, réfléchis, ceux que tu as sur ton plateau, ce ne sont pas des personnes, autrement dit c'est déjà le cas : tu n'as personne sur ton plateau. Personne.
Lundi 3 novembre 2003
Anaximandre, le père de l'Occident.
Anaximandre est réellement l'articulation historique de la volonté consciente de civilisation, ou plutôt de la réminiscence de cette volonté après une parenthèse qui a duré sans doute plusieurs millénaires. Il est étonnant que personne n'ait encore songé à comparer son système cosmologique à celui de Newton, car con géocentrisme évident ne change rien à la dynamique générale de sa représentation de l'univers : Anaximandre nous dit, environ deux mille ans avant le grand savant britannique, que la terre est maintenue dans sa position fixe par l'égalité des distances entre elle et tous les points de l'univers, par sa position centrale dans la sphère de l'apeiron, mot dont la traduction demeure controversée et qui signifie à la fois infini et chaos, concepts qui s'identifient l'un à l'autre si on les comprend bien par rapport à leur relation avec cette position centrale de la planète des hommes. Vous allez me dire qu'il n'est pas question ici de gravité au sens strictement newtonien et vous aurez raison, mais l'intérêt de la découverte de Newton n'est pas du tout dans le concept de gravité (qu'Anaximandre traduit par force, ce qui n'est pas très éloigné), ni dans la loi des relations entre les masses et cette gravitation. L'intérêt réside tout entier dans ce qu'aucun des autres schémas cosmologiques présentés par les Grecs ou plus tard n'est capable d'expliquer, à savoir la stabilité de l'habitat humain dans l'immensité de cet apeiron, tout simplement le fait que " ça tient ".
Revenons en arrière. Le schéma d'Anaximandre est le suivant : la terre est une section cylindrique placée au centre de l'apeiron en équidistance de tous les objets de l'univers, ce qui l'empêche de pencher dans un sens ou dans un autre, de se mouvoir anarchiquement et de garder cette incroyable stabilité qui permet d'envisager le temps et l'espace comme des objets observables et passibles de spéculation. Or cette équidistance est devenue une sorte de réalité évidente par les découvertes liées à la théorie quantique et aux relativismes d'Einstein : la terre est dans une position aussi centrale que n'importe quel autre objet de l'univers parce qu'il n'existe pas de centre mais une indéfinie quantité d'objets, univers dont " la circonférence n'est nulle part et le centre partout ". Pour bien saisir la révolution intellectuelle qu'une telle représentation a pu entraîner, il faut pouvoir se représenter le désordre intellectuel dans lequel étaient tombés les grands centres spirituels qui s'étaient développés depuis le néolithique. Ce désordre peut être représenté comme la panique qui suivrait une faillite dont personne ne comprend les raisons. Les scribes de Babylone ou ceux d'Egypte avaient pensé que la stabilité sociale serait le résultat d'une surveillance constante et scrupuleuse de tout ce qui se faisait, qu'il suffirait en somme de reproduire par écrit une sorte de comput du réel. En fait, ils faisaient ainsi une confiance sans limites dans la représentation à partir de laquelle pouvait toujours s'organiser la réflexion. A partir du moment où toutes les données sont fidèlement reproduites parallèlement à la réalité, on pouvait estimer possible de gérer cette réalité grâce à l'efficacité de l'analyse et du calcul. Il faut admettre que la décision de construire une cité immobile, de bloquer le mouvement de la vie naturelle telle qu'elle est vécue par le nomade, était fondée sur quelques certitudes instrumentales : les mathématiques n'ont certainement pas été inventées sur le tas, mais constituaient déjà une garantie préalable de parvenir au but. Autrement dit, le cadastre était déjà dans les têtes de ceux qui contemplèrent un jour la plaine vide où ils avaient décidé de bâtir leur ville.
Les facteurs qui n'avaient pas été pris en compte, et pour cause, ont été les facteurs psychologiques dont on ne pouvait pas connaître la dynamique collective avant de créer la collectivité. On savait raisonner, mais on ne savait pas gérer les passions qui allaient se former et apparaître comme des données nouvelles et inconnues au fur et à mesure que se formaient les sociétés en tant que telles. Le désordre s'installa donc selon le mythe très réaliste de la Tour de Babel, et la réponse fut la religion. Gérer l'Être sous sa forme matérielle ne posait aucun problème. Gérer l'Être sous sa forme psychique, c'était une toute autre affaire. Et le mot affaire tombe bien, car les Sophistes en firent en effet un business fort lucratif, business repris en gros par le Christianisme qui avait mieux compris que les Anciens polythéistes que seule une transcendance radicale autorisait un poème rationnel sur l'Être psychique. Autrement dit, il fallait aller au-delà du phénomène pour comprendre ce qui se présentait en apparence comme étant aussi au-delà du phénomène : le psychique est aussi caché que Dieu. Alors tant qu'il ne se présente pas comme cause de désordre, ce psychique n'inquiète personne et il fait partie des choses de la nature au même titre que la matière la plus simple. Or dès qu'il se révèle soudain que le psychique peut aller jusqu'à provoquer la violence et installer le chaos dans la cité, il devient autre chose que lui-même, il se dénature, et en se dénaturant il " infecte " ou " contamine " l'ensemble de la théorie et de la pratique humaine. Les " oublis " de l'histoire de la science, par exemple, comme le fait qu'Aristarque de Samos avait calculé apodictiquement l'héliocentrisme de notre univers deux siècles avant JC et qu'il fallut reprendre tous les calculs un millénaire et demi plus tard pour arriver au même résultat, appartiennent à cette pathologie de la connaissance, elle-même infectée par la pathologie psychosociale. Anaximandre en savait certainement autant qu'Einstein en termes de sens ontologique, c'est à dire en termes de ce qu'il fallait être capable de constater pour vivre correctement, c'est à dire selon une morale qui rende possible la vie collective.
La définition heideggerienne du mathématique m'a toujours fasciné par sa simplicité. Se fondant sur l'étymologie grecque, il nous dit que les " matemata " n'ont rien à voir avec le calcul algébrique ou géométrique, mais représentent " tout ce qui est déjà préalablement présent dans l'esprit avant toute expérience ". Pour rester un philosophe orthodoxe, on pourrait se contenter de dire les catégories, et l'histoire ultérieure de l'idéalisme allemand et du rationalisme français montre bien que ces catégories sont au cœur du problème ontologique. Les catégories sont les lunettes psychiques naturelles dont chacun dispose comme il dispose d'un foie ou d'un cœur et à travers lesquelles il reçoit la lumière du présent. Evidemment, ces catégories comprennent également le mathématique au sens moderne puisqu'elles déterminent toutes les ouvertures de la psyché sur le monde, elles déterminent l'aperception de l'univers, qu'on limite ce dernier aux phénomènes ou qu'on se permette d'aller plus loin, peu importe, ce sont les catégories qui nous montrent le monde et qui nous permettent de le calculer si la nécessité de le faire se présente, nécessité que l'histoire n'a pas manqué de servir à l'homme dès qu'il s'est agi de partager l'espace qu'on a décidé d'occuper ainsi que tous les produits issus de ce partage. C'est la raison pour laquelle on adosse toujours le calcul à la naissance de la démocratie, la pseudo naissance des mathématiques à la naissance de la cité. Mais on voit bien aujourd'hui que la recherche fondamentale, qu'elle soit en mathématiques ou en physique, retourne progressivement à son objet premier, à l'objet premier des catégories, à savoir le sens de la présence, la question de l'Être. Les savants actuels sont redevenus les Physiciens d'avant Platon, même si l'économie ne rate pas une occasion pour s'emparer des miettes de découvertes pour inventer des colles et des matériaux nouveaux destinés au marché. En ce moment, il y a deux machines fantastiques qui mobilisent des investissements dont on ose à peine parler : le synchrotron (dont on a pu suivre les aventures politico-économiques et les retombées juteuses sur le marché) et la canon à particule du CERN, encore en construction et dont le prix est tellement prohibitif que les Américains ont abandonné le projet chez eux. La première de ces deux machines est une sorte de scanner absolu de la matière, une lunette de Galilée qui permet d'entrer dans les parties les plus ténues de la matière, et donc d'en tirer toutes les possibilités utiles qu'elle présente dans ses plus petites parties.
La deuxième, c'est tout autre chose. Ce n'est plus une lunette ou un scope quelconque, c'est une machine mathématique qui se propose des calculs totalement vains en termes économiques, sinon militaire, évidemment. D'ailleurs il s'agit d'un circuit de bombardement, un canon circulaire dans lequel on provoque des cataclysmes artificiels destinés à mettre en évidence l'existence, la nature et les attributs des plus petites composantes de la matière, à savoir les particules. Le comput de ces expériences devraient nous permettre de pénétrer plus avant dans le " sens " ou la signification de la matière, aller jusqu'au dernier élément, s'il existe, jusqu'à la monade initiale du réel. Bien sûr, tout cela n'est pas gratuit en terme de finalité, car il s'agit avant tout d'analyser l'énergie, cet or nouveau du présent et du futur, et comme ce qu'on a fait pour contrecarrer les énergies destructrices mises en jeu par le nazisme et la folie nippone, on va prendre le risque de découvrir des modes de manipulation de la matière encore beaucoup plus dangereux que ceux qui ont produit les bombes dont on veut se débarrasser aujourd'hui.
" Ce dont est ce qui existe est aussi ce vers quoi procède la corruption selon le nécessaire, car les êtres se paient les uns aux autres le prix de leur injustice dans l'ordre du temps ". C'est la seule phrase connue d'Anaximandre. Et encore, Heidegger en conteste les huit dixièmes. Mais cette phrase m'a tellement frappé, il y a de cela plus de quarante ans, qu'elle s'est littéralement inscrite dans ma mémoire, sans que je fasse le moindre effort, comme si elle avait déjà sa place dans mon esprit. Dire tellement de choses en si peu de mots indique que l'homme qui l'a prononcée savait des millions de fois plus de choses que le plus savant d'entre-nous. Il dit d'ailleurs presque tout dans cette seule phrase. Je n'en entamerai pas l'exégèse aujourd'hui, mais j'y viendrai un jour. Quand j'en aurai moi-même saisi la perfection du sens qui passe évidemment par une analyse philologique et une connaissance du Grec que je n'ai pas encore. Pas encore suffisante pour bien comprendre l'interprétation fabuleuse qu'en fait Martin Heidegger et dont la compréhension se dessine comme une véritable époptéia sans laquelle on ne saurait se considérer comme un philosophe, voire comme un homme. La révélation est dans les mots, elle ne descend pas du ciel.
Mardi 4 novembre 2003
L'énigme du tétra drachme.
J'ai déjà signalé quelque part que je trimbale toujours dans ma poche un tétra drachme. Je ne suis pas sûr du genre de ce mot, car on dit une Drachme, mais les numismates disent, d'après mon expérience, un tétra drachme, c'est à dire une pièce de monnaie athénienne en argent ou parfois en alliage d'or et d'argent curieusement appelé électron, d'une valeur de quatre drachmes. Sur le marché de la numismatique, cette pièce, selon son âge et son état, est cotée aux environs de 5 à 800 Euros. Sans doute les toutes premières drachmes du 7ème et du 6ème siècle avant JC valent-elles beaucoup plus, mais je n'ai jamais eu le privilège de pouvoir en contempler une ailleurs que dans un catalogue. Avant de posséder mon tétra drachme, je possédais un statère d'Egine, du cinquième siècle avant JC, pièce à peu près équivalente en valeur à l'époque antique, mais plus précieuse de nos jours. Je l'ai pourtant échangée à perte contre la fameuse pièce où l'on peut voir d'un côté la tête d'Athéna, la déesse protectrice d'Athène, et de l'autre la chouette de Minerve, autre symbole de la sagesse et de la vérité dont Hegel disait " qu'elle prenait toujours son envol à la tombée de la nuit ". C'est beau.
Or d'après Plutarque, on pouvait s'acheter, vers le sixième siècle, un mouton avec une seule drachme. Un tétra drachme correspondait donc à quatre de ces animaux dont j'estime aujourd'hui le cours aux environs de cent Euros l'unité, ce qui me paraît déjà beaucoup, mais prenons large. Je suis sûr qu'en Australie un mouton ne vaut pas plus que cinquante Euros. Alors allons jusqu'à cent cinquante Euros et nous obtenons pour un tétra drachme la somme de six cents Euros, ce qui ne fait même pas quatre mille de nos francs de jadis. Or, même mon tétra drachme du troisième siècle, certes magnifiquement conservé, ne m'a pas coûté plus que cette somme, en réalité moins. Problème intéressant, non ? Nous avons devant nous une pièce d'argent avec laquelle on pouvait acheter parfois un bœuf, et aujourd'hui essayez donc d'acheter un bœuf avec quatre mille francs ! Cette monnaie rare, que se disputent les amateurs à travers le monde - car il en va avec ces pièces d'argent comme avec les bijoux, tant que vous n'avez pas d'acheteur, elles n'ont aucune valeur : tout est dans l'acte de vente et d'achat qui se fait ou ne se fait pas, quel que soit le prix qu'affichent ici et là les catalogues spécialisés - vaut moins qu'elle ne valait à l'époque où elle était en circulation quasi universelle, la Drachme étant devenue rapidement le dollar de la Méditerranée. Enigme étrange, car certaines pièces beaucoup plus récentes, des dollars en argent ou des pesos de l'époque de Maximilien valent aujourd'hui beaucoup plus qu'elles ne valaient à l'époque où elles avaient cours. On va me répondre qu'ayant été le dollar des mers du sud, la Drachme était fort répandue et donc qu'on en avait frappé des masses importantes. Comme c'est la rareté qui fait le prix, il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que ma pièce vaille aujourd'hui moins qu'au cours des siècles où elle était en circulation.
Mais cette explication ne me satisfait pas du tout, car le tétra drachme est précisément une pièce particulièrement rare. J'ai parcouru quelques salons de numismates, et j'ai rarement trouvé plus qu'une demi douzaine de ces pièces parmi des milliers d'autres monnaies antiques, médiévales ou modernes. Le tétra drachme est considéré par tous les numismates comme un petit trésor et lorsqu'on en évoque l'idée on voit toujours s'allumer dans leurs yeux une petite lueur d'intérêt très spécifique, et on peut s'attendre à se faire plumer comme un pigeon à moins d'être un connaisseur très éclairé. Car on en fabrique évidemment des quantités de faux, parfaitement identifiables par la qualité de l'argent, sa couleur éclatante et l'absence de la patine du temps, élément qu'il faut avoir longuement caressé entre ses doigts pour en devenir familier. Le temps, voilà la valeur réelle de ces choses dont l'unité pouvait nourrir une famille nombreuse grecque pendant un ou deux mois !! Récemment on a cherché à me vendre un magnifique exemplaire du cinquième siècle, le siècle de Socrate et de Platon, une pièce qui aurait pu traîner dans une poche de Parménide ou de Zénon, hommes généreux et toujours prêts à faire la fête pour un oui ou pour un non. Avec un tétra drachme, le Banquet de Platon était assuré pour deux fois plus de convives.
Ma spéculation s'arrête là. Je ne sais plus quoi invoquer pour éclairer ce problème sinon l'idée que la minoration concrète de la valeur de cette monnaie provient de l'incertitude quant au temps, c'est à dire quant à son authenticité. Il faut préciser qu'il est relativement facile de falsifier ces drachmes pour la simple raison qu'il s'agit d'une simple boule d'argent écrasée par un poinçon de chaque côté, il suffit donc de sculpter habilement le poinçon et le tour est joué. Existe-t-il de surcroît des techniques de vieillissement artificiels ? Je l'ignore, mais tout est possible, car les numismates de bonne foi conseillent vivement de ne jamais nettoyer ou polir ces pièces, car certaines substances qui se sont déposées dans les interstices sont parfois garantes de cette authenticité recherchée. La plupart de ces monnaies ont en effet passé parfois deux millénaires au fond de l'eau de mer, et cela laisse des traces. La vérité de la Chouette en fait le prix ! A méditer.
Jeudi 6 novembre 2003
Islam et Occident, Arius contre Rome.
Deux phobies s'affrontent et font couler le sang à travers le monde. L'une pourrait s'appeler l'islamophobie, l'autre l'occidentalophobie. S'exprimer sur un phénomène aussi grave qu'une phobie, terme issu directement du vocabulaire médical, demande au moins un savoir, une science égale au cadre dans lequel on s'exprime, en l'occurrence ici, la médecine. Dans toute phobie, il y a des causes psychiques profondes, ressortissantes à ce fourre-tout sémantique que constitue l'idée d'une entité psychique cachée, double occulte de la conscience, le fameux inconscient. Donc, du refoulement. L'islamophobie serait donc le symptôme d'un refoulement, et si on se propose de comprendre ce phénomène au lieu de se contenter de citer Charles Martel et les Croisades, il faut trouver ce qui est en somme l'objet du refoulement, et bien sûr, ce qui l'alimente, son énergie.
Cette islamophobie s'accompagne dialectiquement d'une occidentalophobie dont les manifestations réalisent en quelque sorte le désir caché de son autre. Ce que l'occident a baptisé, sans prendre le moindre gant,
terrorisme,
incarne pour des raisons d'inégalités politiques la haine de l'islam, haine qui, de l'autre côté, demeure comme noyée dans les masses chrétiennes et occidentales, latente mais tout aussi réelle. La résurgence de la xénophobie, maladie sociale aussi vieille que la société elle-même, n'est pas seulement le signe d'un affaiblissement des lois républicaines auxquelles l'occident était parvenu, mais elle n'est rien d'autre que le pendant de la guerre de religion qui se déroule entre l'islam et un monde encore totalement dominé par l'idéologie chrétienne. La place que prend un personnage comme le pape dans les médias représente une véritable composante de la puissance politique de l'Eglise dont elle n'est qu'une image, car on ignore en général la véritable puissance politique de cette institution qui, plutôt que d'en souffrir, tire profit de la compassion qu'elle soulève en raison de la désaffection pratique des masses à son égard. Les églises vides de l'occident renforcent paradoxalement le Vatican dont la force ne réside pas dans le nombre de ses fidèles, mais dans sa puissance à exister comme réalité mondiale face à la réalité socialement formidable qu'est devenu l'Islam depuis un demi siècle pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les différences doctrinales, des raisons dont les principales ont été les conséquences latérales de la guerre froide et du règlement, dans ce cadre, des réalités coloniales. L'islam s'est nourri de la " faute impérialiste " de l'occident, s'est engraissé sur le fumier des guerres coloniales et des résidus impérialistes qui structurent encore la gestion des énergies fossiles du monde. Etant entendu que les comportements de part et d'autre reposent en définitive sur des conceptions du monde parfaitement spirituelles. Je veux préciser par là qu'il n'existe nulle part aucun " fait " historique détaché des racines spirituelles de ses acteurs. Pour mieux me faire comprendre, je dirais par exemple, que l'attitude des Arabes du Hedjaz face au miracle pétrolier repose en définitive sur leur vision morale du monde au même titre que l'impérialisme qui s'est emparé de ce pétrole repose sur la morale chrétienne telle qu'elle se dégage des doctrines orthodoxes. Je ne vais pas reprendre ici les analyses pertinentes sinon satisfaisantes de Max Weber.
Alors quel est l'objet refoulé ? A l'évidence, il est d'ordre doctrinal. " Une forme tout autrement radicale de l'arianisme eut son point de départ en Arabie, après que les Juifs et les Chrétiens refluant d'Occident en Orient, furent parvenus à ramener au monothéisme cette branche des Abrahamides égarée ou arriérée dans quelques vieilles idolâtries…car les Arabes, une fois lancés dans la réforme, allèrent jusqu'au monothéisme pur et farouche, et repoussèrent, avec les croyances idolâtriques touchant le Christ, celles qui auraient pu fonder parmi eux la domination sacerdotale
". Qui l'eût cru ? Charles Renouvier, philosophe rationaliste du 19ème siècle, quasi fondateur spirituel de la Troisième République et de la laïcité, arrive à cette révélation incroyable : les Musulmans ne sont que des ariens radicaux ! Qui étaient les Ariens ? Des Chrétiens primitifs qui se refusaient à croire que le Christ fut autre chose qu'un homme inspiré, prophète et révolutionnaire, mais en aucun cas fils de Dieu et donc Dieu lui-même. Or, l'arianisme aura été dans l'histoire de la formation du Christianisme, le principal adversaire de ce qui devint par la suite l'Eglise Catholique et Romaine dont l'orthodoxie reposait principalement sur la reconnaissance de la divinité du Christ. J'ai déjà analysé quelque part ce qui a poussé les Pères des Conciles successifs à adopter finalement un dogme aussi surréaliste, analyse qui aboutit à l'hypothèse selon laquelle le droit divin politique, c'est à dire le principe dynastique transmissible par les Saintes Huiles, dépend étroitement de la croyance à une possibilité de divinisation de la personne humaine. Si l'histoire ne contenait nulle part un être humain qui soit un trait d'union indiscutable entre l'en deçà terre et l'au-delà transcendant, il serait difficile de faire admettre aux masses dominées et exploitées qu'il soit possible que le monarque auquel elles se soumettent possède une légitimité spirituelle aussi importante que le Droit Divin.
Double refoulement donc. Les Chrétiens n'ont jamais cessé de produire pendant les deux derniers millénaires toutes sortes d'hérésies qui, de près ou de loin, reprenaient les principes de l'arianisme, en tout point plus proches des exigences de la raison que le dogme dadaïste de la Trinité. Il suffirait de citer les Cathares, massacrés comme de la vermine par les souverains qui avaient systématisé leur complicité idéologique avec Rome, mais on peut aller plus loin et voir dans la Réforme luthérienne une réaction de même type, même si Luther en dernier ressort se plie au dogme de Nicée. Il serait trop long ici de faire l'analyse d'une proposition aussi audacieuse, mais je vous promets qu'elle ne tardera pas à figurer un jour dans cette chronique.
L'islam et l'Occident ne sont donc pas aux prises à propos de deux religions différentes, mais à propos d'un contentieux interne à une même religion vieux de mille trois cent ans, si l'on admet avec Renouvier que Mahomet n'a jamais été qu'un arien radical, c'est à dire un monothéiste fidèle au dogme d'Arius. Et de fait, l'islam abrahamide n'est qu'une branche du monothéisme qui ne reconnaît dans Jésus-Christ qu'un prophète, le prophète qui précède l'autre prophète que fut Mahomet. Double refoulement puisque d'un côté, celui de l'Eglise romaine, on ne peut nier la culpabilité insoutenable liée à l'arianocide des premiers siècles, car il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'une petite guerre de religion du style de celles qui précédèrent la Proclamation de l'Edit de Nantes, mais de véritables génocides qui ont dépeuplé littéralement la plus grande partie de l'Orient romain, tout le Maghreb et tout le Maschreck (c'est à dire la portion de l'Afrique qui va de la Tunisie à l'Egypte), ainsi que l'Empire romain lui-même à partir de Constantin qui opta évidemment pour l'orthodoxie romaine. De l'autre la revanche musulmane qui a refait en sens inverse la croisade idéologique qui ne s'est arrêtée que sous les murs de Vienne assiégée par les Ottomans. Il faut admettre que nous vivons depuis cette date dans une sorte d'armistice jamais transformée en véritable paix. Or cette armistice fragile lorsqu'on connaît la férocité des oppositions doctrinales, subit la conjoncture, c'est à dire d'une part la propagation et la consolidation des bases politiques de l'islam, facilité par la simplicité de l'arianisme qui avait séduit les Chrétiens bien avant Mahomet, et de l'autre l'invasion latente que constitue l'immigration massive de ces ariens dans les zones jusque là réservées aux Chrétiens romains.
L'islamophobie n'est donc rien d'autre qu'une arianophobie vieille de deux mille ans et qui croyait avoir triomphé définitivement des hérésies internes à la religion de la Révélation. De même l'occidentalophobie repose tout entière sur le rejet des dogmes dont il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas résisté comme ceux de l'arianisme au travail de la Raison et au développement de la laïcité. Pendant cinq siècles, les Turcs ont dominé un immense empire sans toucher aux variantes religieuses du monothéisme des diverses régions, attitude de tolérance qui a donné comme résultat entre autre les Balkans, la Grèce et l'Afrique, mais aussi la survivance du chiisme face au sunnisme largement majoritaire. Parmi les sectes qui se sont partagé l'héritage de la révolution judéo-chrétienne, l'arianisme originaire est sans doute l'une des formes les plus proches et les plus fidèles de l'idéal chrétien de l'amour, idéal que la pensée rationnelle et républicaine n'a aucune " raison " de rejeter. D'ailleurs personne n'est dupe, aujourd'hui l'islam, ce parent riche de l'arianisme, apparaît partout dans le Tiers-Monde comme la religion des pauvres et comme la religion qui s'oppose à une société de castes, raison pour laquelle on n'a pas fini de collectionner les conversions de nos propres enfants à cette religion qui ne se réclame d'aucun lien charnel direct avec un au-delà quelconque, cependant qu'à Rome on ne songe même pas à remettre en question le dogme de l'infaillibilité papale ! Tant que nos enfants auront hélas besoin de religion pour asseoir les fondements de leur être-là et dissiper l'angoisse native de l'homme jeté sur la grève de l'existence. Renouvier avait inventé un scénario où Rome se serait débarrassé du Christianisme fanatique et en avait conclu une accélération du progrès humain tel qu'on aurait pu ainsi économiser un demi millénaire pour parvenir au même progrès de la science et de la technique humaines, c'est à dire au règne de la Raison. Il rêvait en pleine veille, mais il oubliait en même temps que le choix du développement technique est antécédent à la naissance des monothéismes et sans doute étroitement lié à leur apparition, ce qui nous permet de conclure que pour comprendre le fantasme du religieux, il faudrait d'abord se pencher sur la question que pose une humanité qui se définit comme " maître et possesseur de la nature ". Car si, en effet, cette expression a un sens, alors il existe un hors-nature, et toutes les aberrations religieuses sont permises, de même que fatals les totalitarismes qui se succèdent dans l'histoire humaine.
Vendredi 7 novembre 2003
La fabrique de monstres.
Notre société devient une fabrique de monstres. Nos enfants ont cessé d'être considérés comme de futures personnes et le vide ainsi créé dans la vision perspective des parents en fait des petits animaux dont l'éducation s'identifie de plus en plus clairement à un élevage. Evidemment, il ne s'agit pas, ici, de faire le procès des parents et de s'engager dans des analyses qui aboutiraient au constat d'une aliénation culturelle de plus en plus générale. Au contraire, nous vivons un paradoxe d'une société de plus en plus cultivée où la conscience des personnes vit de plus en plus lucidement et donc cruellement ses propres contraintes et aussi ses propres dérives. Car notre société est devenue une machine qui broie impitoyablement le désir dans le but de conformer le comportement des citoyens à ses propres exigences, exigences dont les enfants sont les toutes premières victimes. Dans l'histoire, je suis convaincu que les enfants n'ont jamais été aussi dangereusement exposés à la déréliction sociale, déréliction dont le résultat futur ne peut être que le création de monstres, ces monstres tranquilles qui apparaissent déjà ici et là dans les massacres domestiques dont on découvre les victimes découpés en morceaux dans les poubelles. Un peu partout fleurissent déjà des affiches coloriées reproduisant des photographies d'enfants et d'adolescents disparus. Je n'ai jamais vu cela de ma vie, et loin de penser que le phénomène de la disparition des personnes soit un phénomène nouveau, je me contente de penser que si cette publicité voit aujourd'hui le jour, c'est que les faits sont bien plus effrayants que cette seule affiche ne nous le suggère.
Et il suffit d'aller dans une école maternelle pour s'en rendre compte. Lorsque le jeune couple a trouvé les solutions aux multiples problèmes concrets déjà soulevés par la naissance et les deux premières années de la vie du bébé, vient le moment où il peut confier l'enfant à une instance qui appartient au système éducatif. Il n'est pas obligé par la loi de confier cet être à peine né à un espace public géré exactement comme l'ensemble de la machine éducative, mais pour la plus grande majorité d'entre eux il n'y a tout simplement pas le choix. De la crèche, premier espace de la séparation du nourrisson et de ses géniteurs, il passe à l'école maternelle, deuxième étape de la tréfilerie sociale et d'une temporalité dont les parents sont totalement absents. Cette absence totale se transforme en absence relative dès que l'enfant se retrouve chez lui, dans l'environnement d'une parentèle exténuée, chargée d'une part par le stress de la journée de travail et soucieuse des tâches qui restent à accomplir pour assurer les repas, le programme de la soirée et l'hygiène des enfants, de l'autre par une fratrie que les absences absolues et relatives des parents transforment pour ainsi dire en parents de rechange, c'est à dire des modèles ou leur contraire, des réalités-repoussoirs. Ce qui est perdu par rapport à une réalité passée, par rapport à une histoire de la famille que les générations de plus de quarante-cinq ans ont connue, c'est le rapport direct avec les adultes, la possibilité d'une mimésis, c'est à dire d'une imitation qui n'est rien d'autre qu'une forme fondamentale de leur acculturation. Dans le cercle familial, les enfants deviennent des barbares. Le pire est que cette mimésis manquante peut se retourner en mimésis surabondante lorsque le climat de crise devient permanent, lorsque les parents n'arrivent plus à gérer eux-mêmes leurs relations et que la " maison " devient un champ de bataille entre des adultes qui ont eux-mêmes perdu tous les repères qui peuvent ritualiser pacifiquement leur existence. Ces crises aboutissent souvent au choix d'un bouc émissaire qui reviendra le lendemain dans son école maternelle couvert ou couverte de bleus soumis à la méditation des enseignants. Que faire ? Charger l'administration judiciaire d'enlever ces enfants à leur milieu familial ou bien prendre le risque de voir la maltraitance se changer en tragédie ? Charybde ou Sylla.
Les éducateurs et les éducatrices qui prennent en charge ces enfants à leur entrée en maternelle deviennent ainsi les nouveaux vrais parents. Aujourd'hui, le métier d'institutrice de maternelle est en passe de devenir un cauchemar permanent, et il ne s'agit pas là d'une constatation qui ne porte que sur les quartiers réputés difficiles, ce serait presque le contraire parce que précisément les enfants des familles d'immigrés bénéficient encore d'un environnement familial dont l'européen moyen n'a plus qu'un vague souvenir. Non, les enfants des classes aisées posent autant sinon plus de problèmes que les jeunes beurs ou beurettes, les jeunes originaires des pays du Moyen-Orient ou des Balkans ou même et surtout d'Afrique où les mœurs claniques reprennent toujours le dessus, quelles que soient les conditions de vie identiques auxquelles les parents sont soumis. Non, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un enfant malade cesse d'être malade à huit heure moins le quart le matin, heure à laquelle sa mère ou son père le mène à l'école maternelle, où les enseignants deviennent des aides-soignants voire des infirmières sans qu'il leur soit même possible de faire appel à des instances médicales sans s'exposer à des conséquences administratives souvent surprenantes et négatives voire dangereuses pour leur carrière. On pourrait résumer la situation de la manière suivante : le travail privé des parents a barre sur le travail public des membres de l'école publique. Et pour cause, la libéralisation de l'économie et le mépris dans lequel sombre chaque jour davantage le droit du travail, dissuade de manière totalitaire n'importe quelle mère ou n'importe quel père de prendre sur son temps de travail pour soigner son enfant et rester à ses côtés même si la loi lui en donne largement le droit. A long terme, il est inutile de souligner que l'état de maladie finit par disparaître comme état extraordinaire et comme danger pour les personnes. Au point que désormais il n'est plus rare de voir les salariés partir eux-mêmes au travail dans des conditions de santé gravement dégradées.
Notre société est bien en train de devenir une machine qui broie non seulement les salariés eux-mêmes dans leur dignité et dans leurs droits que de longs combats du passé leur avait accordé le nécessaire privilège, mais encore et surtout leurs descendants, les enfants dont la formation du caractère dépend si étroitement de l'image parentale. Ce matin j'ai pu apprendre via CNN qu'il y avait un milliard et demi d'enfant dans le monde, à savoir un cinquième de l'humanité. Le spot ne montrait que des enfants du Tiers-Monde, souriant et beaux comme nous nous imaginons nos propres enfants. Hier, j'ai vu dans une grande surface où je faisais quelques achats, un petit bambin d'à peine deux ans et demi, les yeux gonflés et bleuis par deux coquards effrayant. Il souriait comme les enfants filmés par l'UNICEF, mais que dire de l'agitation qui le transformait en ce que nos parents nommaient dans le temps un petit diable. Oui, les enfants deviennent des petits diables parce que leur conscience leur parle malgré l'absence de langage et de concepts. Elle leur dit l'absence de ceux qui devraient être là pour les aimer et les initier à l'existence, elle leur dit le désarroi des parents qui s'infiltre en eux à la place de l'image du Père et de la Mère à laquelle ils auraient droit. Notre histoire vraie, celle qui est occulté par le discours académique, a connu plusieurs révoltes d'enfants, elle a même connu une révolution qui fut la fameuse Croisade des Enfants vers l'an Mille. Sans vouloir me faire passer pour un prophète de malheur, je me permets quand-même ici de dire à haute voix que des révoltes nous attendent, bien plus dures que ce que nous connaissons déjà dans les quartiers sensibles, tout en dissimulant soigneusement ce qui se passe aussi dans les beaux quartiers avec une violence parfois pire que ce qui se passe dans les HLM de banlieue. Des révoltes, et pourquoi pas une révolution. Qui aurait pensé, en Mai68, que des étudiants iraient jusqu'à mettre le feu à la société française et européenne ? Personne, ou seulement quelques jeunes un peu moins jeunes et dont la conscience était assez lucide pour prévoir ce phénomène unique, lui, dans l'histoire du monde. Il n'y a rien d'impossible dans la nature humaine, il n'y a rien d'impossible à l'homme quel que soit son âge. Des enfants de dix ans qui ont torturé des camarades de classe pendant plusieurs jours sont ces êtres extrêmes, ces monstres que les rouages de la machine que nous
sommes formons pour l'avenir.
Mercredi 19 novembre 2003
Le présent.
Certains vont me dire qu'il est inutile de réécrire Plotin. Peut-être. Mais d'abord, je ne suis pas Plotin, et je n'ai pas les ambitions de ce philosophe profond qui, sans n'avoir que peu de choses à voir avec Platon, se trouve avoir été l'un de ses meilleurs vecteurs spirituels. Confusion dont l'Eglise, entre-autres, a tiré un profit sans limites. Et puis de toute façon il y a un langage qui échappera pour toujours à ceux qui lisent aujourd'hui Plotin, une poésie dont seuls quelques rares amoureux de Pindare peuvent se servir dans leur quête vers leur apoptéïa. C'est mon dernier concept, glané je ne sais plus où, mais qui recoupe si exactement ce que je pense de la philosophie que je ne peux plus parler de quoi que ce soit sans y faire référence.
Qu'est-ce que l'apoptéïa ? Dans les textes anciens il s'agit d'un passage dans la sagesse. On ne saurait se revendiquer du titre de philosophe sans avoir " fait " son apoptéïa, sans être passé par le miroir du présent. Evidemment cette image du miroir permet immédiatement aux sophistes d'introduire la notion d'apparence, de reflet, de mauvaise copie de l'original, et ainsi d'en revenir à l'idéalisme platonicien. Or, c'est tout le contraire. Passer à travers le miroir du présent, c'est en quelque sorte l'absorber, s'y mêler si intimement qu'on pourrait dire qu'il se produit une réduction de la différence entre moi et le monde. Le dressage mental qu'a imaginé et mis en œuvre la religion ne pouvait pas mieux rêver pour confondre philosophie et sophisme.
Le sophisme étant compris, non pas comme une simple tromperie sur les marchandises, mais comme une redoutable machinerie culturelle qui a formé, on pourrait dire formaté, l'occident tout entier : les " instances " ont transformé la philosophie en tréfilerie éducative. Oui, vous allez tiquer sur le mot " instances ", mais je me suis expliqué longuement ailleurs (notamment dans Atopie) sur l'origine de l'instance. Une instance n'est rien d'autre qu'une institution ou une personne qui détient et exerce un pouvoir sur les autres ou sur soi-même (voir la notion en psychanalyse). La question est donc de savoir pourquoi il y a des instances ? La réponse classique est de dire que le pouvoir est une finalité ontologique, c'est à dire un but naturel de l'existence. Le débat est ancien sur la bonté ou la malignité naturelle de l'être humain, mais le pire n'est pas là, il est dans le darwinisme de café-bar qui, n'ayant rien compris à Darwin, proclame urbi et orbi que la vie n'est qu'un long ou trop court " struggle for life ". Lutte pour la survie qui légitime le pouvoir comme assurance-vie, ce qui paraît rendre naturel une ontologie de la domination de l'homme sur l'homme. Là-dessus j'ai, pour me résumer à la manière de Rousseau, pensé aussi que le mal est lié à la socialisation de l'être humain. Mais Rousseau n'a pas donné de réponses claires et convaincantes sur la question de savoir pourquoi les hommes de l'origine, les nomades naturellement bons, se sont regroupés en sociétés. Ma réponse est simple : pour résoudre sur la base d'une nouvelle méthode le problème du sens de l'existence. Cela s'appelle une révolution au même titre que la-dite révolution copernicienne, c'est à dire cette volte du savoir quant à la position du monde dans l'univers.
Or, en faisant un choix dont les conséquences n'échappaient certainement pas aux fondateurs, l'homme a pris un risque, peut-être insuffisamment calculé, celui de se séparer du présent en le reléguant en quelque sorte dans l'objectivité du savoir. L'idéalisme platonicien n'est rien d'autre qu'un discrédit lancé sur le présent, et non pas sur la matière, la substance ou je ne sais quelle réalité de la perception. Pourquoi Platon s'est-il rendu complice d'une telle opération qui ne faisait que favoriser les desseins des instances que l'histoire avait déjà mis en place : les oligarchies, les monarchies et les fausses démocraties comme celle qu'il essaye de nous vendre dans sa République. Réponse, parce qu'il appartenait lui-même à une instance, celle du savoir qui, entre-temps s'était constitué en pouvoir sur autrui, ce que Platon lui-même décrit merveilleusement bien dans son Sophiste. La relégation du présent se retrouve aussi dans la construction des temples dont la finalité originaire avait été de mettre à l'abri le savoir originaire des nomades. Relégation éminemment dangereuse que l'on peut aujourd'hui percevoir définitivement et absolument dans le phénomène de l'industrialisation de l'agriculture que Heidegger identifiait à la Shoah, ce qui n'est pas peu dire mais qu'il faut comprendre. La question des OGM est à étudier exclusivement dans ce contexte.
Alors, les " fondateurs " ont-ils échoué ? Ou bien au contraire, serions-nous sur la voie de la réussite de leur méthode dite sociale ? Il n'y a pas de réponse à cette question, car une réponse équivaudrait à la résolution de la question de l'être, question qui elle-même est déjà polluée par l'instance dite du savoir conceptuel. Le présent, tel qu'en parle encore Parménide, ne peut pas être conceptualisé, il ne peut qu'être épousé dans ce que j'appelle plus haut une épopteïa, c'est à dire un moment que d'autres ont nommé extase, epectase ou encore transes chamanique. Parménide enseignait la sagesse, c'est à dire la voie qui mène à cet événement de la vie où le présent finit pour le sujet par se suffire à lui-même, quel qu'il soit. Je pense notamment aux Juifs orthodoxes qui à Auschwitz n'ont rien vu de spécial dans leur supplice, que tout au plus un châtiment pour les errements de leur peuple et donc une manière de se réconcilier avec leur Dieu, c'est à dire avec leur présent à eux. Il en va de même pour les quelques martyrs chrétiens authentiques comme Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, dont les souffrances étaient d'ailleurs toutes intérieures et ne devaient rien à la malignité de leurs contemporains. D'où la tentation pour les freudiens, notamment Lacan, de se servir de ces figures pour fonder rationnellement cette aliénation du présent par la séparation de deux instances intérieures, la conscience et l'inconscient. La psychanalyse a donc tous les atout en mains pour remettre ces deux instances en présence, quitte à en arriver au constat qu'elles réagissent finalement comme deux masses critiques d'une bombe atomique et détruise totalement le sujet. Lacan a toujours caché son ontologisme fondamental mais les partie les plus ardues de son jargon ne peuvent pas tromper un lecteur averti. Car le danger de l'explosion du sujet provient aussi de l'option freudienne de cantonner la problématique du présent dans le camp de concentration du langage, du concept qui prétend se saisir du présent. Lacan dit que l'inconscient est structuré comme un langage et réintroduit par le privilège qu'il donne au signifiant sur le signifié, l'idée que la conscience est elle-même seulement sous l'emprise du présent, comme le chrétien est sous l'emprise de Dieu ou de l'Esprit Saint. Alors que, bien entendu, la conscience, quelles que soient les conditions de son aliénation, n'est qu'une partie du présent, mais une partie aussi pure que cette caisse enregistreuse tapie au fond du moi qui a pris le nom d'inconscient. C'est là que l'on voit ressurgir le platonisme foncier de La can.
Pour ma part je pense que les fondateurs ont réussi, pour la seule raison que j'existe, dans une lignée qui n'a pas trahi les causes originaires de l'option de se socialiser. Il faut ajouter à cela qu'une telle fidélité n'est elle-même pas inconsciente ou naïve, c'est à dire qu'elle repose sur la reconnaissance d'une possibilité de la socialisation, et cette possibilité repose elle-même entièrement dans l'invention de la démocratie. Mais, là encore, nuance, car cette invention de Clisthène au Cinquième siècle Avant JC n'est qu'une redécouverte de la démocratie naturelle de la pratique nomade ou semi-nomade. La pensée, comme le disait Platon, est bien réminiscence, c'est à dire mémoire. La démocratie athénienne aura été le moment de l'anamnèse d'une vie politique sans Cité, ce qui semble a priori contradictoire mais ne l'est que si l'on supposait que les nomades de la préhistoire ne se rencontraient jamais. Or, si une chose est historiquement certaine, c'est que l'homme d'avant le néolithique voyageait pratiquement autant que nous le faisons aujourd'hui. La socialisation n'aura été qu'une halte dont la garderie aura été plus ou moins bonne, mais c'est la vie. Désormais un résultat s'esquisse sans qu'on puisse douter de sa réalité, à savoir l'homme individuellement livré à la réalité comme le nomade originaire, mais armé du langage universel et sommé de choisir entre une socialité possible c'est à dire démocratique, ou une socialité à instances, c'est à dire le despotisme, ou pour rester moderne, le fascisme.
Vendredi 21 novembre 2003
France-Culture et son destin.
Je fréquente de temps en temps un forum qui forme l'une des trois instances qui se sont proposés d'afficher publiquement leur désaccord avec les réformes qui ont transformé, depuis 1999, l'antenne radiophonique des intellectuels qui porte le nom suggestif de France-Culture. En fait un sous-produit de Radio-France au même titre que FIP ou Radio Bleue, sauf qu'il existe depuis bien plus longtemps et joue un rôle que l'on aurait tort de sous-estimer dans la société française. En 1963, l'ORTF a créé une sorte de bouquet de fréquences dont France-Inter était le tronc et France-Culture et France-Musique des branches disons spécialisées. De 1947 à cet événement il n'existait que Paris-Inter, somme de l'ensemble de ce qui aujourd'hui s'est encore multiplié avec la création des FIP, radio-bleues, Mouv etc… 1963 est donc une date importante puisqu'on a, alors, commencé à cibler les programmes, c'est à dire à procéder à un découpage de l'ensemble des auditeurs destiné à permettre de concurrencer efficacement les radios privées qui émettaient à l'époque à partir de pays étrangers, comme Radio-Luxembourg et plus tard Europe 1, émetteurs longtemps considérés comme des radios-pirates puisqu'ils diffusaient depuis les petits pays proches de nos frontières, Luxembourg, Sarre, Andorre, Monte-Carlo et j'en oublie. Mais rapidement l'état français va changer de tactique et racheter des actions en sous-main pour limiter la casse d'une concurrence marchande et politique désastreuse pour l'ORTF et le gouvernement français. En Mai68, on se souvient du rôle joué par Europe 1 pendant les événements, mais la chasse au sorcières qui a abouti au licenciement de plus de 500 journalistes n'a pas épargné à l'époque les antennes privées. C'est tout dire.
Revenons donc à France-Culture qui est une sorte de fleuron culturel du bouquet radiophonique du service public, destiné sans fard dès le début à tout ce qui était bac et bac+. Dans les années soixante, nous étions quelques lycéens et étudiants à écouter cet émetteur étrange, qui proposait entre-autre des rediffusions d'émissions anciennes où l'on pouvait entendre parler les grands écrivains du siècle, et même des monstres sacrés comme Tolstoï dont l'INA possède un certain nombre d'enregistrements sur rouleau. A noter en passant qu'à cette époque l'ORTF pouvait utiliser gratuitement ces archives, à condition de faire ses recherches elle-même, alors qu'aujourd'hui le service public doit payer de sa poche la rediffusion de ses propres produits après une période de trois ans, les archives étant désormais centralisées et gérées par l'INA, autre institution imaginée par des esprits fortement imprégnés par l'impératif pétainiste de l'autofinancement du service public (Loi de 1941). France-Culture est restée très longtemps une toute petite radio, écoutée par environ 20 000 auditeurs encore dans les années 80. Aujourd'hui Madame Laure Adler se vante de centaines de milliers d'auditeurs, mais je n'en crois pas un mot, tout au plus France-Culture a-t-il atteint et peut-être dépassé la centaine de milliers de personnes à l'écoute, mais les chiffres sont secrets et ils coûtent très cher puisque les entreprises qui fabriquent l'Audimat ne le font pas pour rien, je peux vous l'assurer en tant qu'ancien rédac-chef-adjoint d'Arte. Mais précisément, le taux très faible d'écoute donnait à FC une énorme liberté d'action, et le gouvernement pouvait à la fois se féliciter d'avoir un émetteur pratiquement d'extrême-gauche, quelle liberté ! et rester serein quant à l'impact de FC sur l'opinion publique.
Encore que, et les gouvernements successifs s'en sont avisés peu à peu, ce n'est pas toujours la quantité qui fait l'efficacité, et le fait que ce soient les intellectuels et donc aussi les leaders d'opinion qui fréquentent ces ondes insolentes a sans doute influencé considérablement les programmes des autres radios, et notamment Europe 1 qui a fait son beurre avec un gauchisme dont on n'a même plus idée aujourd'hui. Dans la presse et les médias en général, cela se passe ainsi : le plus informé et le plus intelligent devient le modèle dont on se procure le plus vite possible la Une et le contenu dont on fait après ce qu'on veut. C'est ainsi que le journal Le Monde est devenu ce qu'on a appelé le Journal de référence. Dans les années 70, 80 et aujourd'hui encore les rédactions de télévision ou de radio formatent leurs journaux sur la presse écrite, pour plusieurs raisons dont la principale est que la presse écrite finance encore le journalisme d'investigation, et donc découvre des événements en enquêtant, alors que les médias audiovisuels n'ont pas assez d'argent à consacrer à la recherche beaucoup trop coûteuse car mobilisant des moyens techniques hors de prix. France-Culture est ainsi devenue avec le temps la radio de référence pour beaucoup de journalistes comme moi, par exemple, qui ne ratait pas un journal du matin de FC avant de faire mon conducteur pour le JT (Journal Télévisé). J'ajoute que je disposais quand-même d'autres sources notamment étrangères, mais je remercie encore aujourd'hui la rédaction de FC qui ne m'a jamais mégoté les adresses de dernière minute pour organiser une ITW pour le JT du 8 ½. A cette époque j'avais même suggéré à Jérôme Clément d'encourager en la formalisant quelque peu notre collaboration avec FC. Mais il y avait quelque part un os, le monde culturel français médiatique est drivé (pardon pour ce franglais, mais il est si suggestif) par un très petit nombre de personnages assez effacés et quelques vedettes comme les Adler, Toulouze ou Moati, et on n'entre pas dans ce ring qui a sa propre stratégie et n'a cure des suggestions d'individus sans importance comme moi. La puissance de ce cercle provient, bien entendu, de ses relations politiques, et si les trois que je viens de citer furent longtemps identifiés à la gauche médiatique, il y en avait d'autres comme Pierre André Boutang, fils de son père et cheval de Troie libero de la droite depuis la création de la 7 où il pilotait notamment très brillamment l'émission Océaniques.
Or les idées concernant l'influence des médias sur l'électorat ont évolué depuis le grand échec de Giscard en 81, la gifle la plus douloureuse infligée à ceux qui pensaient qu'il suffisait de dominer les médias pour se faire élire. Très lentement, on a pris conscience que les Français n'étaient pas les veaux que pensait De Gaulle et qu'on avait eu tort de négliger ces quelques studios qu'on met une demi-heure à trouver au fond d'un labyrinthe miteux, et cette petite troupe d'intellos honnêtes et avisés. Mais surtout de leur laisser la bride sur le cou comme on le faisait, une liberté qui compensait la faiblesse insensée de leur rémunération (les collaborateurs de FC ont été sans doute les plus mal payés du service public de la radio pendant quatre décennies, d'où pas mal de grèves dont le pouvoir n'avait cure étant donné la faiblesse de l'Audimat). " On " a donc décidé de tout chambouler, c'est à dire avant tout de mettre une autorité là où régnait une sorte d'autogestion naturelle, celle de l'intelligence. Or les réformes passent aujourd'hui d'abord par une mise au rancart des vieux, pour qui le signifiant même d'obéissance est une obscénité. Les vieux ont donc rejoint des placards où certains sont morts, les moyens-vieux ont été déplacés dans les programmes (Jean Lebrun par exemple), des programmes tellement rodés dans l'esprit de l'équipe et des auditeurs que leur bouleversement fut considéré comme un crime de lèse-intelligence, provoquant même la création instantanée d'une Association des Auditeurs de France-Culture, excédés par ces bouleversements. C'est ainsi que l'on confia les espaces sensibles (le 7-9) à de faux jeunes, ne conservant que quelques statues de Commandeur comme Michel Cazenave dont on n'avait rien à craindre étant donné la thématique de son émission. Un cas typique fut celui d'Antoine Spire, à propos duquel il faut donner quelques détails croustillants et généralement ignorés.
Antoine n'était pas salarié de FC, mais ce qu'on appelle un producteur. La différence avec les statutaires résidait toute entière dans le fait que FC pouvait acheter ou refuser ses produits, situation inconfortable et dangereuse pour ses revenus. Mais Antoine aimait cette situation où les choses étaient claires et où le salaire prouvait la qualité, et il faut dire qu'il a tenu le coup un temps infini, alors que ses cachets, m'a-t-il révélé un jour, étaient inférieurs à ceux d'un pigiste de onzième zone, au point de vivre dans des difficultés personnelles permanentes. Cette révélation m'avait effaré, car à l'époque, on pouvait presque affirmer que le seul nom de Spire résumait l'esprit de FC. Il est indéniable qu'Antoine a dérivé à partir de la fin des années 90 vers une certaine outrance politique qui, en réalité, reflétait la conscience qu'il avait de ce qui se tramait derrière les rideaux de la scène. Animé par une double rage personnelle et politique, il jouait en somme ses dernières cartes avant d'affronter en samouraï ex-stalinien qu'il était, les nouveaux maîtres de FC. Il faut prendre ce " nouveau " dans tous les sens du terme car ce mot n'avait aucun sens avant l'arrivée de Jean-Marie Cavada et de Laure Adler, même si un journaliste comme Jean Lebrun faisait régner une terreur professionnelle souriante mais sans pitié. C'était le prix de la qualité de ses produits journalistiques que tout le monde regrette aujourd'hui. C'était l'un des paradoxes de France-Culture, une autogestion sans laisser-aller, une liberté partagée mais selon des critères de rigueur et de qualité qu'aucune antenne française n'a jamais offerts à son auditoire. En 1975, pourtant, il suffisait de trois erreurs de forme ou de fond pour qu'un journaliste se fasse virer sans préavis à Europe 1. Là aussi régnait la rigueur, mais cette rigueur là était de la pure terreur. Pour s'en rendre compte, il suffisait d'entrer dans la newsroom. Europe 1 a été, je crois, la première radio a installer cette machinerie infernale, cette immense salle sans la moindre intimité professionnelle, où le Chef régnait sur son personnel à la manière d'un contremaître de chez Peugeot, cependant qu'à FC chacun bénéficiait encore de son propre bureau, de sa propre ligne téléphonique et d'une autonomie de création que moi-même n'ai connu que pendant quelques années à Arte, jusqu'à la création de la …newsroom.
Jean-Marie et Laure on donc procédé à ce qu'on appelle une reprise en main qui était en réalité une prise en main, un directeur comme Borzeix, celui qui a été poussé vers la porte à ce moment-là, étant avant tout le collaborateur numéro UN de tous les membres de FC et le défenseur de leurs intérêts. Bien mal lui en a pris. C'est par lui que j'ai appris une de ces curiosités qui illustre le mépris dans lequel le pouvoir tenait FC jusque dans les années 2000. En effet, FC était relativement bien capté à Paris, mais passé cent kilomètres, il devenait parfois simplement inaudible. Strasbourg a longtemps été une ville-martyr à cet égard, la fréquence de NRJ se situant à 0,001 mhz de celle de FC, elle l'écrasait littéralement sous son terrible Bou-Boum pour demeurés. Et comment, en FM, les quelques dizaines de Watts de FC pouvaient ils se mesurer aux 500 Mégawatts de NRJ ? Mais toute la France a souffert de cette avarice de l'état, avarice qui a également longtemps frappé FR3 pour deux raisons : le coût de l'énergie et la priorité laissée à TF1 et au privé comme NRJ. Voilà toutes sortes de petites manœuvres inconnues du public, mais qui éclairent en partie la désaffection classique des Français pour leur émetteur régional au profit des antennes nationales. Aujourd'hui cette injustice est enfin réparée, et le résultat ne s'est pas fait attendre en termes d'Audimat. La nouvelle direction de France-Culture s'est, il faut le reconnaître, rapidement attelé à ce problème, réaction classique de la préférence des maîtres pour la forme contre le fond. Nous écoutions FC comme Radio-Londres pendant la guerre, et nous étions ravis. Aujourd'hui nous entendons FC aussi bien que France-Inter, mais le cœur en berne.
Le cœur en berne. Pourquoi ? Sur le site Internet DDFC, un de ces sites qui semblent fédérer les auditeurs mécontents de FC, on tente de s'expliquer sur ce qui se passe dans la Maison Ronde. Et finalement c'est la perplexité qui domine, car FC continue de produire d'excellentes émissions littéraires, scientifiques, philosophiques et même musicales. La déchirure la plus évidente, et tout le monde la pointe violemment du doigt, c'est le 7-9, la tranche d'écoute la plus fréquentée car elle peut l'être par le plus grand nombre. Il est vrai que cette tranche a souffert en tout premier lieu de la prise en main politique de l'antenne. Mais je ne pense pas que ce soit la véritable raison de la colère latente chez la plupart des auditeurs qui se voient, malgré tout, contraints de rester à l'écoute de ce média. Non, ce qui a disparu du PAF, ce qu'on a enlevé aux Français une fois pour toute et sur quoi on ne pourrait même pas revenir, c'est l'effet d'un média libre, où des femmes et des hommes libres travaillaient en équipe et sur la base d'une fraternité de l'intelligence et de l'égalité, quitte à vivre mal payés et sans le moindre espoir d'un vedettariat quelconque. FC était un véritable lieu de réflexion commune et de nombreuses passerelles existaient entre les personnes et les programmes, c'était un foyer où les Français républicains pouvaient se reconnaître et se former, s'informer sans danger de mensonge et comprendre souvent par derrière ce que tous les autres médias ne montraient que par devant. C'était une seconde Ecole, pour beaucoup une université du savoir et des valeurs morales qui, malgré tout ce que l'on peut raconter sur ce pays, demeurent ce à quoi nous sommes le plus attachés. Bien sûr que sa création fut une erreur consciente destinée à diviser les Français, mais ce fut aussi une incroyable réussite car FC a démontré, dans son propre rayon d'action, la primauté de la Raison et de la culture que tout le monde aujourd'hui revendique. La crise que traverse FC aujourd'hui est ambivalente, car elle repose sur une critique normale de l'élitisme naturel d'un tel programme, mais en même temps elle prouve soudain une demande beaucoup plus vaste qu'on ne l'aurait imaginé encore il y a dix ans. Sur le site de DDFC, il y a des textes passionnants et intelligents, souvent écrits dans un Français de CM2, mais qu'importe ? La révolte des intellectuels longtemps blottis dans le chaud confort de la reconnaissance réciproque a déclenché un phénomène qui les dépasse et qui peut faire, dans un avenir pas si incertain que cela, qu'un nouveau France-Culture puisse voir le jour. Il faudra sans doute faire des sacrifices, comme on en fait aujourd'hui déjà et peut-être que Laure Adler n'est pas si machiavélique qu'on le dit ? Cavada non plus n'est pas mauvais bougre et ils ont bien le droit de se tromper sur quelques procédures si leur intention de faire passer FC dans une autre dimension est sincère. Mais cela reste le secret du destin des hommes et des choses. La seule chose qu'on peut dire de sûr à propos de tout cela, c'est que lorsque les statues de Commandeur commencent à vaciller, dans quelque sens que ce soit, il ne peut en découler que du bien. Et, il faut bien reconnaître que FC était devenu un monument pour une minorité de jouisseurs du savoir, d'épicuriens de la réflexion et de la recherche. Il fallait bien prendre un risque, celui de le casser pour l'ouvrir à d'autres, à beaucoup plus d'autres. Je ne suis pas sûr que ce soit la volonté de ceux qui aujourd'hui dirigent ce qui reste de FC, qui gèrent ses cendres. Mais peu importe, ce décès doit être considéré comme le symptôme d'une maturité du temps, d'un moment historique de changement important car les intellectuels qui deviennent orphelins apprennent ainsi à souffrir comme les autres et peut-être à entreprendre une démarche vers ces autres qui, DDFC le prouve, ne demandent pas mieux. A l'avenir on peut attendre au moins deux conséquences : la fuite des intellectuels idéologues vers de nouveaux foyers où seuls comptent leur confort et la jouissance de leur état, et le retour des autres intellectuels vers l'engagement et le combat pour les valeurs dont ils peuvent constater sur place qu'elles sont exposées au même anéantissement que celui de France-Culture.
Mardi 9 décembre 2003
Oedipe
Œdipe n'est pas un personnage mythique. Il n'appartient plus au double récit de la mythologie qui circule entre les dieux et les hommes au sens où les dieux sont absents de l'action, ils n'apparaissent plus que comme les porteurs de la parole du destin sans intervenir directement dans le sort des mortels. Ils prescrivent la vérité mais laissent celle-ci venir au jour par elle-même, c'est à dire par l'action, et ce dès l'origine, c'est à dire dès le moment de la décision prise par Laïos d'abandonner le nourrisson Œdipe à la mort. Chez Homère, les dieux s'amusent encore des hommes et interviennent directement dans leurs actions, allant jusqu'à les favoriser dans le combat ou les condamner à périr. Chez Sophocle, la transcendance a changé de nature, elle appartient au talent de l'être humain, capable de voyance et aussi de décryptage du langage divin. Le Sphinx n'intervient pas directement dans la pièce, il est hors récit direct, dans une représentation du passé qui indique précisément le moment de cette mutation du rôle des dieux. L'épisode de l'énigme elle-même n'est, symboliquement, rien d'autre que la naissance de l'homme en tant qu'Homme, la naissance du concept ou de l'espèce. Je pense qu'on ne m'a pas attendu pour faire de la tragédie de Sophocle l'articulation fondamentale de la culture grecque, la césure ou la rupture épistémologique entre le monde des pré-socratiques et celui du platonisme. Il est intéressant de noter le caractère avant-gardiste de cet événement lyrique par rapport à la théorie de l'idéalisme dont on peut dire qu'il est le Prologue et le résumé. Là encore l'artiste parle avant le philosophe la langue non encore philosophique mais qui condense le penser à venir des Grecs du cinquième siècle.
Il faut, cependant, analyser plus en profondeur ce qu'on pourrait nommer ici une voyance métaphysique. Ce dont il s'agit en fait, ce n'est pas le passage du mythe aux formes classiques de maniement du concept, mais la mutation spectaculaire du penser. Dans Œdipe les yeux perdent, au sens propre comme au sens figuré, leur pouvoir véritatif. La présence se détache de la perception, ou bien, on peut également le formuler autrement, la perception perd son accès à la présence en tant que telle, c'est à dire à la vérité. Pour le héros le monde vrai s'écroule pour devenir le domaine du mensonge, tout ce qu'il a vu dans les présents de sa vie passée jusqu'à son dialogue avec Tirésias se délite pour devenir tout à fait autre chose. C'est l'aléthéïa qui change de camp ou de méthode, elle se transforme en représentation. Dans la tragédie proprement dite, il n'y a presque aucune action. Celle-ci se condense dans le suicide de Jocaste et l'auto - aveuglement d'Œdipe. On est loin de l'Iliade et de l'Odyssée qui se présentent tous deux comme de purs récits d'actions successives. Sophocle décrit des actions passées et sa pièce se lit entièrement comme une ré interprétation du sens de ces actions pour les différents personnages. La vue, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le vécu de ces actions passées s'avère comme totalement faux par rapport à la vérité. Notons tout de suite qu'il existe quand-même deux personnages de second ordre, presque des figurants, qui par extraordinaire et pour les besoins de l'intrigue, ont de bons yeux. Pour les deux bergers la mémoire correspond trait pour trait au faits, alors que pour Œdipe, Jocaste et tout le peuple de Thèbes le passé et le présent sont tout simplement faux. Deux vieillards qui ont passé leur existence au niveau zéro de la société grecque, dans la fonction la plus triviale et culturellement la plus aveugle de toutes, garder des bêtes. Les aveugles de profession, les enfants les moins éduqués de la société grecque, sont les seuls à voir clair, à connaître dès l'origine la vérité sur l'identité et le sort d'Œdipe et, ce qui est encore plus important, à s'en souvenir, à garder cette vérité dans leur mémoire. Le statut de Tirésias n'est pas essentiellement différent de celui des aveugles qui l'entourent, car lui, le voyant, ne fait que répéter la voyance originelle qui contient en germe ce qui arrive à Thèbes dans le présent de la tragédie, à savoir la peste. Il applique la règle de l'herméneutique de ce qui est écrit, mektoub. En réalité il joue sa vie sur une logique implicite au produit de son talent de prophète, il prend le risque de désigner Œdipe comme coupable sans la moindre preuve, ce qui manque d'ailleurs de lui coûter la vie. Au total, nous n'avons de la société grecque proprement dite qu'une image d'un peuple fou ou aveugle, jouant une Histoire faussée dès le départ, sauf, je le rappelle car c'est important, deux représentants de la classe la plus humble de la République.
C'est effectivement la République de Platon mais à l'envers. Toute tentative d'identifier la tragédie de Sophocle à l'essence de la mutation épistémologique que va représenter le platonisme échoue forcément à cause de deux bergers qui ont échappé par miracle à la maladie d'Elsheimer. L'Aléthéïa en tant que telle se force un passage à travers la nécessité de la représentation du tragique. Elle s'empare de deux obscurs personnages pour ressurgir dans le dénouement. Car le dénouement n'est pas, dans Œdipe, les deux actions que nous avons citées et l'exil prescrit du héros, mais bel et bien l'apparition de la vérité à travers les yeux de deux figurants. Sans eux, sans leur témoignage, toute l'enquête que déclenche la voyance de Tirésias tombe à l'eau, échoue dans une impasse. Le tragique ne peut pas avoir lieu, tout simplement. On en serait resté tout au plus au niveau d'un drame psychologique de seconde catégorie. Il faut bien saisir les trois niveaux de définition de la vérité qui se jouent dans Œdipe : primo la voyance comme talent religieux, secundo la représentation comme développement de la voyance, et tertio le témoignage direct des actions. Tout le génie de Sophocle est dans cette description impitoyable de sa propre société : le véritable souverain est le prêtre qui prescrit le destin, le souverain apparent est le politique dont l'action (c'est à dire aussi bien les paroles que les actes concrets) ne fait qu'interpréter la prescription religieuse (en vrai ou en faux, c'est selon), et la souveraineté réelle qui réside dans le pouvoir être dans la présence en tant que présence du peuple lui-même. Il est inutile, à mon avis, de s'attarder sur la fonction du Chœur auquel on attribue généralement un rôle de représentation de l'opinion, ce qui est au fond juste si l'on ne confond pas le peuple avec cette opinion, ce que nous appellerions aujourd'hui les medias. Au total Œdipe Roi est bien une sorte d'hymne à la démocratie en son essence la plus stricte, car les deux bergers ne sont pas seulement les deux seuls personnage doués d'une bonne vue, ils sont surtout les véritables acteurs de la tragédie, les souverains de l'action.
Œdipe lui-même ne s'y trompe pas, qui comprend immédiatement que sa place, désormais, est dans le peuple, à son niveau le plus fruste et le plus pauvre. Ses yeux qu'il crève représentent en réalité la critique radicale du système politique qui régente Thèbes, et nous verrons dans Œdipe à Colone le héros se ressaisir en arrivant à Athènes, le berceau de la démocratie, et reprendre sous une autre forme la souveraineté spirituelle perdue. A noter aussi, et c'est essentiel à la compréhension du personnage, qu'il quitte Thèbes pour errer, nomadiser hors du monde de la représentation puisqu'il s'est débarrassé de ses yeux politiques. Il devient nomade réel et nomade spirituel, il redevient cela même qu'évoquent les artistes de toute l'Hellade, l'homme hors de la Cité, hors de la Tribu et même hors du génos, cette famille dont Aristote fera le pivot de toute sa politique aristocratique et bourgeoise. On pourrait aussi interpréter toute la tragédie d'Œdipe comme la condamnation de ce génos, comme l'affirmation que le modèle de la famille est, en vérité, fondé sur un mensonge, celui de l'inceste. La psychanalyse en fera ses choux gras mais Freud a compris, au soir de sa vie, que le destin du sujet n'est pas séparable de celui de la Cité, que l'ontogenèse n'est que le reflet de la phylogenèse. En prenant Moïse dans son collimateur, il s'en prenait aussi à Tirésias et à sa fonction de révélateur représentant de commerce d'un Sur-moi collectif transcendant et fantasmatique. Mais attention, la famille n'est pas un mensonge de par son origine, elle le devient par la représentation de son origine en tant que transgression du tabou.
Mais quelle transgression ? L'inceste ne suffit pas à combler toute la réalité de la notion de transgression, il y faut bien autre chose encore dont le parricide. Mais sur quel sol croît en vérité la possibilité de l'inceste et du parricide sinon sur celui du vivre-ensemble du social : le tabou n'est pas celui qu'on pense, le tabou est la vie sédentaire, la Cité qui repose sur la lèthè, sur le mensonge d'une morale impossible. Pourquoi impossible ? La réponse à cette question justifierait à elle seule tout le mal que je me donne ces derniers temps. Aussi vais-je devoir la peaufiner afin qu'elle soit de l'ordre de l'apodictique. Pour mener à bien ma démonstration je vous propose de revenir à Œdipe, quitte à pressurer encore un peu plus un texte qui figure à peu près comme Leitmotiv de l'occidental, de la psychanalyse jusqu'à la politique.
Ce n'est pas pour rien, et nous avons bien montré l'intrication de domaines aussi différents, en apparence, que l'ontologie et la politique. De nos jours, c'est la psychologie qui a réussi, avec Freud, une véritable OPA théorique, et ce n'est pas par hasard. Œdipe ferme le cercle de la métaphysique de la subjectité qu'en un sens il a lui-même ouvert : il prétend condenser en lui le redoutable problème du destin, cette entité mystérieuse qui doit aujourd'hui se lire non seulement dans les gènes, mais aussi dans l'inconscient, précisément dans l'Œdipe. La construction du sujet n'est pas terminée tant qu'il reste un recoin obscur de son " premier moteur " et la structure du sujet telle qu'en rendent compte aujourd'hui la science + la psychanalyse, qui soit dit en passant peuvent bien se situer dans deux camps opposés sans rien perdre de leur solidarité ontologique, autorise la clôture du problème, sa circonscription définitive. Mais il prétend faire mieux, il prétend étendre la résolution de l'énigme à la société toute entière. Les lacaniens ne tiennent pas pour absurde, bien au contraire, de promouvoir la psychanalyse à la hauteur d'une praxis collective désirable, non pas au sens d'une pratique collective ou collectiviste, mais d'une généralisation de la démarche psychanalytique individuelle. Pour guérir la société, chacun doit prendre en main sa propre guérison.
Un tel projet n'est même pas tellement absurde, sauf que de deux choses l'une, ou bien on prend ainsi le risque de disloquer la société par inadvertance, parce qu'il y a incompatibilité logique entre la vérité du sujet et celle de la Cité, ou bien ce risque est pris en connaissance de cause, et de ce point de vue on peut faire confiance aux lacaniens. Mais dans ce cas il ne pourrait s'agir que d'une phase d'une projet beaucoup plus vaste, une véritable révolution anthropologique, en fait, rien de moins que le retour au nomadisme qui figure noir sur blanc dans le destin du roi de Thèbes. Robinson n'est pas seulement derrière nous, il est droit devant, la Cité devra fermer ses portes et rendre les clés, elle n'aura servi qu'un temps, celui de produire l'usure, une certaine usure de l'Être, c'est à dire ce qui correspond aux effets destructeurs de l'usage, mais aussi aux intérêts du capital placé. Œdipe Roi réalise tout cela à l'envers : il prend la Cité et ses clés qu'il rend en retournant dans l'errance : la plus-value de cette opération apparaît bien comme une moins-value, comme une usure fatale à ses yeux, mais elle produit un intérêt qui compense largement cette infirmité qu'elle peut alors classer dans les frais généraux, elle produit la vérité. La Cité, fondée et détruite par Œdipe, n'aura jamais été que la mékanè, la machine à produire un supplément de sens, un bénéfice ontologique pour l'homme sur le point de retomber naturellement, c'est à dire sous l'effet de toutes les forces objectives, économie, politique, sociologie, dans son ancien statut nomade.
Cela se passe au présent, dans une histoire contemporaine dont le Leitmotiv médiatique et culturel tourne autour du salut de la Cité. Nulle question aujourd'hui ne paraît plus urgente ni plus essentielle, tant le déclin de cette même Cité semble amorcé : tel Œdipe, l'homme actuel s'est aveuglé sur la nature et le sens de son habiter-le-monde et refuse d'envisager une évidence qui se dessine chaque jour avec plus d'acuité : la Cité doit mourir parce qu'elle est effectivement fondée sur le sable du mensonge. Le génie de Sophocle est d'avoir montré cela au moment même où la Cité entrait dans son acmé historique, au moment précis, où le contre-poison semblait avoir été trouvé sous la forme de la Démocratie. Au moment où Clisthène entreprend la réforme d'Athènes dans le sens de la démocratie, Sophocle joue aux billes sur l'Agora. Or il faut concevoir la démocratie comme une véritable révolution car elle rompt brutalement avec l'essence du politique tel qu'il s'engendre à partir de la famille, du génos, dans la logique somme toute assez rationnelle de la politique d'Aristote. Nous disons somme toute parce que le système aristotélicien repose sur un point aveugle ou sur un axiome que le Stagirite fait passer en force, à savoir la naturalité de la famille et celle du passage de la famille à la communauté politique, à la Cité. Cela signifie en clair que la Tyrannie est le modèle naturel, c'est à dire le meilleur possible, même s'il convient de le modérer dans le sens de l'aristocratisme, c'est à dire le gouvernement de l'oligarchie. Or, il n'existe rien qui puisse servir de preuve logique d'une telle naturalité, et si on ne veut voir dans Œdipe qu'une seule chose, à savoir un message politique, c'est bien celui qui vient remettre en cause massivement la légitimité de la Tyrannie, c'est à dire d'un génos rongé de l'intérieur par le mensonge. La famille repose nécessairement sur le parricide et l'inceste, elle ne peut donc en aucun cas servir de modèle à une communauté politique. C'est ce que rappelle Freud en laissant entendre que la violence qui mine notre civilisation ne peut aller qu'en s'amplifiant, l'augmentation de la puissance du Sur-moi collectif venant alimenter elle-même la violence originaire.
C'est donc la Démocratie qui doit sauver l'existence de la communauté. Dans Œdipe Roi, nous l'avons vu, il y a deux peuples, voire trois. Il y a d'abord le peuple muet, celui qui est implicite à l'exercice du pouvoir royal et qui ne se manifeste qu'à travers le deuxième peuple, le peuple médiatique, à savoir le Chœur. Or le véritable peuple entre en scène seulement vers la fin, sous les traits des deux bergers dont le témoignage entraîne le dénouement de la tragédie. Cadmos est sauve, la communauté peut continuer de vivre grâce à l'intervention dans le débat public de deux citoyens qui sont à peine des citoyens : l'un est un Corinthien, c'est un étranger, l'autre est un esclave. C'est lourdement forcer les choses, pourrait-on objecter, que de donner à l'intervention des deux bergers une dimension démocratique, d'autant que, même si leur témoignage est nécessaire, il ne prend sa légitimité dernière que dans l'assentiment du Choeur qui reconnaît le berger auquel Jocaste avait remis Œdipe enfant. Or c'est justement dans cette reconnaissance d'un esclave par le Peuple Médiatique que se joue la véritable action du peuple, la démocratie. Jocaste n'a même pas besoin de témoigner, car c'est elle seule qui pourrait reconnaître réellement celui qui a sauvé la vie de son époux, la conscience collective a pris la place de la singularité souveraine. Le jeu s'accomplit à partir de l'autorité du peuple, devenu la seule partie saine de la Cité, non contaminée par les crimes du passé. Toute la tragédie repose en définitive sur ce dénouement qui aurait logiquement dû rester bien improbable. De nos jours, le premier avocat venu discréditerait sans difficulté les témoignages de ces deux moins que rien. C'est dire si Jocaste avait le pouvoir d'en faire autant, mais la vérité avait changé de camp, parce que les règles du jeu politique avait déjà changé dans la conscience grecque.
Mercredi 10 décembre 2003
Physis et Tekhnè
Tout examen ontologique, tout commentaire sur la pensée de l'Être, passe nécessairement par une explication de ces deux mots grecs. Dans ce cas, je parlerai d'interprétation, une interprétation pour laquelle je ne revendique aucune originalité par rapport à tout ce qu'a déjà dit et répété le philosophe de la Forêt-Noire. Je me contenterai de parler à ce sujet ma propre langue, quitte à ressasser et, peut-être quand-même à évoquer à leur propos une problématique sur laquelle Heidegger ne s'est guère explicitement attardé. Contrairement à Roger Chambon dont le doute sur le " fondement " heideggerien s'accorde parfaitement avec son scepticisme radical et sa certitude sur le devenir néant du monde.
Comme le souligne abondamment Heidegger, les concepts de Physis et de Tekhnè ont été utilisés comme concepts opératoires de la révolution platonicienne, de la mise en quarantaine de l'aléthéia en tant qu'idea. En fait, c'est la différence essentielle introduite par Platon entre ces deux mots qui détermine la vérité comme produit de la tekhnè, la physis étant renvoyée dans le mouvement aveugle et autonome de la nature. La vérité devient avec Platon un produit de l'homme, une pure création transcendantale dont l'ambition peut se traduire par la prétention d'identifier l'être lui-même avec le produit de l'œuvre de l'esprit, du travail intellectuel ; on pourrait encore dire de son ingénierie. Le véritable démiurge devient ainsi l'homme lui-même dont toute l'histoire devient une recherche ontologique, mais non pas une recherche spirituelle de compréhension de l'être ou de compréhension de la relation qui nous unit à lui, mais une véritable création. L'idée moderne de progrès est le frère jumeau de cette absurdité, qui prétend découvrir, à chaque étape de ses découverte techniques, un moyen supplémentaire d'en somme construire l'Être lui-même. Au Moyen-Âge, l'ambition était encore plus modeste et ne dépassait pas le désir d'approcher l'Être, étant entendu que cet Être était alors conçu comme transcendance divine, comme le substantif absolu de la seule et véritable réalité sur-existante à notre monde obscur et fallacieux.
Or, comment a-t-on pu dénaturer en quelque sorte la tekhnè elle-même ? C'est à dire par quel tour de passe-passe a-t-on pu introduire une différence essentielle entre la position de l'homme dans l'Être - et donc aussi la nature de tout ce qu'il peut produire de ses mains ou de son esprit - et celle de ce qui n'est pas l'homme ? Par quel miracle les ruches construites par l'homme seraient-elles d'une autre essence que celles construites par les abeilles ou les fourmis ? Attention : il ne s'agit pas ici de se prononcer sur la question que pose la différence formelle entre ces étants, mais bien d'insister sur le fait que la différence absolue posée par la métaphysique occidentale n'a jamais été qu'une simple décision aléatoire, sans aucun fondement logique ni substantiel. C'est ce que Spinoza ne s'est pas gêné d'envoyer dire à tous les philosophes de son temps. Or l'enjeu de cette différence est de taille : depuis Platon jusqu'à Descartes et au-delà, la réalité est devenu affaire de production intellectuelle, pour parler simple. Le mythe de la caverne n'est rien d'autre qu'une mise en scène du divorce que prononce Platon pour plus de deux mille ans entre l'Être et l'Être conçu. Seul ce dernier jouit pour ainsi dire du statut de réalité. Un millénaire et demi plus tard Descartes parlera carrément de plus ou moins de réalité selon que la res extensa sera ou non passé au crible de la science, encore ou déjà nommée Raison et devenue ainsi la mathesis universalis. D'ailleurs je m'exprime très mal sur cette affaire, car il n'y a d'Être que transcendantal, de réalité que pesée au trébuchet du Bien. Ne cherchez pas trop loin, il ne s'agit que de la très scolastique identification du Bien à Dieu. Dieu l'Être substantivé par la différence entre eidola et idea - que l'on retrouve dans le judaïsme sous la différence entre Dieu et les idoles.
" Tout est phusique ". Ce n'est pas de moi, Roger Chambon écrivit cela dans sa volumineuse thèse sur " Le Monde comme Perception et comme Réalité" . Il voulait dire par là que rien n'échappe à la physis et à son destin. L'homme, ses productions, même ses idées - sans doute aussi celles-là mêmes de vérité et d'être - sont condamnés au même sort que les produits dits de la nature. La vérité, l'Être sont sujets à la mort, comme une vulgaire lame de couteau, ils s'usent, ils perdent leur réalité. Leur idéité, si l'on peut dire.
Effrayant ? Comment l'idée de vérité pourrait-elle décliner pour finir dans l'un ou l'autre débarras de l'Histoire ? Question assez ridicule en regard de ce que les empiristes et autres pragmatistes lui ont déjà fait subir. Je suis à peu près convaincu que ce concept a quasiment cessé non seulement d'être observé et étudié dans son histoire, mais qu'il a perdu toute existence dans les affaires universitaires anglo-saxonnes. Tout au plus l'idée de vérité sert-elle encore de repoussoir, voyez les termes implacables d'un Peirce, mais même ce souci de fonder en origine toute réflexion disparaît face aux urgences de l'efficacité et du fonctionnement. Mais l'Être ?
Une certaine ontologie est à la mode, même en Amérique. De subtils commentateurs noircissent des pages sur l'ontologie fondamentale et Heidegger reste un " must " philosophique (mais peut-on encore dire philosophique ?) dans l'establishment anglo-saxon. Par malheur, les plus érudits de ces professeurs semblent avoir entrepris la pire des réductions phénoménologiques du texte original. En Amérique, Heidegger passe au mieux pour une sorte de Moïse contemporain, répétant en bégayant les fulgurances de Parménide, d'Héraclite ou d'Anaximandre. Ironie suprême, l'auteur de Sein und Zeit serait devenu le continuateur goy d'une herméneutique dont seuls les Juifs ont la passion. Mais là encore il y a un malentendu non dépourvu d'un fond inconscient d'antisémitisme, car la passion rabbinique, l'herméneutique du Livre, même dans son élément d'absoluité religieuse, est elle-même tout autre chose que la simple cantilène théologique que semblent en faire les universitaires californiens. En plus d'un sens, la lecture judaïque de la Bible est restée fidèle au questionnement sur la présentéité du présent, sur ses correspondances et ses discrépances avec, pour parler vite, la temporalité divine, c'est à dire le moment de la révélation. Pour nous, ce moment est bien celui de l'origine de la différence ontologique, mais non pas selon la fable romanesque de la Genèse, mais selon le geste fondateur du choix de l'immobile, i.e. du sédentarisme. L'homme s'est retiré du jeu, du mouvement dont Aristote retrouvera des millénaires plus tard, l'essence en tant qu'essence de l'Être. L'homme a changé d'étance, et ce changement a fait surgir l'étant en tant qu'étant au sens de l'objet. Cet événement n'est mystérieux dans sa causalité que dans une appréhension elle-même causale de l'Être. Il participe en réalité du jeu de l'Être lui-même avec lui-même, d'une véritable surenchère ontologique. La civilisation pourrait passer pour un coup de force de l'Être, et s'il y a un sens à chercher, c'est bien celui de ce geste-là et de rien d'autre.
La dichotomie physis / teckhnè s'avère en définitive n'être qu'une simple martingale opératoire indispensable pour mener à bien la transformation de la philosophie en cette anthropologie qui domine le champ de pensée depuis Socrate. L'invention du transcendantal tire un trait sur l'essence de la question de l'Être. Lisons ensemble les deux premiers paragraphes du Livre III de la Somme de la Foi Catholique contre les Gentils de Saint Thomas d'Aquin :
Titre : " Les astres n'ont aucune influence sur notre intelligence "
" En ce que nous avons établi jusqu'ici, il résulte clairement que les corps célestes ne peuvent rien produire dans l'ordre intellectuel. En effet :
1° Nous avons prouvé que l'ordre de la Providence divine consiste en ce que les êtres supérieurs dirigent les êtres inférieurs et leur impriment le mouvement (ch.81 et 82). Or, dans l'ordre de la nature, l'intelligence est au-dessus de tous les corps (ch.49 et 78). Il est donc impossible que les corps célestes agissent directement sur l'intelligence. Donc ils ne peuvent être par eux-mêmes la cause des faits qui dépendent de l'intelligence. " Et un peu plus loin : " Or, rigoureusement parlant, les faits de l'ordre intellectuel sont absolument étrangers au mouvement, comme Aristote le prouve… "4
" L'intelligence est au-dessus de tous les corps ". Que peut bien signifier cette élévation de l'intelligence au-dessus des corps ? Hé bien, rien moins que la déchirure de l'Être en deux éléments : l'intelligence et les corps, mais peut-on se servir du mot élément pour désigner deux entités dont le destin fatal, dans la stratégie religieuse, est une ré-unification par forfait des corps, par leur néantisation annoncée puisqu'au demeurant déjà, originellement, hors de l'Être ? Il y a une fable de l'Être, partout présente ou suggérée dans les livres dits sacrés dont le modèle le plus simple se trouve dans le recueil des textes du soit-disant Hermes Trismégiste dont on ne sait rien sinon que son nom recouvre vraisemblablement l'identité d'un groupe de gnostiques des trois et quatrième siècles après JC. Le scénario de cette Gnose est assez simple, et pour tout dire séduisante et relativement neutre. Elle fournit une explication certes théologique de l'univers, et si l'on fait abstraction d'un style fortement influencé par les Ecrits des deux Testaments et des Pères de l'Eglise, on peut y trouver matière à représentation stimulante pour qui veut s'initier à la question de l'Être sur le mode conceptuel. Cette dernière remarque fait évidemment allusion aux premières phrases de Être et Temps, où Heidegger nous ouvre les yeux sur le fait que, quelle que soit notre position dans l'étant, nous sommes toujours déjà saisis par la question de l'Être.
Hermes Trismégiste nous présente donc l'étant, le monde des corps pour parler vite, comme la conséquence malheureuse d'une sorte d'explosion de l'Être, de Dieu à vrai dire. Les eons, sortes d'anges qui peuplent l'univers originel, un univers purement spirituel, ont chuté pour de mystérieuses raisons dans la matière. Chacun d'entre eux s'est ainsi retrouvé en tant qu'hôte du corps d'un être humain, hôte qui n'est rien d'autre que son intelligence. Ici, la déchirure n'est pas une véritable déchirure entre deux mondes préexistants, parce que la transformation en matière est le destin des éons, de ces anges dont nous sommes les réceptacles et avec lesquels nous entretenons une relation morale. Problématique d'ailleurs redoutable puisqu'elle institue un dialogue muet, impossible si l'intelligence n'a affaire à rien d'autre qu'à la matière. Or le destin, plus puissant que Dieu lui-même (toujours selon HT) peut suggérer l'idée d'une double âme, d'une conscience divisée, sinon déjà l'existence d'un système conscient à côté d'un Inconscient. Evidemment le désir permanent de chaque éon égaré dans la hylè, la matière, est son retour dans le ciel de l'Un, en somme sa désincarnation ou, comme chez les bouddhistes, l'arrêt du cycle des incarnations. La question de l'Être est, en fait, la passion de l'Être au sens de la passion christique.
La dichotomie physis / tékhnè est tout autre chose, même si le teknique se pose toujours comme l'élément de l'intelligible, du moins comme sa métaphore. Les idées platoniciennes ne se découvrent pas immédiatement dans un regard qui irait à une pure présence, elles deviennent patentes, elles perdent leur latence dans le spectacle du produit de la main de l'homme. C'est en contemplant une maison que le philosophe en infère la préexistence d'une maison idéale dans l'esprit de l'architecte, en observant un outil qu'il comprend la réalité transcendantale de l'action humaine. L'idée de la maison en tant qu'abri, l'idée du rapport entre le poids du marteau et la densité des matériaux n'appartiennent pas à la matière elle-même, elles en sont la vérité dont le seul détenteur serait l'homme. L'idée de tekhnè, c'est à dire d'activité essentiellement humaine, propulse ce même homme hors de la nature elle-même, elle en fait une sorte d'extra-terrestre. Un extra-terrestre qui importe son savoir et son savoir-faire d'une autre galaxie, le ciel des idées, l'hyperouranios topos. L'homme devient porteur de la vérité qui vient, comme le dit le feuilleton, d'ailleurs. De son côté, la physis est renvoyé à sa place de matériaux expérimental de la tekhnè, de matière qui avec les siècles finira en mathésis universalis, c'est à dire en pure quantité d'espace mû par Dieu. Ce sera le schéma de Descartes. On peut dire aussi Einstein.
Les temps modernes pourtant, par leur théorisation de plus en plus détaillée et suspicieuse de ce qui porte le nom d'écologie 5 se sont mis en route vers une autre manière de voir la tekhnè. La technique est aujourd'hui mise en accusation comme fauteuse de mal, sous la forme de défiguration du paysage, de producteur de nuisances multiples et de danger pour de supposés équilibres dont on ne possède pas d'autres assurances qui prouvent qu'ils existent que de vagues postulats pseudo scientifiques. Du même coup son mentor est devenu suspect : l'Homme est devenu un personnage faustien dont l'assouvissement de ses passions, servies par sa maîtrise de la tekhnè, contient le risque majeur de l'anéantissement de cette physis hier encore si méprisée. Cette nouvelle fable n'est pas moins ridicule que la précédente, mais elle " envoie " dans l'étant une nouvelle guise de la question de l'Être et en même temps de son oubli. Elle ôte à l'empire de la technique sa garantie ontologique : l'homme n'est plus seulement mis en examen en quelque sorte pour ses manquements à la moralité, pour l'absence de vertus, mais c'est sa puissance technique elle-même, ce qui a depuis toujours prouvé sa supériorité absolue au titre de sa relation au monde des idées, qui est aujourd'hui mis en cause.
Oh ! ne nous leurrons pas. Cette mise en cause, non seulement est à peine dans sa phase de gestation, dans l'affairement discursif de l'opinion publique, mais ne possède réellement aucun impact concret ni de certitude scientifique, ni de puissance politique. L'écologie n'en est qu'à ses balbutiements, la preuve en étant qu'elle repose encore entièrement sur des mythes scientistes comme les équilibres naturels, et qu'elle demeure encore loin de son seul objet véritable à savoir le poème du monde. La Parole sur l'Habiter sera la traduction prochaine de ce néologisme de laboratoire. J'ai développé cette expression dans mon ouvrage sur le nomadisme,6 mais j'y reviendrai dans la suite, peut-être dans un chapitre qui portera ce titre analogue : l'habiter l'Être. Au demeurant, l'écologie telle qu'elle se présente de nos jours comporte un danger tout aussi grand que cela même contre quoi elle s'élève, et cela précisément parce qu'elle n'accorde aucune attention à l'essence même de ce dont elle parle, à savoir l'habiter le monde. La tyrannie du symbiotique n'est que l'envers de l'univers cartésien sécable à l'infini, elle en est pratiquement l'achèvement sous la forme de l'uniformité d'un monde exclu du risque. Nous pourrions connaître l'empire aristotélicien de la médiété, société figée dont rêvait un homme dont le disciple le plus célèbre fut le fossoyeur de la Grèce antique, Alexandre. Nous aurions ainsi atteint le stade de la ruche.
Il faut donc en finir avec cette fausse dichotomie. Il n'existe pas plus d'opposition entre la nature et l'homme, entre un arbre qui croît et la main qui produit, qu'entre le destin d'un brin d'herbe et celui d'un coquillage du fond de l'océan. L'entreprise monde finira par fermer ses portes comme n'importe quelle compagnie et la tekhnè n'y changera rien. A supposer même que la technique puisse un jour permettre à l'être humain de se transporter sur une autre planète, il y rencontrera exactement le même destin et la même question sur ce destin. Qu'il réalise un tel projet dans l'exaltation de l'aventure humaine, tant mieux, il réussira ainsi à enrichir le trésor des étants qu'il affecte de collectionner et de répertorier. Mais qu'il ne compte pas mettre la main sur la réponse de l'Être, sa déception ontologique lui enjoindra cruellement une fois de plus de revoir sa copie sur le sens de son existence.
Jeudi 11 décembre 2003
Les deux gambits tragiques de Bush.
Cela fait désormais plusieurs mois que je n'écris pratiquement plus rien sur l'actualité. La raison principale de ce silence est le fait que je déteste me répéter. La plupart des événements qui se succèdent depuis fort longtemps avaient en effet été prévus dans mes chroniques, et il est difficile, dans ces conditions, d'en reparler sans avoir la désagréable impression de radoter ou de frimer. Il existe cependant, ce qu'on appelle les sauts qualitatifs, à savoir ces moments où l'accumulation de la quantité transforme la qualité. Le saut dont je vais parler aujourd'hui, en réalité également prévu dans mes analyses précédentes, est ce tournant dans les relations transatlantiques que représente la décision américaine d'exclure le continent européen et russo-asiatique des contrats de reconstruction de l'Irak. Il s'agit là effectivement d'un événement prévu et annoncé, mais son passage dans la réalité en fait un moment de l'hostilité transatlantique crucial, qui va avoir des conséquences en cascades sur l'ensemble de ce qui passe aujourd'hui pour la " mondialisation ".
On ne sait pas grand chose, l'information devenant de plus en plus opaque, sur les conditions et les réactions dans lesquelles ce formidable défi lancé par Bush se réalise. Le président aurait " téléphoné " aux chefs d'états d'outre-Atlantique pour leur faire connaître sa décision, voilà ce qu'on sait. On affirme aussi que Jacques Chirac a déclaré que cette décision était illégale au regard des règlements de l'OMC, ce qui paraît évident, l'OMC étant par avance la première victime de cette décision qui mélange de manière scandaleuse économie et politique. Car c'est de cela qu'il s'agit, Washington tombe le masque d'une hétérogénéité principielle et essentielle supposée des secteurs de l'économie et de la politique, geste d'une gravité infinie qui par ailleurs conforte toute mes théories sur l'inexistence de l'économie en tant qu'activité autonome.
Nous voici donc au tournant attendu, celui de la rupture interne, de la faille qui se dessine à l'intérieur du capitalisme mondial, et le brutal durcissement des autorités judiciaires dans l'affaire Pinault ( en réalité celle de la survie d'une grande banque française au Etats-Unis), indique que cette hostilité est déjà répartie dans l'ensemble du domaine économique. Autrement dit, nous sommes à la veille de l'anéantissement de toute une structure datant de l'après-guerre, comprenant des institutions aussi puissantes et aussi lourdes que l'OTAN, l'OCDE et sans aucun doute l'OMC elle-même. C'est en fait la fin du GATT et le commencement d'une restructuration complète du paysage mondial de l'économie et de la politique. Existe-t-il un exemple comparable dans l'histoire d'une telle rupture d'équilibre ? Sans doute, mais je pense qu'il faut remonter jusqu'à la rupture interne de l'Empire romain en deux entités occidentale et orientale pour trouver une comparaison possible. On sait les conséquences de cette scission que l'on peut résumer de la manière suivante : en occident (l'Europe d'aujourd'hui) le morcellement un instant retardé par l'Empire carolingien, produit un affaiblissement continu qu'atteste la puissance grandissante de l'Eglise aux dépens des états, alors que l'Orient connaît un progrès continu et un développement de puissance telle qu'elle finit par mettre le siège autour de Vienne, autour du cœur même de l'Occident. L'Islam et l'Empire ottoman forment ensemble une puissance homogène que l'occident ne connaîtra plus avant le dix-neuvième siècle et ses empires mondiaux. Comme on le sait, cependant, cette puissance orientale n'était qu'apparente, aussi apparente que la forme même de l'Empire ottoman, qui, comme on le sait, n'était en réalité qu'un réseau fragile de relais militaires qui, couvrant un territoire immense, n'a jamais réussi à ottomaniser socialement et culturellement les espaces occupés. Au fond, la situation était la même qu'en occident, à savoir que seule la religion cimentait une partie du monde et lui conférait la puissance économique et militaire.
La question est donc la suivante : et maintenant ? Je crois avoir aussi déjà fait état de la suite des événements dans l'une de mes chroniques, sans doute d'une manière un peu caricaturale, donnant une suite extrême-orientale à une stratégie qui, pour le moment semble se cantonner autour des problèmes du Moyen-Orient. Mais il est inutile désormais de chercher à déceler la ligne stratégique d'une puissance qui semble avoir perdu la tête. L'Amérique a cessé d'exister en tant que puissance civilisée ; le passage de la stratégie militaire du zéro-morts à la mort quotidienne dans les rues de Badgad tente de mettre fin à la culture de paix qui s'installe invinciblement dans le monde. Je viens d'entendre par la bouche d'Alexandre Adler que Hilary Clinton se déclarait entièrement en accord avec la politique belliciste de Bush. Voilà qui suffit à faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un écart de politique intérieure, c'est à dire au fond d'une erreur électorale aux conséquences désastreuses. Non, il s'agit au contraire bel et bien de toute une société malade, malade de son désarroi ontologique qu'illustre son désarroi économique : l'Amérique est au bord de la faillite, d'une faillite tout à fait semblable à celle qui s'empara de l'Allemagne de Weimar mais pour de toutes autres raisons. Bush n'est donc qu'une ombre du Führer, mais une ombre terrifiante pour toute une partie du monde. La décision qu'il a prise est un double-gambit perdu d'avance. Le premier vise à diviser l'Europe qui semble traverser un moment difficile de son histoire. Le second, bien plus essentiel, vise à stopper net l'évolution politique du monde vers une culture de paix. Depuis la première guerre du Golfe, on a compris que l'Amérique, dont on sait qu'elle avait littéralement fomenté le geste de Saddam Hussein envers le Koweit, avait besoin de la guerre pour se sortir de ses difficultés économiques qui n'ont jamais cessé de s'accumuler depuis la décision de Nixon de laisser flotter le dollar. Cet acte de banditisme international - dénonciation unilatérale des Accords de Bretton-Woods - était à double tranchants. S'il permettait à l'Amérique d'accorder le cours du dollar à ses besoins immédiats, il laissait aussi des puissances grandissantes comme le Japon s'emparer de montagnes de Bons du Trésor en dollars de pacotilles, trésor qui représente aujourd'hui encore, une menace écrasante pour Washington. Il suffit de s'imaginer que Tokyo décide du jour au lendemain de se défaire de ces dollars pour prendre conscience du danger qui menace l'Amérique. La hausse continue de l'Euro me semble d'ailleurs montrer que le processus est déjà engagé, et que le dollar n'est rien moins que menacé de finir comme le Reichsmark des années vingt. La guerre est donc le dernier recours pour cette nation qui a trop bien vécu aux dépens du monde entier, et en particulier du Sud. Cette guerre ne saurait donc s'arrêter aux portes de Bagdad et devra nécessairement se mondialiser, il faut en être conscient. Les quelques chefs d'états qui n'ont pas suivi Bush ont certainement compris cet enjeu capital et la neutralité qu'ils ont choisie leur rapportera les mêmes dividendes que celles que la Suisse a palpés après la Seconde Guerre Mondiale. Quant à Blair, il est politiquement mort.
Vendredi 12 décembre 2003
Sous le voile.
Avant qu'une maladie ne se déclare de manière patente, certains symptômes se manifestent toujours qui permettent aux personnes conscientes de prendre certaines précautions afin d'éviter le pire, voire bloquer le processus morbide. La question du jour est donc de savoir si le traitement de la question du voile en est encore au stade du symptôme ou bien si la maladie est, cette fois-ci, bel et bien déclarée. Apparemment la création et le travail de la Commission Stasi, l'un des rares hommes politiques de droite qui fasse l'unanimité quant à son honnêteté et à son intelligence, devait constituer la parade destinée à éviter l'infection mortelle. Mais les réactions que soulève le rapport ne portent guère à l'optimisme même si on sait que chaque rapport de ce genre commence toujours par soulever beaucoup de poussière avant d'être classé au fond d'un tiroir après avoir donné sa substance à une ou plusieurs lois dont on entend à peine parler, tant tardent à venir les décrets d'application, sans parler de l'ignorance totale dans laquelle demeure l'opinion publique quant aux circulaires d'application qui restent, elles, parfaitement cachées dans les coffres des hauts fonctionnaires chargés d'appliquer la loi. On ne peut donc rien dire sur l'avenir de ce rapport dont les médias ne nous donnent qu'un aperçu tellement vague qu'il finit par se condenser en quelques mots-phares éblouissants comme " visible ", " ostentatoire " ou " ostensible ". Les commentateurs hostiles a priori s'empressent de souligner l'absurdité qui consiste à proposer deux jours fériés supplémentaires alors que le gouvernement vient d'en supprimer un pour des raisons budgétaires pressantes.
Dans l'optique d'une analyse symptomatique, on peut pourtant discerner une étrange coïncidence que personne ne semble relever : l'affaire du voile, dont on parle depuis plusieurs lustres en France, comme d'un problème propre à notre pays, ressurgit au moment précis où les 25 pays de la future Europe - qu'est-ce qui nous oblige encore aujourd'hui de parler de la " future " Europe alors que l'Euro a depuis longtemps soudé au moins douze pays ? - négocient l'adoption d'une Constitution où, comme par hasard, le problème religieux pose l'un des principaux obstacles à un consensus. Bien sûr, la question du droit de vote et celle du veto restent le principal souci de la plupart des petits pays qui se sentent menacés de disparition politique, mais la question essentielle à propos de laquelle leur vote devrait vraiment compter nous renvoie comme par hasard à la présence de Dieu dans le texte fondateur de cette nouvelle Europe élargie. Autrement dit, le religieux jaillit littéralement dans le paysage médiatique de tous côtés. Je n'ai jamais entendu prononcer le mot laïcité aussi souvent que depuis quelques semaines, et ce autant à propos de la réalité française que par rapport à l'espace européen.
Dieu et ses avatars humains ne sont donc pas par hasard à l'ordre du jour d'un bout à l'autre du monde occidental, et, il ne faudrait pas l'oublier, de l'Orient, où s'y mêle une violence quotidienne désormais banalisée. Il ne s'agit rien moins que de la manifestation du réel dans toute sa vérité, à savoir l'apparition du moteur ou des motivations réelles des actions humaines. Ce qu'il faut immédiatement préciser, c'est qu'il ne s'agit nullement d'une opposition entre religions différentes, mais d'une opposition fondamentale entre le religieux d'une part, et d'autre part le refus d'intégrer le religieux dans la sphère de l'action politique ou sociale. Déjà la guerre déclenchée par le président des Etats-Unis au Moyen-Orient était tout entière déterminée par un souci religieux que résume l'expression insolemment osée par un chef d'état occidental : l'axe du mal. Souvenir et amalgame d'un usage du mot axe en des temps où le canon tonnait d'un bout à l'autre du monde, mais où Hitler lui-même n'aurait eu l'idée de baptiser Axe du Bien l'alliance qui unissait son pays au Japon et à l'Italie. Oui, de partout le religieux suinte pour se coaguler comme des gouttes de mercure et reprendre dans l' espace de l'existence humaine toute la place qu'il avait usurpé pendant deux millénaires. C'est au fond l'heure de la vengeance, vengeance des outrages que le temps scientifique et démocratique a osé lui infliger, le repoussant dans un statut marginal d'où il ne devait jamais plus ressurgir.
Et la revoili, la revoilà. Nous entrons dans un nouvelle guerre de religion à l'échelle mondiale, guerre dont l'Europe ne ressent pour l'instant encore que le clapotis d'une tempête qui a lieu à quelques milliers de kilomètres, mais dont l'effet ne manque pas de s'étendre à l'intérieur même de son être-là historique. On pourrait presque dire, de manière ironiquement métaphorique, que Bush réussit en Europe une opération totalement ratée au Moyen-Orient, c'est à dire faire entrer la dimension religieuse dans sa stratégie de division de son principal adversaire, l'Europe. A Bagdad, les choses ne tournent pas du tout comme prévu, car pour régler son problème, il devrait choisir radicalement de donner le pouvoir aux Chiites, manière de renverser la situation traditionnelle qui conférait le pouvoir aux Sunnites protégés par Saddam. Peu d'analystes ont cherché à comprendre comment il était possible de diriger un pays de manière laïque, là où la haine oppose depuis des siècles une majorité de Chiites et une minorité de Sunnites. Peut-être que l'aspect sanglant de la dictature de Saddam pourrait trouver au moins un début d'explication sinon de justification. Bush aurait donc pu simplement passer le relais aux Chiites majoritaires, mais les Sunnites sont aussi les plus précieux alliés de l'Amérique, d'un bout à l'autre du Proche et Moyen Orient. Echec et mat, l'Irak est condamnée à un avenir de pure anarchie militarisée par une occupation sans fin possible, à moins que le futur chef de l'état américain, s'il ne s'appelle pas Bush, trouve quelque part le courage nécessaire pour décider de déguerpir en laissant tout le pouvoir à l'ONU et à la communauté internationale. Je radote.
Il ne nous reste, à nous Européens, qu'à attendre ce qui va ressortir des deux processus en cours, celui de l'élaboration en France d'une loi sur les signes d'appartenance religieuse (qui risque fort de faire école dans d'autres pays si elle s'avère positive, car le problème de l'ostensible ou de l'ostentatoire ne se pose pas qu'en France, il suffit d'aller faire un tour en Bavière, où la chasse aux crucifix n'a pas encore commencé malgré les décisions du Conseil Constitutionnel de Karlsruhe) et celui de la Convention préalable à la Constitution européenne. Pour le reste, nous avons la chance de disposer, entre l'espace de la violence religieuse proprement dite, de l'Afghanistan au Hedjaz, de zones où la laïcité a fortement imprégné le terreau du politique et du social. La Turquie nous apparaît, dans cette conjoncture, comme une véritable bénédiction, car malgré le succès politique des islamistes, les effets de la révolution laïque du début du vingtième siècle sont intacts. Par ailleurs, les pays du Maghreb et du Machreck ont intérêt à éradiquer toute velléité de rendre au religieux les pouvoirs qu'il réclame depuis la création des Frères Musulmans. Au total, la situation est donc la suivante : il y a deux fronts, le front intérieur à l'Europe, et celui qui la déborde vers l'Est. Sur le premier s'affrontent la puissance tranquille d'états laïcisés, peut-on dire, dans l'âme (Même la Suède, qui est encore aujourd'hui un état religieux, cessera de l'être dans une vingtaine de jours) et les reliquats certes remuants de la puissance vaticane, et en particulier la Pologne. S'il tourne à l'avantage de la la¨cité, cet affrontement pourrait, si l'on veut, se définir comme la victoire finale du protestantisme, car la laïcité est paradoxalement plus réellement active dans les pays du Nord que dans notre République laïcarde où le religieux catholique s'harmonise trop bien avec l'esprit monarchique-jacobin des élites. Tant mieux, la Sainte Barthélemy valait bien un tel prix.
Sur le second front, les choses dépendront d'abord des résultats du premier. Si l'Europe finissait par craquer face à ces arrières-gardes vaticanes hispano-polonaises, alors je pense que c'est son concept même qui en souffrirait au point de nous renvoyer à ce statut de la Grèce hellénistique qui ferait de Bruxelles une sorte de capitale d'une Amphictyonie nommée Europe, sorte de sanctuaire religieux où des délégués viendraient périodiquement comme à Delphes, ritualiser une appartenance mystico-mythologique à un socle rituel commun, sous l'œil paterne de la nouvelle Rome américaine. Rome qui se servirait des uns et des autres à son gré pour assouvir ses projets hégémoniques mondiaux. Si, au contraire, l'Europe se construit sur des principes rigoureusement laïcs, sans la moindre allusion à une appartenance à une " christianité historique commune ", alors elle peut devenir la mer calme qui s'étend dans l'œil même du cyclone, dont elle saura se défendre sans même avoir à dégainer. C'est que, subrepticement, l'Europe a pris la place qu'occupait l'Amérique au début des deux grandes guerres qui ont ravagé le monde, et notre problème deviendra un jour ou l'autre le même que celui qui a conduit ce pays à soutenir les démocraties contre le fascisme. Et, si une telle conjoncture devait se présenter, je suis certain que les Européens sauront faire les sacrifices qu'il faudra, et cette fois sans la moindre arrière-pensée.
Mardi 16 décembre 2003
Saddam Hussein.
Merci Madame Marie-José Monzin de nous avoir rappelé ce matin sur France-Culture où se situait l'humain et de nous avoir mis en garde contre le traitement médiatique infligé à un homme qui ne possède même plus son nom de famille. Merci aussi à Miguel Bennassayag d'avoir analysé honnêtement et finement la réalité et les conséquences de la soit-disant arrestation de l'ancien dictateur, arrestation qui n'a jamais été qu'une trahison monnayée : un prince digne de ce nom aurait, au temps des Grecs, fait exécuter le traître et libéré sa victime du fait même de la trahison. Bref. Je n'ai donc pas grand chose à ajouter, mais l'on m'attend sur le terrain de la géopolitique et j'ai passé mon temps, depuis dimanche matin à réfléchir sur ce non-événement, désespérément monté en mayonnaise pour les besoins électoraux américains. La traitement médiatique ne vise évidemment qu'à faire passer la capture de Saddam Hussein pour le " Casus Belli " réel et légitime de cette agression illégale et purement crapuleuse, pour le cœur et la légitimation d'un hold-up digne du plus mauvais thriller.
Je partirai donc des craintes exprimées par Miguel sur le regain de puissance acquis par l'administration Bush et le clan des faucons américains. Je crois qu'à long terme, ce résultat logique d'une guerre qui n'est qu'une rapine opérée par une superpuissance contre un nain militaire à moitié ruiné par une première guerre semi-atomique et dix ans d'embargo, ne peut avoir qu'une seule conséquence : entraîner cette superpuissance dans une spirale guerrière sans fin, ou dont la seule fin ne peut que porter le triste nom de Troisième Guerre Mondiale. On devra cesser de dire Seconde Guerre Mondiale, et se contenter d'un " deuxième ", hélas. Il n'y a cependant pas, à mon sens, de raisons pour l'Europe et une grande partie du monde, de paniquer parce que l'industrie militaire américaine va trouver les exutoires dont elle a besoin et dont l'économie américaine toute entière a besoin pour survivre.
Alors de deux choses l'une : ou bien cette " capture " va suffire à la réélection de Georges W.Bush, dans lequel cas nous irons rapidement vers de nouvelles aventures militaires qui ne s'arrêteront qu'en Mer de Chine et par l'anéantissement de la moitié de la planète, ou bien les Démocrates reviennent au pouvoir. Dans cette dernière figure, pour l'instant fort improbable, manque la solution des problèmes économiques d'une nation en faillite. Quand en Europe on s'emporte contre des pays dont les budgets dépassent 3% de déficit, on ferme les yeux devant un continent qui ne tient plus que par sa fuite en avant dans la militarisation de la société, ce qui nous rappelle de tristes et angoissants souvenirs. Le changement de couleur politique risque donc de ne pas changer grand chose à la dynamique lancée déjà par Bush-père il y a douze ans. Hilary Clinton, qui a de bonne chance de manger tous ses concurrents démocrates n'a-t-elle pas, elle-même approuvé chaudement l'initiative irakienne de son adversaire politique ? En fin de compte je pense que l'an 2004 va marquer l'ouverture d'une parenthèse sans précédant dans l'équilibre mondial de la démocratie parce que l'Amérique va passer, si ce n'est déjà fait, dans le camp des despotismes militaires. Guantanamo est le symbole de l'ouverture de cette parenthèse, et vous savez quelle importance j'accorde aux symboles, réalités des millions de fois plus réelles que ce que l'on peut toucher des doigts ou voir par ses yeux. Il y aurait, dans le cas d'une victoire démocrate, un ralentissement certain de la mobilisation militaire et des atermoiements qui ralentiraient le processus mais ne le modifierait que dans le sens d'un handicap stratégique sans importance. L'Iran, la Syrie, la Corée du Nord et pour finir la Chine n'échapperaient pas à la croisade " pour la démocratie " entamée par une famille de pétroliers texans.
L'Europe dans tout cela ? Dimanche nous avons touché le fond de tout ce qui restait du terrain préparé par les Maisons Blanches depuis 1945. A partir d'aujourd'hui nous allons assister à une accélération, également sans précédant, de l'unification européenne. Elle prendra des voies inattendues qui pourraient passer par une réduction provisoire à un cœur minoritaire en nombre mais majoritaire en puissance politique et économique et aussi en cohérence politique. Il ne faut pas penser en terme de stratégie consciente de la part de nos hommes politiques, mais en termes de réalité qui s'impose dans la nouvelle géopolitique qui se dessine. Il viendra rapidement un temps où les rebelles d'aujourd'hui, derniers restes d'une histoire européenne que les chasses d'eau des deux guerres mondiales n'ont pas encore évacués, s'empresseront de rejoindre le troupeau pour se mettre à l'abri des folies d'un peuple déboussolé qui confie des postes de Gouverneur à des comédiens. Nous ne sommes même plus dans le cas de figure d'un empire dont le souverain, tel Néron, descend dans l'arène pour affronter les gladiateurs lui-même, mais dans le cas contraire où les gladiateurs eux-mêmes s'emparent du pouvoir, autre symbole définitivement irrécusable de la pente angoissante sur laquelle l'administration américaine a entraîné, depuis Nixon, le peuple le plus sympathique du monde. Il ne s'agit rien moins que de la victoire de la Mafia, dont le premier acte fut l'assassinat de JFK, symbole du destin futur et semble-t-il irréversible des Etats-Unis. En conclusion je ne dirais que ceci : faisons tout pour ouvrir les yeux dès maintenant aux citoyens de ce vaste pays qui se condamne lui-même à la ruine la plus amère, mais aussi ceux de nos élus et de nos décideurs, encore prisonniers de schémas historiques totalement dépassés depuis des lustres.
Mercredi 17 décembre 2003
Mèmes, modes et Jacques Attali.
Un sourire du matin vaut le monde entier.
Oui, vous avez bien lu, mèmes, avec un accent grave, et non pas le même dont mon style est tellement prolixe. Pan sur le bec. Qu'est-ce qu'un mème ? Mon Word n'en veut pas, c'est dire qu'il n'existe que dans une sémantique extrêmement spécialisée dont le Larousse est impuissant à rendre compte. Vous n'allez pas me taquiner pour le mot sémantique, la sémantique est la science du sens, une sémantique peut donc être considérée comme un système rendant compte du sens de quelque chose. Point. Si Word n'en veut pas, c'est que ce mot est neuf, pas encore passé Quai Conti, chez les verdurins de l'Académie ni dans les Robert et autres Littré. Le mot mème (Word va jusqu'à me corriger sans mon accord !!!!) est un mot scientifique inventé, d'après mes informations, par un certain R. Dawkins, chef de file actuel de l'école dite néo-darwiniste. Le néo-darwinisme a fait l'objet, ce matin, d'un cours remarquable que l'on peut capter sur France-Culture à 6 heures du matin dans l'émission Université de Tous les Savoirs, ou quelque chose comme ça. Quelle ambition ! Bof. Pas question de vous faire un résumé de ce cours ni même de vous dire ce qu'est le néo-darwinisme, il faudra vous contenter de ce que vous aller pouvoir comprendre à partir de mes explications sur les mots mème, mode et les relations qu'il y a entre ces deux mots et Jacques Attali.
Un mème est l'équivalent mental ou immatériel d'un gène. Dans la théorie néo-darwiniste, du moins dans l'une de ses variantes, les gènes se modifient plus ou moins accidentellement (le statut du hasard dans cette événement est l'objet d'un débat interne à cette Ecole) et se répandent à peu près comme un virus, le virus étant essentiellement une machine à transformer et à répandre. Point important : l'évolution de l'ensemble du monde vivant partirait d'un gène unique qui se diviserait à l'in(dé)fini à l'intérieur du mécanisme le plus mystérieux de tous, la spéciation, c'est à dire la naissance d'espèces différentes. Au fond, il s'agit du même mystère que celui de la division cellulaire, qui fait qu'à partir d'une cellule unique se forme un corps organisé en milliards de cellules différentes, cellules dont le modèle de chacune serait inscrit dans la fameuse spirale de l'ADN. Dans un spermatozoïde il n'y a pas de foie, d'estomac, de muscles ou de matière grise etc, sinon sous la forme d'un programme génétique que l'on s'attelle depuis des années à décoder depuis qu'on s'est rendu maître de sa perception. Certain d'entre-vous comprendront plus vite ce qu'est un mème en pensant au suffixe ème que l'on ajoute à certains mots pour figurer une unité de la matière ou du domaine considéré. Un philosophème est une unité sémantique philosophique, c'est à dire une entité idéelle qui rend compte d'une vérité quelconque. Exemple : l'UN est un philosophème fondamental puisqu'il est un axiome en même temps qu'une réalité, du moins selon la plus importante des écoles philosophiques connues, celle qui va de Parménide à Heidegger en passant par Spinoza, Leibniz et Hegel. J'ai moi-même inventé un concept qui se sert de ce suffixe dans mon mémoire de licence de journalisme consacré à une analyse comparée de contenus d'émissions télévisuelles. Ce concept est le télévisème, unité nécessaire et suffisante pour donner la vie à un programme, c'est à dire à lui éviter la mort par zapping. A l'époque, mon honorable professeur n'y avait, je crois rien compris, ce qui est le sort de la quasi totalité de ce que j'écris et me confère par ailleurs le statut d'un marginal à demi cinglé. Bref, le mème est une unité spirituelle qui modifie tout d'un coup le cours du développement culturel d'une société humaine. Cette unité nouvelle affronte donc l'ensemble des séries d'anciens mèmes qui forment le présent culturel dans lequel se déroule cette naissance. Pourquoi ne pas simplifier les choses et dire qu'une idée nouvelle naît dans le cerveau d'un humain et se répand dans son environnement avec plus ou moins de chances de modifier à terme l'ensemble de la culture ainsi attaquée. A signaler encore que ce processus est considéré comme totalement indépendant du processus matériel génétique, c'est à dire qu'il y a un total parallélisme entre les deux évolutions, parallélisme qui peut faire entrer en opposition les deux. Exemple cité ce matin : le célibat des prêtres, qui est un mème dogmatique, entre en contradiction avec la fonction de croissance et de développement de l'espèce puisqu'il stérilise celui qui en fait un mode de sa profession de foi.
L'opposé du mème serait alors la mode, c'est à dire une nouveauté passagère, qui ne se répand que provisoirement et superficiellement pour disparaître dans le néant d'où elle peut ressurgir pour produire le même néant d'effets réels sur la culture ambiante. Comparaison : le monothéisme est un mème qui a bouleversé la culture humaine de fond en comble (enfin c'est ce qu'on dit, pour ma part je demeure sceptique, vous me connaissez), alors que le jean est une mode, certes persistante, mais qui disparaîtra aussi fatalement que les perruques du 17ème siècle. Qui peuvent, je le rappelle, ressurgir pour un temps, mais seulement pour un temps, sans rien changer sur le fond. J'ai souvent pensé que cette mode de la perruque n'était pas seulement destinée à masquer la déchéance qu'inflige le temps au corps humain, mais qu'elle avait une fonction sociale beaucoup plus complexe, il suffit de constater qu'elle survit encore dans l'exercice de quelques métiers comme ceux de juges ou de procureurs, dans des pays où la monarchie persiste elle-même comme une mode, et non plus comme un mème qu'elle fut réellement pendant des millénaires. La monarchie prise comme mème doit se concevoir comme concept et non pas comme réalité de fonctionnement politique, comme principe et non pas comme mécanique propre aux relations sociales. Elle est, en tant que principe, l'affirmation de l'inégalité fondamentale et essentielle des êtres humains. Monothéisme, monarchie, je pense que ces deux exemples peuvent suffire à faire comprendre ce qu'est un mème. Allez, ajoutons-y l'idée platonicienne de l'Idée qui a modifié de fond en comble l'aperception du monde et du destin de l'être humain, dans le sens, d'ailleurs, des religions monothéistes. Plus on s'enfonce dans la culture plus on peut identifier les unes aux autres des notions que l'on pense a priori indépendantes les unes des autres.
Bref, quel rapport entre mème, mode et Jacques Attali, et pourquoi est-ce que je traite de ce sujet aujourd'hui ? Partons de cette dernière question. Un ami vient de me signaler la parution d'un nouveau livre du prolixe Jacques Attali, ex-père Joseph de François Mitterrand, on l'appelait son sherpa lorsqu'il s'agissait de préparer la participation de son patron aux différents sommets dont ceux qui les ont vécus se souviennent, sans doute grâce au talent d'Attali dans le domaine devenu souverain de la communication. Il est intéressant de noter en passant que Jacques Attali est ce que l'on pourrait nommer le plus fortissime en thème que la France des années soixante ait produit. Lauréat de la plupart des grands écoles, Attali est aussi un avant-gardiste dans un grand nombre de domaines d'analyses théoriques, qu'elles soient d'ordre historique, sociologique ou, disons, anthropologique car je ne peux pas y ajouter philosophique, le brillant étudiant de Polytechnique, Normal-Sup etc.. n'est décidément pas un philosophe, talon d'Achille qu'il comble très certainement par l'étude talmudique comme en témoigne de nombreuses réflexions qui émaillent son texte par ailleurs difficile à suivre tant il est haché, compulsif, presque torrentiel. Attali est un gouffre de connaissances universelles qu'il a bien du mal à ordonner. Et pourtant il a trouvé, il y a longtemps déjà, la trace d'un mème qui aurait pu donner à son œuvre la force d'un mème au lieu de la cantonner dans ce qui risque de n'être qu'une mode passagère, lancée jadis par Deleuze et quelques autres comme Jünger, auteurs attentivement lu par Attali et à propos desquels il a même été accusé de plagiat. Alors quel est ce mème qui aurait pu faire d'Attali un fondateur culturel de premier rang, que même Deleuze n'avait saisi que comme une vague intuition dont la réalité palpable de suffit pas à rendre compte si on ne l'enveloppe pas, comme diraient les philosophes de l'Ecole, d'un mème plus originel et plus universel ? Il est tout entier contenu dans le titre de ce livre qu'il vient de publier : L'Homme Nomade.
La thèse nous décrit un cercle dialectique de l'Histoire dans ou à partir du quel l'homme part d'un statut rousseauien de nomade bon pour aboutir à un homme nomade " transhumain " après avoir parcouru une sorte de passion christique dans un sédentarisme que je qualifierais provisoirement de constructiviste. Je vous avoue que je n'ai pas lu ce livre, mes moyens me permettant tout juste de le feuilleter dans une librairie, mais je sais lire en diagonale, comme on dit, et par ailleurs il se trouve que j'avais établi des relations personnelles avec Attali précisément à propos de ce mème, qui est un mème, même si Attali ne parvient pas à lui en donner la puissance et la cohérence requise pour prendre la place du mème ancien qui formate depuis si longtemps les conditions d'habitation du monde par l'homme. C'est que j'ai moi-même écrit un essai intitulé Atopie (que vous pourrez trouver sur ce site) et qui pourrait tout aussi bien porter le titre que Jacques Attali a donné à son livre. Je lui en avait d'ailleurs donné un exemplaire de la main à la main, il y a de cela presque deux ans dans son bureau après qu'il m'eût invité à en parler et à en favoriser l'édition. L'édition m'importait en réalité peu, mon seul désir étant de partager ma réflexion avec celui et ceux qui semblent accéder d'une manière ou d'une autre à ce mème que tente de déplier mon propre essai. Il n'est pas question ici de comparer ce produit avec celui d'Attali ou de suggérer de sa part un quelconque plagiat, voire même un quelconque parasitisme. Et ce pour plusieurs raisons. La première est que je n'ai pas l'érudition pratique, c'est à dire les moyens de mobiliser des connaissances difficiles à rassembler sans un appareil académique classique et surtout le moindre collaborateur qui peut faire les tâches secondaires cependant que je dessine le contour de l'ensemble. La deuxième est beaucoup plus profonde et porte sur la différence entre les statuts respectifs que nous attribuons l'un et l'autre à ce mème. Et sa finalité, encore que le concept de mème comprend évidemment sa propre finalité. A ce sujet je dirais alors que le mot mode semble mieux correspondre au résultat final de la démarche d'Attali ; à preuve la profusion et l'éclectisme de ses productions qui vont du théâtre à l'analyse économique la plus pointue.
L'idée du nomadisme n'est pas neuve dans son œuvre, et je n'ai aucune prétention à monopoliser la gestation de ce meme. Comme je l'ai déjà signalé, de nombreux auteurs, même des romanciers comme Le Clézio, ont tourné et tournent encore aujourd'hui autour du thème du nomadisme. Même la chanson, la poésie et la philosophie se sont emparé de ce mot, ou de ce thème parce qu'il s'impose effectivement comme un mème, même s'il demeure parfaitement impuissant à fonctionner en tant que tel, c'est à dire à transformer, il faudrait dire transmuter la culture universelle au point de frapper tous les domaines de l'existence humaine et de provoquer une réflexion collective dont le monde a pourtant le plus grand besoin. J'ai néanmoins la certitude d'avoir, par Atopie, donné à la thématique du nomadisme un socle de loin plus solide et plus neuf - si l'on sait reconnaître que le retour à l'arkè, à l'originaire, est toujours le toujours déjà plus neuf que le plus immédiat - que cette mode qui prend les sociétés dans l'aveuglement que décrit parfaitement le désordre difficilement combattu par un chronologisme historiciste sans signification réelle de l'œuvre d'Attali. Je connais peu les développements de Deleuze et Guattari sur ce thème du nomadisme, mais j'en sais assez pour pouvoir affirmer que leur position n'est nullement mèmètique dans la mesure où elle demeure une vision ontologique de l'homme qui a bien du mal à s'expliquer avec l'histoire autrement que par des métaphores poétiques auxquelles d'ailleurs je tente de donner ce précieux contenu mèmètique.
Je vais conclure par ce qu'il ne faudrait pas considérer comme une agression, voire seulement comme une critique d'un ouvrage qui vient de paraître, mais comme un appel à tous ceux qui " sentent " le mème, ne fût-ce que de manière intuitive ou savante comme Attali, pour qu'il sorte de son statut de mode poétique ou seulement théorique, pour devenir l'équivalent d'une révolution du penser c'est à dire de l'exister. Les nomades ont bel et bien choisi en toute conscience de prendre le risque de la sédentarité, mais ils l'ont également fait dans un but conscient et très clair : reposer la question de l'être dans l'être-ensemble, au risque de son oubli, oubli dont Heidegger fit le cœur de sa propre pensée. Il y a bien retour au nomadisme, mais ce retour peut rester stérile et constituer un danger de loin plus grand que ne fut le choix de s'assembler au risque de créer des sociétés dominées par la violence, l'esclavage et l'injustice. Les valeurs que les hommes paraissent défendre à travers les réveils successifs perceptibles dans l'Histoire, ne sont que ce qui reste des valeurs d'avant la Cité, et maintenant que cette Cité s'écroule sans espoir, il est plus que temps de se rassembler autour de ce mème du retour à l'arkè, à l'originaire, et de faire les comptes. Ironie du sort : le mème de la laïcité connaît aujourd'hui les plus grandes menaces, et ces menaces symbolisent la stagnation culturelle la plus rigide et la plus menaçante pour la Vie.
Jeudi 18 décembre 2003
La substantivation de l'Être.
Revenons un peu en arrière. La qualité d'être des choses n'est pas évidente en soi. Elle ne saute pas aux yeux comme leur couleur ou leur forme. L'expérience classique du tunnel et du petit train montre que jusqu'à un certain âge, l'enfant ne possède pas ce qu'on appelle le sentiment de la permanence de l'objet. Une fois que le petit train a disparu dans le tunnel, il cesse d'exister, et ce n'est que bien plus tard qu'on pourra observer que l'enfant se met à attendre l'événement que constituera la sortie du véhicule du tunnel. Cette faculté d'anticiper la résurgence de l'objet indique que la conscience de l'enfant anticipe son mouvement, et non seulement son mouvement mais son existence future dans l'horizon de son regard : il a attribué l'être à l'objet mobile, il l'a constitué en étant permanent et indépendant du mouvement. Il n'est pas question ici de la fable maternelle et tout le mérite de l'œuvre d'un Piaget repose essentiellement sur une réinvention totale du cadre de la païdeia. La venue au concept de l'Être pourrait être décrite de la même manière : ce que nous appelions le gel de l'image au début de ce texte, on pourrait aussi le décrire comme le passage de la conscience humaine au sentiment de la permanence et de l'indépendance des choses qui l'entourent. Mais il ne s'agit là que d'un sentiment et on se trouve encore très loin du concept, or la question que nous posons ici est bien de savoir si le passage au concept est bien l'opération adéquate, celle qu'il nous faut pour comprendre la dimension ontologique de l'étant. De comprendre pourquoi le monde EST - j'utilise souvent pour mieux faire comprendre cette question le mot ester (comme dans ester en justice) - pourquoi on dit non seulement que ce monde est sphérique, mais qu'on peut dire tout simplement qu'il est. Ecoutons Martin Heidegger dans un texte sur lequel nous reviendrons encore souvent dans les paragraphes qui vont suivre 1 : -" Concevoir (concipere saisir-ensemble), à la manière du concept de la représentation, passe a priori pour la seule manière d'appréhender l'être, même là où l'on se réfugie dans la dialectique des concepts, ou dans le non-conceptuel des signes magiques. On oublie totalement que l'hégémonie du concept, et l'interprétation de la pensée comme concevoir, reposent par avance, et uniquement sur l'essence impensée, parce que non-appréhendée, de on et de eïnai ".(on =étant, eïnai =être)2 Autrement dit le concept d'être ne sait pas de quoi il parle, il n'est qu'un instrument dans l'époque de l'hégémonie du concept, instrument qui permet de faire tout ce qu'on veut sauf appréhender l'être. Penser par concept repose certes sur quelque chose, ce penser repose même par avance et uniquement, c'est à dire comme nous le comprenons : avant même d'être penser le penser surgit en un seul point, sur une seule base, celle de l'essence qui reste impensée et non appréhendée de deux mots grecs traduits par étant et être. Le problème soulevé par Heidegger dans ce texte extraordinaire ressemble à un problème de philologie puisqu'il dit ailleurs en substance que le destin de l'Occident repose sur la traduction de ce petit mot de on, classiquement traduit par étant. Nous voici bien au cœur de notre sujet : Être et Histoire.
En fait, pour Heidegger il faut renverser les choses : la pensée n'est pas ce qui saisit l'être, mais la pensée n'est pensée que sur la base de l'être. Mieux, il suffit de relire Parménide : Penser et Être sont Un, Penser et Être sont le même. Et c'est bien ce que Heidegger illustrera abondamment dans la suite de son texte. Au point extrême où je pourrais considérer le sujet dont je parle comme déjà traité, la question de l'Être et de l'Histoire résolue de la manière la plus brutale : le penser naît avec la déclosion de l'Être, c'est à dire son avancée en étant. Dans les pages 274 et 275 Heidegger répète deux fois la phrase suivante: L'Être se retire en ce qu'il se déclôt dans l'étant "3. Ce retrait de l'être produit l'Histoire, l'errance provenant de l'égarement dans lequel est voué l'étant, instituant ainsi " un empire d'erreur ". Beaucoup de lectures sont possibles ici, à commencer par la platonicienne qui inaugure à sa manière la culture du dédain pour le monde, du mépris pour la matière et les formes perçues, pour le spectacle mensonger que l'homme peut contempler sur le mur de la caverne. Décidément, le mot jadis employé par Philippe Lacoue-Labarthe pour caractériser le texte philosophique trouve ici sa véritable place : le ressassement. Je dirais le ressac, toujours identique et jamais pareil, marqué ici et là par d'imperceptibles atonalités.
Revenons cette fois en arrière. De quoi parlons-nous ? Le nous est ici Je, bien entendu, il ne s'agit pas du fameux nous philosophique, cette sorte d'escroquerie historique qui veut introduire de force un consensus, une compréhension commune des mots et des concepts. Le nous est une sorte de rideau de théâtre qui donne sa légitimité aux fictions de la scène, c'est à dire qui pardonne à l'avance leur illégitimité foncière. Nous nous parlons entre philosophes un langage " derrière " lequel nous pouvons dire à peu près n'importe quoi. Ce qu'il faut d'abord c'est sauver les apparences pour toutes sortes de raisons les plus étrangères les unes aux autres mais qui font finalement Histoire. De la philosophie entre autre. Je reviens donc en arrière avec mes mots à moi, ou du moins les correspondances sémantiques qui se sont installé en moi entre ma pensée et les mots.
Jusqu'à présent j'ai parlé du verbe être, cet infinitif qui, comme on le sait ou comme on le pratique, s'applique à n'importe quoi puisqu'il est même courant de dire en de certaines circonstances théologiques que le non-être est, le néant est ce que l'être n'est pas, il est l'Autre. Mais restons modestes, je puis dire par exemple que le monde est, que cette table est, que je suis, que tout ce que je peux appréhender d'une manière ou d'une autre est. Ailleurs j'ai parlé d'un tremblement de cet infinitif qui saisit le tout et chaque partie du tout : rien n'y échappe. Tout tremble du fait d'être, et c'est ce tremblement qui me fascine, qui me bouleverse, qui domine toutes mes autres préoccupations car je conçois clairement qu'elles-mêmes dépendent absolument de ce tremblement. Lorsqu'un camarade de classe se sert d'un mensonge banal pour éviter une punition, il invente un faux tremblement, il affirme l'existence d'un fait ou d'une chose qui ne tremblent pas, il parle d'un lieu où il n'y a pas tremblement, où il n'y a rien. Au contraire, lorsque je dis la vérité, je parle toujours d'un fait ou d'une chose - et on pourra encore parler de milliers de choses comme les émotions, les sentiments, les pensées et que sais-je encore - dont la représentation par mes mots correspondent quelque part à un tremblement ontologique : la vérité que j'énonce fait écho au tremblement de l'être que j'évoque.
Cette particularité de l'être et de sa relation avec le langage a donné lui-même lieu à un mensonge, ou du moins à un malentendu. La fameuse vérité comme adéquation, homoïosis, du mot avec la chose, d'autres diront d'adéquation entre le regard et l'énonciation, adaequatio rei et intellectus. La vérité change ainsi de camp, elle devient exclusivement une affaire entre mots d'hommes, mais comment cette mutation ou cette déclinaison a-t-elle pu avoir lieu ? La réponse est assez simple puisque a priori l'étant vrai n'apparaît comme tel que dans l'écho de la voix humaine. Même si cette même voix humaine possède le redoutable pouvoir de faire être par le mensonge ce qui n'est pas et ce qui n'a jamais été. Il était donc presque évident que le problème de la vérité finisse par se situer tout entier dans le langage et donc, de la réalité du fait qu'un mot recouvre réellement une chose étante.
Or, le pouvoir sophistique, celui de jongler avec les mots et la logique pour instaurer n'importe quelle vérité, a ses limites. L'exemple illustre du bâton plongé dans l'eau et qui paraît brisé - mais que le pouvoir du langage redresse grâce aux contenus de son savoir (de son être) - montre comment s'y prend le sophiste : il plante le théâtre d'une expérience dont le premier acte sera d'abord de persuader que le témoin est convaincu que le bâton en question est brisé, alors qu'il est évident pour tout le monde que cette conviction est totalement fictive. Le moindre imbécile sait que le bâton qu'il plonge dans la mare n'est ni tordu ni brisé, mais s'il écoute Descartes, s'il restreint son regard à la perspective que lui offre le sophiste, alors il doit reconnaître que ce qui est n'est pas. Tout est donc dans le fait d'accepter l'offre d'une perspective, c'est à dire d'accepter le produit d'un charcutage abstrait de ce qui se trouve en réalité là. Descartes, ici, pourrait me répondre à la manière anglaise, mais mon cher, il est vrai que le témoin n'est pas trompé par ses sens, mais c'est seulement parce qu'il a acquis par l'expérience répétée de l'erreur, le savoir qu'enfin tout bâton plongé dans de l'eau peut paraître brisé.
Mais ce n'est pas du tout la réponse de notre grand philosophe. Pour lui la rectitude du bâton ne peut pas surgir de l'expérience, puisque, dira-t-il peut-être, cette expérience produit toujours les mêmes effets, rien ne vient altérer la vérité effectivement patente d'une cassure que l'on peut constater quelles que soient les temps et les époques. Non, il répondra tout à fait autre chose, il dira que la rectitude, en réalité, ne se trouve pas dans le bâton, mais dans le savoir de la rectitude du bâton. Ce qui est juste et recoupe tout à fait la remarque que nous avons faite plus haut. Or, le chevalier Descartes ne peut pas se contenter de cette réponse, car alors il n'aurait pas tenté de persuader son témoin que cette cassure existe, même faussement. L'expérience n'aurait plus eu d'objet. Pourquoi ne peut-il pas se contenter de cette réponse ? Tout simplement parce que le philosophe doute absolument de tout ce qu'il pense, il n'a aucune certitude de ce qui traîne dans sa tête sur le monde, le ciel, les femmes et les bâtons. Il se peut bien que le chaland qui observe l'expérience de Descartes sache parfaitement qu'il s'agit d'une farce pour enfant et qu'en vérité il sait parfaitement que l'argument de la cassure ne vaut pas grand chose, sinon rien du tout. Mais peu importe, car le philosophe, lui, sait que le savoir de son chaland est un savoir douteux, un savoir que rien de garantit quant à sa véracité ou à sa qualité aléthéique. J'emploie ce mot car il ne faut pas ici perdre de vue que le regard du témoin est en fait double : il voit la cassure et il ne la voit pas. Il la voit parce que le philosophe pointe son doigt sur l'effet d'optique en question, mais il ne la voit pas parce qu'il sait que le bâton n'a jamais pu être brisé par le simple fait d'être plongé dans le miroir d'un étang. En termes savants, il y a deux aléthéïa : celle du regard qui perçoit une cassure volens nolens, et celle qui se produit automatiquement dans l'esprit du témoin où le bâton en question garde toute son intégrité. Et les deux sont vraies au sens de leur apparaître dans la conscience du sujet qui contemple la scène.
Donc, il faut non seulement admettre que les yeux trompent, mais aussi l'esprit. Ce que l'habitude des bâtons a enseigné à l'homme ne suffit pas à prouver qu'il a raison de penser que ce bâton ne peut pas se briser par simple immersion. Il ne peut pas non plus se fier aux lois qui régissent les relations entre les éléments et qui prouvent en l'occurrence que de l'eau ne peut pas, sous la forme de flaque dormante, briser un morceau de bois. Pourquoi ? Parce que ces lois pourraient être complètement fausses elles-mêmes, parce que tout pourrait être faux, à commencer par l'existence même de tout ce qui apparaît dans nos sensations. Je ne vais pas reprendre le cours des Méditations de Descartes et me contenterai d'une ellipse pour en arriver à la véritable pensée de Descarte : si je veux me convaincre que tout ce que je perçois n'est pas un rêve suscité par quelque mauvais démon, je dois nécessairement en déduire que c'est un bon démon qui règle les choses dans ma tête, un démon qui est lui-même la loi qui décide des choses, non seulement de leur paraître mais de leur être. D'ailleurs ce dieu, puisqu'il s'agit de Dieu, est lui-même l'Être à partir duquel se décline l'étant dans son clair-obscur de vérité et de mensonge.
Dieu est l'Être. Ce n'est certes pas le pauvre Descartes qui a opéré cette substitution que j'appelle substantivation de l'Être, car celle-ci constitue l'alpha et l'oméga de toute la philosophie scolastique du Moyen-Âge, et pas seulement puisque le fameux hyperouranios dont nous parle Platon lui-même n'est rien d'autre que ce Dieu qu'Aristote nommera, de manière beaucoup plus rusée il est vrai, le Premier Moteur. Le premier moteur immobile qui meut la réalité, c'est à dire lui imprime sa double essence d'energeia, de force, et de dynamos, le mouvement. Mais attention, gardez à l'esprit que ces entités sont de l'ordre de la transcendance : elles sont séparées de l'étant, il y a entre l'Être et l'étant un abyme infranchissable, celui de la nature ou de l'essence. Ce qui nous place immédiatement devant cette conséquence onto-théo-logique qu'il y a autour et en nous deux mondes opposés, celui que nous avons le privilège, ou le malheur, de percevoir avec nos sens, et celui que nous ne pouvons même pas déduire de notre esprit tant celui-ci demeure mêlé à la matière, le fameux néant, le fameux Autre.
Résumons-nous. L'instituteur du village d'Elée, Parménide, procurait aux enfants de sa commune un enseignement tout à fait banal à cette époque. Il disait qu'il était impossible que l'Être ne soit pas puisque la lumière qui nous entoure (la vérité, l'aléthéia) le certifie. Parménide l'instituteur ne cache pas à ses élèves qu'il existe une autre manière de considérer les choses par la croyance, l'opinion, et que, à l'instar du témoin de Descartes, il peut se faire que pour l'homme le non-être soit là-même où l'Être est. Pas de mystère là-dedans. Mais, dans son école, il y a aussi la classe des grands, et dans cette classe il complète son propos par une idée qui n'est pas encore à la portée des petits, il dit que Être et penser sont la même chose. Bigre, voilà qui remet tout en question, car si on remonte à notre histoire de bâton, alors il se peut bien qu'une telle affirmation s'avance un peu loin puisqu'il est possible que le témoin pense que le bâton est effectivement brisé. Alors s'il pense une telle chose, sa pensée ne peut aucunement correspondre à l'être du bâton ! Or Parménide nous donne une petite précision d'importance, il indique que le chemin du non-être est celui de l'opinion. Le témoin de l'immersion du bâton qui admet que l'instrument est brisé ne pense pas en réalité, en réalité il se fie à ce que lui dit l'expérimentateur, il entre dans la croyance dont on veut le convaincre, il entre dans la perspective du regard cartésien. Que ce soit pour de vrai ou pour faire plaisir à Descartes, il opte pour le chemin du non-être et répond au philosophe satisfait : - " tiens oui, c'est vrai, le bâton est brisé " -. Après Parménide, il semble qu'une grande réforme de l'Education Nationale grecque ait eu raison de cette simplicité. Il a suffit de quelques décennies, les siècles de Platon, d'Aristote et de tous ceux qui ont choisi par la suite de les prendre pour modèle, quitte le plus souvent à les déformer à leur profit, tout cela pour en finir avec l'alphabet jusque-là usuel de l'existence.
Naturellement, cette fable ne marche que parce que le patelin de Parménide était un lieu retiré du vrai monde, celui du cœur de la mondialisation commerciale grecque. Les gens d'Elée ne lisaient pas les journaux égyptiens ou perses parce qu'ils arrivaient difficilement en ce lieu paumé. Non, je rigole. Ce que je veux dire en fait, c'est que le platonisme et son ombre stagirite sont en route depuis longtemps. Il y a déjà longtemps qu'on a écrit la Bible et toutes ces sortes de Livres de fables extra-terrestres, et les quelques Grecs qui ne s'en sont pas encore avisés ne sont que des ploucs, quelque chose comme nos José Bové en plus discrets. Car nos Platons et consorts ont voyagé, eux. Ils se sont imprégnés de ces fables que devaient se raconter les nomades en rigolant au coin du feu et qui ont fini en Livres Sacrés, là-bas à Babylone, là-bas à Tyr, là-bas sur les bords du Nil ou encore dans cette Palestine qui ne cessera pas de si tôt à faire parler d'elle. Des fables dont il faut faire l'ordinaire de la païdeia, selon Platon. Dans sa république, le mensonge est une nécessité, le non-être parlé doit seconder l'action politique, aussi bien dans l'éducation que dans les décisions que prendront les roi-philosophes au jour le jour : la Realpolitik le commande. Les Jésuites sont déjà là avec leurs transactions douteuses avec la Loi, leur jurisprudence si habile qu'elle parviendra à ridiculiser les plus talentueux des Pascal. Pas grave tout ça, c'est le menu de tous les jours. On a l'habitude maintenant de la Raison d'Etat et de ses Affaires sans fin où un mensonge en recouvre un autre dans la résignation générale. Parménide est loin, mort, out. On se demande comment il se fait qu'on en parle encore de temps en temps si on ne savait pas qu'il représentait l'adversaire le plus redoutable de Platon qui a dû lui consacrer tout un livre.
Que c'est-il donc passé en réalité ? Quelque chose d'incroyable. Une chose à vrai dire que je n'ai jamais comprise dès mon plus jeune âge, celui où j'ai appris la grammaire : on a transformé un verbe en substantif, on a mis un article défini devant un verbe. On a écrit tout à coup : l'être, le être. L'infinitif du verbe auxiliaire être devient soudain un nom commun désignant une chose. Alors, bien sûr, aujourd'hui cette opération passe pour on ne peut plus commune en philosophie ou en d'autres sciences dites humaines ou même en littérature, on dit couramment le parler, le manger, le n'importe quoi à l'infinitif. Or cet usage de la substantivation ne vise pas du tout le même signifié que celui auquel a été soumis brutalement le verbe être aux alentours du quatrième siècle avant JC. En effet, parler aujourd'hui du manger, ou du parler, est une facilité de langage que l'on s'offre pour généraliser à peu de frais une opération, une action ou un état. En aucun cas l'un de ces pseudo-substantifs ne renvoie à un autre objet ou, comme c'est le cas pour le verbe être, à une personne. Car l'Être à partir du platonisme est devenu le synonyme de Dieu. Dieu est l'Être. L'attribut " suprême " s'avèrera un peu plus tard avec la scolastique comme une perversion supplémentaire car l'idée d'un Être suprême infère logiquement l'existence d'un être non-suprême, et même d'une quantités indéfinies d'êtres tout aussi objectaux que Dieu, l'homme, les animaux, les végétaux etc… Ces " êtres " sont conçus comme ayant chacun un certain degré d'être, un certain degré de réalité par rapport à l'étalon de l'être suprême.
Ce qui a disparu dans cette opération, de manière subreptice, c'est le sens unique et incontournable de l'idée d'être, de l'idée d'un verbe qui désigne à l'infinitif un état universel de toutes choses, leur étance, le fait qu'ils soient des étants. Le fait que tout est étant, et que l'être n'est ni un privilège réservé à une seule personne, au demeurant fantasmatique, ni un état plus ou moins réel d'une personne ou d'une chose selon la catégorie dans laquelle on les place. On comprend tout de suite que cette opération sémantique ouvre des perspectives fabuleuses à la valorisation, à la hiérarchisation et à la qualification abstraite des dits êtres et des dits animaux ou choses. La réalité devient monarchique. A partir de l'idée d'une entité qui posséderait en quelque sorte le monopole de l'étance, de l'être, on peut déduire sans difficulté des échelles de valeurs dont l'âme est la soumission des derniers au premier. Bien entendu, il faut aussi posséder le monopole de la désignation du Premier Être, de l'Être Suprême, pour pouvoir légitimer les jugements qui vont s'abattre en cascade sur le reste de ce qui est sans être tout à fait. L'invention de l'Être Suprême est une clef magique qui seule permet de dévaloriser essentiellement, c'est à dire par essence, tous les étants qui ne font que participer de l'Être Suprême, c'est à dire de Dieu.
Le polythéisme, lui, était d'une toute autre nature et donc aussi le sacré qui s'y attache. Peu d'historiens et de philosophes ont étudié, voire seulement remarqué combien se distinguent les deux modes d'approche religieux du polythéisme et du monothéisme. Gibbon, l'historien du déclin de l'Empire romain, observe cependant très froidement la caractéristique principale du polythéisme par rapport à son adversaire, à savoir la tolérance. Le Dieu des Juifs ou même le Christ n'étaient jamais pour les citoyens de Rome que des dieux comme les autres, et à ce titre ne méritaient pas que le droit civil ou pénal s'en mêle d'une manière ou d'une autre. Les persécutions ne sont certes pas des fables, bien qu'elles n'aient jamais eu l'envergure que leur attribue aujourd'hui la pseudo mémoire d'un véritable génocide. Mais l'acharnement de certains empereurs comme Dioclétien contre les Chrétiens ne provient nullement d'une haine particulière pour la doctrine chrétienne, mais s'en prend à l'empire dans l'Empire que les Chrétiens étaient en train de bâtir. Rien n'interdit de comparer la stratégie des premiers Chrétiens avec celle des scientologues ou d'autres sectes comme la secte Moon, dont l'objectif n'est rien moins que de devenir des puissances économiques et politiques. Les vrais massacres de Chrétiens sont ceux qu'ils se sont infligés à eux-mêmes dans les guerres sanglantes et impitoyables à laquelle se sont livrés les tendances doctrinales à l'intérieur même de la religion chrétienne. Gibbon, toujours, retrace avec effroi les massacres dont furent victimes principalement les Aryens, ces Chrétiens qui refusaient obstinément d'admettre la Trinité divine.
Notes.
1 - La Paroles d'Anaximandre, in "Chemins qui ne mènent nulle part", traduction : Wolfgang Brockmeir, NRF Gallimard 1968, page 272.
2 - parenthèse de l'auteur
3 - ibid.
Vendredi 19 décembre 2003
Le jeu tragique de l'Histoire.
La tragédie, c'est l'Histoire. Elle n'est pas seulement le tissu tragique de notre époque, disons, l'Occidentale, elle est une Tragédie à part entière, une œuvre de fiction, une pièce de théâtre dont le spectacle a fini par s'imposer, non plus comme un jeu politique - tel que le définissait Jean-Baptiste Vico 1 -" elle (l'histoire) s'appuie sur une critique nouvelle, dont le critérium est le sens commun du genre humain. Cette critique est le fondement d'un nouveau système du droit des gens. ", mais comme représentation permanente du temps, comme son spectacle. Né au siècle des Lumières, Vico est le premier " historien " " progressiste " qui voit dans la nouvelle science historique un outil critique destiné au perfectionnement du genre humain, perfectionnement placé sous la Haute Bienveillance de la Providence divine. Il n'aurait jamais pu soupçonner à quel point cette nouvelle science, achevée ou non, deviendrait quelques siècles plus tard un inépuisable répertoire lyrique offert aux oisifs par toutes les industries du loisir ou du divertissement pascalien. Aujourd'hui on prend un Boing 747 pour voyager dans le temps, le long du Nil ou des contrefort de Borobudur. Mais ce destin commercial de l'histoire n'est qu'un accident qui appartient à la fatigue des metteurs en scène. A l'origine, l'histoire est assomption du concept : les poèmes mythiques, l'Illiade, les poèmes indiens ou encore les contes scandinaves enregistrent la Vérité du respect des valeurs ontologiques soumises à l'épreuve de l'association des hommes. Ils sont la comptabilité de l'honneur de l'être. Ces recueils, dont la valeur en tant qu'Histoire transcende essentiellement celle de ce qui passe aujourd'hui pour de l'histoire, avaient une responsabilité, celle de rendre compte du suivi de l'expérience de la sédentarité, de son adéquation avec les normes, avec la nomos précédente. S'il devait exister une preuve que les hommes ont modifié volontairement la forme fondamentale de leur existence originairement nomade, c'est la tragédie de l'histoire telle que la présentent les mythes et la Tragédie classique elle-même. Œdipe est le nomade qui affronte la cité et assume tout le tragique du piège dans lequel il tombe. Antigone est porteuse dans anciennes valeurs qui doivent céder la place à celle de la cité et elle paye le prix de sa fidélité. En substance, la finalité première de la tragédie comme mythe et sous toutes ses autres formes est l'assomption de l'épreuve du social. Les Anciens avaient le sens ou la connaissance profonde du risque tragique du rassemblement humain et l'essence de leur mœurs ou leur vertus essentielles pourraient se définir comme l'attention portée à la garde de ce risque.
Au fond, Vico et le siècle des Lumières ont ressaisi quelque chose de cette mission aléthéique de l'histoire, au sens où pour cette époque l'histoire se détache de sa fonction de chronique pour viser à nouveau un projet de la communauté. La Révolution Française est le retour sur scène du tragique authentique, de la chronique au jour le jour de la garde des valeurs ontologiques telles qu'elles ont lieu lorsque l'homme séjourne dans sa nudité solitaire de nomade. La philosophie des Droits de l'Homme, son ontologie en fait, n'est pas le triomphe abstrait du sujet de la métaphysique, comme on aimerait bien nous le faire croire, mais bien le retour sur scène de l'homme nomade, des droits naturels de l'individu tels qu'ils sont déjà représenté dans tout le répertoire tragique de l'humanité. A distance de cet événement refondateur, l'histoire se retrouve aujourd'hui dans une situation de déséquilibre entre ce qui demeure de ce retour de la chronique sociale, la mission des médias, et l'action de la science qui travaille également au jour le jour à neutraliser ses effets. Pour comprendre cette discrépance entre le projet politique et celui de la science, il faut aller chercher dans l'histoire de la pensée, et là il s'agit d'une déconstruction radicalement nécessaire, les moments qui marquent l'occultation intellectuelle de l'idée de vérité.
Selon la tradition historique classique, la véritable histoire naît chez les Grecs. Hérodote et Thucydide seraient les grands initiateurs de cette nouvelle science, encore qu'il faille bien distinguer ces deux individualités si différentes dans leurs méthodes et dans leurs fins. Il demeure que l'histoire en tant que science se décline à partir de ces deux hommes comme récit pur, comme représentation neutre des faits. Bien sûr, pour qui a lu leurs œuvres, il faudrait encore y ajouter Plutarque pour compléter le tableau de ce qui reste de ces formes larvaires de la science historique, le tragique est loin d'être absent dans leurs récits. Je veux dire le tragique en tant que valorisation des actions tragiques, ce qui ressort de l'épopée des héros ou de ce qui passe aujourd'hui pour le mythe. Malgré toute leur lucidité et leur volonté de neutralité, les premiers chroniqueurs ne peuvent pas s'empêcher d'admirer les héros qu'ils présentent, que ce soit en décrivant sobrement leurs actions ou dans des commentaires comparatifs tels qu'on peut les trouver dans les portraits d'hommes illustres de Plutarque. Il faut d'ailleurs noter qu'entre les premiers historiens et les professionnels contemporains, il y a pléthore de chroniqueurs dont la grande majorité ne sont que des hagiographes stipendiés par le prince. Cette forme d'histoire, celle des historiographes officiels, restera pendant deux millénaires la principale source pour la Science historique moderne. La réaction scientifique à cet état des lieux de l'histoire sera une sorte de désubjectivation radicale des thèmes de la recherche, c'est ce qu'on appelle la nouvelle histoire. Celle-ci fait mine de s'intéresser d'avantage à l'existence quotidienne des peuples du passé qu'au jeu politique de leurs princes, elle opère une sorte de tabula rasa du souci historique en présentant l'histoire comme une simple évolution des mœurs économiques, sociales ( ?) et politique. Mais il est inutile de tenter d'analyser ce qui se passe entre des personnages comme Grégoire de Tours et Braudel, car le tournant réel, la césure entre l'Histoire réelle, celle du mythe, et l'histoire métaphysique, la nôtre, reste grec. En rédigeant sa République, Platon a brisé brutalement la tradition, geste destructeur qui reflète étrangement le déclin et la destruction de sa propre cité et celle à venir de l'hellénité toute entière.
Au demeurant, la République de Platon n'est qu'un résultat logique, une déduction rationnelle de ce que Heidegger appelle " la Doctrine de Platon sur la vérité "2. La citation qui va suivre résume parfaitement ce que nous voulons dire, page 162 :- " Le " mythe de la caverne nous ouvre les yeux sur ce qui, dans l'histoire de cette partie de l'humanité qui a reçu l'empreinte occidentale, constitue maintenant, et constituera encore à l'avenir, l'événement proprement historique : conformément à la définition de la vérité comme exactitude de la représentation, l'homme pense tout ce qui est suivant des " idées " et apprécie toute réalité d'après des " valeurs ". Ce qui seul importe, ce qui est décisif en premier lieu, ce n'est pas de savoir quelles idées et quelles valeurs sont établies et acceptées, mais bien que d'une façon générale le réel soit interprété d'après des " idées ", que d'une façon générale le " monde " soit soupesé d'après des " valeurs ". " - Le tragique ici a déserté le lieu propre de sa manifestation. Il ne se situe plus dans la relation directe entre les hommes, il n'est plus compte-rendu de ce qui se passe entre les hommes eux-mêmes mais entre ce que les hommes représentent par rapport aux idées et aux valeurs. Et pas seulement, hélas, entre les représentants eux-mêmes, mais entre ce qu'ils sont, chacun d'entre eux par rapport à ces idées et ces valeurs. Ce n'est qu'ainsi qu'a pu naître cette monstruosité d'une République dont le souverain serait une classe de représentants d'idées et de valeurs, on ne peut pas mieux décrire ce qu'on appelle aujourd'hui le stalinisme.
Là n'est pas encore, pour la science balbutiante, le principal. Ce qui importe désormais, ce qui se place toujours et partout au début de toute pratique (d'historien par exemple), c'est l'interprétation du réel. Le monde doit passer au trébuchet des valeurs et se trouver en adéquation avec les " idées ". Quelles idées ? Pas difficile à trouver, elles figurent en toute lettre dans La République : le monde réel est un monde divisé en castes, ses valeurs sont hiérarchiques. L'homme en tant que tel n'existe plus, il est lui-même estampillé par les juges avant d'être, et pour être il doit traverser l'épreuve de la païdeia, le championnat de l'éducation au cours duquel il est trahi dans son essence, c'est à dire lui-même soupesé par rapport aux idées et aux valeurs. Cette trahison est évidemment une mutilation ontologique, les juges opèrent une véritable vivisection du seul Être pour lequel il est question de l'Être. Au point où la question de l'Être elle-même va passer définitivement aux mains des professionnels, en l'occurrence des rois-philosophes. Beaucoup de philosophes contemporains se sont penchés longuement sur le problème de la mimesis, on y revient, sur le statut de la fiction chez Platon et en particulier dans La République. Ce qui leur a échappé à tous, sans exception, est le fait d'une simplicité triviale quoique tout à fait cohérent avec le propos de Platon, c'est que les comédiens et les poètes sont chassés de la République parce qu'on a changé toutes les règles du jeu. La menace que fait planer l'artiste sur la société c'est précisément le retour aux valeurs d'avant les valeurs, c'est à dire à la représentation du tragique dans son authenticité, c'est à dire le tragique qui découle de l'altérité elle-même, de la relation sociale toute nue et sans idées. Un certain Lévinas débouté pour deux millénaires. La fiction artistique n'est rien d'autre que le seul moyen de tenir la dragée haute aux idées et aux valeurs, à l'Être tel que Platon le fictionne lui-même sans pudeur. Sous sa plume, sous le calame de son esclave, l'Être a changé de camp, ou, plus concrètement, l'Être est devenu un substantif qui avec le temps deviendra une personne, le souverain, le souverain divin certes, mais aussi le plus banal des tyranneaux de province.
Mais que peut bien une telle histoire avoir de commun avec la tragédie ? Nous avons parlé du jeu tragique de l'histoire, et une telle expression donne un poids immense au concept d'histoire lui-même. Or, d'histoire il n'y en a aucunement nulle part. Ou bien, pour être plus précis, disons qu'il en existe plusieurs représentations différentes, plusieurs actes et scènes dont les liens entre eux demeurent, au cours des siècles et des millénaires parfaitement aléatoires. Exactement comme entre les hommes. On peut certes regretter la manipulation ou la falsification platoniciennes dont les répercussions semblent sans limites aujourd'hui même, mais il n'est pas possible d'en faire le nœud de l'intrigue tragique. En réalité l'histoire n'est tragédie qu'en tant que La Tragédie de l'Être lui-même, c'est à dire le chemin de croix (Hegel avait une dilection pour cette expression) de la vérité. Ce sur quoi veille la tragédie c'est l'occultation de l'Être parce que sa question est au principe de son éthique : l'homme nu d'avant la métaphysique a rendu ses armes subjectives pour les confier à la communauté. Ce geste avait une finalité interne au débat de l'homme avec l'Être, il a été une stratégie consciente destinée à fertiliser la question de l'Être au travers de la communauté et du langage. L'âge d'or n'est pas celui de l'abondance de la possession des étants, ce fut celui de la prépondérance de la question de l'Être dans le dasein individuel. L'histoire est donc bien une tragédie dont le concept surgit dans un mensonge, dans l'occultation elle-même, ce que nous caractériserions pour notre part comme une remise à zéro des compteurs ontologiques avant expérience. En définitive, ce que nous appelons histoire, qu'il s'agisse de l'Historie, désignation allemande pour chronique historique, ou pour Geschichte, l'histoire avec un H, que Heidegger fait dériver de Geschick et de Schicksal qui signifie destin, est un artéfact, un kaléidoscope où peut-être seulement une erreur de parallaxe dont le tragique réside tout entier dans l'oubli actif de son objet.
L'ennui pour la science de l'histoire, c'est qu'elle ne peut pas demeurer simplement histoire des faits, parce qu'elle reconnaît elle-même que les faits sont toujours faits et qu'au fondement d'un événement il y a toujours une action lointaine, inconnue et incontrôlable par l'analyse. Mais ce qui la mine plus radicalement que cette impuissance chromosomique, c'est l'existence de la mémoire, la pulsion vers tout autre chose que les faits et les documents de collection, à savoir la pulsion vers l'avant de l'histoire, vers sa propre origine c'est à dire son propre sens. L'histoire en tant que science a bien pris la relève du mythe et de la tragédie mais en perdant la conscience claire de son désir, celle de sa finalité. Or ce désir n'a pas disparu avec le mythe et la tragédie, bien au contraire, puisque globalement on a fait tout ça, la cité, la tribu, la société pour affiner le désir fondamental. Tant que mythes et art lyrique ont été capables de rester fidèles au projet originel, c'est à dire en somme de rejouer pour la communauté les exploits qui confirmaient les qualités intrinsèques de l'homme nomade socialisé, tout allait bien, la communauté pouvait tenir envers toute agression interne et externe et poursuivre sa nouvelle stratégie. Un certain transfert continuait de s'opérer. Cela signifie aussi que pendant toute cette période, et cela correspond en fait à celle de la Grande Grèce conquérante, les valeurs anciennes restent intactes. Eschyle et Sophocle. Dès lors que la tragédie tourne au drame, à partir du moment où les citoyens d'Athènes ont commencé à divertir leur art de son objet en le prenant comme miroir des faits divers de leur communauté, la finalité ontologique de la tragédie se dissout dans le narcissisme social. Euripide et Aristophane. Le désir doit trouver un autre outil pour sa quête. Et c'est donc ainsi que le concept prend la relève de la méthode poétique, la métaphysique tire un rideau opaque sur l'Être de l'étant. L'étant est déplacé vers un ailleurs de son être dont religions et sciences sont désormais chargés de dénicher le lieu, le ti esti de l'étant, son essence. C'est ainsi que naît le concept de l'être, mais cette fois comme réel imaginaire dont l'expertise véritative des philosophes est désormais chargée de vérifier à chaque fois son homothétie avec la nouvelle réalité. L'événement proprement historique dont parle Heidegger est ce passage de l'alethéia à la veritas, de la vérité parménidienne de l'Être, l'évidence de l'étant-un, au monde des étants représentés comme des sujets comportant une essence et des attributs.
L'homme nu nomade n'a pas d'essence. Il ne pourrait même pas servir d'élément dans le plus simple syllogisme qui soit, car dans son état il est impossible de trouver des généralités ou des classes dans lesquelles il puisse logiquement se situer. L'homme nomade, Robinson, est à chaque rencontre autre chose qu'un homme car dans cette posture ontologique il peut exprimer, à chaque rencontre, sa singularité absolue, sa vérité et sa liberté. En fait l'homme naît en tant qu'homme, dans la taxinomie conceptuelle de l'idéalisme platonicien et seulement là. Ce que les droits de l'homme reprendront plus tard, ce n'est pas une définition métaphysique, c'est une affirmation volontaire, celle-là même qui a manqué lorsque se sont formé les premières communautés sédentaires. L'homme qui ex-siste, comme dit Heidegger, ce n'est pas l'homme en tant que tel confronté à l'étant et à son occultation ontologique, c'est l'homme qui vit dans l'extériorité d'une taxinomie, dans une troupe ou un troupeau (selon la religion) métaphysique. Son aliénation est celle de sa singularité, et, par voie de conséquence, de sa liberté.
La véritable tragédie grecque, celle qui a mis fin à ce que nous entendons aujourd'hui dans l'expression la Grèce Antique, c'est l'exténuation mécanique du paradoxe qui opposait dès l'origine Ioniens et Doriens. Sparte incarne curieusement le nouveau modèle choisi et son éthique, la cité, le sédentarisme parfait, fondé sur l'agriculture, cependant qu'Athènes déroge à ce choix en préférant l'espace maritime et l'aventure commerciale nomade. Les lois des uns et des autres ne pouvaient que se heurter de plein fouet, Lacédémone se cristallisant autour d'un système de castes, alors qu'Athènes opte pour la démocratie. Les conservateurs ne sont pas ici ceux que l'on pense car la démocratie est, selon la disposition ontologique nomade, la loi ancienne.18 Dans le nouveau cadre sédentaire, le système des castes est une nécessité fonctionnelle incontournable, raison pour laquelle toute la puissance athénienne se heurtera jusqu'au bout et jusqu'à la catastrophe finale au " progrès " du modèle sédentaire. Celui-ci n'est pas seulement présent dans la capitale dorienne, mais aussi dans les lointaines cités de Grande Grèce où son principe connaît un développement beaucoup plus simple et plus rapide parce que colonial. Zénon d'Elée comme Empédocle en seront les victimes sacrificielles car en eux déborde encore la loi naturelle, celle de la singularité libre de toute loi interne, à savoir de toute forme idéale, de toute représentation collective de l'essence de l'être humain. Par leur sacrifice, la justice ontologique doit céder la place à la justice des hommes. C'est ici que commence la fuite des Dieux.
Le destin ultérieur de la République Romaine et le Moyen-Âge verront s'épanouir le nouveau modèle. La société de castes deviendra pour plus de deux mille ans le nouveau milieu naturel de l'être humain dominé par le règne de la violence totale et permanente. Mais aujourd'hui, à une époque où le tissu de cette violence devient presque transparent, c'est à dire invisible, l'utopie à l'envers d'un retour vers l'état nomade, celui de l'homme nu, redevient concevable, ou plutôt prend enfin sa véritable place dans la conceptualité historique et dans l'élément du politique. Le déchaînement spectaculaire de la représentation d'une violence fictive, le caractère de plus en plus orgiaque de la fiction contemporaine rend compte du même paradoxe d'une société qui s'accroche à sa valeur constitutive qu'est la violence politique et laisse surgir en même temps de son intériorité la plus intime la dimension la plus naturellement anarchique. Le héros moderne et américain est l'homme nu, nomade et qui vit hors des lois de son pays, à la condition que dicte Bob Dylan lui-même : -" to live outside the law you must be honest ", si tu prétends vivre hors la loi, ce sera au prix de ta loyauté.
Notes :
1 - Jean Baptiste Vico, Principes de la Philosophie de l'Histoire, Bibliothèque de Cluny, 1963, italiques dans le texte
2 - in Questions II, Gallimard NRF 1973.
3 - La démocratie en tant que telle n'est pas essentiellement partage égal de l'espace et donc du pouvoir et de la richesse, partage qui n'est que la fiction de l'égalité dites aujourd'hui des " chances " pour l'individu qui circule dans l'aléatoire naturel, elle est surtout jeu et fiction du partage des rôles dans le théâtre de la nature, dans l'espace et le temps. Le paradoxe de la démocratie réside dans le fait qu'elle mime ou tente de recréer l'état de nature dont elle est issue et donc ses lois.
Samedi 20 décembre 2003
Le safari du concept.
Il y a un mystère dans notre récit. Un mystère sur l'origine de cette conceptualisation de l'Être. Que fait Parmenide quand il prononce les mots On et Eïnai ? Se sert-il de concepts ou d'autre chose que de concepts ? Rien ne permet de répondre à cette question. Heidegger parlera d'un impensé historial de ces deux mots, reconnaissant par là le triomphe radical des manœuvres militaires intellectuelles platoniciennes, une sorte de génocide spirituel. La pensée aurait été écartée de la substance même de ces deux mots en même temps qu'elle s'en emparait formellement. En même temps aussi, et nous venons de raconter cette épisode, qu'elle inventait la transcendance de l'Être en tant que substantif, en tant que mot désignant non pas une action ou un état mais une personne ou une chose. Il y a donc dans cette dernière opération au moins une complicité avec ce qu'on appelle la conceptualisation, elle a partie liée avec le concept. On penserait presque, mais nous y viendrons sans doute aussi, à ce que les marxistes appellerons plusieurs milliers d'années plus tard la réification, la transformation de toute chose, y compris l'homme, en chose au sens de la marchandise. Nous avons déjà vu que la possibilité de valoriser les étants, de créer des échelles de valeurs, dépend étroitement de cette substantivation de l'Être. Or la valeur est le cœur même de la marchandise en tant que chose déterminée par le marché. Mais la question demeure, quelle langue parlait Parmenide ?
Nous n'avons pas le choix. Il faut tenter de comprendre comment sont nés les concepts, ce que signifie la saisie par concept des étants et de l'Être. Au début de notre méditation nous avions imaginé une blague : Parmenide aurait coupé une simple phrase en deux, une phrase qui aurait abouti à cette découverte inouïe : Je suis Je. Nous avions même, presque sans le vouloir ni sans l'avoir planifié dans notre pensée, déduit de cette astuce les conséquences philosophiques qui allaient marquer l'époque moderne, celle du sujet et de la conscience de soi. Tout de suite cela nous évoque Hegel et le chemin de croix de la conscience qui aboutit au Savoir Absolu. L'Être n'est plus vraiment une transcendance extra-terrestre mais le produit d'un procès, d'un mouvement de la conscience de soi s'aliénant elle-même et se ressaisissant à travers l'Histoire. En fait l'Être lui-même s'est aliéné dans l'étant historique, on se retrouve dans les récits gnostiques et dans une alliance stratégique quasi invincible entre le panthéisme de Spinoza et la théologie monothéiste la plus vulgaire. Ce que nous avions donc fait, en réalité, c'est une fiction qui ne fait que révéler l'essence de la conceptualisation : le concept est la mise en subjectité de l'étant, l'étant est devenu le Sujet.
Hegel disait de l'Art qu'il était mort, qu'il n'avait été qu'un moment de cette chaîne d'aliénations successives dans laquelle s'est formée la conscience de Soi. Et malgré le déchaînement contemporain autour du motif de l'Art, malgré les énormes investissements dans l'affairement artistique que nous connaissons aujourd'hui, il est difficile de ne pas reconnaître que l'Art essentiel réside aujourd'hui dans les cimetières de notre culture, dans les temples, les églises, les musées et dans les galeries marchandes. Mais l'art a servi, l'homme s'est cherché et semble-t-il s'est trouvé dans les représentations artistiques qu'il a faites de l'étant, du monde, de lui-même. C'est que, ce que nous appelons Art depuis à peine deux ou trois siècles n'est Art que depuis sa mort, c'est à dire que depuis qu'il ne sert plus à rien. Mais à quoi servait-il au paravent ? Ou bien pour être plus juste, à quoi servaient les activités humaines qui ont produit ce que Heidegger a eu tant de mal à interroger en tant qu'œuvres d'art ? L'Art a bien été, comme le dit Hegel, un moment de la conceptualisation de l'Être. Nous allons tenter de le décrire, car ici il n'est pas question de démonstration.
Le cadre de la naissance (et de la mort) de l'Art, c'est ce qu'il est convenu d'appeler la civilisation, la nôtre, l'occidentale. Mais ne nous y trompons pas, il y a de l'occidental dans toutes les autres formes de civilisation qui ont émaillé les siècles passés et dont certaines tiennent encore bon sous le masque formel de la nôtre. Je pense notamment au Japon. Quels sont les choses que l'on examine en premier lorsqu'on étudie la naissance de notre civilisation et quelle est la science qui s'en préoccupe au premier chef ? Ce sont les ruines de ce que furent les plus anciennes cités que fouille avec acharnement la catégorie particulière d'historiens qui pratiquent la science de l'archéologie. On peut considérer cette science de plusieurs manières et lui attribuer autant d'objectifs qu'on veut, mais son tout premier moteur aura été la mise à jour ou la recherche de ce qui a pris dès le dix-huitième siècle le nom d'œuvre d'art. L'archéologie a toujours d'abord été une chasse au trésor, au point que le marché de l'art ne fait, de son point de vue, aucune distinction entre un vase grec et un tableau de Chagall. Dans les riches appartements new-yorkais ont peut admirer une immense toile de Picasso à côté d'une vierge noire du douzième siècle dérobée dans la crypte d'une quelconque abbaye d'Europe. Nous savons que ces deux œuvres reconnues toutes deux comme des œuvres d'art n'ont pas été produites dans le même but ni dans le même esprit, et pourtant nous les rangeons toutes les deux dans la même catégorie de l'œuvre d'art. Comme si le temps avait conféré à l'une ce que le génie du peintre a incorporé à l'autre, la valeur.
Nous appellerons cet étonnant paradoxe la complicité ou la solidarité qui cimentent les éléments en réalité tout à fait hétérogènes de l'Histoire de notre civilisation. L'archéologie, comme bien d'autres sciences humaines, tissent en permanence un lien signifiant entre un commencement fantasmé et un présent supposé. La valeur intrinsèque du vase grec ne provient nullement de sa rareté ni de sa valeur esthétique, il provient de sa proximité temporelle avec ce qui est quasi rêvé comme le début fondateur d'une époque à laquelle nous appartenons et à laquelle nous nous accrochons comme à une bouée ontologique. A l'autre extrémité, dans notre présent ontologique, nous produisons des objets qui ne se relient plus à cette origine que dans l'ordre de la valeur. La valeur esthétique, donc marchande, est en réalité son degré de conformité avec le geste initial du produire l'objet en tant qu'objet. Mais il y a une raison très concrète et très nécessaire à cette étrange opération. La solidarité culturelle confirme le sens originel du choix primitif, c'est à dire du moment qui installe notre époque. Elle valide en permanence l'échelle des valeurs du monde sorti, pour parler vite, du monde platonicien, du monde non pas étant dans son Être, mais n'étant que par un Être autre que lui.
Le temple grec, le tableau de Van Gogh, le vase grec, tous ces " objets " fonctionnent,
pour employer cette expression immonde, de la même manière, c'est à dire dans le même sens :
ils mettent le présent en silos, ils décorent leur supposé présent avec les trophées
de leur chasse à l'étant. Qu'est-ce-que la chasse à l'étant ? C'est ce que nous nommons, pas pour rigoler, le safari du concept. Dans son texte fameux, l'Origine de l'œuvre d'Art1 (1) Heidegger poétise dans le registre du merveilleux la fonction structurante du temple, son pouvoir révélateur des étants qui l'entourent. Et c'est peut-être là qu'il commet sa principale erreur d'appréciation de ce qui se passe avec la construction du temple ou avec la peinture des chaussures de paysans. Ce n'est pas vraiment un erreur en fait, car il saisit pleinement le rôle de l'ergon, la " fonction " de l'œuvre dite d'Art. Simplement il inverse les choses, il confère à l'œuvre une force contraire à celle qui se manifeste en elle. Pour Heidegger, la force de l'œuvre d'art est proprement créatrice de l'étant, c'est par elle que surgit la figure de ce qui tient debout, son fameux Ge-Stell, si difficilement traduisible et dont le sens se tient pourtant si près de la vérité. Bien sûr, le philosophe a pris la précaution de préciser que les étants ainsi structurés ne sont étants qu'en tant que différents de l'Être. L'œuvre d'Art participe de l'Epokè de l'Être qui édifie le Ge-Stell. Et tout cela est exact, indéniable et tout à fait cohérent avec ce que nous pensons de la civilisation et de son histoire. Mais il ne s'agit là que d'une précaution qui ne fait qu'épaissir le mystère fomenté par la différence ontico-ontologique.
Là où quelque chose semble lui échapper, c'est qu'en vérité l'artiste ou l'architecte n'ont en fait réalisé qu'un transfert de l'étantité de l'étant en tant que tel dans l'œuvre comme valeur représentative de l'Être substantivé. On a rentré dans les murs du Temple la valeur étante des choses de la Physis, on a fait du Temple le lieu de résidence de l'Être (Suprême), exactement comme aujourd'hui les artistes (et les techniciens) continuent d'essorer l'étant sous toutes ses formes et jusqu'à la dernière goutte pour en tirer l'étance et la celer dans les cadres, les formes, les couleurs et les sons. Ce que Heidegger semble laisser de côté, c'est la motivation de l'architecte, le désir concret des artistes, qui, dans l'Antiquité, n'étaient guère autre chose que les exécutants des Hautes Œuvres, celles qui unissaient déjà là, dans l'espace hellénique, des tribus parfaitement étrangères les unes aux autres. Heidegger constate l'effet structurant de l'œuvre, mais ne s'intéresse nullement au contenus de la volonté grecque, ni de l'incroyable cohérence qui lie l'opération platonicienne et la praxis religieuse des Grecs. Ce qui se passe pour le temple comme pour la cathédrale, c'est la construction du tombeau des étants : l'étantité comme valeur désirée passe de la Physis à la Tekhnè. La Physis, elle, se meurt lentement, s'épuise de cette chasse sans pitié, se plie à la lubricité de l'Homme occidental, à l'établissement du règne de la subjectité. Précisons tout de suite qu'il s'agit ici de la Physis fantasmatique des traducteurs linguistiques et philosophiques, l'entité qui se serait détaché du tout pour laisser à l'Homme l'espace de la Tekhnè, le nouveau monopole de l'étant. La traduction de Ge-Stell par arraisonnement est sans doute la meilleure possible, car l'œuvre d'Art, ce qui passe dans l'esprit occidental pour l'œuvre d'Art, n'est rien d'autre que la forme primitive de la mise en exploitation technique de l'étant, son condensé, son bleu pour le chantier d'un étant entièrement soumis au désir humain.
Tout cela n'est pas facile à suivre, même si les résultats sont si patents aujourd'hui. Car ce qui est en cause est le concept et non pas le destin des choses. Ce que je tente de peindre ici, c'est la formation même du concept, ce rapt du sens des étants et leur mise en boîtes de conserve historique. Avec le temple, c'est en réalité une logique qui se construit, une logique au sens de Hegel, c'est à dire La Logique du Savoir Absolu. L'artiste est le premier concepteur du monde, le premier homme à lui infliger un sens en le démantelant dans ses représentations. Le redoublement de présence de la représentation est en fait un rapt de l'étant en tant qu'étant. Le sentiment des primitifs découvrant la photographie et l'accusant de voler l'image de celui qui est photographié est parfaitement légitime, parfaitement vrai. Le cliché viole le sujet en lui dérobant une situation de son être, ou plutôt en le détachant de l'être pour en faire un étant. De même le peintre qui s'arroge le pouvoir d'interrompre la vibration temporelle de ce qu'il peint. Que ce soit un paysage, une nature dite morte ou un simple sentiment qu'il exprime dans le langage de la couleur. Le mensonge de l'œuvre d'Art réside dans son intemporalité, dans sa déhiscence par rapport à la Logique de l'Être qui est Temps. Dans l'Histoire, c'est une nouvelle temporalité qui s'installe dans la proximité du Temps ontologique, une temporalité de force qui construit sa Logique selon les techniques de la guerre, celles de la construction des forteresses qui éteignent l'étant selon le rayonnement de leur réseau : Vauban a fait de la France le premier espace mathématique, un morceau de mathésis, en stérilisant toute possibilité événementielle à ses frontières.
Ici s'impose un commentaire sur le thème de la mimésis et à son propos, sur la théorie kantienne du génie comme imitateur naturel, c'est à dire comme représentant de la Physis qui se représente elle-même. Il faut entendre ici " représentant " au sens de délégué (par la Physis). Selon Kant, qui reprend en cela Artistote, toute l'activité humaine peut se résumer en une vaste imitation de la Physis, la fameuse mimesis. Il y a pourtant un distinguo à faire entre deux sortes de mimesis. D'abord la mimesis simple, celle de tout le monde, celle des enfants qui grandissent dans l'imitation de leurs aînés, celle des paysans ou des ouvriers qui passent leurs journées à imiter les gestes qu'ils on vu faire et qu'ils transmettront à leur tour aux générations suivantes, et puis aussi celle des artistes médiocres qui passent leur temps à faire des imitations grossières destinées à faire rire ou à faire pleurer. Et puis il y a la grande mimesis, l'imitation suprême, celle des génies. Les génies n'imitent plus les choses mêmes et les mouvements mêmes de la nature, ils imitent son talent créateur lui-même, ils s'identifient ainsi largement à la nature elle-même dont ils sont " les favoris " : " .. ; pour ceux-ci l'art est dans cette mesure une imitation dont la nature a donné la règle par un génie " (2) . La nature donne ses règles par les génies, les hommes qui produisent ce qu'on appelle communément dans la science dite de l'Esthétique, le sublime. Or, le sublime n'est rien d'autre que la limite extrême de la Raison, pire il est ce qui se produit lorsque la Raison est dépassée par les événements. Le sublime a donc pour fonction essentielle de démontrer a contrario la grandeur de cette même Raison. La Raison qui, elle, se contente de produire des concepts dans l'ombre de la seule parousie qui compte, celle du sublime produit par l'artiste humain.
Or, le sublime est à son tour imitation du vrai sublime, du sublime naturel : la beauté de la nature et ses mouvements produisent eux-même les émotions qui définissent le mieux l'effet du sublime. Un violent orage, un paysage d'été ou une tempête déchaînée nous offrent, malgré la peur, des images sublimes, mais seul l'artiste génial a le pouvoir de recréer de telles situations émotionnelles par le sublime qu'il représente dans son œuvre. Le génie est donc un homme pas ordinaire. Nous avions employé le mot de délégué par la Physis - en réalité par Dieu - il faudrait dire chargé de mission, et quelle est cette mission ? Elle est assez perverse car Kant est obsédé par deux convictions. La première est que nous ne pouvons rien savoir en dehors du monde des phénomènes, monde organisé dans notre esprit par la Raison Pure, organisé signifiant, disons-le carrément, inventé. La deuxième est justement la toute-puissance de cette Raison, qui puise précisément sa garantie (divine) dans le sublime par un jeu de repoussoir facile à comprendre. Le sublime produit ce qu'il y a de mieux dans l'existence, le plaisir suprême et même une certaine béatitude, et ce sont ces états d'âme (Dans sa troisième critique Kant use et abuse des descriptions de l'âme qui n'est ni la Raison, ni simplement une psyché quelconque) qui donnent l'ordre de grandeur de l'autre (âme) la Raison Pure qui donne les concepts. Tout cela est peut-être une manière paradoxale de présenter Kant, un peu à l'envers, mais cette méthode a des qualités éclairantes que la raison ignore, car on comprend comment le penseur de Königsberg est piégé par son système : le génie, en réalité, ouvre des portes à l'Être, et pour ce faire il doit posséder des pouvoirs qui remettent largement en cause le dogme de la docte ignorance kantienne. Il n'est pas étonnant que la troisième critique revienne sur Dieu et sur la preuve de son existence, car le génie et son sublime ont partie lié avec lui, et c'est le miracle de l'existence du génie qui atteste celle du créateur de la nature. Rappelons simplement le titre de la quatrième section du chapitre qui s'intitule " l'Idéal de la Raison Pure "(3) : " De l'impossibilité d'une preuve ontologique de l'existence de Dieu ". On a compris que les concepts sont, eux, impuissants à prouver cette existence et que sans les génies, il n'y aurait pas de Dieu du tout.
On a compris aussi que les concepts demeurent sous la dépendance de ceux qui ont un accès à l'Être, qui dialoguent en quelque sorte avec Dieu, que leur valeur dépend totalement de ces génies qui occupent une place quasi démiurgique dans la société humaine. Au demeurant, nous ne disons pas autre chose, nous pouvons même affirmer notre totale accord avec une telle proposition. Ce sont bien les artistes qui précèdent, pour ainsi dire, les concepts. Ce sont même les artistes qui, en réalité, les fondent, les créent, leur donne forme et sens. Au point qu'il faut, à notre sens, considérer comme des artistes les êtres humains qui ont forgé le langage, sa logique, sa rigueur, sa richesse et sa poésie. Mais pour nous, mais pour moi, ces artistes sont des hommes comme les autres. La notion de génie apparaît à un moment de l'histoire où quelqu'un comme Emmanuel Kant, et plus tard Hegel, ferment pratiquement le grand livre des concepts, où tout est dit, où il ne reste pratiquement rien à concevoir. Presque deux siècles plus tard, Heidegger sera tout à fait d'accord lui-même pour reconnaître la clôture du monde conceptuel en soulignant son impuissance essentielle à entrer dans la compréhension de l'Être. Or, ce qui se clôture ainsi ce n'est pas seulement l'univers conceptuel, car celui-ci a une limite évidente qui est l'homme, ce qui se ferme avec le concept tout-puissant, c'est la toute-puissance de l'homme. Elle se ferme au sens où elle élimine tout autre possibilité d'accès à l'étantité : l'étant dans sa totalité est devenu le monopole du concept. Il est ainsi devenu le monopole de l'homme pensant : il faut bien saisir ici ce que signifie un tel monopole : la réalité est devenue la création exclusive du sujet humain. Or cette clôture est aussi la clôture de toute ontologie, son anéantissement, et sans l'astuce du génie la pensée elle-même s'effondre sur elle-même pour de bon.
Pour illustrer ce dont on parle ici, on pourrait faire des comparaison avec les idéalismes qui ont émaillé l'histoire de la philosophie. D'abord la formidable machine de guerre philosophique que fut l'œuvre de Berkley et qui demeure, j'en suis convaincu, le défi majeur à tous les idéalismes post-cartésiens. Elle reste un défi surtout par sa simplicité. Berkley démontre sans difficultés que toute connaissance est représentation. Ne perdant pas son temps à diviser le monde en réalité et en semi-réalité comme le fait Descartes, il ira droit au but : le monde n'est rien d'autre que la vision de Dieu, vision à laquelle l'homme participe dans sa mesure singulière et selon l'ordre et la force de ses vertus. Il s'agit ni plus ni moins que d'un hégélianisme avant la lettre, car le Savoir Absolu hégélien peut se superposer point par point à la Vision divine au cœur de laquelle peut se glisser vaille que vaille le regard de l'homme. Quant à la dialectique, à ce qui finalement se conçoit chez Hegel comme aliénation de l'Esprit dans l'Histoire, hé bien ce n'est pas grand chose d'autre que le désir de Dieu de se contempler lui-même à travers le kaléidoscope de l'humanité et de la nature. Mais on ne peut plus compter sur des comparaisons de ce genre, car le troisième terme de tous les idéalismes, Dieu, l'Esprit ou même l'Ego, ont sombré dans l'indifférenciation technique. Il n'y a plus trois termes dans l'appréhension de l'étant, à savoir l'homme, la nature et Dieu, il n'en reste plus que deux, l'homme et la nature. Et encore ! La conceptualisation du monde ce n'est pas seulement une affaire de vocabulaire, ce n'est pas seulement l'emprise taxinomique de l'homme sur les choses et leur classement par rapport à ses besoins et à ses désirs. Le grand événement de l'Occident c'est la Science et sa servante la Technique : l'arraisonnement dont parle Heidegger à travers le technique, ce n'est pas seulement l'appropriation sémantique des choses, c'est leur conceptualisation au sens le plus élevé, c'est à dire leur transformation en objet humain. Il semble qu'on le sache, qu'il ne s'agisse là que d'une banalité pseudo-philosophique, mais tel n'est certainement pas le cas car ce qui échappe aujourd'hui à tous les penseurs, du moins ce qui se dissimule sous leurs angoisses, c'est que cette transformation est en réalité le produit d'une volonté de mutation : l'Homme veut s'attribuer le sens même de l'Être. Cette auto-attribution n'est rien d'autre que la volonté de fabriquer un ersatz d'Être, un Être artificiel. Pourquoi l'homme ferait-il une chose pareille ? D'abord parce qu'il ne sait pas ou plus faire autrement pour gérer sa relation à l'Être. Faute de soutenir les yeux ouverts l'éclat de la Parousie, il se voile la face par un monde qui sortirait exclusivement de lui. Platon disait que l'étant lui-même était ce voile qui recouvrait la réalité de l'Être et sans doute pensait-il en réalité la même chose que nous dans la mesure où toutes ses analyses de l'étant tournent autour des étants produits par l'homme, de la tekhnè. Au fond, Platon lui-même déjà, avait oublié le sens de la Physis, le règne de la Science avait commencé depuis déjà trop longtemps.
Notes
1 - Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, Paris, 1973
2 - Emmanuel Kant, Critique de la Faculté de Juger, Traduction Philonenko, Ed. Vrin 1974, page 147.
3 - Emmanuel Kant, Critique de la Raison Pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, PUF 1967 page 425
Dimanche 21 décembre 2003
Vérité Liberté.
Dans les sombres années de la guerre d'Algérie, il existait un journal vendu clandestinement dans le métro et dans certains couloirs de facs. Il s'appelait Vérité Liberté(1) et donnait des informations sur ce qui se passait réellement en Algérie, notamment la pratique de la torture. Ce rappel d'un fait banal dont l'intitulé reprend pourtant cette étonnante équation que Martin Heidegger nous livre au détour de l'une de ses conférences : vérité = liberté, donne le ton de ce qui va suivre.
Au fond, il existe une banalité théorique, une thèse sur l'histoire que l'on n'ose plus exhiber sous peine de risquer les fourches caudines du ridicule, tant est grande aujourd'hui la puissance de ce qui s'est construit en négatif de cette thèse à savoir le pragmatisme(2). Cette thèse est aussi celle du progrès, le progrès de l'esprit humain. L'Histoire serait le mouvement du désir de la connaissance, je traduis par élaboration de la question de l'Être. Il faut se souvenir de la liaison originelle entre l'effort scientifique et technique et la quête du sens profond de l'existence de l'être humain. L'autre histoire, celle de la philosophie, est en réalité la seule et véritable Histoire, qui, comme on le sait ou croit le savoir, se termine avec l'élucidation définitive de la Logique hégélienne. A ce stade, nous nous trouvons dans la situation suivante : Hegel aurait mis un point final à la méditation occidentale sur le sens, laissant ses successeurs dans une sorte de capharnaüm scientifique et technique qui semble poursuivre un mouvement propre, sans limites et sans finalité connues. La question qui court aujourd'hui sur la fin de l'histoire illustre bien cette situation. En gros, la théorie de l'Etat de Hegel agrémentée de la thèse d'une démocratie universelle d'origine kantienne aurait mis un point final au problème de l'existence des hommes sur cette planète. Au-delà de cette clôture, c'est : et maintenant au boulot ! En fait, tout se passe comme si le sens cherché n'avait jamais été autre chose que le secret du vivre en commun, la liquidation du terrible problème de l'individuation face à l'existence des sociétés. Or, notre méditation nous a conduit à une pensée diamétralement opposée à celle-ci. Ce que nous affirmons ici est tout différent. Le danger que contient l'opposition de l'universel et du singulier faisait intégralement partie de ce qui était déjà su, connu, appréhendé avant tout établissement social. On pourrait même dire que le tragique de l'histoire était au menu dès le début et que les hommes qui l'ont fondé étaient parfaitement conscients que l'état social ne pouvait être que provisoire, qu'il ne s'agissait que d'une technique, ce que j'appelle partout ailleurs une stratégie déterminée et non pas la finalité elle-même de la fondation de la Cité. Autrement dit, ce danger a été considéré comme risque qu'il fallait prendre pour parvenir à des fins toute différente de cette simple découverte de la recette politique de l'Etat + la Démocratie et passez muscade.
Or il semble que les faits me donnent raison sans même que j'ai à les expliquer : le duo kanto-hégélien est bel et bien mort dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Auschwitz est le nœud de la Tragédie historique, la limite ultime de l'expérience sédentaire comme la preuve ontologique de son impossibilité. Je n'aime pas rester dans le sous-bois des sous-entendus et de la suggestion, mais l'existence simultanée de cette réalité totalitaire et de quelques hommes de pensée comme Heidegger, Jünger et Lévinas n'est pas un hasard. C'est la nécessité imposée par le mouvement du sens de l'Histoire en tant qu'expérience de l'Être et pour l'Être. C'est le prix d'une sorte de trahison de l'envoi initial. Dans l'idéologie morale contemporaine, Auschwitz, et ses semblables pseudo-communistes, fonctionnent comme avertissement moral et comme mésusage de la doublette métaphysique hégélienne et kantienne, et non pas comme rejet. C'est dommage, car si l'on a pu se duper soi-même, et j'avoue être passé par là d'une certaine manière, si l'on a pu se dire au lendemain de 1945 et cinquante ans plus tard que le totalitarisme avait été jugulé, et qu'avec sa disparition s'ouvrait enfin la perspective d'une culture humaine de paix, il faut bien déchanter aujourd'hui. Les hommes attentifs de ma génération n'ont d'ailleurs jamais été réellement dupes, et Mai 68 aura été tout autre chose, dans son projet essentiel, qu'un simple dérèglement entérologique de la démocratie européenne. Nous avons senti la persistance des démons totalitaires tout au long de notre jeunesse de l'après-guerre et très tôt compris qu'ils étaient consubstantiels, non pas à un mode de fonctionnement politique, mais à l'oubli de ce pour quoi nous étions dans une Histoire. Pour nous, la pièce était loin d'être terminée et notre refus de " retourner au travail " contenait un refus beaucoup plus radical de cela même qui se faisait passer pour l'histoire achevée.
Notre " vécu " de la Guerre d'Algérie, et des autres guerres coloniales ou impérialistes, venait nous confirmer dans la conscience de l'hiatus essentiel qui perdurait entre la liberté et la vérité. L'Etat démocratique qui avait fait mine de moraliser l'histoire dans la plus sanglante des guerres connue, continuait de bafouer la liberté aux quatre coins du globe dans l'indifférence générale. La tyrannie simple continuait de suppurer d'un système politique qui s'avérait ainsi tout simplement malade. Mais, au-delà d'une infection que la grande Démocratie Américaine fit alors mine de soigner à coup d'antibiotiques diplomatiques et économiques, le totalitarisme resurgit comme son ombre dans son propre berceau européen et comme sa nouvelle figure dans la Religion. Le problème n'était pas une affaire de rigueur démocratique car là-même où les hommes se targuent de pratiquer la forme la plus parfaite de la démocratie, les Etats Unis d'Amérique, là s'est mis à frapper le terrorisme, nouvelle forme de la politique totalitaire. Quoique, pas si nouvelle que cela, puisque le terrorisme fut l'arme de conquête des nazis et des-dits communistes. Il est intéressant de noter le consensus non-dit qui fait que les états démocratiques modernes désignent le nouveau totalitarisme par ce seul mot de terrorisme, qui n'est que la méthode des nouveaux totalitaires. Mais allez donc désigner l'Islam comme le nouveau nazisme, alors que ce totalitarisme infecte, en réalité, tout le cœur du monothéisme en tant que tel, de l'onto-théologie.
Alors tout est possible. De dire par exemple que non seulement l'Histoire est close, finie, terminée, circulez, mais de sous-entendre ainsi qu'elle n'a jamais eu lieu. Car d'une part, si une Histoire avait eu lieu réellement en tant que résolution du problème de l'être-ensemble des hommes, on serait loin de pouvoir affirmer qu'elle est terminée et que le problème est résolu. C'est ce que nous venons de démontrer. D'autre part la dénégation absolue de toute histoire ne ferait elle-même que confirmer l'impossibilité essentielle de l'être-ensemble des hommes. Du moins dans sa configuration actuelle. Ce qui reste en-dehors de toutes ces pensées qui s'affairent autour de l'idée d'une Histoire, c'est que l'objet de cette science n'est peut-être pas elle-même, c'est à dire la chronique de l'aventure sociale, mais la cause de cette aventure, à savoir la question de l'Être. Pourtant on y a longtemps cru, en toute simplicité, à cette eschatologie ontologique de l'Histoire. Le positivisme lui-même était paradoxalement pétri de cet idéal de la connaissance ainsi que toute l'idéologie républicaine française qui avait partie liée avec lui. Personne ne peut nier qu'au cœur même de la science des dix-huit et dix-neuvième siècles, battait la passion de la vérité de l'Être de l'étant, même si cette passion avait perdu son chemin entre le romantisme et le rationalisme cartésien. Les " gens compétents " ont cherché avec ardeur et enthousiasme, mais ils ont cherché le " concevable ", ils l'ont cherché dans le romantisme le plus échevelé, lisez Hölderlin et méditez son idée de la calculabilité de l'art tragique, comme dans le rationalisme le plus distingué, voyez Husserl. C'est son élève le plus distingué qui a flairé le piège du concevable. La pensée d'Heidegger provenait du cœur même de l'onto-théologie puisqu'il avait étudié avant tout la théologie elle-même. Cet accès privilégié à la logique de la substantivation de l'Être et le génie de son maître Husserl lui ont dessillé les yeux pour notre plus grand bénéfice.
Vérité liberté. En vérité, cette équation qui s'est pour ainsi dire imposé à la logique de Martin Heidegger, n'aura pas un grand retentissement dans le reste de son œuvre, et restera toujours une sorte d'Euréka sans lendemain. La question de l'Être finira dans ce que j'ai appelé la bergerie de l'Être et n'aura franchi aucune ligne décisive qui la sortirait de la clôture onto-théologique. Peut-être les spécialistes de la rhétorique ont-ils raison, peut-être Heidegger n'aura-t-il pas réussi à s'arracher du chœur de l'Eglise métaphysique, du temple où le vide de la divinité demande son chant du cygne. D'où son appréhension difficile et erronée de Nietzsche, d'où son refus de commenter Spinoza et Kierkegaard autrement qu'en de rares remarques en passant. D'où son silence final. Il est vrai que Martin Heidegger était lui-même, en tant qu'homme, saisi dans le piège matériel de l'onto-théologie, le nazisme. Son erreur, car je resterai toujours convaincu qu'il s'agit d'une erreur, la même sans doute qui précipita Platon dans l'état d'esclave pour quelques mois, son erreur aura été d'historialiser son époque de travers. S'il s'était contenté de penser son époque comme historiale au sens strict de son essence, il aurait pu se sauver lui-même de cette complicité idiote avec le nazisme, mais il a fait pire, il a cru, et ses propres textes en font foi, à un historial positif et national. Il a cru que le surhomme annoncé, les nouveaux philosophes étaient là, sous les lambris de la Chancellerie. Mais ce simple mirage n'aurait pas porté à conséquence s'il n'avait pas succombé à la tentation de se classer parmi les surhommes, parmi les nouveaux philosophes et parmi les fondateurs du nouveau Temple de l'Être. On sait que Heidegger n'avait pas que des ambitions philosophiques et qu'il se voyait parfaitement en Denkensführer du Reich, en dictateur du penser de son peuple. Bien sûr, cette dictature ne se pensait certainement pas en tant que telle et Heidegger se voyait plutôt en organisateur d'une Allemagne philosophique dont la question de l'Être serait le nouveau projet. Et un tel projet n'avait d'absurde, mais alors une absurdité incommensurable avec la notion même d'absurde, que parce que le contexte proprement politique se formait à cette époque comme le contraire exact de la promotion d'une telle idée. Dans le nazisme naissant, se cristallisait d'un seul coup l'opposition irréductible de l'Histoire et de l'Être.
Ce que Martin Heidegger a en quelque sorte mésinterprété dans Nietzsche est précisément au cœur de cette naïveté sans bornes. Dans un paragraphe contorsionné du second volume de ses conférences sur Nietzsche, données je le rappelle, au beau milieu de la guerre, Heidegger porte contre Nietzsche une accusation ontologique proprement scandaleuse quand il dit que le philosophe du Zarathoustra aurait, dans sa critique des valeurs, en réalité fondé une ontologie de l'étant comme valeur ! -" La " transvaluation " nietzschéenne revient dans le fond à convertir en valeurs toutes les déterminations de l'étant ". (Op cité plus bas). Il ne s'attarde pas sur cette conclusion qui n'avait, dans son contexte qu'une fonction de bouclage métaphysique, il fallait trouver le point ultime où la métaphysique échoue face à la question de l'Être. Et pour cause, car s'il avait creusé la critique nietzschéenne des valeurs, il aurait, à travers notamment le Zarathoustra, compris tout autre chose, à savoir que Nietzsche avait élucidé dans la seule affirmation morale, dont au demeurant il aurait lui-même pu s'accuser, le statut de l'homme par rapport à l'Être. Ce statut n'est rien d'autre que la valeur propre de l'homme dans sa relation à l'Être, une valeur d'ailleurs que Heidegger ne se prive nulle part dans son œuvre d'hypostasier comme ne le fait jamais son illustre prédécesseur. Mais Nietzsche ne se permet nulle part, bien au contraire, de faire de l'homme le " berger de l'Être ", l'homme qui justement n'est rien du tout en référence au Surhomme. La volonté de puissance est un programme pour la race humaine et non pas l'aboutissement ultime et logique de la métaphysique comme la volonté de volonté hégélienne. Le Surhomme n'a rien d'ontologique, il n'est pas (encore) un dasein mais seulement la prophétie d'un aboutissement nécessaire du dépérissement de l'occident métaphysique. La grande souffrance de Nietzsche aura été sa terminologie, il avait à réinventer tout le langage de la philosophie, et en regard de cette difficulté et de l'aristocratisme spartiate de sa pensée, ses choix n'ont pas toujours été heureux. Entre le Surhomme et la Volonté de Puissance, Nietzsche laissait se perdre l'humanité de son propre appel philosophique.
Mais l'expression Volonté de Puissance ne devrait pas tromper un grec de la pensée comme Heidegger, car la Puissance ce n'est rien d'autre que l'Energeia, c'est à dire l'Être même tel que le pensait Aristote. La Volonté de Puissance est la volonté de l'Être dans son double génitif. Cette phrase résonne exactement comme la tautologie un peu magique et creuse de Heidegger lui-même lorsqu'il dit : " L'histoire de l'Être est l'Être même "(3). Mais justement, il ne faut pas s'y tromper, cette volonté de puissance n'est pas volonté d'appropriation de l'Être comme l'affirme Heidegger qui ainsi s'y retrouve dans son schéma qui va de l'Aletheia à la Volonté de Valeur, enfermant ainsi Nietzsche dans la clôture de la métaphysique. Il est vrai que toute interprétation de Nietzsche comporte d'immenses risques de mécomptes tant son texte paraît hétérogène et souvent contradictoire. Je pense que la lecture de ce philosophe ne s'identifie avec aucune autre lecture philosophique, sauf peut-être avec celle de Martin Heidegger, au sens où il s'agit d'une véritable expérience poétique plutôt que du parcours intellectuel d'une représentation classique et logique. Il est curieux que celui-là même qui a si bien problématisé l'énigme du langage poétique soit passé à côté du mystère nietzschéen, car il s'agit d'un mystère encore plus fort, à mon sens, que celui de Hölderlin. Le Zarathoustra, on le sait, n'est rien de repérable dans les catégories connues à son époque dans les genres philosophiques ou littéraires. La seule comparaison possible demeure celle que l'on pourrait tenter avec les livres prophétiques, et encore, il faudrait en ce cas rendre compte du sens de l'absence, dans la mise en scène sémantique du Zarathoustra, de toute espèce de transcendantalité, ce qui est proprement impossible. A condition, évidemment, d'exclure le Surhomme de toute transcendance, ce qui me paraît à moi évident.
Non, non, le propos de Nietzsche, s'il y en a un de vraiment repérable, est celui de la naissance programmée par l'histoire, par son échec métaphysique, des nouveaux philosophes. Mais non pas d'une nouvelle classe de " gens compétents ", rien à voir, mais de l'homme lui-même en tant que philosophe. Pour lui, l'échec des valeurs mène forcément et tout droit à la reprise en main du problème de la métaphysique par l'homme du commun. Zarathoustra n'est pas un prophète ni un modèle de Surhomme, il est l'homme d'avant l'homme de la métaphysique, le nomade solitaire qui a souffert la relation ontologique de la manière la plus pure - au fond comme le Christ, c'est aussi la méditation de Schelling qui prépare en sous-sol l'avènement du Surhomme, à savoir le Chrétien - et qui vient créer le peuple de l'ontologie. Il n'est que le rappel de l'origine, cette origine tant invoquée par Heidegger et jamais élucidée parce que le philosophe de Fribourg était ficelé par sa conscience de classe, par cette réification même qu'il désigne comme l'histoire de la métaphysique. A propos de cette histoire de la métaphysique, on se demande bien parfois pourquoi Heidegger se donne tout se mal, car elle se trouve déjà condensé, et il le sait et le dit, dans la pensée des Grecs. Tout est dans Platon, et il le sait et le dit. Si son propos n'était pas seulement guidé par un souci didactique, ce qui est tout à son honneur, alors il faut soupçonner autre chose, à savoir la nécessité d'une histoire " historiale " pour en arriver à l'exaltation de la germanitude hégélienne et Heideggerienne. Il fallait que les " envois " de l'Être s'enquillent si je puis dire, de telle sorte que la clôture de la métaphysique puisse être attribué au grand philosophe de l'Allemagne dont la langue grecque " est seule en mesure " de parvenir à un tel but. Heidegger ne s'aperçoit que bien trop tard qu'il s'inclut ainsi lui-même dans la métaphysique occidentale, et pleinement.
Mais revenons à son erreur à propos de Nietzsche, car elle est intéressante dans ce contexte précis d'une histoire qui aboutit en fait à l'idéalisme allemand. Zarathoustra est seul sur sa montagne, et cette solitude figure, pour l'humanité, l'Oubli de l'Être. Mais en tant que tel, en tant qu'Oubli pour l'homme, il n'est pas encore oubli de l'Être en double génitif. Car Zarathoustra fraye avec les serpents et les aigles, il est dans l'animalité, ou plutôt dans la fraternité animale : la question de l'Être n'est pas encore le privilège de l'anthropos, elle se partage avec les étants, aussi bien d'ailleurs les animaux que le ciel et les pics neigeux - on se souvient que Nietzsche a écrit le Zarathoustra en quelques jours dans le site fameux de Sils-Maria, au pied du Mont Cervin - la question de l'Être est l'essence de la vie solitaire de Zarathoustra, une vie gaiement partagée avec le Tout de l'étant. Mais, là-bas, dans le lointain des vallées, il y a un fourmillement de cloportes qui ont déserté les sommets (de la solitude) pour se rassembler dans les villes et les sociétés. L'homme d'avant l'homme de la métaphysique des valeurs a trahi sa position ontologique en quittant la solitude du nomadisme. Dans beaucoup d'autres textes de Nietzsche, l'anthropologisme est souvent beaucoup plus flagrant, mais peu de commentateurs ont découvert que le Zarathoustra est une étude de part en part anthropologique et que cette étude n'a absolument rien de religieux ou de mystique, encore moins de politique. Elle devient ontologique dans sa finalité morale car le Zarathoustra constitue une sorte d'épisode du Sinaï, de jeu réitéré de la donation originelle de valeurs. Mais d'une donation intra anthropologique, du don d'homme à homme, ce que salue dès son arrivé parmi les hommes le funambule du prologue. L'énigme du funambule n'est pas une énigme bien difficile à élucider. L'artiste populaire, le représentant de la mort en conserve de la fiction représentative, cède sa place à l'Homme qui revient, à celui dont lui seul, l'Artiste, a gardé le souvenir pratique et préservé l'honneur au-delà de la fuite dans les plaines de la multitude. En réalité cette multitude est devenue multitude dans sa fuite éperdue des sommets vers les plaines de la métaphysique platonicienne où les bourgeois se regardent " et clignent de l'œil ". Heidegger a bien senti tout cela, mais comment a-t-il pu confondre Hitler avec Zarathoustra ? Car tout le scénario est en place lorsqu'on lui propose en 1933 le fameux Rectorat qu'on lui a tant reproché : Zarathoustra-Hitler est descendu des montagnes et a entrepris de pulvériser le monde des philistins et de donner à l'Allemagne la flamme Olympique du futur Jeu du monde.
Aussi simple que cela. Heidegger avait bien compris le Zarathoustra, trop bien. Il lui aura fallu quelques années pour se distancier de la grossière erreur dont cette bonne compréhension était paradoxalement l'origine. Il faut ici préciser que l'identité du Zarathoustra de 1933 n'avait aucune importance. Hitler n'était qu'un signe destinal, il était le = 0 de l'étant dans sa faiblesse la plus grande, et cela n'importunait nullement le véritable Zarathoustra qui se cachait sous la toge du professeur de Fribourg. Mais restons de glace pour que ce qui est écrit ici ne soit pas interprété comme une Xième satire de Martin Heidegger. Rien à voir avec le rire ici. Heidegger est resté honnête tout au long de sa démarche, car ce qu'il avait en vue n'avait rien de commun avec une ambition personnelle, ambition que l'on se complaît un peu trop souvent à souligner, notamment dans les descriptions souvent triviales de ses rapports avec Hannah Arendt, alors que tout son parcours démontre la plus grande humilité, ou le plus grand mépris pour le pouvoir universitaire, le seul dont il aurait pu cultiver l'ubris. Non, Heidegger a cru sincèrement à l'avènement de la plus grande Kehre, du plus grand bouleversement culturel de l'histoire de l'occident, il a cru au scénario de Nietzsche du début à la fin. Et, au fond, il n'avait pas tellement tort, il avait si peu tort que sa seule erreur d'interprétation de Nietzsche provient d'une sorte de reniement de ce qui l'avait ébloui dans le Zarathoustra. Au sortir de cette expérience, il est un penseur brisé mais non anéanti. Il entreprendra le chemin inverse de celui du héros de Nietzsche en se hissant sur les hauteurs de Todnauberg pour n'en plus jamais descendre que métaphoriquement. Il est même resté très cohérent du point de vue de la théorie, car il n'a jamais cessé d'alimenter son " pressentiment " d'un nouvel envoi destinal. Son tragique à lui aura été l'exigence par l'Être même de son silence à lui Martin Heidegger, non pas de sa mort qui restera purement anecdotique, mais le silence de sa voix, le devenir voix blanche de son prodigieux poème ontologique. Il a payé pour son audace, paix à son âme.
Vérité Liberté. Nous y voilà, avec Zarathoustra au milieu de " son " peuple. Il serait juste à cette croisée des chemins de faire un petit signe, un Wink, à l'autre penseur du dasein, à Jean-Paul Sartre dont la pensée n'a pas été aussi éloignée de celle de Heidegger que l'on a bien voulu l'établir pour l'Académie et l'Eternité. Le plus curieux, lorsqu'on examine le destin de Sartre, c'est que le philosophe parisien réussit là où Heidegger échoue lamentablement. En obscur et courageux ouvrier de l'ontologie fondamentale, Sartre n'a sans doute pas accepté tout l'enjeu de la question de l'Être tel que Heidegger a su le mettre en scène. Il ne l'a pas fait pour des raisons, je dirai, françaises. Pour ce demi-Alsacien expatrié dans le pays de cocagne de la culture mondiale, la France était, ne l'oublions pas, une réalité, la seule réalité morale incarnée dans une République. Sartre a été une sorte de chantre du fixisme sentimental et ontologique, au sens où l'Être lui parvenait à travers cette plaine tant méprisée par Heidegger, à travers la France de la glèbe et du pavé parisien, à travers ce que les " cloportes " de la plaine avaient su faire de mieux, à travers l'arbre planté au plus profond de l'immobilité ontologique. Il était certes terrifié par cette immobilité, au point d'y puiser angoisse et sens de l'absurde à la Camus, mais cette fixité du monde français lui paraissait être le milieu le plus propice à la méditation de la question de l'Être telle qu'elle résonnait depuis l'Outre-Rhin si proche de son Alsace génétique. Autre problème dont il faudrait préciser les contours, celle de la position anthropologique - ontologique de l'Alsace et des Alsaciens qui n'ont pas tous encore compris qu'Hitler n'avait pas été Zarathoustra, mais il n'y a pas de place ici pour cette discussion qui pourra se faire ailleurs.
Or Sartre eu le privilège destinal de connaître son acmé philosophique dans un pays vivant, dans une France qui non seulement n'avait comme problème réel immédiat qu'à se relever de ses ruines et pas réellement ni aussi durement que l'Allemagne à se pencher sur sa responsabilité morale face à la Shoah, mais qui se piquera très vite de fréquenter à nouveau les champs de bataille de ses colonies et se préparait donc dès les lendemains de la guerre à refaire la guerre. C'est là que se constituait, sous les yeux du philosophe encore traumatisé par ce qu'il venait de vivre dans son corps en tant que déchirement entre collaboration et résistance, l'absurde dans toute sa dimension humaine.22 Et non pas métaphysique. Il lui faudra encore quelques années de maturation, et notamment de fréquentation assidue du texte heideggerien et même de la région de Fribourg elle-même, pour entrer dans son personnage réel, celle d'intellectuel français engagé. La tartufferie générale qui suivra en France la mort du grand homme s'en prendra essentiellement à cet engagement, minable triomphe des cuistres et des politiciens de salon, et au lieu de lui reconnaître son seul grand mérite d'homme, on en a profité pour le traîner dans la boue et malheureusement avec lui, une réalité nouvelle qui venait de naître et qui portait le beau nom de Vérité Liberté.
Telle une nausée, l'Être et le Néant lui pèse. Non pas qu'il prenne conscience qu'il n'a rien compris à rien. Bien au contraire, il a trop compris, il a trop conçu, et les gens comptétents qui tentent de ridiculiser cette œuvre majeure ne sont que des cancres de la philosophie. Sartre a pénétré très profondément la question de l'Être, mais il l'a saisie avec les pinces coupantes de la conceptualité métaphysique la plus pointue de son époque. Son talent littéraire n'est pas en cause car il est aussi une très belle plume, mais il n'a pas su faire la belle synthèse hölderlinienne de la forme et du fond, de l'avant et de l'après et de leurs mouvements. Il a labouré, bêché en forçat du concept le reflexif et l'ontologie onto-théologico-philosophique du nihil negativum. Au résultat la question de l'Être elle-même lui a littéralement glissé des mains pour aller s'échouer bien plus tard dans une dialectique qui avait les meilleures intentions du monde, les vraiment bonnes, mais qui retombait en charpie dans un modèle de l'histoire du progrès des plus platement métaphysique. Mais, mais son passage par Fribourg avait fait son œuvre au plus profond de la personne Sartre, sa contemplation de l'Être, il allait s'en saisir dans les œuvres vives de son Temps. Vérité Liberté, je ne sais pas si c'est réellement Sartre qui a suggéré ce titre pour la petite revue rebelle qui tentait de placer les Français en face de leur comportement scandaleux là-bas, au loin, dans le non-su des colonies. Mais il est certain, en revanche, qu'il a non seulement supervisé tout ce qui se faisait à Paris contre la guerre coloniale au plan qu'on nomme aujourd'hui médiatique, mais qu'il a mis la main à la pâte lui-même, signant presque en tout premier le Manifeste des 121 qui appelait ouvertement à la désertion. Il a fait beaucoup plus grave, en termes judiciaires, qu'un attentat au code civil et au moral des troupes, mais là n'est pas ce qui nous intéresse. L'engagement politique de Sartre a eu le retentissement qu'il a eu et aussi l'efficacité parce que ce fut un engagement ontologique en direction du peuple. Sartre est en quelque sorte descendu du ciel de l'intellectualisme français pour parler aux cloportes, moins d'ailleurs pour leur parler que pour leur montrer la vérité. Cette monstration était en même temps réalisée comme une anamnèse cuisante pour ce même peuple de ce qu'il venait de vivre pendant l'occupation et de sa responsabilité dans le génocide des Juifs et de la liberté. Il fallait en avoir du courage civique et moral pour oser venir, si près du péché, rappeler aux Français leur douteux comportement sous le doux règne du Maréchal. Le décalage historique a fini par produire, plus de vingt ans plus tard, tous les mea culpa officiels et la conscience collective a enfin pris note de la faute commise par lâcheté. Mais sans l'engagement de Sartre et des quelques cinq cents Français qui ont sacrifié leur confort et leurs carrières présentes ou futures, jamais ce mea culpa n'aurait eu le moindre espace et la moindre chance de se faire. Les guerres coloniales n'en auraient pas pour autant connu un autre sort parce que les atouts étaient en d'autres mains, mais c'est la conscience des Français qui aurait pu laisser au Général De Gaulle l'entière responsabilité qu'il avait lui-même revendiqué dans le fermez le banc cinglant qui fut le sien : l'Etat français et son peuple ne sont en rien responsables des horreurs de la collaboration, il n'y a que quelques traîtres politiques qui ont été jugés. Circulez.
Le petit germanopratin à lunettes rondes a vécu ses dernières années tout près du cimetière Montparnasse où il allait prendre son crème au café de la Liberté, comme si cette idée le hantait par-dessus toutes les autres. Et c'est là, et seulement là, que se trouve l'engagement du philosophe Sartre, dans sa farouche détermination à traquer partout les atteintes à la liberté et donc à la vérité, ou bien à la vérité et donc à la liberté. Les Arlequins de la culture parisienne qui se sont permis d'en juger autrement n'ont jamais eu le moindre sens ni de l'une ni de l'autre. Ils ont fait passer Sartre pour un Propagandaführer du marxisme en faisant peser la balance de leur justice toute entière sur l'échec de son travail systématique. Or on peut dire du neveu d' Albert Schweitzer et du seul intellectuel français qui a refusé le Prix Nobel par souci de vérité23 et de liberté, qu'il fut le grand Français du vingtième siècle, tant par l'effort de sa pensée que par l'audace de son courage civique. S'il reste une chance à la République Européenne de voir le jour, nous en devrons une grande part à Jean-Paul Sartre.
Notes
1 - L'influence de Jean Paul Sartre, grand lecteur de Heidegger, dans les milieux qui militaient
contre la guerre coloniale, n'est sans doute pas pour rien dans le choix de ce titre. Il indique le
tour que Sartre veut donner à l'ontologie fondamentale et que dans un certain sens nous reprenons à
notre compte, celle de l'humanisme de la responsabilité historique.
2 - Je ne résiste pas au plaisir de citer ici quelques lignes de l'un des plus importants de
ces pragmatistes, l'Américain Charles Sanders Peirce. Dans ces textes fondamentaux de Sémiotique,
Ed. Méridiens Klincksieck, 1987 page 98, il écrit -" Nous arrivons maintenant à la considération du
derniers des quatre principes dont nous devions déterminer les conséquences, à savoir que
l'absolument inconnaissable est absolument inconcevable. Il y a longtemps que la plupart des gens
compétents doivent être convaincus que, selon les principes cartésiens, les réalités mêmes des choses
ne peuvent jamais et aucunement être connues. " On pourrait nommer cette tautologie la clôture
du concept et, en ce cas, applaudir des deux mains au propos de Peirce, mais il n'est nulle part
ici question de la vérité. Encore moins, et tragiquement, de la liberté, sauf peut-être celle des
"gens compétents " ?
3 - Dans Nietzsche II Gallimard, 1971, page 398, c'est à dire dans la conclusion de la conclusion à sa méditation sur Nietzsche.
4 - De mauvaises langues comme Céline prétendent que Sartre ne fut qu'un résistant hypocrite et en réalité un collaborateur mou. Je pense plutôt le contraire. Il se peut que Sartre ai " cohabité " hypocritement avec les Allemands parce que sa gloire était venue un peu trop tôt dans son destin et que, malgré tout, il y avait parmi les officiers allemands stationnés à Paris, de grands calibres comme Ernst Jünger qu' aucun intellectuel français proche de la pensée allemande comme Sartre, n'aurait songé à ostraciser. Sartre était Alsacien de cœur, et en tant que tel, partageait avec les Alsaciens l'ambivalence culturelle fatale en ces heures sombres. Il est également certain qu'il a résisté, même si ce fut un peu mollement, mais je dénie à quiconque n'ayant jamais résisté, le droit de juger un homme qui l'a fait un tant soit peu.
Mardi 23 décembre 2003
Le pacte ontologique.
L'Être est. Das Sein west. En Allemand il y a une évidence qui manque cruellement dans la langue française. Dans la proposition l'Être est, le Français affiche une sorte de tautologie qui ne " dit " rien d'immédiatement intelligible. En Allemand cette même proposition donne au sujet Être une force transitive qu'on ne peut pas imaginer dans notre langue. Pour un germanophone comme moi, c'est à dire imprégné de surcroît par l'ancien Allemand présent dans mon dialecte alémanique, le verbe Wesen est un verbe actif. Il me dit : l'Être (me) traverse. Ou encore l'Être (m') anime. Une analyse très classique de l'animisme permet d'ailleurs de bien adapter le concept à nos paquets phatiques, à notre affect et à notre imaginaire, comme on dit aujourd'hui. On peut figurer l'Être comme une sorte de hantise, au sens d'une présence intérieure homogène et répartie de façon homogène. L'autre image, celle de l'Être en doigt de gant, allusion lacanienne, est en réalité erronée car elle repose sur l'Être comme aspect, comme eidos et donc comme idea. Cela n'est pas si difficile à comprendre sans refaire une exégèse interminable de Heidegger : les objets possèdent tous, et nous figurons dans la liste des objets, une réalité externe et une réalité interne. Mais ce double caractère de l'objet ne recouvre nullement la dichotomie forme et fond sinon en un sens qu'il convient de préciser. La " réalité " interne des objets doit s'imaginer pour ainsi dire dans leur densité et non pas dans l'agrégation interne de nouveaux objets non immédiatement perçus comme le sont par exemple nos organes internes. Là, dans cet intérieur, l'Être est dans la compacité de sa notion, au même titre qu'il figure dans la forme que donne la vision ou les autres perceptions. Autrement dit, l'Être n'affecte pas seulement le dehors des choses, le dehors du monde, mais il transit choses et monde comme une fièvre transit le corps. Mais cette image, pour efficace qu'elle soit, est également fausse, car on peut encore y distinguer une différence résiduelle dont l'origine réside dans le concept. Un concept se saisit des objets, et se faisant, il invente une surface d'emprise qui sépare. Goethe disait que le tragique résidait dans la séparation. Il pensait à la séparation des êtres humains, une femme et ses enfants par exemple, mais cette idée est centrale, car la séparation, même vue sous cet angle paraît de même essence que la séparation ontologique fomentée par le concept. Mère et enfant sont deux faces du réel comme semblent l'être l'objet et son double formel. A ce titre la phénoménologie de la parturition telle que l'analyse Peter Sloterdijk prend une consistance intéressante, la naissance est dédoublement du réel, mais un faux dédoublement vécu comme vrai. C'est une séparation radicale, c'est le tragique absolu et donc susceptible d'intégrer le questionnement ontologique lui-même. L'erreur de parallaxe qui peut se glisser alors dans ce schéma, et le dégrader ultérieurement en mauvaise psychologie, est de ne pas s'apercevoir que la parturition n'est pas dédoublement mais redoublement. La séparation du nouveau-né de sa mère ne l'en sépare pas du tout du point de vue ontologique, mais seulement du point de vue ontique - objectif, c'est à dire dans le domaine de la conceptualité de l'Être.
Entre nous et l'Être il n'y a donc rien. Tout en nous et hors de nous est Être, car tout en nous et hors de nous est, west. La conscience de cette situation n'est pas donnée immédiatement, elle passe par la prédication qui s'inscrit dans l'Être comme sa partition ou son individuation. Lorsque je dis que ce chiffon est rose, j'extrais de l'Être du chiffon une particularité qui est sa couleur, mais ce chiffon n'est nullement rose en tant que tel, car cela impliquerait que le rose est son essence, c'est à dire ce qui caractérise précisément son Être. Au fond on dirait alors que le chiffon est être-rose. Or cela est évidemment impossible, non seulement parce qu'il existe des chiffons d'une autre couleur, mais parce que le chiffon n'est lui-même qu'une sorte d'inscription ou de nuance dans l'Être en tant que tel, exactement comme le rose n'est qu'une nuance et une inscription dans le chiffon. De la même manière nous, les hommes, ne sommes qu'une nuance et une inscription dans l'Être, et rien de plus. C'est ainsi que l'on peut comprendre le démocratisme poétique et ontologique de Hölderlin lorsqu'il dénie à la puissance de la nature quoi que ce soit de monarchique. Rien dans la physis, rien dans le monde, ne transcende autre chose du point de vue de l'Être. C'est pourquoi il n'est possible de concilier transcendance et Être que par l'opération de la substantivation de cet Être. Cette manipulation a pour objet premier de créer une étance d'un genre spécial, c'est à dire une présence en tant que telle, présence de toutes les présences, une essence en tant que telle c'est à dire une essence de toutes les essences et un Être en tant qu'être de tous les étants. C'est assez subtil dans son concept, car il ne dépare que de manière presque insignifiante du schéma que nous avons tracé plus haut. Il ne s'en sépare radicalement que par la séparation elle-même de cet Être substantif de l'Être lui-même qui devient, mais nous l'avons déjà signalé plus haut, un simple dégradé de l'Être transcendant. La différence entre l'idéalisme absolu (et aussi le panthéisme) avec les rationalismes et l'idéalisme allemand provient précisément de la nuance dont il faut ici choisir la couleur. Si on dégrade l'Être sans solution de continuité, on est rationaliste cartésien ou Kantien, chaque étant se révèle comme plus ou moins étant selon son degré de conception (pour Descartes) ou d'appréhension (pour Kant, comme nous l'avons vu dans sa troisième critique) de l'Être. Tout le reste est irréel, n'existe pas. Si on sépare violemment l'Être de l'étant, on est soit idéaliste au sens de Berkley car cette séparation va jusqu'à la négation totale d'un étant autre que Dieu, de même que le monde de Spinoza. Ce dernier pourtant, ne connaît pas la séparation parce qu'il n'y a pas à proprement parler de relation entre les étants et l'Être, pas de participation plus ou moins grande comme chez Berkley, mais il n'y a que destin de l'Être à l'intérieur duquel tout étant a sa place et son destin dérivé mais cohérent avec celui du tout.
Alors comment parler de Pacte ontologique ? Difficile, voire impossible. La pensée de Spinoza ne souffre aucune contradiction, et s'il existe quelque chose comme un pacte ontologique dans son système, il s'agirait exclusivement de l'engagement moral, c'est à dire de l'exercice moral qui conduit à la cohérence avec Dieu ou avec le tout, encore que, même cette cohérence, si j'ai bien compris Spinoza, demeure contingente. Le mal a aussi une place dans la forteresse de l'Être, et en tant que tel doit trouver son assomption à l'intérieur du calcul divin. C'est à cette endroit précis que la position de Nietzsche se sépare radicalement de celle de Spinoza. Le Surhomme n'est ni le sage qui parvient à s'inscrire dans les voies divines, ni le héros qui parvient, lui, à s'emparer de l'Être lui-même, ce qui caractérise le héros de la métaphysique et/ou de la science moderne. Nietzche campe son héros dans le jeu absolu de la volonté qui par essence est condamnée à l'errance par rapport à la question de l'Être. La transvaluation s'en prend essentiellement à l'idée qu'il existe une recette morale pour régler cette question, en fait, qu'il existe une voie métaphysique pour y parvenir. Nietzche admet pleinement la déréliction absolue de l'être humain, dont il fait même un privilège, et dans cette déréliction il doit principalement s'assumer en tant que ce en quoi il participe de l'Être. Cela ne signifie nullement qu'il doive s'en remettre aveuglément à ses instincts ou à ses appétits, voire ses passions, même si ces dimensions de la volonté de puissance doivent participer d'une manière ou d'une autre à l'assomption de la position humaine. Nietzsche a en quelques sorte dénudé moralement la question de l'Être. Déjà avant Heidegger il a exposé sans fard la position fatale de la conscience confrontée à l'évidence de la puissance comme essence de l'Être et nécessairement engagée dans une volonté de s'identifier avec cette puissance. C'est peut-être là que l'auteur du Zarathoustra rejoint en un certain sens la modernité, dans l'ubris d'appropriation de la puissance, mais en un certain sens seulement. Car Nietzsche ne tombe pas vraiment dans ce piège, il s'en tient à la portion de puissance qui échoie de toute manière à l'homme comme appartenant à l'Être. Son désir est clair : -" Être vrais - bien peu le peuvent ! Et qui le peut, encore ne le veut. Mais moins que personne le peuvent les gens de bien ? " -(1). Vérité Liberté. L'auto - affirmation n'est pas ici instinct de domination, elle est assomption de soi dans le mouvement aléatoire du monde, mais aussi dans la fatalité de l'éternel retour du même. Les " gens de bien " ont inventé un monde fallacieux du bien et de la sécurité, pire un monde qui veut changer, qui veut s'améliorer, or -" Tout se brise, tout se remet en place ; éternellement se rebâtit la même maison de l'être. Tout se sépare tout à nouveau se salue ; éternellement fidèle reste à lui-même l'anneau de l'être….- à jamais je reviendrai pour cette même et identique vie, dans le plus grand et le plus petit d'elle-même, pour à nouveau de toutes choses enseigner le retour éternel - du grand midi de la Terre et de l'homme pour à nouveau dire le dit, pour faire aux hommes de nouveau l'annonce du surhomme " -(2).
Le surhomme est l'homme du vrai dans le tourbillon de l'être, celui qui ne détourne pas les yeux de ce qui se brise ou de ce qui brise. Il est aussi, et nous sommes ici à cent lieux des Envois de l'Être heideggerien, l'éternel retour de la volonté du vrai, de la volonté d'exprimer la puissance de l'Être. Comment ? En artiste, évidemment, en tant que ceux qui ont fait de leur existence la volonté du dire du dit par les mots et les sons : -" Comme est plaisant qu'il y ait des mots et des sons ! Ne sont-ils, mots et sons, des arcs-en-ciel et, entre des êtres à jamais séparés, des ponts en trompe-l'œil ? A chacune des âmes appartient un autre monde ; pour chacune des âmes arrière-monde est toute âme autre " -(3) Plaisant ! Destiné au pur plaisir, à la vanité d'un " trompe-l'œil ". Le langage n'est nullement chargé de la lourde tâche d'unir les étants humains et des conduire quelque part, ni de les aider à percer le mystère de l'Être et de son éternel retour qui se moque bien du bavardage des étants. Le langage est don de l'Être pour saluer sa présence et le mouvement de son éternel retour, célébrer chaque instant où " l'être commence " c'est à dire rien moins que le présent éternel que les mots découpent en instants. Si pacte il y a ici, c'est celui-là, le dire de l'Être dans sa parousie éternelle par les mots et les sons " qu'il y a ", c'est à dire aussi un don ou un caractère de l'Être lui-même. Par les mots et les sons, l'Être se joue en Un et en multiple.-" Comme plaisants sont tout discours et tout sonore mensonge ! Sur de multicolores arcs-en ciel avec des sons danse notre amour.(4) ". De son côté, l'onto-théologie s'est servi des mots et des sons pour séparer l'Un du multiple et condamner les étants à l'enfer de l'individuation : l'état totalitaire qui règne entre ceux qui apparaissent comme les plus semblables parce que " ..la plus petite faille est celle qui le plus pesamment se franchit27 ". Autrement dit, la métaphysique des gens de bien, l'état totalitaire des étants condense les étants, les rend semblables et leur donne l'aspect de la généralité, et c'est dans cet état que se creuse l'abîme le plus profond entre les étants. La singularité comme trait fondamental de l'être est bafoué et cette insulte rend de plus en plus infranchissable le fossé naturel de l'individuation. Nietzsche avait déjà en vue la société moderne et ce qu'on désigne aujourd'hui comme son atomisation. Il avait pressenti non pas une atomisation qui ne serait qu'un simple éclatement, une parcellarisation qui ne serait en rien différente de l'individuation ontologique de l'Être, mais une atomisation nucléaire radioactive : c'est d'une société malade d'elle-même qu'il est question ici, celle de la plaine, celle des hommes qui ont fui les sommets pour se réunir en troupeaux et se protéger du risque, se protéger de la vérité.
Car le seul pacte ontologique concevable est celui du respect de l'égalité ontologique des étants, la reconnaissance de leur appartenance à l'Être et donc de cette seule et unique valeur qui les unit essentiellement, et aussi les désunit dans le jeu de leurs singularités. De cette manière seulement Heidegger peut dire que Nietzsche change en valeur les déterminations de l'étant. L'étant est valeur par soi en tant que présence de l'Être, mais il n'est pas valeur en soi en tant qu'étant dont l'homme, ou même le surhomme seraient valeurs suprême parce qu'ils seraient les voulant de la volonté de puissance. Mais qu'est donc ce respect de l'égalité ontologique des étants ? Elle est le respect de la vérité dans leur présence. Le logos danse avec les mots et les sons sur la vérité de la présence multiple et mouvante. Le théo-logos couvre cette présence de son voile pour le restituer dans sa réalité mensongère, exactement comme un organe de propagande restitue un fait selon la logique et les intérêts du pouvoir dont il dépend. Il truque la photographie du présent pour représenter un présent-absent, une absence qui va devenir son alibi en tant que devenir outre-réel de la vie. Or, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le respect de l'égalité ontologique des étants sinon de la vérité de leur chronique, la beauté de la danse des mots et des sons qui les unit dans les arcs-en-ciel de l'art ? On désigne ainsi l'Histoire, l'hymne de l'Être dans son mouvement chatoyant et éternel, vérité ultime et aussi résultat en tant que bonheur suprême de l'ek-sistant au sens de l'Être individué qui tient sa place dans la Chronique de l'Être.
Alors se pose la question : comment quelque chose comme le mensonge pourrait-il prendre le dessus ? Comment l'Histoire pourrait-elle, aurait-elle pu dégénérer ? Devenir de l'Être autre chose que son hymne ? Hic rhodus hic salta : je pense que l'histoire, avec ou sans H, n'a en réalité jamais dérogé à sa finalité originelle. Ce que j'ai nommé mensonge, d'autres l'auront caractérisé comme l'Oubli de l'Être. Idée énigmatique, car elle entend le complément de nom dans son double génitif subjectif et objectif, comme nous l'avons déjà plusieurs fois précisé. Nous, les hommes, avons oublié l'Être, mais l'Être lui aussi nous a oublié, ou plutôt se serait retiré de l'affaire. Or, ce n'est pas notre affaire que de trancher entre ce qui passe pour un simple déclin fomenté par la tendance au mensonge des sociétés et ce qui passe à la fois pour une négligence de l'homme et un mépris de l'Être lui-même pour sa propre question en nous. Au surplus, notre relation à l'Être n'est nullement contingente, elle ne peut pas l'être en aucune façon, excepté dans son acception métaphysique et théologique. A propos de l'Être comme Dieu, comme transcendance, il faut noter l'existence (fantasmatique mais fondatrice dans sa signification) de ce que j'ai appelé pacte. D'ailleurs il ne peut exister de pacte qu'entre deux personnes, deux entités différentes, deux forces opposées qui concluent un accord en vertu de certaines fins. Or, je le répète, de l'Être j'en suis, et je me vois mal conclure un pacte de cette envergure avec moi-même. Oh certes, je puis entamer un dialogue à l'intérieur de ma conscience et par un tel dialogue établir une espèce de pacte moral entre des éléments internes de ma conscience, constitutives de ma conscience. Je peux opposer mes passions et ma volonté et agir en vertu de conventions que je me suis moi-même fixées, mais en aucun cas je ne peux entamer de telles négociations avec ma propre étance. Je suis, et en tant que tel, je ne peux rien remettre en cause de mon étance sinon en mettant fin à la conscience que j'ai de cette étance, de ma profonde identité avec tout ce qui semble ne pas être moi.
Toute personne est le produit d'un ou de plusieurs pactes qui marquent son évolution. Le pacte, comme le montre bien Freud, n'est pas contingent, il est nécessaire car lui seul permet au sujet d'assumer l'altérité et plus largement son existence sociale. L'ontogenèse comporte des étapes par les quelles la sociation du sujet se réalise plus ou moins bien selon un certain degré d'adaptation aux valeurs dominantes de la société avec laquelle il confronte sa singularité. Mais la phylogenèse n'est en rien différente quant à cette nécessité pour les générations de négocier dès leur arrivée dans l'existence sociale le pacte d'allégeance aux valeurs dominantes. Il s'agit d'ailleurs toujours d'une renégociation de ces valeurs et l'histoire montre que cela ne se passe que rarement de manière mécanique et pacifique. La violence n'est jamais autre chose que l'effet d'un échec de cette négociation intérieure au sujet ou de ces renégociations historiques. Le destin n'est lié qu'indirectement à ces actions personnelles ou sociales car il opère une péréquation du juste et de l'injuste " dans l'ordre du temps " comme le dit Anaximandre. Œdipe est un individu que les actions du passé, le sien et celui des autres, emprisonne dans une injustice objective dont il n'est pas responsable. C'est pourquoi son personnage est une représentation parfaite du destin. Mais Œdipe n'est pas que cela, nous allons le voir dans le chapitre suivant.
Notes.
1 - F.Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, traduction Maurice de Gandillac, NRF Gallimard 1971, page 221
2 - ibid. page 242
3 - ibid. page 239
4 - ibid.
Vendredi 26 décembre 2003
Ontologie et démocratie.
Sans y prendre garde, nous avons fait retour à ce lien qui unit Histoire et Être dans une opposition irréductible. Le siècle d'Oedipe est aussi celui de ce que nous avons nommé un peu cavalièrement la consigne de l'Être, en fait, sa mise " à la consigne ". Hérodote est l'ami de Sophocle qui naît à l'acmé de Parménide et partage sa pouponnière avec Périclès. Tout cela est historiquement très dense et très lourd. Encore plus lourd si on ajoute le nom de Clisthène, le fondateur de la démocratie athénienne, l'homme par qui le scandale est arrivé et qui le paye d'ailleurs par une étrange absence tant dans le domaine historiographique que dans celui des arts.(1) Aujourd'hui encore, à l'école, on mentionne bien Périclès et Démosthène, mais on ne parle pas de Clisthène ni de son œuvre politique, on pourrait y distinguer les principes de la démocratie de bien trop près. On pourrait insolemment comparer cette ingratitude à l'ergonocide du travail de Parménide, c'est à dire à cette quasi éradication de son œuvre par la Tradition, phénomène qui a frappé l'ensemble des présocratiques, et pour cause. La contemporanéité n'est pas un principe logique et rien ne nous permet de fabriquer une sorte d'Epokè athénienne, une histoire corrélative de la pensée et du politique qui formerait un germe rationnel pour le destin de l'Occident. Et aussi n'avons nous pas cette intention. Mais, si la simultanéité de l'existence de tous ces personnages historiques ne font pas forcément histoire, il y a un domaine où elle fait principe, c'est précisément la Démocratie. Car il s'agit bien d'une équipe politique, d'un parti pourvu d'une idéologie et qui a exercé le pouvoir dont il avait lui-même fixé les règles. Et c'est sur ces règles qu'il va falloir se pencher sérieusement pour entrevoir la relation logique entre l'ontologie parménidienne et la Démocratie.
En bref on pourrait dire simplement ceci : l'Histoire a montré que la démocratie ne joue pas forcément dans le camp de l'aléthéia, mais il se trouve que ceux qui l'ont fondée semblent l'avoir fait, et que par conséquent Parménide joue un rôle central dans cette fondation, qu'on le veuille ou pas. De quelle manière l'on-t-ils fait ? C'est là un secret bien gardé, aussi bien gardé que tout ce qui entoure la fondation de la démocratie, et bien gardé pour la même cause, à savoir la peur de sa Vérité. Cette vérité peut se formuler le plus simplement du monde : l'Être est la seule chose commune, c'est la seule Res Publica, c'est le seul et unique lien entre les singularités humaines. Pourquoi un lien ? Parce que l'alethéia est indiscutable, la présence du jour et de la nuit, de l'air, de la terre et des océans, la présence des êtres vivants et des choses, tout cela ne fait aucun doute. Si peu de doute qu'on peut en tirer une conclusion et une seule : il existe une présence de la présence, il existe une essence universelle du fait de la permanence de ce qui devient, de ce fait même, un monde, et cette essence c'est l'Être. C'est le tissu du monde lui-même qui se présente dans une égalité absolue à partir de laquelle tout comportement monarchique devient proprement sacrilège. A partir de cette découverte, qui transcende, en ouvrant leurs possibilités, toutes les découvertes scientifiques, il devient nécessaire de produire une nouvelle dimension de la praxis collective, celle de la représentation. De la comédie. La démocratie est la seule scène politique qui permette un dédoublement fictif, c'est à dire la possibilité pour les communautés de jouer le politique de manière aléatoire. Aléatoire signifie ici une seule chose : plus ou moins éloigné de son origine principielle. Seule la démocratie peut se tromper, entamer et exécuter des choix négatifs, valoriser l'erreur sans pour autant porter atteinte à l'essentiel. Platon, le mercenaire de l'anti-démocratisme, avait tout compris.
Et ce tout n'est pas rien. La démocratie, en fait, est le secret de la vie en commun et elle relègue définitivement dans l'ontologiquement inacceptable toutes les autres formes politiques. Il faudra quand même par la suite quelques dix-huit siècles de dur labeur onto-théologique pour maintenir sous le boisseau toute discussion sur les différentes formes politiques. Et encore, on ne tolérera les Grotius et les Hobbes seulement parce que la révolution est partout et permanente dans une réalité qui a, semble-t-il alors, involué radicalement vers le monarchisme. L'instinct de rébellion naît exactement là, avec la découverte d'une forme possible de l'être-ensemble dans la position sédentaire et la constatation que les forces de voilement de cette vérité non seulement ne désarment pas, mais redoublent de violence physique et métaphysique. Platon sait qu'il ne peut pas se contenter de démontrer les vices apparents de la démocratie, ce qui est facile en regard de la plasticité essentielle de cette forme, mais qu'il lui faut encore démolir le fondement absolu de cette forme, l'Aléthéia. Or, pour ce faire, il devra se servir du sentiment religieux pour inventer l'outre-monde des idées, la réalité cachée des choses, le ciel des idées. Il faut imaginer la force de l'éblouissement grec dans sa dimension phylogénétique : l'instant clisthénien est la ligne de partage, la rupture avec le désespoir de l'impasse sédentaire, car l'immobile est impossible, le nomade est la Loi de la Physis, celle de l'Être. La démocratie est l'introduction de la dimension nomade dans le politique, temps et espace sont quadrillés de telle sorte qu'aucun repos, qu'aucune immobilité ontologique n'est possible : il faut errer, mais on peut errer dans tous les sens, exactement comme le chasseur - cueilleur de la préhistoire. Ici s'impose un peu de théorie, celle de la démocratie qui, au demeurant, restait encore à faire. Voici.
L'idéologie qui domine aujourd'hui encore le débat philosophique et politique pose le problème en ces termes : qui de la démocratie ou des autres formes de souveraineté ont les meilleures chances d'atteindre la vérité de l'histoire. Cette vérité de l'histoire peut à son tour être interprétée de multiples manières : progrès, stabilité, conservation, réaction etc .. Dans tous les cas de figure la forme politique en soi est considérée comme une recette de cuisine métaphysique, et non pas simplement comme ce qui rend possible et seulement possible le fait de vivre ensemble, de faire société. Les formes productrices de bonnes valeurs sont les bonnes formes, il suffit alors de définir les valeurs et on peut tout faire. On a tout faux, merci Platon, merci aussi Aristote qui, pourtant avait une vision plus pragmatique de la Cité et qui lui, n'a tout simplement pas compris le fonctionnement de la démocratie ni son sens premier. Alors quel est le sens premier de la démocratie ? Il n'est pas la recherche du Bien, notion qui fausse tout dès l'entame dans la longue élucubration de la République, car, nous l'avons dit et répété, il n'y a pas de Bien, il n'y a pas de valeurs que l'on pourrait privilégier car tout est dans l'Être. Ce qu'il faut donc découvrir c'est le moyen de mettre en scène politiquement le plus grand nombre possible de martingales, de faire circuler le pouvoir de telle manière qu'il puisse passer partout, qu'il puisse précisément représenter le tout dans son essence. C'est le génie même de la forme démocratique : le pouvoir se répartit et circule dans l'espace et dans le temps de telle manière qu'il ne peut pas s'arrêter sur une forme déterminée, qu'il ne peut pas fonder d'empire, figer l'histoire dans une figure forcément erronée de l'Être. Parce que l'homme ne peut pas revendiquer, même sur la nature, le pouvoir totalitaire que forcément il est contraint de s'arroger en refusant la démocratie. La saga de la subjectité, si bien décrite par Heidegger, n'est rien d'autre que la fatalité qui s'attache au déni de la démocratie, qu'on peut aussi nommer autrement Justice, et pourquoi pas, le Bien. Dans sa traduction du fragment d'Anaximandre, Heidegger était tout près de faire cette découverte, mais son propre destin ne pouvait lui ouvrir l'accès à la véritable traduction du mot rythme. La démocratie est le rythme fondamental de l'être-ensemble de l'homme, et somme toute, la traduction classique du fragment en question n'est pas si fausse que cela, à condition de concevoir clairement le sens du mot dikè, de la justice qui rattrape toujours toute corruption du rythme. Car cette justice est ontologique, elle se situe dans l'Être non pas comme l'une de ses qualités mais comme son essence.
Voilà aussi élucidée toute la question de la mimésis et de sa fonction dans la Cité : le mimème est l'unité pensable du jeu politique. Ce jeu politique ne peut pas être autre chose que représentation, fiction d'une politique qui nous échappe radicalement et dont nous ne sommes, nous les hommes, qu'une parcelle. A chaque nouvelle impulsion du Démos, c'est à dire à chacun de ses renouvellements dans la représentation, s'ouvre un jeu périodique mis en scène par les nouveaux archontes, par les nouveaux représentants choisis par le peuple. Au cinquième siècle grec, cette représentation se trouve coïncider avec la représentation lyrique, la démocratie se joue à elle-même sa naissance et son triomphe. Antigone clôt le " Ring " d'Œdipe. Mais on ne rêve pas, surtout pas dans la tragédie, nulle part ce triomphe ne fait salut, nulle part ne se met en scène une quelconque eschatologie, bien au contraire. Les obscures recherches de Hölderlin sur la mécanique poétique s'éclairent ainsi aussi en regard de son intuition ontologique de la " prolétarité ", passez moi le mot, de l'Être. Le poète sait que seuls comptent le rythme et la césure, le jeu des lois et… des élections. Certains voudraient cependant forcer la représentation en-deçà de son véritable statut, c'est à dire impliquer l'ontologie parménidienne elle-même dans la représentation lyrique et en faire une simple martingale parmi les autres. Mais il ne s'agit là que d'un platonisme tardif qui répète la définition de l'homme comme marionnette de l'Être Suprême et ne veut pas admettre la responsabilité totale et entière qui lie chaque individu à son destin, à savoir la liberté. Car si tout est représentation, la représentation n'a plus de sens, elle n'est plus que fonctionnement aveugle du destin, ce en direction de quoi on peut certes aussi forcer l'interprétation du cycle oedipien, mais il s'agit bien alors d'une violence transcendante et qui vise exclusivement l'animal politique humain. Or la position de l'homme est beaucoup plus modeste que tout cela, personne dans l'univers ne s'intéresse particulièrement à lui et ses mouvements, il est seul, seul, seul. Comme Œdipe il rencontre le destin dans un étant bien concret, une existence sans mystères dont il lui faut assumer le cours : il naît dans une conjoncture qui le trahit originairement. Le moment de sa liberté n'est plus que celui de l'honneur : Oedipe pourrait transiger car il n'est pas coupable, mais la situation de sa personne dans le jeu social est telle, il est Roi, qu'il doit plus à ce qu'il représente qu'à lui-même. Par conséquent il ne lui reste plus qu'à se retirer du jeu et assumer la fatalité qui l'accable. La justice humaine n'est rien d'autre qu'assomption de la présence du présent dans la représentation.
La démocratie est bien le centre de la tourmente métaphysique car c'est bien elle qui se permet la première l'opération qui consiste à enter la représentation sur la réalité afin de la sauver, de la relever. Le cycle de l'Aufhebung, son rythme, est celui du pouvoir qui change de mains et ne deviendra l'Etat qu'au lendemain de l'échec apparent de la Révolution française. Pas plus qu'Aristote, Hegel ne saisit l'essence de la démocratie et son rôle pivot dans le destin occidental, au point qu'il doit, parce qu'il le peut et qu'il y est invité par les puissances dont il dépend (2), opter finalement pour un girardisme avant la lettre où le Christ vient dissoudre la Justice réelle de l'Être, celle dont parle l'Ancien Testament, la " relever " de sa dureté pour l'homme et lui permettre de négocier directement sa mort avec l'au-delà. Et pourtant, il y a dans la structure de la démocratie une eschatologie radicale et réelle : les représentants assument leurs responsabilités le temps de leur mandat dont un seul élément leur donne quitus, le temps. Mais Œdipe ne peut pas bénéficier de cette opportunité parce qu'il représente encore les anciennes valeurs. Il leur appartient parce qu'il en a accepté les règles et sa grandeur réside en ceci qu'il pourrait s'en remettre à la démocratie et à son jugement fictif, mais il refuse parce que le monarchique ne peut pas, ontologiquement, lui accorder le pardon. La démocratie finira quand-même par le sauver, mais ce ne sera que pour qu'il précipite la fin de l'ancien monde auquel appartient Antigone, celle qui introduit la démocratie dans Thèbes et pour cela doit en mourir. La mort d'Œdipe appartient au même programme ontologique. Il figure le " retrait " définitif des anciens dieux.
Selon Schelling il faudrait dire ici " de l'Ancien monothéisme relatif ou unilatéral ". L'un des textes cardinaux du philosophe des " vaches noires "(3) est certainement son Introduction à la Philosophie de la Mythologie (4). En fait d'Introduction, Schelling plonge son lecteur dans un maëlstrom théologique, anthropologique, linguistique et même ethnographique qui ne se veut rien moins qu'une véritable Histoire de l'Humanité et de ses relations avec Dieu. En résumé, Schelling ne croit pas, comme ses contemporains Creuzer ou Voss, à une linéarité du développement du sentiment religieux. En véritable dialecticien, il pose la certitude sensible, c'est à dire l'état de nature, comme origine et comme fin de l'Histoire. Autrement dit, non seulement l'homme de la préhistoire n'est pas un animal athée ni un animiste idolâtre mais sa " conscience est comme l'être ", il entretient avec l'Un, c'est à dire avec le vrai Dieu, une relation directe et totale. Seulement, ce Dieu n'est pas encore le vrai Dieu parce qu'il est " trop vrai ", il n'est pas passé par la représentation, c'est à dire la Révélation. La Mythologie, le véritable sujet d'étude de Schelling, n'est donc pas non plus ni un état de régression de la conscience religieuse, ni un moment du développement de ce sentiment vers le monothéisme. Il est le moment du négatif, celui qui permet et impulse le passage du Dieu relatif ou unilatéral au Dieu Vrai de la Révélation, à la négation du négatif. Entre les deux divinités se joue, évidemment, le sort de la liberté humaine : la Révélation est présentation / représentation de Dieu qui ouvre la possibilité de la liberté de l'accepter ou de le refuser. Remarquable coïncidence, l'époque historique du polythéisme coïncide avec l'épopée grecque et Schelling est amené à poser le problème religieux exactement comme nous posons celui du politique. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse au premier chef, car nous trouvons bien plus passionnant de découvrir un penseur de l'occident qui ne prenne pas les premiers hommes pour des sauvages. Cela n'empêche nullement Schelling de s'empêtrer dans de hâtifs jugements de valeurs sur les sauvages " dégénérés " des sylves brésiliennes, pire encore de planter le décor d'un Âge d'Or où Dieu tient les hommes dans ses bras et sous son absolue protection. Mais en aucun cas l'homme de la préhistoire n'est un crétin sans cervelle : en son temps " la conscience est comme l'Être ". En fait ce " comme " identifie la conscience et/à l'Être, ils sont une même chose, ils sont un âge de l'Esprit où ne règne encore aucune différence, d'où la petite mignardise de l'Âge d'Or qu'on peut bien s'offrir au passage car ça peut toujours servir pour l'avenir… Avec la Révélation nous abordons enfin la vraie terre du déchirement dialectique, de la saisie en pleine figure de la figure de la mort, seule état de conscience garant de la pureté d'intention de l'enfant de Dieu.
De nos jours il existe bien quelques anthropologues qui se posent des questions sur les étranges ressemblances entre le goût esthétique des hommes de la préhistoire et le nôtre. Encore l'art ! Certains en concluent audacieusement à un degré de conscience inattendu en ces millénaires obscurs. Pour autant continue de régner partout l'idée qui va de soi d'une humanité semi animale dont les déterminations essentielles plafonnent dans le struggle for life et les relations avec les dieux du chaud et du froid. La prudence reste de mise, même si le primitivisme a définitivement perdu tout son sens péjoratif depuis au moins Levi-Strauss, sinon évidemment pas avec Monseigneur Las Casas. Je m'autorise d'un certain persiflage, comme Schelling d'ailleurs par rapport aux " cuistres " de son temps, parce qu'il ne me déplaît pas de donner un fond phatique et même emphatique à l'idée que je défends avec acharnement : il n'y a aucune histoire de la conscience, l'homme est et demeure le même à travers les siècles et les millénaires. Nulle évolution culturelle, nulle maturation historiale, nul progrès spirituel, rien n'est venu s'ajouter ou se retrancher de ce qu'est l'homme. L'homme est et demeure ce qu'il a toujours été à savoir l'être à l'Être. Dans l'Être certes, des " choses " changent mais qui ne nous sont connaissables ou représentables qu'à travers le kaléïdoscope de l'imagination et des techniques du langage, c'est à dire pas du tout. Les images que nous renvoient ces domaines, comme dirait Ruyer, ne sont que des images que nous sommes libres d'interpréter et dont nous sommes libres de faire usage en un sens ou dans l'autre. Que ce soit le Cardinal de Cues, Emmanuel Kant ou encore Heidegger qui l'affirment, la vérité de l'ignorance ontologique est un fait irrécusable : l'Être effectivement et par essence se retire toujours déjà du savoir, ce qui ne signifie nullement qu'il s'absente, mais justement qu'il a séjour dans la Présence en tant que présence. Le savoir est un accident, ou une volte comme on voudra ou encore un Envoi, de la relation ontico-ontologique qu'entretient l'homme avec l'étant. Le Savoir Absolu n'est qu'une étape de l'errance et donc de l'erreur.
Que de grands mots pour dire des choses au fond très simples. Le statut fondamental des êtres vivants est l'errance. Il est curieux de constater combien cette évidence ne fait pas problème pour ce qui concerne les animaux et les végétaux dans leur ensemble et l'on s'émerveille lorsqu'on découvre une logique dans les ressorts secrets du mouvement animal comme la migration par exemple. Mais dans la conscience occidentale, l'homme n'erre que par erreur. Son essence réside dans la résidence, dans l'habiter le monde dont il est d'ailleurs le seul habitant réel, le seul locataire légitime, bref, dans l'immobilité de la civilisation des peuples, des nations et des mégapoles en béton armé. Dans l'immobilité des temples et des cathédrales, de la Bourse des valeurs et de la Raison d'Etat. On en revient pourtant et les jours de ces fables sont comptés, la dimension nomade du marché est venu réveiller les plus sceptiques, l'époque (Epokè) de l'immobile se rapproche de sa frontière, de sa clôture. Schelling en avait l'intuition à travers sa dialectique mais aussi à travers le romantisme et notamment celui de son ami Hölderlin, le poète (allemand) au semelles de vent. Mais que dire aujourd'hui après que cette culture de l'immobile nous ai mis le monde à feu et à sang au point de frôler non plus la clôture mais la destruction pure et simple ? Comment peut-on encore se voiler la face devant l'inéluctable retour du refoulé, justice immanente et ontologique, retour prévisible du balancier trop lourdement chargé, jadis, d'espérances trop naïves. Car l'immobile sédentarité n'a pas été le résultat ou la conséquence d'une Révélation ou d'une injonction transcendante, mais bien celui d'une décision prise en toute connaissance de cause et en vertu d'un placement à usure, celui de l'Histoire. Connaissance de cause : les nomades de la préhistoire n'avaient pas moins de raisons de se méfier des sédentaires que nous n'en avons de chasser les nomades hors nos murs. L'évolution historique n'a fait que renverser les positions des uns et des autres dans les mêmes logiques : nous concevons les nomades avant tout comme des voleurs, des humains certes mais qui ne vivent que de rapines et de piraterie. Nous les accusons de violer nos espaces et de vivre au dépens de nos propriétés privées. Or, du cœur même de notre civilisation nous sommes à même de donner raison à ces nomades de jadis qui pensaient exactement la même chose des hommes qui en leur temps avaient eu l'audace de se sédentariser. Car au temps où cette sédentarisation en était encore au stade expérimental, les nomades devaient bien constater que les villages qui se formaient alors exerçaient forcément une emprise économique sur leur espace tout à fait comparable à une monopolisation criminelle, à un accaparement injuste et donc à cela même dont nous accusons aujourd'hui les nomades, les gitans, les immigrés, l'étranger, le Juif.
Et en vertu d'un placement à usure, celui de l'Histoire. Oh, il ne faut pas trop s'illusionner. Au néolithique le modèle sédentaire ne s'est ni compris ni choisi comme tel par des nomades méfiants et certainement convaincus de la légitimité de leur praxis à eux. Il s'est agi sans aucun doute d'une lutte politique dont les derniers feux consument la France du cinquième siècle razziée par les Huns d'Attila, mais dont la structure agonale traverse toute notre Histoire. La Grèce, puis Rome se sont construites dans cette lutte, dans ce qui fut la véritable dialectique de l'Histoire dont la guerre du Péloponnèse reflète encore et toujours l'opposition entre la démocratie dont l'esprit est nomade, l'esprit des marins marchands, et l'oligarchie de Lacédémone, enracinée dans sa terre et dans ses castes. A ce titre, l'espace grec est un paradoxe qui fait rupture épistémologique au sens plein du terme. Athènes où souffle l'esprit d'aventure découvre la clé de la possibilité de la Cité alors que Sparte demeure une Cité impossible qui mourra de son impossibilité, disparaîtra jusqu'aux temps modernes, quasiment maudite. Elle est la chose même de la contradiction entre la liberté ontologique et l'immobilité de la propriété, de l'appropriation, l'impasse qui continue de fasciner ceux qui n'ont pas désarmé de leur haine de la démocratie ou de leur mépris, voyez Churchill. Bon à la guerre, incompétent pour gérer la paix, un vrai spartiate. Les quelques siècles qui ont fait et défait la Grèce n'en demeurent pas moins le moment de la césure, justement parce que la vie sédentaire se trouve une issue dans la démocratie. Presque en même temps qu'Athènes, Rome entame la mutation qui va la conduire à la République, non pas parce qu'elle se contente d'importer un modèle prestigieux, le prestige grec à Rome sera bien plus tardif. Rome évolue vers une forme démocratique pour deux raisons majeure. La première provient de la ressemblance des origines latines et ioniennes. Comme les Athéniens, les Romains sont à l'origine un peuple de marchands, de marins qui choisissent une position au carrefour de la Méditerranée, un site médian entre la côte occupée par les marins étrusques et les pirates commerçants de Carthage. Il y a un créneau commercial, un site inhabité tant sa terre et son climat sont pauvre et insalubre, mais la plupart des historiens de Rome, Mommsen en tête, sont formels, les latins ont choisi la région romaine pour des raisons de stratégie commerciale. Cela ne tardera pas à se confirmer : leurs ennemis déclarés tirent aussi leurs richesses de la mer et du trafic, la République triomphe et meurt du triomphe militaire sur Carthage. Car on sait aussi que les fortunes des oligarques du futur Empire se sont accumulées là, pendant les deux guerres Puniques, et que dès lors le destin de la République est scellé, elle deviendra l'Italie des compradores et des chefs de guerre.(5)
Pourtant, on peut parler d'un placement ontologique, d'un emprunt ou d'un tirage forcé sur le savoir de l'Être. Le platonisme se révèle alors comme un piège qui se retourne contre ses auteurs : la représentation originaire dont l'essence est strictement limitée à cette mimésis ludique d'une praxis ouverte de la communauté qu'est la démocratie et qui conserve à ce titre un caractère totalement aléatoire, est mise au service de la Science, de la Philosophie, de la Métaphysique et elle devient onto-logie, logos sur l'Être. Parménide avait pourtant prévenu, Être et penser sont le même, ce qui n'admet pas, ne peut pas admettre que l'Être puisse devenir l'objet de la pensée. Mais ainsi s'ouvre une époque dont le mot arraisonnement rend parfaitement compte, le Gestell est cette manipulation qui prétend mettre la représentation au service de la Vérité : la représentation se cristallise, se fige, se fossilise molécule pour molécule dans la représentation unique du Dieu unique, du jeu qui ne s'appelle pas encore Monopoly mais déjà monothéisme. Sous le masque de cette Représentation, le principe ludique de la démocratie produit alors sa plus-value ontologique : le discours sur l'Être, qui n'est pas onto-logie, science de l'Être, s'arrête en tant que tel, s'oublie dans la substantivation de son signifiant, mais produit un degré plus bas, l'arraisonnement de l'étant, la guerre-éclair du technique, l'étant se substitue à l'Être ou plutôt devient pure représentation de l'Être, pure apparence. Qu'est-ce-que l'expérience scientifique ? Elle est la transposition dans la science du jeu initialement inventé pour régir les relations entre les hommes. L'homme va user à l'égard de l'étant d'une liberté illimitée mais qui n'est originairement légitime que parce qu'elle est strictement limitée. L'étant devient la poubelle du discours ontologique, l'objet d'une pure curiosité objectale dont la représentation - le progrès scientifique - devient la dramaturgie nommée Histoire. Cette histoire est bien celle de la réification au sens le plus platement marxiste du terme, de la réification associée au spectacle devenu entre-temps la nouvelle figure lyrique de la représentation.(6) Ce piège, il se refermera lorsque l'Être substantivé cessera de garantir la représentation scientifique qui en réalité a épuisé l'objectité de Dieu en montrant les limites objectives de l'étant monde : on ne peut pas se goberger du monde comme on peut se repaître de sentiments humains au théâtre. Avec le retour de l'Être comme question, c'est la finitude même de l'Être qui se manifeste, le savoir absolu de la dépendance réciproque de l'homme et de l'Être et la reconnaissance finale d'un Savoir Absolu impossible en termes eschatologiques. C'est bien pourquoi Hegel sait qu'un tel savoir ne peut se soutenir que d'une étreinte avec la mort.
Notes
1 - Voir les commentaires de P.Lévèque et P. Vidal-Naquet dans Clisthène l'Athénien, Coll. Deucalion, Ed MACULA 1992.
2 - Je n'ai pas lu une seule biographie du Grand Homme qui ne souligne l'ubris universitaire de Hegel, mais aussi et surtout sa hantise pour ses vieux jours.
3 - Allusion au traitement que Hegel, précisément, réserve à la philosophie de son collègue du Stifft Schelling dans sa Préface à la Phénoménologie de l'Esprit.
4 - Nous utiliserons pour en parler la traduction Jankélévitch, in Ed. Aubier Montaigne, 1946
5 - Voir notamment l'analyse de Mommsen. Au lieu de réquisitionner les moyens militaires qu'exige la situation désespérée de Rome menacée par Hannibal, le Sénat décide de faire un emprunt qui deviendra vite le boulet de la République. Nihil novi sub sole.
6 - Un mot à ce sujet : il serait totalement abusif de comparer la tragédie grecque, du moins celle de la période classique avec le théâtre tel que nous l'entendons aujourd'hui. On l'a dit et répété, notamment Hölderlin, la représentation de la tragédie originaire tient davantage d'une cérémonie rituélique (où, soit dit en passant, la catharsis aristotélicienne prend tout son sens parce qu'elle est anamnèse du destin grec, psychanalyse avant la lettre) que d'un divertissement. Le spectacle au sens de Debord ne naît que comme divertissement pascalien, c'est à dire comme forclusion du discours sur l'Être.
Samedi 27 décembre 2003
Du Fondement.
" Quand nous voudrions supposer un homme Sauvage aussi habile dans l'art de penser que nous le font nos Philosophes ; quand nous en ferions, à leur exemple, un Philosophe lui-même, découvrant seul les plus sublimes vérités, se faisant, par des suites de raisonnements très abstraits, des maximes de justice et de raison tirées de l'amour de l'ordre en général ou de la volonté connue de son Créateur. En un mot, quand nous lui supposerions dans l'Esprit autant d'intelligence, et de lumière qu'il doit avoir, et qu'on lui trouve en effet de pesanteur et de stupidité, quelle utilité retireroit l'Espèce de toute cette Métaphisique, qui ne pourroit se communiquer et qui périroit avec l'individu qui l'auroit inventée ? Quel progrès pourroit faire le Genre humain épars dans les bois parmi les Animaux ? Et jusqu'à quel point pourroient se perfectionner, et s'éclairer mutuellement des hommes qui, n'ayant ni Domicile fixe ni aucun besoin l'un de l'autre, se rencontreroient, peu-être à peine deux fois en leur vie, sans se connoître, et sans se parler ? "
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, coll. Idées nrf, 1965
Aucun texte de la métaphysique n'est exempté de la redoutable question du fondement, exceptés ceux qui s'assignent to théïon comme leur alpha et oméga, c'est à dire, comme l'expose avec élégance Carlo Angelino dans son petit Essai sur Nietzsche (1), comme la mort elle-même. On peut à ce propos parler d'une sorte de boitement intellectuel entre deux positions de principe : l'une proprement onto-théologique qui ne s'embarrasse de l'histoire ontique que dans des articulations de pensée où il n'est plus possible de faire autrement, et l'autre qui s'appuie explicitement sur une évolution anthropologique proprement physique pour scander les moments de l'histoire de la pensée ou de la praxis sociale. La première ne s'aventure guère au-delà d'allusions voilées comme on pourrait en citer plusieurs exemples typiques dans l'histoire des systèmes que présente par exemple Heidegger dans son Schelling (2). Le plus limpide se trouve à la page 59 : " La possibilité des systèmes, dans la figure historiquement déterminée où nous les connaissons jusqu'ici, n'est ouverte que depuis l'instant décisif où le Dasein historial de l'homme en Occident est soumis à de nouvelles conditions, qui ont eu finalement pour effet d'ensemble de produire ce que nous nommons la modernité ". Quelques pages plus loin il sera encore question du " fond qui nous demeure encore aujourd'hui obscur ", obscurité qui conditionne la " mutation complète " qui permet la venue au jour de l'exigence de système. Instant décisif, fond obscur, Heidegger n'est pas avare de ces expressions tout au long de son texte, et on sait qu'il ne parle, très explicitement, que d'un seul événement historique - ontique, à savoir le destin de la Grèce antique, mais sans jamais aborder, que je sache, ses contenus anthropologiques, sociaux ou politiques. Cette espèce de mauvaise conscience n'avait pas échappé à Roger Chambon qui exprime par rapport à l'ensemble de la pensée de Heidegger une méfiance qui repose précisément sur le caractère vague de ce fondement obscur.37 De fait, toute onto-théologie se sustente pour ainsi dire d'une seul et unique événement, savoir la Révélation, ce dont il faut remercier des penseurs comme Schelling de n'avoir jamais hésité une seconde à reconnaître pour tel. Le philosophe de l'idéalisme transcendantal est d'ailleurs l'un des penseurs modernes qui n'hésite pas à reprendre presque mot pour mot le schéma ontologique d'Hermes Trismégiste dont nous avons donné un aperçu plus haut.38
Nous reviendrons sur Schelling dont la pensée de l'Histoire des hommes reste bien au-dessus des platitudes qui ont cours à son époque dans l'Université allemande justement parce qu'elle préserve de cette Histoire la seule unité évidente, celle de la question de l'Être. C'est aussi la raison pour laquelle Heidegger ne pouvait que lui rendre un hommage égal à celui qu'il n'a cessé de réserver à Kant. Il n'en a pas fait autant pour Rousseau qui pourtant semble bien être la source principale sinon unique non seulement du criticisme mais encore de tout l'idéalisme allemand lui-même. Excusez du peu. Or une telle ingratitude ne se comprend pas seulement à la lumière de l'option fondamentalement " germano-hellénique " de Heidegger mais surtout, et c'est précisément ce qui distingue Rousseau de tous les philosophes Allemands, et pas seulement des idéalistes, à son argumentaire ontico-historique, à sa robinsonnade. Rousseau n'hésite pas à mettre ce que j'appellerais la main à la pâte : le parcours de l'être humain n'est pas pour lui un rêve métaphysique ou le développement de l'Idée, il est tout simplement une Histoire. Une histoire dont la cohérence spirituelle ne va pas sans la cohérence matérielle. Que ce soit l'origine du langage, celui de l'inégalité ou même seulement le développement de la musique, il y a toujours une base solide, un histoire matérielle concomitante, une évolution de l'étant/homme qui demeure inséparable de l'évolution de l'étant/monde. Bon, il y va ici comme pour le concept de temporalité, l'étant/homme et l'étant/monde seraient des expressions réversibles. Il n'y a pas de concept d'homme sans concept de monde. Soit. Or ce n'est pas de cela qu'il est question ici, ici nous parlons précisément de ce qui pourrait aussi ne pas se réduire à des concepts, et donc à l'identité étant/homme = étant/monde. L'erreur de Rousseau, si erreur il y a eu, n'est que de détail, même si ce détail ou ces détails sont d'une importance fondamentale. Mais en gros, il n'y avait et il n'y a jamais eu d'autres raisons que théologiques à ce que la recherche philosophique et anthropologique ne porte pas sur les conditions matérielles de l'existence humaine aux diverses étapes de son histoire eu égard à l'activité spirituelle et à son développement connu. Et cela était normal puisqu'il existait une Histoire toute faite et Sainte, préfabriquée par les Pères et qui faisait de ces conditions matérielles cela même à quoi s'oppose tout esprit, cela même qui représente le chemin de croix de l'Idée ou de l'Esprit à travers l'Histoire.
Et puisque nous avançons l'idée qu'il existe des erreurs fondamentales chez Rousseau, nous pouvons ajouter en même temps que ces erreurs sont dues exclusivement à sa propre alliance spirituelle avec le Christianisme, même calviniste et surtout calviniste. Rousseau était hanté, d'une certaine manière à très juste titre, par le développement du commerce et de l'industrie, développement dans lequel il voyait le principal facteur du développement de la raison au dépens des " passions ". Le Robinson de Rousseau n'échappe pas à la règle de l'élévation morale et spirituelle de l'être humain au cours des millénaires passés, règle à laquelle nous avons vu que Schelling échappe comme par miracle. Le bon sauvage de Rousseau est un animal féroce que seul dompte une socialisation qui n'a pas de cause clairement établie. En réalité, depuis la Chute, il n'y a plus de bon sauvage. Rousseau fait constamment allusion aux changements climatiques, aux migrations et aux formations sociales qui y seraient liées selon les sempiternelles logiques du besoin et de la passion, selon qu'il s'agisse de parler de l'être humain pour celle-ci ou de son évolution matérielle pour ce qui concerne celui-là. En somme le génie de l'invention du Moi critique et du Moi des romantiques y compris Stirner, l'inventeur de l' " Homme Nouveau " a une vision quasi paléontologique de l'histoire humaine. Rien de vraiment trivial si une telle mentalité, limite positiviste, ne venait pas heurter de front tout le projet humaniste, ou du moins en saper toute possibilité théorique : car la seule transcendance qui compte, celle de l'homme en tant qu'homme ne manque évidemment pas de faire naufrage dans une tel conte, il faudrait écrire compte rendu du destin de l'Être tel qu'il se manifeste à travers cet être particulier. On pourrait presque ajouter ici que Rousseau se perd dans la même contradiction que Marx pour qui le présent, et seulement le présent, contient les éléments nécessaires à l'analyse du passé. Non pas que ce soit l'ouverture du présent présent qui soit ici invoqué pour donner la mesure de la science du passé, ce qui serait parfaitement juste, mais le présent est hypostasié comme seul contenant, en tant que Capital achevé, l'ensemble des déterminations de l'Être de la société. Hegel revisité.
Car il s'agit d'une contradiction cette fois-ci foncière, fondamentale et inhérente à la dévaluation métaphysiquement nécessaire des hommes du passé, à leur relégation dans les steppes du primitivisme. On peut se poser la question de savoir comment Marx s'est aveuglé sur ce point central, coupant tous les ponts avec la liberté dont il se revendique in fine quand-même, selon le même positivisme que Rousseau. La réponse est dans l'expression que rappelle Heidegger dans le même Schelling : téléologia rationis humanae. Marx avait en vue le même type d'eschatologie que la dernière des doctrines chrétienne, enfermant la liberté humaine dans un ersatz de libre-arbitre syndical au lieu de le renvoyer dans un confessionnal. La thèse léniniste d'une avant-garde prolétarienne organisant les masses est le pendant onto-dialectique de la thèse de l'Etat de Hegel et rien d'autre. L'histoire l'aura prouvé sans phrases dès le siècle suivant. Le seul donc qui n'est pas entièrement tombé dans ce piège du progrès de l'espèce, c'est donc bien Schelling, car de Nietzsche à Deleuze il n'existe aucune trace d'une pensée qui se soit passée radicalement de cette idée de domestication " lente et progressive " de la pensée et de la vie des hommes selon des requisits les plus fantaisistes les uns que les autres. Il serait temps, à l'époque où se fait jour une résistance tout à fait inattendue des cultures régionales à travers le monde, et non seulement un résistance mais encore une sorte d'instinct de reviviscence à marche forcée, de modifier radicalement ce point de vue et d'en finir avec l'évolution des corps et de l'esprit, les uns et l'autre n'ayant jamais été que ce qu'ils sont encore dans notre présent le plus présent.
Il n'y a pas de fondement obscur, pas d'instant décisif, pas de rupture épistémologique ou historiale autre que fondée entièrement sur la liberté humaine et sur une liberté qui ainsi seulement peut prendre cette fameuse place de foyer du système de l'étant/homme dans l'étant/monde. En passant, et après relecture, il me semble indispensable de préciser ici que la liberté n'est ni un principe ni un " cœur de système ", mais une véritable condamnation : l'homme n'a ni père, ni dieu ni maître, il est seul et il est demeure seul au cœur même de la communauté ou de la collectivité, comme on veut. La liberté est ainsi tout au plus la qualité essentielle de la place que l'homme occupe dans l'étant, ce qu'on appelle au fond la déréliction. Les fondements, donc, car nous n'en connaissons vraisemblablement qu'une faible partie, sont des décisions, des projets, et seulement à ce titre aussi on peut les inscrire dans un système, quel que soit leur mode d'expression, le cri, le chant, la parole ou l'écriture. Or parmi ces décisions et ces projets ont figuré ceux du rassemblement et de la sociation des êtres humains, volonté claire, c'est à dire consciente de tous les enjeux, dangers, des prix à payer pour les réaliser, mais aussi de leur télos, de ce pourquoi cette volonté s'investissait dans de telles aventures. Le petit extrait que nous avons choisi de mettre en exergue est lumineux, autant dans l'exposé des faits que pour illustrer la faille du raisonnement de Rousseau, sa seule faiblesse oserais-je dire. Lisons : à quoi servirait le savoir individuel s'il ne pouvait se communiquer à autrui dans l'intérêt de l'espèce ? Où serait l'utilité de " toute cette Métaphisique " personnelle qui serait condamnée à disparaître avec son auteur ? Implicitement il reconnaît la possibilité d'une sagesse individuelle mais c'est le télos, la finalité d'une telle sagesse qui rend absurde l'idée qu'elle pourrait exister réellement : si la sagesse ne fait pas progresser l'espèce, elle ne sert à rien. Peu importe si ce Philosophe solitaire s'assure de la question de l'Être en jouissant de toute la plénitude de la sagesse qu'elle dispense, s'il est incapable d'en assurer la diffusion par une bonne campagne de communication. Cherchez l'erreur : si la fiction est logiquement bonne, il faudrait exprimer cela tout à fait autrement, c'est à dire reconnaître la possibilité que TOUS les sauvages solitaires pourraient être des philosophes, et par conséquent qu'il n'y aurait aucune utilité à ce qu'ils se partagent quoi que ce soit. Rousseau fictionne à l'envers, il plaque sur la préhistoire l'image de sa propre société où il y a des génies, des hommes aux talents particuliers, des philosophes-nés au milieu d'un tas de crétins, au lieu de reconnaître en l'homme lui-même qui et quel qu'il soit, en son essence, la faculté innée d'avoir accès à l'ouverture de l'Être. Evidemment s'il allait jusque là, son syllogisme tomberait à l'eau et avec lui la nécessité de fonder des sociétés. Et pourtant le dernier mot de toute la pensée de Rousseau, nous l'avons dit, repose sur l'idée de la perfection originelle de l'être humain. C'est l'Homme Nouveau de Rousseau qui ouvre les perspectives idéalistes et romantiques et certifie par avance la légitimité métaphysique du Moi et de son savoir absolu. De plus, Rousseau, si je l'ai bien compris, rend précisément responsable de la dégradation morale de l'homme la sociation elle-même. En attendant l'Aufhebung et l'Etat.
Toute la métaphysique dite occidentale, excepté dans de certaines mesures Nietzsche et peut-être Kierkegaard, bute sur cet obstacle. Elle ne veut et ne peut pas faire retomber toute la responsabilité de l'être-là humain sur l'homme lui-même, il faut toujours qu'il y ait un facteur étranger, transcendant, destiné aussi bien à lui conférer ses pouvoirs surnaturels, c'est le cas de toutes les idées qui tournent autour de l'esthétique critique et post-critique, celle notamment du génie, qu'à le soumettre radicalement à une déréliction qui peut se dire dans tous les vocabulaires de la métaphysique onto-théologique. Bref, l'homme est partout et nulle part ce qu'il devient in fine dans toutes les représentation métaphysiques, à savoir ni un animal rationale, ni un zoon politikon, ni un zoon ekon logon, et finalement il ne peut même pas être un Moi, n'en déplaise à Stirner. Toujours il est tout cela à moitié, comme si un comptable habile était en permanence chargé de trafiquer les comptes de son Dasein et de son Histoire pour faire une balance qui le maintienne à la fois à l'écart des affaires tout en lui faisant payer d'avance en général le prix de ce qui est maquillé en choix, projet, finalité dernière de son ek-sistence par les clercs. Marx est l'exemple le plus remarquable de victime de cette parallaxe qui déforme en permanence l'image de l'être humain. Dans les Grundrisse, si je me souviens bien, il va jusqu'à attribuer à la volonté délibérée de l'être humain le pouvoir de décider de la formation de nouveaux organes tels que les yeux ou les oreilles. En substance il dit que l'homme a voulu voir et qu'en conséquence il s'est fait des yeux et il a vu. Formidable, mais alors pourquoi aussi ne pas reconnaître qu'il a voulu un jour vivre en société, qu'il en a fait le choix délibéré ? Et pas seulement cela, pas seulement reconnaître que l'homme a consciemment décidé de se rassembler en peuples, nations et je ne sais quoi encore, mais conférer à cette option fondamentale un sens, une finalité. La société a été, en vérité, un investissement industriel, le premier peut-être, et dont le sens n'était lié ni aux besoins ni aux passions - ah que cette idée de passion est vulgaire, stagiritement médiocre, triviale pour tout dire et précisément à la hauteur de cette comptabilité mesquine qui manque toujours et partout l'essentiel ! - le sens de ce choix destinal était lié à cette sagesse innée que " pourrait attribuer " Rousseau à un Sauvage de la brousse, au seul souci qui aura toujours déjà différencié l'homme de l'étant/monde, et cela dès l'origine, la question de l'Être.
Dès l'origine. Où se trouve cette origine ? Mais elle est en nous, dans notre présent d'homme. Nous n'avons pas le choix, nous devons assumer ce qui est présent en nous dans le présent et s'il nous prend le caprice de parler de nous, du nous-homme, vivant dans un passé lointain, de le représenter d'une manière ou d'une autre, rien ne nous permet de distraire de l'image que nous en ferons cette part essentielle, ou du moins que nous affirmons essentielle. Je préfère encore le langage clair des pragmatistes qui assument absolument la dure loi du nihilisme démasqué et qui envoient l'Idée se faire bronzer sur les plages de l'utilité, à celui des clercs chargés de distribuer les Légions d'Honneur du savoir absolu. Et de fait, notre monde est exactement partagé entre ces deux tendances morales, situées toutes les deux à l'autre bout de l'univers grec de la tragédie, dans un monde tel que le décrit Shakespeare, le dernier des Grecs. Soyons clair : le héros (le Bon et Savant Sauvage) s'est dilué dans le peuple. Regardez où ça se passe dans la Tragédie Classique, en réalité dans le Musée Grévin de Plutarque, là où naissent encore des héros de chair et de sang (4). Or ce qui fait toute la différence entre nos Racine, nos Corneille et l'Homère des Îles britanniques, c'est que ce dernier comme Sophocle et comme Eschyle sait faire descendre la sagesse et la lucidité jusqu'au plus bas de l'échelle du peuple. L'imbécillité, la lâcheté, la haine ne sont pas l'apanage de la Classe, ils sont aussi bien partagés que la Raison chez Descartes. Mais il y a mieux, Shakespeare ne met pas en scène un théâtre de marionnettes en cire, des marionnettes qui trottinent dans l'Histoire au gré des doigts des dieux qui s'amusent à rejeter sur les hommes l'aveugle destin qui les dépasse eux-mêmes, mais des Hommes qui assument les yeux ouverts aussi bien leurs " passions " que l'échec de leurs vertus. Ici, sur les scènes de la grande Elizabeth, on ne ment pas, on n'accuse pas l'outre-monde même si on y fait appel précisément comme l'Histoire passée, on se comporte en homme d'honneur et on accomplit son destin les yeux ouverts, quitte à les crever d'une manière prophétiquement moderne, c'est à dire, après Nietzsche, en prenant la place du fou.
Il faut ici préciser la dimension et la valeur réelle de tels fondements ainsi que la logique de leurs conséquences. Si les hommes " sauvages " ont pu craindre par avance un tel projet que celui de s'associer, ce n'est pas dans la logique que nous avons indiqué plus haut en passant, celle des conséquences économiques et politiques. Le problème était exactement qu'ils savaient par avance qu'ils infligeraient ainsi un traitement terrible à la question de l'Être, ils prenaient consciemment le risque de faire advenir cet Oubli de l'Être millénaire et toutes les conséquences morales qu'il entraînerait : ils mettaient dans la corbeille, dans la Bourse ontologique, la richesse essentielle qui était leur propriété à titre individuel, leur sagesse et certainement un bonheur dont nous ne faisons que soupçonner à travers toutes les mythologies le seul merveilleux digne de ce nom. Mais l'existence ou non d'un tel Paradis, sa réalité scientifiquement établie et ses contenus concrets ne nous sont d'aucun intérêt, une onto-archéologie n'aurait pas plus d'intérêt que l'onto-théologie, d'autant que la première n'aurait pas d'autre choix que de chercher ses propres motivations dans la seconde, comme c'est d'ailleurs le cas. Non, il n'y a aucune raison de chercher à découvrir autre chose que la nature exacte des Pommes d'Or du jardin des Espérides, à savoir la nature ou l'essence de ce qui manquait à une situation ontologique que nous n'avons pas d'autre choix que de juger parfaite. En d'autres termes, si déjà il leur était clair qu'il allait falloir sacrifier l'essentiel, pourquoi les hommes ont-ils quand-même décidé de jouer d'un coup le tapis, en vertu de quel espoir de gain ont-ils pris de tels risques boursiers ?
La réponse est-elle dans notre présent ? Certainement. Mais avant d'en arriver à cette réponse, qui se lit déjà presque toute entière dans ou plutôt à travers Nietzsche, il faut affermir notre position morale par rapport aux conséquences ultimes, c'est à dire présentes, de cette extraordinaire aventure. Ce qu'il faut comprendre et admettre ici, c'est que nous n'avons pas le choix pour un autre récit des faits. Il n'est plus question du tout de douter comme le faisait encore Rousseau de cette possibilité pour l'homme des origines d'être un philosophe-né. Car comme pour Œdipe, il y va de notre honneur parce que c'est en nous qu'est né cet homme mythique, et entre autre, à travers les Philosophes, à travers tous les Rousseau de notre métaphysique occidentale. Il est donc trop tard pour reculer, nous ne pourrions plus avorter, même si dans le clair jour d'aujourd'hui cette volonté d'avorter domine de toute son arrogance. Il est trop tard parce que le Surhomme est déjà né, l'usufruit de la Geschichte, les intérêts de ce placement à long terme sont tombés dans nos escarcelles et tout le problème est désormais, comme le décrit si bien Bataille, d'en décider la dépense. A l'autre bout de l'histoire grecque, judaïque et chrétienne nous somme dans la même position qu'Œdipe, nous avons à assumer notre position dans notre propre représentation : nous nous sommes faits Rois, et par conséquent nous devons en payer le prix, même si dans l'histoire, dans ce que Nietzsche appelle indirectement " l'illusion de l'Être " nous ne sommes que les tard-venus, les innocents aux mains pleines. Le fragment (5) d'où je tire cette expression mérite qu'on le cite en entier, tant il conspire avec tout ce qui s'écrit ici, mais sa longueur m'incite à me limiter au dernier paragraphe qui se suffit à lui-même : - " Le caractère du monde du devenir est d'être informulable, " faux ", " contradictoire ". La connaissance et le devenir s'excluent. La connaissance doit donc être autre chose : il faut que préexiste la volonté de rendre le monde connaissable, il faut qu'une sorte de devenir crée lui-même l'illusion de l'être. " (P.A. 1887 (XVI, § 517)
Nietzsche a aussi besoin qu'on le remette sur ses pieds, comme Hegel. Il avait compris l'essentiel, il avait compris que toute histoire, et par histoire il faut aussi entendre savoir, langage, art et science, découle d'une volonté qu'il affirme supérieure. Le nihilisme bien compris, ce n'est que cela, la reconnaissance de l'humanité essentielle de toute action et de toute option passée, l'absence de tout Label transcendant, de toute garantie universelle. L'Histoire est un feuilleton à épisodes qui s'enchaînent plus ou moins bien, formant une œuvre plus ou moins réussie, plus ou moins homogène selon les représentations que l'on réussit à en faire selon des stratégies elles-mêmes créatrices de nouveaux choix.. Le Professeur de philologie de Bâle a bel et bien ouvert la boîte de Pandore de la vérité sur cette Histoire qu'on avait fini, notamment avec Hegel, à prendre pour une conne, i.e. la boniche de Dieu. Nietzsche souffrait cependant encore de séquelles métaphysiques d'un positivisme trop prégnant en son siècle et n'a jamais pu se défaire d'un physiologisme évolutionniste absurde. Une certaine lecture pourraient ne faire apparaître l'ensemble de ses textes que comme une énorme répétition de ce qu'il conçoit lui-même comme nihilisme, à savoir la domination idéologique des prêtres, au fond une apologie de l'Histoire occidentale dont, dans la vie concrète, Nietzche n'est qu'un clerc tardif et parfois ridicule de prétention. Les Surhommes qu'il décrit parfois lorsque son sens ontologique de la volonté de puissance le lâche, ont existé. Ils ont émaillé toute l'époque qui nous sépare du néolithique, ils sont même nés à la faveur du déclin de cette époque nomade, créant les " populaces " et le marais des sous-hommes, des esclaves, des cerfs et des prolétaires. Il faudrait ajouter Juifs car ce qui leur a été infligé par les Européens, c'est aussi dans Nietzche qu'ils en ont cherché et trouvé l'absolution métaphysique, quoiqu'on en dise et malgré le dégoût qu'à la fin de sa vie il affichait à l'égard des antisémites. Il faudra, aussi, faire l'histoire vraie de l'intelligentsia européenne d'entre les deux guerres. Céline, Drieu La Rochelle et même le grand Giono, Bertram et Baeumler sont des exemples plus pertinents pour une telle histoire que Thomas Mann et Malraux.
Voici donc nos crimes, y compris le dernier, le pire de tous. Pas question d'en rejeter la responsabilité sur un " peuple ", cette notion qui ferait rire les baleines, pas question d'en faire une " question allemande " comme on fait une " question juive ", rien à voir. La création des castes dont rêvait Nietzsche et la Shoah sont de notre responsabilité occidentale, sont nos crimes collectifs. Ils sont pour l'une comme pour l'autre l'aboutissement matériel fatal de la prophétie de la Pythie dont notre ignorance de nouveaux-né dans le millénaire ne nous absout en rien. Nous sommes là avec les conneries de nos pères, elles-mêmes emberlificotées dans celles des leurs et ainsi de suite. Hannah Arendt peut bien tenter de dédouaner les hommes du présent en livrant au hasard les conséquences des actes du passé : il n'y a aucun hasard, il n'y a que la lâcheté de renoncer, à chaque génération, à l'analyse de ces actes, de conserver cette critique de génération en génération et de faire fructifier ce savoir par les Révolutions qu'il faut au moment où il le faut. Il y a quelques Baeumler en France de nos jours, qui tentent de se servir de cette idée de responsabilité en série pour se retourner contre la Révolution Française. Bien joué, mais la Révolution Française fait précisément partie de ce qui s'est durement et péniblement conservé et fortifié en tant que critique de l'onto-théologie et de la société qui s'est construite sur ses fondements. Curieux intellectuels qui consacrent une grande partie de leur temps à la République et à son culte et qui n'ont rien de plus perversement pressé que d'en saper en profondeur les véritables piliers historiques. Pour en finir une fois pour toute avec cette inférence bi-centenaire du totalitarisme qui ferait de Robespierre un quelconque Staline, il suffit de rappeler à qui veut bien entendre que la Terreur est venue, cette fois et seulement cette fois, du bas et non pas du Reichstag ni du Kremlin. Elle a été la conséquence de l'inégalité sociale produite par l'histoire et de la gestion des instincts de la masse telle qu'elle fut pensée par la Monarchie. Au demeurant, et à ceux qui voudraient pinailler avec certains détails de la Terreur, je dis que les Républicains français n'ont pas à prendre en compte les crimes qui ont été commis au nom du traître Danton et de ses complices. A bon entendeur Salut. A tout candidat au statut de Surhomme : ayez des haines fortes et durables, n'oubliez jamais rien, d'un millénaire à l'autre s'il le faut.
Notes
1 - Carlo Angelino, Il " terribile segreto " di Nietzsche, il melangolo, Gênes, 2000
2 - Martin Heidegger, Schelling, NRF Gallimard, 1977 traduction Jean-François Courtine. Souligné par nous.
3 - Voir notamment dans Philosophie et Religion, F-W Schelling, Essais, Traduction Jankélévitch, Aubier Montaigne 1946, page 204
4 - Loin de moi l'idée de faire de Plutarque un Alexandre Dumas de l'Antiquité, mais il se trouve que son Histoire est comme le paradigme de l'historiographie hagiographique. Même d'un point de vue idéologique il est plus " objectif " que Thucydide qui reste empêtré dans ses intérêts privés et dans ses opinions d'homme de droite, et d'un certain point de vue Plutarque est un précurseur de la mise à distance critique de toute notion de héros.
5 - F.Nietzsche, la Volonté de Puissance, vol. 1, fragment 138, Edition Tel Gallimard, 2000
Dimanche 28 décembre 2003
L'illusion de l'Être.
L'Être, une illusion. " Il faut qu'une sorte de devenir crée lui-même l'illusion de l'Être ". Curieux langage chez Nietzsche, une " sorte de devenir " ? De quoi s'agit-il, de quel fatum transcendant est-il question ? Cela ne colle pas avec le fond de la pensée du philosophe du nihilisme. Heureusement, il place juste avant cette étrange expression, l'idée selon laquelle doit préexister à ce devenir " la volonté de rendre le monde connaissable ". Car seule la notion d'Être permet de donner au sujet, à la substance ou à la raison leur stabilité ontique et donc logique. On ne peut pas dire ontologique car la science des phénomènes ne s'intéresse pas à l'Être mais aux objets, et par ailleurs le terme ontique contient de toute façon le dessein ou la causalité ontologique en lui-même. Pour Nietzsche l'Être est donc un instrument artificiellement produit par un devenir déterminé par la volonté de connaître. Biblique. Je ne sais pas quelle place attribuer à ce fragment 138 par rapport au dispositif de l'éternel Retour, mais cela n'a pas d'importance. Dans sa dernière livraison, Safranski ne cache rien des contradictions affichées dans les affirmations de Nietzsche, cela fait partie de son arrogance. Cela me fait penser à ma première lecture de Nietzsche bien avant l'aube de mes vingt ans. Imaginez-vous sortir de Bergson et du Sartre de la Nausée pour tomber d'emblée dans le Zarathoustra, puis pour dévorer d'un coup tout ce qui se trouvait alors dans les bibliothèques municipales et qui portait le nom de Nietzsche. Cette lecture a toujours eu pour moi un statut tout à fait unique : c'était une lecture qui ne laissait aucune trace dans l'esprit, une pure musique si je conclus aujourd'hui, car dans les années 50 - 60 je n'aurais pas pu établir une telle comparaison, le seul livre qui me resta réellement obscur et qui, finalement me découragera, fut la Naissance de la Tragédie. Sa première grande œuvre, celle qui aujourd'hui fait prime sur le marché de l'intelligence et de l'Esthétique, m'est tombée des mains parce qu'elle n'était pas écrite comme le reste. Elle voulait dire quelque chose d'indicible dans la langue universitaire, elle puait la philistinerie que son auteur dénonçait partout ailleurs. Pour lui-même, ce livre est devenu entre-temps " impossible ", tant mieux. Bref, je n'ai pas lu Nietzsche, j'en ai fait une expérience unique dont je n'en trouve de semblables que dans mes incursions littéraires majeures, Dostoïevski, Céline et plus récemment Shakespeare.
Cette remarque ne devrait pas figurer ici, pourrait-on m'objecter. Qu'est-ce-qu'on a à faire de mes états d'âme d'il y a quarante et quelques années ? Peut-être, mais cette expérience a une suite que je trouve intéressante, même si elle reste totalement subjective et je profite de cette occasion pour éclairer le titre de mon premier écrit (dont j'ai perdu le manuscrit sinon la pensée directrice) : Deuxième Entretien Préliminaire. Philippe Lacoue-Labarthe m'avait dit à son sujet (au sujet du titre) qu'il avait quelque chose de Malebranche, ce que depuis j'ai bien compris. Or je n'ai jamais eu le temps de lui expliquer que l'idée était alors de coucher par écrit le Deuxième Entretien que m'avait refusé un psychanalyste lacanien de renom sur la place de Strasbourg, ma seule tentative (ratée) d'analyse. Je veux ajouter ici que je ne revendique pour ce texte aucun statut différent, fidèle en cela à tout ce qui a pu s'inscrire malgré moi en moi de la pensée la plus profonde et la plus importante du même Nietzsche. Je n'ai donc aucune raison de désubjectiver ce texte, bien fous, d'ailleurs, sont ceux qui adoptent la raideur des Philistins et leur hygiène spirituelle. Quelle rigolade ! La suite donc me paraît intéressante à signaler, comme on raconte une aventure qui vous est arrivé, je me mis à fuir panique le moindre écrit de Nietzsche. Il me faudra attendre quarante ans avant de pouvoir reprendre en main des volumes vieillis que j'avais acquis par obligation professionnelle, Nietzsche me faisait peur, une peur très simple, celle de trop bien le comprendre et de finir comme lui. C'est idiot sans doute, mais pas tant que cela, car la lecture de ce philosophe comporte en effet des dangers inouïs dont notre histoire la plus récente nous donne des illustrations démentes mais bien réelles. La pensée de Nietzsche, pardonnez-moi cette longue digression qui n'en est pas une, est historiale au plein sens du mot inventé par Heidegger. Elle contient en une extraordinaire condensation toute la psychose du peuple européen, tout le désarroi logique et affectif d'une civilisation qui semble s'effondrer sous sa propre pression interne, qui semble imploser. Zarathoustra est bien le sujet de la subjectité qui vient de naître à Berlin, le fruit de la maïeutique hégélienne, si l'on peut dire. Rüdiger Safranski (1) était attendu au tournant avec son sens aigu de l'efficacité, il n'a pas osé dire ce qui lui brûlait son traitement de texte, il n'a pas osé lier directement Nietzsche au cauchemar nazi. Et pourtant ! Il m'arrive plus souvent que nécessaire de prendre la défense de Heidegger dans le débat que l'on sait, mais la cécité ontologique des intellectuels est remarquable, on ne veut pas voir que la seule parenté qui compte dans le destin de Martin Heidegger est celle qui le relie à Nietzche, un million de fois plus coupable par rapport à l'histoire sordide de l'Allemagne des années 30 et 40 que son descendant spirituel badois. Il y a de l'inceste entre ces deux hommes et du parricide en même temps, mais au total ils ne sont que deux espèces de cow-boys qui règlent leur compte dans l'espace clos de la métaphysique. Leur témoin tient le sablier dans sa main, il s'appelle Ernst Jünger.
Or le résultat de ce duel n'est pas rien, c'est l'échec même du nazisme, l'impasse et l'anéantissement de ce rêve paranoïaque. Le fils du tonnelier de Messkirch perd ses cordes vocales dans son affrontement avec le fils du pasteur de Naumburg mais il fait plus contre Hitler que les divisions russes et américaines. Il est remarquable que ce sacrifice ne le préserve pas d'un véritable Nuremberg spirituel et que ce soit à lui que s'en prennent ceux qui continuent assez gaiement de commenter les élucubrations de l'inventeur de la machine à broyer l'Être. Car il y a une mékanè chez Nietzsche, une véritable industrialisation de son nihilisme à lui, celui du Sujet prénommé Surhomme, mais ce qui aggrave son cas et le rend coupable de falsification, c'est qu'il plaque ce Sujet, qui au fond est un résultat légitime et escompté des choix destinaux de nos ancêtres, sur le schéma positiviste néo-métaphysique du Dix-Neuvième siècle sans aller y regarder de plus près. Pas étonnant qu'on doive, dans sa foulée si malheureusement intelligente, ramasser les Spengler, les Klages, les Linke et autres Gestaltistes de contrebande. De quoi alimenter toute la néo-gnose américaine dont on voit le résultat politique-social à travers la planète toute entière. La pensée la plus sombre et la plus systématiquement nihiliste de notre époque est passée inaperçue parce que l'homme est mort provoquant une sorte de soulagement général et silencieux. Roger Chambon a écrit un seul livre, une de ces œuvres universitaires dont la qualité force l'édition mais qui demeure à jamais condamnée à la poussière des rayons de la librairie Vrin. Cet ouvrage, déjà cité, porte le titre suivant : " Le Monde Comme Perception et Réalité ". L'auteur se réclame d'une filiation qui ne fait certes pas prime sur le marché de la philosophie, mais dont le travail de taupe n'en demeure pas moins l'un des fondements de l'idéologie dominante du libéralisme aveugle et moralement de plus en plus incertain. Dans cette filiation, Nietzsche tient le rôle d'une référence permanente, alors que toute l'explication, die Auseinandersetzung, s'articule logiquement et historiquement sur l'école phénoménologique française qui, comme on le sait prend son essor en Allemagne avec Husserl et se poursuit de notre côté du Rhin avec Sartre, Ruyer, Merleau-Ponty, Michel Henry ou encore Lupasco.
Roger Chambon a une vision tragique de l'Être. Elle pourrait se définir comme un résultat parfait et indiscutable de la synthèse que Nietzsche n'a pas eu le temps d'opérer entre les sciences dont il a eu vent et sa critique de l'ontologie, le tout moins le Surhomme. En écho évident au titre célèbre de l'œuvre majeure de Schopenhauer, Chambon résume toute sa " métaphysique " dans le titre de son travail : Le Monde Comme Perception et Réalité. L'Histoire ici est une histoire totalement matérialiste : le monde naît dans la rencontre hasardeuse, démocritéenne, des éléments chimiques de l'univers. Il s'agit donc d'un naturalisme délibéré dont l'essentiel se conclut ainsi : " Il n'est pas possible de penser l'homme comme une partie de la nature sans penser également que la manifestation du monde est un phénomène naturel " (2). Cette manifestation du monde n'est autre chose que la perception ou auto-perception de la vie consciente, " la vie consciente dans son actualité " (3). Qui ne se réduit pas à la conscience humaine. Le hasard, que Chambon cherche directement chez Monod, a bien fait les choses : il a créé une entité, le monde, qui SE perçoit, selon des degrés qui vont de ce que l'auteur appelle la protoperception qui anime toutes les formes de vie jusqu'à la conscience humaine et la Science dont l'œuvre représente l'essence en mouvement de cette perception ou son résultat ultime. Cette perception auto-centrée, à l'intérieur de laquelle l' " Être a barre sur son paraître " s'opère par " glissade " dans l'Être qui sertit les phénomènes, sans coupure entre " le profilement sensible et les adhérences ontiques qui le dérobent au sujet en l'empêchant d'être une simple " apparition " (4). La psychologie phénoménologique des Ruyer et Henry apporte ici ses matériaux théoriques qui permettent à Chambon de construire cette glissade selon des continuités ontiques toujours auto-affectés et auto-centrées (une individuation par décentration centripète) sur le modèle de la Théorie des Champs Unitaires des domaines en étages des jardins suspendus. Le ciment de ce bâtiment, l'Être, c'est l'affectivité, " base interne de toute existence subjective (5)". " L'affectivité, essence de l'être et fond de l'Ego, est la source à partir de laquelle transcendance, pensée, action deviennent possibles". Au total, le monde est un vaste Narcisse dont le temps est compté d'une nuit à l'autre : " La nuit vivante de la formation des corps laisser percer, au hasard, sa lumière ; l'illumination extérieure du monde, une forme à son tour dans le mouvement de l'Être, sera supprimée par ce mouvement même où seule règne, haute et claire, la nuit d'après comme d'avant."(6)
Il s'agit là d'un modèle qui préfigure cette onto-anthropologie dont nous parle Sloterdijk dans son petit opuscule intitulé " La Domestication de l'Être ". Heidegger a eu beau faire, la technostructure intellectuelle des XIX et XX èmes siècles ne veut pas lâcher prise. Comme chez Chambon, la référence à Bolk, et donc au phénomène de la néoténie - le retard, programmé selon Sloterdik, de la maturation du petit de l'homme - est centrale, car elle permet tout un récit, une pure fiction carrément médiatique, de l'évolution de l'animal-homme. Mais non seulement cela, car l'un comme l'autre, ils extrudent pour ainsi dire de cette évolution le sens de la clairière, l'extériorité de l'Être. Pas étonnant donc, que pour l'un comme pour l'autre, l'humanité ne doive en dernier ressort quand-même se contenter d'un pur spectacle de l'univers, parquée dans ses Disneyland métaphysiques ou pas. La vie comme feu d'artifice, c'est bien la thèse des cyniques et des hédonistes qui ressurgit ainsi, estampillée de la garantie scientiste, sinon scientifique. Pourquoi pas ?
Pourquoi Pas ? Parce que l'Être ne peut rien avoir à voir avec une production. Pour Chambon cette production reste, il est vrai, une auto-production d'un Être - Univers dont les contours restent cependant bien flous, alors que Sloterdijk fait de l'homme en tant qu'animal à l'Etre, son propre auto-producteur, selon des motivations qui tiennent du sempiternel discours scientiste sur les modifications de l'Umwelt humain, de son environnement. Or l'un comme l'autre refusent d'admettre que la question de l'Être ne nous intéresse nullement dans une Histoire, une évolution ou une mutation quelconque, mais que cette question reste, avant et après n'importe quel récit de genèse, en tant que telle la question de l'Être. Que nous ayons conquis une extériorité, l'ex-stase, parce qu'un jour nous avons appris à jouer au lancer de pierre, ou bien que ce soit une force auto-affectée en développement qui nous ait ouvert le monde de l'Être, l'Être demeure comme énigme absolue en tant qu'ouverture. Ce qui montre bien que les deux " philosophes " dont nous venons de parler, restent totalement étrangers à la matière même de l'ontologie, c'est que pour tous les deux le phénomène de la clairière, de l'ouverture à l'Être est un phénomène tout simplement humain : tous les hommes ont accès à la clairière, la question de l'être est une maladie commune ou un attribut universel de l'aperception humaine du monde, c'est un mode ou une affection de la conscience. La métaphysique onto-théologique avait résumé cela en disant que nous étions tous les enfants de Dieu. Or tel n'est pas le cas, car l'accès à la question de l'Être demeure le privilège singulier que procure à certains l'expérience de l'extase ontologique elle-même. Que l'on puisse ou non se procurer cette extase par un long travail du concept, je n'en sais rien, tout ce que l'on peut supposer est que le malaise originel de l'être à la mort peut conduire à l'expérience extatique à travers des éthiques de vie dont le travail du concept n'est qu'une variante. Certaines expressions de Heidegger, notamment dans Sein und Zeit, ont contribué à introduire une certaine confusion, car la position ex-statique devient communément chez lui la caractéristique universel de la position humaine en tant que telle. Les hommes auraient pour ainsi dire zappé génétiquement, ou bien, pour le dire autrement, l'accès à la question de l'Être s'est inscrit dans le programme génétique, ou encore dans son " essence ".
Nietzsche a raison une fois de plus, la question de l'Être en tant que déterminant l'humanité ou l'hominité est une illusion. C'est précisément cette illusion qu'ont exploité les maîtres du " parc humain ", les prêtres, les clercs et leurs commensaux. On pourrait décrire la société historique occidentale, mais on peut certainement étendre ce schéma à l'ensemble de toutes les civilisations, effectivement comme une pyramide que surplombe une pyramide inversée. La figure inférieure reflèterait le " parc humain " " enveloppé " par les prêtres dans une souveraineté approximative sur la foi de l'existence de la figure supérieure : les prêtres ne sont pas les Saints, mais les Saints existent. Ils sont les extatiques dont le comportement erratique au regard du grand nombre est interprété par les prêtres à l'aide de leur pauvre matériel existentiel qui repose entièrement sur cette mimésis si énigmatique. L'extranéité au monde est l'essence représentable de l'anachorète, de l'ermite, du héros ou du révolutionnaire. Mais, ne nous y trompons pas, ce n'est pas le constat de l'existence de telles personnalités qui, comme dans le modèle ontopaléontologique de Sloterdijk, produirait la différence ontologique : cette différence est seulement vécue, elle est seulement une expérience et ne peut en aucun cas devenir un attribut universel de la conscience humaine. Les herméneutes de telles expériences ne contribuent en rien à leur extension à une pluralité quelconque d'êtres humains car ces expériences demeurent irréductibles à tout pédagogie, à toute initiation. La République de Platon elle-même ne peut pas recevoir et contenir les êtres qui ont expérimenté la question de l'Être, car eux-mêmes ne représentent que ce qui conduit à l'extérieur, ce qui provoque la panique et le désordre. Poètes et artistes sont les inspirés qui dérangent toute communauté organisée et " enveloppée ", ils doivent par conséquent assumer leur exil naturel de toute réalité sociale.
Mais cela ne va pas de soi. Il faut encore éclaircir un point central : de quoi est composée la pyramide renversée qui ne communique avec l'autre que par le contact des significations modélisés par les prêtres ? Elle est composée par l'Histoire de l'Homme à l'Être, c'est à dire par la réduction progressive du nombre des initiés à partir de la totalité des hommes vivants : la Grèce n'est pas un miracle ou un bond dans la Civilisation, elle figure au contraire le moment tragique de l'extrême réduction du nombre d'initiés, le moment panique où s'est profilé d'un coup la possibilité de la disparition totale de ces êtres dont l'existence possède le caractère du vital, parce que sans eux la République est ingérable. Les sophistes, les cyniques, les hédonistes se mettent à pulluler. Qui sont-ils ? Il sont les philosophes du désespoir. Ce désespoir n'est pas autre chose que le scepticisme métaphysique universel dont le regain actuel n'est que l'une des manifestations du retour à la case départ de la Grande Grèce. Sur la scène du théâtre de l'histoire des Grecs, Parménide et ses disciples étaient aussi minoritaires que l'est aujourd'hui Heidegger et les quelques esprits qui creusent dans le sillon de son dire. Mais ils sont aussi les concurrents naturels des prêtres car ils possèdent aussi le pouvoir du langage et celui de l'émission de significations : ils sont les contre-interprètes du divin, ses négateurs logiques. Leur position est exactement équivalente à celle des prêtres, au point qu'il faudra leur réserver une place de plus en plus large dans le pseudo débat métaphysique de l'Occident. Empiristes et transcendantalistes, matérialistes et idéalistes, naturalistes et culturalistes, ces dichotomies représentent pour chacune d'entre-elles les deux versants d'un même mensonge clérical. Ce mensonge nous l'avons amplement décrit : la substantivation de l'Être et le règne du Sujet, produit de l'interprétation suprême de la vie de l'un des plus grands révolutionnaires de l'Antiquité, à savoir le nommé Jésus-Christ (7). La coexistence, nolens volens, de ces deux modes à l'origine inconciliable d'interprétation, ne tire sa possibilité que d'un accord provisoire signé à Nicé autour de la question de la Sainte Trinité, c'est à dire la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi Luther ne remet-il pas ce dogme en question ? Parce que ce dogme a démontré son efficacité dans la lutte contre les sceptiques, dont une grande partie s'est naturellement glissée parmi les inter-prêtres de l'aventure christique. Les Ariens, les Gnostiques ou encore les Manichéens n'étaient que des sceptiques masqués qui remettaient en cause l'unité de l'interprétation dont dépendait l'unité sociologique recherchée. Le dogme de la Trinité a peut-être joué le même rôle que les mathématiques au temps de Pythagore mais à l'envers, celui d'un stabilisateur irrationnel, c'est à dire ouvertement relié à la Foi et donc au pouvoir de la violence, de l'étant rationnellement exploité selon les divisions sociales ainsi légitimées. Une sorte de talisman de reconnaissance que se montraient en cachette les initiés d'un bout à l'autre de l'Europe et qui autorisait un prélat comme Nicolas de Cues à traverser le continent dans toutes ses largeurs à une époque où le banditisme paralysait le reste des citoyens de cette République fantôme.
Notes
1 - Rüdiger Safranski, Nietzsche, Biographie d'une Pensée, Actes Sud, 2000, traduction Nicole Casanova.
2 - Roger Chambon, Ouvrage cité, page 17
3 - Ibid. page 19
4 - Ibid. page 89
5 - Ibid. page 307
6 - Ibid. page 572
7 - En ce qui concerne ce personnage et sa vie, leur interprétation par Nietzsche ne souffre aucune critique.
Mardi 30 décembre 2003
Histoire et Historisme.
Il faut revenir à Nietzsche, un Nietzsche que l'on connaît aujourd'hui bien mieux grâce, faut-il l'avouer, au tremblement de terre qu'il a déclenché par l'une des paroles les plus libres qui ait pu se manifester dans notre occident muselé par le religieux. En fait, on pourrait faire de cet homme le point de rencontre et de répulsion réciproque de la Science et de la Religion, l'homme par qui le scandale est arrivé. Je ne sais pas au juste quelle circonstance proprement historique il faut invoquer pour nous permettre de comprendre comment une telle voix a seulement pu s'élever en plein milieu de l'un des siècles les plus obscurs des trois derniers millénaires. Tout au plus peut-on conjecturer la possibilité d'une telle " erreur de casting " de la part des prêtres au vu de la frénésie jubilatoire qui s'empare alors en même temps de ce que devient alors l'Allemagne. La vérité s'est glissée à travers une immense faille d'enthousiasme poïétique directement lié à la naissance du Reich, mise en scène par Wagner en personne comme une éclatante Renaissance. En bref, on n'était pas à ça près, on était pas à un tel risque près alors que partout retentissaient les clairons du triomphe de la caste militaro-industrielle germanique. Il faut sentir en historien le bonheur d'être Allemand en ces temps privilégiés où l'Esprit n'avait qu'à se mirer dans son miroir berlinois pour y jouir de toute la complétude imaginable. Hegel venait de donner aux Allemands encore désunis l'image de l'Être Un de l'Histoire occidentale, philosophique et politique, se relevant dans l'unification en marche d'un Empire dont Napoléon venait, lui, à peine de soulever l'ubris par le vase communiquant de son propre échec. Le fils surdoué d'un pasteur de Naumburg avait bien le droit, alors, de tenir un langage, c'est à dire des tonalités et un style que seul se permettra quelques décennies seulement plus tard quelqu'un comme Hitler parlant du Reich millénaire. Non qu'il le fît aussi simplement que cela, mais l'anéantissement qu'il fit subir à l'historisme valut alors fondation, pour prophétique qu'elle demeurait, de la folle aventure nazie. Nietzsche est un homme extraordinaire par ce fait que, coupable, il ne porte en vérité aucune culpabilité, il est textuellement porteur d'une Parole historiale, ce qui signifie concrètement que son Dire se confond totalement avec le destin du " peuple " dont il dit la langue (1).
Or la chose n'est pas allemande en elle-même, elle est bien occidentale et métaphysique. C'est aussi une raison pour laquelle Nietzsche reste moralement inattaquable : il ressentait en réalité le plus grand mépris pour son propre " peuple ", et son divorce d'avec Wagner est plus que l'illustration d'une déception esthétique, voire, ce qui revient au même, philosophique. De plus, il faut garder à l'esprit que Nietzsche est resté durant toute sa vie consciente un penseur confidentiel, d'abord le fou du roi Wagner et de sa cour, puis un philologue lu par quelques dizaines de savants. Nietzsche à peine mort, les campagnes médiatiques et les manipulations des textes par sa sœur Madame Förster-Nietzsche ont, certes, démultiplié l'accès du public à la pensée du maître, mais on peut gager que jusque bien après la Deuxième Guerre Mondiale, la compréhension globale du message nietzschéen non seulement n'aura pas progressé, mais il est sûr qu'en se diluant en direction d'un lectorat factice - même la Werhmacht avait fait imprimer des textes à l'intention de ses soldats et de ses officiers - les ouvrages du penseur se sont littéralement vidés de leur sens. Aujourd'hui la situation a changé, on peut aller jusqu'à résumer la pensée de Nietzsche, ou du moins, de laisser apparaître les moments essentiels d'une écriture dont la forme aphoristique demeure un moyen habile de brouiller certaines pistes. La fascination que les sciences exerçaient sur le philosophe pouvaient transpirer dans de petites incises, voire de petits paragraphes, sans affecter en profondeur le trait essentiel du Dire. Mais elle ne lui permit pas de systématiser sa pensée autrement qu'à travers une sorte de rythme qu'avait fini par prendre la succession de ses aphorismes.
Nous ne considérerons ici que ce que l'on peut désigner comme l'anéantissement brutal de l'historisme, un acte qui pouvait alors passer pour un acte de barbarie tant était grande la violence et la radicalité de l'attaque. En réalité c'est l'Histoire qui sombre corps et bien dans cette critique. Nietzsche ne s'en prend aux historiens et à l'historisme que parce qu'ils se sont faits les complices d'un vaste mensonge autour de l'idée de la Raison de l'Histoire ou de l'Histoire comme destin de la Raison. Les plus intelligents tels le propre mentor de Nietzsche, Jacob Burckhardt, s'inclinent le cœur serré, sans pour autant condamner leur discipline au nom d'une éthique dont l'humanisme se force une place inattaquable à l'intérieure même de la critique nihiliste : " on a le droit et le devoir de constituer en propriété autonome, ce qui du passé répond individuellement à chacun et il est possible d'y trouver une source de bonheur49 ". Mais le vieux sage de Bâle prend toute la mesure de ce qui vient de se passer dans les aphorismes des Considérations Inactuelles : " Cette fois vous allez saisir de nombreux lecteurs en mettant rudement sous leurs yeux un malentendu vraiment tragique : l'antagonisme entre la Science historique et le Pouvoir (ou l'existence), de même que l'antagonisme entre l'énorme accumulation du savoir assembleur et les impulsions matérielles de l'époque50 ". L'Être a dévissé. Nietzsche met sous les yeux de ses contemporains un phénomène gigantesque dans son essence et dans ses conséquences : la science historique ne mène nulle part, elle a perdu son chemin en perdant sa place dans l'Être, son sens. Cet événement n'est pas un fait, c'est un dévoilement insolent, prononcé de l'intérieur même de la Science historique et que cette dernière ne peut pas réfuter. Il est vrai que quelques décennies plus tôt un certain Karl Marx avait déjà fait la moitié du chemin en dénonçant la fausseté du modèle idéologique courant. L'Histoire était déjà devenue matière à critique, mais d'une critique (la Critique de la Critique critique) qui ne faisait que renverser le sens des dogmes, du Dogme hégélien, sans aller au fond. Et quel est ce fond ? Burckhardt le saisit immédiatement, la Science de l'Histoire ne peut pas être en tant que telle, elle ne peut jamais qu'offrir une matière à l'appropriation individuelle du passé. Qu'une telle appropriation puisse devenir une source de bonheur, voilà qui ne concerne, semble-t-il, que les sentiments pitoyables d'un vieil homme qui a construit son " existence " autour de la Science historique. Et pourtant ce qui suit indique que le sage a compris dans toute son extension le danger que représente l'entrée en contact de ces deux masses " critiques ", l'énorme accumulation du savoir assembleur et des impulsions matérielles de l'époque. Burckhardt comprend d'avance la possibilité qui se dessine de n'importe quelle synthèse fictive, de n'importe quelle Aufhebung scénique d'une telle opposition. De fait, le nazisme ne sera que la reprise en grand de la pièce mise en scène par un certain Bismarck dans l'euphorie fantasmatique de la Germanie retrouvée.
Tout est fou, reconnaît Burckhardt. Et pourtant cette folie peut devenir source de bonheur alors que tout menace de partout, d'une menace dont le sage a une vision claire. Elle est pour lui une évidence prophétique parce qu' elle surgit d'un antagonisme absolu : l'Être et l'Histoire ont cessé d'entretenir des relations dialectiques, chacun est retourné dans son camp et que la guerre commence. Que vient faire, dans ce tableau d'Apocalypse, le bonheur individuel ? Il est la laïcisation réelle du savoir, le retour à l'usage singulier et réel de la théorie en tant que contemplation. Les documents historiques sont à usage personnel et ils sont assimilables dans l'existence, dans la vie présente. Dans la même lettre à Nietzsche, Burckhardt avait déjà fait un aveu inouï dans ce siècle dégoulinant d'idéologie : " J'ai fait tout mon possible pour les (ses étudiants) initier à l'assimilation personnelle du passé - quel qu'il fût ". Burckhardt formait des Surhommes. On ne peut pas se dérober à la représentation historique de la charge religieuse et idéologique qui reposait alors sur les épaules de n'importe quel pédagogue. En plein milieu du Vingtième Siècle cette charge a à peine diminué alors que la bombe historiale dessinée par le professeur bâlois vient de ravager la planète. Que l'on mesure alors ce que signifie en plein Dix-Neuvième un tel cri de ralliement pédagogique : il faut initier à l'assimilation personnelle du passé ! Même un Jacques Chancelle effaré dirait : -" et Dieu dans tout ça ? ". Ce paradoxe nous dessine un croquis " historique " intéressant de ce siècle de tous les antagonismes. Si nous ne faisons pas de Jacob Burckhardt ni de Nietzsche d'ailleurs, des exceptions sociologiquement surnaturelles, de véritables Surhommes avant la lettre, alors nous saisissons mieux l'expression de Freud : " L'avenir d'une Illusion ". Car la vision de Burckhardt, ainsi que ce qu'on pourrait nommer pour faire vite la pédagogie du Surhomme, étaient en réalité une illusion collective, n'en déplaise à Nietzsche. A la veille de l'unification du Reich il y eut bel et bien une Allemagne des Professeurs -celle-là même que fustige Heine lorsque ces mêmes Professeurs vont débouler sur les champs de bataille de Reischoffen et de Sedan - une Allemagne bourgeoise-humaniste rarement considérée dans son projet historique, un projet peu différent en somme de celui qui anime les républicains français de la même époque. Il y a bien une face lumineuse de ce siècle, une face illuminée par l'idée de la liberté individuelle au sein de la République. Or, de notre côté du Rhin ce projet se réalisait en dur cependant que Berlin produisait des " esprits ", comme si la menace républicaine en Europe appelait d'abord en réponse le rassemblement des forces intellectuelles, et des forces formatées par la théorie toute fraîche de la liberté, telle qu'elle se retrouve systématisée, par exemple, chez Schelling, mais aussi telle qu'elle surgit dans les forces politiques du socialisme marxiste ou anarchiste. Nietzsche n'est pas, en son siècle, le monstre qu'on croit. Les foyers artistiques et intellectuels autour desquels il gravite alors, celui de Wagner mais aussi celui de Burckhardt ou de Rhode, sont des entreprises où l'on usine le matériau liberté, où l'on coule, rectifie, tourne, fraise et alèse des mécanismes très délicats de conceptualisation de l'histoire et du projet même de cette liberté. Nietzsche ne s'en détournera massivement que parce qu'il voit de son œil d'aigle la vanité de la situation de ces bourgeois patentés par l'Etat. Toute l'histoire des philistins des Considérations Inactuelles n'est qu'une description lucide, une répétition en somme, de ce que saisit Marx en tant que malentendu fondamental autour de la fonction réelle des pédagogues de la société européenne, celle de l'idéologie. Que Nietzsche psychologise sa propre critique ne fait qu'indiquer le sens dans lequel il va lui-même articuler sa pensée, mais aussi un sens très généralement exprimé tel qu'il se trouve dans la lettre de Burckhardt que nous venons de citer, le sens de la liberté individuelle.
Au fond, la bourgeoisie européenne était en train d'accomplir cette Révolution que Marx désignait avec un certain mépris comme une révolution bourgeoise. Il y a une certaine cécité chez le fondateur du communisme, ou plutôt un point aveugle dans toute sa construction théorique, c'est précisément celui de la relation de l'individu à la collectivité ou aux classes sociales. Le texte d'un Ernst Jünger51 montre avec éclat que l'adversaire acharné de l'aristocratie européenne, mais aussi celui d'une révolution métaphysique totale, n'est ni le penseur d'un socialisme quelconque, ni les prolétaires eux-mêmes, mais la bourgeoisie, le monde bourgeois. Or de ce monde bourgeois, en tant que son essence, Jünger retient surtout la fiction de l'individu ou de l'individualisme. L'ontologie qui se masque derrière la critique de Jünger ne rejoint ni celle du Surhomme, ni celle du Berger de l'Être de Heidegger, elle postule une transcendance nouvelle, celle du retour des Titans, les tueurs de dieux, mais aussi les manipulateurs de l'individu. Elle emprunte pourtant à l'un le style et l'ampleur du ton, à l'autre un transcendantalisme " humanisé " sous les traits du Travailleur. Pour en revenir à Marx, qu'on ne peut pas expédier ainsi en quelques lignes, il y a bien une contradiction fondamentale dans toute sa pensée. Certain diront que c'est ce qui en fait une pensée. Bref, d'un côté le fondateur du communisme se dit l'héritier du matérialisme anglais et français, qui comme il le rappelle lui-même dans La Sainte Famille52, descend en ligne directe du nominalisme médiéval. Je fais ce rappel parce que le dogme central de ce nominalisme est la nature singulière de tous les êtres de la nature, même des mots : on ne voit pas comment peut naître une idéologie sur un tel fondement, sauf à faire donner les thèses freudiennes du transfert et du contre-transfert tels qu'y fait allusion abondamment Althusser dans son petit écrit sur Machiavel53. D'un autre côté, il manipule constamment un substantialisme spinoziste soigneusement maquillé sous le concept de " conditions " : la conscience de l'individu n'est que la traduction intellectuelle des mouvements de la matière, de la situation historique et de ses conditions, mais, elle accède tout d'un coup (de force) à la conscience de soi, comme si, mais ont sait où Marx va chercher ce processus, comme si la conscience de soi naissait au détour d'un moment de l'histoire (de la conscience). On peut souligner ici plus qu'une certaine admiration qui transpire dans tout son texte, des Manuscrits de 44 jusqu'au Capital, et que Karl Marx voue à cette bourgeoisie dont il ne manque jamais de faire le principe de toute la révolution qui aboutit à la naissance du prolétariat et donc aux fondements de la prochaine révolution. Mais là encore il y a un malaise, car cette révolution n'a de chance de s'accomplir que lorsque le taux de profit aura atteint le niveau zéro de sa tendance baissière. Autrement dit que lorsque le capitalisme bourgeois se sera critiqué lui-même. En dernière analyse c'est la bourgeoisie qui mène la danse de bout en bout, ce que démontre admirablement l'histoire réelle de la fin des " communismes " étatiques. Et en cela, elle est aussi le frein à la révolution des Titans comme elle a été responsable de l'anéantissement du nazisme. Ernst Jünger a vécu jusqu'à 102 ans, tard dans les années 90, et n'a jamais commenté le beau retour de la bourgeoisie à travers le monde après la grande catastrophe hitlérienne. Cela ne signifie pas que son utopie ne s'est en rien réalisée, car le monde est bien devenu le monde du Travailleur, mais pas du travailleur socialisé en ruche hiérarchisée. Le Travailleur est en passe de devenir un nomade, propriétaire de ses compétences et en fait, un chasseur en course sur le marché du travail. Les capitalistes les plus lucides ne perdent pas leur temps à penser qu'il est possible d'éviter un évergétisme universel. La disparition à terme du travail non hautement qualifié laisse déjà entrevoir une croissance exponentielle du nombre de sans-emploi dont il ne restera qu'à faire, ou refaire, une plèbe, à défaut de conserver des moyens de les exploiter de manière profitable. Mais nous reviendrons sur ce délicat sujet à propos duquel il faut cependant déjà avertir le lecteur qu'on ne pourra plus raisonner dans le futur comme on le fait encore dans la terminologie que nous venons nous-même d'employer dans ce paragraphe.
Cette maldonne à propos de l'idéologie et du véritable rôle de la bourgeoisie dans son époque, a ouvert la porte à l'interprétation léniniste des découvertes de Marx, interprétation, que le maître, il est vrai, a largement favorisé de son vivant, notamment dans le Programme de Gotha. Il est vrai par ailleurs, que Marx a plus souvent parlé de partage de la connaissance que de consciencisation des masses. En même temps qu'il semblait piégé par le schéma historique hégélien, pour tout dire eschatologique, il reconnaît dans cette même histoire un processus d'aliénation, cette perte de conscience réelle que Lukacs a si bien nommé la réification. Mais pour lui, l'histoire est un " fumier " dont il a voulu à toute force identifier des lignes de forces, des directions et des vecteurs pour les gaz qui s'en échappent, d'où son respect pour ainsi dire forcé pour les maîtres réels de ces vections, les capitalistes. Il y a chez Marx une sorte d'instinct aristocratique qui le lie fortement à Hegel et à la " réalité rationnelle ". D'où un mépris souvent agaçant pour des penseurs de grand courage et pas si stériles qu'il veut bien le suggérer comme Proudhon et surtout Saint Max, Max Stirner. Marx va hésiter longtemps avant de tirer à boulets rouges sur le pauvre Stirner dans L'Idéologie Allemande, un texte qui, il est vrai, ne sera pas publié de son vivant. Mais là où une telle critique avait vraiment sa place, à savoir la Sainte Famille, il n'est pas question un instant de ce philosophe et jeune hégélien célèbre qui sera exécuté quelques années plus tard de la pire façon. Nietzsche lui réservera le même sort ainsi que la plupart des grands penseurs à l'exception notable de Ernst Jünger qui a surtout trouvé commode de prendre sa philosophie pour modèle de ce qu'il se considérait être lui-même, à savoir un anarque, notion qui n'a d'équivalent que dans le Prince lui-même de Machiavel. Mais certainement pas pour les mêmes raisons. Pour Marx le cas était grave, parce que Stirner ne fait rien d'autre que d'achever la critique entamée par Feuerbach en la poussant dans ses limites, en fait les limites tracées par Fichte quelques décennies plus tôt. Cette pensée aux limites est très vite devenue une mauvaise fréquentation dans cette Europe euphorique, où toutes les grandes pensées, à l'exception de Nietzsche et encore, étaient des pensées sociétales. Personne, encore une fois à l'exception de Nietzsche et aussi Kierkegaard54, ne veut raisonner hors société dans un siècle où le sociétal se coule lui-même dans le béton de l'Etat. C'est pourquoi il était téméraire pour un jeune hégélien comme Stirner, arrivé légèrement trop tôt, de s'en prendre directement au dogme de la nature sociale de l'être humain. Il existe une différence historique radicale et rarement remarquée, il faudrait dire un mur historial, entre la constellation qui gravite autour de Hegel, disons les penseurs officiels de l'idéalisme allemand et de sa critique, et puis le monde confidentiel et interlope qui protège et permet la mise en orbite de la critique nietzschéenne de cette même constellation. Au point que ce qui reste pour moi un des mystères de la pensée de ce siècle, mais vous en savez sans doute plus long que moi, est la mesure dans laquelle les deux mammouths se connaissaient et se lisaient. Il est certain que Nietzsche a lu Marx, certaines allusions dans Ecce Homo en font foi. Le contraire demeure pour moi totalement mystérieux. Mais je n'ai pas lu tout Marx, en particulier toute sa correspondance qui n'était pas disponible à l'époque où moi je l'étais pour une telle lecture. Quoiqu'il en soit, il me paraît inconcevable que Marx n'ait pas eu vent des publications de Nietzsche, d'une manière ou d'une autre. Son silence à ce sujet me paraît aussi important que le fameux silence de Heidegger, d'autant que le style de l'essentiel de l' œuvre " exotérique " de Nietzsche, ses " Considérations Intempestives ", ressemblent à s'y méprendre au style caustique de Marx, forme et fond.
Tant il est vrai que la pensée de Nietzsche est une véritable catastrophe pour le " système " de pensée marxien. Une catastrophe d'autant plus grave que les racines métaphysiques (ou anti-métaphysiques) de Marx sont les mêmes que celles de Nietzsche : l'atomisme de Démocrite et la pensée héraclitéenne du mouvement sans fin. Faut-il mentionner Machiavel ? Je peux sentir d'ici la souffrance d'une grande intelligence aux prises avec un adversaire dont la pensée s'avère tellement plus fidèle à ces propres sources. Il fallu, sans doute, reconnaître, cœur crevé, que la Lutte de Classe n'était qu'une resucée onto-théologique même si l'aristocratisme apparent de Nietzsche permettait à Marx de se classer sans remords dans le camp adverse. Etant donné les dates où cela aurait pu se produire, cela pouvait passer pour une simple affaire de stratégie politique, et Marx a pu se sentir autorisé sans trop de dégâts à se réfugier dans la position fameuse de Debord : " pas de dialogue avec les cons ". L'affaire paraît sérieuse, et elle l'est parce que les deux hommes vont chacun peser lourd dans la balance de l'époque qui va suivre leur non-débat, conséquence logique du fait que chacun pense dans la limite de ce que pense l'autre et contre cette limite. Ce qu'on peut dire, à mon sens, au sujet de ce chassé-croisé de pensée, est que Nietzsche est marxiste là où Marx est nietzschéen. Nietzsche se retrouve marxiste dans ses errements scientistes et évolutionnistes que ne vient border que tardivement par le coup de force de la volonté de puissance, la thèse de l'éternel retour du même. Quant à Marx, il se méfie précisément de la Science et de l'Evolution en soumettant tous les deux à la volonté de puissance du prolétariat. Ce prolétariat, par ailleurs, n'est souvent à son corps défendant que l'Homme en tant que tel, le Robinson qui invente l'œil pour voir et peint des chefs-d'œuvre pleins de mystères. Le Prolétariat est bien une figure de l'histoire, identique dans sa fonction à la figure du Travailleur de Jünger, et cette fonction est à chaque étape de l'Histoire, d'identifier conceptuellement, c'est à dire en définitive dans le langage de la métaphysique, la nature humaine. Le prolétaire en Zarathoustra.
" Les âmes de législateurs et de tyrans, capables de fixer un concept, de le retenir ; les hommes doués d'une telle énergie spirituelle qu'ils savent cristalliser et presque éterniser ce qu'il y a de plus fluide au monde, l'esprit : voilà les hommes doués au suprême degré pour le commandement. Il disent : " Je veux que l'on voie telle et telle chose ! Je veux qu'on la voie précisément de telle façon ! Je le veux pour telle fin et pour cette seule fin ! " Cette race de législateurs est celle qui, nécessairement a exercé de tout temps la plus forte influence ; c'est à eux que l'on doit toutes les formes caractéristiques de l'humanité ; ils en sont les sculpteurs, et les autres (le plus grand nombre) ne sont à côté d'eux que de l'argile "55. La mort de Dieu en neuf lignes, la mort de Dieu, celle de l'Histoire et de son ombre l'historisme. Ce fragment, le 137, aura désormais la même valeur, c'est à dire la même puissance créatrice de forme que le Cogito. Il comprend le cogito au sens où il concède à l'homme seul la puissance de fixer des concepts, de les sortir du néant dans une finalité qui leur est propre, aléatoirement propre c'est à dire conforme à la volonté singulière de ce potier de l'histoire. Il dissipe donc en même temps la malédiction que représente la valeur logique du concept de Dieu pour toute construction conceptuelle, en réalité pour toute volonté de façonnage. C'est que Dieu lui-même n'est qu'une forme sortie des doigts agiles et puissants des législateurs et des tyrans, une forme dont la force était la garantie de sa pérennité. En même temps il balaye par une force d'évidence incontournable tout le Saint-Frusquin des idéologies et des conditions matérielles dans le quel se sont embourbés les meilleurs d'entre nous, et en particulier Marx et Engels.
Cette force d'évidence a, cependant, son revers, sa face cachée qui est aussi son terrible secret qui en fait une malédiction : elle est toute entière pétrie du refus pour l'humanité de s'en remettre à quelque transcendance que ce soit. A partir de ce fragment, il n'y a plus ni père, ni Dieu ou destin, tout le poids de l'existence retombe en totalité sur les épaules de l'Homme. Qu'il existe par ailleurs des hommes " d'exception ", des législateurs et des tyrans, ceux qui tissent les toiles idéologiques et pétrissent l'argile des masses, cela n'est ni un mystère ni un miracle ni surtout une donnée de la nature : c'est un résultat auquel chaque génération de notre civilisation est confronté et par rapport auquel elle se définit en terme de soumission, de compromission, de complicité ou de révolte. Le grand mérite de Machiavel est d'avoir analysé avec une grande acuité comment s'établissent les relations qui font et défont le pouvoir, mais il n'a pas bien saisi l'intrication des différentes couches sédimentaires de ce que les Princes, c'est à dire les législateurs et les tyrans, laissent derrière eux. Il raisonne toujours comme si le Prince qui conquiert une nation avait toujours affaire au vide, donnant à la religion un statut à part. Machiavel se leurre lui-même, à moins qu'il ne fasse de l'ironie, lorsqu'il affirme des principautés ecclésiastiques qu'elles vivent " sûres et heureuses " parce qu'elles ne sont pas gouvernées sinon par la main de Dieu lui-même. Ce qu'il raconte dans le même chapitre XI démontre d'ailleurs le contraire. Ce qu'il ne peut pas concevoir, apparemment, c'est que la religion est en elle-même une législation forgée dans un passé déjà lointain, c'est à dire quelle représente déjà la volonté d'un législateur. C'est ainsi, et ainsi seulement, que se forgent les classes sociales, à savoir dans le partage, l'application ou le refus calculés des décisions antiques des anciens décideurs. Et personne n'est dupe. Toute tradition se rapporte à une lignée ou plutôt à un jeu de lignées, jeu étant pris ici dans ses deux sens : celui de pratique ludique et celui d'ensemble, comme on dit un jeu de clefs. Il faut se rendre à l'évidence, l'histoire est faite de décisions d'hommes seuls et des seuls hommes, les éléments conditionnels, aucune condition si nouvelle ou si bouleversante qu'elle soit, ne peuvent modifier ce point.
Il est pourtant un point sur lequel les deux grands hommes, on ne sait pas, pour l'instant, pour quel motif, se sont tous les deux gravement trompés. Marx comme Nietzsche tenaient l'un l'argile, l'autre le prolétariat, en piètre estime. En ce qui concerne Nietzsche, on pourrait dire que son audace nihiliste, c'est à dire sa manière presque suicidaire d'anéantir tout ce qui ressortit du Christianisme, l'autoriserait presque à cette manipulation quasi métaphysique qui consiste à réduire toute une partie de l'humanité en quelque sorte à de la matière, à de l'argile. Mais c'est qu'il s'agit bien d'une manipulation métaphysique dont il a besoin pour éterniser son retour du même. C'est bien pourquoi on ne comprend en définitive pas grand chose aux motifs de sa critique si virulente de l'existant, et en particulier du siècle dans lequel il a vécu. Car que fait le grand homme sinon donner son absolution à une Histoire des Grands Hommes dont il a sous les yeux un exemple on ne peut plus grandiose? A une histoire dont les valeurs qu'il critique n'ont jamais été, c'est ce qu'il dit si bien, que l'arsenal des guerriers dont il a la nostalgie. Faudrait-il croire que le philosophe du Zarathoustra n'a, en réalité, réagi que devant la menace socialiste, dans l'étroit chenal de ces quelques décennies où les ouvriers européens ont fait sentir leur poids dans le jeu des grands ? Toujours l'Histoire (Historie) : Nietzsche - Bismarck. Bismarck était le défenseur discret mais acharné de la monarchie et de l'aristocratie des Junker face à la montée inéluctable de la gauche du Reichstag soutenue par défaut par une opposition libérale-bourgeoise inconsciente de ses véritables intérêts (dirait Marx). Or c'est par la classe intellectuelle que cette bourgeoisie se manifeste, une classe sociale qui je le rappelle, sera brocardée et condamnée à la disparition le siècle suivant par Jünger. C'est du sein de la petite bourgeoisie Souabe que sont sortis les grands " idéologues " de l'idéalisme et de sa critique : la biographie de Hegel ne montre pas seulement que le philosophe était un homme d'une ambition séculière démesurée mais encore que Sans-Souci s'en est beaucoup soucié. Hegel était bel et bien le protégé de la Cour, et donc l'homme par qui l'Allemagne devait penser. Voilà qui ne pouvait que faire de l'ombre à des aristocrates comme Schopenhauer, à des petits-bourgeois extrémistes comme Nietzsche. En résumé, le tableau est le suivant : dans les années 1870 Bismarck réalise le rêve de Machiavel pour l'Italie. Nietzsche peut s'adonner, comme bien d'autres Allemands, à tous les fantasmes de la puissance atteinte et de ses promesses. Au point que même Bismarck, décidément trop hégélien, deviendra un obstacle que la nouvelle Cour devra éliminer pour forcer la cadence de la militarisation et l'évolution qui conduira inéluctablement vers les conquêtes Pichrocolesques de 1914 - 1945. Le Reich de Mille ans et son conducator étaient déjà dans l'air. La bourgeoisie libérale, de son côté, avait à faire face à la réalité du marché, et en particulier à celui du travail : on pouvait bien faire tirer de temps en temps sur les ouvriers, mais par rapport à un marché qui s'ouvrait enfin sur le monde cela n'avait pas de sens. L'économie ne pouvait plus se passer d'un compromis, un compromis que Bismarck lui-même avait contribué à forger. Bref, tout le non-dit de la pensée " sociale " de Nietzsche est dans le refus enragé de tout ce qui se passait dans les bassins de la Rhur et de Westphalie, de la croissance d'une Allemagne entachée de démocratie où l' " argile " venait de reprendre la parole, cinq siècles après le bain de sang de sa dernière révolution.
Il ne s'agit pas ici d'une analyse de l'idéologie allemande mais d'une interprétation des écrits de Nietzsche et de sa position par rapport à l'université allemande et à la classe bourgeoise. Sa critique de cette bourgeoisie est en réalité la critique du fait que du sein de la masse surgissent des hommes qui parlent de la liberté réelle, de celle qu'ils peuvent désormais invoquer au Reichstag par députés interposés. Car l'argile, comme la matière artistotélicienne, n'a que la puissance, pas la réalité. Ce que Nietzsche rate complètement en tant que théoricien et même en tant que nihiliste, c'est la position des êtres d'argile. Il se comporte en réalité avec les masses dont il parle comme on se comporte avec un chien dont on veut se débarrasser et qu'il convient donc de déclarer enragé. Or le peuple est constitué d'individus pourvus de conscience et même de la parole. Les individus qui le constituent s'inscrivent selon leur liberté dans l'une ou l'autre lignée historique représentée par les uns ou les autres. Qu'ils s'inclinent devant les conditions dans lesquelles ils naissent en décidant de poursuivre dans la même voie, voire dans la même impasse que leurs ancêtres, qu'ils décident de se battre en suivant la Tradition de la révolte ou même qu'ils décident de se marginaliser de toutes les manières que l'on veut, ces individus demeurent tous des hommes, les mêmes hommes en valeur ontologique que n'importe quel conducator. Ce qui manque totalement dans la pensée de Nietzsche, le trou théorique, c'est Rousseau. Il y a bien d'une part des intuitions poétiques sur l'espace dans lequel vivent les hommes et dans le parcours de Zarathoustra on peut lire une socio-géographie, ou pour reprendre un expression de Debord, une psychogéographie. La plèbe vit dans la plaine, Zarathoustra vit seul dans la montagne. Les individus des masses se tassent les uns contre les autres, leur caractère fondamental est la grégarité alors que le Surhomme est un nomade solitaire, etc.. D'autre part Nietzsche admet quelque chose comme l'évolution, une évolution darwinisée à outrance pour les besoins de son système déguisé. Mais Nietzsche n'entend rien à l'évolution des formes politiques selon le degré d'une sédentarité qui s'intensifie avec le temps. Entre la Grèce de Périclès et l'Allemagne de Bismarck, il n'y a au fond pour lui guère de différence, et pendant sa lune de miel avec Wagner, il n'est pas loin de penser que le jeu tragique entre Dionysos et Apollon pouvait désormais avoir lieu entre le Rhin et l'Elbe. Une illusion qui ressemble à s'y méprendre à celle de Hölderlin et de Heidegger. En fait, Nietzsche a bien détruit l'Histoire, mais seulement à moitié, c'est à dire celle qui est concernée par l'historisme. Contrairement à d'autres penseurs de son siècle comme Engels ou Schelling, il ne s'intéresse pas du tout à la préhistoire où aux découvertes ethnographiques toutes récentes. A la limite, l'affairement d'un Humboldt devait lui paraître du dernier ridicule. Et pourtant Engels avait flairé toute l'importance du mystère de la naissance de l'agriculture, c'est à dire de ce qui s'est passé pendant l'époque néolithique. Mais la position de Nietzsche est décidément trop métaphysique.
Marx quant à lui, a commis une erreur d'appréciation du même ordre. Il fallait faire marcher le schéma historique - eschatologique, il fallait imaginer les conditions d'une lutte de classes, or celle-ci demanderait du temps parce que la formation du prolétariat demanderait du temps. Celui qui avait fait remarquer que toute formation exigeait par avance des hommes formés ne se rendait pas compte que la thèse d'une nécessité de la formation reprenait tel quel l'alibi de la science historique bourgeoise. Il savait parfaitement que toute formation devait, en dernier recours, s'appuyer sur une idéologie, parce que la théorie implique aussi que l'idéologie reste la nécessité interne de toute relation sociale non communiste. Tout tourne ici autour du rôle du Parti Communiste et de celui de l'Internationale. Or il semble que Marx se soit leurré de la même manière que Debord, et bien d'autres dans l'Histoire, en pensant possible la réunion d'hommes parfaits, l'organisation d'une multiplicité d'égaux capables de concevoir et de diriger une stratégie de prise de pouvoir. Rappelons à cette occasion qu'il avait écrit le Capital comme un manuel de formation des ouvriers, affirmant froidement que son livre était accessible à n'importe qui. Ce qui n'est pas faux dans l'absolu mais se révèle comme une véritable farce dans une réalité où les ouvriers aliènent l'essentiel de leur énergie dans le travail salarié. L'erreur plus fondamentale est dans le concept même de lutte de classe : lutte il y a, il y a toujours eu et il y aura tant qu'elle sera nécessaire. Lutte de classe contre classe c'est tout autre chose, c'est à dire qu'il ne peut pas s'agir d'autre chose que d'un conflit politique tout à fait classique. Je veux dire par là que si une classe sociale (à supposer que cela existe) se constitue en adversaire d'une autre classe, nous nous trouvons tout simplement devant le cas de figure d'un conflit banal dont l'issue politique n'est en rien différente a priori de celle d'un conflit entre peuples ou entre familles ou clans. C'est tout simplement l'exercice de la force, de la violence ou de l'action politique quelles qu'elles soient en vue de s'emparer du pouvoir, ce qui est l'essence même du politique. Le destin du communisme expérimental soviétique montre une chose avec une assez grande certitude, c'est que la société socialiste qui devait servir de transition vers le communisme s'est transformée rapidement en une société de classes en tout point comparable à n'importe quelle société bourgeoise. L'implosion finale n'est en rien différent d'une crise de régime quelconque : le Prince-Parti avait perdu la confiance de son peuple. Faut-il ajouter que la seule idée d'un délai historique, cette idée que le salut du Prolétariat allait demander non seulement une lutte révolutionnaire, mais que cette lutte ne saurait se passer d'une véritable éducation des masses, un projet qui n'avait rien de différent de ce pensaient des humanistes républicains et bourgeois comme Condorcet ou Jules Ferry, faut-il préciser qu'il implique un véritable sacrifice de générations ? En dernier ressort le malheur était le vrai programme de ces masses dont seule l'Idée possédait une valeur morale et.. conceptuelle.
Mais l'essentiel n'est pas là. Le secret de l'échec du communisme est dans l'absolution donnée à une conception historique de l'être humain, une conception évolutive qui ne pouvait tenir que sur la base d'une évolution métaphysique, c'est à dire bourgeoise. L'inégalité sociale dont il avait scientifiquement analysé les fondements historiques et économiques était devenu subrepticement une inégalité d'essence : dans le présent de son époque, le prolétariat n'était pas prêt, ni à la lutte directe ni à l'exercice du pouvoir. Or l'impératif du Programme de Gotha, celui de la dictature du prolétariat, montre par définition que le pouvoir dont il est alors question est sous son masque le pouvoir bourgeois, le pouvoir de se substituer à l'oligarchie régnante. Qu'est-ce à dire sinon que les véritables aspirations du prolétariat comptent pour du beurre, parce qu'elles n'existent tout simplement pas dans l'esprit du théoricien. Plus profondément encore, le prolétaire n'est qu'un semi-idiot, dont l'aveuglement et l'inconscience vont justifier, quelques décennies plus tard des traitements peu éloignés de ceux que les nazis ont infligés à des millions de semi-idiots. Et pour cause, ils ne sont pas passés par le travail du concept, ils ne se sont rien approprié de tous les mécanismes tactiques et stratégiques de la métaphysique et de la religion, à savoir des mécanismes de la prise du pouvoir et de son maintien. Même Marx s'est laissé piéger par le double-bind mortel du Socratisme : le Bien c'est le Savoir, Savoir qui est savoir du non-savoir. Marx a cru comme tous les philosophes sans exception qu'il fallait apprendre à ne rien savoir, ce qui signifie tout crûment qu'il excluait, encore une fois comme la grande majorité des métaphysiciens, la majorité des êtres humains de tout statut ontologique. Son scepticisme foncier lui permettait certes de fondre toute l'humanité de son siècle dans une Préhistoire non communiste où, comme dirait Hégel, toutes les vaches sont noires. Mais cette pirouette ressemble à s'y méprendre à la fiction des arrières-mondes de n'importe quelle religion.
Or la chose n'est pas allemande en elle-même, elle est bien occidentale et métaphysique. C'est aussi une raison pour laquelle Nietzsche reste moralement inattaquable : il ressentait en réalité le plus grand mépris pour son propre " peuple ", et son divorce d'avec Wagner est plus que l'illustration d'une déception esthétique, voire, ce qui revient au même, philosophique. De plus, il faut garder à l'esprit que Nietzsche est resté durant toute sa vie consciente un penseur confidentiel, d'abord le fou du roi Wagner et de sa cour, puis un philologue lu par quelques dizaines de savants. Nietzsche à peine mort, les campagnes médiatiques et les manipulations des textes par sa sœur Madame Förster-Nietzsche ont, certes, démultiplié l'accès du public à la pensée du maître, mais on peut gager que jusque bien après la Deuxième Guerre Mondiale, la compréhension globale du message nietzschéen non seulement n'aura pas progressé, mais il est sûr qu'en se diluant en direction d'un lectorat factice - même la Werhmacht avait fait imprimer des textes à l'intention de ses soldats et de ses officiers - les ouvrages du penseur se sont littéralement vidés de leur sens. Aujourd'hui la situation a changé, on peut aller jusqu'à résumer la pensée de Nietzsche, ou du moins, de laisser apparaître les moments essentiels d'une écriture dont la forme aphoristique demeure un moyen habile de brouiller certaines pistes. La fascination que les sciences exerçaient sur le philosophe pouvaient transpirer dans de petites incises, voire de petits paragraphes, sans affecter en profondeur le trait essentiel du Dire. Mais elle ne lui permit pas de systématiser sa pensée autrement qu'à travers une sorte de rythme qu'avait fini par prendre la succession de ses aphorismes.
Nous ne considérerons ici que ce que l'on peut désigner comme l'anéantissement brutal de l'historisme, un acte qui pouvait alors passer pour un acte de barbarie tant était grande la violence et la radicalité de l'attaque. En réalité c'est l'Histoire qui sombre corps et bien dans cette critique. Nietzsche ne s'en prend aux historiens et à l'historisme que parce qu'ils se sont faits les complices d'un vaste mensonge autour de l'idée de la Raison de l'Histoire ou de l'Histoire comme destin de la Raison. Les plus intelligents tels le propre mentor de Nietzsche, Jacob Burckhardt, s'inclinent le cœur serré, sans pour autant condamner leur discipline au nom d'une éthique dont l'humanisme se force une place inattaquable à l'intérieur même de la critique nihiliste : " on a le droit et le devoir de constituer en propriété autonome, ce qui du passé répond individuellement à chacun et il est possible d'y trouver une source de bonheur" (2). Mais le vieux sage de Bâle prend toute la mesure de ce qui vient de se passer dans les aphorismes des Considérations Inactuelles : " Cette fois vous allez saisir de nombreux lecteurs en mettant rudement sous leurs yeux un malentendu vraiment tragique : l'antagonisme entre la Science historique et le Pouvoir (ou l'existence), de même que l'antagonisme entre l'énorme accumulation du savoir assembleur et les impulsions matérielles de l'époque" (3). L'Être a dévissé. Nietzsche met sous les yeux de ses contemporains un phénomène gigantesque dans son essence et dans ses conséquences : la science historique ne mène nulle part, elle a perdu son chemin en perdant sa place dans l'Être, son sens. Cet événement n'est pas un fait, c'est un dévoilement insolent, prononcé de l'intérieur même de la Science historique et que cette dernière ne peut pas réfuter. Il est vrai que quelques décennies plus tôt un certain Karl Marx avait déjà fait la moitié du chemin en dénonçant la fausseté du modèle idéologique courant. L'Histoire était déjà devenue matière à critique, mais d'une critique (la Critique de la Critique critique) qui ne faisait que renverser le sens des dogmes, du Dogme hégélien, sans aller au fond. Et quel est ce fond ? Burckhardt le saisit immédiatement, la Science de l'Histoire ne peut pas être en tant que telle, elle ne peut jamais qu'offrir une matière à l'appropriation individuelle du passé. Qu'une telle appropriation puisse devenir une source de bonheur, voilà qui ne concerne, semble-t-il, que les sentiments pitoyables d'un vieil homme qui a construit son " existence " autour de la Science historique. Et pourtant ce qui suit indique que le sage a compris dans toute son extension le danger que représente l'entrée en contact de ces deux masses " critiques ", l'énorme accumulation du savoir assembleur et des impulsions matérielles de l'époque. Burckhardt comprend d'avance la possibilité qui se dessine de n'importe quelle synthèse fictive, de n'importe quelle Aufhebung scénique d'une telle opposition. De fait, le nazisme ne sera que la reprise en grand de la pièce mise en scène par un certain Bismarck dans l'euphorie fantasmatique de la Germanie retrouvée.
Tout est fou, reconnaît Burckhardt. Et pourtant cette folie peut devenir source de bonheur alors que tout menace de partout, d'une menace dont le sage a une vision claire. Elle est pour lui une évidence prophétique parce qu' elle surgit d'un antagonisme absolu : l'Être et l'Histoire ont cessé d'entretenir des relations dialectiques, chacun est retourné dans son camp et que la guerre commence. Que vient faire, dans ce tableau d'Apocalypse, le bonheur individuel ? Il est la laïcisation réelle du savoir, le retour à l'usage singulier et réel de la théorie en tant que contemplation. Les documents historiques sont à usage personnel et ils sont assimilables dans l'existence, dans la vie présente. Dans la même lettre à Nietzsche, Burckhardt avait déjà fait un aveu inouï dans ce siècle dégoulinant d'idéologie : " J'ai fait tout mon possible pour les (ses étudiants) initier à l'assimilation personnelle du passé - quel qu'il fût ". Burckhardt formait des Surhommes. On ne peut pas se dérober à la représentation historique de la charge religieuse et idéologique qui reposait alors sur les épaules de n'importe quel pédagogue. En plein milieu du Vingtième Siècle cette charge a à peine diminué alors que la bombe historiale dessinée par le professeur bâlois vient de ravager la planète. Que l'on mesure alors ce que signifie en plein Dix-Neuvième un tel cri de ralliement pédagogique : il faut initier à l'assimilation personnelle du passé ! Même un Jacques Chancelle effaré dirait : -" et Dieu dans tout ça ? ". Ce paradoxe nous dessine un croquis " historique " intéressant de ce siècle de tous les antagonismes. Si nous ne faisons pas de Jacob Burckhardt ni de Nietzsche d'ailleurs, des exceptions sociologiquement surnaturelles, de véritables Surhommes avant la lettre, alors nous saisissons mieux l'expression de Freud : " L'avenir d'une Illusion ". Car la vision de Burckhardt, ainsi que ce qu'on pourrait nommer pour faire vite la pédagogie du Surhomme, étaient en réalité une illusion collective, n'en déplaise à Nietzsche. A la veille de l'unification du Reich il y eut bel et bien une Allemagne des Professeurs -celle-là même que fustige Heine lorsque ces mêmes Professeurs vont débouler sur les champs de bataille de Reischoffen et de Sedan - une Allemagne bourgeoise-humaniste rarement considérée dans son projet historique, un projet peu différent en somme de celui qui anime les républicains français de la même époque. Il y a bien une face lumineuse de ce siècle, une face illuminée par l'idée de la liberté individuelle au sein de la République. Or, de notre côté du Rhin ce projet se réalisait en dur cependant que Berlin produisait des " esprits ", comme si la menace républicaine en Europe appelait d'abord en réponse le rassemblement des forces intellectuelles, et des forces formatées par la théorie toute fraîche de la liberté, telle qu'elle se retrouve systématisée, par exemple, chez Schelling, mais aussi telle qu'elle surgit dans les forces politiques du socialisme marxiste ou anarchiste. Nietzsche n'est pas, en son siècle, le monstre qu'on croit. Les foyers artistiques et intellectuels autour desquels il gravite alors, celui de Wagner mais aussi celui de Burckhardt ou de Rhode, sont des entreprises où l'on usine le matériau liberté, où l'on coule, rectifie, tourne, fraise et alèse des mécanismes très délicats de conceptualisation de l'histoire et du projet même de cette liberté. Nietzsche ne s'en détournera massivement que parce qu'il voit de son œil d'aigle la vanité de la situation de ces bourgeois patentés par l'Etat. Toute l'histoire des philistins des Considérations Inactuelles n'est qu'une description lucide, une répétition en somme, de ce que saisit Marx en tant que malentendu fondamental autour de la fonction réelle des pédagogues de la société européenne, celle de l'idéologie. Que Nietzsche psychologise sa propre critique ne fait qu'indiquer le sens dans lequel il va lui-même articuler sa pensée, mais aussi un sens très généralement exprimé tel qu'il se trouve dans la lettre de Burckhardt que nous venons de citer, le sens de la liberté individuelle.
Au fond, la bourgeoisie européenne était en train d'accomplir cette Révolution que Marx désignait avec un certain mépris comme une révolution bourgeoise. Il y a une certaine cécité chez le fondateur du communisme, ou plutôt un point aveugle dans toute sa construction théorique, c'est précisément celui de la relation de l'individu à la collectivité ou aux classes sociales. Le texte d'un Ernst Jünger (4) montre avec éclat que l'adversaire acharné de l'aristocratie européenne, mais aussi celui d'une révolution métaphysique totale, n'est ni le penseur d'un socialisme quelconque, ni les prolétaires eux-mêmes, mais la bourgeoisie, le monde bourgeois. Or de ce monde bourgeois, en tant que son essence, Jünger retient surtout la fiction de l'individu ou de l'individualisme. L'ontologie qui se masque derrière la critique de Jünger ne rejoint ni celle du Surhomme, ni celle du Berger de l'Être de Heidegger, elle postule une transcendance nouvelle, celle du retour des Titans, les tueurs de dieux, mais aussi les manipulateurs de l'individu. Elle emprunte pourtant à l'un le style et l'ampleur du ton, à l'autre un transcendantalisme " humanisé " sous les traits du Travailleur. Pour en revenir à Marx, qu'on ne peut pas expédier ainsi en quelques lignes, il y a bien une contradiction fondamentale dans toute sa pensée. Certain diront que c'est ce qui en fait une pensée. Bref, d'un côté le fondateur du communisme se dit l'héritier du matérialisme anglais et français, qui comme il le rappelle lui-même dans La Sainte Famille (5), descend en ligne directe du nominalisme médiéval. Je fais ce rappel parce que le dogme central de ce nominalisme est la nature singulière de tous les êtres de la nature, même des mots : on ne voit pas comment peut naître une idéologie sur un tel fondement, sauf à faire donner les thèses freudiennes du transfert et du contre-transfert tels qu'y fait allusion abondamment Althusser dans son petit écrit sur Machiavel (6). D'un autre côté, il manipule constamment un substantialisme spinoziste soigneusement maquillé sous le concept de " conditions " : la conscience de l'individu n'est que la traduction intellectuelle des mouvements de la matière, de la situation historique et de ses conditions, mais, elle accède tout d'un coup (de force) à la conscience de soi, comme si, mais ont sait où Marx va chercher ce processus, comme si la conscience de soi naissait au détour d'un moment de l'histoire (de la conscience). On peut souligner ici plus qu'une certaine admiration qui transpire dans tout son texte, des Manuscrits de 44 jusqu'au Capital, et que Karl Marx voue à cette bourgeoisie dont il ne manque jamais de faire le principe de toute la révolution qui aboutit à la naissance du prolétariat et donc aux fondements de la prochaine révolution. Mais là encore il y a un malaise, car cette révolution n'a de chance de s'accomplir que lorsque le taux de profit aura atteint le niveau zéro de sa tendance baissière. Autrement dit que lorsque le capitalisme bourgeois se sera critiqué lui-même. En dernière analyse c'est la bourgeoisie qui mène la danse de bout en bout, ce que démontre admirablement l'histoire réelle de la fin des " communismes " étatiques. Et en cela, elle est aussi le frein à la révolution des Titans comme elle a été responsable de l'anéantissement du nazisme. Ernst Jünger a vécu jusqu'à 102 ans, tard dans les années 90, et n'a jamais commenté le beau retour de la bourgeoisie à travers le monde après la grande catastrophe hitlérienne. Cela ne signifie pas que son utopie ne s'est en rien réalisée, car le monde est bien devenu le monde du Travailleur, mais pas du travailleur socialisé en ruche hiérarchisée. Le Travailleur est en passe de devenir un nomade, propriétaire de ses compétences et en fait, un chasseur en course sur le marché du travail. Les capitalistes les plus lucides ne perdent pas leur temps à penser qu'il est possible d'éviter un évergétisme universel. La disparition à terme du travail non hautement qualifié laisse déjà entrevoir une croissance exponentielle du nombre de sans-emploi dont il ne restera qu'à faire, ou refaire, une plèbe, à défaut de conserver des moyens de les exploiter de manière profitable. Mais nous reviendrons sur ce délicat sujet à propos duquel il faut cependant déjà avertir le lecteur qu'on ne pourra plus raisonner dans le futur comme on le fait encore dans la terminologie que nous venons nous-même d'employer dans ce paragraphe.
Cette maldonne à propos de l'idéologie et du véritable rôle de la bourgeoisie dans son époque, a ouvert la porte à l'interprétation léniniste des découvertes de Marx, interprétation, que le maître, il est vrai, a largement favorisé de son vivant, notamment dans le Programme de Gotha. Il est vrai par ailleurs, que Marx a plus souvent parlé de partage de la connaissance que de consciencisation des masses. En même temps qu'il semblait piégé par le schéma historique hégélien, pour tout dire eschatologique, il reconnaît dans cette même histoire un processus d'aliénation, cette perte de conscience réelle que Lukacs a si bien nommé la réification. Mais pour lui, l'histoire est un " fumier " dont il a voulu à toute force identifier des lignes de forces, des directions et des vecteurs pour les gaz qui s'en échappent, d'où son respect pour ainsi dire forcé pour les maîtres réels de ces vections, les capitalistes. Il y a chez Marx une sorte d'instinct aristocratique qui le lie fortement à Hegel et à la " réalité rationnelle ". D'où un mépris souvent agaçant pour des penseurs de grand courage et pas si stériles qu'il veut bien le suggérer comme Proudhon et surtout Saint Max, Max Stirner. Marx va hésiter longtemps avant de tirer à boulets rouges sur le pauvre Stirner dans L'Idéologie Allemande, un texte qui, il est vrai, ne sera pas publié de son vivant. Mais là où une telle critique avait vraiment sa place, à savoir la Sainte Famille, il n'est pas question un instant de ce philosophe et jeune hégélien célèbre qui sera exécuté quelques années plus tard de la pire façon. Nietzsche lui réservera le même sort ainsi que la plupart des grands penseurs à l'exception notable de Ernst Jünger qui a surtout trouvé commode de prendre sa philosophie pour modèle de ce qu'il se considérait être lui-même, à savoir un anarque, notion qui n'a d'équivalent que dans le Prince lui-même de Machiavel. Mais certainement pas pour les mêmes raisons. Pour Marx le cas était grave, parce que Stirner ne fait rien d'autre que d'achever la critique entamée par Feuerbach en la poussant dans ses limites, en fait les limites tracées par Fichte quelques décennies plus tôt. Cette pensée aux limites est très vite devenue une mauvaise fréquentation dans cette Europe euphorique, où toutes les grandes pensées, à l'exception de Nietzsche et encore, étaient des pensées sociétales. Personne, encore une fois à l'exception de Nietzsche et aussi Kierkegaard (7), ne veut raisonner hors société dans un siècle où le sociétal se coule lui-même dans le béton de l'Etat. C'est pourquoi il était téméraire pour un jeune hégélien comme Stirner, arrivé légèrement trop tôt, de s'en prendre directement au dogme de la nature sociale de l'être humain. Il existe une différence historique radicale et rarement remarquée, il faudrait dire un mur historial, entre la constellation qui gravite autour de Hegel, disons les penseurs officiels de l'idéalisme allemand et de sa critique, et puis le monde confidentiel et interlope qui protège et permet la mise en orbite de la critique nietzschéenne de cette même constellation. Au point que ce qui reste pour moi un des mystères de la pensée de ce siècle, mais vous en savez sans doute plus long que moi, est la mesure dans laquelle les deux mammouths se connaissaient et se lisaient. Il est certain que Nietzsche a lu Marx, certaines allusions dans Ecce Homo en font foi. Le contraire demeure pour moi totalement mystérieux. Mais je n'ai pas lu tout Marx, en particulier toute sa correspondance qui n'était pas disponible à l'époque où moi je l'étais pour une telle lecture. Quoiqu'il en soit, il me paraît inconcevable que Marx n'ait pas eu vent des publications de Nietzsche, d'une manière ou d'une autre. Son silence à ce sujet me paraît aussi important que le fameux silence de Heidegger, d'autant que le style de l'essentiel de l' œuvre " exotérique " de Nietzsche, ses " Considérations Intempestives ", ressemblent à s'y méprendre au style caustique de Marx, forme et fond.
Tant il est vrai que la pensée de Nietzsche est une véritable catastrophe pour le " système " de pensée marxien. Une catastrophe d'autant plus grave que les racines métaphysiques (ou anti-métaphysiques) de Marx sont les mêmes que celles de Nietzsche : l'atomisme de Démocrite et la pensée héraclitéenne du mouvement sans fin. Faut-il mentionner Machiavel ? Je peux sentir d'ici la souffrance d'une grande intelligence aux prises avec un adversaire dont la pensée s'avère tellement plus fidèle à ces propres sources. Il fallu, sans doute, reconnaître, cœur crevé, que la Lutte de Classe n'était qu'une resucée onto-théologique même si l'aristocratisme apparent de Nietzsche permettait à Marx de se classer sans remords dans le camp adverse. Etant donné les dates où cela aurait pu se produire, cela pouvait passer pour une simple affaire de stratégie politique, et Marx a pu se sentir autorisé sans trop de dégâts à se réfugier dans la position fameuse de Debord : " pas de dialogue avec les cons ". L'affaire paraît sérieuse, et elle l'est parce que les deux hommes vont chacun peser lourd dans la balance de l'époque qui va suivre leur non-débat, conséquence logique du fait que chacun pense dans la limite de ce que pense l'autre et contre cette limite. Ce qu'on peut dire, à mon sens, au sujet de ce chassé-croisé de pensée, est que Nietzsche est marxiste là où Marx est nietzschéen. Nietzsche se retrouve marxiste dans ses errements scientistes et évolutionnistes que ne vient border que tardivement par le coup de force de la volonté de puissance, la thèse de l'éternel retour du même. Quant à Marx, il se méfie précisément de la Science et de l'Evolution en soumettant tous les deux à la volonté de puissance du prolétariat. Ce prolétariat, par ailleurs, n'est souvent à son corps défendant que l'Homme en tant que tel, le Robinson qui invente l'œil pour voir et peint des chefs-d'œuvre pleins de mystères. Le Prolétariat est bien une figure de l'histoire, identique dans sa fonction à la figure du Travailleur de Jünger, et cette fonction est à chaque étape de l'Histoire, d'identifier conceptuellement, c'est à dire en définitive dans le langage de la métaphysique, la nature humaine. Le prolétaire en Zarathoustra.
" Les âmes de législateurs et de tyrans, capables de fixer un concept, de le retenir ; les hommes doués d'une telle énergie spirituelle qu'ils savent cristalliser et presque éterniser ce qu'il y a de plus fluide au monde, l'esprit : voilà les hommes doués au suprême degré pour le commandement. Il disent : " Je veux que l'on voie telle et telle chose ! Je veux qu'on la voie précisément de telle façon ! Je le veux pour telle fin et pour cette seule fin ! " Cette race de législateurs est celle qui, nécessairement a exercé de tout temps la plus forte influence ; c'est à eux que l'on doit toutes les formes caractéristiques de l'humanité ; ils en sont les sculpteurs, et les autres (le plus grand nombre) ne sont à côté d'eux que de l'argile " (8). La mort de Dieu en neuf lignes, la mort de Dieu, celle de l'Histoire et de son ombre l'historisme. Ce fragment, le 137, aura désormais la même valeur, c'est à dire la même puissance créatrice de forme que le Cogito. Il comprend le cogito au sens où il concède à l'homme seul la puissance de fixer des concepts, de les sortir du néant dans une finalité qui leur est propre, aléatoirement propre c'est à dire conforme à la volonté singulière de ce potier de l'histoire. Il dissipe donc en même temps la malédiction que représente la valeur logique du concept de Dieu pour toute construction conceptuelle, en réalité pour toute volonté de façonnage. C'est que Dieu lui-même n'est qu'une forme sortie des doigts agiles et puissants des législateurs et des tyrans, une forme dont la force était la garantie de sa pérennité. En même temps il balaye par une force d'évidence incontournable tout le Saint-Frusquin des idéologies et des conditions matérielles dans le quel se sont embourbés les meilleurs d'entre nous, et en particulier Marx et Engels.
Cette force d'évidence a, cependant, son revers, sa face cachée qui est aussi son terrible secret qui en fait une malédiction : elle est toute entière pétrie du refus pour l'humanité de s'en remettre à quelque transcendance que ce soit. A partir de ce fragment, il n'y a plus ni père, ni Dieu ou destin, tout le poids de l'existence retombe en totalité sur les épaules de l'Homme. Qu'il existe par ailleurs des hommes " d'exception ", des législateurs et des tyrans, ceux qui tissent les toiles idéologiques et pétrissent l'argile des masses, cela n'est ni un mystère ni un miracle ni surtout une donnée de la nature : c'est un résultat auquel chaque génération de notre civilisation est confronté et par rapport auquel elle se définit en terme de soumission, de compromission, de complicité ou de révolte. Le grand mérite de Machiavel est d'avoir analysé avec une grande acuité comment s'établissent les relations qui font et défont le pouvoir, mais il n'a pas bien saisi l'intrication des différentes couches sédimentaires de ce que les Princes, c'est à dire les législateurs et les tyrans, laissent derrière eux. Il raisonne toujours comme si le Prince qui conquiert une nation avait toujours affaire au vide, donnant à la religion un statut à part. Machiavel se leurre lui-même, à moins qu'il ne fasse de l'ironie, lorsqu'il affirme des principautés ecclésiastiques qu'elles vivent " sûres et heureuses " parce qu'elles ne sont pas gouvernées sinon par la main de Dieu lui-même. Ce qu'il raconte dans le même chapitre XI démontre d'ailleurs le contraire. Ce qu'il ne peut pas concevoir, apparemment, c'est que la religion est en elle-même une législation forgée dans un passé déjà lointain, c'est à dire quelle représente déjà la volonté d'un législateur. C'est ainsi, et ainsi seulement, que se forgent les classes sociales, à savoir dans le partage, l'application ou le refus calculés des décisions antiques des anciens décideurs. Et personne n'est dupe. Toute tradition se rapporte à une lignée ou plutôt à un jeu de lignées, jeu étant pris ici dans ses deux sens : celui de pratique ludique et celui d'ensemble, comme on dit un jeu de clefs. Il faut se rendre à l'évidence, l'histoire est faite de décisions d'hommes seuls et des seuls hommes, les éléments conditionnels, aucune condition si nouvelle ou si bouleversante qu'elle soit, ne peuvent modifier ce point.
Il est pourtant un point sur lequel les deux grands hommes, on ne sait pas, pour l'instant, pour quel motif, se sont tous les deux gravement trompés. Marx comme Nietzsche tenaient l'un l'argile, l'autre le prolétariat, en piètre estime. En ce qui concerne Nietzsche, on pourrait dire que son audace nihiliste, c'est à dire sa manière presque suicidaire d'anéantir tout ce qui ressortit du Christianisme, l'autoriserait presque à cette manipulation quasi métaphysique qui consiste à réduire toute une partie de l'humanité en quelque sorte à de la matière, à de l'argile. Mais c'est qu'il s'agit bien d'une manipulation métaphysique dont il a besoin pour éterniser son retour du même. C'est bien pourquoi on ne comprend en définitive pas grand chose aux motifs de sa critique si virulente de l'existant, et en particulier du siècle dans lequel il a vécu. Car que fait le grand homme sinon donner son absolution à une Histoire des Grands Hommes dont il a sous les yeux un exemple on ne peut plus grandiose? A une histoire dont les valeurs qu'il critique n'ont jamais été, c'est ce qu'il dit si bien, que l'arsenal des guerriers dont il a la nostalgie. Faudrait-il croire que le philosophe du Zarathoustra n'a, en réalité, réagi que devant la menace socialiste, dans l'étroit chenal de ces quelques décennies où les ouvriers européens ont fait sentir leur poids dans le jeu des grands ? Toujours l'Histoire (Historie) : Nietzsche - Bismarck. Bismarck était le défenseur discret mais acharné de la monarchie et de l'aristocratie des Junker face à la montée inéluctable de la gauche du Reichstag soutenue par défaut par une opposition libérale-bourgeoise inconsciente de ses véritables intérêts (dirait Marx). Or c'est par la classe intellectuelle que cette bourgeoisie se manifeste, une classe sociale qui je le rappelle, sera brocardée et condamnée à la disparition le siècle suivant par Jünger. C'est du sein de la petite bourgeoisie Souabe que sont sortis les grands " idéologues " de l'idéalisme et de sa critique : la biographie de Hegel ne montre pas seulement que le philosophe était un homme d'une ambition séculière démesurée mais encore que Sans-Souci s'en est beaucoup soucié. Hegel était bel et bien le protégé de la Cour, et donc l'homme par qui l'Allemagne devait penser. Voilà qui ne pouvait que faire de l'ombre à des aristocrates comme Schopenhauer, à des petits-bourgeois extrémistes comme Nietzsche. En résumé, le tableau est le suivant : dans les années 1870 Bismarck réalise le rêve de Machiavel pour l'Italie. Nietzsche peut s'adonner, comme bien d'autres Allemands, à tous les fantasmes de la puissance atteinte et de ses promesses. Au point que même Bismarck, décidément trop hégélien, deviendra un obstacle que la nouvelle Cour devra éliminer pour forcer la cadence de la militarisation et l'évolution qui conduira inéluctablement vers les conquêtes pichrocolesques de 1914 - 1945. Le Reich de Mille ans et son conducator étaient déjà dans l'air. La bourgeoisie libérale, de son côté, avait à faire face à la réalité du marché, et en particulier à celui du travail : on pouvait bien faire tirer de temps en temps sur les ouvriers, mais par rapport à un marché qui s'ouvrait enfin sur le monde cela n'avait pas de sens. L'économie ne pouvait plus se passer d'un compromis, un compromis que Bismarck lui-même avait contribué à forger. Bref, tout le non-dit de la pensée " sociale " de Nietzsche est dans le refus enragé de tout ce qui se passait dans les bassins de la Rhur et de Westphalie, de la croissance d'une Allemagne entachée de démocratie où l' " argile " venait de reprendre la parole, cinq siècles après le bain de sang de sa dernière révolution.
Il ne s'agit pas ici d'une analyse de l'idéologie allemande mais d'une interprétation des écrits de Nietzsche et de sa position par rapport à l'université allemande et à la classe bourgeoise. Sa critique de cette bourgeoisie est en réalité la critique du fait que du sein de la masse surgissent des hommes qui parlent de la liberté réelle, de celle qu'ils peuvent désormais invoquer au Reichstag par députés interposés. Car l'argile, comme la matière artistotélicienne, n'a que la puissance, pas la réalité. Ce que Nietzsche rate complètement en tant que théoricien et même en tant que nihiliste, c'est la position des êtres d'argile. Il se comporte en réalité avec les masses dont il parle comme on se comporte avec un chien dont on veut se débarrasser et qu'il convient donc de déclarer enragé. Or le peuple est constitué d'individus pourvus de conscience et même de la parole. Les individus qui le constituent s'inscrivent selon leur liberté dans l'une ou l'autre lignée historique représentée par les uns ou les autres. Qu'ils s'inclinent devant les conditions dans lesquelles ils naissent en décidant de poursuivre dans la même voie, voire dans la même impasse que leurs ancêtres, qu'ils décident de se battre en suivant la Tradition de la révolte ou même qu'ils décident de se marginaliser de toutes les manières que l'on veut, ces individus demeurent tous des hommes, les mêmes hommes en valeur ontologique que n'importe quel conducator. Ce qui manque totalement dans la pensée de Nietzsche, le trou théorique, c'est Rousseau. Il y a bien d'une part des intuitions poétiques sur l'espace dans lequel vivent les hommes et dans le parcours de Zarathoustra on peut lire une socio-géographie, ou pour reprendre un expression de Debord, une psychogéographie. La plèbe vit dans la plaine, Zarathoustra vit seul dans la montagne. Les individus des masses se tassent les uns contre les autres, leur caractère fondamental est la grégarité alors que le Surhomme est un nomade solitaire, etc.. D'autre part Nietzsche admet quelque chose comme l'évolution, une évolution darwinisée à outrance pour les besoins de son système déguisé. Mais Nietzsche n'entend rien à l'évolution des formes politiques selon le degré d'une sédentarité qui s'intensifie avec le temps. Entre la Grèce de Périclès et l'Allemagne de Bismarck, il n'y a au fond pour lui guère de différence, et pendant sa lune de miel avec Wagner, il n'est pas loin de penser que le jeu tragique entre Dionysos et Apollon pouvait désormais avoir lieu entre le Rhin et l'Elbe. Une illusion qui ressemble à s'y méprendre à celle de Hölderlin et de Heidegger. En fait, Nietzsche a bien détruit l'Histoire, mais seulement à moitié, c'est à dire celle qui est concernée par l'historisme. Contrairement à d'autres penseurs de son siècle comme Engels ou Schelling, il ne s'intéresse pas du tout à la préhistoire où aux découvertes ethnographiques toutes récentes. A la limite, l'affairement d'un Humboldt devait lui paraître du dernier ridicule. Et pourtant Engels avait flairé toute l'importance du mystère de la naissance de l'agriculture, c'est à dire de ce qui s'est passé pendant l'époque néolithique. Mais la position de Nietzsche est décidément trop métaphysique.
Marx quant à lui, a commis une erreur d'appréciation du même ordre. Il fallait faire marcher le schéma historique - eschatologique, il fallait imaginer les conditions d'une lutte de classes, or celle-ci demanderait du temps parce que la formation du prolétariat demanderait du temps. Celui qui avait fait remarquer que toute formation exigeait par avance des hommes formés ne se rendait pas compte que la thèse d'une nécessité de la formation reprenait tel quel l'alibi de la science historique bourgeoise. Il savait parfaitement que toute formation devait, en dernier recours, s'appuyer sur une idéologie, parce que la théorie implique aussi que l'idéologie reste la nécessité interne de toute relation sociale non communiste. Tout tourne ici autour du rôle du Parti Communiste et de celui de l'Internationale. Or il semble que Marx se soit leurré de la même manière que Debord, et bien d'autres dans l'Histoire, en pensant possible la réunion d'hommes parfaits, l'organisation d'une multiplicité d'égaux capables de concevoir et de diriger une stratégie de prise de pouvoir. Rappelons à cette occasion qu'il avait écrit le Capital comme un manuel de formation des ouvriers, affirmant froidement que son livre était accessible à n'importe qui. Ce qui n'est pas faux dans l'absolu mais se révèle comme une véritable farce dans une réalité où les ouvriers aliènent l'essentiel de leur énergie dans le travail salarié. L'erreur plus fondamentale est dans le concept même de lutte de classe : lutte il y a, il y a toujours eu et il y aura tant qu'elle sera nécessaire. Lutte de classe contre classe c'est tout autre chose, c'est à dire qu'il ne peut pas s'agir d'autre chose que d'un conflit politique tout à fait classique. Je veux dire par là que si une classe sociale (à supposer que cela existe) se constitue en adversaire d'une autre classe, nous nous trouvons tout simplement devant le cas de figure d'un conflit banal dont l'issue politique n'est en rien différente a priori de celle d'un conflit entre peuples ou entre familles ou clans. C'est tout simplement l'exercice de la force, de la violence ou de l'action politique quelles qu'elles soient en vue de s'emparer du pouvoir, ce qui est l'essence même du politique. Le destin du communisme expérimental soviétique montre une chose avec une assez grande certitude, c'est que la société socialiste qui devait servir de transition vers le communisme s'est transformée rapidement en une société de classes en tout point comparable à n'importe quelle société bourgeoise. L'implosion finale n'est en rien différent d'une crise de régime quelconque : le Prince-Parti avait perdu la confiance de son peuple. Faut-il ajouter que la seule idée d'un délai historique, cette idée que le salut du Prolétariat allait demander non seulement une lutte révolutionnaire, mais que cette lutte ne saurait se passer d'une véritable éducation des masses, un projet qui n'avait rien de différent de ce pensaient des humanistes républicains et bourgeois comme Condorcet ou Jules Ferry, faut-il préciser qu'il implique un véritable sacrifice de générations ? En dernier ressort le malheur était le vrai programme de ces masses dont seule l'Idée possédait une valeur morale et.. conceptuelle.
Mais l'essentiel n'est pas là. Le secret de l'échec du communisme est dans l'absolution donnée à une conception historique de l'être humain, une conception évolutive qui ne pouvait tenir que sur la base d'une évolution métaphysique, c'est à dire bourgeoise. L'inégalité sociale dont il avait scientifiquement analysé les fondements historiques et économiques était devenu subrepticement une inégalité d'essence : dans le présent de son époque, le prolétariat n'était pas prêt, ni à la lutte directe ni à l'exercice du pouvoir. Or l'impératif du Programme de Gotha, celui de la dictature du prolétariat, montre par définition que le pouvoir dont il est alors question est sous son masque le pouvoir bourgeois, le pouvoir de se substituer à l'oligarchie régnante. Qu'est-ce à dire sinon que les véritables aspirations du prolétariat comptent pour du beurre, parce qu'elles n'existent tout simplement pas dans l'esprit du théoricien. Plus profondément encore, le prolétaire n'est qu'un semi-idiot, dont l'aveuglement et l'inconscience vont justifier, quelques décennies plus tard des traitements peu éloignés de ceux que les nazis ont infligés à des millions de semi-idiots. Et pour cause, ils ne sont pas passés par le travail du concept, ils ne se sont rien approprié de tous les mécanismes tactiques et stratégiques de la métaphysique et de la religion, à savoir des mécanismes de la prise du pouvoir et de son maintien. Même Marx s'est laissé piéger par le double-bind mortel du Socratisme : le Bien c'est le Savoir, Savoir qui est savoir du non-savoir. Marx a cru comme tous les philosophes sans exception qu'il fallait apprendre à ne rien savoir, ce qui signifie tout crûment qu'il excluait, encore une fois comme la grande majorité des métaphysiciens, la majorité des êtres humains de tout statut ontologique. Son scepticisme foncier lui permettait certes de fondre toute l'humanité de son siècle dans une Préhistoire non communiste où, comme dirait Hégel, toutes les vaches sont noires. Mais cette pirouette ressemble à s'y méprendre à la fiction des arrières-mondes de n'importe quelle religion.
Notes
1 - La France de cette même époque me fait souvent penser à l'Alsace de toujours, celle où tout Dire passe par l'absconse ou surréaliste poésie. Les grands voisins français de Nietzsche s'appellent Beaudelaire, Rimbaud,
Isidore Ducasse ou encore Nerval et Mallarmé. Mais il n'y a pas de Nietzsche français.
2 - Lettre de Jacob Burckhardt à Nietzsche après réception des Considérations Inactuelles , cité par Karl Schlechta dans " Le Cas Nietzsche ", Tel Gallimard, Paris 1997, page 68.
3 - ibid, page 69
4 - En particulier son ouvrage principal : Le Travailleur, traduit aux Editions Bourgois 1989.
5 - Karl Marx, La Sainte Famille, Traduction Erna Cogniot, Editions Sociales, 1969.
6 - Louis Althusser, L'Unique Tradition Matérialiste, dans un tiré à part de Lignes N°18 Janvier 1993.
7 - Il est toujours présomptueux voire ridicule d'adopter, en philosophie, le ton de celui qui a tout lu et qui prononce la sentence sur ce qui a été ou non pensé et sur ceux qui ont pensé ceci ou cela. Comme il n'y a pas d'Histoire, il n'y a pas davantage d'Histoire de la Philosophie, pas de science exacte. Il y a longtemps que des ouvriers comme Derrida ont montré que la pensée pense, c'est à dire qu'elle se débat dans la contradiction et ne produit réellement qu'aux " marges " de sa propre pensée. Ceci pour dire que les grands noms de l'histoire de la pensée ne possèdent certainement pas le monopole des idées dont on les a crédités. Dans la frénésie possédante de notre civilisation on n'a jusqu'ici rien inventé de plus risible et de plus criminel que de Droit à la Propriété Intellectuelle.
8 - Nietzsche, La Volonté de Puissance, traduction G.Bianquis, Edition Tel Gallimard, 1995, page 132.
Jeudi 1er janvier 2004
La mort de Dieu
ou le gambit du divin.
Quel empressement pour le Dix Neuvième siècle et surtout pour le siècle suivant à attribuer à Nietzsche la paternité d'un événement aussi ancien que la naissance du monothéisme ! Il est vrai que l'expression du fils de pasteur possédait une dimension unique par rapport aux athéismes qui n'ont jamais cessé de défier le Christianisme tout au long de l'histoire occidentale : elle postulait a contrario que ce Dieu AVAIT existé. Reprenant ainsi le thème hölderlinien de l'éloignement ou de l'infidélité de la divinité. Il valait toujours mieux adopter cette version parce qu'elle permettait, tôt ou tard, d'aborder l'idée d'un retour du divin, retour qui hante toute la métaphysique finissante. Or il faut bien reconnaître que la célèbre sentence sur le décès de l'Être Suprême n'a, en substance, absolument rien d'original. Quant à sa force poétique, elle est à chercher dans l'imitation séculaire de la Passion Christique, spécialité narcissique de l'homme qui va s'effondrer dans le mutisme, dit-on, de la folie. Le génie de Nietzsche, serais-je tenté de dire, est précisément dans ce gambit psychologique qu'il opère lui-même sur sa propre santé mentale : Ecce Homo est bien un texte historial parce qu'il y est question de l'homme occidental s'effondrant, écrasé entre la Science et le Fatum, et pas seulement de l'individu Nietzsche déchiré entre le statut de fin de race au chevet de qui se penchait le Futur Empereur du deuxième Reich lui-même et le bâtard au sang neuf dont allait sortir la nouvelle Allemagne.
Pourtant ce mot fameux reste central car il pose d'une part la question du rapport de la religion et de l'idéologie, et d'autre part celle du statut privilégié de la Religion par rapport au politique tel que le caractérise déjà Machiavel. Dans notre imaginaire, celui de l'homme de la rue du Vingt et Unième Siècle, la Religion se pose comme l'idéologie absolue, la Religion a force d'idéologie. Or rien n'est moins sûr même si le Christianisme s'avère dans l'histoire réelle comme une alliée indéfectible des puissances séculaires. Indéfectible mais non pas indéfectueuse, si je puis me permettre ce néologisme. On pourrait remonter très loin vers les origines du monothéisme et analyser avec soin les affres du long accouchement d'une doctrine dont les premières faiblesses n'apparaîtront qu'au Dix-septième Siècle avec la tentative de Réforme interne du Catholicisme qu'a représenté le conflit entre Jansénistes et Molinistes. La Reforme Protestante semble a priori avoir produit davantage de conséquences, mais quel que soit son intérêt historique, et nous y reviendrons évidemment, cette Réforme ne porte essentiellement que sur le Rite, sur la pratique de la même Doctrine, alors que le procès entamé par Pascal dans les Provinciales est d'une toute autre importance par rapport aux dogmes fondamentaux. Entre le Jansénisme et la position défendue par les Jésuites qui ont l'appui des puissances séculaires, il y a une différence concernant précisément le statut idéologique de la religion des uns et des autres. J'emploie le présent parce que cette différence est loin d'avoir disparu dans une époque où la Religion est devenue dans la conscience collective une idéologie plus ou moins partagée selon le libre-arbitre postulé par cette autre idéologie, celle des Droits de l'Homme.
Quelle est cette différence essentielle ? Elle réside tout entière dans la définition de la nature de la relation entretenue par les êtres humains, les Chrétiens, avec leur Être Suprême. Une longue analyse n'est pas utile ici, il suffira de rappeler que tout tourne autour de la question de la Grâce, mot dont la majuscule indique tout de suite son origine divine. La Grâce est dispensée par Dieu, Grâce dont l'enjeu n'est rien moins que le Salut Eternel des pécheurs. A partir de cette définition se pose le problème de savoir comment le Chrétien peut accéder à cette nécessité ultime, à cette garantie infinie, et c'est là que se séparent les chemins des uns et des autres. La réponse historique, au sens d'un résultat pratique, est celle qui a fini en idéologie destinée à préserver les intérêts des Grands, à mettre de l'huile dans les rouages de l'état moliniste par définition. Il faut bien, une fois de plus, sentir le Grand Siècle comme une époque de crise ontologique aiguë. Cette crise repose sur des nécessités avant tout politiques : il faut légitimer d'une manière ou d'une autre la plus grande révolution situationniste du millénaire. Je n'ai trouvé que ce concept pour illustrer ce qu'aucun historien, à ma connaissance, n'a traité ou analysé pour tel, à savoir le passage de la souveraineté personnelle à la territorialité. Depuis Louis XI un processus est en cours dont l'aboutissement porte le nom pompeux de Monarchie Absolue, alors qu'il faudrait au contraire qualifier le règne de Louis le Quatorzième comme la fin historique de l'absolutisme monarchique. En réalité, la souveraineté a changé de place et de nature, elle n'est plus situé dans l'emprise d'une personne sur un espace aléatoire dépendant de son influence, mais dans un territoire délimité - le fameux pré-carré - par des frontières matérielles. Il s'agit d'un événement ontologique, au sens où un tel coup de force n'est possible que sur une base ontologique. Or cette base n'est rien d'autre que le cartésianisme, décalque théorique de ce qu'on pourrait appeler le ludovicisme, nouveau théorème de gouvernement dont le fondement est l'idée d'un espace non-qualifié, d'un espace purement quantitatif dont on a effacé les traces ou les stigmates de la présence du Souverain lui-même, et qui va posséder désormais sa propre Raison, la Raison d'Etat.
Un tel chamboulement ne manque donc pas de provoquer des mises au point ontologiques pour ainsi dire en position corollaire : si le territoire n'est plus l'identité, le corps même du souverain, que devient le statut de Dieu par rapport à la Création, et plus précisément par rapport à ses créatures ? Si la Nation devient Nation, c'est à dire un objet détaché, une res extensa divisible partes extra partes, alors le problème de son gouvernement change du tout au tout parce que les hommes qui vont incarner la souveraineté vont perdre d'un seul coup leur nécessité essentielle : la monarchie devient contingente non seulement par rapport à l'identité du Monarque, mais par rapport à n'importe quelle forme de souveraineté. Messieurs Gaucher ou Furet ont bien raison de lier la monarchie absolue à la forme que prendra la Révolution Française de 1789, mais pas dans le sens qu'ils croyaient. Cette évolution, qui a du même coup libéré toute la discussion européenne sur la nature du Droit Naturel et donc de la souveraineté, a porté en elle-même sa propre critique. Autrement dit c'est le ludovico-cartésianisme qui est l'origine absolue et indiscutable de la fin de la monarchie. Le conflit théologique concomitant est donc lui aussi absolument révolutionnaire, et sans la guerre de diversion qu'a constitué la Réforme allemande et ses conséquences dans toute l'Europe, il aurait certainement pris un tout autre tour. De quoi s'est-il agi alors ? Quelle est la place du Jansénisme dans cette révolution et en quoi les Jésuites ont-ils eu nécessairement le dernier mot envers et contre l'ontologie dominante à l'intérieur même du Christianisme, au point, pourrait-on dire aujourd'hui, de l'abaisser définitivement au rang d'une simple idéologie ?
Une première question va nous mettre sur la voie : pourquoi la France de Louis XIV est-elle allé chercher ses maîtres en théologie en Espagne ? Pourquoi sont-ce les disciples du hobereau castillan Ignace de Loyola, les Jésuites, qui ont pris le monopole de l'éducation de la noblesse française ? Réponse, parce que l'Espagne avait été le champ expérimental de ce que Louis XIV allait achever sans coup férir, en précisant que cette expérience avait été tentée au plan européen, raison même de son échec. Le règne de Charles Quint n'aura eu pour seul résultat réel, décisif pour l'histoire à venir, que la création de l'Ordre des Jésuites, cette organisation idéologique organisée en armée et dont l'objectif primitif était, par une erreur de parallaxe ou une ruse de l'histoire dialectiquement banale, la défense du trône papal. Or si on me permet l'expression, les trônes sont comme l'argent, ils n'ont pas d'odeur. Ce qui meut nos bons pères d'un bout à l'autre du monde, est le même souci de s'emparer des élites et de les former en vue de leur soumission au trône de Rome. Or leur méthode possède une originalité par rapport à toutes les pédagogies des autres Ordres catholiques. Elle ne s'embarrasse pas de la logique des consanguinités dynastiques, elle permet à n'importe quelle sujet doué d'apporter sa pierre à l'édifice de la puissance du catholicisme. La bourgeoisie aura ses entrée dans les allées des pouvoirs, le Sujet porte en lui la même puissance neutre que le territoire, le sang n'est plus le signe de la légitimité ni, à la limite, de la qualité divine qui en donne le Droit. Du même coup la Raison d'Etat prend le pas sur cette même légitimité métaphysique : la vertu en tant que manifestation de la divinité du souverain devient superflue, voire gênante pour un exercice efficace du pouvoir.
Un siècle plus tôt, Luther avait déclenché une révolution similaire dont les conséquences vont se nouer avec le bouleversement brutalement imposé par Louis XIV, si brutal d'ailleurs que le Roi tentera sur ses vieux jours, mais il sera bien trop tard, de faire machine arrière. Car la Contre-Réforme n'est pas étrangère au remue-ménage qui va faire trembler le Palais et la Sorbonne, elle en est le moteur caché sous la figure de personnages peu connus malgré leur immense influence comme le Cardinal Pierre de Bérulle ou plus tard l'Abbé Saint Cyran et le Chevalier de Rancé. Engagés dans la lutte contre le Protestantisme au sein d'une Eglise largement corrompue, ces hommes croient avant tout nécessaire de rendre aux vertus chrétiennes leur statut de critères essentiels de toute action politique. Luther avait rendu à l'individu le contrôle directe de sa moralité par l'intermédiaire de l'examen de conscience libre de toute intrusion d'un tiers. Or la confession, le pouvoir de l'Autre de remettre ou non les péchés demeurait la clef de voûte du système catholique de gestion de la moralité : sur quelle base théologique fallait-il alors asseoir le jugement des confesseurs, étant entendu qu'il en allait avant tout de la vertu de la Noblesse et des agents du nouvel état ? C'est ici que se heurtent de front la Raison théologique et la Raison d'Etat. Pascal fait rire le tout-Paris dans cette sorte de Canard Enchaîné avant la lettre que furent les Lettres d'un Provincial à un Ami, où le savant-philosophe se délecte en ridiculisant page après page les contorsions pseudo théologiques des Jésuites pour défendre l'indéfendable. Le molinisme fait pour ainsi dire disparaître la notion même de péché mortel, car tout crime, même le pire de tous, devient moralement défendable grâce à cette sophistique qui portera par la suite le nom ambiguë de casuistique. Cette casuistique ne rendait certes aucun compte du sexe des Anges, mais bien de la manière de faire absoudre toutes les vilaineries de la Cour de Louis. Rien de plus roboratif que la lecture à quatre siècles de distance de ces quelques pages des Provinciales qui n'ont pas perdu la moindre actualité au plan de l'éthique la plus sobre et la plus dépouillée de toute idéologie métaphysique. Les valeurs qui y sont défendues pourraient en substance se résumer à rien de bien différent que l'impératif Catégorique. Or un tel impératif ne pouvait ni complaire à une Noblesse dont Louis avait fait un troupeau de jouisseurs privés de tout pouvoir politique, ni au Monarque lui-même pour qui la violence, le crime et l'hypocrisie étaient des moyens de gouvernement vitaux dans un pays en révolution permanente. Reste à comprendre en quoi la doctrine de la prédestination, qui avait été reprise telle quelle par le Protestantisme des Zwingli et des Calvin, présente une contradiction avec un tel exercice du pouvoir.
Le dogme de la prédestination, car il s'agit bien d'un dogme clairement établi chez Saint Augustin et repris sans nuance par Saint Thomas (1), consolide la transcendance divine en brisant tout lien qui pourrait se fantasmer entre le Chrétien et son Dieu. Dieu et le destin se confondent au sens où ce dernier est préinscrit dans la volonté divine sans possibilité pour le pécheur d'en modifier le sens et le résultat. C'est dans ce dogme que bat le cœur de la métaphysique et c'est lui qui fonde la transcendance divine en tant que transcendance, ce que nous avons appelé la substantivation de l'Être. Tout compromis sur cette question, sur cette représentation de Dieu, ne peut qu'aboutir à un arianisme ou un Pélagisme déguisés par lesquels la substance divine se trouve entachée de contact avec la matière, même humaine. L'erreur des Pélagiens, selon laquelle l'homme peut mériter la gloire de Dieu avec son seul libre-arbitre est réfutée, et avec elle toute emprise du pécheur sur son destin. Il n'y a donc aucune négociation possible avec la transcendance, même la vertu la plus pointilleuse ne suffit pas à garantir le salut -" si mon Père, qui m'a envoyé, ne l'attire". (Joann., VI, 44). La coupure est totale, identique à celle qui sépare chez Aristote le Premier Moteur de l'univers tout entier, ou celle qui sépare du monde doxique, le ciel des idées, l'hyperouranios topos. En dernier ressort, il ne peut y avoir aucune causalité dans l'homme, aucune causalité consciente, c'est à dire que sa volonté est sans objet. Pascal est le seul véritable adversaire de Descartes, le dernier représentant de la mystique négative dont le mérite est de reconnaître pleinement la différence ontico-ontologique et la déréliction absolue de l'être humain. Dans la réalité politique du Grand Siècle, une telle vision ne pouvait avoir cours car elle mettait en doute l'infaillibilité royale, le caractère divin du sang royal, alors que Louis était en voie d'achever la plus grande mutation de l'étant : la Nation n'était plus le corps du Roi lui-même, endurant le destin à lui réservé par Dieu, mais un véritable ens creatum humanae, une créature ou une production séparée dont l'homme allait pouvoir devenir maître et possesseur.
La Scolastique avait maintenu contre vents et marées une logique de l'Être qui en interdisait l'accès au savoir, et même la Foi, aurait dit le Cusain, ne pouvait s'en approcher que comme une tangente peut se rapprocher d'une sphère dans une proximité infiniment petite mais sans jamais la toucher. Cette logique de la Docte Ignorance avait le mérite de laisser pour ainsi dire un espace à l'Être, même si elle exclut en même temps l'appartenance de n'importe quel étant à cet Être Suprême. Il faut comprendre cette différence absolue comme une différence spirituelle, comme l'humilité d'une pensée forte de la différence, comme ce qui subsiste en fait de la pensée archaïque de l'Être en tant que son négatif : il n'y a aucun accès direct, ni sensuel ni intellectuel à l'Être pourtant présent partout. Mais il faut bien saisir que l'accès dont il est ici question est pure intellection, pure compréhension : l'Être n'est pas un phénomène dont les catégories de la Raison peuvent rendre compte, il ne se laisse enfermer dans aucune conceptualité dans la mesure même où il englobe le tout d'une différence où cette conceptualité peut certes avoir lieu, mais seulement comme partie contingente et comme représentation forcément erronée. La théologie négative ne fait que reconnaître dans toute son épaisseur le mystère de l'Être et son caractère inentamable. L'Être est le Grand Autre, le seul. Il y a une grande force logique et humaine dans la Scolastique : la conscience porte en elle une relation à l'Être, elle " sait " qu'il y a de l'Être tout autour d'elle et qu'elle-même fait partie de ce qui est. Ce qu'elle choisit alors d'adopter comme position de cette conscience par rapport à cet Être, entre-temps substantivé sous le nom de Dieu (c'est tout le secret du Nominalisme, à savoir rendre la substance divine irréfragable : le nom de Dieu est une réalité), cette position est la soumission absolue, totale, et la conséquence est que - mais on peut aussi bien inverser la causalité - l'Être demeure parfaitement inconnaissable. L'Être devient pur fatum, destin dont l'âme ne peut saisir que la logique morale que commande cette ignorance fondamentale, à savoir la morale de l'abstention, du retrait de toutes les sollicitations physiques qui parviennent à l'âme par le canal des sens. Pour les anachorètes de l'Antiquité comme pour le Chevalier de Rancé le but est de détruire par abstention le véhicule des sensations pour purifier l'âme de sa partie liée à la physis. Dans l'antique théorie d'origine aristotélicienne, il y a une partie ontologique de la conscience (de l'âme), le nous, qui n'est pas consubstantielle à l'âme en tant qu'organe physique comparable à l'âme végétative des plantes par exemple. Le nous entre turathein, de l'extérieur dans l'âme physique, il est la partie divine dont tout le problème est de savoir s'il est la Science en tant que telle, s'il la possède toute entière dès l'origine, ou bien si le nous n'est que la faculté de mettre en mouvement la science, seulement la puissance de savoir et non pas le savoir en acte. L'histoire de la pensée occidentale tourne autour de la réponse à cette question car elle est la même que celle de la traduction du mot onpuisque selon Aristote, le nous est en réalité l'Existant, ce on ou cet einaï dont Heidegger cherche le sens originaire.
Fait remarquable et tout à fait conséquent avec ce qui précède, cette théologie que nous nommons négative pour aller vite, est pour ainsi dire suivie à la trace par une opposition philosophique qui prend ses racines dans un combiné de Gnose aristotélicienne, si on peut forger une telle combinaison historique, et de Scepticisme. Elle porte le nom générique d'Empirisme, mais seulement longtemps après que le tronc commun de la Théologie strictement aristotélicienne ait divergé en deux rameaux sous l'action de l'un des plus importants interprètes de l'Aristote qui nous est parvenu par Avicenne, à savoir Roger Bacon. Roger Bacon est à sa manière partisan d'une théologie négative au sens où de manière très orthodoxe il opère dans l'âme une séparation entre la partie matérielle-végétative et la partie divine qui porte sur la science de l'Être, de Dieu. Mais Bacon est l'un des premiers penseurs à posséder une vision historique du Christianisme : pour lui l'être déchu mais qui a bénéficié de la Révélation peut reconstruire le Royaume de Dieu, à savoir le règne de l'Eglise Catholique. Or un tel projet exige une puissance à laquelle aucun penseur de la chrétienté n'aurait osé penser, celle de la Science empirique. L'expérience peut servir à regagner le savoir perdu lors de la Chute. En somme, Bacon ouvre deux perspectives millénaires : l'expérience scientifique et l'histoire du progrès de l'espèce humaine sous la direction de la papauté, cela va sans dire. On ne saurait assez insister sur la responsabilité métaphysique de la pensée de Bacon dont on retrouve encore par exemple des traces assez gênantes pour la pensée moderne dans le Schelling qui légitime directement et indirectement toutes les aventures sanglantes des Européens aux quatre coins du globe. L' " l'âme intellective " ou " l'Idée " ont été les deux véritables bannières sous lesquelles l'Occident a mis en pièce toute une humanité non reconnue pour telle, malgré les nuances qu'un Las Casas pourra introduire entre la " fragilité " des Indiens et la " robustesse " des nègres dont on pourra dès lors exiger la montée au front de l'esclavage pour quelques siècles.(2) Curieusement, l'empirisme se développera dans l'aire anglo-saxonne dans le sens d'un négativisme gnoséologique de plus en plus strict pour aboutir à un rejet absolu de toute idée de vérité, allant jusqu'à l'attitude satirique des Pragmatiques dont nous avons déjà touché un mot plus haut. Dans ce chassé-croisé théologique et philosophique Kant occupe la place centrale que l'on sait et qui permet aussi bien aux rationalistes qu'aux idéalistes les plus échevelés d'en faire le penseur de la nouvelle Patristique des Kantbücher.(3)
C'est donc à cette domination intellectuelle et idéologique bimillénaire de la notion issue de la substantivation de l'Être en Dieu qu'il faut mesurer l'importance du scandale philosophique du mot de Nietzsche. Cette nécrologie divine ne s'adressait certainement pas aux masses de son siècle dont on peut dire qu'il n'avait cure, elle visait exclusivement l'aristocratie de la pensée européenne, mais aussi l'aristocratie des forces vives de l'Allemagne. Nietzsche vomit cette Allemagne, il suffit de relire Ecce Homo, mais cette nausée ressemble en tous points aux symptômes libératoires d'une catharsis historique. Le métissage qu'il promeut dans l'un de ses textes (4) entre l'homme allemand et la femme juive a quelque chose de plus que glauque si l'on se réfère strictement à sa psychologie de la femme (5), mais cette idée laisse entendre au moins le désir d'une Renaissance géopolitique de l'aire germanique dont il n'avait sans doute même pas conscience. Je me rends compte de ce que ces propos peuvent avoir de scandaleux pour les intégristes du nietzschéisme, et pour faire pièce à une telle émotion je ne peux que renvoyer mes lecteurs au scandale en tant que tel comme style absolu de l'écriture de Nietzsche. On ne peut pas être plus fidèle à ce style, et donc à cette pensée, qu'en pratiquant avec lui, et il le demande lui-même à ses " bons lecteurs ", la " bonne guerre ". Il y a une thèse à faire, mais peut-être est-elle déjà sur le marché et je l'ignore n'ayant rien d'un érudit, sur le dilettantisme absolu de Nietzsche et le caractère polymorphe de sa pensée. La direction que prendrait mon analyse si j'entreprenais un tel travail, serait celle de la figure d'un décrochage historial, d'un largage d'amarres qui, à son époque, n'est pas le seul fait de Nietzsche mais concerne entre autre le dandysme mais aussi certaines tendances anarchistes. Un tel largage, au demeurant, me semble appartenir à une mécanique fondamentale de la Parole à laquelle s'offre un champ de liberté inattendue. C'est l'euphorie allemande mais aussi européenne à laquelle nous avons fait allusion plus haut qui, encore une fois, libère l'insolence et le mépris de toute logique morale ou ontologique. Il serait inconvenant de ne pas préciser que ce même siècle est celui de l'envoi d'une guerre civile européenne que seule la grande catastrophe de la guerre 1914 - 1945 parviendra à juguler, et seulement partiellement. Ajoutons que ce ne furent pas les partis politiques ni les organisations révolutionnaires qui ont soulevé ces forces antagoniques, mais cette même confusion euphorique entre la découverte et l'explosion des puissances ontiques et la parole de la liberté. On peut en trouver la preuve évidente dans l'impuissance de ces instances à s'opposer à l'adhésion de ces mêmes masses à la grande guerre qui s'annonce.
La mort de Dieu est en vérité une proclamation bien postérieure au dernier soupir de la transcendance onto-théologique. Nietzsche a peint " gris sur gris " l'ultime station du calvaire de la transcendance parce que la puissance qu'il incarne ne pouvait rester à la traîne du mouvement qui s'est mis en branle le siècle précédant : les maîtres de l'idéologie libérale, et Nietzsche n'en est-il pas le chef de file ? ont été contraints à ce qu'on pourrait appeler le gambit du Divin parce que les forces sociales s'étaient déjà emparé de ce bastion. Pendant quelques trois mille ans, la sentence était restée en suspens car elle demeurait le jeu des prêtres et des inter-prêtres. Vers 1870, le Premier Moteur de la domination cléricale a perdu son efficace, et à la veille des grandes batailles sociales, il faut tomber le masque, porter le défi à son maximum, sans quoi on ne pouvait pas spéculer sur un résultat maximum. C'est la tâche que s'est fixé Nietzsche, laïciser la guerre civile à l'envers en choisissant d'attaquer ses adversaires sur leur propre terrain. L'annonce de la mort de Dieu n'était rien d'autre qu'un cri de guerre typiquement germain, l'insulte mortelle qui annonce le pire, c'est à dire pas de quartiers. La Volonté de Puissance n'admettait plus de Tiers entre elle et l'adversaire, entre Zarathoustra et le marais. Ainsi naît la guerre totale. Ainsi naît le totalitarisme.
Notes
1 - Saint Thomas, Somme contre les Gentils, Livre III, De la Grâce, Ed. Louis Vivès, 1856, page 281.
2 - Je dois cette information surprenante à Schelling lui-même qui en fait mention dans le second volume de ses Leçons sur la Philosophie de la Mythologie, ouvrage déjà cité.
3 - Le Kantbuch, la thèse sur Kant, a été et demeure les Fourches Caudines de tout candidat allemand aux degrés de la Philosophie, curieusement et modestement cataloguée Outre-Rhin sous le nom de Philologie. Seuls Platon et Aristote ont eu ce privilège qui est loin d'avoir disparu.
4 - Je n'ai plus aucun souvenir précis du texte en question, et il reste toujours le problème que soulèvent les textes authentiques et les falsifications attribuées à Madame Förster-Nietzsche, sa sœur. Avec le non-texte et le non-système nietzschéen on sera toujours condamné à boiter d'une idée à son contraire.
5 - " Wenn du zu den Weibern gehst, vergiss deine Peitsche nicht ", " Tu vas chez des femmes ? n'oublie pas les étrivières ". Ainsi parlait Zarathoustra, De petites jeunes et de petites vieilles, NRF Gallimard, 1971, traduction M. de Gandillac, page 81
Vendredi 2 janvier 2004
L'Être usé
ou la certitude ontologique.
La fiction de l'Histoire a fait son temps. Elle l'a fait dans le théâtre d'ombre des interprétations ontologiques. Dès l'instant de ce qui vaut pour nous comme sa naissance, l'Être s'est vu jeté dans un kaléidoscope, trimbalé d'un arc à l'autre du cercle herméneutique, tombant ainsi au rang d'ustensile des visions du monde, de l'intoxication eschatologique des masses, en réalité maintenues par la terreur la plus physique dans l'orthodoxie cléricale. Nous venons de voir quel degré de cynisme historique on peut attribuer à celui qui proclame renoncer à cette ontoxicologie. Ce qui surgit en fait avec la renonciation à la foi comme véhicule du salut, c'est la situation naturelle des relations sociales, à savoir la guerre de tous contre tous. Mais il ne faut pas, ici, confondre avec le schéma de Hobbes. La situation naturelle des relations humaines ne signifie pas que l'état social de l'être humain est perturbé par l'essence mauvaise de l'individu. La situation naturelle est conçue ici comme résultat de la sociation elle-même, sociation naturellement impossible. Hobbes et Rousseau sont convaincus que l'Homme est un animal social, et cela sur la base d'une tradition qui conserve toute sa puissance depuis Aristote. Or la " nature sociale de l'homme " n'est qu'un postulat qui prend vigueur dans la sociation elle-même quel qu'en soit le prix. En réalité il en va pour l'homme comme pour la plupart des animaux, à savoir que l'espèce peut opter pour tel ou tel état, dont on pourra dire en les observant de l'extérieur qu'il s'agit de leur nature. De telles observations ne laissent pas de réserver nombre de surprises aux zoologistes et en particulier sur les structures de sociation ou d'association. Dans les faits on peut vraiment raconter n'importe quoi sur les formes d'association des êtres vivants sur cette planète, et il ne se passe pas un jour sans que ce discours ne s'invente ses surprises et ses exceptions afin de faire bonne mesure de commentaire avec les images de plus en plus précises que livrent la technologie iconique. Le plus drôle aujourd'hui, c'est que l'homme continue obstinément à tenir sur la " nature " et ses êtres un discours qu'il ne tient plus depuis longtemps sur lui-même. Sous les catégories et sous le label de la Science, il fossilise les situations des autres êtres vivants de la même manière qu'il avait figé la sienne propre pour l'éternité pendant des millénaires. Les fameux équilibres dont on gratifie a priori n'importe quel écosystème ressemblent à s'y méprendre à ces essences qui " enveloppaient " les existences. En vérité on ne sait rien du tout à ces échelles que l'on peut bien photographier, filmer, analyser sous tous leurs angles sans pour autant avoir la puissance d'y introduire de manière réaliste l'échelle du temps : car cette échelle nous échappe totalement. Les fantasmes nés de l'historisme nous ont fourni une sorte de vision du temps, en fait une idée fumeuse ou peut-être mieux encore une saveur toxique dont nous abusons sans cesse en mêlant nos pauvres perceptions et ce qu'elles captent grâce à l'expérience à la vérité de ce que nous réserve le Temps en tant que destin. L'une des névroses les plus graves de nos sociétés apparaît sous la forme la plus banale et la plus innocente : la météorologie a fini par se produire chaque jour sur la scène du monde comme son humeur globale, c'est elle qui donne le ton de ce que Chambon nomme l'auto-affection de l'Être. Il faut reconnaître qu'en même temps tout cet affairement autour du ciel perpétue à sa manière inconsciente le souci du Temps, et donc en ce sens le souci de l'Être en tant que question. La météo est devenue le seul lieu de questionnement ontologique, l'ultime refuge de la liberté que l'on accorde au monde d'être comme il le veut et non pas comme nous en avons besoin. On va me rétorquer que cette technique produit aussi de beaux résultats dans l'agriculture ou dans la prévision des catastrophes. Ridicules arguments, car ces deux domaines se sont depuis longtemps eux-mêmes transformés en dangers permanents et l'un des problèmes les plus graves du présent est bien de savoir comment sortir de l'agriculture industrielle dont le destin avéré est désormais clairement affiché, celui de devoir un jour ne plus produire que des poisons. Rions encore un peu, jaune, sur les volontés affichées elles aussi de prévenir les catastrophes naturelles : les seules variations dont ont pourrait maîtriser les effets sur notre habitat, à savoir les variations pluviométriques et les inondations saisonnières, il faut bien constater à leur sujet que l'instinct grégaire-sédentaire et les intérêts du marché immobilier demeurent encore plus fort que la peur qu'elles engendrent. Comme quoi, la catastrophe en tant que telle n'est qu'un sujet de conversation, un autre dérivé de la question de l'Être.
Or l'Être en a marre. On peut se demander comment on peut en arriver à proférer une telle proposition. Et pourtant elle n'est pas neuve, elle ne fait que répéter à distance les affirmations contenues dans le Livre Sacré, celles qui mettent en scène la colère de l'Être suprême, le courroux divin. Même dans le polythéisme la colère et la plupart des affects humains avaient leur place. On pouvait y discerner cette attribution dérisoire de sentiments humains à des êtres non seulement irréels en termes empiriques, mais tellement hors de portée qu'en réalité aucun discours ne saurait convenir d'aucune façon, sagesse ultime de la théologie négative, mais aussi ce qu'il y a en elle d'approximatif et de caricatural. Faut-il se réfugier dans la formule qui a fait fortune avec la psychanalyse et dire que " quelque part " l'Être parle par nous, à travers nous, en nous et pour nous ? Inutile de se ridiculiser à ce point, car tout le dispositif métaphysique repose précisément sur les différentes réponses que l'on peut apporter à la question du topos de ce quelque-part, au lieu où se produit un Dire originaire, c'est à dire qui aurait partie directement liée avec l'Être. Et ce sont aussi ces réponses qui ont produit la stagnation ontologique du religieux mais aussi le résultat final de sa propre critique, sa limite. Mais voyez-vous, ici déjà on pressent que la plupart des lecteurs perdent pieds parce que manque au sens de leur lecture la certitude ontologique. Disons tout de suite que ce texte ne peut en rien la leur conférer, leur en faire ni une formation ni un cadeau existentiel. Tout au plus peut-il, aidé en cela par tout un discours romantique de plus en plus prégnant dans la culture ambiante parce que son souci publicitaire le contraint de plus en plus fréquemment à célébrer même sans le ressentir le sublime sous-jacent à toute réalité, tout au plus ce livre peut-il exhorter son lecteur éventuel à l'attention permanente, à une libération de l'ouverture de la conscience comme on ouvre une connexion permanente sur le réseau Internet, lui conseiller de se tourner vers le présent de manière radicale et d'y chercher, comme un sourcier muni de baguettes de coudrier cherche le gisement d'eau, le gisement bien plus essentiel de la Parousie de l'Être. S'il a la chance de seulement distinguer le mouvement des choses, ce mouvement enfermé dans le repos, alors il peut s'attendre à une extase encore plus essentielle, dans laquelle se manifeste le sublime dans n'importe quelle direction vers où peut se porter un tel regard de l'âme. Une raison de beaucoup plus frappante nous conduit cependant tous vers une valorisation du sous-jacent sous la forme de l'inquiétude à l'égard du tout, une inquiétude qui fait retour après la longue répudiation de toute totalité comme lieu de pensée et la découverte ou la redécouverte du lien qui identifie l'universel et le singulier. Mais il faut répondre à la question, comment puis-je me faire le porte-parole de l'Être en évoquant sa fatigue ou son usure ?
Il y a là un piège ancien mais toujours étonnant. Si je pouvais parler au nom de l'Être, cela devrait impliquer que j'en ai une connaissance réelle qui ne pourrait dériver que de deux sources possibles : soit je possède un moyen de communication avec l'Être en tant qu'Être, soit j'en possède la connaissance essentielle. C'est le piège que la théologie décrit sous toutes ses formes possibles : la substantivation de l'Être en Dieu n'est pas univoque dans l'histoire de l'onto-théologie. Dieu n'est pas forcément la substance, comme elle l'est chez Spinoza par exemple, en réalité il est plus souvent sujet de la substance, subjectum ou dominatio, maîtrise de ce qui existe, de l'Être, sans avoir le moindre contact avec cet Être. Mais cette distinction que je viens de faire entre communication et connaissance est intéressante car ces deux modes d'approche de l'Être forment les deux prétentions théologiques fondamentales : l'une part de la Révélation, événement mythique au sens de fantasmatique, pure invention de prêtres dont rien ne peut rendre raison ou servir de preuve. La Révélation n'est rien moins qu'un communiqué de Dieu, une information en provenance de l'Être (substantivé) qui porte le double fardeau d'exhiber l'existence d'une divinité unique etc .. et celle d'une Loi voulue par cette divinité et qui doit former le fond des valeurs selon lesquelles l'humanité doit se comporter. L'autre mode, la connaissance, n'a pas, en principe, besoin de la Révélation, parce qu'elle repose entièrement sur les résultats de la faculté de connaître qui repose, elle, sur les éléments transcendantaux de l'esprit humain, ou si on veut de son âme. Platon et Aristote, repris et amplifiés par les scolastiques médiévaux, doivent leur gloire au fait d'avoir établi ce lien de la connaissance par le biais du nous, cet élément de la psyché qu'on traduit généralement et faussement par Raison, mais qui en tout cas garantit la possibilité de se rapprocher de la connaissance des Idées propres à Dieu, et donc d'une certaine manière de Dieu lui-même. Or ces modes de relations ontologiques souffrent tous deux du même défaut de fabrication, ou plutôt du choix primitif du matériaux utilisé, à savoir le sujet. Croire ou connaître sont tous deux des opérations purement subjectives, et quelles que soient les contorsions épistémologiques ou phénoménologiques auxquelles on puisse se livrer, la foi et la connaissance demeurent parfaitement unilatérales, à savoir du côté du sujet.
Est-on donc ainsi condamné à répéter inlassablement le message de Kant ? Pour finir par tergiverser comme lui et comme tous ses héritiers et s'assoupir finalement dans une philosophie de l'extase religieuse ou esthétique ? Il n'y a, je le crois fermement, que chez Spinoza que l'on peut chercher une troisième voie dont sont exclus le simple réquisit de la Foi et en même temps la foi aveugle en la connaissance, même si les composantes de cette connaissance, ce que Spinoza appelle un peu ironiquement lui-même les " transcendantaux ", procèdent tous d'idées qui seraient en Dieu. Mais quel Dieu ! Pour en parler, il faut passer par la substance. Qu'est-ce que la substance ? Il y a plusieurs manières d'interroger ce mot, la plus simple étant d'en prendre le sens le plus courant, un sens qui était déjà courant du temps de son emploi latin de substantia, à savoir la richesse ou le bien. Le bien au sens de propriété et non pas au sens moral. Contempler la substance signifierait alors que le regard se tourne nécessairement vers ce qui s'impose, vers ce qui, dirait Heidegger, proprie, c'est à dire en réalité identifie le lieu ou, le cas échéant la personne dont dépend cette substance. Et cela seulement parce que de la richesse et du bien dépend la vie. En faisant un pas de plus on pourrait aussi dire que cette substance primitive est cela qui manifeste, c'est à dire rend présent. On se trouve ainsi dans une logique directement vitaliste, anthropologique et paléontologique : dans le désert qui fait face au besoin, le bien prend le devant de la scène, la richesse comme source de vie capte l'attention comme objet premier de la conscience. Une signification plus moderne du mot substance, celle qui en fait le " meilleur " de quelque chose, à l'instar de la substantifique moelle, est en parfaite continuité avec ce sens primitif. Elle nous conduit aussi à une signification dérivée qui fait de substance tout simplement l'essence de quelque chose, ce qui compte dans sa définition ou dans sa valeur. Il faudrait donc rendre compte de toute une évolution du mot, de son concept, qui va finir par englober des entités signifiantes aussi vastes que la matière, la force, l'Être (ou l'étant) ou encore Dieu. En résumé on revient en quelque sorte au début de notre méditation, lorsque nous avons tenté de décrire le phénomène de la naissance du concept d'Être. Car il se passe entre le début du processus décrit, le rapport du besoin vital avec le bien, et la généralisation de ce rapport avec le tout de la présence, une formidable mutation du concept qui fait de la présence elle-même, quelle qu'elle soit, un bien, une richesse universelle. Cette mutation ne se fait totalement et radicalement que chez Spinoza, même si Aristote a déjà identifié la substance à la puissance ou à la force en tant que nature ou essence de l'Être. Mais cette identification est bancale, car la puissance ou la force n'est pas, en réalité, dans le présent ni dans la matière visible ni dans les phénomènes, mais seulement en Dieu, seulement dans le Premier Moteur qui meut ce qui demeure plus ou moins réel, plus ou moins substantiel.
Seul Spinoza opérera un strict retour à la vision parménidienne de l'Être, c'est à dire à une reconnaissance entière de la présence, c'est à dire de la substance existante affectée par une infinité d'attributs, comme seule et unique réalité. Cette unicité de la réalité, ce panréalisme, aboutit logiquement à ce qu'on a appellé le panthéisme, crime théologique qui valut à Spinoza non seulement d'être ostracisé par sa propre communauté juive, mais encore une exclusion moins voyante et pourtant bien réelle de l'histoire officielle de la philosophie. Entre Descartes et Hegel il y a un blanc à l'endroit de Spinoza, un malaise qui provient de la difficulté majeure à intégrer sa pensée dans l'histoire du Sujet, dans l'onto-théologie qui règne en maîtresse sur l'idéologie européenne. Hegel rapporte dans son Encyclopédie que Lessing disait : -" On traite Spinoza comme un chien crevé "-. Ce blanc est particulièrement éclatant dans le fameux " projet pour l'histoire de l'Être en tant que métaphysique " par lequel Martin Heidegger conclut son interminable interprétation de Nietzsche. On relève quelques traces de Spinoza chez Heidegger, notamment, et pas par hasard, dans son Schelling ; mais à l'évidence le polisseur de lunettes juif ne cadre pas dans la série des envois de l'Être propres à l'histoire de la métaphysique selon le maître de Fribourg. Parmi les idéalistes allemands, Schelling restera, en effet, le penseur le plus proche de Spinoza dont le système a peut-être été l'obstacle qui a empêché le grand romantique un peu bilieux de devenir le philosophe jumeau de Hegel. Tout était présent dans le dispositif logique de Schelling dont on ne sait pas avec certitude s'il n'est pas le véritable découvreur de la dialectique du négatif. Le paradoxe veut pourtant que le vrai spinoziste soit Hegel lui-même, mais un spinoziste dont le système se masque derrière une Histoire de l'Esprit, cause de l'Être en absolue contradiction avec le fondement de l'Ethique où l'Être ne peut être que causa sui, cause de lui-même et de rien d'autre. Or Hegel souligne expressément et cela directement en rapport avec la pensée de Spinoza que : - " … la substance effective en tant que telle, la cause, qui en son être-pour-soi refuse de rien laisser pénétrer en elle-même, est déjà soumise à la nécessité, ou au destin, de passer dans l'être-posé, et c'est cette soumission qui est bien plutôt le plus ardu "(1). Il est inutile de préciser que la substance spinoziste est en elle-même posée dans l'Être et, loin d'être soumise à une nécessité, n'a nul besoin de " passer " ailleurs. Il ajoute d'ailleurs un peu plus loin :- " La grande intuition de la substance spinoziste n'est qu'auprès d'elle-même la libération par rapport à l'être-pour-soi fini, mais le concept est pour-lui-même la puissance de la nécessité et la liberté effective ." Autrement dit, Spinoza aurait superbement méprisé la liberté humaine, la liberté effective au profit de celle de Dieu, mais alors comment Hegel peut-il admettre que le système de Spinoza fait une place à l'homme et à son rapport à la substance, et qu'il en découle une morale d'une " haute pureté "(2) ? Peut-être que la liberté qui est liée au concept ne se préoccupe-t-elle pas autant que cela de la " hauteur " de la pureté morale ? La Raison d'Etat n'est-t-elle pas un digne rejeton de la liberté issue de l'effectivité de la liberté ?
Derrière cette question on distingue la hantise qui anime Hegel d'un bout à l'autre de son existence pensante : attribuer à la philosophie le statut de la Science. En bref, disait-il, à quoi sert de s'en tenir au sentiment ou à la logique si leur élaboration philosophique n'aboutit pas à l'effectivité propre à la science ? En d'autres termes, il y a nécessité à produire, à créer ou à inventer une mékanè, ou tout simplement à comprendre la vérité et le système d'une mécanique immanente à la réalité, la dialectique, dispositif que Spinoza aurait alors complètement manqué pour avoir laissé l'Être " auprès de lui-même " dans sa liberté par rapport à la finitude. L'Être se tiendrait ainsi dans une position dans laquelle il est débarrassé de l'étant fini et du problème de sa liberté, n'ayant exclusivement en vue, mais cette expression hégélienne ne convient évidemment pas du tout à la structure de pensée de Spinoza, que sa propre liberté. Ce sur quoi insistent la plupart des commentateurs de Hegel, disciples ou non, est le caractère lui-même historique de son désir de science et de système. On peut résumer le drame de la dialectique comme LA réponse à l'échec postulé des Lumières. La Raison française, devenue entre-temps la Raison Pure allemande, avait crevé pour ainsi dire la délicate poche amniotique du sentiment et de l'intuition qui permettait toujours, comme on le voit in fine chez le Kant de la Critique du Jugement, d'entretenir de bonnes relations avec la transcendance tout en " fonctionnant " raisonnablement dans la finitude et la déréliction réelle. Mais cela était totalement insuffisant car la Raison avait déjà tué Dieu de la plus belle manière, l'invention du Sujet lui-même absolu de Descartes jusqu'à Fichte renvoyait la transcendance à ses chères études. Et pourtant il y avait toujours de l'Être dont la même Raison et le même Sujet ne pouvait plus rien dire, ou ne voulait plus rien dire à partir de la position dans laquelle ils s'étaient placés. Hegel le dit lui-même en décrivant la séparation et l'immobilité historique du sentiment et de la Raison dont il se proposait la réconciliation définitive grâce à la médiation. Le Savoir Absolu, ou l'Esprit, reprenait ainsi en sous-main l'extase rationnellement négative tout en préservant la Raison de l'Histoire, c'est à dire la prise en main du destin par les " institutions autorisées " et les " gens compétents ", i.e. la bureaucratie berlinoise. Le projet hégélien a réussi au-delà des espoirs de son auteur puisque notre époque est encore de part en part effectivement (au sens hégélien) hégélienne, même si la réalité se charge depuis plusieurs décennies d'alimenter les bacs à dissolution du bel édifice métaphysique - politique inventé par notre Edison politique. Marx a parfaitement raison de renvoyer la Philosophie du Droit de Hegel aux poubelles de l'histoire de la Prusse, parce qu'il a déjà compris l'étroitesse territoriale de la vision hégélienne par rapport au marché mondial et à sa dynamique nomade. Hegel avait, lui aussi, tout en le reconnaissant humblement, peint gris sur gris la réalité de son temps. Il pensait ne pas pouvoir être plus que son temps, et pourtant son cadet de quelques années, Karl Marx, lui a bien prouvé qu'on pouvait " être " mieux que son temps et prévoir des choses réelles qui se sont réellement accomplies et ne pas s'en tenir à enregistrer l'échec apparent du seul événement qui bouleversa alors l'Europe à savoir la Révolution Française.
Personne ne doute plus aujourd'hui que l'Etat tel qu'il s'est imposé dans l'histoire mondiale de ces deux derniers siècles est voué à la disparition. En quoi cet Etat peut-il avoir vocation à disparaître alors qu'il semble que tous les fils de la réalité des individus aujourd'hui vivants les rattachent de plus en plus étroitement à l'Etat ? On pourrait peut-être pour répondre à cette question reprendre la métaphore de Hegel sur la séparation du sentiment et de la raison. Mais non plus cette fois dans la tête de quelques philosophes mais dans la réalité. Le rationnel de notre réalité peut en effet se décrire comme cet écartèlement entre une raison encore paradoxalement représentée par l'Etat et le désir qui a pris ses quartiers privés sur le marché mondial. On est revenu à la case départ du même hiatus dénoncé par Hegel dans sa célèbre Préface, nous sommes en panne de dialectique et l'Être est parti en vacances auprès de lui-même, nous laissant nous débrouiller face à l'abîme intérieur qui sépare nos sentiments de notre raison. Oui, je crois que l'Être en a marre d'être ballotté ainsi dans l'imagination des idéologues, il est fatigué de devoir ses lieux d'existence au caprice des théoriciens, usé par la persistance de l'inadéquation dominante des représentations qui prétendent rendre compte de ces " lieux divins " et de la position qu'occupe l'homme par rapport à eux. Et ce que je dis là n'est pas si métaphorique qu'on pourrait le penser, car l'Être, je le répète, nous en sommes, et par conséquent il n'y aucune raison que nous restions indemnes des affections de l'Être, pas plus que ce dernier ne saurait être indifférent aux nôtres. C'est la dualité introduite entre l'Être et l'étant, la fameuse différence ontico-ontologique, qui permet aux prêtres de poser une supposée indifférence de l'Être par rapport à la réalité qui est la nôtre quand ce n'est pas une volonté Toute-Puissante de reconnaissance et d'adoration de notre part. Or cette dualité sort d'un véritable conte de fées, un conte dont on ne trouve d'exemple de comparaison que dans le vaste domaine de la publicité commerciale contemporaine, où le mensonge côtoie l'absurde dans l'unique but de distraire l'attention du public vers un seul et unique nouveau dieu, le marché. En passant, on peut dire de ce phénomène répugnant qu'il possède toutes les caractéristiques de la religion au sens où il promeut en réalité non pas une marchandise en particulier mais le commerce en tant que Praxis sociale, en tant qu'éthique de vie. La publicité s'est d'ailleurs arrogé dans la foulée le droit de présenter en permanence les définitions esthétiques du monde prévu à l'effet d'une telle éthique. Deux des nouvelles bibliothèques d'Alexandrie on déjà brûlé et le nouvel Erostrate est assuré de l'immortalité réelle, celle de la mémoire des hommes. Eternel retour du même.
La différence ontico-ontologique. Voilà le gros morceau qui veut dépouiller la conscience universelle de sa propre certitude ontologique, l'exproprier de l'Être postulé " seulement auprès de lui-même ". Il faut essayer de comprendre toutes les implications de cette expropriation, et lorsqu'on fait cet effort on tombe immanquablement sur le système de castes intellectuelles qu'autorise l'idée d'une gradation de la réalité qui s'appuie précisément sur cette différence fantasmatique. Dans les quelques millénaires qui nous précèdent, on aura tout essayé pour à chaque fois légitimer de toutes les manières possibles cette idée d'une quantité décroissante de sublime dans le monde dans lequel nous existons tous selon les mêmes modes, besoins, désirs et nécessité. Or c'est sur une telle décroissance que s'est toujours à nouveau calqué la formation des classes sociales, et nous pouvons le constater aujourd'hui même, alors que la gradation de réalité est définitivement passée dans la marchandise et dans la maîtrise de ses flux : dans notre système de formation des êtres humains, dans leur éducation essentielle, ce sont les écoles de Commerce qui forment les nouvelles académies où l'on traite de la nouvelle ontologie marchande. Mais, contrairement à ce que pensait Marx, ceci n'est en rien différent des autres " envois " de la différence, de leurs autres exploitations historiques successives, où l'on a vu cette gradation se déplacer de la violence pure de l'impérialisme vers la Religion, et de la Religion vers la Science et la Technique. La hiérarchie marchande n'est qu'un succédané de ces autres échelles de valeurs, au sens où comme tout succédané elle a perdu sa fixité et son enracinement dans la durée, Heidegger aurait utilisé ici le mot de solidité. Il y a entre l'éthique guerrière des Grecs ou des Romains et notre monde un affaiblissement continu de cette volonté d'affirmer la différence, au point d'en arriver à ce véritable cri d'alarme que pousse Heidegger au plein milieu de l'effondrement de la volonté en tant que telle, c'est à dire telle que l'avait lancée dans le jeu de quille du monde un certain Nietzsche quelques décennies au paravent. Nietzsche avait parfaitement compris les enjeux de la valeur et il est vrai qu'il n'y a nullement renoncé, mais non pas comme le prétend Heidegger pour repeindre l'étant gris sur gris, c'est à dire le transformer en détermination des valeurs, mais beaucoup plus simplement pour affirmer la seule différence qui restait à exploiter métaphysiquement, celle que postule la volonté de puissance humaine en tant que telle, sans chichi. Que le plus fort gagne est la réponse aujourd'hui devenue Leitmotiv du libéralisme, héritage de la transgression cynique opérée par le père de Zarathoustra. L'éternel retour du même se révèle ainsi comme un pur et simple retour à la barbarie la plus primitive, issue des premières tentatives d'associations humaines. Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre et il faut bien prendre conscience que ce pourrait n'être qu'un simple commencement, ou recommencement.
Il faut pourtant nuancer le propos, non pas sur le fond mais sur la forme. Car cette différence, la différence ontico-ontologique, s'est certes présentée, dans l'histoire sous une forme qui n'a pas toujours seulement servi les intérêts immédiat des souverains temporels. La différence, et nous en avons abondamment parlé, porte aussi en elle l'idée d'une coupure gnoséologique entre l'homme et la réalité, entre la conscience et l'Être. Quelles contorsions ne faut-il pas à un génie comme Spinoza pour trouver un lien cohérent entre Dieu et l'homme, pour rendre à ce dernier une liberté qui s'évanouit d'un coup dès la première définition ! Or Spinoza est un homme simple et bon, et nous ne parlons pas ici de sa personnalité historique dont la description ne ferait que corroborer cette affirmation morale, mais de la simplicité et de la bonté de son esprit, de son intelligence du monde. On pourrait peut-être résumer sa position dans ce débat ontologique de la manière suivante : au lieu de valoriser le gain de réalité par le savoir, il valorisait la diminution du manque de savoir comme seul et unique fondement moral et jamais nulle part comme fondement d'une quelconque souveraineté de qui que ce soit sur quoi que ce soit. Comme les théologiens négatifs, il avait établi effectivement une coupure gnoséologique radicale entre l'Esprit humain et celui de Dieu, tout en maintenant une sorte de sainteté naturelle de la conscience humaine en tant que de nature divine. L'esprit humain n'a accès qu'à des idées d'affects du corps et des choses, mais ces idées sont en Dieu, et l'esprit grâce auquel l'homme accède à ces idées est de nature divine. Que signifie cette expression, nature divine ? Seulement ceci : de l'Être, de Dieu, nous en sommes. Nous ne sommes pas en lui comme une huître est dans sa coquille, mais nous sommes en lui sur le mode immanent et en tant que partie des attributs infinis de sa nature. Voilà la seule certitude ontologique qui puisse avoir un sens non biaisé par des limitations artificielles et des impératifs de réalisme politique sans phrases. Et il est étonnant de constater que l'Ethique de Spinoza, qui représente la seule et unique grande réconciliation entre le Dieu de l'Ancien Testament et celui de l'Evangile n'ai même pas eu les faveurs des quelques théologiens indépendants qui ont marqué les époques suivantes à l'exception peut-être de Jacobi qui avec Boehm demeure l'une des sources principales de l'originalité de pensée de Hegel. Ni Schelling, ni Schleiermacher n'ont compris l'enjeu de ce texte, peut-être n'y eût-il que Hölderlin chez qui se sont reformulés dans un contexte totalement différent des intuitions proches de ce qu'on a appelé avec mépris le panthéisme de Spinoza
Notes
1 - Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, NRF, Gallimard, 1990, page 187
2 - Hegel, ibid, page 57
Dimanche 4 janvier 2004
Volonté et différence.
Revenons quelques instants sur ce que nous avons appelé un peu pompeusement l'usure de l'Être. Cette expression n'a, bien évidemment, aucun sens autre que métaphorique, sauf si l'on acceptait de souscrire à la thèse désormais courante d'une " naissance " de l'Être comme concept chez quelques personnages plus ou moins mythiques comme Parménide. Thèse, je dois le reconnaître, à laquelle je semble avoir souscrit moi-même dès l'entame de ce texte, mais que je me suis empressé de nuancer en préférant penser que de tels personnages ne sont que les représentants, mis en avant pour des raisons publicitaires par le platonisme, d'une éthique de penser beaucoup plus générale dans l'aire grecque et dans son environnement sans doute beaucoup plus vaste que la seule Méditerranée ou même l'Empire Perse (1). Si, cependant, on fait crédit à l'école allemande et à son idée de " miracle grec ", alors on peut dire que l'Être en tant que concept est usé, troué comme un vieille chaussette et ne peut plus avoir cours autrement que comme une distraction d'historien des significations. Or une telle interprétation de l'Être et de son concept me paraît parfaitement absurde. D'abord pour une raison toute bête de date, d'époque, en un mot d'histoire. Comment pourrait-on, autrement qu'en se repliant résolument sur cet ethnocentrisme que Derrida a, avec génie, renvoyé au diable, justifier une telle découverte ? Sans m'enfoncer dans la théorie de l'idéologie selon Marx ou Althusser, il me paraît tout simplement impossible de penser que la pensée de l'Être et de l'Un puisse naître ex-nihilo dans un contexte qui, dans les faits, n'a en rien changé depuis pratiquement un millénaire. L'histoire de la Grèce antique, la peinture de son acmé et celle de son déclin n'en font rien de très original par rapport à ce qui précède ni par rapport à ce qui suit. La seule et unique rupture historiale, celle-là, réside dans le passage de ce qu'on pourrait désigner comme une ontologie naturelle, l'intuition universelle d'une appartenance à un tout, à une morale politique et à une praxis sociale entièrement neuve et révolutionnaire non seulement pour l'époque, mais encore pour toute l'aire dont nous parlions plus haut, à savoir la Démocratie. Les familiers de la Guerre du Péloponnèse n'ignorent pas l'intrication profonde des puissances étrangères à la Grèce dans le conflit, et l'importance des alliances contractées par les uns et les autres, que se soit avec l'Empire perse ou avec l'Egypte, sans parler de la Phénicie, des puissances italiotes et de Carthage. Athènes et sa démocratie avait, en réalité, déclenché une Sainte Alliance contre elles, tout à fait comparable avec ce qui a suivi les deux premières années de la Révolution Française. Lacédémone n'a guère joué qu'un rôle de cinquième colonne si l'on fait le compte de ses nombreuses défaites directes contre les troupes athéniennes et si l'on retient que la défaite finale des Ioniens a lieu en Sicile, dans une Grande Grèce où les formes politiques de la métropole ne se sont partout retrouvées qu'en position de refuge et donc dans une faiblesse structurelle permanente. Syracuse ou Messine passaient de la démocratie à la tyrannie ou à l'oligarchie au gré des vents qui portaient ou emportaient les flottes des uns et des autres. Platon en a fait l'amère expérience.
Par conséquent, il faut froidement revoir toute cette histoire, des formes politiques et de la pensée. L'enjeu du basculement de l'ontologie naturelle dans le politique est, pour nous, quasi impossible à évaluer tant le brouillage idéologique du platonisme et de l'aristotélisme a été génialement conduit puis amplifié par le Christianisme. En fait, ce basculement était la réponse à une recherche qui n'a jamais dû cesser depuis le moment crucial où furent fondées les premières sociétés dignes de ce nom, les premiers ensembles d'humains sédentaires. Car cette recherche n'avait pas d'autre but que de trouver la possibilité effective - et ici j'emploie à dessein ce mot de Hegel - d'assurer la vie en commun, et non seulement la vie en commun, idée qui n'a de sens que depuis Aristote, mais la garantie de l'épanouissement humain, de ce que Aristote lui-même appelle si bien l'entéléchie. Or la démocratie, comme nous avons tenté de le montrer plus haut, a été cette réponse tant cherchée, elle l'a été au point que son " concept est sorti de lui-même " pour se répandre sur la presque totalité de la planète, étrange retournement de situation pour les vainqueurs de Sicile. La taupe a bien travaillé, certes, mais le résultat présent est loin du modèle initial, très loin de ce que produisit un jour à Athènes le déchirement oedipien de la constellation génétique, la forclusion politique du génos. En réalité, le résultat, à savoir la forme représentative de la démocratie, n'est plus dans son véritable concept de représentation : il ne représente plus les voix individuelles des dèmes, il ne traite plus de la volonté singulière dont les sommations ordonnent la Constitution et les lois. La forme moderne de la représentation est une fausse représentation, elle ne fait qu'établir de multiples consensus autour des oligarques des nouvelles oligarchies. Elle contraint l'individu à confier aveuglément ses intérêts à des représentants en perdant ipso facto tout contrôle sur ce qu'il fait. Mais ce qui est plus essentiel est que le politique lui-même n'est plus, dans notre démocratie, conçue originairement comme représentation, c'est à dire comme drame provisoire, comme libre jeu des affrontements lyriques, c'est à dire en dernier ressort ontologiques.
Ce détournement, cependant, n'est que partiel, et il est fatalement lié à l'augmentation démographique incommensurable des sociétés si on compare les nations d'aujourd'hui à celle de l'Antiquité, même les plus vastes. Comme Rousseau le fait remarquer dans le Contrat, il y a un nombre d'or de population pour que la véritable démocratie soit possible. Au-delà de ce nombre, la démocratie ne peut plus se concevoir autrement que par le recours à des représentants d'ensembles et de sous-ensembles de la société. Mais cette fatalité n'est recevable, logiquement et moralement, que dans la détresse des sociétés devenues des sociétés de masses, et des sociétés qui continuent de se définir comme des sociétés immobiles, sédentaires, confinées dans des concepts de régions, de nations ou de sous-régions continentales. En fait, le modèle athénien atteint ainsi ses limites, des limites non certes principielles, mais des limites de pertinence pratique du concept. Il n'est pas difficile de constater aujourd'hui dans l' Europe des quinze, que toutes les petites nations réussissent à mettre en œuvre une forme beaucoup plus pure de démocratie que les grands pays, condamnés à enfermer tout le débat dans un bipartisme à l'américaine qui est devenu un véritable système de cooptation par alternance, de personnes et de politiques. Ces petits pays peuvent, de par leur taille réduite, gérer des coalitions représentatives selon une stricte proportionnalité, ce qui est bien le minimum dans une démocratie qui reste malgré tout bourgeoise. Ce qu'il faut prendre en considération, pour bien comprendre que la démocratie est le seul principe qui rende possible la vie en commun, est le fait qu'il n'est que la transposition dans le monde sédentaire des règles naturelles du comportement humain et des relations qui ont lieu dans le cadre de la mobilité permanente des individus non massifiés en sociétés. Nous y reviendrons. Pour l'instant, il nous faut revenir à la volonté, à la certitude ontologique et à ce que représente l'histoire par rapport à ces deux phénomènes.
Nietzsche a tapé dans le mille, sans le savoir. L'envergure phénoménale de son intelligence et de son intuition lui ont permis de donner un contenu définitif à la métaphysique de la volonté telle qu'elle a émergé de l'idéalisme allemand et/ou du rationalisme français, en fait en tant que résultat final de la métaphysique envoyée par le socratisme. Au beau milieu du plus gigantesque processus de massification des peuples, à l'heure où se formaient réellement et pour la première fois de véritables sociétés conscientes de leur concept, il lance une grenade philosophique dans le tas qui aura, un siècle plus tard, l'effet contraire de celui qu'il escomptait puisqu'il donnera le fascisme, mais qui s'avère comme la seule solution envisageable dans le cas de ce qui s'annonce, à savoir la disparition de la société, la dissolution du sociétal. L'explosion deviendra plus tard, sans d'ailleurs qu'il en soit pris réellement conscience même sous nos yeux, le retour de l'homme à sa réalité individuelle si longtemps occultée par toutes les puissances matérielles et intellectuelles de l'époque occidentale. Stirner comme Feuerbach n'avaient que désiré cette volte du destin humain, et leur audace ne pouvait moralement que retomber au niveau le plus nul de la morale chrétienne, et qui pis est, catholique. En cela la méchanceté réelle et parfois injuste de Marx à l'égard de Stirner ne rate pas sa cible (2). Il montre avec une cruauté qui révèle d'ailleurs a contrario l'importance et le danger qu'il pressentait dans l'intrusion de Stirner qui mettait en danger l'idée d'une organisation du prolétariat, que l'auteur de l'Unique et sa Propriété de même que Feuerbach, restaient prisonnier de la gangue petite-bourgeoise de l'intelligentsia allemande. Les deux philosophes n'ont cessé, en effet, de vouloir composer avec le monde qui les entourait et ne pouvaient concevoir, dans leur désir exclusivement explicatif, voire scientifique à la manière hégélienne, que le monde en question avait fait son temps. Hegel lui-même, dans sa Préface à la Phénoménologie de l'Esprit, avait au moins eu l'intuition de ce déclin ; les deux guerres mondiales et tout le tintamarre qui a suivi n'ont rien changé au sens réel et prophétique de sa fameuse comparaison du développement de l'enfant avec le procès de l'Esprit : -" L'insignifiance et l'ennui qui envahissent la réalité, l'impression indéterminée de quelque chose d'inconnu en marche sont les signes qui annoncent quelque chose de nouveau. Ce tissu mité des choses quotidiennes qui ne change pas pour autant la physionomie du tout, se déchire d'un seul coup, et en un éclair se dessine les contours d'un nouveau monde "(3). Son erreur réside simplement dans cette immédiateté qui est le cauchemar de tous les métaphysiciens et qui s'est réfugiée à son insu dans son propre concept d'effectivité. Il a pensé que le nouveau monde était sur le point immédiat d'accouchement, car ce nouveau monde était celui de l'Esprit Absolu, le savoir définitif qui reposerait dans le Concept revenant en lui-même après son détour dans l'Histoire. Ce ne serait pas grave, car je pense que tous les philosophes, sauf, encore une fois, Spinoza, se sont leurrés de la même façon, mais la gravité ne se situe pas dans le fait qu'un penseur d'envergure se trompe de date, elle se situe dans la libération des forces morales que cette erreur autorise. Et par morale j'entends ici par la certitude désormais aveugle qui légitime la dictature du sujet. La certitude ontologique échoue ainsi en certitude historiale qui mène un continent vers l'assomption réale d'un étant défini comme objet de la maîtrise conceptuelle humaine et vers celle de toute Real Politik ultérieure. Bismarck, encore lui, n'est que l'accomplissement sans contenu de la philosophie du droit et de l'état de l'illustre penseur berlinois. Et il faut bien reconnaître que ce n'était pas si raté que cela puisque le célèbre Chancelier a quand-même accompli pour sa nation le rêve de Machiavel tout en menant une politique de stabilité européenne sans précédant dans son intention morale. L'erreur de Hegel était qu'il ne suffit pas d'un bon élève dans une classe pour ouvrir toutes grandes les portes d'une nouvelle histoire, car les Guillaume se suivent et ne se ressemblent pas, le bien n'est pas mécanisable dans le temps selon une Logique conceptuelle. Encore une fois, Spinoza. La certitude mécanisée en trois articulations, le cogito, la raison et le concept, non seulement n'entame en rien la certitude ou l'inquiétude ontologique qu'elle reconduit finalement devant les autels des églises, mais elle ouvre un règne pratique où il suffit aux souverainetés ontiques de se parer du rationnel pour assurer leur réel. Je dis bien parer, car à l'évidence aucune certitude non fondée sur la certitude ontologique elle-même et dans toute son extension, ne peut vouloir prétendre fonder un concept et encore moins une quelconque gestion de la liberté humaine. Celle-ci, la liberté, n'a que deux sources : la volonté et la question de l'Être, deux sources qui n'en font en réalité qu'une seule, la volonté de l'Être dans le double génitif de cette attribution.
C'est ici que la subjectité dont accouche la métaphysique se confronte avec la solitude de sa volonté. On peut contempler la manifestation historique de cet événement dans la poésie d'un texte comme le Zarathoustra, le tragique d'un Mort à Crédit ou bien encore l'épouvante d'un Faulkner. Mais la réalité se charge par ailleurs de finir le travail en posant de plus en plus crûment et sans fards la déréliction sociale de tout individu, son retour à l'état sauvage au cœur même de la civilisation. Pourtant, l'état rationnel, l'état hégélien + la démocratie, avait donné, à travers quatre révolutions et une Guerre de Trente ans la France républicaine, sa Constitution, ses Institutions, ses Lois et sa morale de la solidarité. Vaille que vaille, l'Europe en pièces détachées suivait, parfois précédait, la structuration d'une nouvelle vie collective paradoxalement protégée par ce qui se passait au-dessus de sa tête entre le libéralisme américain et l'utopie mécanique des Soviets. La guerre froide fige alors la réalité politique de l'ancien Empire romain dans une sorte de cocooning social informe où l'humanisme prend la forme d'un règlement d'hôpital. Mais les dernières formes de volonté collective sont ailleurs, même celles qui ont planifié, ont entrepris et se sont mis à construire la nouvelle Europe, même cette volition laborieuse et froidement menée, ne procède par de la volonté des Européens eux-mêmes. Les autres en ont eu besoin dans une dialectique d'affrontement qui avait en vue l'homme mondial, ou plutôt le système d'une société mondiale. Adam Smith contre Karl Marx, une joute métaphysique dont ne sortira d'autre vainqueur qu'un Homme moralement épuisé, aux prises avec les débris de tous les systèmes, de toutes les représentations, en fait un terrain vague du monde où il prend lentement conscience d'une précarité d'existence qu'il avait fini par oublier.
Entre-temps, le monde lui-même se ratatine comme une peau de chagrin. L'espace devient irréel, le temps devient réel. Les distances ont cessé de compter, elles ne sont plus qu'un mode de déplacement, un prétexte à user de ce qui reste de la dynamis et de l'energeia, à savoir la vitesse qu'autorisent les " seconds " moteurs qui se sont mis à pulluler comme les poux de Lautréamont. Le Temps, lui, s'est mis à cheminer vers le cœur de l'âme transformée en sablier des secousses désirantes ou passionnelles, quand le désir et la passion n'ont pas cédé la place à la délectation morose marchande. L'homme se retrouve ainsi dans une situation tout à fait nouvelle, non pas nouvelle en soi car elle appartient formellement à son essence, mais tout à fait neuve pour son être real, dans l'ouverture ou l'exposition de l'homme à la vérité de cette essence, la situation de la solitude du nomade. C'en est fait de la volonté commune, du projet ou de la praxis collective, d'un monde où l'adulte peut rester un enfant tant qu'il accepte de s'inscrire dans une idéologie porteuse de représentations fixes, qu'elles valent pour cette vie-là, ou bien qu'elle désignent le destin dans son éternité. Il est désormais requis de chaque individu de vouloir au sens d'un vouloir absolu, plein et sans marges dans lesquelles il pouvait encore espérer exister par les autres ou dans les projets des autres. Ici encore il ne faut pas mal comprendre les implications a posteriori de ces affirmations : ce qui s'exprime ici ne signifie en rien que la volonté individuelle est au chômage depuis la nuit des temps, ni non plus que cette volonté ne s'est jamais manifesté que parmi ceux qui ont accaparé la souveraineté d'une manière ou d'une autre. La nouveauté réside précisément dans la réquisition de l'individu comme son propre souverain. Jadis, hier encore et pour l'apparence de la majorité aujourd'hui encore, l'homme semble toujours être celui qui signe un contrat dans un système de souveraineté quelconque. Or, c'est cette signature qui devient impossible : même la servitude la plus totale ne peut plus figurer dans le contrat qui lie un individu à un ou plusieurs autres, parce que cette servitude n'est jamais suffisante en elle-même, elle trouve toujours de la concurrence sur son propre terrain.
Car la signature aussi est volonté. Si les sociétés sédentaires ont eu une possibilité d'existence, ce n'est que parce que la volonté de chaque homme pouvait aussi se manifester par la limitation de ses ambitions et même de sa volonté de survie dans une réalité donnée. Les contrats imaginés par Rousseau comme par Hobbes ne sont que des fictions de gens de Lettres et de fonctionnaires d'état, des fictions qui reposent entièrement sur le postulat d'un inconscient collectif qui décide de la réalité de l'ensemble. Car la, leur réalité sociale est toute autre que celle d'une mécanique historiquement établie et fixée, elle n'est jamais que le jeu empirique et toujours provisoire des accords que se passent entre elles des puissances morcelées, changeantes et réellement insaisissables. De Babylone à New-York, il n'a jamais existé de société d'aucune sorte, et c'est bien le message que délivre entre les lignes le grand œuvre philosophique de Marx, jamais édité de son vivant tant il était gênant pour tout le monde, l'Idéologie Allemande. Ce qu'autorisait l'époque métaphysique n'était pas la formation de sociétés, mais l'association de malfaiteurs tels qu'elles se formaient dans l'oligarchie des nations, et dans les efforts d'unification de ceux qui refusaient les souverainetés qui en étaient le produit. On ne comprendra jamais assez bien le caractère permanent de guerre civile qui marque l'histoire occidentale car il est trop tentant de projeter vers le passé un état dont on a besoin dans le présent. Ce fut le travail des historiens patentés, des philistins de Nietzsche, que de promouvoir l'image d'un passé rationnel dont le fond structurel ne se différenciait pas tellement de la situation générale dans laquelle se déroule l'existence de l'homme moderne. Or la mission de ces historiens, notamment ceux du Dix-Neuvième siècle, n'était pas de donner une forme au passé, mais de garantir par leur discours mensonger la légitimité des formes de leur présent. Le siècle des révolutions, en fait, annonçait la fin de la possibilité des alliances des souverains en même temps que celle des rebelles. Le " Prolétaires unissez-vous " était le chant du cygne de la dynamique naturelle qui unissait les sans-terre du monde entier, car ce slogan ne pouvait dans son essence que promouvoir la continuation du jeu des puissances par un renversement que rien ne permettait, et on l'a bien vu par la suite, de différencier des jeux classiques des pouvoirs. Pourquoi ? Seulement parce que l'exhortation à l'union se présentait comme la négation d'une union naturelle qui n'avait nul besoin de parti ou d'organisation pour agir en tant qu'association. En langage cru on pourrait nommer cela du foutage de gueule. Les situationnistes ne se sont jamais trompé sur un point précis, et il est signifiant de constater que tous les commentateurs ou historiens qui ont prétendu faire l'histoire de ce mouvement révolutionnaire passent ce point sous silence. Leur idée théorique essentielle était que les révolutions n'ont jamais été le fruit du travail de partis, de syndicats ou d'organisation de quelque genre qu'ils soient, mais qu'elles ont surgi des masses parce que la pensée révolutionnaire ne vit pas ailleurs que dans les masses. Bien au contraire de ce que les historiens ont peu ou prou réussi à faire circuler comme vérités, les associations de tout poil ont toujours fini par pactiser avec l'adversaire, l'histoire réelle pullule de ces Accords de Grenelle destinés avant tout à faire triompher l'ordre régnant. Un événement récent, celui qui doit paraît-il signer l'arrêt de mort du communisme, à savoir la fin de l'Union Soviétique, n'est rien d'autre qu'une trahison collective du Parti Communiste de l'URSS. Les malfaiteurs au pouvoir n'ont rien fait d'autre que d'admettre que leur méthode de domination des masses n'était plus à la hauteur des enjeux de la véritable puissance qui entre-temps a vu le jour sur la planète. Quelle autre preuve faut-il que le constat d'un transfert unité par unité des individus qui formaient l'état communiste vers le nouvel état dit libéral ? Le fait que ce soit un fonctionnaire de la police secrète qui surplombe tout cela aujourd'hui ne fait que livrer une autre clé de notre histoire occidentale, celle de la toute-puissance de la dissimulation et du mensonge.
La vérité est que l'homme n'a jamais été seul. Il a sans aucun doute il y a très longtemps, vécu dans une solitude relative, dans un état nomade qui ne signifie pas forcément, d'ailleurs, un isolement absolu. Entre le Robinson des fictions littéraires et la Horde d'Or, il y a des identités et des différences, mais une chose est sûre, c'est que la forme métaphysique de souveraineté, celle qui domine l'occident depuis la haute antiquité, n'est concevable qu'à partir d'un certain seuil démographique, un seuil qui contraint les communautés nomades à se sédentariser ne fût-ce que partiellement. Ce qui explique, entre-autre, que les grands ensembles nomades n'ont fait qu'une brève carrière dans l'histoire connue ; elles n'ont pas su se reconvertir à temps en structures territoriales. Le retard civilisationnel (Dieu que ce mot est laid !) qu'avait pris la Russie du temps des Tsars provient très exactement de la survivance et de la prédominance du nomadisme dans l'espace le plus vaste du monde. Ceci expliquant cela, c'est aussi la plus grande barbarie qui prévalut comme méthode pour créer la Russie d'Yvan le Terrible et de Pierre le Grand. Pourtant, cette solitude relative du nomade, telle que nous la révèle par exemple l'ethnographie de l'Amérique du Nord, mieux étudiée en définitive que l'Afrique dont on n'a pu observer que des débris post-coloniaux, n'a pas comme corollaire l'état de nature selon Hobbes ou Rousseau, ou l'état de sauvagerie selon Schelling. Elle ne peut pas être autre chose que la préfiguration de ce que nous sommes en train de devenir ou de redevenir : des êtres humains contraints d'une part à survivre dans un milieux hostile, et d'autre part à n'entendre plus que le murmure de notre âme et de notre propre pensée pour affronter l'existence en tant qu'existence. Le temps est déjà venu où la philosophie elle-même ne s'intéresse plus que marginalement à cette question tant les impératifs de l'intégration contraignent ses professionnels à perdre leur temps à conjurer la désintégration sociale et le mal-être-ensemble de l'individu. En perdant l'école, l'homme ne perdra pas grand chose à devoir reconstruire lui-même les bases de la question de l'Être, car l'histoire métaphysique a porté ses fruits, le capital de l'Être s'est augmenté de son usure. En produisant la différence, que l'on peut effectivement tout aussi bien nommer différance, la métaphysique occidentale n'a pas seulement exposé l'Être à toutes les falsifications et à toutes les exploitations idéologiques, elle l'a aussi mis paradoxalement à l'abri. Cette mise de l'Être sous la protection de la représentation ne peut être interprétée que de deux manières : la métaphysique - onto - théologique propre par exemple à Schelling. Schelling raisonne à l'envers de ce que nous tentons de montrer ici, mais sur le fond il part des mêmes présupposés à savoir l'originarité de la question de l'Être chez l'homme. L'homme a toujours été, dès son apparition, saisi par l'Être. Néanmoins, la position de Schelling reste totalement théologique puisqu'il considère que la différence ontico-ontologique est un projet de Dieu lui-même, projet dialectiquement conduit à travers le polythéisme afin de donner à l'homme la liberté d'être, c'est à dire de rester, ou de ne pas être, c'est à dire de cesser d'être en quelque sorte prisonnier de la volonté divine, à l'intérieur de son amour sans limites et sans exigences ou demande de retour. Le second mode d'explication de la dissection mentale qui aboutit à la différence ontico-ontologique, qui n'est en dernier ressort rien d'autre que l'idée de deux niveaux d'existence psychique, est celle d'une volonté délibérée de dédoubler le présent dans la représentation pour des besoins purement techniques, instrumentaux. Et contrairement à ce que pourrait laisser entendre la tendance traditionnelle de tout attribuer aux contingences de l'histoire ou de l'évolution, il faut envisager une telle décision dans une absolue antériorité par rapport à son objet ou à sa finalité. En réalité, la différence ontico-ontologique appartient en tant qu'instrument de pensée, c'est à dire d'action, à l'outillage intellectuel universel de tout être humain aussi " primitif " ou isolé qu'il soit. La différence qu'on introduit entre les choses elles-mêmes et leur idée, ou encore entre celle de leur essence et celle de leur existence, n'est qu'une mise en scène permettant de prendre du recul par rapport au présent pour toutes sortes de motifs. La diplomatie, par exemple, est la mise en scène d'une pièce de théâtre qui se joue en général sur une scène éloignée et qui doit représenter la vérité ontique de l'état des relations entre deux souverains. Le simple dialogue entre deux personnes ressortit exactement aux mêmes impératifs de la différence devenue intrinsèque au langage, car originairement chaque " Unique " doit être pensé comme souverain. Seulement, ce qui change avec l'Histoire, c'est à dire avec le choix de la civilisation sédentaire, c'est que cette différence - que l'on peut tout aussi bien retrouver en Chine sous les traits du rite, ou chez les Grecs sous ceux du rythmos - devient le cadre permanent de l'existence parce que celle-ci s'est toute entière intégrée au projet de la société, au projet d'un habiter le monde en commun.
L'homme est seul avec sa volonté. Il ne peut jamais et aucunement se soustraire à la responsabilité à laquelle l'engage la volonté, non pas la volonté divine, non pas la volonté souterraine de l'inconscient ou je ne sais quelle puissance objective qui viendrait alléger le poids de cette nécessité volitive et lui ôter le fardeau de cette responsabilité. L'Âge d'or a été certainement l'époque où cette volonté, parce qu'elle n'était portée que par des hommes souverains, pouvait agir dans une communauté, c'est à dire s'exercer dans un partage. Les grandes options civilisatrices ont été prises par de telles communautés de volontés égales, égales dans leur solitude et égale dans l'évaluation du sens de leur être-là. Par la suite cette volonté commune s'est pour ainsi dire disloquée comme une banquise pour se réfugier dans le sujet à travers toute une histoire de sous-communautés, toute une histoire de la naissance et du règne du collectif. Il faut reconsidérer toute l'histoire que nous pensons connaître selon une image de l'évolution sociale où la souveraineté se sépare de la volonté individuelle comme de son double pour exister à part, selon la logique de la fortune et en trahison ouverte du sens originel de la volonté commune. On peut noter que jusqu'au nazisme, et peut-être dans quelques grandes tyrannies comme celle de Timur Lang, le fameux Tamerlan, le sens originel de cette volonté commune à savoir la primauté du souci ontologique - qui fonde en réalité ou en essence toute véritable souveraineté comme le suggère par exemple la fonction impériale dans l'ancienne Chine - n'a jamais cessé de ressurgir, selon des envois qui sont loin de n'être que les voltes théoriques des philosophes ou des théologiens, mais aussi selon des retours à la volonté commune en acte dans la violence et toujours aussi la gaieté des révolutions. Allons plus loin dans la fiction historique et poétique et affirmons avec insolence que l'essence de la volonté et communautaire parce que l'homme seul, l'homme isolé n'a en réalité nul besoin de volonté. Pour un être contraint par sa solitude à prendre sur lui-même la totalité des champs de conscience et à inventer pour chacun d'eux sa propre réponse au prix de sa vie, la volonté n'est rien d'autre qu'une réponse possible et naturelle à l'exigence du contingent, il ne peut pas parce qu'il n'a aucune raison de le pouvoir, anticiper son action dans le sens de ce qu'on attribue aujourd'hui à la volonté individuelle. Autrement dit, en réduisant son topos, son lieu d'exercice dans l'individu, dans le sujet métaphysique, la volonté s'est dénaturé comme on dit de certains alcools qu'ils sont dénaturés. En perdant son sens, c'est à dire le contenu du projet de la civilisation elle-même, la volonté s'est séparé de sa substance morale originairement garantie par l'égalité des fondateurs.
Le moment est venu de dissiper l'une des illusions les plus tenaces de l'époque dans laquelle nous vivons et qui consiste à croire que les hommes ont gagné en culture et en moralité. Les images mentales académiques sont indélébiles qui représentent les masses humaines des siècles passés comme des troupeaux de bêtes ignares que l'école carolingienne ou républicaine seraient venus sortir de leur barbarie naturelle. La littérature du Dix-Neuvième siècle, cinquième roue du carrosse métaphysique en perdition, a beaucoup fait pour la fabrication de ce monstre poilu et puant que devait être le cerf du Moyen-Âge ou l'ouvrier des ateliers de Manchester au Dix-Huitième siècle. Dans toutes ces représentations idéologiques, l'homme d'aujourd'hui a de quoi se délester des horreurs climatisées du présent en laissant divaguer son imagination dans un passé plus noir que l'enfer, sans la plupart du temps prendre garde aux paradoxes et aux contradictions qui naissent des autres parties de son esprit tourmenté et qui le porte sans cesse au regret du passé, à la valorisation du bon vieux temps. La réalité d'une évolution entre les hommes d'hier et nous-mêmes est toute autre, elle peut même se décrire comme le contraire de ce que nous pensons communément. La conscience individuelle et la moralité de chaque homme d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi pauvres. Et ceci comprend aussi la culture dans son sens essentiel, un sens inséparable du degré de conscience et du degré de moralité, c'est à dire aussi du degré de liberté. Au fait, tout cela figure mot pour mot dans le Zarathoustra, poème qui à sa manière décrit le naufrage de ce Titanic que fut la volonté commune. La solitude de l'ami des serpents et des aigles n'est pas la solitude d'un homme éclairé dans des masses aveugles, elle est la solitude de la volonté dépouillée d'elle-même, c'est à dire de son sens. L'expression volonté de puissance trahit clairement cette impasse qui a conduit Nietzsche dans une surenchère ipséiste où le sujet n'est plus qu'un sujet vide. Ce vide est bien entendu le vide de souveraineté (puissance), essence de la possibilité de la volonté, vide qui engage la conscience dans un Trieb, une pulsion univoque vers la souveraineté abstraite, sensée répondre aux réquisits d'un royaume instinctuel imaginaire reconstruit de bric et de broc à partir des débris desdites valeurs. Il faut avoir le courage d'admettre le pire, à savoir que nous sommes devenus les sauvages de la légende, que nous sommes descendus au degré zéro non seulement de la moralité, ce que personne n'oserait contester, mais encore tombés dans la nullité du savoir le plus trivial. Ce savoir ne brille plus de nos jours que par les éclats furtifs que renvoient les poussières d'une culture en mosaïque, comme disait le psycho-sociologue Abraham Moles. La conscience de cette éclipse de l'humain est partout présente mais ne trouve nulle part le courage ou l'héroïsme de son exposition systématique et générale. Elle fait peur.
Notes.
1 - Il s'est trouvé il y a peu d'années, je dis cela en passant, un archéologue de renom dont je tairai le nom par respect pour sa famille, qui défendait l'idée apparemment bien ridicule d'une rencontre entre Bouddha et Epicure. Même si les collègues de ce chercheur un peu téméraire et aujourd'hui décédé se sont évertué à démontrer l'impossibilité d'une telle rencontre, j'en retiens pourtant l'idée que ces mêmes savants ne répugnent pas à envisager une telle circulation intellectuelle, même si dans le cas d'Epicure et de Bouddha les dates ne peuvent pas coïncider.
2 - -" Ainsi donc, quand son esprit veut s'émanciper vis-à-vis de lui, saint Max fait appel à sa chair, et quand sa chair se rebelle, il se souvient qu'il est aussi esprit. Ce que le Chrétien ne fait que dans un sens, saint Max le fait dans les deux. Il est Chrétien " composé " et s'avère, une fois de plus, être le chrétien accompli ". Karl Marx, l'Idéologie Allemande, Edition Sociales, 1968, page 290.
Hegel, Phänomenologie des Geistes, Edition Reclam, 1987, page 16, traduction libre.
Lundi 5 janvier 2004
Le monde nouveau.
Roger Chambon m'a confié un jour une sorte de résumé de sa pensée anthropologique en disant : -" Les actes humains sont entièrement déterminés par la peur " - . Nous étions en Mai 68, et cette phrase résonnait bizarrement au milieu du tintamarre des amphithéâtres de l'université de Strasbourg où le Professeur désœuvré malgré lui, aimait à se promener en devisant avec les étudiants. Son propos fleurait le paradoxe ironique face à une certaine haine que j'ai regrettée de la part de certains de mes plus jeunes cothurnes pour ce sceptique mélancolique très injustement accusé de fascisme intellectuel. Pour ma part, je ne manquais jamais d'écouter attentivement ce que disait cet homme bien que je n'adhérasse en rien à cette sorte de dandysme de haut niveau. Depuis, le tour qu'a pris ma carrière dans le journalisme, et le pire d'entre eux, le journalisme télévisuel, la vie n'a fait que me confirmer cette sinistre sentence. C'est bien la peur qui gouverne les hommes et j'ai souvent été extrêmement surpris de devoir constater à quel point et pour quels genres de personnages cette vérité se confirmait jour après jour. Souvent même j'ai dû éclater de rire face à l'usage que l'on escomptait faire de cette réalité à mon égard, non pas que je me considère comme une sorte de héros, mais au regard des enjeux pour lesquels on se montrait prêt à brandir n'importe quelle menace pour faire susciter la peur et faire reculer la volonté de liberté. Il n'est pas inutile ici de donner un témoignage de l'intérieur du monde des médias et de confirmer ce que tout le monde pense tout bas sans oser en affronter les conséquences : la liberté d'expression a bel et bien déserté l'essentiel des conférences de rédaction qui se tiennent d'un bout à l'autre du monde, quel que soit le média considéré. On pourrait énoncer une loi quasi mathématique de ce phénomène en disant que le degré de liberté est inversement proportionnel au taux d'écoute, au lectorat ou à l'Audimat. La chose est désormais aussi certaine qu'elle le fut au plus sombre des années de plomb de tous les totalitarismes, plus grand est l'accès au public d'un média, moins les journalistes qui y collaborent ont une chance de pouvoir exercer leur liberté de penser et de s'exprimer. Les quelques livres qui dénoncent cette situation comme par exemple " Les nouveaux chiens de garde " de mon confrère Serge Halimi, demeurent encore bien en-dessous de la vérité car ils souffrent tous de ce parisianisme qui leur permet aussi, ceci explique cela, de paraître dans l'édition. Je mets quiconque au défit de me démontrer le contraire, or le plus triste est que même chez les plus courageux des intellectuels ce n'est la conscience du phénomène qui fait défaut, mais le courage d'y faire face. Le plus grand danger en ces jours qui correspondent si bien aux titres des pires ouvrages de Céline, est bien l'intrusion de la peur dans le monde de l'esprit.
Or cette intrusion a bien à voir avec l'évolution du statut de la volonté que nous tentions d'analyser plus haut, à savoir l'isolement de plus en plus angoissant des hommes, un isolement tel qu'aucun cri, aucun message, aucune expression des choses vraies et des situations en vérité, ne sauraient servir de moteur social à une " Modification ". Le silence, tel qu'y fait allusion le texte de Hegel cité plus haut, recouvre désormais le champ des actions humaines et chacun se retrouve peu à peu et à chaque jour avec un peu plus de certitude, livré à sa seule volonté et à sa seule responsabilité. Le paradoxe veut de surcroît que ce silence soit assourdissant. Les formes et les contenus des iniquités et des crimes s'étalent sans aucune pudeur sur l'agora médiatique, et l'individu est à chaque instant sommé de choisir son camp, dans l'autre silence, celui de son cœur et de son audace. Il y a quelque chose de surréel que seul des poètes comme Henri Michaux ou Yves Bonnefoy ont pu pressentir, prophétiser et stigmatiser dans leur langue. La poésie possède le privilège absolu de la liberté et donne pouvoir à ceux qui la fréquentent de fraterniser au-delà des contingences, mais cet au-delà est à la fois un refuge naturel, comme une cabane dans la forêt, et un obstacle à l'action parce que sa liberté procède de l'essentiel dont justement aucune histoire, aucune époque ne peut se revendiquer. Avec l'échec apparent de l'effort philosophique, la poésie est devenu " en ces temps de détresse (1) " le lieu naturel ultime de la question de l'Être, cette question qui s'est retirée de la volonté en la privant ainsi de son essence. Mais cette conjoncture est loin d'être neuve. De tous les arts pensants, la poésie s'est toujours manifestée en retrait de toute connivence avec les faits, ce qui a rarement été le cas dans le domaine des sciences philosophiques qui pourtant se hissent toujours a priori au-dessus des phénomènes. Ce retrait demeure cependant symboliquement lié à la structure transcendantale de la société occidentale, il figure certes l'altérité au mouvement métaphysique de notre histoire, mais comme son négatif. Dans sa réalité factuelle, la poésie partage le même état transcendantal que tout le reste de ce qu'on appelle la culture, parce qu'elle fait appel à un partage inégal du langage. C'est pourquoi les maîtres réels ont toujours pu et su accepter la critique et la contestation tant qu'elle restait pour ainsi dire domicilié au ciel des idées et du beau langage. Ces affirmations ne signifient en aucun cas qu'il n'existe pas une dimension poétique en partage dans les masses, mais cette poésie-là appartient en propre à ces masses et son destin esthétique est étroitement lié au destin de ces masses. Le langage des banlieues porte en lui l'avenir du monde des banlieues comme la Marseillaise a pu, pendant un temps, porter le destin de la Nation. En lui se chante le négatif immédiat et le rejet des formes sociales mais il ne peut jamais être plus que l'accompagnement narratif de la lutte qui a lieu, et de celles qui se préparent.
Le propos de Chambon est étroitement lié au nihilisme propre à sa vision du destin de ce qui se manifeste comme notre monde. Cette vision est de quelque manière irréfutable, mais cette fatalité inscrite dans le temps et qui prescrit la disparition nécessaire du tout, de ce tout qui est le nôtre, est une fatalité mathématique, une simple abstraction. Elle nous concerne exactement de la même manière qu'un fantasme comme par exemple la quête du Graal. Elle est pure rêverie mélancolique, station imaginaire dans un à valoir du néant tout à fait équivalent à la mort de chacun de nous, et Epicure a dit tout ce qu'il fallait dire à ce sujet. La mort n'est pas le sujet de la pensée. La peur qui pourtant règne en maîtresse dans notre existence ne concerne pas davantage la mort. Elle n'est que la manifestation concrète d'un vertige historial dont on peut mesurer l'importance à l'enjeu de sa cause : l'homme est désormais sommé d'assumer à nouveau sa souveraineté en reprenant en sa volonté propre et pour lui-même la question de l'Être. Tel est le résultat de notre Histoire, tel est le sens de l'affirmation de la métaphysique déterminant la volonté comme essence de l'Être et de la surenchère subjectiviste que nous devons à quelques hommes qui ont voulu détruire cette métaphysique en l'accomplissant. Ce qu'il faut avoir le courage d'affronter spirituellement, c'est la transformation de l'essence du monde dans lequel vivent les hommes. L'époque du sociétal est révolue, et cela au moment où l'homme planifie dans ses fantasmes une société mondiale. Le Retour du même est un vrai retour à la case départ du destin collectif dont on pourra dire plus tard qu'il n'aura été que l'idée instrumentale d'une époque, d'une parenthèse dans l'élaboration de la question de l'Être. Les hommes d'aujourd'hui se retrouvent un peu comme des enfants qui auraient retrouvé un de leurs anciens jeux, ou plutôt des circonstances identiques à celles de l'époque où ils pratiquaient ce jeu, mais dont ils ont oublié les règles. Le nomadisme forcé auquel les condamnent à terme la réalité concrète des relations qui règlent la survie, et en premier lieu le marché, fait peur parce que cette perspective détruit radicalement le fantasme de la civilisation immobile qui aurait vaincu l'anankè, la nécessité, la pénurie et le risque. Or le combat contre ces fléaux n'a jamais été le véritable telos, la véritable finalité de la civilisation. Les formes archaïques de cette civilisation montrent même que l'au-delà de la vie était le lieu réel de la préoccupation générale et que la vie elle-même ne comptait que comme préparation à cette autre vie. Les sépultures dont l'histoire a parsemé le monde sont la véritable matière de l'anthropologie et de l'archéologie parce qu'elles ont condensé les investissements spirituels des peuples. Le Christianisme a abondamment exploité cette sagesse spontanée qui faisait que les hommes de l'Antiquité tenaient réellement ce séjour dans la vie comme un simple passage vers l'essence de la Vie, devenue dans le monde conceptuel de la métaphysique, l'essence de la réalité. Mais il faut toujours se souvenir du fait de la primauté de la question de l'Être, non pas comme science réservée aux prêtres qui se sont emparé de son monopole, mais comme l'élément - on dirait aujourd'hui l'environnement - permanent du souci des hommes. On répète encore une fois : Platon et l'interprétation qu'en ont fait plus tard les religions, aussi bien d'ailleurs l'Islam que le Christianisme, a détruit cet environnement comme on détruit aujourd'hui les forêts. Il serait temps de comprendre à quoi correspond cette démolition industrielle du monde c'est à dire à la continuation pratique, active, de la démolition sociale de l'environnement spirituel originel. La fatalité de cette destruction est toute entière contenue dans la socialisation elle-même de la vie humaine : Platon est donc en quelque sorte innocent, mais innocent comme peut l'être un exécuteur des hautes œuvres, un bourreau, c'est à dire un homme dont la société a longtemps caché l'identité car il est, en réalité, censé ne pas en avoir, censé ne pas exister tant le sacrifice qu'il accomplit est inacceptable selon la loi fondamentale de la vie.
Cette primauté de la question de l'Être dans le souci quotidien avait donc comme conséquence logique un mépris résolu du fait de la mort elle-même : l'héroïsme qui est la vertu première d'un Grec, ce dont on limite l'essence en le faisant passer pour ce que nous appelons avec une certaine condescendance le " courage physique ", l'héroïsme est le désir d'une mort glorieuse, c'est à dire d'une mort conforme à l'engagement dans la volonté commune, de la volonté non encore aliénée. Or le monde moderne a fait de cet engagement dans la volonté commune, une simple adhésion aveugle à la communauté originelle de l'individu, ce qui est devenu le patriotisme ou le nationalisme. Mais les Grecs ne s'engageaient jamais seulement en fonction de leur cité ou de leur genos, mais en fonction du projet ontologique, c'est à dire de l'ontologie sous-jacente aux choix politiques de leur communauté. Ils étaient convaincus que leur séjour dans la mort, leur véritable destin, dépendait absolument de la conformité entre leur choix ontologique originel, c'est à dire la manifestation de leur liberté, et ce que cette option destinale impliquait sur le terrain de la guerre ou de la paix. Cette foi était tellement forte que chaque bataille, quelle qu'en soit l'issue, était suivie par le rituel de la remise des morts. Si on peut parler d'une loi de la guerre, ou d'un droit des belligérants, c'est essentiellement de ce droit de recueillir sur le champ de bataille les corps des guerriers morts et de les ramener dans son propre camp. Il y a très peu d'exemple dans les innombrables guerres que se sont livrées les états grecs où cette trêve des morts a été bafouée, et les historiens n'ont pas de mots assez durs pour stigmatiser ces événements exceptionnels considérés comme les plus sinistres qui soient. Le message de la tragédie d'Antigone est la prophétie d'une réalité lointaine, celle de notre présent, où les morts sont devenus des cadavres, des cadavres dont l'histoire récente nous a montré qu'on peut aller jusqu'à les recycler dans l'industrie.
Un autre phénomène caractérise l'histoire des cités grecques et de leurs querelles dont on a un compte-rendu extraordinairement précis chez Thucydide, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ambivalence politique de chaque camp. En apparence, les batailles s'accompagnent la plupart du temps de trahisons, au point que la tactique classique s'appuie le plus souvent sur le soutien d'une partie des membres de la cité adverse. Il ne s'agit pas, en réalité, de trahison, mais de la réalité de la scission idéologique de toutes les cités où les partisans de la démocratie apportent leur soutien aux attaquants qui représentent la Ligue athénienne, et inversement où les oligarques organisent la " trahison " dans une cité démocrate lorsque les troupes de Sparte sont en vue. Dans la grande guerre qui va de 1914 à 1945, on a vu des phénomènes semblables, il y a eu des résistances internes de même nature comme il y a eu des résistances internes aux guerres coloniales. Est-il besoin de noter qu'on serait loin du compte si nous devions comparer de manière chiffrée l'importance de ces résistances internes modernes avec l'importance décisive que revêtait souvent le soutien d'une partie de la population dans les guerres antiques.(2) C'est qu'en réalité les Grecs défendaient des idées, et non pas des biens ou des territoires. Derrière cette différence essentielle se rangent également d'autres différences historiques et politiques qui échappent presque toujours aux analystes des sociétés antiques. Le statut de l'esclavage est parmi les sujets les plus mal compris par les théoriciens de la Grèce antique, et en particulier par ceux qui se sont aventurés dans l'analyse économique. Cette question est certainement extrêmement complexe car elle intègre de multiples données aussi mal connues et aussi mal interprétées les unes que les autres. Ce qui fait défaut à toutes les analyses est bien entendu le cadre général de l'existence de la société grecque, à savoir son statut dans l'histoire de la sédentarisation des peuples. La place qu'occupe la civilisation hellénique dans cette histoire serait négligeable en regard du grand voisin perse et même de l'histoire romaine, si n'avait pas eu lieu à Athènes la découverte fondamentale de la possibilité de vivre en commun, la mécanique qui seule permet l'existence d'une société, la démocratie, mais nous en avons déjà abondamment parlé. L'histoire de la Grèce archaïque et classique condense et contient tous les développements ultérieurs de l'histoire occidentale qu'elle a rendue possible, y compris les plus récents développements ainsi que ceux qui se préparent. Dans le contexte d'une telle découverte, qui fut d'ailleurs fatale aux Grecs eux-mêmes puisque la guerre qui mit fin à ce qu'on appelle pompeusement leur prépondérance a été en réalité une guerre civile entre deux formes politiques, les esclaves ne peuvent pas tout simplement se définir comme une classe d'êtres humains qui ne comptent pas. Ce n'est pas parce que ses esclaves n'étaient pas des êtres humains que Thucydide les exploitait cruellement dans ses mines d'argent où l'espérance de vie n'était pas très grande, mais parce que les esclaves n'appartenaient pas originairement à la Horde Dorienne ou Ionienne. Le cas de Thucydide est d'ailleurs intéressant car bien qu'Athénien, il était partisan de l'oligarchie, et si les cités démocratiques ont souvent cherché à intégrer les esclaves dans la cité, il est notoire que les Lacédémoniens considéraient leurs esclaves non seulement comme des ennemis réels au quotidien, mais en faisaient, en tant de paix, leurs sparring partners pour s'entraîner à la guerre. Sparte a été l'une des rares cités grecques qui a failli être anéantie par une révolte d'esclaves réprimée grâce à l'appui d'un détachement d'Athéniens, alors que Sparte venait de transgresser un accord de paix dont la signature n'était pas encore sèche. Comportement paradoxal qui confirme le caractère spécifique ou l'essence de la guerre et de la paix dans la Grèce de l'Antiquité. L'esclavage ne s'explique pas non plus par des motifs purement économiques comme sont tentés de le faire les théoriciens les mieux intentionnés du monde, y compris Hegel dans sa dialectique du Maître et de l'Esclave. Le véritable problème de l'esclave dans la Grèce antique est le fait que les Grecs avaient à inventer leur espace et leur coexistence. Or les esclaves, qui sont par définition des étrangers à toute tribu, ne peuvent pas recevoir de statut spatial à l'intérieur de ce processus. Lorsque Clisthène met au point la structure démocratique de la Cité, il commence par redessiner la ville en fonction d'un partage de l'espace entre les dèmes, c'est à dire entre ce qui reste des genoï, des familles d'origine, de ceux qui ont pris possession de la terre hellénique après une longue migration. Les esclaves, de même que les étrangers, n'appartiennent pas au projet intime des Grecs, qu'ils soient Doriens ou Ioniens. Or dans une société qui n'a pas encore trouvé, et tant s'en faut, son homéostase, tout ce qui peut venir perturber l'évolution souhaitée, voulue, n'a pas de place et se retrouve dans une position naturellement hostile. Il faut cesser de transposer dans l'Antiquité notre Dasein chrétien fataliste et bien concevoir que les Grecs vivaient constamment dans un projet commun, dans une praxis qui recevait de chacun un apport actif. Et cela ne compte pas seulement pour les démocrates de l'Agora, mais cela est consubstantiel à toute hellénité. Les mœurs de Sparte démontrent avec éclat que sous sa préférence pour la monarchie et la politique oligarchique, se joue en réalité un comportement presque supérieur en morale démocratique qu'à Athènes même. Sparte était en réalité une société communiste qui a dû son déclin à ce que nous appellerions aujourd'hui le libéralisme politique, mais qu'il faut traduire en termes philosophiques par l'hypostasie de l'individu ou de la singularité. Alors qu'Athènes devient un appareil démocratique, une bureaucratie avant la lettre, dont les décisions vaudront sa perte, notamment par la nomination de généraux incompétents mais figurant sur les rôles démocratiques et tirés au sort selon la loi. Pour en revenir au problème des esclaves, j'oserais une comparaison qui pourra paraître scandaleuse mais qui peut au moins illustrer la gravité de la situation d'extériorité des esclaves par rapport au projet collectif des Grecs : nos esclaves contemporains ne sont rien moins que tous ceux que nous projetons dans des valeurs que nous avons définies une fois pour toute comme négative, les délinquants, les criminels de toute sortes, les terroristes ou tout ceux qui pourraient se retrouver sous la dénomination d'ennemi au hasard des conflits aussi absurdes et ridicules qu'ils soient. La classe des esclaves constituait une masse hostile de par son origine et de par une identité qui l'excluait à priori de tout pratique commune. Et cette masse hostile n'avait nul besoin d'être soumise à l'enfermement, la force et le courage grec, et en ce sens leur humanisme, les préservaient de cette ultime indignité. Quant à leur rôle économique dans la société antique, il n'y a pas grand chose d'autre à dire que ceci : notre propre société a créé une classe d'esclaves en tout point identique à ce titre à celle de l'Antiquité, à la seule différence qu'elle inclut la quasi totalité des populations qui constituent nos sociétés. Le Grec naissait grec, la plupart d'entre nous naissons esclaves avant de naître Européens ou autre chose.
Cette universalité de ce que Luther appelait le " serf-arbitre " est la première grande nouveauté de ce monde nouveau. Le consensus autour des fins de la société dont l'essentiel est économique, a accouché d'une société d'esclaves dont la conscience est pour ainsi dire absorbée par le souci propre à la condition servile, celui de survivre. L'un des résultats de la métaphysique occidentale, l'un de ses meilleurs résultats en termes politiques et stratégiques, aura été de rendre crédible et fondamental le concept de pénurie. Là où jadis seuls quelques vagabonds avaient des raisons de se demander de quoi serait fait leur lendemain, à ce même endroit nous sommes aujourd'hui tous convoqués pour un culte de la pérennité de la consommation. Georges Bataille a fait crouler d'un seul coup d'écriture tout le château de cartes théorique construit autour de ce concept de pénurie. Son livre, La Part Maudite, fait litière une fois pour toute de ces certitudes " scientifiques " qui ont plongé des générations dans la conviction d'un état naturel de pénurie universelle. Le seul objet de croyance avec lequel on pourrait comparer cette superstition n'est autre que Dieu lui-même et tout son roman à dormir debout. Au demeurant, ce concept est de facture toute récente et Marx fut l'un de ceux à y avoir mis la dernière main, et c'est loin d'être la moindre critique que l'on pourrait lui adresser d'être tombé lui-même dans ce piège énorme de l'économie politique bourgeoise. Mais qu'on y prenne garde, lorsque nous disons que la notion de pénurie est de facture récente, cela signifie en réalité que le moment où il a atteint son efficace est récent, et non pas que la théorie l'a ignoré de tout temps. Il suffit de relire Aristote ou Albert le Grand.
La conceptualité d'un projet existe toute entière dans sa cause, il fallait donc que cette articulation théorique destinée à peser sur la crédulité des masses appartiennent déjà au projet sociétal dès son origine. Autrement dit, la conscience de la pénurie n'a réellement de sens, ne trouve sa raison d'être que dans l'époque où le doute peut s'installer sur sa vérité. La nôtre. C'est pourquoi le phénomène de la guerre a pris une telle amplitude dans nos siècles récents et c'est pourquoi cette guerre doit se poursuivre d'une manière ou d'une autre dans le fantasme des esclaves. Aujourd'hui la Bourse et le Terrorisme alimentent abondamment la source de la terreur collective, on peut aussi y ajouter les inquiétudes entretenues avec soin sur les malfaçons dangereuses de nos comportements industriels et leurs conséquences sur notre environnement et finalement sur le sort de la planète. Mais plus essentiellement, la pénurie est pénurie ontologique. Dans son langage, Heidegger nous suggère que la victoire technique sur l'étant, le pouvoir illimité de tout produire y compris l'homme lui-même, est l'organisateur de cette pénurie : -" L'usure de toutes les matières, y compris la matière première " homme ", au bénéfice de la production technique de la possibilité absolue de tout fabriquer, est secrètement déterminée par le vide total où l'étant, où les étoffes du réel, sont suspendues. Ce vide doit être entièrement rempli. Mais comme le vide de l'être, surtout quand il ne peut être senti comme tel, ne peut jamais être comblé par la plénitude de l'étant, il ne reste, pour y échapper, qu'à organiser sans cesse l'étant pour rendre possible, d'une façon permanente, la mise en ordre entendue comme la forme sous laquelle l'action sans but est mise en sécurité. Vu sous cet angle, la technique, qui sans le savoir est en rapport avec le vide de l'être, est ainsi l'organisation de la pénurie (3)". L'action sans but, le vide de la volonté ou bien la volonté vidée de sa substance essentielle vue ici chez Heidegger avec acuité comme le désir du sentiment ou même de la sensation de l'Être. La contemplation, concept falsifié par la signification qui s'en tient au champ de la vision, est bien le degré suprême de l'intimité avec le sentiment de l'Être. Or ce sentiment s'est dissout non seulement dans les comportements individuels corrompus par l'esclavage technique, mais encore dans la culture et la païdeia, l'éducation. C'est donc par là que l'Être est usé, il a perdu dans la présence l'attrait immédiat par lui-même parce que partout l'étant ne fait plus refléter que la volonté vide du sujet. Imaginons pour mieux comprendre que l'homme soit parvenuresser entre lui et l'étant, entre lui et tout étant, un miroir où domine encore et toujours sa propre image, mais où l'usure du tain laisse encore, ici et là, passer quelques reflets de l'Être.
Notes
1 - Expression fréquente chez Martin Heidegger
2 - L'érudit helléniste Pierre Vidal-Naquet qui fut aussi un résistant de la première heure aux guerres coloniales pourrait nous en dire long sur ce sujet.
3 - Martin Heidegger, Essais et Conférences, Dépassement de la métaphysique, NRF Gallimard Les Essais LXC, page 110.
Mardi 6 janvier 2004
Le retour du même.
Dans ses Essais de Théodicée, Leibniz développe le seul et unique thème qui agite l'occident des clercs depuis les origines du Christianisme, à savoir celui de la relation des hommes et de Dieu avec le Bien et le Mal. A un certain moment, il cite le cardinal Cajetan commentant Saint-Thomas qui dit ceci : " Notre esprit se repose non sur l'évidence de la vérité connue, mais sur la profondeur inaccessible de la vérité cachée. Et comme dit Saint Grégoire, celui qui ne croit, touchant la divinité, que ce qu'il peut mesurer avec son esprit, apetisse l'idée de Dieu.(1) ". Nonobstant le fait que ces deux phrases résument en toute simplicité tout ce que la théologie négative développe en volumes de sermons démonstratifs ainsi que des développements interminables comme ceux de Malebranche, ces propos ont la qualité de demeurer d'une vérité qui dépasse radicalement la théologie elle-même. Ecoutez bien ce que dit ce prélat du quinzième siècle : l'esprit repose sur la profondeur inaccessible de la vérité cachée. Il faut ici comprendre rien moins que le fait qu'il n'y a pas d'esprit sans le mystère de la vérité, mystère que nous appellerons, nous autres, le mystère de l'Être. La grande " faute ", au sens de péché, de la métaphysique aura été de croire qu'elle peut " mesurer " la divinité avec son esprit. Autrement dit de cerner par le concept l'Être de l'étant. L'astuce kantienne ou celle de Schelling qui consistent à laisser la Foi prendre la place de la raison tout en chargeant le sujet de tous les pouvoirs de la Raison ont ouvert une boîte de Pandore où l'esprit devient la servante exclusive de la technique et du remplissement de l'étant par ses produits. Or, l'esprit n'est rien d'autre que la certitude vide de l'Être qu'aucune dialectique ni aucune science en tant que telle ne pourra venir remplir. Le remplissement de la vérité n'est pas l'objet de l'esprit parce que l'esprit est déjà dans l'Être, il se meut déjà dans la vérité ne jouissant d'aucune extériorité qui pourrait faire de la vérité son objet. En revanche, l'homme a bel et bien con-science avec l'Être, conscience dont il peut représenter les états par le langage. Or cette con-science n'est rien d'autre que le sens d'une appartenance qui impose l'universalité de l'Être et donc le devoir de rassembler les langues qui le parlent. Est-ce à dire que la Bible a tout faux à propos du mythe de la Tour de Babel ? Certes non, car la Bible est un recueil d'anthropologie, un livre scientifique qui retrace ce qui s'est réellement passé à partir du moment où les hommes ont décidé d'unifier leurs Paroles dans l'Être. Car la civilisation, l'option fondamentale prise par les hommes de se réunir et de séjourner d'une nouvelle manière sur cette terre, n'avait pas d'autre objet que celui d'unifier cette Parole. L'épisode que rapporte le Pentateuque n'est que le constat postérieur, lointain déjà par rapport à la décision originelle, de l'échec apparent de cette aventure de l'esprit. Le polythéisme illustre comme une bande dessinée cet éclatement de l'Un qui correspond trait pour trait à l'éclatement du souci premier des fondateurs de civilisation. Dans sa méditation sur Logos (2), Heidegger demande : " Que se passe-t-il, quand l'être de l'étant, l'étant dans son être, quand la différence de l'un et de l'autre, vue comme différence, quand tout cela est amené à la parole ?…Que serait-il arrivé, si Héraclite - et après lui les Grecs - avaient pensé spécialement l'être du langage comme Logos, comme la Pose recueillante ? Rien de moins que ceci : les Grecs auraient pensé l'être du langage à partir de l'être de l'être, bien plus ils l'auraient pensé comme ce dernier lui-même (3)". Mais ni Héraclite ni les Grecs ne l'ont fait, ajoute plus loin le penseur allemand, tout au plus Héraclite a-t-il, le temps d'un éclair, aperçu le langage dans la lumière de l'être. Ce que nous osons avancer ici, dans cette méditation sur le rapport entre la Civilisation occidentale et la question de l'Être, c'est précisément que Héraclite et les Grecs n'ont fait qu'apercevoir le flamboiement du coucher de l'Être comme langage, c'est à dire comme contenu essentiel de toute parole. Mais non pas le coucher au sens heideggerien de legein, de lesen c'est à dire de laisser s'étendre devant, de coucher en face dans la présence, mais comme le coucher de soleil d'une époque qui laisse encore percer au raz de l'horizon l'éclat du rayon vert de son lointain passé. Héraclite et Parménide sont les derniers regardeurs d'horizon, les tard-restés dans l'essence de l'origine humaine. Pour une raison que j'ignore, Heidegger ne pouvait pas penser ainsi. Il ne pouvait même pas supposer que les Grecs étaient autre chose que le commencement de l'occident, et en un sens il n'avait pas tort, mais seulement en un sens qu'il n'a pas su distinguer en tant que tel tant il est resté prisonnier d'une différence ontico-ontologique métaphysique. Ce sens est lui-même déjà d'ordre ontico-technique, il n'est que le commencement de la possibilité de ce qui se cherchait depuis sans doute déjà quelques millénaires, à savoir la paix sociale, introuvable sans cet autre éclair que fut la découverte de la Cité démocratique. Contrairement aux idées reçues sur la société grecque, la guerre n'est pas, même si elle domine le destin de l'Hellade, l'essence de la Praxis grecque. Les Grecs ont inventé la paix en même temps que la démocratie. Pour le reste, les Grecs auront été un peuple de la fin, de l'exécution capitale et du détournement industriel du langage dans la forme métaphysique. L'admiration que leur ont voué sans faille les Romains ne tient qu'à la réussite extraordinaire de cette mutation de la nature et de la fonction du langage, mutation dont on peut comparer l'efficacité à celle de l'invention de la poudre à canon. Il est tout à fait vraisemblable que la première esquisse de transformation de la fonction du langage aura d'abord montré tout son efficace dans la conduite de la guerre et de la diplomatie. Le concept cherche son essence dans la différence ontico-ontologique, c'est à dire, selon la Logique, la conception simultanée de l'étant comme Être et comme néant, être et néant dont l'articulation dialectique s'identifie au devenir. De cette chirurgie de l'étant le langage est autant cause que conséquence, mais le langage en tant que chose de l'homme, en tant que chose de la volonté. Lorsque Heidegger demande ce qui serait arrivé si les Grecs avaient pensé l'être du langage comme Logos, il sait de quoi il parle, il parle d'un choix qui aurait pu prendre la place d'une autre option, d'une alternative destinale et consciente. Or dans cette alternative se dissimule d'un côté la décision de la vérité à tout prix, de l'alethéia sans réserve, de l'autre la décision d'un usage pragmatique du langage, c'est à dire un langage qui comporte en lui-même la différence de l'Être et du Néant, de la Vérité et du Mensonge. Sans cette arme absolue, aucune supériorité matérielle, économique ou militaire ne peut expliquer l'essor historique de l'occident et sa planétarisation actuelle. Marx a parfaitement distingué la nature criminelle de la formation des nations européennes. La féodalité s'est forgée d'une manière parfaitement mafieuse, pratiquant un grand banditisme d'une barbarie dont les comptes ne seront faits que lorsque l'histoire en sera totalement sortie, ce qui est loin d'être le cas. Le capitalisme se trouve d'ailleurs face à la contrainte d'en revenir à sa méthode originelle, mais il n'est pas sûr, cette fois, que la langue du monde lui donne les moyens de parvenir à ses fins. Ces fins ne sauraient être d'une autre nature que ce dont nous avons eu un avant-goût avec l'aventure nazie, il ne faudrait pas oublier que la barbarie hitlérienne n'est que la continuation d'une longue chronique bien sanglante. Elle n'est que le dard que le scorpion métaphysique a retourné contre lui-même. Le naturaliste Nietzsche décrit ce phénomène à son époque latent, d'une manière saisissante, mais il faut effectivement lire exhaustivement cet auteur prolifique pour se faire une image nette du double-bind, le piège à double-entrée dans le lequel le système des valeurs s'est laissé enfermer en même temps que celui de sa critique.
L'histoire de l'Occident est en effet émaillée de crimes et de génocides tels qu'aucune Antiquité n'en a connue - imaginez un instant Hitler renvoyant les Juifs en Palestine pour reconstruire leur temple comme le fit Cyrus - or il est significatif que cette sauvagerie ait trouvé son commencement dans les affrontements sanglants et sans pitié qui ont opposés entre eux les premiers Chrétiens. Le concept du dieu trinitaire a fait plus de morts que toutes les conquêtes romaines prises ensemble (4), car les sectes chrétiennes se sont déchirées massivement pour la maîtrise du pouvoir idéologique, pour l'imposition d'une prétendue nouvelle Parole commune, de ce qui devait redevenir une nouvelle volonté de l'Occident. Cette guerre civile de l'espace méditerranéen ne fut pourtant qu'un hors d'œuvre en regard des guerres de conquêtes menées d'abord en Europe par la Rome des premiers papes, puis par le rapt systématique de l'espace planétaire au prix du sang des autres. Le meilleur exemple de cette criminalité sophistique demeurera sans doute la conquête espagnole de l'Amérique dont aucun mea culpa papal ne saurait laver le Christianisme de son ignominie. Il est le modèle d'un double mensonge théologique par lesquels le Vatican donnait au nom du divin tous les pouvoirs politiques et militaires à Madrid sur tout un quartier de l'espace planétaire où les troupes de Cortes décimaient les populations indiennes en trahissant parole sur parole. Mayas et Aztèques parlaient encore une langue trop proche de celle dont rêvait Heidegger pour ne pas succomber pratiquement sans livrer combat aux sophismes hypocrites des Européens. La lutte des Indiens du Chiapas ne devrait pas être considérée comme un vain folklore car elle constitue par sa méthode une réponse tardive mais symboliquement forte à l'ethnocentrisme européen qui n'a jamais cessé une seconde de faire peser sa chape de plomb sur l'Amérique encore dite Latine ! On pourrait encore aller plus loin dans des analyses historiques plus proches de nous. Nous poser, par exemple, la question de savoir pourquoi justement la langue latine a manqué son objectif, pourquoi les langues régionales de l'Europe de Charlemagne ont fini par triompher politiquement et sociologiquement de la langue du conquérant. Beaucoup de réponses sont possibles, mais elles tourneraient toutes autour de ce que nous avons caractérisé plus haut comme la résistance permanente des peuples. Mais il y avait une autre raison plus impérative à l'occultation de la langue latine puisque ce furent les souverains eux-mêmes, les fils mêmes de Charlemagne, qui les premiers trahirent le projet de romaniser linguistiquement l'Europe. Cette raison était la nécessité de créer une langue pour une classe, un idiome initiatique dont la possession allait devenir le privilège qui permettait la communication à distance, communication à l'intérieur de laquelle l'Empire se conserverait mieux que de n'importe quelle autre façon. On retrouve dans le destin de la langue de Rome, un succédané d'une langue Une pour une volonté Une, mais ce n'est plus qu'un fantôme dont le contenu sémantique tourne bien autour d'un Un, celui de la théologie chrétienne. On appelait son latin le latin de cuisine, c'est tout dire.
Le phénomène majeur de ce début de siècle, à savoir le développement conjoint de la suprématie d'une langue, l'Anglais, et de celle d'un réseau planétaire de communication est de nature à sceller un changement essentiel du cours du temps humain. Que ce soit la langue des empiristes et des pragmatiques qui finalement triomphe n'a qu'une importance anecdotique et symbolique. Ce fait définitif met en relief cependant l'agonie de la prépondérance centralisatrice romaine et vaticane dans la culture mondiale, agonie par ailleurs paradigmatique de celle des états, républicains ou non. Le libéral-empirisme prouve ainsi une plus grande résistance en tant que métaphysique car de loin plus souple que la tendance systématique allemande et c'est lui qui représente aujourd'hui la dernière forteresse onto-théologique telle qu'elle s'est reconstruite selon la structure de pensée du sujet nietzschéen. Si la pensée de Hobbes a pu servir de contrefort inusable à la constitution de l'Empire britannique, elle doit aujourd'hui abandonner la notion d'état pour s'arrimer au mouvement relativement occulte du marché international qui se propose de prendre la place des états et de procéder à une nouvelle centralisation et bâtir un nouveau Léviathan dont Washington n'est pas loin de vouloir s'attribuer la paternité et le contrôle. En dépit de la fantastique puissance qui se dégage non seulement du projet mais déjà de sa réalité constituée - il suffit d'observer les dérives résolues et stratégiquement dirigées dont se servent les entreprises transnationales pour annihiler progressivement tous les pouvoirs publics et tous les droits de l'Homme qui en dépendent jusqu'aux plus élémentaires. Le danger est d'autant plus grand que l'opérateur majeur de cette opération dont nous avons suggéré l'identité, savoir l'Amérique du Nord, s'est constitué en modèle absolu de la démocratie, un modèle dont les formes manichéennes fondées en dernier ressort sur l'esprit théologique du protestantisme, s'universalisent sans trouver d'opposition pratique ou théorique. En jeu, notamment, les formes des démocraties européennes où le bipartisme manichéen s'impose rapidement contre toutes les formes de représentation proportionnelle. La construction de l'Europe a déjà encaissé ce modèle, il suffit d'observer la répartition politique de la représentation parlementaire pour constater que les partis minoritaires qui ne jouent déjà pas un rôle exécutif très important dans leurs pays, perdent à Strasbourg et à Bruxelles tout autre influence directe qu'en s'alliant au jour le jour à telle ou telle des deux grandes formations du Parlement.
Les défenses sectorielles des langues nationales à travers des institutions et des politiques comme celles de la " francophonie " ou de la " lusophonie " ne font elles-mêmes que refléter un combat certes politique puisqu'elles ont pour objet la défense des cultures régionales, mais dans un contexte d'une telle faiblesse des états par rapport au marché qu'elles n'ont aucune chance de renverser une tendance expansionniste de la nouvelle langue mondiale. La langue anglaise est depuis longtemps devenue la seconde langue nationale de la plupart des nations du monde ; elle est aussi devenue la première langue vernaculaire mondiale et c'est bien cela qui compte. Or, dans ce contexte, l'important est la capacité de la langue de Shakespeare à servir de squelette pour une langue à venir, celle de la Parole de l'Être, c'est à dire celle de la vérité et de la liberté et non pas sa représentativité politique par rapport à sa terre d'origine. Contrairement au latin qui est toujours demeuré le monopole de l'Eglise, tant dans son enseignement que dans ses mutations et dans son usage, l'Anglais a pour ainsi dire échappé à tout pouvoir politique. On peut rappeler ici que la véritable langue politique de l'establishment féodal anglo-saxon était le Français (5), l'anglo-saxon demeurant longtemps la langue du peuple. Il ne peut donc pas se reproduire ce qui a eu lieu à propos du Latin, c'est dire un déclin pratique au profit des langues régionales, ou bien, ce que nous avions suggéré plus haut, la main-mise d'une classe sociale sur le monopole de cette langue pour en faire un code secret de l'usage du pouvoir, ce qu'était devenu le Latin dès avant la Renaissance.(6) L'Anglais est ainsi condamné à devenir une langue universelle, et il faut bien mesurer toute la signification d'une telle réalité.
Mais avant d'aborder ce fatum linguistique d'un futur pas si éloigné, il nous semble intéressant de faire un détour par la culture chinoise, afin de mieux comprendre à quel point une démarche où la langue et la communication peuvent être considérées comme essentielles. En 1999, Albin Michel a publié un ouvrage déjà ancien du sinologue Marcel Granet (7) dans lequel cet éminent érudit semble remettre, comme on dit, quelques pendules à l'heure. Nous n'analyserons pas dans le détail un travail immense de densité et de précision pour n'en retenir que l'idée centrale qui parcourt l'ensemble des questions abordées qui vont de la langue et de l'écriture jusqu'aux recettes de sainteté et à l'orthodoxie confucéenne, à savoir ce qu'il considère comme l'âme de toute philosophie originaire de cette partie du monde. Au début de notre texte, nous avions souligné l'absence, dans la pensée chinoise, du mot et du concept d'être. Nous aurions dû signaler une exception que l'on doit au supposé Lao Tseu dans un court article du Tao Tö King auquel, d'ailleurs, Granet ne semble pas s'être arrêté. Cela peut s'expliquer par les grandes disparités des traductions à propos desquels le sinologue affirme sans ambages que certains textes sont proprement intraduisibles, ce dont lui donnons volontiers acte ne connaissant à peine que quelques mots de ce prodigieux langage. Mais le savant avait une raison impérieuse de dédaigner un insert aussi isolé que celui dont nous parlons, parce qu'il avait de la pensée chinoise une idée si opposée à celle que nous autres occidentaux pouvons avoir de la philosophie que cette allusion à l'être de Lao Tseu n'a réellement qu'une importance anecdotique. En effet, pour Granet, il n'y a de pensée chinoise que sociologique et politique : toute philosophie, toute morale et toute éthique de vie ne peut pas avoir d'autre but, d'autre eskaton, que la stabilité de la vie sociale. On croit savoir que la pensée chinoise se partage entre deux grands courants, le Tao et le Confucianisme. Or ces deux courants convergent également quant à leur finalité, ils prétendent tous deux rendre théoriquement et pratiquement possible la vie sociale. Leurs thèses ne s'écartent que lorsqu'il est question de méthodes pratiques à mettre en œuvre pour entretenir la paix et le bien-être des sujets de l'Empire du Milieu.
La thèse taoïste est particulièrement intéressante dans le contexte de notre réflexion car elle n'hésite pas à proclamer monstrueux et anti-naturel le fait pour les hommes de vivre ensemble. Granet écrit page 424 : -" Les Pères du Taoïsme ", au contraire, se soucient de distinguer la connaissance psychologique de la science des comportements régis par les conventions sociales, bien plus qu'ils ne se préoccupent de la détacher des spéculations sur l'Univers. Ils affectent de voir dans la société non pas le milieu naturel de la vie humaine, mais un système fallacieux de contraintes ". Pour enfoncer le clou des disciples de Confucius partisans comme on sait d'une société totalement ritualisée, le Rite étant la seule et unique vertu et la seule et unique vérité qui puisse rendre possible l'existence même de la société, Granet fait dire aux taoïstes que -" Le pis serait de vouloir lier ensemble par le jen et le yi, par ces liens, ces réseaux, ces colles, ces vernis factices que sont les rites, les lois, l'étiquette, des êtres qui ne peuvent subsister qu'à condition de rester eux-mêmes ". D'où une philosophie entièrement fondée sur la défense de l'individu et du singulier - on retrouve ici les préoccupations des Scolastiques de notre haut Moyen Âge - et l'encouragement non pas à la connaissance en général de la nature ou de la société, mais de soi-même. Paradoxalement, cette pensée ne rejette aucunement les réjouissances collectives, et il ne serait pas abusif de classer le taoïsme dans la catégorie des religions dionysiaques. En fait, il y a dans ce mouvement de pensée une sorte de nostalgie permanente d'une nature perdue, un véritable romantisme presque systématisé dont les idéaux pratiques aboutissent à la recherche exclusive de l'extase. D'où une philosophie de la recette empirique, des recettes alimentaires, hygiéniques et corporelles destinées à atteindre et conserver le plus longtemps possible ces états extatiques, des recettes dont ne sont exclus ni les alcools ni les drogues. Les sages sont aussi des chamans.
Ni ontologie, ni métaphysique donc, seulement des représentations et des conjectures assemblées en lettres, en nombres et inscrites jusque dans l'architecture, dont la finalité est toujours l'efficience par rapport à la vie sociale. Du côté des confucéens, un autre aspect émerge qui semble au contraire du taoïsme privilégier une éthique des relations sociales, une éthique toute entière basée sur le rite, l'étiquette et ce que nous désignerions par l'adéquation entre le mot et la chose. L'Ordre dépend de la justesse des dénominations qui ne saurait par exemple tolérer qu'une fille incestueuse puisse continuer de porter le nom de fille ou de soeur alors qu'elle se comporte en épouse de son père ou de son frère. Une maison ou un royaume qui ne modifierait pas sur le champ ces dénominations seraient menacées de violences et de destruction. Cela ressemble étrangement à notre épisode thébain d'Œdipe, à la différence près que le respect de l'Etiquette semble prendre la place du destin lui-même. On sait combien Confucius et son disciple Mencius insistent dans leurs textes sur l'importance du rite et du respect de l'Etiquette dans les maisons féodales ou royales. Cette pensée du rite n'est pas si facile à comprendre, et si on se réfère à son efficacité historique dans la société chinoise il serait parfaitement inutile de la réfuter comme pure hypocrisie formelle ou comme un machiavélisme déguisé. Ce qu'il nous en semble, c'est que la théorie du rite social confucéen et l'individualisme taoïste constituent tous deux des résidus solides, des comportements nomades fossilisés auxquels il a précisément manqué l'entrée en scène du concept d'Être et de la différence ontico-ontologique pour faire histoire au sens occidental. En fait, les Chinois auraient accepté le pacte sédentaire sur une base archaïque qui reflèterait plus directement les valeurs et l'éthique du monde abandonné du nomadisme.
Cette base est d'abord la reconnaissance du caractère hypothétique et aléatoire de la tentative elle-même de fonder une société, alors que les Grecs - et en réalité la plupart des peuples occidentaux - ont vécu de manière oedipienne, c'est à dire à l'aveugle, une transition marquée par la violence entre la réalité familiale et tribale et l'état central. D'où les incertitudes politiques et les luttes pour l'une ou l'autre forme politique relative à la redistribution des richesses, du pouvoir et des honneurs.(8) Pour être plus clair, les Chinois auraient conservé dans leur formes culturelles, leur langue et leur tradition orale, une conscience plus claire qu'il a été, jadis, fait un choix sociétal sur une base dont on connaissait d'avance les difficultés. Du même coup on a conservé des modèles de comportement plus immédiatement proches des mœurs nomades, qu'au demeurant les Chinois ont pu continuer d'observer de près une guerre interminable contre les " barbares " nomades qui encerclaient littéralement l'Empire. Encore une différence notable, la Grèce avait affaire principalement à un Empire déjà constitué sur un modèle sédentaire, alors que les Chinois se sont faits en opposition avec des hordes purement nomades. Ce qui donne aussi à penser que l'Empire du Milieu a conservé sous ses yeux pratiquement le modèle initial ou archaïque, c'est à dire les traits essentiels de son propre destin passé qu'il fallait précisément réussir à adapter à la nouvelle manière d'habiter le monde choisi par eux. En Grèce, en revanche, nous assistons dès le Cinquième siècle à une situation presque comparable à l'époque moderne où chaque nation se voit bordée par une autre nation où se joue le même problème qui consiste à assumer d'une manière ou d'une autre la structure de vie sédentaire. Ce que les analystes de la Chine ont souvent constaté non sans surprise et non sans interrogation, c'est l'absence déterminée de tout expansionnisme chinois. On sait par exemple que la Chine constitue le seul exemple d'une nation maritime puissante, pratiquement mondiale, qui du jour au lendemain décide de couler la plus grande flotte du monde pour se retirer dans les limites de son territoire. Même la conquête du Tibet est une conquête défensive. Les historiens savent que parmi les peuples nomades qui entouraient l'Empire, les Tibétains ont longtemps constitué le danger le plus direct pour la société chinoise. Or, que signifie une politique non-impérialiste conduite par un empire, sinon l'affirmation d'une option définitive de retrait du mouvement de ce qu'on devrait appeler ici la prédation politique. En rappelant évidemment que le nomadisme se trouve confronté, de son côté, au même problème que constitue le refus de s'installer dans l'immobile et qu'il se retrouve ainsi comme forcé dans une position radicalement hostile à ceux qui s'emparent de l'espace au nom d'un projet différent de civilisation. Il ne fait pas de doute que la vocation guerrière des peuples nomades est une réaction logique, un résultat dialectique de la formation de territoires déterminés dont l'exploitation allait devenir le monopole d'une fraction de l'humanité.
Cette situation originale de l'Empire du Milieu lui confère donc, dès l'origine, une sagesse particulière qui consiste à conjuguer très habilement le statut fortement individué du nomade et les pratiques fortement ritualisées des rencontres nomades. Le Tao et son contraire - il faudrait peut-être analyser le Yin et le Yang également sur un autre mode que celui de la simple partition des sexes - ces deux éthiques qui paraissent s'opposer sur tous les points, sembleraient ainsi plutôt complémentaires. D'un côté l'assomption individuelle du destin, la forme originaire de la situation humaine, de l'autre une ritualisation de la rencontre, et donc de l'être-ensemble, qui ne se paye pas de la monnaie de singe de la vérité, mais qui se contente de représenter sur le théâtre social, la possibilité de partager pacifiquement le même espace. On retrouve ici le sens grec de la représentation politique, le jeu du social comme pure fiction dont seule la démocratie a retrouvé le rythme qui lui permet de prétendre à la véritable durée. Et, contrairement à ce qui suit l'événement grec de la découverte de cette démocratie, ça marche, ou, du moins pourrait-on parler d'un meilleur rendement immédiat. La Chine est sans aucun doute l'un des rares continents qui a connu de longues périodes de bonheur social et dont toutes les crises furent des crises intérieures de désagrégation puis de reconstitution du tout. Elle a même été le laboratoire de la plupart des formes de souveraineté, y compris le communisme deux mille ans avant Karl Marx, sans pour autant se laisser atteindre de l'extérieur de manière irréversible comme ce fut le cas des civilisations Incas ou Mayas. On pourrait avancer l'idée que la Chine a radicalement changé depuis la fin du Dix-Neuvième siècle où sa faiblesse par rapport à l'occident a laissé pénétrer le poison de la culture métaphysique qui devait aboutir à une mise " à niveau " avec l'histoire globale du monde, la technicisation, l'industrialisation et la société de production-consommation. Certes, mais dans le même temps, et pour la première fois de son histoire connue, la Chine sort d'elle-même sous la forme de migrations massives masquées par une stratégie réellement mondiale. Commencée dans les années tardives du Dix-Neuvième siècle en direction de l'Amérique du Nord, cette migration est aujourd'hui universelle. Ce qui ne signifie rien moins qu'un tournant fondamental dans le destin du pays le plus peuplé du monde. Parfois je suis contraint de reconnaître que les Chinois représentent, en réalité, les premiers citoyens planétaires de l'histoire, tant ils se répandent et s'adaptent partout où ils décident de s'attarder. Au fond, l'échec relatif de leur projet initial rebondit comme un succès total dans cette autre décision historiale que constitue l'émigration systématique, c'est à dire le retour à un nomadisme de forme entièrement nouvelle, mais, si on y regarde de près, économiquement et socialement identique à un nomadisme parfaitement pur, identique à la position nomade archaïque. L'émigré chinois qui ouvre un restaurant à Cagliari, dans ce réduit sarde où se conjuguent mafia, église catholique et de puissantes tendances xénophobes, cet immigré réussit à faire preuve d'une indifférence idéologique absolue qui le met, pour ainsi dire, hors jeu de toute appartenance nationale, tout en tirant à lui tous les bénéfices d'une position nationale. Le marché en général se comporte exactement de la même manière, se déplaçant dans le monde selon les opportunités qu'offrent les situations politiques et sociales spécifiques. A l'exception des Libanais, qui au fond n'ont jamais profondément changé de mœurs depuis les Phéniciens, il n'existe aucun peuple au monde qui ne soit aussi parfaitement répandu sur les cinq continents. Reste à savoir si la Chine, comme le Liban d'ailleurs, sont prêts à recevoir sur leur sol les étrangers de la même manière que leurs ressortissants sont reçus ailleurs.
Il existe donc bien un retour vers la lointaine situation nomade qui se profile à travers ces exemples. Ironie ou paradoxe, ce retour s'entame au moment même où la géométrie des nations essuie ses dernières marges, ses dernières imperfections. A côté de très anciens conflits comme celui du Sri Lanka, dont les origines remontent au Douzième siècle et qui combine curieusement des données religieuses comme en Irlande du Nord par exemple et des données politiques propres à la position insulaire, il subsiste ici et là quelques problèmes irrédentistes. Les plus graves que nous avait légué l'histoire de l'Asie mineure, ceux de l'ex-Yougoslavie, ont été finalement réglés à un rythme et une vitesse extraordinaire à l'échelle du temps historique. Il s'agit donc bien de l'achèvement mondial du processus de sédentarisation auquel n'échappent plus, pour le folklore, que quelques Inuits ou quelques Kirghizes. Dans ce monde enfin nanti en toutes ses parties d'une identité aux couleurs multiples mais bien établies, règne une sorte de paix, la terre est comme revenue à un statut lointain de neutralité où elle ne provoque plus en tant que telle l'homme à la violence. Ce dernier peut donc reprendre son mobil-home de nomade, et organiser son existence selon des processus qui ressemblent exactement à la dérive aléatoire des nomades d'avant le néolithique. Mais ce retour ne s'opère plus du tout dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se sont progressivement et douloureusement figé les nations.
Notes.
1 - Leibniz, Essais de Théodicée, Garnier Flammarion Poche, 1969, page 78.
2 - Martin Heidegger, Essais et Conférences, Logos, Gallimard NRF Essais LXC, 1969, page 276.
3 - Ibid. pp 276 et 277.
4 - Il ne faut jamais cesser de lire et de relire Edward Gibbon, le seul historien de l'antiquité romaine qui fasse un compte-rendu objectif et courageux de la guerre barbare que se sont livrées les sectes chrétiennes, et en particulier dans le pays natal de Saint Augustin.
5 - Se reporter à la remarquable analyse du professeur d'Anglais qu'était Mallarmé. Dans les Œuvres Complètes, Pléiades, Gallimard.
6 - A noter au passage que la langue grecque n'a jamais souffert de ce statut ancillaire par rapport au politique, ni à Rome ni plus tard dans l'histoire européenne. Elle est certes demeurée une source culturelle pour tous les théoriciens de la métaphysique, et en ce sens elle constitue un code encore plus occulte que le Latin. Le Grec constituait donc une aussi une arme, mais une arme interne au débat entre les clercs dont le résultat théorique dépendait étroitement de la traduction de cette langue si proche de la parole aléthéique. Heidegger a insisté avec beaucoup de courage par rapport à son entourage théologique sur la falsification globale opérée sur la langue grecque par ses traducteurs latins. Cette dérive sémantique porte, selon lui, une lourde responsabilité dans les dérives ontologiques de l'occident.
7 - Marcel Granet, La pensée Chinoise, Albin Michel, 1999.
8 - A noter en passant, mais la remarque est d'importance, que les siècles de crise où semblent se faire des choix structurels pour de nouvelles sociétés sont les mêmes en Occident et en Extrême-Orient. C'est en gros entre le Cinquième et le Troisième siècle avant Jésus-Christ qu'ici comme ailleurs quelque chose se rompt dans la continuité de ce qui précède - en Chine c'est l'éclatement de l'Empire et le régime des féodalités alors que dans l'Hellade, un moment unifiée contre le Royaume Perse, on assiste au même phénomène de parcellarisation politique de l'espace grec - comme si un même rythme ordonnait en sous-main les mêmes développements. On pourrait presque parler de mouvements de plaques tectoniques ontologiques au plan planétaire.
Mercredi 7 janvier 2004
Le retrait de l'Être.
Le retour au nomadisme est un fait. Comme le lecteur l'aura compris sans qu'il soit nécessaire de le souligner, ce retour est le rétablissement d'une situation ontologique originaire. La question qui se pose alors est celle de la mesure dans ou selon laquelle l'homme participe volontairement et consciemment à ce rétablissement. Nous avions postulé, ici et ailleurs, que le choix initial du sédentaire a été une option consciente, le produit d'une volition commune dont on ne pourra jamais relever les traces ailleurs que dans l'analyse ou l'herméneutique rigoureuse des grands textes fondateurs, les textes dits " sacrés ", et ceux de ce qu'il est convenu de désigner sous le nom de philosophie. Nous ne pouvons donc pas nous dédire en quelque sorte de cette position volontariste, en déclarant maintenant que le retour ne serait pas, lui, une option volontaire mais une fatalité quelconque liée à l'essence de l'Être, une essence dont nous serions forclos par définition, alors que nous avons longuement illustré comment le retrait de l'Être appartient au programme de la Cité. Le retrait de l'Être dans l'étant, selon la formule de Heidegger, est la conséquence de la mise en consigne de l'Être, de sa conceptualisation utilitaire liée à la mise en exploitation réglée de l'étant. S'il apparaît donc que ce programme ne suive plus son cours, mais que la Cité soit plutôt sur le point d'éclater et de disparaître comme ont disparu quelques unes des tentatives citoyennes de par le monde (1), il devient logique de penser que les hommes soient sur le point de retirer l'Être de sa consigne, de remettre son action en circulation à la bourse du destin.
Comment cela ? Où se produirait aujourd'hui un tel événement ? Ne s'agirait-il pas d'une divagation absurde que d'affirmer qu'il existe une entente humaine suffisamment générale autour d'un pareil projet ? Que des hommes se soient attelés à défaire consciemment, à déconstruire ce monde fixe de l'urbain et du propre, de l'espace qualifié et de la propriété privée ? Qu'enfin il existe une volonté consciente de reconstruire une toute nouvelle praxis humaine qui en son essence consisterait en un retour à la mobilité du Da sein, de l'existence humaine et à une liberté absolue en termes de relations à la communauté ou en termes de dépendances réciproques ?
A toutes ces folles questions, il existe pourtant des réponses, les unes patentes, les autres latentes. Les réponses patentes sont lisibles dans la région ontique de notre univers, dans sa réalité triviale dont nous avons suffisamment développés, ici et ailleurs, l'évolution en direction de l'éclatement des structures étatiques ou économiquement centrées. Le marché n'est pas un instrument aveugle, contrairement aux assertions métaphysiques des économistes bourgeois du Dix-huitième siècle et en particulier d'Adam Smith. Dans la mesure même où il est un instrument, il est d'ailleurs parfaitement absurde de lui attribuer une autonomie comparable à une fatalité transcendante. Mais, là encore il faut nuancer, car Adam Smith n'avait pas si tort que cela dans la mesure où il parlait, non pas du marché réel, mais du concept d'un marché qui n'a jamais existé au moins depuis la naissance de notre civilisation. En bref, nous disons qu'un marché ne peut pas être économique et en même temps politique. Un marché pur, c'est à dire cet instrument de régulation automatique des relations économiques entre les humains, ne saurait être tel qu'à partir du moment où il serait débarrassé entièrement de l'action du politique. Or la médiation nécessaire de l'échange économique qu'est la monnaie porte en elle les stigmates des conflits de souveraineté politiques. Aujourd'hui encore, il existe deux marchés parallèles. Le premier est celui des marchandises porteuses de valeur d'usage, le deuxième celui des monnaies qui ne sont que des valeurs d'échange. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la pluralité des monnaies est en fait une échelle de valeurs d'échange qui va de la plus faible monnaie à la plus forte, et non pas un agrégat aléatoire de valeurs d'échange qui fonctionnerait selon des proportionnalités données. Ce qui n'empêche nullement ces monnaies de fluctuer dans un sens ou dans un autre, c'est à dire de changer d'échelon dans l'échelle dont nous parlons. Cette échelle n'en reflète pas moins immédiatement la puissance politique de chaque effigie inscrite sur chaque monnaie ou bien seulement sa relation à la monnaie la plus forte, directement ou par le truchement d'une ou de plusieurs monnaies tierces. A cet égard, il est plaisant de noter le paradoxe actuel hérité de Nixon et qui fait que le seul marché mondial qui n'ai jamais existé et qui reposait sur une parité de la monnaie la plus forte avec un étalon universel, l'or, a été détruit à des fins économiques mais grâce à la puissance politique du détenteur de cette monnaie qu'est le dollar.
Objectivement, c'est à dire selon le modèle d'Adam Smith, il ne pourra jamais y avoir de marché mondial, c'est à dire de marché tout court puisque les réalités économiques marchandes se sont, elles, mondialisées depuis longtemps, tant qu'il existera une pluralité de monnaies, représentant chacune des puissances politiques rivales par définition. D'une certaine manière, le destin présent tourne autour du maintien de la suprématie du Dollar, suprématie qui n'est rien d'autre que l'hégémonie des USA sur le monde entier, et tout le monde le sait.79 Mais ce secret de polichinelle est un tabou, ou sinon un tabou, du moins une évidence sans usage, c'est à dire une vérité dont personne ne se sert sinon les milieux financiers. Or précisément, le lieu où le théorème d'Adam Smith prend tout son sens est notre présent, car en dépit de l'hégémonie apparente des Etats-Unis, le marché des marchandises semble avoir pris définitivement le dessus sur ce que la spéculation monétaire peut encore produire en terme de puissance économique. Nous ne sommes plus tellement loin d'un véritable marché mondial, c'est à dire d'un marché unique des marchandises lié à une monnaie mondiale unique. Le phénomène de l'alignement du Dollar sur l'Euro, ou de l'Euro sur le Dollar ne traduit rien d'autre que l'affaiblissement du pouvoir politique réel de Washington, un affaiblissement dont l'actuel Président tente désespérément de freiner le cours en lançant son pays dans l'aventure de la guerre. Encore une remarque pour les marxistes qui pourraient s'offusquer d'une telle analyse en rappelant que Marx considérait la monnaie comme une marchandise comme les autres : tant que les monnaies, comme du temps de Marx, étaient étalonnées sur un métal précieux ou sur toute autre marchandise, ce qui s'est vu aussi, elles pouvaient effectivement se parer du titre de marchandise puisque leur convertibilité les mettaient en relation avec les valeurs d'usage. Tout change dès lors qu'une monnaie s'isole pour ne représenter qu'une force partielle du marché. Pour bien comprendre ces soit-disant mystères de l'économie, je rappelle toujours que si une bouteille de Coca Cola avait en Indonésie la même valeur marchande qu'aux Etats-Unis, il ne s'en vendrait pas un millionième de ce qui s'y vend. Ce serait une très mauvaise affaire pour Coca Cola. La faiblesse de la monnaie de Djakarta permet de transvaluer ce liquide vers son accessibilité aux bourses des Indonésiens. De même, si les prix du marché des denrées alimentaires d'Afrique du Sud correspondait en pouvoir d'achat à ceux de Londres, la population sud-africaine serait condamnée à la famine en raison de l'abîme qui sépare le niveau des salaires pratiqués à Londres et celui des salaires distribués à Johannesburg. C'est simple et sans appel.
Dans le registre des réponses patentes à la question de savoir si nous voulons ou non revenir à un statut nomade de l'être humain, il existe une foule d'autres évidences sociologiques et politiques, avec leurs paradoxes et leurs contradictions. La construction européenne forme ainsi un puzzle qu'il faut savoir lire en dépit de ses contradictions internes patentes et a priori affligeantes. En gros, deux mouvements s'affrontent : d'un côté la tendance unificatrice de l'économique et du politique (dans le premier ça marche fort bien, alors que le second est marqué par une panne incompréhensible au commun des mortels), de l'autre celle de la tendance désagrégeante de la subsidiarité et de la régionalisation. En clair : si d'une part le marché, y compris cette fois la monnaie, joue pleinement son rôle unificateur, de l'autre les politiques ne cessent de dresser des barrières protectrices de réalités nationales apparemment intouchables. Mais là aussi, l'économie semble devoir garder le dernier mot, dans la mesure où le marché est désormais unifié de fait par une monnaie commune : la souveraineté européenne est inscrite sur nos billets de banque, et si la Grande-Bretagne persistait à rester à l'écart de cette réalité, elle se condamnerait à terme à sortir entièrement du processus de la construction européenne. Mais cet entêtement ne causerait de tort qu'aux Anglais car leur marché dépend entièrement du continent et ne saurait seulement imaginer de s'en rendre indépendant. Or, ce paradoxe nous livre toute sorte d'éléments pour comprendre que derrière les apparences de la fixité d'une Europe sédentaire, se profilent les prémices d'un continent mouvant, d'une République nomade où chaque citoyen pourra circuler destinalement sans crainte. La régionalisation elle-même et son principe de subsidiarité contient en elle-même le gène du mouvement, car, de même qu'aux Etats-Unis ce sont les différences entre les états qui ont créé un mouvement incessant et l'ouverture d'un espace unique et unifié, de même en Europe on verra les populations se mouvoir d'une région à l'autre pour bénéficier de tel avantage ou fuir tel inconvénient. Nous n'avons pas encore fait l'expérience de l'époque de Bonny and Clyde, mais cela ne saurait tarder. Encore que, si on y regarde de plus près, les migrations Sud-Nord ont déjà largement ébranlé la Cité européenne fantasmatiquement comparée à Rome ou à je ne sais quelle autre empire imaginaire. Est-il utile d'ajouter à cela que le phénomène de la construction européenne n'est qu'un modèle facile à manier pour nous, mais que les phénomènes qui l'animent et que nous décrivons, nous pourrions les retrouver au plan mondial, avec certes un peu plus de travail, de patience et de recherches. Récemment encore j'ai pu constater par expérience que les organisations internationales s'emploient aujourd'hui à dissimuler des réalités dont la médiatisation pourrait être trop éclairante pour les peuples, et donc trop dangereuse pour les intérêts des nantis de ce monde. Cette situation nous rappelle celle de 1789, lorsque la réunion des Etats-Généraux se révéla avant tout comme un vaste inventaire dont les éléments éparpillés et dissimulés par les différents pouvoirs se sont rassemblés en un tableau de la France dont l'effet devint incontournable. Il en ira de même avec le monde, n'en doutez pas.
Restent les éléments latents de la volonté commune d'en revenir à un en-deçà de la Cité. Et lorsque l'on parle d'éléments latents, on fait allusion immédiatement à cet animal caché, à ces raisons occultes qui dirigent en secret les actions humaines et qu'on affuble du sobriquet méprisant d'idéologie. Dans ce domaine les choses sont étrangement beaucoup plus claires, mais aussi beaucoup plus difficiles à exposer justement parce qu'il s'agit d'une réalité sur-exposée, aveuglante et de nature à faire fondre toute tentative de s'en approcher de trop près. On peut ainsi constater la souffrance qui traverse tout le texte de Jacques Derrida, l'un de ceux qui tente depuis quarante ans de déconstruire toutes les esquisses idéologiques, c'est à dire de renvoyer l'idéologie à sa fonction là où elle fonctionne en tant que telle, mais aussi de saisir les moments des esquisses de pensée qui, mises bout à bout, peuvent faire substance et dire quelque chose qui transcende tout fonctionnement et toute reconduction du même projet eurocentrique, ethno-euro-centré, en un mot occidental. " Déconstruire " la philosophie ce serait ainsi penser la généalogie structurée de ses concepts de la manière la plus fidèle, la plus intérieure, mais en même temps depuis un certain dehors par elle inqualifiable, innommable, déterminer ce que cette histoire a pu dissimuler ou interdire, se faisant histoire par cette répression quelque part intéressée (2) ". Ne retrouvons-nous pas ici les termes mêmes que nous venons d'utiliser en parlant d'inventaire révolutionnaire ? " penser la généalogie structurée " des concepts de la philosophie, qu'est-ce d'autre que d'en faire le tableau, la représentation aussi exhaustive que possible, et Derrida sait de quoi il parle, des enchaînements et des ruptures de cette " pensée occidentale ", certes totalitaire mais aussi mitée de " blancs ", de trous et de méandres oubliés dont le déconstructeur peut relever la topologie et dévoiler le dessein répressif ou le dessin du réprimé. Etrange analogie, qui est sans doute plus qu'une analogie et en réalité originellement le même, c'est à dire procédant du même souci, ce dont on peut s'assurer en lisant la suite de ce même texte qui révèle à la fois la perplexité des lecteurs de Derrida et son propre désarroi face à son entreprise.
Pourtant, qui mieux que lui aurait pu dresser un tableau, quitte à se passer d'une " trouvaille " et porter le fer sans faiblir là où le destin occidental le demande et sans se réfugier comme le firent en leur temps les dadaïstes dans un registre mélancolique et hirsute du commentaire désabusé et de la caricature hyper réaliste. Je ne pense pas pouvoir me dédouaner de tout ce que je dois personnellement à cet homme, ne serait-ce que les fruits abstraits, la force que répand en soi l'exercice insoutenable parfois de la lecture de son texte. Je ne peux cependant pas me déprendre de l'idée que son œuvre, il faut bien parler d'œuvre qu'il le veuille ou non, que cette œuvre n'est qu'une sorte de moment ultime du nihilisme. Derrida semble affecté d'un orgueil sans limites, d'un moi si fortement paradigmatique de ce sujet contemporain que l'on comprend aisément pourquoi il doit sa véritable gloire à l'Amérique, celle de Carter, mais aussi celle de Reagan et de Bush. Beaucoup de mes amis d'université l'ont suivi, dans sa quête destructrice et mélancolique d'esthétisme et dans les universités américaines. Dommage. D'un certaine manière, Derrida aurait pu continuer le travail brillant de Debord, mener le vrai combat contre les idéologues et contre les faux théoriciens du présent. Au lieu de quoi il aura préféré se réfugier dans un prétrarquisme moderne, attestant finalement du triomphe de la subjectité là-même où il défend les derniers rayons du soleil de l'humanisme républicain. Dommage.
Aussi me contenterai-je de ma " trouvaille " pour faire un ménage auquel personne n'ose s'attaquer. Où donc peut-on repérer dans l'histoire des idées cette volonté de dissoudre la fixité du Da sein dans l'étant ? Ce qu'on peut peut-être classer sous la catégorie " désenchantement du monde ", sécularisation du réel ? La première partie de cet ouvrage peut tenir lieu de fil conducteur à condition que l'on prenne au sérieux la construction de Heidegger qui part de l' idée fondamentale d'un Aristote qui enveloppe tout comme pour préserver l'essentiel au moment de l'envoi du métaphysique, de l'homme qui inventa le moteur immobile pour mieux faire passer l'energeïa et la dynamis, le mouvement et la force comme essence de l'Être pour franchir les millénaires dans le rythme des envois de la question de l'Être sous ses diverses formes. Nous n'allons donc pas tout simplement recopier son esquisse d'une histoire de l'Être, mais plutôt méditer un peu plus longuement sur la dernière séquence de cette époque, séquence qui commencerait avec Nietzsche et se terminerait par Lévinas et Derrida autour des deux grandes figures de Husserl et de Heidegger, mais aussi eu égard au destin allemand.
L'éclat - et l'éclatement - que représente Nietzsche dans l'histoire de la philosophie nous propose une grille de lecture toute aussi éclatante de clarté. C'est sans doute cette seule qualité qui a propulsé et qui ne cesse de propulser ce dandy de l'establishment germanique au zénith de la gloire et du respect universel, en dépit de tout ce qui le condamne irrémédiablement au regard du main stream, du courant éthique majeur du Dix-Neuvième siècle et des siècles suivants, français ou allemands. Voir plus haut ce que nous avons dit sur le rôle et sur le projet de la bourgeoisie de ces deux pays à cette époque de bouleversements scientifiques et techniques. Oui, Nietzsche fut un Dire majeur du Retrait de l'Être. Tout ce que Pascal lui-même avait laissé debout, tout ce que les néo-hégéliens avaient cru devoir retenir de la leçon du maître et ce y compris Marx, tout cela passe à la plus immonde des poubelles. S'il est sans contestation possible vrai que le Christianisme est lui-même l'initiateur de ce retrait, ce qui veut dire que cette religion a tué son propre dieu dans le mouvement même de sa parousie à travers son fils Jésus-Christ, en en faisant un étant, il faut laisser à Nietzsche le mérite dont le lieu n'est pas ici d'en juger l'essence morale, d'avoir coupé les derniers ponts entre le magique du religieux et le monde séculier du sujet. En repliant pour ainsi dire toute l'eschatologie sur le sujet, sur le Surhomme, Nietzsche a mis un point final à toute prise en compte d'autre chose que l'animal humain. Nietzsche confirme essentiellement et principiellement l'homme dans sa place de seule réalité pensante, pensable et digne de pensée. Les choses vont très loin dans cette direction, le plus loin possible. Non seulement la volonté de volonté est reprise en compte entièrement et elle seule, mais l'Être est littéralement nié en tant même qu'immédiate présence, en tant que ce qu'aucun philosophe ou théologien des millénaires précédents n'auraient seulement songé à ne pas placer en tête de sa recherche.
Ce qui sauve Nietzsche du solipsisme totalitaire, de ce qui aurait pu le renvoyer lui aussi dans les poubelles de l'histoire de la philosophie, est la dimension poétique de son Dire, son insistance sur la position unique du Surhomme dans l'étant, c'est à dire dans une proximité magique. Mais cette proximité qui lui permet de dialoguer avec les animaux et les paysages, il ne la doit qu'à lui-même, à son " élan vital " qui le met en continuité avec l'élan universel étalé par la science de son époque, à sa puissance quasi génétique et aux passions dont il a bien fallu se servir comme alibi du Dasein lui-même. En passant, j'ai toujours conservé pour le thème de la passion et des passions le plus glacial des scepticismes, considérant qu'il s'agit là de la plus pernicieuse invention stratégique de l'onto-théologie, d'un paradigme infernal qui n'est qu'une pièce d'artillerie dans l'arsenal des prêtres. L'un des rares mérites de Sade aura peut-être été de ridiculiser ces passions en les transférant à leur niveau le plus trivial, en les déversant dans des poubelles imaginaires où elles ne pouvaient que se décomposer malgré les efforts muséaux des Surréalistes et en particulier de leur observateur silencieux, Georges Bataille. Qu'est-ce à dire ? Je dis que la passion est une invention littéraire, que les passions sont une invention religieuse, et qu'il n'existe aucune passion nulle part à aucun moment de l'existence d'un homme ni à fortiori dans l'Histoire. Cela dit, il a bien fallu une sorte de fondement architectural ou une base formelle pour établir le profil de cet affect particulier, asymptotique dans sa puissance et dans ses effets. Base que l'on retrouve dans la théorie freudienne de l'instinct de mort ou du principe de réalité. Il me faut donc le culot de renvoyer toutes les constructions à base de telles " passions ", dont on ne se gênera pas le cas échéant pour en exciper les excès de vertu révolutionnaire d'un Robespierre ou d'un Saint Just ni ceux du stalinisme lui-même, dans les poubelles des choses impensables car non étantes, sans appartenance à l'Être.
Non, la lecture de Musil entre-autre, d'un Kafka ou encore d'un Pessoa, nous enseignent tout autre chose sur les-dites passions. Ou plutôt ces auteurs nous plantent un décor de loin plus crédible de la médiété réelle de la position humaine, quelles que soient les circonstances historiques, de sa médiocrité constitutive prisonnière de la tunique de Nessus des réalités quotidiennes. Ne parlons pas de Dostoïevski qui est le seul écrivain, le seul observateur de l'âme humaine à conserver toute la distance qui convient par rapport à cette réalité fantasmatique des passions. La seule passion qui traverse toute son œuvre si ontologiquement juste, est celle de sa maladie, la sienne qui porte le nom si parlant de Haut-Mal, c'est à dire la passion en tant que telle, celle du Christ, de la souffrance sacrificielle au sens où elle ne se reconnaît très justement pas d'autre issue que la mort, la résignation ou sa sublimation dans l'œuvre d'art. Même l'Œdipe, on y revient, ne repose en définitive pas sur autre chose que sur la construction toujours lamentablement circonstancielle de la famille. Le meurtre du père est une sale besogne nécessaire parce qu'il monopolise la propriété des femmes mais jamais le produit d'une haine liée à la jalousie particulière liée à la mère. Pure affabulation. La situation de la famille monoparentale bourgeoise ne change strictement rien à l'affaire, ni en effet au refoulé phylogénétique. Nietzsche a donc mené tout le monde en bateau avec sa sur-affectivité, or cette monstration du monstrueux avait sa raison d'être, elle servait, comme le Christ avait servi, à anéantir théoriquement, c'est à dire idéologiquement, toute trace d'une autre relation que l'être-homme entretient avec l'étant, avec le monde autre que lui, y compris avec l'Autre en tant qu'Autrui. Ce dernier trait est le trait fatal du nietzchéisme, la cassure reprise aveuglément pour telle par tous les suiveurs, y compris Husserl et Heidegger.
Il faut ajouter à cela que la passion était devenu une réalité historique, une fabrication ex-nihilo que le clan Wagner mettait en scène. Il faut avoir vécu dans certaines rues de Strasbourg ou de Berlin Est pour sentir jusque dans sa peau la folie esthétique qui s'est emparée de l'Allemagne de la seconde moitié du Dix-Neuvième. Il suffit de contempler l'architecture dite néo-classique, véritable symptôme de narcissisme exacerbé en mégalomanie. Chaque immeuble est le reflet d'un onirisme de cabinet, partagé par les premières classes de purs techniciens encore membres de l'une ou l'autre ramification de l'aristocratie d'argent ou de titre. J'ai habité quelques treize ans dans l'un de ces immeubles presque magiques, aux murs élevés à plus de quatre mètres au-dessus des planchers. Je suis resté fasciné par tout ce que j'ai pu lire en mettant simplement mon nez à la fenêtre à contempler les façades voisines scarifiées de rêveries mythologiques qui mélangent gaiement les styles gréco-romains et le romantisme de la Bavière de Louis II en résultats parfois simplement ahurissants. Cette architecture, commandée en Alsace par la victoire de 1870 et menée tambour battant, Université comprise, se sent et se vit comme la carapace d'un monstre en gestation, la croûte des sentiments grimés en passion que les Allemands affectaient déjà d'exposer au monde dans leur vitrine alsacienne de l'avant-guerre, de l'avant-cataclysme dont ces Européens redevenus Germains commençaient déjà à rêver. Voilà, oui, ce qu'il en est des passions, enflures psychiques du sublime, prétention humaine trop humaine à s'approprier les vraies grandeurs de la Nature et à les coudre, se les tatouer là où cela se voit.
Avec Husserl, la philosophie, rebaptisée phénoménologie, " se présente comme seule capable de formuler et de remplir la tâche universelle, de résoudre la double énigme de l'existence d'un monde formé d'objets et de l'existence de sujets qui sont dans le monde, et pour lesquels seules pourtant ce monde est.(3) " Rien de moins sûr. Qu'existe-t-il pour prouver que nous les hommes, les sujets, soyons les seuls êtres pour lesquels le " monde monde " ? Husserl, et donc aussi Derrida qui pense avoir trouvé toutes les faiblesses de la cuirasse phénoménologique, raisonnent en permanence dans les termes de la subjectité comme évidence de la situation ontologique. Pourquoi le transcendantal serait-il notre propre, ou notre privilège ? Chambon, et bien d'autres phénoménologues, n'hésitent pas à graduer l'accès à la perception, comme nous l'avons vu plus haut, et donc à une organisation des sensations qui n'exclue ni l'existence de systèmes signifiants, ni la " différance " comme reliant le transcendantal à la présence pure. Et encore à la condition que la différance, ce non-concept conceptuel, soit réellement autre chose que la possibilité de la répétition, possibilité hautement douteuse et sans doute origine de toutes les difficultés de la phénoménologie. En passant, la " différance " m'a toujours fait l'effet d'une lapalissade philosophique, le suffixe en a ne changeant strictement rien à l'état que l'expression verbale est censé produire : la différance produit de la différence. Point. Mais que signifie réellement raisonner dans les termes de la subjectité ? Ceci : la question de l'Être est réduite à l'examen de la relation de l'individu, du sujet, à la présence. Chez Husserl cette réduction se redouble encore de la Réduction transcendantale, comme si la question de l'Être avait trouvé son laboratoire absolu non pas dans la position de l'être parlant et de l'autre, du monde, mais exclusivement dans l'être parlant lui-même, dans cette nouvelle mouture du microcosme cette fois délié de toute analogie avec le macrocosme. Au quinzième siècle un Sébastien Franck allait lisant dans le Grand Livre de la Nature comme macrocosme, mais Husserl, toutes barrières franchies dans le sillage de Descartes, non seulement ne s'adresse plus qu'à lui-même, mais au lui-même de lui-même, à son propre microcosme intentionnant à l'intérieur de l'encombrant Livre de sa propre corporéité, corporéité dont il ne retient plus que sa présence intuitionnante.
Plus nomade que ce réducteur d'intuitions tu meurs, plus seul dans la démarche cognitive tu meurs, et tout est dans le sens moderne de la connaissance. Oui, de Nietzsche, Husserl a retenu la terrible leçon de la position solitaire absolue, le pouvoir narcissique de démanteler le mystère de la relation ontologique. Besoin de personne sur sa Harley Davidson pour démonter les rouages et les forces objectives qui confèrent au sujet le pouvoir absolu sur la vérité, le pouvoir absolu de la vérité. Avec quel enthousiasme communicatif, Edmond découvre le côté charnel de la quête philosophique, la réité fondamentale de son cadre, la simplicité du topos, cette présence intentionnée que la dialectique avait dissimulée derrière la certitude sensible pour permettre au savoir absolu de se l'approprier cette fois hors du sujet, dans l'état. En un certain sens, avec Husserl la philosophie occidentale atterrit sur son sol propre, et cette fois de manière parfaitement laïque. Car Descartes avait déjà, en réalité, accomplit dans toute son extension cette démarche subjectivante, sauf à la limiter du côté de ce qu'on pourrait appeler son label, ou son estampille, par cette autre présence indiscutable de la divinité. Or Husserl joue de malchance. Au moment même où la liberté prend son essor théorique, ou disons qu'elle trouve son véritable terrain, au moment où l'Homme naît en quelque sorte comme interlocuteur solitaire et tout-puissant de l'Être, c'est à dire au moment où il récupère pour ainsi dire sa position originaire, celle du nomade, le monde s'effondre dans le fracas d'un mouvement historique où ce sujet se trouve gommé d'un seul coup, expulsé sans phrases de la quiétude du dialogue ontologique vers les tranchées des collectivités où l'on s'égorge. Précisons : Husserl réinstalle l'homme à sa vraie place, celui de son débat avec la présence, montrant ainsi les espaces immenses de recherche qui s'ouvrent, et que trouve-t-il pour ainsi dire comme cadre empirique immédiat de cette nouvelle perspective épistémologique ? Avec quelle qualité de présent se voit-il tout d'un coup sommé de méditer ? Avec l'Apocalypse. Avec la mise en charpie de ce présent délicat, son abattage méthodique, sa pulvérisation. Husserl se retrouve dans la situation d'un savant dont les instruments et l'objet même de la recherche se brisent en mille morceaux au son des canons de la Marne et de Verdun.
Ces canons, il y a deux hommes qui les entendent bien, et qui ne feront pas la fine bouche pour opérer, même dans ces conditions, les pires que l'on puisse imaginer. Au contraire, Ernst Jünger jubile, lui aussi. Le temps réel est enfin arrivé, la mort sous la main, le parfum sulfureux de la décomposition du présent lui monte à la tête. A la manière du baron de Münchhausen il chevauche les boulets de canons et se fait servir les shrapnells à tous ses petits déjeuners. Dans ses sous-sols il mitonne déjà le monde de demain, celui du Travailleur, cette figure résolument antinomique à tout ce dont la métaphysique occidentale vient péniblement d'accoucher. Martin Heidegger, quant à lui, n'est pas encore le voisin de pallier qu'il deviendra longtemps après cette guerre, lorsque, vaincu mais toujours vaillant, Jünger va s'installer à un jet de pierre de Todtnauberg. Mais les deux hommes sont déjà comme frères et c'est une bien curieuse fraternité qui s'initie alors, car ils n'ont rien en commun que cette étincelle provoquée par la rencontre quotidienne de la mort. L'Être devient le Temps, tout de suite. Heidegger a compris qu'il n'était plus possible de se jouer du temps ou de se contenter d'en faire un usage ancillaire et purement instrumental. A la guerre elle-même il échappera car le cœur lui manque. Il en fera donc la météorologie en pratique et en théorie. Le temps réel des bonds que fait Jünger de tranchées en tranchées, il va le cataloguer en critère, paramètre du Da Sein, de l'existence, essence du " souci ", mais tout cela est mal dit, écoutons le tout jeune Martin en 1922 dans le rapport qui vaudra comme thèse d'habilitation à son poste à Marbourg : " Dans la mobilité du souci est vivante une inclination au monde, à titre de disposition à se perdre en lui, à s'y laisser prendre. Cette propension du souci exprime une tendance facticielle fondamentale de la vie à la chute, par où elle se détache de soi-même, et par là à la déclivité qui la livre au monde, et ainsi à la ruine de soi-même….La déchéance ne doit pas être comprise comme un événement objectif et comme quelque chose qui se " passe " simplement dans la vie, mais bien comme une modalité intentionnelle de la vie. "(4) Dans ce texte remarquable dont on pourrait dire par ailleurs qu'il contourne ou qu'il dépasse toute la problématique d'une Kehre, d'un tournant ultérieur de sa pensée après l'échec de Sein und Zeit, Heidegger historicise d'un coup toute la phénoménologie. Il la plonge, la soumet à la trempe du présent historique d'une manière si radicale qu'elle apparaît presque comme une insulte à la pensée du maître, Edmond Husserl. Comment, en effet, ce dernier pouvait-il entendre une phrase comme celle-ci : " L'être-là facticiel est ce qu'il est, toujours seulement en tant que propre et jamais en tant qu'être-là général d'une quelconque humanité universelle, chimère dont il n'est aucunement besoin de se soucier. " (4)
L'homme, une chimère. Voilà le message que reçoivent en même temps cinq sur cinq le penseur de l'époque des Titans et celui de la question de l'Être. Le souci de Husserl lui-même n'était certes pas étranger à l'Histoire, mais une histoire qui concernait principalement le statut de la Science et celui de sa relation à la philosophie, c'est à dire à la phénoménologie. Qu'aujourd'hui la psychiatrie allemande soit pratiquement dominée par l'école phénoménologique montre que le projet purement psychologique de Husserl a trouvé un aboutissement concret, quoi qu'on en pense, mais aussi que ce projet portait précisément sur ce que l'homme avait d'universel et non pas sur le Da Sein collectif auquel se vouent désormais deux éminents penseurs de deux Reich successifs, chacun à sa manière.
Pour Jünger comme pour Heidegger, le temps n'est plus à l'analyse de la relation de l'ego à sa présence et à son dépassement dans la signification transcendantale et intentionnelle. Ensemble ils foncent en direction du sens, non pas celui qui émerge de l'intellection ou de l'intuition elle-même, mais du sens du tout de l'Être, et donc forcément du sens de l'Histoire. En réalité d'une différence ontico-ontologique dont le topos, l'espace, ne se confine plus dans le transcendantal proprement dit. Pour l'un, ce transcendantal intègre l'horizon de l'histoire de la philosophie qui devient le vecteur des envois de l'Être. Pour l'autre c'est l'Histoire tout court qui devient le lieu d'un transcendantal aussi palpable que la chose de l'intuition. Oublieux des ricanements anti-historiques de Nietzsche, Jünger se sert quand-même du Surhomme mais en le collectivisant pour inventer une figure collectivement inconsciente qui se prépare au-delà et à travers la destruction totale du monde bourgeois. La guerre, la destruction, les horreurs de ces nouveaux labours sidérurgiques forment la parturition d'un monde formaté en tant que la figure du Travailleur. Bien sûr, c'est l'Être qui formate, l'Être qui transforme l'univers envers et contre la pusillanimité stérile de l'individu même si cet ëtre n'est jamais cité et demeure implicite, quasi théologique. Les guerres ne sont que de vastes chantiers de démolition que suivront d'autres chantiers définitifs, les derniers, ceux qui accoucheront d'une société stable et pacifique, réglée par l'ordre des nouvelles castes techniques. Ce monde à venir sera-t-il essentiellement différent de celui-là ? Sera-t-il une nouvelle utopie ? Non, en fait, ce travail de Titans ne doit avoir pour effet que de rendre le monde à sa sainte origine, son équilibre antique où les valeurs aristocratiques auront ressuscité pour reprendre toute leur place dans la réalité. Héroïsme, honneur, vertus, les Tugende, les vertus de Frédéric vont - on est en 1932 - reprendre leur place, et cette fois au plan du monde, de la civilisation elle-même. Pourquoi se voiler la face ? Le diagnostic que nous révèle le Travailleur a beau recouvrir génialement le cours apparent de l'histoire occidentale et nous en proposer des visions proprement prophétiques, il reste que l'image globale de cette utopie ne diffère de ce qui se prépare dans les conciliabules nocturnes de la NSDAP que par la force morale de l'intention de son auteur. L'importance du Travailleur n'en est pas pour autant affaiblie, car les intuitions de Jünger vont bien au-delà des événements qui vont suivre immédiatement la parution de son livre : il pressent des enjeux réels, ceux-là mêmes qui forment la crise présente. Ses options aristocratiques patentes reposent entièrement sur la certitude du triomphe final inespéré du sédentarisme, une eschatologie qui demeure interdite à Heidegger dont le maître-mot du destin de l'étant est l'errance, cet effet historique du retrait de l'Être.
Martin Heidegger. A l'époque des locomotives à vapeur, il existait un métier qui a laissé un nom dans le vocabulaire qui va bien au-delà de sa fonction propre, celui de fumiste, le cheminot chargé de l'entretien des cheminées des locomotives. Il faut croire que ce travail n'était guère valorisant puisque son nom désigne aujourd'hui exclusivement un individu dont les occupations ne valent pas grand chose, ne sont que de la fumée qui tente de tromper son monde. Je raconte cette petite histoire sémantique parce que le nom propre du philosophe considéré par beaucoup comme le Platon de notre époque, signifie dans le dialecte de son pays une fonction comparable à celle du fumiste. Hei vient, comme dans l'Alsace voisine, de Heu, le foin. Degger est une déformation dialectale de Decker, couvreur. Or le matériau noble utilisé pour les toits de jadis n'était pas le foin, mais la paille, Stroh. L'emploi de Heu, de foin, correspond donc à quelque chose comme un bricolage probablement réservé à ceux qui ne pouvaient pas se payer le luxe de la chaume, un matériau résistant aux intempéries et au temps. La chaumière du philosophe pourrait ainsi s'avérer très fragile, impression qu'on est cependant loin de ressentir au vu du chalet massif que Heidegger possédait près d'un sommet du Schwarzwald. Ce contraste entre un nom qui évoque d'abord l'éphémère et la fragilité et l'empire qui s'est construit autour de lui peut nous servir de tonalité fondamentale d'une image qu'on pourrait donner de sa pensée. Mais ce contraste est tout aussi pertinent pour illustrer l'histoire de la " faute " qu'on lui impute si cruellement, et si je m'en réfère aux réactions que j'enregistre dans mon environnement intellectuel, de plus en plus impitoyablement. L'affaire du Rectorat est vraiment, dans son essence, une affaire de fumiste et pas plus. On peut le dire autrement : Heidegger a péché par vanité, tellement conscient de la force de sa pensée, de la solidité du sol sur lequel il construisait alors sa théorie, c'est à dire son abri de pensée, qu'il a cru qu'en le désignant à un poste aussi convoité mais somme toute bien secondaire du point de vue politique, on en faisait une sorte de souverain spirituel de la destinée allemande, le Hegel de Fribourg. Il n'a pas mis longtemps à déchanter, et la seule chose que l'on peut lui reprocher d'un point de vue moral est d'avoir cru à cette farce et de s'être laissé instrumentaliser par le parti nazi, ne fût-ce que pendant quelques mois.
Cette fragilité ontique se retrouve-t-elle au plan ontologique ? Là est toute la question qui peut se reformuler ainsi : de quel matériau Heidegger s'est-il servi pour étayer l'ontologie fondamentale ? Nous avons déjà répondu d'une certaine manière à cette question lorsque nous avons affirmé que le disciple le plus doué de Husserl avait abandonné la phénoménologie dont le maître avait décrit et qualifié le champ une fois pour toute, pour une phénoménologie historique qui dépassait radicalement le cadre du débat intellectuel de l'époque. Toute son audace, d'ailleurs, réside dans ce geste qui a consisté à briser, du moins de manière programmatique, tous les hublots ménagés par la tradition pour accéder à des universaux dégagés du temps historique. L' " existentialisme " qu'il planifie déjà dans le rapport cité plus haut, dépasse de loin la question de savoir qui de l'essence ou de l'existence précède l'autre. Car le paradoxe de sa pensée historique veut qu'en même temps qu'il procède à une réduction phénoménologique historique de la métaphysique occidentale, il enregistre positivement le nihilisme anhistorique de Nietzsche. Autrement dit, il y a une histoire, celle de la question de l'Être, à l'intérieur d'une non-histoire, d'une errance ontique qui n'est sauvée que par la récurrence développante des figures de l'Être. C'est là que l'on peut distinguer la paille qui fissure et affaiblit en permanence le béton de son questionnement, car son Rectorat est précisément l'affirmation soudaine du Retour dans un contexte dont les conditions n'ont aucune importance : l'histoire ontique de l'Allemagne de Weimar n'intéresse nullement le professeur Heidegger, cette histoire n'existe pas, et c'est bien pourquoi il s'enfonce lui-même en conférant à Hitler, parce qu'il ne peut pas faire autrement, la caractéristique nietzchéenne du Surhomme. Le Surhomme, on le sait, vit en-dehors de toute Histoire autre que la sienne. Comment alors bricoler, faire tenir ensemble, le foin du politique et les murs en béton du Retour du même, celui de Parménide ? Par le compromis d'un dédoublement ontique qui laissait à Hitler le rôle pastoral du destin gréco-allemand. Pauvre Martin !
Heidegger mérite la pitié car la place qu'il occupe dans toutes ces Histoires constitue le piège le plus diabolique que l'on puisse imaginer. J'ai beau chercher dans ma culture, mais je ne trouve aucun équivalent dans le passé sinon, sinon peut-être Platon qui a vécu les affres du déclin brutal d'Athènes et s'est trouvé mêlé, peut-être bien malgré lui, à cette liquidation de la culture pré-socratique. Pourtant c'est dans la relation qu'entretient Heidegger avec Aristote que l'on trouve une bien plus grande fraternité de pensée. Et à bien y réfléchir, c'est bien Aristote qui se trouve à un carrefour historique étonnamment analogue à celui du maître de Fribourg. La Grèce ionienne et dorienne agonise. Comme notre Europe d'aujourd'hui, elle ne parvient pas à s'unir malgré toutes ses institutions religieuses ou ludiques. Epuisée par trente années de guerre fratricide, Sparte et Athènes confient leur destin au Macédonien Philippe dont Aristote éduque le fils Alexandre. Ces faux " Doriens du Nord " iront jouer le destin de l'occident grec dans l'aventure orientale, tombant ainsi le masque de faux sédentaires qu'ils étaient. En élargissant le panorama historique, on est obligé de constater que cette aventure est un modèle qui sera imité régulièrement avec le même résultat, et ce jusqu'à l'opération Barberousse, juin 1941. Heidegger est donc sommé, non pas de montrer patte blanche aux nazis, mais d'intégrer l'historique à l'historial : si on peut soupçonner Aristote d'avoir été celui qui a cru devoir rassembler en hâte pour le mettre en sûreté le tout du projet grec peu avant la catastrophe finale, alors on peut placer Heidegger dans une situation analogue. C'est pourquoi il mérite plus que de la pitié, mais un respect infini pour le courage avec lequel il a traversé tant d'orages historiques sans renoncer à son destin historial. Le geste qu'aura osé Martin Heidegger au milieu d'une tempête qui aurait dû l'en dissuader, dans l'œil du cyclone d'un nihilisme ontique, est celui du retrait de l'Être. Au risque de disparaître sous les murs s'effondrant de la gare du Destin, il est allé à la consigne retirer le sale paquet déposé là il y a quelques millénaires.
Notes
1 - L'anéantissement des civilisations amérindiennes n'en est qu'un exemple.
2 - Jacques Derrida, Positions, Les Editions de Minuit, 1972, page 15.
3 - René Schérer in Histoire de la Philosophie 3, Encyclopédie de la Pléïade, Gallimard , Paris, 1974, page 528
4 - Martin Heidegger, Interprétations Phénoménologiques d'Aristote, traduction J-F Courtine, Ed T.E.R. , 1992, page 23
5 - ibid.
Jeudi 8 janvier 2004
L'Être consigné.
Oui, l'Etre s'est un jour mis à la consigne des hommes sous la forme transcendantale du concept d'être. Qu'a révélé cette forme en tant que fond ? Quel trésor sémantique s'est ainsi mis à la portée de main de l'homme, trésor que le même homme va désormais s'acharner à entraîner dans un processus déterminé de destruction nommé Histoire.
Hé bien il faut avoir de l'imagination pour comprendre. Heureusement nous avons inventé le cinéma qui va nous aider à sentir ce qui s'est passé dans la tête de Parménide ou d'Anaximandre, deux hommes dont les consciences, d'après ce que nous savons, ont été les scènes sur lesquelles se serait joué toute l'affaire, et quelle affaire ! On peut aussi tenter de faire, chacun pour soi l'anamnèse du comment ça c'est passé dans l'enfance. Et cela donne à peu près ceci : sous nos yeux, sous les yeux de Parménide, le monde s'est arrêté. Tout simplement.
Plongez-vous dans un film d'action hollywoodien quelconque, un thriller comme on les appelle, et gelez l'image n'importe quand en zappant sur la bonne touche. Voilà que tout s'arrête, le ou les personnages se figent dans leurs rictus, les objets qui volaient s'arrêtent de voler et vous pouvez à loisir détailler la scène en examinant aussi longtemps que vous le souhaitez le moindre recoin de l'image. Tout s'unifie dans votre regard. Ce regard était jusqu'à ce moment précis entraîné par une sarabande de mouvements, totalement ou totalitairement submergé par les enchaînements de l'action dictée par le scénario. Pour les professionnels, ce diktat de l'image a ses limites car le mouvement filmé exige une science elle-même limitée, mais le spectateur pour qui ces films sont produits est supposé, lui, être entièrement soumis au rythme du déroulement de l'intrigue. Pour que le film soit un succès, il s'agit là d'une condition sine qua non. En gelant l'image, le spectateur subvertit le sens de sa position et devient, ce faisant, un professionnel car il fait passer la décision réalisante de l'écran à son œil, il cesse de voir pour regarder, observer, scruter et non plus simplement recevoir des stimuli qu'il devra interpréter comme il pourra. Ce que chacun de nous peut retenir de son enfance et de sa jeunesse en général, c'est le côté aveugle de la succession des événements : ce qui arrive dans l'enfance, arrive et n'est jamais une conséquence attendue par la conscience du sujet. En bref, la réalité de l'enfance de la vie est un chaos qui s'ordonne lentement et douloureusement.
Et c'est cet ordonnancement qui s'entame avec Parménide et Anaximandre. Pour la première fois l'homme sort de la position purement phatique, purement passive face à ce qui lui arrive de partout, sensations, sentiments, volitions ou intellections. Parménide a été le premier grand zappeur de l'histoire humaine. En proférant cette simple expression to on è on, l'étant en tant
qu'étant, il fige d'un coup l'univers entier comme si c'était une simple image sur un écran de télévision.
On peut imaginer un avant à cette expérience esthétique. On peut, et on doit d'ailleurs logiquement se dire qu'il y avait déjà de l'être AVANT le dit de ce " en tant que ". Pourquoi ? Hé bien parce que chaque élément de l'appréhension de ce qui pouvait alors passer pour le monde contenait de l'être mais sans que cet être n'apparaisse comme dimension particulière de l'élément capté par l'une ou l'autre faculté psychique. Cet être n'était pas consigné, il n'était pas encore être au sens d'élément d'une taxinomie des idées, des idées au sens de Descartes, c'est à dire des sensations, perceptions, intellections. L'être n'était pas catalogué et encore moins hiérarchisé dans une taxinomie. Il faut donc chercher pourquoi, avant même de se demander comment, quelqu'un comme Parménide a pu établir, c'est le seul mot que l'on peut utiliser à cette place, l'être dans une sorte d'ailleurs de toute chose, de substrat des choses. Le mot théorie est ici employé dans son sens primitif, à savoir dans le défilement des choses et des idées ou, plus exactement des choses-idées.
Nous apercevons tout de suite que la consignation de l'être, sa mise en lumière en tant que lui-même élément de l'appréhension, requiert une sorte de vision de l'invisible : Parménide voit soudain une chose qui n'existe pas dans le catalogue des choses qu'il connaît. On peut supposer, mais ici rien de moins sûr, que l'être en tant que copule possède une certaine antécédence par rapport à la notion d'être en tant que tel. Mais, antécédence ou pas, l'accouchement du concept d'être en tant qu'être passe nécessairement par une sorte de mutilation de l'opération attributive ou autrement dit d'une soustraction opérée sur la substance perçue. Si je dis : je suis un homme, je dois me débarrasser de l'attribut pour parvenir au simple je suis, c'est à dire à une appréhension primitive du concept d'être. On peut discerner par ailleurs que ce court-circuit de la pensée, comme aimait à dire Roger Chambon, renvoie l'opération attributive à une attribution toute nouvelle. Elle signifie rien de moins que " Je suis Je ", sous-entendu " et rien d'autre ". Ce qui dans la conception anthropologique grecque pouvait passer pour aberrant en regard du sentiment de dépossession radicale éprouvé par l'homme grec. C'est ainsi, sans aucun doute aussi, qu'est né le sujet en tant que moi, sans qu'il y paraisse et sans qu'il soit à l'ordre du jour explicitement avant plusieurs siècles, avant Descartes en tout cas.
Laissons parler Parménide, selon une traduction dont je ne suis pas à même de faire la critique. On pourra malgré tout en tirer quelques fruits intéressants. Voici ce qu'il dit (traduction Jean Voilquin, Garnier Flammarion 1975) : - " Une des routes est que l'Être est, et qu'il n'est pas possible qu'il ne soit pas ; c'est le chemin de la certitude car elle accompagne la vérité " - Nous savons que l'autre route est celle de l'opinion, du non-être où règne l'obscurité totale, en somme ce à quoi nous faisions allusion lorsque nous avons évoqué l'âge où nous subissons toute chose sans agir. Donc, en contemplant toutes les choses, le philosophe d'Elée découvre deux routes, deux dimensions inhérentes au spectacle global qu'il peut contempler. La première part de la vérité, prise ici comme témoin et non comme l'objet de la recherche : il dit en effet " car elle accompagne la vérité " comme si la vérité dont il parle était une évidence pour tout le monde. Or elle l'est car cette vérité est ici exactement l'aléthia telle qu'elle est comprise et décrite ou poétisée par Martin Heidegger, c'est l'ouverture, l'éclaircie, la parousie. Toute chose apparaît dans un dévoilement qui le fait être : l'étantité d'une chose est le produit de la vérité, et non pas le contraire, ou encore, une chose devient étante, on peut dire d'elle qu'elle est à partir de sa vérité aléthéique, à partir de son dévoilement dans l'éclaircie (de l'être).
Encore faut-il, et tout est là, être capable de considérer toute chose seulement dans sa parousie, exclusivement dans son surgissement et non pas pour l'une ou l'autre de ses qualités pour lesquelles nous aurions désir ou dégoût, c'est à dire qui entraînerait le mouvement. Génération et corruption sont les mots qui articulent toutes les philosophies des pré-socratiques autour du concept central de physis aujourd'hui si bêtement traduit par nature. Aujourd'hui encore on oppose physis et teknè, en présentant la physis comme ce qui naît et croît de soi-même et la teknè comme ce qui est produit par la main de l'homme. En réalité la physis est le cadre dans lequel se meut la pensée de ce qui apparaît et disparaît, de la vérité de l'être et du non-être, raison pour laquelle Aristote n'a pas écrit une technologie, mais une physique.
Tout est phusique. Cela veut dire que rien de ce qui se conçoit d'une manière ou d'une autre, y compris l'illusion, l'hallucination ou le mirage, n'échappe à la logique de la physis, génération et corruption. La science, au sens vulgaire, c'est à dire cette discipline politique et idéologique inventée à l'époque moderne face à l'évidence de la disparition prochaine de la raison religieuse, cette science a tenté d'éterniser les éléments structurels de l'étant exactement de la même manière que la religion avait posé l'éternité comme évidence ou comme corrélat de l'infini. Or même Aristote avait déjà démystifié l'infini comme impossibilité logique. Dans sa métaphysique en Alpha 3 28-29 il condamne l'infini sans recours : -" Rien d'infini ne peut exister ou alors l'infinité n'est pas infinie " - (Trad. J.Tricot. Ed Vrin 1974) . Que peut-on ajouter à cela ? Le stagirite avait compris cette chose simple à savoir l'incompatibilité de l'existence avec l'infini. Or nous ne sommes pas qualifiés pour affirmer l'être de quoi que ce soit qui échapperait à l'existence, et c'est là toute la faiblesse pour ainsi dire génétique de toute théo-logie.
Nous venons en somme de raconter une histoire, celle de ce que nous avons appelé la consignation de l'être. Un homme se met un beau jour à concevoir une dimension de l'étant et des étants absolument universelle et absolument indubitable. C'est pourquoi il parle de certitude, et il n'est pas question ici de la différence entre science et opinion, entre vérité et erreur, mais bien de la certitude qui découle de la présence de quelque chose plutôt que de rien. Je le répète, à supposer même que tout ne soit qu'illusion, ou encore représentation au sens des idéalistes comme Berkley, ce tout reste quelque chose, une physis qui n'a nul besoin de s'incarner dans une matière pour revendiquer l'existence. La question qui se pose donc est de savoir quel statut accorder à cet événement particulier nommé Parménide ou encore Anaximandre ou Melissos encore pour certains. Ces hommes ne sont-ils que les répétiteurs d'une évidence dont nous avons retenu les noms par hasard, ou bien appartiennent-ils à une histoire, sont-ils des découvreurs au même titre que ces aventuriers dont les parcours ont ouvert l'Europe à de nouveaux horizons vers la fin du Moyen-Âge ?
Je n'en sais rien. Je répugne à mélanger mon souci anthropologique avec cette méditation ontologique, car il serait évidemment facile de mettre la découverte de Parménide au compte de cette pratique de la mise à l' abri des choses initiée et motivée par la sédentarisation encore proche à l'époque des Grecs. L'histoire elle-même participe de cette pratique économique de la mise en silo de la réalité, la mémoire devenant ainsi une sorte de banque des faits et gestes dont les comptes offrent avec intérêt matière à imitation et à répétition. Il n'en reste pas moins que l'événement qui a poussé l'être humain à fonder des civilisations, à se rassembler dans des cités et à créer des territoires dotés de frontières est lié à la découverte ou, je préfère encore dire la mise au point des philosophes qui ont précédé Platon. Comme je l'ai indiqué dans mon ouvrage Atopie, la question de l'être est même la raison essentielle du choix que semblent avoir fait les hommes de mettre fin à leurs transhumances, à leur mobilité fondamentale, au nomadisme.
Au total, je préfère en rester à la notion finalement commode de répétiteurs mais en y ajoutant l'idée de l'initiatique. Parménide ne serait qu'un banal pédagogue dont la grandeur qui nous fait illusion provient de la rareté matérielle de son message : la censure du temps, et notamment celle de la latinisation chrétienne, a effacé le paysage réel de l'Antiquité et ce qui reste prend figure d'exception merveilleuse, de ce qui participe de l'enchantement du monde. En réalité, la théorie de l'être telle que l'articulent les quelques fragments qui nous restent, n'a été, semble-t-il, que la base la plus élémentaire de l'enseignement de ces temps-là. Un enseignement que le platonisme et sa suite théologique se sont empressé de pervertir en vue de son anéantissement définitif auquel on ne sait pas encore s'il a échappé. Les pré-socratiques n'étaient ni des illuminés ni des précurseurs de La Philosophie, mais les derniers enseignants de ce qui faisait le souci des humains, leur culture au sens essentiel et, peut-être l'origine pratique du choix de la sédentarité. L'un immobile de Parménide n'était que le symbole d'un choix historial qui cohabite pour ainsi dire avec son opposé, le multiple en mouvement d'Héraclite, l'histoire en tant que chaos historiographique. On peut aussi dire l'hostilité subsistante de l'esprit nomade. Le destin de la Grèce antique peut se décrire sans peine selon une logique d'opposition dialectique de ces deux tendances praxistiques, Ioniens et Doriens n'ont échoué historiquement que par manque de résolution, par défaut d'Entschlossenheit. On pourra ultérieurement constater que toute l'histoire de l'occident se caractérise par la répétition théorique de cette opposition ainsi que par la répétition de l'échec pratique qui y demeure lié. Au bout de cette Histoire, Martin Heidegger se trouve dans l'œil du cyclone, déchiré entre le chant des sirènes de l'ubris nietzchéenne et la mise à l'abri de la vérité en tant que liberté.
Samedi 10 janvier 2004
La bergerie de l'Être.
Heidegger avait certes ses raisons pour enfermer l'être dans cette bergerie dont il présente l'homme comme le gestionnaire obligé de par son apanage langagier. Il n'est pas innocent que le philosophe accusé d'avoir fricoté avec les nazis, ce qui dans un certain sens ne fait aucun doute, se soit cru obligé, le moment venu, de rendre sa dignité transcendante à l'être que son histoire immédiate avait tant ravalé au rang d'animal. Encore faut-il toujours préciser que l'animalité dont on parle ici est celle que fantasme l'opinion depuis tant de siècles, et non pas notre propre conception (notre propre ignorance) de ce qu'est un animal. C'est dans ses plaidoyers de dénazification théorique - que ce soit dans la plaquette qui traite de l'humanisme ou encore dans l'interview publiée à titre posthume qu'il avait donné au Spiegel - que l'on trouve cette mise au point dont on sent bien qu'elle lui est somme arrachée contre son gré. Plus tard, il ne parlera plus guère de sa bergerie, s'étant installé définitivement dans ce qui n'est qu'une exclusivité apparente de l'homme, à savoir la parole. Il ne lui avait pas échappé qu'il y a longtemps que les poètes ont su lire et entendre les paroles des étants autres que l'animal humain. Au demeurant, son édifice philosophique et poétique s'achève sur ce qu'il y a de moins humain dans l'univers, à savoir le silence.
Son erreur aura été bénigne mais embarrassante. Il a longuement développé son idée des " envois " de l'être, plantant un décors historique de la détresse de l'oubli de l'être (un génétif double qui implique aussi que l'Être lui-même s'oublie) et où, malgré cet oubli ou à travers cette nuit, certains personnages recouvrent " historialement " la vue ontologique, se retrouvent face à la question initiale et tentent d'y répondre, parfois de la manière la plus alambiquée et la plus obscure, voir Kant ou Hegel. Voir le maître de Heidegger, Husserl lui-même. Ces hommes auraient, chacun selon sa guise - mais que recouvre ce mot ? - redécouvert la question fondamentale résumé par Leibniz dans son fameux : pourquoi y-a-t-il de l'être plutôt que pas ?
La geste de la bergerie a pourtant un sens historique, une direction par laquelle il se passe quelque chose de nouveau à chaque nouvel envoi et qui se cumule en un résultat. Nous le savons, ce processus, puisqu'il faut l'appeler ainsi faute d'une autre expression, aboutit à la subjectité, c'est à dire en quelque sorte au transfert de la substance en l'homme en tant que sujet. Si on peut imaginer le monde avant Descartes, il faudrait pouvoir le représenter pour ainsi dire en morceaux, en diverses parties substantielles telles que la science encore aujourd'hui nous le présente : le monde minéral, végétal, animal et humain. Il faudrait encore ajouter divin. Or cette hétérogénéité n'est pas encore hiérarchisée, elle se contente d'énumérer ce qu'il y a autour de nous, les hommes, et ce qu'il y a autour de nous en tant que réalité intangible. Ce qui change dans le règne de la subjectité, c'est que finalement tout s'ordonne autour et en vue de l'homme, ce que l'opinion commune désigne comme la domination de l'être humain sur le reste de l'univers. Désormais rien d'autre que l'Homme n'est plus assuré de sa réalité ni de sa pérennité. L'homme a repris en lui toute la responsabilité de l'être des autres choses que lui : il s'est posé comme le créateur continu de ce qui est. C'est en critiquant ce résultat, un fait incontestable, que Heidegger en est venu lui-même à son propre " envoi ", qui au résultat n'aura pas été autre chose qu'un respectueux mais stérile pas en arrière. C'est l'expression dont il se sert lui-même pour caractériser son propre dialogue avec l'Histoire de la Philosophie.
Peut-être pas si stérile que cela. Car cette histoire " historiale " aura également eu pour résultat d'attribuer à l'homme une position d'entière solitude vis à vis de la question de l'être : cette question aura fini par lui échoir totalement au point de devenir son destin. Là encore on peut s'interroger sur la finalité originelle de la décision des hommes de cesser de nomadiser, et ce faisant, de partager le sens de l'étantité du monde avec les autres étants. Tous les nomades ont toujours laissé aux autres étants, au ciel , aux paysages, aux arbres, aux animaux, une place dans leurs panthéons. On peut supposer qu'il s'agit là d'une délégation de pouvoir, pour ainsi dire d'un accord diplomatique avec les éléments qui composaient leur monde. Cette attitude écologique avant la lettre - mais qui n'a rien à voir avec notre écologie sinon avec le souci qui la mine - faisait de ces éléments naturels les ambassadeurs ou les coadjuteurs des humains par rapport à cette question de l'être. Même dans les pré-civilisations sédentaires, les empires grecs et romains, ces éléments jouaient encore un rôle au moins divinatoire dans les affaires humaines. Les haruspices romains ne faisaient pas autre chose que d'interroger l'état de l'étant en tant que tel, son faste ou son néfaste, à partir de ce que pouvait montrer les éléments qu'ils interrogeaient, que ce soient les astres, les oiseaux dans leur vol ou la couleur de leurs excréments. La religion, puis la science, les deux puissances historiales qui ont institué l'Homme comme sujet absolu, ont chacune à sa manière anéanti cette coopération ou ce partage, l'agriculture en s'industrialisant parachève ce divorce. Le mythe de l'Eden illustre la rupture qui s'installe entre l'homme et la nature. La science a transformé le monde en objet, miroir du seul sujet, et elle adresse désormais ses questions à la seule autorité qu'elle reconnaît, à savoir les structures transcendantales de la raison " pure ".
Bien sûr, cette solitude est intenable, elle dispose toute la charge de l'angoisse ontologique sur les fragiles épaules d'un être qui n'a jusqu'à présent prouvé sa supériorité que dans son pouvoir de destruction et de mutilation. Et cette constatation suffit à elle seule à expliquer les absurdités des affairements humains. Albert Camus a profondément tort, ce n'est pas le monde ni la vie qui sont absurdes parce qu'ils sont condamnés à la disparition, l'absurdité est exactement ce qu'inventent les humains à chaque minute pour échapper à la question de leur être et de l'être en général. Mais pourquoi donc ? Mon propos ici n'est pas de répondre à cette question. Il est vraisemblable que la question du sens de l'être n'est pas en elle-même porteuse d'angoisse, mais qu'au contraire cette angoisse naît très exactement de son refoulement. Le plus grave dans tout cela est que c'est sans doute la civilisation elle-même qui a opéré ce refoulement dans une stratégie volontairement orientée vers l'angoisse, mère de tous les crimes et de toutes les résignations. Cette stratégie porte précisément le nom d'Histoire. Disneyland du divertissement pascalien.
C'est donc un complet retournement de point de vue qu'il s'agit d'opérer. La consignation de l'être porte en elle le risque d'avoir été une véritable consignation dans son sens le plus péjoratif, dans son sens de la privation de liberté tel qu'on l'utilise encore dans les armées. Il faut essayer de comprendre comment l'Histoire a pris son essor à partir de la mise sous tutelle de l'être, une tutelle caractérisé par Heidegger comme l'emprise du concept. La différence ontico - ontologique, c'est à dire cette sorte de divorce entre l'étant et l'être, est le résultat de cette mise sous tutelle de l'être comme concept. Mais ne nous y trompons pas, cette tutelle est un mirage, l'homme n'a, en tant que ce qu'il s'imagine être lui-même, rien gagné d'autre à cette opération que de pouvoir s'exhiber comme sujet face à un monde - objet. D'où la nécessité de l'Histoire comme eschatologie de cette différence, comme besoin quasi militaire corrélatif à ce défi qu'il nous est impossible de qualifier. Les Cultures des différentes civilisations, à l'exception remarquable des peuples nomades, ont accumulé les réponses à la question du pourquoi. La plus banale et la plus répétitive reste la tragique, celle d'une chute fantasmatique de l'être humain hors de la symbiose divine, hors de son appartenance essentielle à l'être.(1)
Tout cela ne tient évidemment pas debout. Il faudra tout reprendre à zéro, tenter de remonter à l'aurore de cette différence qui semble avoir engagé l'espèce humaine dans la folle aventure de sa propre destruction. Bergers de l'être nous le sommes encore dans quelques poèmes, d'où le retrait hautain de Martin Heidegger vers le seul commentaire de ces œuvres qui restent pour la plupart soustraits à l'horizon des multitudes. Dans ces textes parle encore une invisible coappartenance des choses et des hommes dont le secret se trouve dans l'évidence obscurcie de l'être universel.
Spinoza a été le grand illustrateur de cette coappartenance, plus puissante et qui transcende de son absolu toute notion de mouvement du temps, d'évolution et d'histoire, que ce soit celle de la pensée ou celle des actions humaines. Ne dit-il pas presque cyniquement au début du Livre 3 de son Ethique : - " …et je considérerai les actions et les appétits humains de même que s'il était question de lignes, de plans ou de corps " (2). Autrement dit, les hommes auront bien pu, à l'intérieur de leur destin, œuvrer à leur propre malheur et à leur propre déclin - mais ici on se méfie de suivre aveuglément le sentiment collectif d'une crise dont on connaît le caractère structurel de notre civilisation aussi loin que remonte notre mémoire ; Heidegger lui-même a souvent hésité entre une condamnation sans appel de la place qu'ont pris les hommes par rapport à l'étant, et le doute qui toujours lui parlait de la proximité d'un autre résultat qu'une pure et simple apocalypse technique.
Notes.
1 - Le Bouddhisme aura été la seule culture à comprendre en profondeur la portée de l'événement de la différence, sans s'aveugler dans un feuilleton patriarcal où l'être substantivé devient en réalité un autre homme fantasmatique caché dans l'au-delà. La forme de son eschatologie, cependant, rejoint toutes les autres formes de salut sous la forme du forfait. Le désir d'interrompre le cycle des réincarnations constitue en réalité le refus de soutenir l'épreuve de la différence et de s'évader d'un destin dont nous ne sommes pas les seuls maîtres.
2 - Spinoza : L'Ethique Collection Idée NRF 1970 page 146
Mardi 13 janvier 2004
L'horreur étatique.
L'aveuglement historique en est arrivé à un point critique. Aveuglement signifie ici éloignement de la ou des finalités fondamentales de l'existence de l'être humain. L'Oubli de l'Être, la formule de Heidegger, se traduit par une perversion totale du rôle des institutions sociales et en résumé celui de l'Etat. Cette perversion se présente comme un véritable renversement des finalités de ses fonctions, mais aussi comme une stérilisation absolue. L'Etat ne produit plus rien. Car il est censé produire, et non pas simplement gérer, gestion qui représente cette finalité perverse produit de l'inversion de ces finalités. Nous avons en fait réalisé l'Etat hégélien, c'est à dire l'instrument abstrait de la souveraineté, en réalité l'être lui-même descendu sur terre sous la forme de l'Histoire et dont la finalité réside dans le seul fait d'être. Assis sur la rationalité théologique, c'est à dire sur un fondement divin indiscutable, cet Etat règne sous n'importe quelle forme, c'est à dire dans n'importe quelle utopie qu'elle a fini par éterniser sous la forme particulière de l'économie libérale bourgeoise. L'idéal du libéralisme économique actuel n'est que la forme de cette impasse des relations humaines dans la forme de l'échange marchand, véritable abstraction vide de la relation d'altérité.
Alors en quel sens l'Etat est-il censé produire quelque chose ? On ne peut répondre à cette question que si on précise que cet Etat est ou doit être un Etat démocratique, ce qui n'est pas aujourd'hui contesté puisque la grande majorité des Etats mondiaux se sont définitivement, semble-t-il, placés sous cette forme politique. Comprenons-nous bien : aujourd'hui la notion d'Etat est étroitement liée à celle de Démocratie, et les états qui rejettent encore la forme démocratique se retrouvent pratiquement dans une situation d'exclusion, de bannissement et sous la menace d'intervention comme celle qui vient de frapper l'Irak. Or toute la problématique de la productivité ou de la créativité d'un Etat réside précisément dans sa forme démocratique, c'est à dire dans ce qui doit se concevoir comme une mécanique productive d'utopies en série. Nous l'avons déjà longuement expliqué ici, notamment dans notre commentaire sur Œdipe et dans ceux qui concernaient la démocratie athénienne, mais il faut y revenir sous une forme peut-être plus simple.
La Démocratie peut se concevoir comme un concours permanent entre des utopies qui se succèdent et dont le peuple juge la production par ses suffrages qui confirment ou rejettent le travail accompli. Comme l'Etat moderne a fini par s'identifier avec l'Etat divin, sous la forme de la prédominance absolue de la gestion économique, la seule utopie qui subsiste comme critère de la productivité de l'Etat s'appelle la croissance économique. C'est à peu près comme si on se contentait de juger le destin d'un individu sur sa capacité à grandir en laissant de côté tous les autres aspects de la vie. La croissance est devenu l'essence abstraite du progrès de l'humanité, alors que l'on ne connaît cette croissance que sous la forme de chiffres abstraits dont on ne mesure même pas le sens par rapport aux relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Par exemple si la croissance d'un pays est accentuée par la production massive d'armements qui ne font que servir à détruire une autre partie de la planète, on ne la distingue jamais d'une croissance qui repose sur la production de biens de consommation ou de biens culturels. Les chiffres exercent une dictature parfaitement aveugle.
Ce n'est pas un hasard, mais quand-même il est étrange que je m'attelle à une telle analyse au moment et au jour même où d'une part la Recherche Scientifique lance un ultime appel à l'Etat parce qu'elle est dans une situation dramatique, et que de l'autre les responsables de l'Education et de la Culture protestent de plus en plus violemment contre le sort que l'Etat chiraquien réserve à cette éducation et à cette culture. Nous avons pu constater en 2003 que le gouvernement de droite a excellemment résisté à tous les dangers qu'ont suscité des réformes économiques dures qui remettent en question bon nombre d'acquis sociaux comme la retraite ou les 35 heures. Comme si ces questions n'intéressaient pas réellement les citoyens. En revanche, le gouvernement n'a pas fini d'entendre parler du statut des intermittents du spectacle et des coupes claires dans les budgets de la culture ou de la recherche. Comme en Mai 68, l'entrée en fission du corps social prévisible n'aura pas pour cause déterminante la situation économique du pays, alors extrêmement prospère, mais bel et bien l'oubli terrifiant dans lequel se complaisent les décideurs actuels des soucis fondamentaux des citoyens.
Et pour cause. Alors que cette fission sociale devient de plus en plus prévisible, les commentaires vont bon train sur la ou les formes qu'elle va prendre, et on entend même le mot révolution, d'autant qu'on enregistre au plan politique une montée régulière des extrémismes dont la révolution était jadis le mot d'ordre. Parmi les commentaires que j'ai pu surprendre la semaine dernière, j'ai entendu rappeler le fameux éditorial de Pierre Viansson-Ponté dans Le Monde, quelques semaines avant Mai 68 et qui portait ce titre désormais historique : " La France s'ennuie ". Hé bien, la France semble être le pays européen où l'ennui métaphysique surgit le plus souvent et le plus régulièrement depuis toujours. Je dis métaphysique car il est impossible de qualifier autrement l'ennui dont parlait le journaliste du Monde. Parler de mélancolie ou de nostalgie ne changerait rien à l'affaire, car il faudrait encore qualifier chacune de ces pathologie psychosociologiques et on parviendrait au même résultat.
Nous parlerons donc d'ennui métaphysique. Il y a quelques pays dans notre occident qui ont participé au travail ou à la création métaphysique, c'est à dire qui ont mis au centre de leur intérêt la réflexion sur le sens de la vie. En fait toutes les sociétés humaines sont nées pour ainsi dire en vertu de cette réflexion, mais quelques-uns seulement comme la Grèce, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou encore la Hollande, ont poussé les feux de ce travail avec suffisamment de régularité et de force, il faudrait dire de la rigueur, pour atteindre enfin certaines limites de cette métaphysique. Ce qui est remarquable dans cette longue histoire, c'est la place et le rôle déterminant de la démocratie par rapport à ce résultat. Dans la Grèce antique, la qualité de cette démocratie fut à ce point parfaite que l'on atteignit presque d'emblée ce résultat, mais de même que la démocratie européenne fut longtemps menacée par toutes sortes de totalitarismes, de même les Grecs étaient-ils seuls au milieu d'un monde hostile à leur conception de la vie et à leur pratique politique. Au total, il se produisit donc un recul, voire une véritable occultation de ce résultat. On entra pour deux mille ans dans la religion de l'existence, c'est à dire dans une vie sociale dans laquelle ne comptait que le fait de rester ensemble, de souder les communautés par des croyances où l'imagination et les passions avaient plus de place que la raison. Lentement cependant, le principe démocratique ressurgit au cœur même des monarchies dont certaines sont encore vivante.
C'est dans une Grande Bretagne monarchique que renaquit par hasard le souci de la démocratie, hasard qui n'était rien d'autre que la volonté de faire vivre côte à côte plusieurs croyances religieuses qui s'étaient au cours du temps, détachées du tronc commun du Christianisme romain. Mais c'est en France, comme le dit si bien Marx, que le coq Gaulois entonna le véritable chant de la révolution démocratique pour tous les peuples. Ce chant séduisit d'un seul coup toute une nichée de penseurs allemands dont le travail fit avancer de pas de géants la réflexion métaphysique. De cette révolution française avait surgi une notion que ces penseurs d'une Germanie encore féodale mirent définitivement au centre de leur souci, la notion de liberté. Les Grecs ne s'étaient pas attardés sur cette notion pour une raison simple, c'est qu'ils étaient des hommes libres et ne pouvaient donc pas concevoir qu'il y eût sujet à discussion autour de cette idée, encore que les initiateurs de la démocratie, les Démocrites et les Epicures, avaient pris bien soin de placer cette liberté au fondement de leurs systèmes de pensée. Mais hélas, l'Allemagne n'en voulût point, de la liberté, et les idéalistes comme Kant, Hegel, Fichte ou Schelling qui s'étaient rués sur cette notion pour construire une véritable philosophie de l'existence, échouèrent tout près du but. De plus, l'absence de démocratie était si vive Outre-Rhin que cet échec se transforma en une véritable débâcle de la liberté qui dût à nouveau franchir le Rhin en sens inverse.
Là, dans une France en proie au bouillonnement politique mais où Napoléon avait codifié avec une habileté diabolique les pratiques sociales, inoculant en douceur le virus de la liberté sous les dehors de l'absolutisme le plus dur, la démocratie repris le dessus et avec elle le souci métaphysique. Ce siècle, à la fois éclairé et obscurci par le romantisme, vit naître le rationalisme et le personnalisme, deux philosophies qui se complétaient et donnait enfin à la liberté son vrai terrain, l'individu. Il fallût trois Républiques pour asseoir les institutions et consolider les fondations constitutionnelles de la démocratie, et à chaque suffrage une nouvelle utopie venait ajouter des idées destinées à apaiser définitivement la société française et à la sortir du cheminement aléatoire et biscornue qu'elle avait entrepris à partir de 1815. Je passe les ultimes et sanglants remous qui secouèrent cruellement l'Europe entre 1914 et 1945, mettant en danger de mort tout le travail accompli pendant ce siècle si fertile en rebondissement. Je les passe, sans oublier de noter que tout ce sang et toute cette violence produisirent un effet catastrophique pire que la disparition de la démocratie, ils faillirent mettre un terme à cette pensée si intimement liée à la démocratie. Il ne restait qu'un mince fil d'Ariane pour sauver l'objet de la démocratie, et ce faisant, la démocratie elle-même.
Martin Heidegger fut l'homme qui distingua ce fil au cœur même du pays où s'effondraient toutes les valeurs durement acquises. Il nous montra un chemin, qui, disait-il, ne menait nulle part sinon à l'origine, et la France se trouva être tout naturellement le terrain où l'écoute de son message trouva le plus d'écho. Moment dramatique où se rencontrèrent les plus éminents représentants du rationalisme français imbus d'idéalisme et de liberté pour fertiliser une démocratie renaissante qui avait perdu de vue son objet, la métaphysique. Jean-Paul Sartre éclaira pendant plusieurs décades un pays dominé par les soucis économiques et son passé d'empire, entraînant dans son utopie un grand homme comme le général De Gaulle, seulement beau-frère, dirais-je, de la décolonisation. Mais il ne survécu pas longtemps à cet échec apparent de la liberté en acte que représenta en 1968 la révolte des étudiants. Apparent, car la démocratie qui survécu à cette révolte dû tenir compte de ce que ce geste politique d'apparence antidémocratique pouvait vouloir signifier. L'Etat avait, à cette époque, déjà perdu la puissance de l'utopie, mais avait su écouter en tant que démocratie républicaine, la revendication de liberté qui se profilait dans les fumées de gaz lacrymogène. La France continua son chemin dans une nouvelle dimension morale d'où avait disparu des contraintes superflues et surtout un style d'existence qui avait fait son temps au-delà de ses propres limites.
Entre-temps la démocratie devient le jouet d'un phénomène ambivalent et dont la nouveauté est sujet de doute et de discussion sans fin, la mondialisation. Pour faire court, il suffit de dire que la mondialisation est un mot - masque. Ce mot recouvre une réalité terrifiante dans sa simplicité : l'utopie démocratique étouffée par le marché, ou bien le marché devenu l'utopie unique de la planète ! Vu ainsi, cela ne paraît pas d'une nouveauté extraordinaire, rien de scandaleux dans cette victoire finale du capitalisme que personne, même pas Attac, ne remet en cause. Mais vu de l'angle de la liberté des utopies dans la démocratie, on reste atterré face à ce Monopoly infernal. Les Grecs pensaient la démocratie comme le moyen de donner à chacun sa chance de répondre à la question de l'Être, d'apporter sa vision de l'être-là humain, quitte à se tromper, quitte à se ridiculiser, quitte même à faire des dégâts. La liberté de penser, de représenter et d'exprimer est l'âme de la démocratie. Cette dernière n'est pas la liberté de réglementer le marché pour ou contre la pauvreté, la pauvreté ne gisant pas là où on la trouve aujourd'hui. Oui, c'est une étrange coïncidence que d'avoir passé la matinée à entendre parler de la crise de la Recherche et de la Culture, crise dont l'opinion se fout apparemment totalement, mais je dis bien apparemment, car les mois qui viennent vont nous réserver bien des surprises. L'intermittence du spectacle risque bien de se muer en intermittence du pouvoir politique. Il serait temps.
|

|
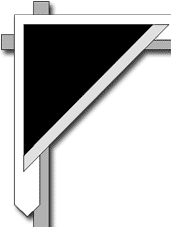


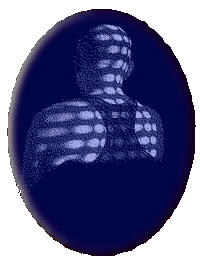

![]()