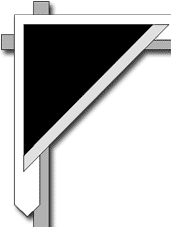
|

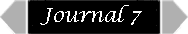
Mardi, le 15 avril 2003
Je voulais parler ingérence et je ne trouvais pas d'entame. Merci donc à France-Culture et à Miguel Bennassayag qui vient de nous appeler de Buenos Ayres et qui, au fond, fait le travail. Je pourrais donc me contenter de vous renvoyer à son reportage, qui montre bien que l'enjeu de l'ingérence américaine en Irak tourne autour de la construction de l'Empire du Fond Monétaire International. Les Argentins se désintéressent totalement, semble-t-il, de leurs prochaines élections, sachant pertinemment que quelque soit le gouvernement élu dans deux semaines, le véritable décideur restera le FMI. L'envoyé de FC n'avait pas le temps, évidemment de nous dire ce que cela voulait dire, ce que signifiait dans l'histoire présente, l'émergence de la toute-puissance de cette Institution Internationale dont les Etats-Unis, là comme ailleurs, possède la part du lion (47 % sauf erreur).
Ce n'est pas un hasard, mais la coïncidence est remarquable, il y a deux jours j'ai revécu par télévision interposée, le fameux virage à 180 ° de la politique économique de Mitterrand en 1982. Parmi les nombreuses interviews qui rapportent pratiquement heure par heure cet épisode dit " historique ", j'ai relevé au passage une citation cruciale attribuée à Delors, disant, nous étions en 1982, que, je cite, "faute de prendre la bonne décision nous aurions le FMI sur le dos ". C'est dire que la France est depuis longtemps une sorte d'Irak qui aurait survécu économiquement en se pliant aux prescriptions du FMI, prescriptions qui portent le nom bien connue de " politique de rigueur ". Le lendemain de cet avertissement de l'alors Ministre des Finances, le Président de la République décidait de bloquer les salaires et les prix pour quatre mois, puis plus tard de réaliser ce qu'aucune droite n'avait osé faire depuis la guerre, savoir désindexer le smig de l'inflation. C'était en résumé, le Trafalgar qui conservait à la France sa place dans le Serpent Monétaire Européen tout en soufflant d'un coup, comme une bombe à neutron, tout espoir de voir naître une autre politique en Europe que celle décidée par les Américains.
Mitterrand avait bel et bien baissé le pantalon, mais gardait un chien de sa chienne, une volonté de hisser au plan européen l'essence des 110 propositions, un labeur dont les historiens ne sauront mesurer la valeur et l'efficacité que dans quelques décennies. Je me souviens qu'à titre personnel je m'accrochais alors à la défense du Président sur ce seul plan de la construction européenne qui me paraissait la seule solution pour finir un jour par être en mesure de faire front à l'impudence américaine. Impudence, car le FMI n'a pas bougé un cheveu lorsque Nixon a déchiré d'un geste arrogant le Traité de Bretton Woods, démolissant d'un coup toute la logique d'une gestion internationale équitable possible des monnaies du monde. A partir de 1971, le dollar régnera sans partage et sans que l'institution " démocratique " du FMI ne lève le petit doigt
L'affaire du Watergate aura été une véritable catastrophe pour les libéraux qui piaffaient derrière Nixon et entraînera un retard de plus de dix ans dans les plans des Républicains. Carter tentera de redresser la politique de la Banque Fédérale en faveur des ménages et laissera placidement monter l'inflation à des sommets rarement connus et qui firent la prospérité du populo pendant quelques années. Puis vinrent deux hommes qui firent le ménage brutalement : Reagan et Paul Volcker. La moitié des membres de la nouvelle classe moyenne américaine se retrouvait sur le carreau, endetté jusqu'au cou et condamné au chômage par une diète monétaire qui fit passer les taux d'intérêt de 12 à 3 % en quelques jours. C'était le début de ce qui deviendra en Europe la discipline monétaire et aboutira au Traité de Maastricht. L'Europe se pliait aux injonctions du FMI en bloc et décidait de serrer la ceinture quelles qu'en soient les conséquences.
Mais la taupe Mitterrand avait bien travaillé, car la naissance de l'Euro, à laquelle ont assisté catastrophés mais impuissants toutes les puissances financières alignées derrière le dollar, a remis toute cette belle construction en question. Pendant deux ans les anglo-américains se sont acharnés à détruire l'Euro sans y parvenir, c'était la fin de la suprématie politique du dollar, mais aussi la constitution d'un ensemble de pays, tous membres du FMI, et qui désormais ont les moyens de contrebalancer le pouvoir de Washington autour de la table du conseil d'administration. Je n'ai pas les chiffres, mais il suffit d'additionner les parts des Quinze, et bientôt des Vingt, pour pouvoir célébrer d'ores et déjà la fin de l'hégémonie américaine au FMI et à la Banque Centrale.
Miguel Bennassayag se trompe donc légèrement dans son raisonnement. S'il est vrai que Washington est bien décidé à universaliser sa politique économique ultra-libérale, il n'est plus aussi vrai qu'hier, que ce sera le FMI qui pilotera cette politique. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que c'est précisément l'échec monumental que représente pour l'Amérique la naissance et la puissance actuelle de l'Euro qui a lancé les Républicains dans cette politique de gribouille qui veut signifier seulement ceci, et c'est assez terrible : nous avons perdu la bataille monétaire mais nous restons militairement la nation la plus puissante. Et nous allons vous le montrer. Hé bien qu'ils le fassent. Il le feront à leurs dépens. J'ajoute à l'intention des Argentins qu'il ne faut pas qu'ils désespèrent, car il n'est pas interdit de penser que la politique du FMI pourra, elle aussi, changer, guerre ou pas guerre.
Mercredi 16 avril 2003
Suzanne Sontag, merci pour la brillante analyse que vous nous avez livrée ce matin sur France-Culture. Sur le fond, je n'ai rien à ajouter à votre diagnostic sur la crétinisation hégémoniaque du clan Bush et d'une grande partie, hélas, du peuple américain que j'ai eu l'occasion d'approcher dans ses meilleures années et au meilleur endroit, le San Francisco de 1975. Le " hire and fire " était déjà le thème familier des cafés du commerce de Market Street et les intellectuels avaient déjà commencé à se contenter de vivoter, plus haut dans la baie, dans un Berkley devenu mélancolique.
Mais il y a dans votre esprit dédiée à la terre, ce qui en soi est ce qu'il y a de plus beau, une petite lacune, sans doute due à votre allergie ontologique pour la civilisation industrielle, allergie que je partage pleinement avec vous. J'ai parlé de ce détail hier, dans ma chronique, un détail qui dénationalise un peu votre discours et celui de tous ceux que l'Amérique effraie aujourd'hui. Il s'agit du FMI et d'une politique américaine qui a, comme on dit vulgairement chez nous, le cul entre deux chaises. D'une part Washington détient encore le pouvoir dans la direction générale de la politique financière, bancaire et monétaire internationale, grâce à sa majorité de fait dans le conseil d'administration du Fonds. Or avec l'Europe cette situation va changer, et il s'agit là de la principale menace qui plane sur la puissance américaine qui décide depuis Paul Volcker de l'éthique budgétaire de la plus grande partie de la planète.
La radicalisation de la politique étrangère du Pentagone a donc une origine encore plus inquiétante que celle que vous évoquez au plan culturel : derrière la situation économique actuelle de l'Amérique se dissimule une sorte de Weimar, où la dette intérieure et extérieure est en train d'asphyxier le pays, alors que l'Euro, la monnaie ennemie, a d'ores et déjà gagné la bataille du marché mondial. La guerre a toujours été, vous le savez mieux que moi sans doute, l'ultime réponse aux impasses intérieures des pays. Déjà au temps de la guerre du Péloponnèse la démocratie athénienne s'est vue contrainte d'augmenter son agressivité au fur et à mesure que les républiques alliées, certains historiens préfèrent dire vassales, cessaient de verser leurs " cotisations " à la Cité par ailleurs menacée par les " terroristes " de Sparte alliés aux ennemis ancestraux mésopotamiens. Ainsi, la montée de cette agressivité effectivement encouragée, comme ce fut le cas d'Athènes, par une réelle suprématie militaire, est en réalité une course contre la montre. Les éditorialistes ne soulignent pas assez souvent l'importance du facteur temps dans le processus du capitalisme. Dans le capitalisme ultra-libéral des Républicains (qui ne sont plus que le Parti Unique de l'Amérique comme vous le dites si bien), ce facteur temps est démultiplié par les urgences que créé la naissance du marché mondial. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la vraie révolution du vingtième siècle est la renaissance d'un vrai marché mondial, grâce à la naissance d'une monnaie qui fait concurrence au dollar. La monnaie a toujours été la figure du pouvoir politique et pas seulement un marchandise comme le pensait Marx. La première grande bataille menée par Wall-Street a été perdue contre l'Euro : il ne reste plus qu'à faire parler la poudre. Merci encore pour votre message dont le seul accent nous met bien du baume au cœur.
Vendredi 18 avril 2003
Ce matin la guerre était au menu de l'émission philosophique hebdomadaire de France-Culture. Constatant sur le champ que Madame Blandine lançait la discussion sur les plaines académiques de la spéculation labellisée Locke, Rousseau, Kant etc…j'ai tout de suite coupé la communication. Dans mon esprit s'était condensée d'un coup une série d'anciennes impressions qui revenaient par ci - par là dans mes méditations de ce qui se passaient là-bas dans les sables de la Mésopotamie.
En réalité, j'ai sagement attendu depuis le premier jour du conflit le moment où le général qui commande cette agression, le dénommé Tommy Franks, se rende sur le terrain où il envoie depuis son palace du Qatar, bombes, missiles et bidasses anéantir, tuer et mutiler les Irakiens et leurs biens. Si vous avez eu la même curiosité que moi, vous avez dû vous rendre soudainement compte que ce vieux briscard du Vietnam et de toutes les autres aventures guerrières des States, s'est rendu à Bagdad pour la première fois hier, 17 avril, alors que l'armada américaine avait déjà commencé son repli vers la Méditerranée et que les boys qui restaient encore sur le terrain avaient déjà entamé leur mue en nounou humanitaires. Bravo mon Général ! Il ne fait aucun doute que le dénommé Bush Georges W. vous attend déjà avec une jolie panoplie de décorations qui vont venir s'ajouter à la plaquette multicolore qui orne votre poitrail de héros.
Minable accusation. Attaque sous la ceinture. Pauvre argument d'intello frustré par l'apparent changement de sens du vent éditorial qui s'efforce de cultiver le sentiment de la justesse de la décision américaine de tout casser pour " reconstruire ". Et pour faire exhaustif, vilaine habitude des intellectuels français de rappeler à tout bout de champ qu'il n'y a que les généraux pour mourir dans leur lit entre quatre-vingt dix et cent ans. Ce qui est statistiquement vrai, mais allons, on ne dit pas des choses pareilles en ces temps de tragédies autrement plus sérieuses. Certainement. Vous avez raison. D'ailleurs la philosophie qui affirme que la guerre n'est une guerre que lorsqu'elle oppose des états, confirme la futilité de ma remarque. A l'avenir, lointain, on parlera de l'héroïsme du Peuple Américain et les vrais acteurs n'intéresseront que quelques vieux barbeaux de l'historiographie. Quant aux dirigeants de ces boucheries cataloguées sauvetages de l'humanité, ils donneront du travail aux sculpteurs et aux fondeurs. Le buste de Monsieur Franks prendra place dans une rangée de bustes d'autres culottes de peau dont tout le monde se fout et tout sera dit.
Oui, oui. N'empêche. La guerre c'est un truc que chaque homme considère d'abord du point de vue le plus pragmatique qui soit, c'est à dire en se demandant QUI la fait réellement. Car il s'y voit forcément, engagé ou pas, mobilisé ou pas, il sait que dans une guerre il y en a qui montent à l'assaut en première ligne, et il y en a qui arrivent quand le travail est fait. Quelques rares historiens iconoclastes se sont penchés sur ce problème, notamment pour la Grande Guerre (celle que je préfère…) pour constater invariablement que les hommes envoyés en première ligne n'étaient en général que des demi-hommes, des noirs, des jaunes, bref, des dont la mort ne comptera que lorsque, cent ans plus tard, il se trouvera quelques fous pour élever des monuments aux morts dans quelques petits patelins du Sénégal ou du Vietnam. Et encore, qui va faire le boulot de rechercher les noms de ces morts inconnus dont les familles attendent encore aujourd'hui un signe de reconnaissance de la métropole qu'on est allé défendre sans savoir pourquoi. Voyez en particulier les livres les plus récents sur cette question. Tout de suite derrière, en deuxième et troisième vagues, de retrouveront les jeunes paysans bretons ou corréziens, la vraie chair à canon, celle qu'on fusille pour faire des exemples quand le truc ne marche plus comme il faut et que les officiers chargés de pousser les vagues pistolet au poing font eux-mêmes grève. Mais ceux-là auront leur nom gravé pour l'éternité sur l'horrible pyramide grise de la place de la Mairie et leur famille peut-être une pension. Napoléon verse aujourd'hui encore 5 Francs par an aux descendants des soldats tombés à Austerlitz, ce qui coûte fort cher au Ministère des Anciens Combattants en paperasserie sinon en argent réel.
Ta ta ta. On n'y est pas encore avec toutes ces digressions. Mon angle c'est tout autre chose : combien de Grands Hommes, depuis la nuit des temps, se sont vraiment comportés en héros ? Combien d'entre eux sont montés en première ligne avant de mourir ou avant de prendre place dans les trônes et les palais présidentiels ? L'Antiquité nous en donne pas mal d'exemples, encore qu'il ne faille pas exagérer. Les choses fonctionnaient encore autrement, car on devenait général sur le champ de bataille en faisant la démonstration de son courage et de son intelligence. Il s'est trouvé quelques officiers français nommé aux hauts grades pour faits de bravoure, mais quelle galère ensuite pour les replacer dans la hiérarchie. Pareil en Amérique où les gradés par héroïsme devenaient forcément des emmerdeurs dans les états-major composés de planqués. Mais la question qui m'intéresse le plus se situe dans l'histoire récente : de tous les grands acteurs de la Deuxième Guerre mondiale, combien ont senti l'odeur de la poudre, combien ont contracté pour la vie ces syndromes définitifs de l'ouïe cent fois agressée par les millions de décibels d'un tir d'artillerie ?
Je n'en sais pas assez long pour être affirmatif. Néanmoins il y a des choses qui se savent et que les historiens mettent d'ailleurs rarement en avant tant la question est délicate. On sait par exemple que le Général De Gaulle est, comme le fut Bonaparte, un héros dans le plus pur sens du terme. Dans la Première comme dans la Deuxième Guerre Mondiale, De Gaulle a payé de sa personne jusqu'au bout, debout dans les blindés face aux Panzers allemands, repoussant les assauts qui sur le reste du front passaient pour des promenades de santé. Vicieux comme je suis, je regarde des images du passé, des photographies prises à Casablanca, Yalta et surtout Potsdam où l'on voit la grande stature de notre Général dépasser de trois têtes des hommes vêtus de bric et de broc. Et je fais le tri entre ceux qui ont mis leur propre existence sur la balance du destin, et les autres. La grandeur de De Gaulle n'est hélas pour les autres personnages présents pas que physique, sur ces images qui représentent les Roosevelt, Churchill, Eisenhower et autre Marshall, il est bien seul. Le destin ultérieur de notre pays doit certainement énormément à la position humainement dominante de cet homme politiquement solitaire et qui ne représentait quasiment rien. Il pouvait regarder dans les yeux ses Alliés arrogants et légitimer sa place à chaque endroit où il les rencontrait. Oui, je sais que ce que je vais dire n'a guère de pertinence historique, mais j'affirme que la personnalité de De Gaulle a plus fait pour la résurrection de notre pays que tout le reste. Question : de quoi avait l'air Giraud, ce général d'opérette que les Américains avaient choisi pour représenter la France ? Et puis il n'y avait pas que De Gaulle, il y avait à ses côtés des hommes comme lui, des vrais baroudeurs de l'honneur, des Leclerc et des Salan, des officiers supérieurs qui avaient conquis leurs grades dans les déserts de Libye et du Tchad, sous le feu. Pour faire bonne mesure, rappelons encore que le Général a affronté l'OAS avec le même courage physique que celui qu'il manifestait sur les champs de bataille.
Voilà la guerre, la vraie. Marathon, Salamine, Syracuse, Stalingrad et Guam, et pourquoi pas la Normandie. Mais combien de généraux sur les plages d'Omaha ? Combien de généraux sur le pont de Remagen ? Alors assez de bavardages sur la nature de la guerre. Je n'ai jamais été aussi gaulliste qu'aujourd'hui, mais cet individu justement illustre démontre au moins une chose, c'est que le discours philosophique ne peut rien dire sur la nature de la guerre. De Gaulle prenait un soin extrême à passer pour le représentant d'un état, certes, mais que serait-il advenu de cet état si l'homme en question n'avait pas été le soldat qu'il fut ? C'est son courage personnel qui a donné force de vérité, qui a donné réalité à l'état français, et non pas le principe de la guerre tel qu'énoncé dans les divers Traités sur l'Entendement et autres Critiques.
Malaise. Qu'ai-je dit sur la guerre ? Rien ? Rien de philosophique, ça c'est sûr. Je n'ai pas voulu, très expressément dire que la guerre était tantôt ceci, tantôt cela, qu'elle pouvait être juste ou pas, qu'elle opposait des hommes ou des états (qu'est ce que c'est qu'un état, sinon une assemblée de brigands qui se donnent des airs aux dimensions ontologiques, ce qu'ont hurlé pas mal de gens sans être entendus), qu'elle appartenait ou non aux comportement naturel de l'être humain, bref je n'ai pas perdu mon temps. Mais sachez que je pense néanmoins quelque chose de philosophique à propos de cette saloperie : la guerre ne surgit qu'à partir de la contrainte faite à l'homme de vivre ensemble, car le temps où cette contrainte a été un choix démocratique est bien loin, sous les ruines du Musée de Bagdad dont on n'a pas fini de parler précisément parce qu'il contient le moment du choix et qu'il ne raconte pas d'histoires d'états ou de sociétés. Le vivre-ensemble dont quelques Grecs ont découvert la recette qui s'appelle démocratie (mais attention pas n'importe quelle structure étatique qui s'empare de l'étiquette démocratique, comme l'Amérique par exemple). Les guerres ne sont que la démonstration qu'on ne peut pas vivre ensemble par la grâce de Dieu et du Président, mais aussi, et là nous y voici pour ce qui nous concerne : la volonté tenace d'anéantir la Démocratie par tous les moyens, y compris le méta-langage pseudo démocratique mis au service des hommes les plus paresseux du monde, ceux qui tirent un avantage personnel de la difficulté de gérer la démocratie, les militaires. Mais attendez, l'Histoire ne se laisse pas berner par quelques godelureaux fils à papa. Le nomadisme essentiel de l'Être est en voie de reprendre ses droits sur l'Homme. La guerre qui s'achève là-bas près de Babylone est hautement symbolique, elle a opposé les derniers tenants acharnés d'un sédentarisme de nantis aux sédentaires archaïques devenus tyrannies à l'occidentale (le Baas est un parti tout à fait occidental-totalitaire). Qu'ils s'entretuent. Pourvu que l'Europe, les Européens finissent par comprendre qu'ils sont sur la bonne voie en ouvrant leurs frontières, en étendant à l'infini l'espace dans lequel l'homme pourra circuler sans se heurter aux états et donc, aux guerres. L'Europe ne doit pas chercher sa définition territoriale, mais sa définition ontologique, son concept. L'Europe doit devenir une éthique mondiale, celle de l'ouverture et de la liberté.
Samedi 19 avril 2003
Nous y voilà, l'Irak est passé en troisième page. N'intéresse plus personne. Consommé. Il n'y avait pas marqué The End, mais c'est tout comme. The game is over. Les médias en reparleront quand on leur dira de le faire, sauf évidemment de l'autre côté de la Manche et de l'Atlantique où ça fait encore recette. Pour l'instant les producteurs font les comptes et constatent que le trou d'ozone s'est nettement agrandi, alors mollo. Avec toutes ces primes, ces voyages et cette technologie hors de prix, il ne faudrait pas que Bush s'amuse à lancer une nouvelle opération avant l'an prochain, le budget 2003 il est mort. Voilà ce qu'est la réalité de l'information. On peut se faire une image : celle des gens qui regardent un match de tennis. Tête tournée à droite, tête tournée à gauche, etc.. L'information c'est la balle qui va dans le sens voulu par les médias, et les têtes suivent la balle. Attention aux torticolis !
Dimanche 20 et lundi 21 avril 2003
L'Europe n'est pas une entité territoriale mais un concept. En termes réels, cette phrase devrait s'écrire ainsi : l'Europe ne doit pas rester une entité territoriale mais devenir un concept. Mais que veut dire concept ? Lorsque l'Amérique débarque au Vietnam ou en Irak, c'est aussi au nom d'un concept qu'elle le fait, un concept qu'elle se charge en quelque sorte de propager. La différence que je voudrais introduire ici tout de suite entre la manière de voir américaine et celle qui pourrait être celle de l'Europe, c'est que le concept, contrairement à la pratique américaine, ne peut pas être représenté par un état ou une nation, comme on voudra nommer ces agrégats d'êtres humains stockés entre des frontières. La première conséquence est que le concept en question ne pourra jamais être un concept " européen ", comme l'Amérique parle de " sa " Démocratie ou de son concept de liberté. C'est l'Europe elle-même, en chaque citoyen, qui doit devenir le concept, et à ce titre revendiquer d'amblée l'universalité et porter en lui la fiction d'une Europe étendue aux limites de la planète. Il ne peut s'agir ici d'une hégémonie telle que son concept filtre à travers les déclarations de plus en plus cyniques des gouvernants américains.
De terribles difficultés semblent surgir à l'évocation ou à l'examen de la praxis que les états qui aujourd'hui se définissent déjà comme européens, devraient construire afin de parvenir à transformer l'Europe en un concept appelé à conquérir par lui-même et par lui-même seulement l'univers humain. Disons, pour commencer, qu'il y a, pour parler en termes militaires, des lignes d'attaque et des lignes de défense qui empêchent presque définitivement le franchissement ultime, c'est à dire la mutation du territoire en concept. Il est presque inutile de les énumérer tant elles sautent aux yeux. De la frontière matérielle de l'entité territoriale aux lignes de défenses intérieures à chaque nation, on peut décliner toute une liste d'obstacles. En fait, le problème de la mutation du territoire en concept se joue d'abord et déjà en chaque parcelle de l'entité par le fait même que chaque nation se doit, avant tout, de parvenir à se définir comme concept plutôt que comme territoire. Il s'ensuit la nécessité absolue d'une adéquation du concept de chaque nation à l'ensemble, d'une unification du principe de l'abandon de toute référence territoriale. L'une des grandes difficultés de la construction européenne provient depuis toujours des idéologies identitaires, soigneusement entretenues par des forces parfois archaïques, parfois ultra-modernes afin d'empêcher le concept européen de naître d'abord dans chacune des nations qui forment l'Europe.
Les conflits irrédentistes représentent des lignes de défense particulièrement efficaces de l'esprit territorial, même si les partis en présence se réclament tous, à chaque occasion, de différences conceptuelles et non pas d'esprit hégémonique. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce sont les gouvernements les plus conservateurs par rapport à ce que représente la mutation dont nous parlons, qui semblent impuissants à régler ces conflits dont certains, comme ceux de l'Ulster ou du Pays Basque, stagnent depuis des décennies à des niveaux de violence qui ne semblent jamais faiblir. Il faut en conclure, en termes géopolitiques, que les états qui gèrent ces conflits les encouragent par une pente naturelle, celle qui renforce leur propre identité territoriale. La position ambiguë de la Grande Bretagne par rapport à l'Europe est logiquement reliée à son apparente impuissance à régler le sort de l'Irlande, de même qu'il n'est pas le fruit du hasard que l'Espagne, minée par l'irrédentisme basque, mais dont on pourrait dire qu'elle fait tout pour l'entretenir, prenne le parti du groupe d'états qui s'est placé sous la bannière de l'état qui ne cache plus sa volonté hégémonique. On pourrait faire la même constatation pour tous les autres états comme la Hongrie ou la Tchéquie qui ont fait le même choix à l'occasion de l'agression de l'Irak.
Par contraste avec ces conjonctures archaïques, on peut citer un exemple de puissance ultra-moderne de défense des identités territoriales contre un avenir conceptuel qui se trouve dans les partis conservateurs qui, depuis le Traité de Rome, s'attachent à un morcellement territorial encore plus sournois, celui qui se cache derrière le concept de " principe de subsidiarité ", introduit subrepticement dans les textes européens avant même que la plupart des hommes politiques et des observateurs n'en connaissent la définition. Ce principe prône ni plus ni moins qu'un morcellement de la Loi et de son exécution. En fait il représente d'abord une dichotomie juridique entre deux catégories de lois, les unes applicables à l'ensemble du territoire et les autres laissées aux puissances locales, déterminées selon une géographie sociale et économique destinée à faire contrepoids à l'universalisme de la culture qu'exigent les paramètres universaux du marché. On pourra ainsi laisser aux communautés locales le soin de légiférer en des domaines juridiques jugés secondaires comme celles qui ont trait au travail, à la protection sociale ou à la culture. A noter en passant que la nouvelle loi de décentralisation est la première mise en application concrète de ce principe dont on dit qu'il fut inventé et baptisé par Monsieur Valéry Giscard d'Estaing lui-même. Rien d'étonnant donc que ce soit l'un de ses plus fidèles lieutenants qui s'empresse, arrivé au pouvoir, de lancer cette opération qui, pour ne rien arranger, va encore dresser des obstacles supplémentaires à la naissance d'une politique intérieure commune européenne. Pour éclairer encore un peu mieux ce point je vous renvoie au dossier de l'AMI, cet accord mort-né de l'OCDE, dont la vocation était de mettre en application par le haut le principe de subsidiarité, c'est à dire à permettre aux entreprises transnationales de se soustraire aux lois sociales du pays où elles opéreraient. Ce qui a fait capoter ce projet est l'incroyable arrogance de la procédure qui fut utilisée mais surtout ce que j'ai signalé plus haut comme l'universalité de la culture : les membres de l'OCDE qui comptaient bien faire entrer cet accord dans les futures nouvelles " lois internationales " qui règlent le commerce mondial, autrement dit à l'OMC se sont laissés surprendre par la culture politique et économique de tellement de citoyens d'Europe que même les gouvernements qui avaient déjà voté en faveur du projet on dû se retirer du débat. Après tout l'OCDE n'est pas une institution officielle, rien qu'une Chambre de consultation des quelques cinquante plus puissants pays du monde.
Mais revenons au concept, cette idée qui semble s'opposer à la réalité que constituent les territoires. Je dis semble car on ignore encore jusqu'à quel point la géographie détermine elle-même les conditions dans lesquelles naît et meurt le concept. Quoi de plus simple à comprendre que la probabilité qu'une réalité dotée de vastes horizons comme les océans, par exemple, inspire aux hommes un sentiment ou un instinct de liberté bien plus puissant que ne le ferait le fond d'une vallée suisse. On dirait du Rousseau. Ce sentiment, la liberté, doit se trouver à l'état natif chez les hommes dont l'horizon change chaque jour, je veux parler des nomades, alors que la position sédentaire impose forcément des barrières pratiques qui inscrivent en l'homme autant de limites morales. Moral est pris ici en son sens primordial, c'est à dire dans ce qui a rapport aux mœurs, et non pas aux lois. Ce qui signifie que le nomade est forcément plus spontanément libre dans ses mœurs que le sédentaire, puisqu'il peut modifier à sa convenance la forme de son horizon. Cette remarque n'est pas fortuite, car elle indique immédiatement que le concept est lié à la mobilité de l'homme, le concept n'étant finalement rien d'autre qu'une condensation de valeurs pratiques : les choses qui vont par elles-mêmes y vont grâce à l'évidence du concept. Il est maintenant grand temps de faire remarquer que le concept n'est ni un sentiment ni une valeur, il est un équivalent général forgé dans le langage par l'homme, précisément pour compenser l'absence ou la défection de l'état natif du sentiment et de la valeur. Cela dit, le concept n'est pas non plus à confondre avec une idée ou un mot, erreur qui a conduit bien des penseurs dans l'impasse, même ceux qui ont cru défaire tous les systèmes construits sur des concepts idéaux ou nominaux. Une autre erreur a été de confondre le concept avec l'emblème, spécialité chinoise, mais cette erreur n'est rien d'autre qu'une identification du concept et du territoire, ce dernier ne faisant lui-même que représenter le corps du souverain. La réalité du concept, son sens réel, est à chercher du côté de l'action, c'est à dire de la pensée. Pour utiliser une métaphore, disons que le concept n'est ni l'or natif, ni l'or produit grâce à la pierre philosophale, ni la pierre philosophale elle-même, mais uniquement l'action de chercher la pierre philosophale. Cette action est en même temps expérience, expérience de l'ouvert en tant que tel, c'est à dire conscience du rapport avec autre chose que soi, et expérience d'un élargissement de l'ouverture qui nous est donnée spontanément ou immédiatement. Ce qui peut aussi porter le nom de recherche, scientifique ou pas. Toute recherche ouvre, élargit l'horizon dans lequel s'est déroulée l'expérience précédente dont les insuffisances ont indiqué un manque ou une absence.
Le concept, ultérieurement, deviendra seulement l'action d'ouvrir l'horizon, ou de le rouvrir selon qu'il sera devenu évident qu'à un moment donné cet horizon a été mutilé ou obscurci par erreur. Cette action, on l'aura déjà compris, ne doit globalement sa nécessité qu'à une fermeture ou une mutilation de l'horizon, qui, comme nous le soulignons plus haut, demeure ouvert à l'homme essentiellement mobile, nomade. Elle est donc un moyen, une médiation non contingente destinée à permettre à l'homme de survivre dans l'immobilité, envers et contre les obstacles naturels qui dans cette position l'entoure et limite son ouverture. Cette médiation, le concept, a été hautement fructueuse puisqu'elle à permis aux hommes de fonder des entités territoriales et de les gérer selon des formes de souveraineté et des lois qui ont pour fonction de donner suffisamment l'illusion de l'ouverture pour que les membres de ces communautés retrouvent le sentiment natif de la moralité naturelle, de la liberté originelle, de la possibilité de la vie, car aucun homme ne peut penser la vie possible hors de la liberté. Même là où, par l'absence d'harmonie ou par la fausseté des lois, la liberté vient le plus à manquer, l'homme ne peut pas oublier qu'il a cessé de vivre et qu'il ne fait que subsister dans une sorte d'hibernation existentielle sans autre perspective que la résignation ou la rébellion. Au demeurant, une seule forme conceptuelle a pu stabiliser l'espèce humaine à un tel degré qu'on a convenu de donner à cet état de stabilité le nom de civilisation, c'est la démocratie. La démocratie n'est pas, en elle-même, un instrument de recherche ou de conquête de valeurs ou de vérité, elle n'est qu'un jeu mimétique. La démocratie remplace la mobilité du nomadisme, c'est à dire le changement permanent de perspective, par la mobilité des perspectives juridiques de l'existence à l'intérieur d'une aire géographique déterminée. Et donc également la mobilité des personnages qui forment l'horizon décisionnel. L'ouverture naturelle est dessinée, reproduite dans les mots de la loi avec l'avantage décisif par rapport à la monarchie qui peut bien produire des lois analogues par leur efficacité, que cette ouverture est mise à la portée de chaque membre de la communauté selon un rite scellé par une constitution qui est le concept du consensus et le consensus du concept. Autrement dit, la démocratie permet idéalement à chaque individu d'expérimenter l'ouverture native, c'est à dire le retour à la liberté originelle dans l'exercice de la souveraineté. Les tyrannies, oligarchies ou monarchies ont toutes comme dénominateur commun la fixité de la scène primitive, c'est à dire la reproduction dynastique des familles fondatrices. Dans ces formes de souveraineté, aucun sujet ne peut prétendre à vivre ne fut-ce qu'une seule journée, il doit se résigner ou se rebeller. C'est pourquoi le mot civilisation a été attribué abusivement à tout un bloc historique qui ne comporte en réalité que fort peu d'époques véritablement civilisées.
Ce qui nous permet de revenir à l'Europe comme concept. Le territoire qui constitue aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler l'Europe, a plusieurs raisons de réussir à devenir un pur concept en abandonnant toute prétention territoriale. La première est qu'elle est le seul lieu délimité de la planète qui a expérimenté dans ses ultimes conséquences l'échec de la territorialité en tant que telle. Le rôle que s'attribue, par exemple, aujourd'hui l'Allemagne, c'est à dire celui de conduire la lutte pour les Droits de l'Homme, provient directement de la conscience qu'a ce pays d'avoir expérimenté l'absolu contraire jusqu'au néant final. La France, elle, a expérimenté l'échec d'une première tentative de conceptualiser l'appartenance à l'Europe sous Napoléon. Par ailleurs, le travail conceptuel avait déjà produit une Europe inconnue du public mais dont les fruits peuvent aujourd'hui se cueillir en chaque conscience d'Européen. Certains philosophes considèrent aujourd'hui comme une banalité que de dire que la réalité mondiale est devenue hégélienne. Cette affirmation ne veut rien dire d'autre que l'accouchement d'un territoire spirituel, c'est à dire d'un espace de travail ontologique de masse. Ce ne sont pas les bâtiments des institutions des états qui sont hégéliens, mais la conscience fermement ouverte sur la nécessité des valeurs qu'ont incarnées ces institutions. La pseudo destruction des valeurs n'aura été que l'ultime test de la solidité du fondement conceptuel. Ce qui s'est passé à Auschwitz est définitif, mais non pas dans le sens tragique auquel certains condamnent le peuple et la langue de l'Allemagne. Au contraire, Auschwitz aura été la passion de l'Europe, de l'Abendland, le moment de la Pâques des valeurs et donc celui de la possibilité de leur naissance en tant que volonté commune.
En forme de conclusion provisoire, je dirais que l'Europe est le lieu de la transcendance du territoire. Seule une barbarie supérieure à celle d'Auschwitz pourrait remettre en danger cet acquis de l'histoire humaine. L'avenir nomade de l'être humain demande ouverture, et seule l'Europe peut gérer ce retour à l'état natif de la situation ontologique de l'homme, c'est à dire à l'errance de la liberté et à la liberté de l'errance.
Mardi 22 avril 2003
Le chantier ouvert ces deux derniers jours a toutes les caractéristiques de ces utopies vaseuses ou de ces points de vue de grande âme sans contenu concret, en un mot irréaliste. Je n'ai donc pas le choix. Il faut creuser et donner consistance à cette déconcertante définition de l'Europe comme concept. Loin de moi cependant, la prétention de " déposer une invention ", de me poser en démiurge politique qui a reçu la lumière. S'il arrivait un jour que ces textes puissent alimenter les débats qui président aux choix décisifs, ce ne serait que sur la base d'une réalité déjà là ou en puissance et non pas d'une volonté abstraite qui poserait des valeurs pour l'avenir. Il y a une étrange relation entre l'homme et son histoire, une relation où l'homme a rarement l'occasion de jouir des fruits de son action dont s'empare la fameuse Ruse de la Raison pour, le plus souvent, lui servir le contraire de ce qu'il escomptait. Mais l'action politique, ne l'oublions pas, est elle-même une invention historique qui a son propre destin, c'est à dire aussi son propre déclin. C'est donc en fonction de la fatalité de ce déclin qu'il faut envisager, non pas de nouvelles actions préventives ou thérapeutiques, mais une disposition spirituelle capable de recevoir l'événement du déclin de la capacité d'action humaine. A l'époque où le déroulement des faits nous parvient de partout en temps réel, par surgissement de données qualifiées et quantifiées de plus en plus précises, la conscience est déjà née d'une impuissance à guider le destin collectif, seul but de toute action. Les premiers économistes ne s'y sont pas trompés qui ont parlé de la " main invisible " du marché, concept qui, si on le passe aux rayons X, ne révèle pas plus de valeur qu'une quelconque superstition. La contradiction la plus amusante des théories économiques en vogue aujourd'hui est la relation entre cette fatalité invisible et la prétention de plus en plus vaniteuse à sa calculabilité. On appelle cela l'économétrie, qui, comme on le sait, permet d'éviter les krachs et de piloter le marché… En fait, l'invisibilité du fonctionnement du marché ne provient pas du tout d'une impotence humaine à le piloter, mais des conditions politiques dans lesquelles se forme ce marché, c'est à dire, pour rester en contact avec notre problématique, de l'action humaine. Adam Smith avait à la fois raison et à la fois tort. Le marché pourrait, à lui seul, réguler les relations humaines mais à la seule condition que les conditions politiques soient unifiées pour permettre l'existence d'un marché universel, ou bien que ce marché fonctionne sans l'intervention humaine !
La suite demain, mais je me sens pris d'une étrange fatigue après ce climax guerrier.
Vendredi 25 avril 2003
Hard Talk, la World-BBC vous vous souvenez ? David Jessel et Ehud Olmert. Deux Juifs, l'un journaliste, l'autre porte-parole du gouvernement Sharon (et aussi ex-maire de Jérusalem si je ne me trompe pas et même ex-travailliste, à vérifier). Mise en scène : David Jessel, le journaliste (que Ehud appelait sans cesse David avec une sorte de douleur dans la voix faite d'un doux reproche) au bureau, seul. Monsieur Olmert est à Jérusalem en duplex sur grand écran ; debout, rigide, masque ironiquement fermé. Seules ses lèvres remuent. Comme un moulin à prière ou une crécelle, répétant sans se fatiguer les mêmes phrases dont le sens devait contenir une polysémie telle qu'elles s'adaptaient pour ainsi dire seconde par seconde au terrain du questionnement de David. Le journaliste " anglait " ses questions comme il pouvait, les réponses tombaient, invariables, inéluctables, dans une langue de bois absolument propre aux hommes politiques israéliens. Et puis soudain, les deux hommes semblaient s'échauffer et parler l'un sur l'autre, de sorte qu'on ne comprenait plus rien. On n'avait même pas l'impression que dans ces moments-là, quand chacun tentait de parler plus fort que l'autre, leur discours ait changé. Seul le ton montait, comme on dit, mais dans une sorte de rituel médiatique que nous connaissons désormais tous, pour retomber dans la gamme de la Raison Claire mais désespérément répétitive.
Malgré tout, le discours, ou le " dialogue ", avançait. Pour les professionnels des interviews avec des hommes politiques israéliens la dialectique est classique. David connaissait certainement d'avance le déroulement de la conversation dont le sujet principal était l'espoir d'un règlement pacifique eu égard au conflit qui vient de s'achever (pour notre part nous n'en sommes pas convaincus, mais on le dit, alors…) et la pression de Washington sur le gouvernement Sharon pour accélérer ce règlement. Le tout en trois points comme à l'ENA : USA / Terrorisme / Compromis possibles. D'une décennie à l'autre, les réactions israéliennes ne varient pas d'un pouce : USA ? Ce n'est pas une affaire entre l'Amérique et nous, mais entre les Palestiniens et nous. Terrorisme ? La chute du régime de Saddam ne nous concerne en rien, nous n'avons pas été partie prenante dans ce conflit, le terrorisme palestinien continue de prendre des vies israéliennes avec l'appui massif des états arabes. Lorsque les Palestiniens feront eux-mêmes efficacement la police anti-terroriste, alors nous pourrons négocier. Et puis viennent les trois points classiques d'une éventuelle négociation : les colonies, Jérusalem et le retour des Palestiniens en exil. Pour les nouvelles colonies, on peut discuter. Et puis là, se place une inversion également classique : on bouscule un tout petit peu l'ordre des sujets, de sorte que la question de Jérusalem vienne clore le débat, et non pas celle du retour, car il n'est pas question, un seul instant d'envisager le retour des exilés, c'est ce qu'on appelle une condition sine qua non. Et puis enfin vient Jérusalem, le statut de la Ville Sainte, dont, Ehud dixit, le monde chrétien est témoin qu'elle est la capitale du Judaïsme. En bref, l'essentiel est non-négociable. David se tait, atterré, remercie Ehud qui quitte l'écran avec le sourire.
Combien de fois ai-je assisté à cette dramaturgie tragique ? A Jérusalem, j'ai moi-même fait cette interview en tant que journaliste, toujours la même, toujours les mêmes questions et toujours les mêmes réponses. C'est ce qu'on pourrait appeler, dans l'esprit de cette émission de la télévision britannique, le réel dur, inaltérable comme l'or qui coule dans le générique entre les lettres du titre Hard Talk J'ai vu cet épisode ce matin, vers cinq heures et quelque, et la seule question qui m'est venue tout de suite : pourquoi n'ont-il pas choisi Tim Sebastian, Tim le terrible, pour affronter Olmert ? Pourquoi le pauvre David Jessel ? Qu'en pensez-vous ? En tout cas cette émission est un échec désolant pour la BBC. Mais, pouvait-on vouloir autre chose qu'un échec ?
Pour ma part je ne tiens pas à me répéter car j'ai déjà fait mon analyse de ce conflit dans cette chronique, il y a déjà assez longtemps. Je vais pourtant ajouter quelque chose de neuf. La Shoah est évidemment au centre de toute réflexion concernant la Palestine. Or la Shoah fut l'invention de la barbarie et non pas une résurgence, et elle fut une invention totale et indépassable. Heidegger l'avait nommée " la fabrication de cadavres ". Depuis la Shoah le destin du monde est suspendu, non pas à l'éradication de toute répétition de la Shoah, mais à la destruction de toute possibilité d'engendrer une barbarie encore plus grande. Les Nazis ont industrialisé cette " fabrication de cadavres ", il reste encore à fabriquer industriellement des " âmes mortes ". Au plan expérimental et artisanal, ce " décervelage " a déjà commencé. Jarry avait beaucoup d'avance sur Orwell. Son message est tragique et révèle tout autre chose que l'inventeur de la pataphysique. FC en a parlé avec talent récemment.
Dimanche 27 avril 2003
Je comptais, aujourd'hui vous entretenir de l'âme en raison de ma colère grandissante à la lecture répétée de Plotin. Mais colère pour colère, deux autres événements ou plutôt deux interventions médiatiques sont venues renforcer la colère en tant que telle tout en la dérivant vers un tout autre sujet, sujet dont il y a quelques années je vous ai déjà rabattu les oreilles, mais, à la persistance du mal il faut opposer la persistance de la protestation. Alors.. Il ne s'agit rien moins que de la prestations de deux personnages de notre paysage politique qui ont bien des points communs tout en se campant chacun dans un camp opposé. En effet, avant hier soir, ça avait commencé avec l'interview, mais peut-on appeler cela une interview, de Monsieur Sarkozy à propos de ses projets liberticides concernant l'utilisation et le trafic (on dit toujours trafic, jamais tout simplement commerce, alors que les spiritueux, qui tuent bien plus de monde, ont droit à la noblesse du concept de l'échange marchand) de la drogue. Foin des distinctions entre drogues douces et drogues dures, il faut donner aux lois de 1970 toute leur rigueur, allez, punition pour tout le monde, d'une manière ou d'une autre - : " ces gens-là, je cite, se détruisent, et on n'a pas le droit de les laisser faire "-. Réponse le lendemain, en compagnie d'une présentatrice toute heureuse d'avoir l'occasion d'en rajouter une louche tout en faisant semblant de donner la voix à l'opposition, par le bon docteur Kouchner, qui s'est récemment signalé par sa position originale, soutenant l'insoutenable guerre irakienne pour venir au secours de " son " concept de l'ingérence humanitaire.
Kouchner / Sarkozy, vous allez bien ensemble, allez ! Figures qui prenez si bien la lumière des studios en obscurcissant celle des âmes, jeunesse-masque derrière laquelle se tiennent deux vieillards du monde actuel, deux divinités courroucées et qui se pensent sincèrement destinées à refaire le monde. De vrais hommes de pouvoir, " sûrs d'eux-mêmes et dominateurs ", dont les regards fixent le monde dans les yeux avec l'insolence extrême de dictateurs du quotidien. Des gens qui n'ont même plus la moindre distance vis à vis de la gravité de ce qui s'appelle une décision et qui nous chantent la crise de civilisation comme causa sui de leur arrogance sans limite, sans même savoir de quoi ils parlent. Comme vous pouvez le constater ça chauffe, car vous l'aurez compris, ce qui me chagrine est moins le contenu de leur ressassement archaïque que cette ressemblance, je dirais presque cette fraternité ontologique qui unit ces deux êtres qui devraient, en toute logique, se parler par boulets intellectuels rouges interposés.
Au lieu de quoi c'est tout juste si, à la manière de Tex Avery, on ne discerne pas les cœurs qui s'envolent des yeux de l'un pour l'autre, du moins sur le fond de tout ce qu'ils racontent et de tous leurs mensonges. La réponse de Kouchner à la citation qui précède est un pur écho - : " le tabac ! 60 000 morts par an ! " - Sans sourciller, Monsieur Kouchner ment, à peine par omission, là où Sarko a au moins le mérite de porter au jour sa décision régalienne de s'emparer du destin de ses concitoyens. On voit la petite différence qui sépare le tenant du pouvoir de celui qui vient de le perdre, car Koukou tenait exactement le même langage que Sarko quand il était encore ministre : moi, Kouchner je vous interdits d'aller mal, je vous interdits de décliner, d'être la cause de votre maladie et de votre mort, je n'ai pas le droit d'autoriser cela, c'est exactement ce que disait Sarko. Ce détournement de la philosophie de la santé publique née au dix-neuvième siècle est remarquable car, bien évidemment, le moteur de cette logique que personne, aucun journaliste ne trouve le courage de contester, c'est que cette emprise que s'arroge l'état sur la liberté individuelle de faire de soi ce qu'on entend en faire, est un moteur ignoblement trivial, l'argent.
Mais examinons les faits de près. Car là où dans la presse toute nuance a disparu, autre que ces distinctions ridicules entre douceur et dureté des drogues, il y en a de biens réelles et qui sous la solidarité apparente des positions, les opposent très profondément, sans que l'une ou l'autre des deux positions ne soit plus reluisante. D'une certaine manière j'aurais, si je devais en avoir une, une préférence de goût disons, pour Sarkozy, et savez-vous pourquoi ? Parce que derrière son arrogance de parvenu du pouvoir il y a une certaine " Entschlossenheit ", un esprit de décision qui transcende les causes matérielles ; alors que Monsieur Kouchner nous cache la réalité sordide de son hystérie contre le tabac, l'alcool et les drogues dures, tout en cherchant à se dédouaner vis à vis de la majorité des consommateurs de " drogues douces " qui font toujours un fond électoral bon à prendre. Cette réalité sordide s'appelle le budget de la Sécurité Sociale, nouveau Veau d'Or de la République et de toute politique sociale. Alors voilà comment les choses se présentent, et au passage nous parlerons aussi des manœuvres subtiles qui consistent à prôner l'accompagnement à la mort pour alléger les coûts exponentiellement coûteuses de ces mêmes fins de vie.
D'abord, où Monsieur Kouchner va-t-il chercher ses 60 000 morts par tabac ? Il fait comme moi, il prend les statistiques de l'Inserm, auxquelles manquent hélas encore la rubrique Tabac et Alcool, car quoi qu'on puisse dire, aucune mort ne peut être imputée tout de go à ces deux matières de la nature. Il faut encore et toujours passer par des causes de mortalité réelle, à savoir les maladies, la mort dite naturelle, les accidents etc… On obtient le chiffre de 60 000, qui soit-dit en passant ne représente jamais qu'un dixième environ de la mortalité annuelle totale en France, par extrapolation étiologique. Je m'explique. Les deux agents principaux de la mortalité européenne, car les choses se passent mutatis mutandis partout dans les mêmes proportions (sauf la circulation et les crimes de sang) sont le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Il suffit donc d'affirmer, avec l'accord quasi unanime du corps médical, que le tabac et l'alcool entrent pour tant et tant dans l'étiologie de certaines de ces maladies principales, sans que l'on produise la moindre preuve scientifique de ces affirmations, et le tour et joué. Comme les journalistes ne font pas leur boulot, ou manquent en général du moindre courage pour nager contre le courant, aucun d'eux ne prend le temps de mettre son nez dans les statistiques. Il prend donc pour argent comptant tout ce que Monsieur Kouchner, le bon docteur socialiste, affirme urbi et orbi.
Or, les statistiques ne peuvent, hélas, pas mentir. L'un des accidents de parcours de cette manipulation médiatique est ainsi passé totalement inaperçu. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, l'équation était unilatéralement celle-ci : tabac = cancer. Car dans ces années-là, le cancer semblait rattraper statistiquement la cause principale de mortalité, à savoir les " maladies cardio-vasculaires ". Dans ces maladies entrent, évidemment, toute sorte de chose, y compris les arrêts naturels de cet organe programmé pour battre tant et tant de fois et pas une de plus, selon l'individu. Or le cancer est le cauchemar de la Sécurité Sociale, pour la raison évoquée plus haut, à savoir le coût exponentiel des soins dans les derniers jours du malade. Dans les budgets de la Caisse Maladie, c'est l'imagerie médicale et les chimiothérapies qui forment le gros des chiffres. On prédisait déjà le dépassement probable par le cancer des performances du cardio-vasculaire, et donc le tabac devenait l'ennemi numéro 1, on ne sait trop pourquoi, car le cancer des poumons n'a jamais été l'un des plus meurtriers en termes chiffrés. Bien sûr en y ajoutant les cancers ORL on gagnait quelque crédit, tout en sachant que ce cancer ne fleurit statistiquement que dans des zones à forte pollution industrielle, conjugué ou non au tabac. Mais tout cela constituait un excellent argument médiatique et permettait une imagerie tout à fait dantesque. Or voilà que ces sacrés chiffres du cancer se mettent à régresser vers les années 90, à tel point que l'Inserm a tout simplement cessé de livrer les chiffres de causes de mortalité à la presse, du moins à moi bien connu de leurs services. Un jour, pfouitt ! plus rien, plus de réponse à mes commandes. Mais le trend était clair, le cancer régressait globalement, cependant que certains d'entre-eux comme les lymphomes subissaient des augmentations spectaculaires, en pourcentage sinon en nombre. Tchernobyl fut immédiatement accusé. Il fallut donc revenir à Maladie cardio-vasculaires = tabac sans aller toutefois jusqu'à dire la vérité au public qu'on laissait à ses mythes classiques. J'ai longuement étudié les quelques études épidémiologiques qui existent à travers le monde, les chiffres de mortalité et leurs variations, les causes etc… Quelques éléments sont de véritables invariants, à commencer par les chiffres globaux. En France meurent environ 500 000 personnes par an avec une marge de variation de 30 à 40 000 sujets. Seuls varient les causes de mortalité. Il s'opère des transferts de certaines maladies à d'autres et même les facteur lié au hasard, comme le suicide, le meurtre, l'accident de route ou la mort subite restent étonnamment stables. D'où la mise en relation des effets du tabac avec pratiquement l'ensemble du tableau clinique de la médecine : plus rien n'échappe au tabac, cela n'empêche nullement la population de vieillir de plus en plus sereinement quel que soit le prix des bobos liés au passé professionnel ou à la dégénérescence naturelle, dégénérescence dans laquelle il faut inclure le cancer puisque les chiffres montrent aussi que cette maladie est avant tout une maladie de vieillesse. Point barre.
Il est temps maintenant de voir sur quel terrain se rencontrent ces messieurs, dont l'un s'en prend au laxisme des autorités face à la consommation de drogue et l'autre au laxisme dans l'application de la fameuse et triste loi Evin. Ce terrain est simple : le principe de plaisir est une véritable boniche à tout faire en politique. Monsieur Sarkozy a le mérite de ne pas cacher qu'il s'en prend directement à lui, c'est dans sa nature d'homme de pouvoir : qui bene amat bene castigat. Faire mal fait partie intégrante de l'exercice du pouvoir, de cette injustice fondamentale et essentielle qui donne à un homme le droit d'exercer son pouvoir sur d'autres hommes. Koukou quant à lui est un frustré-type du genre socialiste français, une Madame Pernelle du principe de plaisir qui a dû gérer les finances de la Santé soumises au contradictions et aux menaces que représente le secteur privé. A ce sujet une remarque : Hôpitaux privés et Ecoles privées, même topo : sans le secours de l'état tout s'effondre, et pourquoi ? Parce que le principe de la Santé et de l'Ecole à deux vitesses n'est pas accepté par les Français et ne le sera jamais, et que ces établissements sont donc contraints de recevoir des clientèles qui ne correspondent pas à leurs ambitions sous peine de perdre définitivement leur possibilité même d'exister. En revenant quarante ans plus tard dans ma ville natale, Mulhouse, j'y ai trouvé ma petite clinique où je suis né, et qui était un quasi dispensaire pour pauvres géré par des religieuses transformée en Hôpital de grand style. L'Eglise avait changé radicalement de politique et s'était lancé dans l'investissement économique à finalité économique. Il faut dire qu'elle n'avait guère le choix pour survivre que se transformer en agent économique privé ; en Alsace il lui reste encore tant de bien fonciers et immobiliers que de telles opérations sont encore faisables. Les Protestants en font exactement autant.
Conclusion. Je vais me faire pas mal d'ennemis ou d'adversaires même parmi les fidèles lecteurs que me confirment mes propres statistiques. Mais pour moi la liberté n'a aucune frontière et rien ne permet à une société de faire des choix destinaux et existentiels à la place de ses citoyens. Je rejette toute immixtion de l'état dans la liberté individuelle par rapport à la vie et à la mort. L'interdiction des drogues est une invention diabolique du vingtième siècle, siècle de la mort à l'usine, de la mort dans les camps et de la productivité à outrance à n'importe quel prix. Lorsqu'on prend la vie des hommes au fond des mines ou dans les usines bourrées d'amiante, on commet le crime d'assassinat mais cela porte le nom d'accident du travail. Lorsqu'on construit un espace social tellement pollué que la vie y devient dangereuse, que les virus eux-mêmes ne s'y retrouvent plus et mutent d'une espèce à l'autre à cause de nos manipulations et que l'on se prépare à cloner des surhommes, alors on laisse au moins aux plus désespérés le droit de s'abstenir de participer à cette sinistre gabegie et même de se détruire si tel est leur bon vouloir. Qu'on se souvienne de ceci : la loi qui s'en est pris pour la première fois aux drogues dures date de la première guerre mondiale, où la consommation de morphine était devenu la réponse logique aux souffrances du front. Cette souffrance n'a pas disparu et c'est elle qui explique que des milliers d'individus prennent des risques de toute sorte pour y mettre fin. Et enfin, QUI, QUEL DIEU a donné le droit à un homme ou à un groupe d'hommes d'interdire à d'autres hommes d'absorber de la nature ce que bon leur semble ? C'est un scandale sans nom et le fait que ce scandale ne soit presque nulle part dénoncé à sa juste dimension ne fait que prouver la lâcheté foncière de l'homme moderne. Vale.
Lundi 28 avril 2003
L'âme." Par conséquent l'être de l'âme ne consiste donc pas à être la forme de quelque chose ; elle est une réalité qui ne reçoit pas son être du fait de s'établir dans un corps, mais qui est avant même d'appartenir à ce corps ; par exemple, chez un vivant ce n'est pas le corps qui engendrera l'âme "(Plotin , Traité 2, & 8, De l'Immortalité de l'âme, Ed GF Flammarion). Le bavardage de Plotin, pour élégant qu'il soit, m'irrite chaque jour davantage. La phrase que je cite ici contient à peu près l'ensemble de toutes les contradictions non seulement du plotinisme, mais de son modèle, il faudrait dire ses modèles platoniciens et aristotéliciens. La première partie de la phrase est d'ailleurs une attaque d'Aristote. La thèse aristotélicienne est sans doute la plus puissante dans notre culture et aussi la plus profonde. Que dit-elle d'intelligible pour un public moyen, simplement capable d'entendre un langage simple ? Ceci : chaque être possède un état parfait vers lequel il tend, son entéléchie : le mouvement n'est rien d'autre que l'illusion qui provient de cette tension des êtres vers leur perfection. Aristote ajoute que l'atteinte de cette acmé formelle aboutit au repos, à l'immobilité. Mais tout ceci paraît encore assez compliqué. Disons pour simplifier que Aristote avait longuement observé la nature et qu'il avait été fasciné par les phases par lesquelles passaient les êtres vivants. Ce qu'il appelle entéléchie, en fait, peut se décrire comme la phase culminante de la force et de la vitalité d'une plante, d'une fleur par exemple. L'entéléchie d'une fleur serait ce moment où elle a atteint son plein développement et où elle a atteint sa beauté parfaite, la beauté pour laquelle les hommes la cultivent et l'entourent de tous les soins nécessaires pour qu'elle atteigne cette " entéléchie ".
L'âme est donc d'abord une sorte de modèle en puissance, le modèle qui tend vers sa perfection par le mouvement de la génération, c'est à dire de la croissance à partir de la graine vers ce que dès lors on peut enfin appeler son être. Donc, Aristote ne considère l'être que dans l'entéléchie des choses. Rien de matériel ne peut être, ne peut participer de l'être avant de se trouver dans son entéléchie, c'est à dire dans la forme suprême qui apparaît, et là on retrouve le ciel des Idées platoniciennes, dans la sphère primitive d'Aristote dont émane pour ainsi dire les formes et les entéléchies. Tout cela est proprement incompréhensible pour nous, n'a pas de sens. On retrouve pourtant dans la science la plus moderne des analogies intéressantes qui permettent de donner au génie d'Aristote toute sa dimension. Qu'est-ce en effet que la molécule d'ADN, sinon un programme formel qui s'accomplit tout au long de la vie de son porteur ? Il y a là, je me contente d'employer le terme d'analogie, le soupçon déjà dans l'Antiquité d'un lieu de la réalité individuelle où se trouve inscrite son entéléchie et aussi les menaces qui pèsent sur elle. Malgré tout, Artistote demeure réaliste : il n'y a pas de forme sans être, et sans être individué, et il n'y a pas d'être individué sans forme. C'est à dire que l'âme, qui est cette forme, n'est attestée que par la matière, qui ne peut pas être matière sans forme. Le présent est forme, même si ces formes sont agitées par le mouvement comme on a vu plus haut puisqu'elles tendent vers le repos de l'entéléchie. Ce repos, d'ailleurs, est très problématique, car dans le système explicatif d'Aristote, n'est en repos que la sphère de l'entéléchie universelle dont émanent les formes du présent pour se rendre dans la réalité matérielle.
En quoi tout cela nous intéresse-t-il ? Pour nous l'âme est une notion théologique, tout au plus y faisons nous appel lorsque nous avons besoin d'une métaphore poétique pour décrire un état intérieur dont on ne peut pas préciser les contours. Un état d'âme est l'image d'un certain degré d'harmonie intérieure chez un homme, harmonie qui devient entéléchie dans sa perfection. Dans cette perfection, le monde apparaît dans la vérité du modèle éternel et parfait contenu dans la sphère immobile : la sagesse est donc l'état qui permet à l'homme de prétendre sortir du mouvement, entrer dans le repos de la contemplation, de la contemplation du véritable monde, du monde vrai tel qu'il est modélisé dans le moteur primitif. Ce qui m'irrite dans la notion d'âme, c'est qu'en réalité elle vient perturber directement la question de l'être. Ecoutons encore une fois Plotin - :".. elle est une réalité qui ne reçoit pas son être du fait de s'établir dans un corps… "Il y a ici une redondance énigmatique pour le moins. Dans la métaphysique antique, réalité = être, ces deux concepts désignent la même chose. Alors que signifie une " réalité qui reçoit son être ", sinon peut-être un être qui " reçoit " l'existence. Ce qui serait conforme avec ce qui suit quand il affirme que l'âme est avant d'appartenir au corps. Et c'est là que rien ne va plus, car l'être est, que Plotin le veuille ou non, et rien d'autre ne manifeste l'être que la forme que possède toute matière.
Nous nous trouvons donc devant la difficulté majeure de toute compréhension de la philosophie, le cauchemar des honnêtes individus qui cherchent à comprendre pourquoi il y a de l'être autour d'eux, et non pas si cet être est enveloppé par une âme ou non. D'autant qu'on vient leur parler ailleurs d'une âme motrice des êtres vivants, c'est à dire non plus d'une forme des choses extérieures, mais d'une instance intérieure et qui, à la fois, serait détachée de la matière corporelle. Sans parler de la notion chrétienne d'âme, parcelle de divin ou carte d'identité attribuée par le Créateur et autres sornettes. Pour finir sa démonstration, Plotin ajoute que ce n'est pas le corps qui engendre l'âme, ce qui signifie en clair qu'on n'a pas besoin de l'existence des corps pour prouver l'existence des âmes, ou que l'âme n'est pas le propre des corps individuels. Avec Aristote on s'en tire quand-même un peu mieux, car son concept d'entéléchie, que j'espère avoir quelque peu éclairci, peut s'appliquer à l'univers tout entier. Cet univers est bien là, il est, et en tant que tel participe de l'être. Mais il est en mouvement, et à ce titre ne possède pas le repos de l'entéléchie, ce pour quoi Aristote est contraint d'inventer une sphère imaginaire, modèle transcendant qui inspire à la matière les formes qui la constitue, tout en laissant ouverte la possibilité pour cette matière d'entrer dans l'entéléchie du modèle parfait. Par extrapolation on pourrait y voir une préfiguration de l'histoire universelle comme mouvement vers son entéléchie, mais de cette manière on ne sort pas, on ne peut pas sortir de la théologie qui pose d'avance une entité séparée dont notre réalité ne restera qu'un reflet tant que quelque changement définitif ne vienne confondre les deux lieux de réalité.
Mardi 29 avril 2003
Le gouvernement Raffarin nous réserve des surprises bien étranges. Le projet de Monsieur Borloo mérite un coup de chapeau, même s'il faut, primo se garder de tout triomphalisme, car l'affaire n'est pas encore dans le sac, et si elle y entre, ce sera sans doute avec quelques amendements. Secundo que l'affaire est loin d'être aussi simple qu'on le pense. J'habite l'Alsace où j'ai, jadis, longuement étudié le surendettement en tant que journaliste. A ce propos, je rappelle que dans notre province privilégiée, la faillite personnelle est un processus judiciaire, et que ce sont les tribunaux qui décident. Je peux ainsi vous affirmer que la plupart des cas (rares, il faut le souligner) qui ont bénéficié de ce moratoire, y sont parvenus en Appel ou en Cassation, car la plupart des Tribunaux d'Instance, et surtout celui de Strasbourg, rejettent presque systématiquement tous les dossiers. L'amendement principal que je pressens, c'est donc la judiciarisation de cette faillite personnelle, autrement dit, la dissolution des Commissions Neiertz qui sont d'ores et déjà considérée comme trop laxistes par les banques et autres créanciers. Si tel est le cas, bonjour pour la procédure, son coût en avocat et le temps qui passe… Mais ne soyons pas un oiseau de mauvaise augure et faisons confiance au bouillant maire de Valenciennes. Je le félicite personnellement d'avoir fait ce que j'attendais que fît Monsieur Badinter en 1981, c'est à dire un moratoire judiciaire pénal.
Je m'explique. Aux lendemains du 10 Mai 1981, quelques 5000 détenus ont été remis en liberté, peut-être plus je ne m'en souviens plus exactement. Or, cela étant, j'attendais un geste plus profond de la part du Garde des Sceaux, à savoir que l'on accorde aussi à ces ex-délinquants que l'on renvoyait dans la société, un moratoire de leur destin, à savoir une purge de leur casier judiciaire, sans quoi leur libération n'aurait pas plus de sens qu'une vulgaire amnistie électorale. Ce qui fut le cas puisque le Ministre n'a pas jugé bon d'aller aussi loin dans le pardon, un manque d'audace qui a bien vite repeuplé les prisons. J'évoque cette affaire car elle est exactement de même nature que le projet de Borloo, et j'espère que la loi qui devrait naître de ce projet, comportera aussi un moratoire moral, c'est à dire la destruction du " Casier bancaire " des citoyens réhabilités. Je rêve sans doute.
Il reste aussi un autre domaine où il faudrait légiférer une fois pour toute, celui de la jungle du crédit facile. Tout le monde sait qu'aujourd'hui lorsque vous allez faire vos achats dans un hyper marché, vous ressortez avec plus d'argent qu'en rentrant, car on vous a offert sans vous demander la moindre garantie, des crédits dits revolving (qu'il faudrait appeler revolver) dont vous pouvez faire ample moisson en un seul jour. Mieux que cela, les marchands de l'immobilier veulent faire du chiffre, et pour y arriver il leur suffit de fermer les yeux sur votre situation réelle. J'ai ainsi connu un éboueur strasbourgeois auquel le Crédit Foncier en personne a vendu un appartement de 5 pièces pour la bagatelle de 800 000 FF alors qu'il avait déjà une dette de 400 000 FF pour maison Bouygues, acquise avant finitions, finitions qui ont ruiné le bonhomme. Mais ce monsieur était fonctionnaire de la municipalité, donc réputé solvable, en dépit de la réalité. Ce monsieur a obtenu le bénéfice de la faillite en Appel, après deux ans de cauchemar. Cela dit, c'est un bien plus vaste moratoire qu'il faudrait entreprendre pour assainir la situation de la majorité des citoyens de ce pays, car l'endettement à l'américaine avance à la vitesse d'un cheval au galop, et bientôt on pourra vendre sa vie à ses créanciers, ne plus jamais voir un billet de banque et transmettre à ses enfants, s'ils le veulent, une montagne de dettes faute d'un patrimoine quelconque. Je crains hélas que le capitalisme ne soit pas assez clairvoyant pour procéder lui-même à un tel assainissement. Et il faut bien constater qu'il n'y a pas que des Borloo dans ce gouvernement qui ferme les yeux sur une paupérisation en marche en jetant beaucoup de poudre aux yeux de ses électeurs. RDV en Mai et plus tard encore, et encore, jusqu'à ?..
Vendredi 2 mai 2003
La certitude métaphysique. Jean-Luc Marion à France-Culture ce matin. Je n'ai jamais compris intimement la question de la certitude, ni la donation de Marion. Je l'ai comprise au sens d'une péripétie historique d'une science qui a besoin de garanties à un moment où le divin perd sa puissance de légitimation de tout discours sur l'étant, c'est à dire aussi la science. La certitude n'est donc qu'une prothèse du désir et de la volonté. Le côté génial de la tabula rasa de Nietzsche est le pressentiment du retour à un questionnement ontologique simple : Nietzsche enlève toute couleur, il ne laisse de l'étant que le translucide, l'enveloppe invisible des étants qui sont toujours couleur, c'est à dire valeur. Sa vanitas n'est en rien différente de celle de la Bible, elle n'est qu'une traduction de la mélancolie philosophique, c'est à dire de la connaissance d'une vision qui nous échappe, dont nous demeurons en manque : du visible qui se cache derrière l'invisible.
Mais on parle de l'amour. Le connatus est dans la nature, dans l'étant en tant qu'étant. De notre point de vue, celui de notre présent, et bien entendu symboliquement, Dieu en serait venu à la contrainte de s'aimer lui-même par défaut d'amour de son Peuple. Mais nous ne pouvons pas rester en dehors de cet amour car il n'y a pas de peuple : l'individuation est elle-même coloration du translucide. Spinoza l'a bien dit : nous ne sommes chacun que des nuances de la substance et l'amour est puissance d'identification au-delà de l'individuation. La fabrication métaphysique du sujet a été une tentative de liquider l'individuation dans son sens essentiel c'est à dire d'être nuance. La machine totalitaire kantienne tente de réduire définitivement le nuancement de la physis mais se heurte au sublime pour retomber dans le théologique le plus plat. L'amour est avant tout jouissance des nuances, jouissance du constat de l'existence de l'individuation et de sa contemplation. Le surréalisme a compris un aspect de cette contemplation en poussant les nuances hors de leur cadre pour les rendre visibles à tous. Magritte nous renvoie à l'absence de couleur en détruisant le sujet propre à la couleur au sens de l'esthétique kantienne : il démocratise la vision et toute la puissance de l'art moderne réside dans la poursuite de cette démocratisation de la vision, cette pédagogie de la contemplation.
Pour une fois, Blandine ne met pas mes nerfs à rude épreuve. Sa manière de mettre le mystère en avant me paraît être un progrès considérable dans le contexte d'une analyse qui porte sur la certitude. Si elle poussait sa méditation un peu plus loin, elle trouverait la relation entre mystère et jouissance. Toute jouissance est jouissance du mystère de l'Être, même et surtout dans la relation érotique, sexuelle. Dans cette relation il se produit un aveuglement qui est abolition de la couleur et des nuances et accès furtif à l'invisible. Abandon.
Samedi 3 mai 2003
Lisbonne, Italie, Californie, Turquie, Japon, Balkans, fossé rhénan. Ces lieux géographiques vous suggèrent-ils quelque chose ? J'ajoute Montserrat, c'est très personnel. Vous ne voyez toujours pas ? Hé bien j'ai choisi ces zones de la planète pour leur taux élevé de morbidité par catastrophe naturelle, je veux dire par tremblement de terre ou éruptions volcaniques. Je n'ai pas besoin de citer le stimulus de cette chronique, la ville turque de Bingöl qui vient de subir un 6,5 sur l'échelle de Richter, ce qui n'est pas beaucoup, sauf si ça se concentre sur quelques hectares. J'aurais aussi pu citer l'océan Pacifique et l'Amérique Latine mais l'objet de mon intérêt est très précis, et je ne m'intéresse pas à la colère de la nature ou aux explications scientifiques de ces phénomènes. Non, ce qui me chatouille depuis toujours, et je pense que je suis loin d'être le seul à se poser à chaque fois cette même question : pourquoi les hommes retournent-ils toujours sur le lieu du crime (de la nature) ? Lisbonne rasée, réduite en cendres, quatre-vingt mille morts, San Francisco complètement détruite, Saint Pierre en Martinique quarante mille victimes, Pompéï, et Montserrat, le merveilleux paradis antillais où j'ai vécu deux années resplendissantes dévasté en quelques heures par l'éruption d'une montagne que je parcourais souvent à pied, me baignant dans les cascades paradisiaques, un tas de cendres.
Et pourtant, comme dirait Galilée, ils y retournent, reconstruisent tout jusqu'à la prochaine. cata, dansent, élèvent des poulets, des cochons et des gratte-ciels, fêtent le Carnaval et font comme si de rien n'avait été. Dans un de ces endroits j'ai failli mourir de rire, San Francisco. Dans cette ville extraordinairement belle, étendue mais pas gigantesque, se concentrent quelques immeubles à l'américaine, mais pas tout à fait dans le style Chicago ou NY, plutôt bien balancée, ici on veut visiblement bien vivre et il y a comme un air de rébellion si on la compare aux grandes cités aux mille gratte-ciel pour fin du monde de cinéma. On s'y sent comme nulle part ailleurs, du soleil toute l'année, toujours un petit vent aigrelet, des panorama en veux-tu en voilà tous azimuts. Et pourtant on vit, oui, mais dans la terreur. Comme les gens de ce joyaux de la côte ouest sont plutôt d'un niveau culturel légèrement supérieur à ce qu'on trouve dans les tréfonds du Texas, ils sont également d'une intelligence agréable à fréquenter. Mais voilà, qui dit intelligent dit attentif et lucide. Les San-Franciscains vivent donc accrochés à leur radio locale dans la hantise permanente du grand choc, que ça fait deux fois déjà dans l'histoire récente qu'il a presque tout réduit en poudre. Alors c'est du Rabelais : on ausculte chaque jour toutes les sources d'information, on consacre des matinées entières à répéter ce qu'il faudra faire au cas où, on creuse dans le petit jardin qui entoure la maison pour y stocker des vivres et de l'eau douce, que l'on changera avec une minutie d'horloger, on sait déjà tout sur les plaques tectoniques et en particulier sur le grand fossé qui risque un jour de séparer la presqu'île San Francisco du continent.
Bref on vit dans l'attente du pire, on ne vit que dans l'attente du pire, sans que cela n'empêche quoi que ce soit. Admirable espèce humaine ! L'immense pont à deux étages qui relie la ville à Berkley s'est littéralement effondré, abîmé dans l'océan Pacifique, écrasant les pauvres automobilistes qui avaient choisi les voies du rez de chaussée. Pas grave, on refait, allez ! Et puis de l'autre côté de l'autre pont, le fameux Goldengate Bridge, se trouvent quelques contés où il ne doit plus rester le moindre bosquet jusqu'à la pointe, tout au nord, dans le décor du film d'Hitchock sur les Wouasauou. Tout se couvre de coquettes petites villas telles que vous pouvez les admirer dans les films d'horreur avec leur portes en carton garni de fenêtres, leur jardinet précédé d'une boîte aux lettres pour Sunday Times (450 pages) et la tondeuse qui ronronne de partout. Quant à la radio et à la télévision, ils en parlent tous les jours. De quoi ? Du futur tremblement de terre et des conséquences dantesques à prévoir, car cette fois, cette fois-ci, ce sera la bonne. Tout va péter, Messieurs, Mesdames, un tremblement de terre comme vous n'en avez jamais vu ! Pire que Al Qaida, et pas la peine de prendre de masque à gaz, vous n'aurez pas le temps de vous en servir. Donc, n'oubliez pas d'ajouter dans le trou de votre jardin les antibiotiques dont il faut soigneusement relever les dates de péremption ainsi que de tout le reste d'ailleurs. Votre calendrier est rigoureusement tenu ? Vous savez exactement quoi faire, à la seconde près juste avant que la terre ne vous engloutisse pour l'éternité ? Vous connaissez par cœur la combinaison du cadenas ? Vérifiez SVP, tout de suite, oui, je dis tout de suite ! Big Brother vous regarde alors droit dans les yeux et vous vous sentez coupable tout de suite. Ah oui, les jouets des enfants, mon dieu, et les kit-psy pour passer le temps (calciné au fond du gouffre), et surtout, surtout, mais alors là pas question de plaisanter, les A-SSU-RAN-CES, tout risque, bien entendu.
A Los Angeles, l'hystérie est encore, paraît-il, plus intense. Tous les soirs on boit la dernière coupe de Champagne, on enterre déjà les morts, on ne dit pas, comme chez nous : -" ah quel sale temps ! "- Non. On dit : -" tu crois que c'est pour demain, ou cette nuit ? " - " et si on allait se torcher pour fêter ça, hein ? ". Bof, direz-vous, ce sont des Américains, après tout, de grands émotifs qui aiment le cinéma, les grands frissons et le sang qui gicle. Surtout celui des autres… Car changement de décor, au pied du Vésuve on s'en fout, à Montserrat on s'en fout, à Bingöl on va bientôt s'en foutre dès que le gouvernement aura indemnisé tous les vivants et quelques morts, je ne parle même pas du fossé rhénan, qui pourtant a connu une petite secousse il y a quelques semaines : tremblement de terre, connaît pas. C'est des choses qui arrivent au Japon, et encore eux ils construisent anti-sismique et voyez ce que ça donne à Kobé (j'ai enfin retrouvé le nom de l'espace le plus meurtrier de la planète), alors on va pas se mettre à paniquer. Bien vu. Sans doute. Mais quand-même, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça, on dirait que les gens coagulent précisément là, dans les endroits les plus dangereux qui existent. Ils ne vont pas dans la Creuse ou dans le Limousin, non, ils vont à San Francisco, à Kobé, ils continuent de vivre, de construire et de reconstruire là où on sait que ça ne durera pas plus de quarante ans !
Normal. L'homme est ainsi fait depuis qu'il a choisi de s'arrêter, de cesser d'errer comme un romanichel à travers le monde. Avant, il risquait pas grand chose dans ses tentes souples et légères, voire à même le sol sous la lune complice. Maintenant, il est là où il est né et il y restera quoi qu'il arrive, et même si la faim l'envoie balader jouer les SDF dans les quartiers ouest de Calais, il reviendra un jour, quand il aura construit pendant les vacances, sa maison où s'affairent déjà le ou les vieux, rescapés de la grande dernière. C'est beau tout ça. Mais moi, oui, et moi ? Moi ? j'en ferai de même, je resterai vissé à mon Mulhouse jusqu'au bout, jusqu'à ce que la tour de l'église (je me refuse à appeler cela une cathédrale) St Etienne, qui s'écroule déjà, ne descende s'amonceler sur la Place de la Réunion comme j'ai vu sur les photos de Dresde après les bombardements de 45. D'ailleurs, l'autre jour, quand la terre a tremblé, j'étais au restaurant avec Martine, et tout d'un coup, nous nous sommes regardés, droit dans les yeux, d'un air un peu surpris, mais oui c'est un tremblement de terre, avant de nous rasseoir pour pas laisser refroidir. Faut pas gâcher. Les gens sont marrants, ils crèvent paraît-il de peur de la mort ! Vous croyez ça ? Moi pas. Ce serait plutôt le contraire, et ça depuis des millénaires, depuis qu'ils ont un jour pensé qu'on pouvait mettre une pierre sur une autre et recommencer avant de poser des lozes ou d'autres pierres, à cause de la pluie. Après, ils ont trouvé ça tellement marrant qu'ils ont inventé des canons pour que ça aille plus vite, et sur commande encore. Hiroshima, mon chef d'œuvre !
Lundi 5 mai 2003
Être et néant. C'est la grammaire qui m'interpelle cette nuit à propos de ces deux mots. Il me manque l'érudition nécessaire au traitement du mot néant, à savoir pour commencer son origine. Aussi vais-je me contenter de travailler sur et à partir de la différence grammaticale pure qui sépare les deux mots de être et de néant. Ce qui m'a frappé tout à l'heure en méditant sur le sujet, c'est que le mot être est un verbe décliné à l'infinitif, alors que le mot néant est un substantif verbal décliné sur le mode du participe présent. Je ne me sers pratiquement jamais du mot néant car j'en ignore à peu près tout, sauf ce que je viens d'en dire, à quoi je peux ajouter qu'il semble que sa composition suggère quelque chose comme la négativité en acte, c'est à dire un étant fait de négativité. Ce qu'on peut aussi désigner sous le terme de rien ou de rien absolu. Or, comme dirait Bergson ou Parménide, je n'ai strictement rien à dire sur le rien, le presque rien ou le rien absolu. En revanche l'opposition être et non-être me semble d'une toute autre nature en rien comparable à l'opposition être et néant.
L'opposition entre être et non-être est une opposition logique simple : le non-être est le contraire de l'être. Or peut-on en dire autant de l'opposition de être et de néant ? Impossible parce que le premier mot désigne un verbe (qu'il soit actif ou passif n'a ici aucune importance), alors que le second est un substantif. Comment peut-on opposer un verbe avec un substantif ? Dans l'histoire de notre langage, il est vrai que le verbe être a subi un traitement qui en a également fait un substantif, puisqu'on peut dire l'être ou un être. Cette substantivation créé donc une équivalence grammaticale avec n'importe quel autre substantif. Mais cette manipulation linguistique a totalement dénaturé le terme primitif, modifié en profondeur son sens et donc l'usage sémantique que l'on peut en faire. Lorsqu'on dit un " être humain ", ou " l'être suprême ", on ne parle absolument plus de l'action ou de la passion (dans le langage des Anciens) d'être. Cet être devenu nom commun ne peut plus signifier l'événement que constitue pour quelque chose le fait d'être. Au point que l'on peut douter de son existence, alors qu'il est radicalement impossible de dire à la fois qu'une chose est et de douter de son existence. Si je dis qu'un arbre est là devant moi, je ne peux pas douter qu'il en soit ainsi, qu'il y a un arbre à l'endroit que je désigne. En revanche, lorsque je considère tel individu, il peut m'arriver de douter qu'il soit un être humain, de même que je peux douter de l'existence d'une hiérarchie d'êtres dont le sommet serait occupé par un être suprême.
C'est pourquoi j'interroge le mot néant. Parménide n'en faisait pas usage, me semble-t-il car je ne suis pas philologue et encore moins helléniste. Je sais néanmoins que
mè on
ne signifie pas néant, mais non-étant, équivalent verbal de non-être décliné sur le mode du participe mais qui ne peut pas s'identifier avec ce que nous avons dit plus haut à propos du mot néant c'est à dire " étant fait de négativité ", " rien " ou encore négativité en être (ou en acte comme dirait Aristote). Car le néant est bel et bien une chose, même si elle n'est qu'une chose pensée, et non pas un acte. Tout tourne alors désormais autour d'une nouvelle question : une chose pensée est-elle ? Et si elle est, sur quel mode est-elle ? Est-elle comme serait un arbre ou est-elle autrement ? A priori la chose pensée ne peut pas être sur le même mode que la chose sentie car la chose pensée et sa représentation par le langage peuvent être sujettes à caution, contraires à la vérité au sens du mensonge, et contestables par l'opinion des autres, cependant que l'arbre est incontestablement là, de même que mon corps, la rue, la ville, le clocher, le ciel et l'océan. J'en arriverais presque à un paradoxe culturel du style : je pense donc je doute, je parle donc ceux qui m'écoutent doutent. Par conséquent, je ne peux pas me fier à la valeur ontique, existentielle, de la chose que désigne le mot néant, ni a fortiori construire une spéculation rigoureuse sur l'opposition entre être et néant. A la limite je peux prendre en considération l'effet poétique que produit le mot lui-même à partir de l'analyse du mot qui peut nous renvoyer aux intentions de ceux qui l'ont pensé et porté au langage.
Or Parménide nous a légué une de ces pensées dont on peut douter si on veut, mais que l'on peut aussi méditer pour mesurer le degré d'adhésion ou de rejet personnels qu'elles provoquent chez nous. Cette pensée dit ceci : être et penser sont la même chose. (traduction libre, on peut aussi dire : être et penser sont un). Nous voilà bien embarrassés puisqu'il semblerait que le philosophe qui a affirmé avec le plus de force qu'il n'y avait que de l'être, et que le non-être est un fantasme, affirme aussi que la pensée et l'être sont une seule et même chose, et que par conséquent il est impossible de contester la pensée sans contester en même temps l'être. Alors il y a une interprétation possible de cette équation qui peut nous aider, et qui dit ceci : on ne parvient à l'être que par la pensée, ou bien encore : il n'y a de l'être que pour autant que nous le pensons, une sorte de cogito archaïque. Corrélativement à une telle interprétation, s'imposerait donc cette conclusion qui peut aussi passer pour un soupçon de forfanterie de la part du philosophe d'Elée : pour arriver à poser l'être comme seule réalité, Parménide a tout pensé, a assez pensé pour en quelque sorte coïncider avec l'être. En découvrant l'être et son caractère unaire il a découvert la véritable pensée. Le penser de Parménide n'aurait donc rien à voir avec notre acception de ce terme.
Que serait alors un tel penser ? Parménide le dit : c'est l'être. L'être est au résultat d'un processus et non pas le processus lui-même qui permet d'atteindre la vérité de l'être, vérité qui est….penser. Autrement dit : on ne commence à penser réellement qu'à partir du moment où le non-être est exclu de toute agitation mentale, spéculation, représentation, langage etc.. Inversement, on ne commence à être vraiment que lorsqu'on a trouvé le penser ontologique, lorsqu'on a abandonné tout autre mode de cogitation ou d'action. Etre n'est donc pas un donné mais un acquis qui demande un cheminement vers lui, une action plutôt qu'une autre, car il existe aussi un cheminement qui mène au non-être. Cette interprétation paraît de prime abord une pure folie, mais elle a l'avantage de réintégrer dans la problématique de l'existence, dans l'ontologie première, la dimension du sujet, l'incontournable réalité de l'individuation. Et cela n'est pas rien.
En effet, la science métaphysique se meut généralement à l'intérieur d'une dualité classique, celle du sujet et de l'objet, de la conscience et de la réalité, de l'esprit et de l'être. L'histoire de la métaphysique a pour ainsi dire fabriqué une terrible machine totalitaire, sur le modèle de la théologie, une machine qui en définitive prétend assumer le plus incroyable des paradoxes : asseoir le sujet dans la réalité, le hisser hors d'une pensée commune tout en le privant de sa singularité. Le meilleur exemple de cette tréfilerie du sujet est, sans conteste, la Critique de la Raison Pure qui est une esquisse quasi technique, un bleu de l'Homme dans sa relation à l'être. Comme il manquait un moteur à cette machine, Hegel s'attela à la tâche de le concevoir et de l'installer dans la carrosserie kantienne. Ce moteur, soit dit en passant, repose sur un carburant qui nous intéresse au premier chef, à savoir la négativité ou encore le néant. Or Hegel, qui, loin de se penser en opposition avec Parménide, estimait que son système en était l'achèvement. Nous avons assez parlé du destin de la Dialectique et de l'Aufhebung pour nous permettre aujourd'hui d'abréger. Par ce constat : la phénoménologie qui naît avec Husserl ne se permet pas de faire l'impasse sur la singularité. Le temps devient la temporalité qu'un Merleau-Ponty va ancrer profondément dans la singularité, cependant que Heidegger entreprend de faire surgir ce qu'il nomme l'impensé du penser de Parménide dans le cadre du souci singulier, du dasein hic et nunc, dont il pense qu'il n'aurait jamais dû sortir.
Par manque de temps, nous allons conclure provisoirement et un peu hâtivement. La notion de néant, le mot qui prétend prendre la place du non-être, me paraît être un symptôme d'une autodéfense de la métaphysique, incapable pour des raisons théologiques de faire usage de l'antonyme réel de l'être, à savoir le non-être. Pourquoi ? Parce que le néant, repris en réalité dans la théologie négative médiévale où il avait un tout autre sens, à savoir celui du résultat d'un anéantissement des contenus transcendantaux, ce néant se présente comme une totalité indivisible à quoi ne saurait s'opposer rien de moins qu'une autre totalité indivisible, savoir l'être. Or, ce que nous avons essayé rapidement de montrer ici, c'est que l'être, même s'il se présente dans l'étant dans une permanence évidente, même si l' " éclaircie " de l'être a une valeur universelle, cette éclaircie demeure un privilège singulier, individué : exactement comme la grâce dans la religion chrétienne. La différence est que cette grâce s'obtient non pas par l'arbitraire d'un transcendance ou une économie politique ecclésiale de la moralité, mais par un cheminement de pensée, dont l'impensé, en définitive n'est rien d'autre que ce que devient la pensée dans ce que Hegel appelait le Savoir Absolu, c'est à dire quand elle se dissout dans l'être pour donner raison à Parménide. Il y a donc bien des histoires de l'être : une histoire phylogénétique et une histoire ontogénétique. L'Occident, c'est à dire le monde sédentaire, s'est construit sur le projet d'un tel cheminement qui va de la liberté sauvage du nomade de l'état de nature à la liberté civilisée du nomade de la technologie.
Mardi 6 mai 2003
Je ne suis pas fait pour la gloire. Or, cela m'arrange tout à fait. Car je vais vous demander d'écouter le mot gloire, prononcez-le à haute voix et jugez-en : glou âââ rrrr. C'est proprement dégoûtant. Ca vous a à la fois des relents de tuyauterie de wc et des accents d'animal agonisant. Si, si, refaites l'expérience jusqu'à ce que vous captiez cette musique assez répugnante. Alors question : comment a-t-on pu accoler au signifié de ce mot, c'est à dire à son sens, un signifiant aussi dégueulasse, passez-moi l'expression.
Bon, vous allez me dire qu'on ne choisit pas forcément les consonances d'un mot, son étymologie passant d'abord ou avant tout. D'autant que dans le cas d'espèce, l'origine est religieuse. Au début fut Gloria (in excelsis deo). Alors quid de " gloria " ? Ce signifiant a-t-il de quoi pardonner en quelque sorte à son descendant d'exister ? Bof, je ne le trouve, pour ma part, guère plus ragoûtant que son rejeton. D'abord glo, mais qui a bien pu forger un phonème du style de " glo ", une mélodie qui glougloute à peu de choses près autant que la version française. Ensuite on pourrait dire que ça s'arrange un peu avec " ri " et " a ", " ria ", où l'on peut percevoir un sourire. Mais ce sourire accolé à ce " glo ", ça fait quand-même ringard.
Donc, j'ouvre mon Gaffiot à la page 715 et je descends à la troisième colonne : glomeratio, glomeratus, glomerosus, glomus, ah ! voilà gloria : gloire, renom, réputation, ornement, parure (l'horreur montre le bout de son nez), un taureau blanc, la gloire du troupeau,…..esprit de vanité, d'orgueil, grands airs (là on y est presque), point d'honneur à produire du miel (sic), et enfin nous y sommes : vaines forfanteries. Hélas pas d'étymologie. On s'en passera en procédant d'une manière pragmatique, science expérimentale du secteur philologique et tentative certainement inédite, du moins à ce que je sache. Nous allons remonter en amont du mot gloria, toujours dans le Gaffiot, comme ça, pour voir si les mots qui précèdent n'auraient pas quelque ressemblance avec notre animal.
Cela donne, nous l'avons déjà vu, d'abord " glomus ". Alors là, musicalement c'est l'horreur, à peu près aussi moche que " gloire " sinon plus. Qu'est-ce-que ça veut dire ? Glomus signifie peloton, pelote, sorte de gâteau sacré. Peloton, parfait, d'exécution bien entendu. Pelote, pas mal, on fait sa pelote, non ? Quant à la pâtisserie divine, nous venons trop tard pour en avoir la moindre connaissance gustative, donc nous n'en dirons rien, sinon que je préfère de très loin manger un " éclair ", pof ! ça pète comme le soleil, qu'un " glomus " qui me fait penser tout de suite au mot glauque. Glome, glomüss, pouah ! Vient ensuite, toujours en remontant le cours des signifiants proches, l'adjectif " glomerosus ", qui veut dire : qui est en peloton. Ce mot commence à m'intriguer. Être en peloton peut vouloir dire plusieurs choses, comme Aristote dit de l'Être qu'on peut le définir en plusieurs manières. Être en peloton peut vouloir dire être en rang d'oignon, le fusil à l'épaule et l'œil sur le viseur, face aux dernières secondes d'un pauvre bougre qui ne pensait pas finir ainsi, ou bien face à un mec rigolard qui n'attendait que ça ou qui n'avait jamais pensé que ça finirait aussi bien. Si, si, j'ai vu ça, je vous le jure. J'ai vu ça dans les restes du camp de concentration de Sachsenhausen où il y a un petit musée photographique avec un immense agrandissement d'un cliché représentant un peloton de SS dans la position décrite plus haut face à un résistant coiffé d'un magnifique béret de Chasseur et d'une cape idoine, la bouche fendue d'un sourire éblouissant. Ebloui, je suis resté sans mots pendant des minutes et des minutes, figé de je ne sais quel sentiment de joie profonde et réelle, le bonheur vrai, sans reste, au milieu de ce Grévin des horreurs.
Donc peloton, Feu ! Tiens, glomerus tout d'un coup me rappelle quelque chose ? Ah oui, glamourous, le glamour, mais oui. Glamourous, alors là je me marre alors carrément, comment des hommes ont-ils pu inventer un signifiant aussi vilain pour une chose aussi belle. On se retrouve devant le même problème qu'avec le mot gloire, avec lequel, d'ailleurs il doit y avoir connivence, c'est sûr. Glamourous veut vouloir dire : séduisant. Bon, on est tout près des définitions latines du mot gloria, et c'est aussi répugnant. Mai bon, c'est british, ce n'est donc pas notre problème, sauf pour les communicants et autres publicitaires qui commettent l'idiotie d'utiliser ce mot sur leurs affiches et dans leurs spots télévisés. On continue ?
Allons-y : glomerus (ha ha ha !), glomero, je glomère, du verbe glomerare qui signifie, je vous le donne en mille : mettre en pelote, en boule, en masse, en forme de boulettes (de figues ajoute-t-il sans rire), glomerare tempestatem, on rigole plus : amonceler une tempête. Strange. Jamais vu personne amonceler une tempête, mais bon, Dieu peut-être, ou les nuages, soit. Rallier une troupe pour combattre, bouh bouh, encore des militaires, toujours des militaires ! décidément, mon instinct poétique a de la puissance prophétique, je savais que derrière des sons aussi discordants que glou âââ rrr, il n'y avait pas grand chose de beau. La suite : rassembler, accumuler, voici Harpagon et son pognon, et pour finir, et ce pourrait être le mot de la fin : galoper. Mais le Gaffiot ajoute cette précision surréaliste mais au fond juste si on y réfléchit longuement et en pensant au chevaux : " en rassemblant les pieds ". Je suis mort, la gloire m'a tuer.
Pas tout à fait, je reprends mon souffle, parce que ça tire là-dehors, croyez-moi, et toute cette tempête à cause d'un mot qui me reste en travers de la gorge parce que son signifié me fuit depuis toujours. Non mais, ne m'en veuillez-pas, on a bien rigolé quand-même, non ? Et puis derrière toute cette rigolade, et toujours en remontant dans la colonne de la taxinomie des glo, je finis par trouver le fin mot de l'histoire des glo, glou, gloua et autre glaume : cette sonorité est à la base, au fondement, de tous les mots qui désigne la grégarité, le rassemblement en masse, en foule, en troupes fonçant sur l'ennemi ou sur la plage ou dans les rave-parties pour se frotter les uns aux autres, se fondre dans la glouarrrité du glomeratus et du glou-glou de l'humanité transformée en matière semi-liquide qui coule le long des autoroutes et se répand sur le sable chaud. Et surtout ne plus penser : mon string, mes lunettes de soleil et mon polar et ciao.
Mercredi 7 mai 2003
Bon fini de rigoler. Comme je l'attendais depuis quelques mois, le rythme des événements prévisibles n'est jamais connu du public même averti, le réel monte à la surface. Le contexte des relations transatlantiques change de nature et aussi d'importance : l'OMC vient de donner raison à l'Union Européenne contre les Etats-Unis qui est condamnée à payer quelques 4 milliards de dollars de dommages et intérêts à Bruxelles pour cause de protectionnisme sur l'acier. Le dossier stagnait depuis quelques années maintenant puisque la décision de Washington de taxer les aciers importés date d'avant le 11 septembre 2001 si je ne me trompe pas. Bien sûr cette décision, certainement très pénible pour les amis ultra-libéraux des Américains qui gèrent l'OMC à Genève, est assortie d'un délais qui devrait permettre aux Américains de sauver la face avant la fin de l'année, sauver la face veut dire trouver une nouvelle parade contre les Européens et l'Europe. Fini les prétextes saugrenus de s'en prendre à la " vieille Europe " et de lancer l'anathème à des pays qui prétendent respecter les Institutions Internationales pour la plupart créées à l'initiative du pays de l'Oncle Sam.
C'est dire si rien ne va plus dans le casino mondial, car les Américains ont toujours été persuadés, convaincus, absolument sûrs qu'aucune puissance économique ou financière n'arriverait jamais à les contrer dans les conseils d'administrations de ces institutions dont ils ont toujours été les actionnaires majoritaires. Mais voilà, ce temps est passé, l'Europe à elle toute seule contribue à présent pour autant que Washington dans les budjets de l'ONU, du FMI , de la Banque Mondiale, de l'Unesco, BTI, OMS et co. Le déséquilibre est rompu, alors que pendant trente ans la puissance fictive de l'Amérique était telle qu'elle ne payait même plus ses cotisations à l'ONU, sortait de l'UNESCO et se battait l'œil de touts les organisations qui s'occupaient de social, de maladie et de faim dans le monde. Aujourd'hui, peu de temps avant l'aventure irakienne (tiens, tiens !), Washington a apuré sa dette à l'ONU qui s'élevait à plus d'un milliards de dollars et demi, sans évidemment payer le manque à gagner en terme d'intérêts, c'est à dire tout l'argent perdu par l'ONU pour emprunter l'argent manquant pour intervenir sur tous les théâtres bien connus de ces dernières années. Si je me trompe, détrompez-moi.
Voici donc surgir le réel, la matière solide de la conjoncture qui s'envenime entre les deux continents. Oh ne c'est pas nouveau, la Politique Agricole Commune a produit de nombreuses guérillas juridiques entre Washington et Bruxelles, presque toujours gagnées à l'OMC par les States, notamment sur le dossier de la viande de bœuf aux hormones. Cela n'empêche pas que les ports européens restent fermés à cette viande et que nous préférons payer des amendes à Genève plutôt que de manger leur saleté. Mais les chiffres relatifs à l'acier, c'est tout autre chose, c'est un peu le cœur, avec le pétrole, du marché mondial et c'est surtout pour l'administration Bush une pression de politique intérieure énorme. La sidérurgie est le lobby le plus puissant, bien avant celui du pétrole qui, en réalité, n'a jamais connu de crise ni de menaces réellement dangereuses, alors que l'acier vit dans le risque depuis le début des années 70. Pourquoi ? parce que l'Amérique a fait la même erreur que tous les pays du monde dans le début des années cinquante : investissement massif dans l'acier, la perspective du secteur automobile semblait être une garantie sans limites de croissance de l'ordre de 6 % en moyenne par an pour cent ans. L'Europe, l'URSS, et l'Asie ont fait la même erreur (même l'Algérie qui s'est lancée dans l'acier en 1963 indépendance industrielle oblige). C'était aussi le temps ou Tito construisait ses propres automobiles, ainsi que les petits pays d'Europe centrale, sans compter le pays où les marques pullulaient, à savoir l'Allemagne. Or, si de ce côté-ci de l'Atlantique on a fait à partir des années 80 tous les efforts et tous les sacrifices nécessaires pour rationaliser le marché de l'acier (en Europe par exemple, on a fait des échanges et des sacrifices réciproques : l'acier pour le Benelux et l'Allemagne, l'Agriculture pour la France, etc… on a rien fait outre-Atlantique où on sait bien que l'on laisse vivre et crever les entreprises au nom du libéralisme sacro-saint tout en les aidant en douce parce que les conséquences sociales ne seraient, à partir d'un certain point, incontrôlables. Donc on aide tout le monde par des moyens moins voyant et plus détournés qu'en Europe, mais on plaide officiellement pour la guerre aux subventions. L'exemple le plus classique, les professionnels m'excuseront, est le financement étatique direct de la recherche technologique (notammenvt la NASA) dont les résultats sont transférés gratuitement au secteur privé de la construction aéronautique.
Donc, encore quelques mois de patience, et le drame va prendre une tournure tout à fait nouvelle, il va descendre dans les mass-média, la querelle à propos de l'Irak n'aura été qu'un galop d'essai. Puis viendra sans doute un processus de ruptures en série qui aboutiront forcément à un protectionnisme affirmé de l'Europe à l'égard des puissances dépendantes de la ligne de l'actuelle Maison-Blanche. Car il ne faut jamais oublier que malgré tout, les locataires de ce bâtiment curieusement épargné par les avions de Ben Laden, changent parfois. Du temps de Clinton, les choses s'arrangeaient toujours et les fromages et les vins français n'ont jamais manqué dans les restaurants de NY ou de LA. Avec Bush il faudra attendre la fin pour savoir si l'Europe va être contrainte de se lancer dans l'aventure de l'indépendance réelle, de la majorité politique et de la volonté propre, mais aussi du sacrifice d'un marché juteux et facile. Pour ma part je connais la réponse, mais chutt… !
Jeudi 8 mai 2003
Pour hier, reportez-vous au Financial Times de ce matin, comme quoi même moi je peux avoir de l'avance sur le meilleur quotidien d'information du monde (paraît-il…).
Bon, je voudrais rapidement revenir sur l'affaire du non-être (voir lundi 5 mai), car certain discours entendu du côté de Strasbourg stagnent dans mon oreille interne de manière fort désagréable. Il faut dire que j'ai été presque nul dans ma réponse tout en soulignant le fait qu'on ne peut pas répondre à une peinture, on ne peut pas construire une antithèse contre une non-thèse, contre une mosaïque de remarques décousues sur l'inexistant et le néant. Le sujet débattu était intitulé " de l'inexistant au néant ". Je n'ai compris l'argument, si on peut appeler cela un argument, que lorsque son auteur a précisé qu'il s'agissait de la parenthèse de la vie qui se tient entre " l'inexistant avant la naissance, et le néant après la mort ". A propos de quoi il a dit à peu près tout et n'importe quoi, se contentant d'une sorte de pastel mélancolique sur la futilité essentielle de toute chose. Bof, une seule ligne de Cioran ou de Schopenhauer suffirait à remplacer ce discours qui a quand-même duré sa petite demi-heure.
En fait, j'aurais dû être beaucoup plus brutal : toute parole qui prétend se prononcer sur le non-être ou autre néant est pur bavardage, bavardage signifiant ici non-parole, non-discours, silence bruyant. Pourquoi ? Parce que le logos, la pensée et la parole portent toujours sur de l'être, ne peut porter que sur de l'être. J'ai bien rappelé que Parmenide avait prévenu en disant que penser et être étaient UN, étaient la même chose, mais ce genre de dit n'est jamais compris. Cela me fait presque penser qu'il faudrait légiférer sur l'usage du langage une fois pour toute et mettre les infractions sémantiques au pénal. Car le langage est comme une constitution qui contient les fondements du réel politique : la naissance du sens est consubstantiel de la naissance du langage, or le sens ne porte pas sur des fantasmes, mais sur le réel : on ne peut pas jouer avec les mots pour fabriquer n'importe quelle martingale véritative car les mots sont des représentants pour ainsi dire soudés au réel, liés à la parousie de la réalité. Le mot non-être ne peut pas vouloir signifier car avant l'être il n'y a pas de mots, aucun mot. C'est bien la raison pour laquelle les mystiques du Moyen-Âge désiraient revenir en-deça de la naissance des mots, pensant ainsi pouvoir revenir au point de départ créateur de réalité, c'est à dire Dieu. Le nihil negativum, mais on pourrait aussi dire le nihilisme moderne, se pose comme un trou noir qui aspire la matière pour la rendre à son origine, la nudité ou l'absence de forme de l'être avant la création. A partir de quoi on peut tout faire, y compris tout démolir y compris l'humain, ce que certains ne se sont pas envoyés dire peu de temps après Nietzsche.
Ou alors, comme le souligne très bien Heidegger dans son commentaire sur le Sophiste, on se tait, c'est à dire on admet que parler du non-être et se taire sont pareils.
Vendredi 9 mai 2003
Ne pensez pas que je méprise la politique intérieure française même s'il est vrai que je n'y consacre guère de temps ni de place dans mes chroniques ces derniers temps. Aussi vais-je faire un effort aujourd'hui pour vous faire une esquisse de ma vision de ce qui se passe à quelques jours de la grande journée des syndicats contre les projets de réforme de la retraite du gouvernement Raffarin.
Par quoi commencer ? Le fond ou la forme ? Les images ou la réalité ? Il y a toujours dans l'opinion publique une sorte d'image globale du présent qui domine et qui change au gré des modifications impérieuses que lui infligent les médias et ce qui reste aujourd'hui de ce qui passe encore pour du journalisme. Nous commencerons donc par cette image, cela nous permettra au moins de donner un cadre à une analyse plus détachée des contingences de l'événementiel.
Dans quelle image pataugeons-nous aujourd'hui à propos de la situation française ? Difficile à dire de mon seul point de vue, il faut que je fictionne une représentation qui ne me concerne que de très loin, bien que je ne prétende en rien me soustraire à la force de cette " in-formation " au sens aristotélicien du terme, c'est à dire à cette machine à donner précisément à ce présent sa forme. Comme chacun d'entre-nous appartient à ce présent, je ne vois pas comment et qui pourrait échapper à une image qui, elle aussi en fait partie. Il faut donc peindre avec soin et méthode, en rendant compte du cadre, du fond, des nuances formelles et aussi de la place que nous occupons dans le tableau.
Alors d'abord le cadre et le fond. Je vois ces deux éléments de manière parfaitement contradictoire, et j'ajoute que cette vision est déjà très ancienne et qu'elle semble ne se modifier que très lentement ou alors par des à-coups brutaux induits par des événements qui dépassent la réalité française et même européenne comme par exemple la guerre qui vient de ravager l'Irak. La contradiction est la suivante : d'une part nous baignons incontestablement dans une ambiance de crise permanente. Aussi loin que remonte ma mémoire, je n'ai jamais connu de présent non représenté comme crise. Je rappelle ce que je dis souvent ici, je n'ai jamais connu les Trente Glorieuses dont on parle si fréquemment. Au plus beau des années cinquante et soixante, les titres qui faisaient l'opinion n'en ont jamais fait mention, ce qui prouve qu'il s'agit d'une invention a posteriori qui a son usage et sa valeur dans le présent, certes, mais qui n'a jamais eu de présent en tant que tel, c'est à dire en tant que vécu par les Français. Je pense qu'il est inutile de vous demander d'aller consulter les titres des quotidiens de l'époque, je suis péremptoire : vous n'y trouverez jamais à la Une des propositions du genre :- " AH QUE NOUS SOMMES HEUREUX ! " -. De l'autre côté je suis surpris de constater hier comme aujourd'hui et aujourd'hui comme hier, que la vie continue exactement comme si tous ces discours n'existaient pas. Dès la fin des années quarante, l'Abbé Pierre s'est mis à faire du foin pour venir en aide aux SFD, soixante ans après le problème en est au point mort, si on en croit les informateurs. Dans ma petite bourgade de Riedisheim, j'en ai déjà parlé, les voitures neuves sillonnent les jolies petites avenues boutonnées de ronds-points en veux-tu en voilà, les rares piétons de la semaine foulent une zone piétonne de porphyre rouge sans même s'en rendre compte, se rendre compte du prix du porphyre italien au mètre cube. Chaque mercredi, le marché attire riches et pauvres, les riches pour la marchandises, les pauvres pour le sourire et la convivialité ou le dur travail du maraîchage ou de la vente au détail de camelote à deux sous. Nihil novi sub sole.
Bref, vous m'avez compris, la crise se porte plutôt bien. Récemment il y a eu un véritable scandale dans mon immeuble HLM dont j'occupe un quatre pièce du quatrième étage : l'ascenseur est resté en panne pendant trois semaines !! Mais n'allez pas croire qu'il s'agissait d'une quelconque mauvaise volonté des responsables ou d'une tortueuse manière de gagner quelques sous sur le dos des locataires par négligence ou mépris, non non, il s'est agi d'incompétence passagère et au demeurant pardonnable puisque la panne ne provenait pas de la machine (neuve) mais de l'alimentation en électricité (obsolète). Depuis trois jours, tout est rentré dans l'ordre, et les courses remontent vers les étages supérieurs dans le silencieux confort d'un appareil sans histoire. Raté la crise. Bon, à présent, jetons un coup d'œil à droite et à gauche sur le sort des uns et des autres : le chiffre des chômeurs augmente, il est vrai, mais il est encore loin des trois millions et demi, record absolu des années quatre vingt dix. Le pouvoir d'achat a toujours eu une tendance à la baisse, mais là aussi, je dois admettre que les efforts consentis par les militants de toute catégorie, certains événements frappant comme Mai 68 et décembre 95, sont toujours venus redresser la barre pour faire en sorte que malgré tout, on vit. Mal, dit-on, mais on vit à peu près comme le suggère ma description précédente de Riedisheim. Alors on va me dire, hé et les quartiers de la zone, et les zonards, et les immigrés qui chôment parce qu'ils s'appellent Ahmed ou Ali, et ces quartiers un peu négligés où on s'entasse dans des maisonnettes du début du siècle passé ? Je réponds, désolé, mais ces ruelles qui abritaient les maisonnettes d'entreprises déjà au dix-neuvième siècle, sont peuplées de fort belles automobiles, telles que je ne pourrais m'en offrir, moi qui bénéficie d'un revenu régulier et, somme toute, acceptable. Et puis les maisonnettes un peu défraîchies s'ornent toutes de " poêles à frire " de première catégorie, de quoi recevoir en direct toutes les télévisions du monde, alors que moi, je me contente du câble et de trois chaînes du TPS.
Et puis comme je circule de préférence en bus, je peux me frotter à ce supposé lumpen prolétariat de jeunes qui menacent la République, et je constate que ces enfants sont fort bien vêtus, portent des vêtements de " marque " que je n'oserais même pas porter dans la colonne vêtement de mon propre budget. Bref, la crise tarde à montrer le bout de son nez. Bon, je ne suis pas partout, et surtout pas dans les perspectives qu'ont toutes ces personnes que je croise ici et là, dans la rue, dans les trains, dans les bistrots, dans ma famille et ailleurs. Pour ma part, c'est à dire pour ce qui me concerne (car je ne suis pas seulement un observateur, mais aussi un acteur), la crise est bien en vue, cela je ne peux pas le nier. Et cette crise s'appelle bel et bien la Retraite, retraite qui doit prendre effet pour ce qui me concerne le Premier janvier 2005. Et là, premier caillou dans le jardin de mon optimisme invétéré, je balise. Je balise car les chiffres que l'on m'a annoncés sont effrayants, et je ne sais pas encore comment je vais survivre à mon changement de régime. Il va falloir que j'y songe très sérieusement pour deux raisons essentielles : primo il faut que je puisse continuer à survivre, c'est à dire payer mon loyer et ma nourriture, secundo il faut que je puisse continuer de faire ma chronique et gérer ma connexion, ce qui est loin d'être assuré même avec l'aide de mon amie. J'ajoute qu'après analyse, je dois cette catastrophe personnelle à deux facteurs mortels : l'émigration et les lois Balladur. J'ai travaillé toute ma vie, mais une grande partie de cette vie s'est passé à l'étranger, dans des pays qui ne pourraient même pas me verser une retraite même s'ils le voulaient. Quant aux lois Balladur, elles me frustrent de vingt et quelques années de cotisation de cadre ramenées à la portion congrues par le nouveau calcul sur vingt ans. Pour rappel, j'ai commencé à FR3 à moins de 5 000 FF par mois (762 Euros) pour terminer à Arte avec un salaire d'environ 24 000 FF (3658 Euros). La péréquation n'est évidemment pas la même sur les trois dernières années que sur les vingt dernières. Calculez vous-mêmes.
Croyez-moi, je serai dans la rue le 13 du mois prochain, je n'ai même pas le choix, et alors là je peux vous dire que je ne serai pas seul, car la loi Balladur n'a pas qu'un seul cocu, nous sommes des divisions entières de cocus et nous ne l'enverrons pas dire à Monsieur Raffarin. Les choses sont d'ailleurs très différentes de la présentation qu'en fait la presse et la télé. Les gens ne descendront pas dans la rue pour protester contre la réforme qui risque d'aggraver notre sort, mais pour hurler leur rage devant les conséquences déjà présentes des lois Balladur. Et c'est pourquoi aucun écran de fumée ne parviendra à freiner ou à dissuader ou à calmer l'opinion, même pas la paresse structurelle du Français moyen lorsqu'il s'agit de manifester. Car ce qui va m'arriver dans un an et demi, est déjà arrivé à des centaines de milliers de personnes : il y a cumul de dommages, et le cumul ça ne marche jamais, on ne peut pas visser indéfiniment, disait Badinguet (Napoléon III), en politique il faut toujours être à même de faire comme si on dévissait. La Réforme Raffarin est donc, à mon point de vue, le point de rupture de la vis, raison pour laquelle quelques syndicats ont déjà parlé de grève illimitée, sans doute sous la pression d'une base qui, pour une fois, ne se laissera pas museler.
Reste deux énigmes pour les jours à venir. La première est la raison pour laquelle les syndicats, une fois de plus, se divisent sur ce mot d'ordre, division qui pose toujours l'éternelle question de la manipulation : les syndicats veulent-ils la peau de Raffarin ou se contenteront-ils d'une feria un peu bruyante, histoire précisément de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain ? Car il ne faut jamais confondre la volonté des syndicats avec celles des gens de la rue. Les syndicats ont avant tout à défendre leur être propre, c'est à dire la place qu'ils ont dans le wellfare state français qui les nourrit, les loge, les transportent en première classe et leur assure une retraite que bien des salariés lambda envieraient s'ils les connaissaient. Ce seront donc les gens eux-mêmes qui décideront, dans la rue et dans les entreprises publiques et privées, s'il faut faire une grève comme ceci ou comme cela. Pour ma part, ma religion n'est pas faite, car je soupçonne le gouvernement de nous jouer une véritable comédie destinée à projeter beaucoup de fumée autour de ce qui se fait en silence dans les cabinets où on rédige déjà les décrets d'application des lois liberticides comme cette décentralisation dont on a pas fini d'essuyer les plâtres si on ne fait rien pour y mettre un terme. Donc, Raffarin me paraît tout à fait prêt à jouer la comédie de la résistance bidon, puis du recul plein de sagesse et de dialogue (entrepris dès que ça commencera à se gâter) à propos de la question des retraites puisque l'essentiel a été fait par Monsieur Balladur. En rajouter est proprement inimaginable, d'autant que la vérité sur l'avenir démographique de la France finira bien par sortir, vérité qui réduit à peu près à néant toutes les projections catastrophistes. Sauf à penser une autre vérité, c'est celle de la disparition du travail, ce que personne ne veut admettre, et pourtant, il le faudra bien un jour, mais ça, c'est une autre crise. Une seule par jour suffit à ma peine. RDV le treize mai.
Samedi 10 mai 2003-05-09
Quand je vous le disais, qu'une seule crise par jour suffit largement : figurez-vous, mais vous l'avez sans doute déjà appris, l'Italie de Berlusconi veut vendre son patrimoine culturel et artistique au privé ! Vous voyez ça d'ici, Le Colisée s'envoler pour le Texas ! Et pourquoi pas Saint Pierre ? Cette information m'assomme littéralement.
Mais elle n'a rien d'étonnant, à vrai dire. Cette idée annonce la liquéfaction de la culture comme représentant un territoire, comme son reflet et son histoire. Elle est le même geste que celui des armées de la coalition (je ne suis pas prêt d'oublier que la Grande Bretagne s'est rendue coupable d'un tel crime) qui ont laissé piller les musées de Bagdad : l'Histoire doit disparaître. Pourquoi ? Elle gêne parce qu'elle indique forcément un désir collectif, le désir métaphysique qui sous-tend, quoiqu'on veuille, le présent. Nous vivons au cœur de la tragédie du renoncement à ce désir, renoncement aveugle, aussi aveugle que le renoncement à une temporalité sans histoire qui a eu lieu précisément là-bas du côté de Bagdad.
Mais il y a deux versants dans l'explication comme il y a deux possibilités de conséquences à un geste qui est entamé, en réalité, depuis longtemps. Le premier est l'occultation de la raison du présent : plus d'histoire, plus de coupables, la loi disparaît au profit d'une jurisprudence aléatoire, le présent est déconstitutionnnalisé. Bien sûr, ce n'est que l'état abstrait rationnel qui disparaît ainsi, laissant la place à l'état des faits qui s'enroulent les uns dans les autres. En Afrique, par exemple, la disparition des états a déjà produit une régression temporelle vers un traitement privé et anarchique des faits : dans la phase de la colonisation, les blancs monothéistes avaient pris pour prétexte les massacres tribaux et claniques pour s'emparer des territoires. Dans le principe, la décision de Bush de liquider Saddam Hussein part du même préjugé religieux qui donne aux puissances " civilisatrices " le droit de contraindre le reste du monde au respect du décalogue. C'est le fameux " droit d'ingérence " de Monsieur Kouchner. Or le décalogue, on le sait, n'a rien réglé quant au fait de tuer des hommes : le meurtre individuel, tribal ou clanique, s'est transformé en meurtre collectif nommé guerre qui a trouvé son climax dans le génocide. Les conséquences liées à cette disparition se présentent comme le démantèlement de l'autorité territoriale en autorité économique, puisque les faits n'ont plus d'autre critère ni sens.
Le deuxième versant nous dit que la liquéfaction de la culture ouvre la possibilité d'un homme nouveau qui reprendrait en lui la constitutionnalité du présent. Mais il ne dit pas plus, hélas ! Ce serait le tribut que la civilisation doit payer à la barbarie selon l'idée exprimée par Camus, avec tous les risques que comporte un tel paiement. Mais on ne peut pas exclure le risque du réel sans prendre l'autre risque de stériliser le présent. A propos de stérilisation, la Chine me semble avoir entamée son Xième retrait de la mondialité en inventant, cette fois, un mécanisme imparable d'isolation automatique telle qu'on n'en plus connue depuis les épidémies de peste du Moyen-Âge.
Lundi 12 mai 2003
La dicité. Ne cherchez pas dans votre dictionnaire même si c'est le Littré en vingt volumes, vous ne trouverez pas ce néologisme qui provient d'une traduction de l'Allemand, et encore pas n'importe lequel, vous avez compris, celui de Heidegger. Je n'ai pas l'original, mais je suppose assez bien, je pense, qu'il s'agit de " die Sagenheit ", pur néologisme en lui-même déjà, des comme seul le penseur de Fribourg savait les tourner. Or, à peu près de la même manière que ce même homme disait que le destin de l'occident tenait à la traduction d'un seul petit mot grec, le mot on, qui signifie en gros le mot être, il aurait pu dire que le destin de son œuvre dépendait de sa dicité, et encore davantage de la compréhension par ses lecteurs et auditeurs de ce néologisme. Lévinas, qui suivit assidûment les cours de Heidegger, a largement repris à son compte toute l'hypothèse qui gît derrière ce mot étrange, et d'abord derrière son radical qui n'est autre que le participe passé de dire, (le) dit, ou encore la troisième personne du singulier décliné au présent : il dit. Mais chez lui il ne faut pas aller bien loin pour trouver l'absolu du Dit, ou alors disons très très loin dans la Thorah…
Ce mot je l'ai pêché au beau milieu du commentaire du Sophiste de Platon fait par Heidegger au début de sa carrière et dont j'ai eu le bonheur de trouver une traduction toute récente chez Gallimard NRF, celle de Jean-François Courtine, un traducteur sincère, mais dont j'ai déjà eu à mettre en doute quelques extrapolations douteuses dans Interprétations Phénoménologiques d'Aristote. Au beau milieu dans le sens essentiel de l'expression, à savoir au tournant véritable du commentaire, au sein de sa substance. A la page 392 du livre, Heidegger en arrive enfin à Platon, ce qui précède étant entièrement consacré à une sorte de préparation d'artillerie aristotélicienne, un commentaire qui fixe le vrai cadre de la compréhension heideggerienne de Platon. Platon, ne l'oublions pas, vient en amont d'Aristote, ce qui fait dire au philosophe allemand que Platon parle encore dans l'entente grecque originaire de l'ontologie, mais sans les outils parfaits mis au point par Aristote quelques décennies plus tard, outils qu'il convient donc tout d'abord d'offrir à tout lecteur de Platon avant d'aborder le dit même du dialogue de Platon. Quelques cent trente pages plus loin nous arrivons à la fameuse " dicité ". De quoi s'agit-il ?
Nous en sommes à la partie du dialogue entre l'Etranger et Théétète où est abordé la difficulté majeure, celle qui concerne l'énoncé sur le non-être. Heidegger donne à ce chapitre lui-même le titre inquiétant de " obscurités fondamentales ". Il faut bien connaître ce penseur pour comprendre immédiatement que seul le " fondamental " reçoit quelque clarté, de même que seule l'obscurité ou l'occultation provoque à l'éclaircie. Il n'y a donc pas de paradoxe ici, seulement l'annonce qu'on arrive au cœur du sujet, du dialogue et de son commentaire par Heidegger. Et en effet, la phrase qui est ici mise en perspective analytique est cette interrogation qui explose d'un seul coup : -" que pouvez-vous bien entendre par le sens de être quand vous prononcez le mot on ". Toute personne qui un jour s'est préoccupée de la question de l'être, encore qu'il me paraît idiot de dire un jour, car dès lors qu'on a seulement touché cette question elle ne peut plus disparaître de l'horizon comme l'écume d'une vague, est tombé un jour ou l'autre sur cette difficulté fort bien énoncée dans le Sophiste : en gros : quelle place occupe le langage dans la relation de l'homme à l'être ? Rappelons, avant d'aller plus loin, que les pragmatiques américains estiment que l'être est un abus de langage, une fantaisie linguistique sans aucun intérêt, et d'une certaine manière il leur est même possible de s'appuyer sur le texte de Platon pour le démontrer puisque le Sophiste est précisément celui qui joue avec les mots. Or, dans le dialogue de Platon, on ne sait pas très bien jusqu'où va la critique du sophiste, ou bien plutôt jusqu'où elle ne va pas. C'est la raison, sans doute, pour laquelle Heidegger se sent contraint de faire appel à Aristote pour remettre le wagon sur les rails, car si les intentions de Platon restent de part en part floues, on ne peut pas accuser Aristote d'avoir traité la question de l'Être par quelque flou que ce soit.
Dans le commentaire de la question posée plus haut, Derrida aurait sans doute appuyé d'abord sur le mot entendre et sur l'expression complète " entendre par le sens de " puisque dans son commentaire de Husserl intitulé " La Voix et le Phénomène ", il accuse la métaphysique jusqu'à Husserl compris, d'attribuer à l'oreille le privilège de la captation du sens. Phonème contre graphème. Mais il me semble que Heidegger soit plus difficile à piéger que Husserl, dans la mesure où l'entente heideggerienne n'a que peu ou rien à voir avec l'organe de l'ouïe, ce qui n'est pas le cas chez Husserl qui donne effectivement une prime d'immédiateté à l'oreille sur tout autre sens, prime d'immédiateté signifiant en fait quelque chose comme intimité (avec les signes qui proviennent de l'être lui-même par le canal des sons). L'entente heideggerienne c'est tout autre chose, ce n'est plus une simple sensation, c'est d'abord un accord, une entente au sens de l'alliance ou de l'amitié lorsque cette entente est " bonne ". Et ensuite seulement, lorsque naît l'objectivité ou si l'on préfère la subjectité, quelque chose comme de la compréhension, de l'éclairci(e)(ssement). Bref, entente et éclaircie vont toujours ensemble. Je dis tout cela seulement parce qu'il s'agit d'une traduction faite par Heidegger lui-même du texte de Platon, traduction où apparaît le mot entente à une époque de la carrière du philosophe où celui-ci est encore classé comme phénoménologue à part entière et disciple univoque de Husserl. Je pense donc que déjà dans ce commentaire, Heidegger ne fait plus du tout allusion à l'entente husserlienne de l'être, mais est déjà tout à fait ailleurs, en fait déjà à l'autre bout de son œuvre, déjà au-delà de Etre et Temps.
Donc Heidegger analyse cette question qui parle de l'entente " par le sens de être " (note : je suis désolé, mais je ne dispose pas de l'édition allemande, je ne peux donc rien dire sur la traduction de JF Courtine, mais à ce point-ci, je lui fait une totale confiance). Le sens de être donne à entendre, et il donne à entendre lorsqu'on prononce le mot on, le mot être en grec. Mais que donne-t-il à entendre ? Pour le savoir, ou pour interroger ce qu'il donne à entendre, Heidegger fixe un cadre analytique en quatre directions :
1- le quid thématique, l'objet, l'être.
2- le contenu propositionnel c'est à dire le dit sur l'être.
3- les caractères de la dicité, de l'être-dit (nous y voilà !).
4- l'exprimé en tant que tel, c'est à dire l'être-énoncé.
Voilà, tout est là. Pour ma part j'interrompt volontairement ma lecture à ce point, non seulement par pur jeu, mais parce que je veux pouvoir vous éclairer avec mes mots, et ne pas risquer de reprendre à mon compte les développements ultérieurs de Heidegger lui-même. En revanche je vais remonter en amont du texte, légèrement, car cela me paraît indispensable. Quelques lignes plus haut, en effet, Heidegger qui avait parlé d'obscurités fondamentales à propos de la possibilité d'énoncer le non-être, le mè on, les avaient également classées en trois catégories ou comme on veut appeler ça, à savoir :
1- l'obscurité du concept de " ne pas… ". En effet comme peut-on dire de l'être qu'il n'est pas quelque chose ? Qu'est-ce-que la négation ?
2- l'obscurité relative à la distinction entre on en tant qu'être et on en tant qu'étant.
3- L'obscurité générée par l'histoire singulière de chacun des termes utilisés pour parler de l'être, à savoir l'on, le èn, le ti (être, Un, la chose en question). On connaît les batailles philologiques qui forment le fond de commerce de la plupart des philosophes et qui reposent toutes sur cette obscurité-là.
A présent, rappelons pour mémoire que le Sophiste est logiquement relié au Parménide, et qu'il traite donc du même quid thématique, du même objet : l'être et la possibilité du non-être. Selon la tradition largement soulignée par Heidegger, Parménide domine encore lourdement l'horizon de pensée des Grecs à l'époque où Platon atteint son acmé. Le Sophiste, comme le Parménide, sont donc des textes " subversifs ", surtout le Parménide, encore que bien compris, il révèlerait plutôt la perplexité de Platon face à Parmenide qu'une avancée réelle dans la question de l'être au sens de l'ousia platonicienne. Ici comme là, la question de l'être se déplie selon la logique de l'Un et du multiple telle qu'elle est déclinée dans le langage. Or le langage a le pouvoir de faire à peu près n'importe quoi, n'importe quelle mise en scène dont le caractère sophistique ne saute pas aux yeux et qui repose toujours sur une identification de l'être et de l'Un qui ne semble tolérer aucune multiplicité immédiatement interprétée comme la porte ouverte à la possibilité du non-être. Si on dit que l'on est un autre sémantème que l'èn on a créé quelque chose qui " n'est pas l'on ", qui est autre chose que l'être. De plus, la notion de l'Un peut se présenter dans le langage sous l'aspect de l'olon, à savoir d'une totalité, d'un tout qui se conçoit logiquement comme l'assemblage de parties (cet argument est au centre du dialogue intitulé Parménide). Or qui dit parties dit multiple, contraire de l'Un. Dans le Sophiste (traduction E.Chambry, ed. GF poche), le Xénos, l'Etranger demande : -" Reconnaître qu'il y a deux noms, après avoir posé qu'il n'y a que l'un, c'est quelque peu ridicule " - . Ridicule ! Mot extrêmement fort dans un tel contexte. Mais le ridicule se renforce encore lorsque l'Etranger insiste en soulignant que, je cite toujours le même texte : - " poser que le nom est autre que la chose, c'est dire qu'il y a deux choses " -. Et que répondre à cela ? Comment donc se tirer d'un tel pétrin ? Comment sortir de ces obscurités qui, quoique fondamentales, n'en demeurent pas moins de véritables énigmes ? Heidegger propose donc de faire les catalogues des difficultés afin de trouver l'articulation qui rende à la parole de Parménide son évidence première.
La première de ces obscurités porte sur la manière de concevoir la négation. Le ne pas… est la première des obscurités, lorsque par exemple on dit que l'un n'est pas le tout. Nous tombons ici, comme également plus tard, sur la différence entre ce qui peut se décrire comme une définition de l'étant d'une part et la fonction de copule qui attribue certaines qualités à un quid, à un sujet ou à une essence d'autre part. (Cette obscurité-là nous renvoie par avance à celle qui opposera dans le second catalogue l'on comme être et l'on comme étant). Le problème est certes qu'on ne peut pas procéder à une quelconque attribution à l'être faute d'y introduire immédiatement la multiplicité. Mais voyons l'exemple de plus près : on dit l'être n'est pas le tout etc…, or cette proposition est une prétendue définition, alors que l'être en tant que tel n'a pas besoin, ne tolère même pas la moindre définition. Ce qui nous renvoie directement à la fameuse dicité du mot être, c'est à dire en somme à son autonomie absolue, une autonomie qui se passe absolument de toute définition, de toute adjonction conceptuelle : l'être est le CONCEPT en tant que tel, l'arkè de toute conceptualité, son origine et sa cause (causa sui), et à ce titre il ne peut se voir relié à aucun autre concept qui ne peut jamais être autre chose qu'un reflet proche ou éloigné du concept premier. La primarité ou le caractère principiel du concept d'être est la seule transcendance qui se présente paradoxalement comme un fait immanent.
La deuxième nous l'avons déjà évoqué deux fois : l'on désigne-t-il l'être ou bien signifie-t-il l'étant ? Pour nommer mon site, j'ai précisément choisi l'expression d'Aristote on è on reprise abondamment par Heidegger et qui ne répond en rien à cette obscurité autrement qu'en laissant libre l'accès à la réponse. Platon choisira la deuxième : on = étant, réservant la notion d'être au verbe eïnai ce qui semble a priori indiscutable. Or, si on étudie de près l'expression on è on , l'étant en tant qu'étant, il apparaît qu'elle rassemble absolument les deux sens en question : dans le tout premier texte de ce site, je rappelle que l'étant est une notion impossible puisque le participe présent ne reçoit pas le mouvement du temps. Mais ce participe présent devient possible dès lors que l'on précise qu'il est étant en tant qu'étant, c'est à dire soumis à l'action de l'être. En bon immanentiste spinozien que je suis, cette obscurité ne me pose aucune difficulté, l'étantité de l'être et l'être de l'étant me paraissant parfaitement synonymes. Dans mon premier texte, celui qui précède le Troisième Entretien Préliminaire, j'avais tranché en disant qu'il n'y avait rien d'autre que de l'étantité, voulant signifier ainsi que l'ontique est l'élément de l'être, qu'il en est inséparable absolument et totalement. Je refoulais ainsi définitivement hors de toute possibilité de spéculation la transcendance d'un être substantivé et qui " existerait " séparément du monde perçu, de l'étant ou des étants, de la chose.
L'obscurité liée à l'histoire du langage, je la laisse simplement tomber, car je n'ai rien à en dire, du moins je n'ai rien pour nourrir le débat, aucune érudition suffisante pour prétendre distinguer l'usage de tel ou tel mot dans l'histoire de la langue grecque. Il est certain que cette histoire demeure fondamentale dans la mesure où le mot premier se rapproche au plus près de l'arkè, de la fameuse causa sui, c'est à dire au premier énoncé du Concept Premier de l'Être. On peut supputer à l'aide des quelques petites connaissances qui m'échoient, que la notion de l'UN précède (c'est il me semble la thèse de Heidegger) celle de l'être, ce qui me paraît assez logique dans la mesure où la notion d'être ne peut pas surgir sur fond de multiplicité. L'unité du monde est le seul fondement possible d'une notion supérieure et qui contient cette unité en la dépassant, celle de l'être, car à l'UN vient s'ajouter l'aperception humaine qui contient le mouvement et le repos, la fixité et le mouvement, l'énergie (energeïa) qui n'est ni fixe ni mouvante.
Je laisse également tomber les subtilités grammaticales (j'y reviendrai ailleurs) qui désignent ce que Heidegger appelle le quid thématique, le contenu propositionnel et l'exprimé en tant que tel ou l'être-énoncé, subtilités qui n'en sont pas et sur lesquelles nous retomberons fatalement en revenant directement à la dicité, le numéro 3 du second catalogue des obscurités fondamentales, c'est à dire des occasions d'éclaircie. Alors, la dicité ? Quid de la dicité ? Dans son petit catalogue, Heidegger fait allusion rapidement au fait que l'être appartient au legein, non pas au logos au sens classique du terme, la raison, mais au legein au sens de l'être-dit, c'est à dire de l'acte qui découvre l'être. Cette obscurité est la plus noire, la plus dense et donc la plus éclairante : le logos originel est tout entier contenu dans la découverte de l'être, dans l'être découvert dans l'obscurité du logos en tant que langage. La sophistique joue avec le pouvoir du langage de couvrir les faits, de disposer du même instrument qui dé-couvre afin de couvrir. Et pourtant ce pouvoir de couvrir, en fait simplement de mentir, ne touche en rien à la dicité originelle de l'on. Le dit de l'être a tout simplement eu lieu, comme aurait eu lieu la Révélation, à condition qu'il faut ici entendre l'expression " le dit de l'être " dans son double génitif subjectif et objectif. Le dit de l'être est bien un mot prononcé par un homme, un jour, mais il est aussi un dit de l'être lui-même puisque en disant l'être, l'homme a dû se rendre immédiatement compte qu'il appartenait lui-même à l'être, qu'il en / y participait, et que par conséquent il n'était pas possible de laisser le dit dans l'unilatéralité du bavardage d'un représentant de l'espèce humaine. Comme je le dis ailleurs, Parménide n'était certainement pas l'inventeur de cet être non mêlé aux éléments ailleurs considérés comme fondamentaux (l'air, le feu, la terre ou encore le sec et l'humide etc….), éléments non concevables dans leur primitivité même sans la domination du primitif, de la causa sui en tant que telle.
Je veux dire par là que le concept d'être est le seul point de départ possible pour toute recherche de principes, et je dis bien le concept d'être, et non pas un usage linguistique d'attribution (la copule) qui aurait soudain pris le dessus de la mêlée. Parménide, je le répète, ne fait que revenir aux sources de toutes les évaluations ontologiques que nous connaissons à partir d'Anaximandre, lequel ne pouvait en aucun cas déterminer l'Apeïron (le chaos) comme fondement absolu de l'univers sans avoir au préalable acquis la notion même de fondement. Or le seul fondement est l'être. Au demeurant, il me paraît également évident que la fonction copulative du verbe être demeure postérieur à son dit ontologique : autrement dit le don du dit est cela seulement qui a permis l'établissement de relations logiques et catégorielles entre les choses, et la découverte progressive de l'objectivité comme différence ontico-ontologique, ontico-existentielle. La dicité de l'être c'est donc le pouvoir de l'être de pénétrer dans la relation ontico-ontologique qui se trouve préinscrite en l'homme comme on et comme on è on. En ce sens, la dicité rejoint la force autonome ou la maîtrise de la Révélation du monothéisme, car elle se passe de toute attribution ontique, puisque n'importe quel étant doit d'abord être avant de devenir objet pour l'homme ou pour la conscience. Le monstre n'est rien d'autre que l'objet révélé dans toute sa nudité, c'est bien pourquoi les Dieux de l'Antiquité sont tous des monstres et que Schelling a génialement raison de penser que la Révélation est le processus même du polythéisme s'accomplissant. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que la Révélation bloquait le processus ultérieur d'objectivation libéré par le dit de l'être en le soumettant à l'unique objet de la transcendance divine. Raison profonde de l'échec répété du judaïsme dans sa tentative de sédentarisation, décision d'une fixité que pouvait assouplir le sacrifice du Fils à la condition non respectée de le laisser rester exclusivement homme. Mais le Concile de Nicée en a décidé autrement, refoulant ainsi le nouveau monde dans un mixte inextricable et sans fin où semble alterner fixité et mouvement, cela même que nous appelons aujourd'hui réaction et progrès. Le même désordre se reproduit dès lors partout et à commencer par le langage où objet, énoncé et contenu propositionnel se confondent avec la dicité dont on peut peut-être retenir en premier lieu qu'elle est force, énergie de liaison, une liaison qui trouve son entéléchie dans le mot décisif d'être.
Note : ce texte est une note de lecture qui prendra sans doute place dans l'ouvrage que je prépare par ailleurs sur Être et Histoire ou l'Usure de l'Être.
Mardi 13 mai 2003
L'être est. Même Aristote a fini par l'admettre d'une certaine manière en évitant de prendre parti dans le faux débat introduit par Platon entre les matérialistes qui cherchent le " sens " de l'être dans le corps, le soma, et les idéalistes qui cherchent la même chose du côté de la connaissance, du noeïn et de l'idée. Alors qu'il n'y a pas de sens à chercher, l'être est le sens lui-même. L'expression " sens de l'être " est le premier dédoublement de l'être en être et non-être. Je suis resté moi-même longtemps piégé par cette fausse manière de poser la question de l'être. En réalité la question de l'être n'est pas celle de son sens, mais celle des conséquences pratiques que nous avons à tirer de notre position dans l'être. Au demeurant, Spinoza suffirait à cette tâche s'il n'était pas l'objet de l'une des plus perverses censures de l'histoire de la philosophie.
Vendredi 16 mai 2003
J'avais pris la décision de m'en tenir désormais à la philosophie dans ce Journal qui n'en est pas un, ou qui est la seule forme de Journal possible, je ne sais pas. En tout cas il faut le lire comme ce qui se passe dans mon esprit, dans ma tête, comme l'évolution de ma recherche qui porte le nom provisoire de question de l'être. Cette décision je l'avais prise en dépit de ma conviction, et même plus qu'une conviction, qu'il n'existe pas de plans séparés dans l'intellection du monde et de ses événements, par pur souci de sérier mes efforts en fonction du déclin de mes forces.
Or, les événements français reprennent une sorte de dessus dans le paquet d'affects dont je suis fait comme tout le monde. L'affaire des retraites non seulement me concerne à titre existentiel, puisque dans quelques mois je vais plonger dans ce statut dans des conditions que vous savez, j'en ai déjà parlé, mais cette raison demeure secondaire. Ce qui me torture littéralement est l'ambiance de trahison qui entoure ce soit-disant débat. Trahison de l'état, trahison des syndicats, trahison en résumé de tous ceux qui ont la parole, le pouvoir de dire quelque chose ailleurs que dans la rue. Bref, ce matin on apprend, comme on pouvait s'y attendre et comme je m'y attendais, que le " front syndical " est rompu, et que la CFDT, comme d'habitude, a trahi une fois de plus pour prendre le parti du gouvernement, toujours dans l'espoir et l'illusion de devenir le syndicat tout-puissant d'une future cogestion à l'allemande. Cette-fois c'en est trop de l'arrogance du monde syndical par rapport à la prise en main du destin des salariés de ce pays. Il est scandaleux de voir comment l'establishment intellectuel et médiatique fait passer comme une lettre à la poste le fait que le destin des femmes et des hommes qui travaillent soient déterminé par ces deux instances, alors que par ailleurs chaque carrière, chaque histoire individuelle porte sur un engagement duel, une signature que le salarié appose à côté de celle de son employeur. Tout le reste est cadre légal et cadre historique. Dans l'histoire du travail en France, il s'est produit un événement de prestidigitation qui a fait des syndicats une sorte de pouvoir législatif bis, nantis de pouvoirs de représentation exorbitants et anticonstitutionnels. D'un rôle de fédérateur des forces des masses exécutantes, les syndicats se sont hissés eux-mêmes et avec la complicité des instances intéressées par leur docilité, au rôle de décideur du destin des salariés, sur la base d'une représentativité réelle mesurée tellement ridicule qu'elle frise l'absurdité ou le cauchemar des nomenklaturas des anciens satellites de Moscou. L'histoire de cette perversion reste à faire, même si de nombreux pionniers de l'après-guerre (comme la revue Socialisme ou Barbarie ou les Situationnistes) l'avaient déjà largement analysée et combattue. Malgré mon peu d'enthousiasme à me replonger dans le facticiel, je me sens quand-même obligé de rendre à l'histoire de cette réforme des Retraites son véritable cadre et ses véritables perspectives. J'affirme donc que tout ce qui se fera en-dehors de ce cadre et de ces perspectives ne fera rien d'autre que d'attiser les braises d'un conflit social qui ne s'est jamais éteint, mais cette fois on pourrait bien en arriver à un degré d'affrontement où tout sera remis en danger, la République et la paix sociale. Une fois de plus, ce seront les fascistes qui en tireront bénéfice.
LE CONTRAT DE FIN DE VIE
Qu'est-ce-que la retraite ? En tout premier lieu c'est un concept militaire appliqué à la vie sociale. Dans la " retraite ", toutes les forces vivantes d'une société reconnaissent la nécessité de sonner la retraite à un moment donné de l'histoire des individus, mais aussi à un moment donné de l'histoire sociale. De ce point de vue historique, la retraite est un compromis obtenu sur le champ de bataille de la lutte entre les classes exécutantes et les classes décidantes, ou encore, comme à Rome, entre l'Etat et les personnes qui risquent leur vie à la guerre. Mais, quelle que soit la situation considérée, individuelle ou sociale, la retraite est toujours un contrat qui engage un individu envers une instance, instance qui s'engage à son tour envers l'individu. Un contrat de travail ne comporte jamais que deux signatures, celle du salarié et celle du représentant de l'entreprise qui l'emploie, deux acteurs soumis également au Droit du Travail.
Le premier paramètre de toute réforme de ce principe et des lois qui le régissent, est donc le respect de cet engagement, quelles qu'en aient été les conditions signées de part et d'autre. Pour parvenir à réformer le cadre des retraites tout en respectant ses engagements, l'instance qui réforme ne peut pas simplement s'appuyer sur le pouvoir provisoire que lui confère le suffrage universel, il doit tenir compte des engagements tels qu'ils ont été pris par rapport à chaque individu. La République est garante du respect de ces engagements.
Si donc le gouvernement veut modifier fondamentalement le cadre du mécanisme de la retraite, il ne dispose que de deux options possibles pour le faire dans le respect des institutions républicaines :
1- Faire porter les modifications sur les futurs signataires du contrat, faute de quoi il donnerait à la nouvelle loi une rétroactivité anticonstitutionnelle et se rendrait coupable d'une simple trahison. Une telle trahison donnerait constitutionnellement le droit aux citoyens de se révolter.
2- Le gouvernement peut aussi choisir de négocier personnellement avec chaque signataire individuel de nouvelles conditions d'application du principe de la retraite voire même son retrait du système par répartition.
Modifier les conditions pour les " entrants " dans la vie active : cette solution ne comporte aucune difficulté. Le principe démocratique est respecté ainsi que les engagements pris dans le passé. Les acteurs économiques doivent cependant s'attendre à ce qu'un autre gouvernement procède à un nouvelle modification dans un sens différent. Si la réforme est drastique, elle peut ainsi être limitée dans le temps par le principe du suffrage universel.
La négociation individuelle peut paraître théoriquement absurde et pratiquement infaisable, mais elle offre la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les transformations attendues. Du point de vue pratique, l'informatisation de la vie sociale ouvre des perspectives tout à fait réalistes pour de telles négociations, les banques et les assurances le font quotidiennement. Si le discours libéral a un sens, il existerait une grande fraction de la société qui serait partisane d'une retraite totalement privatisée. Cela implique, par exemple, qu'un salarié X pourrait accepter de se voir remboursée la somme de toutes ses cotisations en Euros constants capitalisés au taux moyen du marché sur la période considérée, en échange de l'abandon de sa retraite par répartition. Pour ma part je serais prêt à accepter un tel marché. Cette négociation serait également nécessaire en cas de nouveaux changements à prévoir dans de nouvelles législatures.
Il n'y a rien à ajouter. Toutes les autres considérations, extrapolations et projections chiffrées ne constituent en rien un droit pour les instances au pouvoir de rompre les engagements pris dans le passé. L'existence des syndicats ne change rien au caractère individuel de chaque contrat et ces associations de défense collective ne sauraient en rien se substituer à la décision individuelle. Si maintenant le gouvernement s'obstinait à se faire le représentant des intérêts d'une classe particulière de la société, il prendrait le risque de fomenter une logique d'affrontement qui aboutirait fatalement à la violence sociale.
Dimanche 18 mai 2003
Rencontre inattendue avec Renouvier sur l'ombre de qui mon ancien maître Fernand Turlot a étendu quelques commentaires que j'attendais plus académiques. Tel que je connais Turlot, Renouvier a dû représenter pour lui quelque chose comme un extrémisme de la pensée rationaliste, tout juste fréquentable. Dans ma culture à moi, Renouvier n'existait pratiquement pas autrement que sous la forme d'une sorte de dandy sombre, de Maldoror de la Raison dont on ne se hasardait jamais à lire une ligne, ne le rencontrant que dans quelques notes hardies de Bergson ou d'Hamelin. Pour les fous qui lisent encore ces deux penseurs. Et voici que je fais une découverte que seuls peuvent faire ces chercheurs quasi incultes, non dressés dans nos Grandes Ecoles et pour qui l'histoire de la philosophie passe presque directement de Parménide à Heidegger, et quelle découverte ! Elle s'appelle Uchronie, l'ouvrage de Renouvier dont personne ne parle, mais dont se délectent en secret les derniers défenseurs de la philosophie post-critique rationaliste. Je n'ai pas encore eu le temps de me le procurer mais cela ne saurait tarder, tant le sujet me brûle : figurez-vous une utopie à l'envers, une histoire telle qu'elle aurait pu se dérouler si… Si, excusez du peu, le Christianisme n'avait pas connu cette carrière triomphante en occident. Donc, si Marc-Aurèle vieillissant avait pris d'autres dispositions pour éviter que son fils Commode ne parvienne au pouvoir, et que par conséquent ses successeurs s'attachent avant tout à chasser les Chrétiens vers l'Orient, consacrant leurs efforts à restaurer le " rationalisme latin " ! Je m'étonne n'avoir jamais lu une ligne de cette histoire chez Heidegger qui aurait certainement apprécié cette fiction rétrospective, lui qui n'a pas de mots assez durs pour le sort que l'Eglise a réservé au écrits des Anciens et à la traduction de ce qui a subsisté. Il faut dire que son allergie au rationalisme était au moins aussi puissant, surtout dans son aspect personnaliste, stade ultime de la formation du sujet ou de la subjectité. Mais ce qui m'intéresse par ailleurs c'est cette sorte de fixisme qu'inflige le rationalisme pur à toute vision historique. Et pourtant il reconnaît, Turlot cite Hamelin à ce sujet, que la naissance de l'Histoire et celle de l'être sont contemporaines, intuition que ces messieurs tirent more geometrico de leur vision théologique de la Raison, sous-entendant par ailleurs que cet événement ressortit à la Chute, l'histoire devenant le chemin de croix de la rédemption. Cherchez l'erreur. Et vous trouverez cette étrange familiarité entre la critique que Schelling a fait de Hegel après lui avoir servi la dialectique sur un plateau et le criticisme français qui naît à la même époque. Dire qu'une sorte d'Europe philosophique aurait alors pu se construire comme si Marc-Aurèle avait fait à temps le bon choix. Renouvier / Nietzsche, une antinomie dont on n'aurait jamais cru qu'elle eût pu donner une thèse géniale.
Ah si seulement ces rationalistes, qui auraient pu faire pièce à la phénoménologie allemande, ne s'étaient pas laissé intimider par ce religieux fil à la patte, chose d'autant plus étonnante que Renouvier mangeait du curé à tous ses petits déjeuners. Cette fiction " uchronique " dénote une imagination tout à fait digne des Jarry (le vrai Jarry et non pas seulement le farceur de la pataphysique) et prouve à quel point j'ai raison de penser que la bourgeoisie du Dix-Neuvième siècle, en France comme en Allemagne, a été une chance immense pour la civilisation déjà menacée par le pourrissement de l'aristocratie dont Descartes a été le dernier et unique représentant pensant. Et encore, il n'a jamais été qu'un petit chevalier de province, mercenaire par besoin et philosophe par ennui. Voyez la vitalité d'un Pascal, fils de petit robin de campagne. Oui, ce fixisme a empêché ces hommes de qualité de porter leur critique jusqu'au cœur de l'histoire et de distinguer dans celle-ci non pas la naissance de la Raison, mais une nouvelle forme de son traitement. Peut-être des Nietzsche ont-ils eu ainsi les mains libres pour étaler leur nihilisme arrogant semeur de catastrophes futures, simplement parce qu'il avait su distinguer cette finitude historiale de la Raison et mettre cette découverte au service de l'aristocratie allemande. Je me ferai un plaisir de revenir sur le sens et le destin de cette école philosophique sacrifiée aux lendemains de la deuxième guerre mondiale au profit de la phénoménologie germano-française. Et dont il n'est pas sûr que l'œuvre n'ait pas contribué en définitive à la reconstruction de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui.
Jeudi 22 mai 2003
La France et ses deux principaux alliés, la Russie et l'Allemagne plient le genou devant Bush. Ce matin le mot force revient dans tous les journaux qui commentent la décision de ces trois pays de voter la résolution américaine sur l'Irak. Nous nous inclinons devant la force américaine. France-Culture nous a offert ce matin une excellente analyse juridique de cette résolution, analyse qui montre à l'évidence qu'elle est une infraction au droit international, un simple délit. Nos gouvernants se rendent ainsi complices d'un délit dont ont sait qu'il pourrait s'étendre sur d'autres pays du Moyen-Orient comme la Syrie ou l'Iran. Cette reculade pose deux questions douloureuses : primo, comment se fait-il que le Peuple Français n'ait pas eu à se prononcer sur une telle décision ? Pourquoi le Président de la République estime-t-il pouvoir se passer d'une discussion à l'Assemblée Nationale sur une décision qui fait de notre pays un pays délinquant ? Secundo : de quelle force s'agit-il lorsqu'on évoque cette puissance qui fait de l'Amérique un véritable despote international ?
Ces deux questions sont intimement liées. Si le gouvernement français a cru pouvoir se passer de l'avis de son Parlement c'est qu'il existait un risque, non pas d'empêcher la diplomatie française d'entreprendre sa reculade, mais celui de porter sur la place publique une discussion gênante qui aurait révélé son caractère criminel. Puis, de fil en aiguille, de poser d'une manière plus précise le pourquoi de ce Canossa inattendu et intolérable. La première pensée qui vient à l'esprit lorsqu'on réfléchit à cette question, c'est que Georges W. Bush n'est passé à l'acte en Irak que pour affirmer cette fameuse force devant laquelle on s'incline aujourd'hui. Contrairement à la plupart des commentaires que l'on peut lire un peu partout, j'ai toujours maintenu que la cause-pétrole était une cause secondaire. L'Amérique n'a aucun besoin stratégique ou tactique d'un produit qu'elle possède en très grande quantité et dont elle contrôle de toute façon le négoce mondial. Non, l'affaire irakienne est une affaire purement politique dont nous commençons seulement à apercevoir les aboutissants. On pourrait donc simplement s'en tenir à l'analyse classique d'une stratégie hégémonique, mais là encore je pense moi-même m'être souvent laissé emporter par les mots, du moins de n'avoir pas suffisamment précisé le sens des mots.
Car s'il s'agit bien d'hégémonie, il faut encore la définir dans son essence et non pas seulement dans sa forme dite géopolitique. A ce sujet, il convient même de souligner combien grands sont les risques géopolitiques pris par Washington dans toute cette aventure. Depuis quelques heures on entrevoit les conséquences réelles à terme dans les attentats qui se multiplient ici et là. La fameuse guerre contre le terrorisme enregistre désastre sur désastre alors que la guerre contre Saddam Hussein devait être la première d'une série de victoires décisives contre le monstre qui menace la paix civile mondiale. La seule grande victoire que le Pentagone et le Secrétariat d'Etat peuvent donc revendiquer est bel est bien la victoire contre la diplomatie de la " vieille Europe ". Alors quelle est l'essence de la force américaine ? Elle réside toute entière dans le principe qui domine la scène politique et idéologique d'Outre-Atlantique, à savoir le libéralisme économique intégral. L'intégrisme libéral s'est donc servi d'un faux combat contre l'intégrisme religieux pour s'imposer là où demeurent encore quelques poches de résistance. Et parmi ces poches de résistance figure au premier plan le peuple français et puis de manière logiquement concomitantes les quelques forces social-démocrates européennes qui résistent encore, et la pauvre Russie qui tente de se relever du malstrom libéral qui la ravage depuis 1990.
En conclusion, Chirac va à Canossa parce qu'il se trouve lui-même face à des échéances libérales imminentes. Lors de son élection, j'ai eu la faiblesse de penser que le Président de la République pourrait d'une certaine manière réincarner la politique du Général de Gaulle. Hé bien, il le fera certainement, mais pas de la manière que j'osais espérer, c'est à dire en résistant à la pression libérale jusqu'au bout. Il me paraît plutôt évident qu'il se dirige vers l'imitation du De Gaulle vieillissant, celui qui n'a pas su gérer Mai 68, qui a demandé à ses ministres de faire tirer sur les manifestants et qui a fui en Allemagne pour quémander d'une manière un peu ridicule et humiliante un appui que l'Otan était bien incapable de lui fournir. Voilà donc cette fameuse force américaine dont on a entendu ce matin-même l'écho dans la mise en demeure de la Commission de Bruxelles à propos de la réforme des retraites en France. Cette réforme, ce sont les Américains qui l'exigent depuis des décennies avec une rage de moins en moins contenue de voir l'argent des salariés européens bouder leurs fonds de pension. Car ne vous y trompez point : le gouvernement français clame haut et fort qu'il ne touchera pas à la retraite par répartition. Mais comment les Français vont-ils pouvoir assurer leur vieillesse si les réformes successives qui ont commencé avec celle de Balladur, vident cette répartition de son contenu ? Pure plaisanterie, mauvaise plaisanterie. D'une certaine manière, et j'en terminerai provisoirement là, le peuple français est en première ligne, et ceci dans les toutes prochaines semaines. Alors reste cette question : Chirac se contentera-t-il de la menace psychologique que représente une Europe à nouveau lovée dans le sein de l'Otan, en espérant que les syndicats finiront, cette fois, par comprendre les enjeux réels avant de lancer leurs divisions de salariés dans les rues ? Pour ma part, j'inclinerais à penser que les syndicats n'auront même pas d'autre choix que de suivre les Français dans les rues, en faisant comme d'habitude semblant de les précéder. Mais je peux aussi me tromper. Après tout l'Europe (de Bruxelles) peut bien faire le choix de l'égoïsme des nantis et les nantis n'ont pas besoin de retraite.
Samedi 24 mai 2003
Hic Rhodus hic salta !
Ici est la rose, ici il faut sauter. Traduction libre qui autoriserait le mot " choisir " à la place de sauter, peu importe. L'essentiel sera de ne pas confondre choisir avec ce geste quotidien qui consiste à trier la marchandise, mais d'en garder le sens profond de l'engagement à risques. Cette pédanterie apparente a pourtant guidé dans ses anticipations conscientes la dernière Révolution française que fut Mai 68, vous la trouverez dans les textes mobilisateurs et initiateurs publiés par les situationnistes entre 1958 et 1968. Elle réapparaît ici dans des conditions qui font de notre présent la réplique des circonstances dans lesquelles ce tremblement de société a fait surgir partout dans le monde tant d'ennemis acharnés de notre esprit et dans notre propre pays tant de personnes anéantis au beau milieu de leur rêverie et récupérés plus tard par cela même qu'ils vomissaient. Ces derniers n'auront pas le loisir de céder une nouvelle fois aux mêmes errements. Les autres devront se plonger dans les livres d'histoire et s'attarder longuement sur Valmy ou bien, si leurs inclinations bibliques prenaient le dessus, l'épisode du combat de David et de Goliath.
La grande question qui obsède donc la plupart des internautes de Libération mais aussi de nombreux autres forums est claire comme un titre de livre : Que Faire ? Ce souci se dissimule ici et là sous d'autres formulations portant sur la mobilisation du peuple, le boycott de ceci ou de cela, bref, toutes sortes d'expressions et d'idées qui révèlent brutalement la colère que les récentes humiliations infligées à la France a réveillé, mais aussi celle que provoque la trahison flagrante du contrat républicain qui unit les Français sur les questions les plus essentielles de leur destin de citoyen comme celles de leur Ecole ou celles de leur vie d'outre-travail. Alors que faire ?
Lorsque de telles crises éclatent, il faudrait dire lorsque la crise atteint un tel climax, rien ne sert de courir, il faut chercher le bon point de départ afin d'être, le moment venu, capable de partir à point. Or comment chercher ce point sans risquer d'empiéter sur l'opinion des autres sinon en soi-même ? Où est la vraie souffrance et quel est le sacrifice que nous sommes prêts à mesurer à l'aune de cette souffrance ? Arrêtons en effet, comme le souhaitent tant d'honnêtes gens sur ces forums, arrêtons de nous prendre pour les stratèges d'une réalité et d'un combat dont nous ignorons pour l'essentiel les données fondamentales : qui va me dire avec la vérité que je requiers les raisons exactes de la guerre menée en Irak ou les causes réelles de toutes les réformes jetées en vrac dans l'enceinte du Palais Bourbon ? Personne. Alors cherchons en nous tout simplement et nous trouverons.
Nous trouverons par exemple que nous sommes humiliés en tant que Français et Européens par l'arrogance insultante de l'administration Bush. Colère d'autant plus sainte qu'elle ne prend pas sa source dans notre égoïsme national ou continental, mais dans tous les espoirs que nous avons placés dans les Institutions Internationales pour éviter de retomber dans les horreurs du siècle passé. Des horreurs dont nous avons payé le capital et les intérêts malgré tous les débarquements du monde. Monsieur Bush ne pisse pas sur nous, il pisse sur le monde, sur la réalité tout entière qu'il veut barioler de ses couleurs comme un sale gosse gavé de hamburgers et de bière texane. Première souffrance. Qui peut la réfuter parmi tous les internautes non stipendiés par le Pentagone ou qui refuseraient de se considérer comme les collabos d'une puissance qui se déclare elle-même hostile à la France et à l'Europe ?
Nous trouvons ensuite un gouvernement de la trahison. Je n'en peux plus d'entendre reportage sur reportage, débat sur débat, discours et théories sur la retraite sans jamais entendre l'essentiel qui est que toute modification unilatérale d'un contrat est une trahison, une forfaiture qui fait litière de chaque destin individuel, qui rompt un contrat d'autant plus sacré qu'il lie chaque individu à la République par un engagement réciproque par principe irrévocable. La rétroactivité des lois est devenue monnaie courante sans que personne ne bronche. Et cette trahison se double d'un autre mauvais coup, celui des syndicats qui se présentent comme les négociateurs légitimes de ces forfaitures, ce qui n'a jamais figuré dans aucun texte constitutionnel, pas plus que cette idée folle que deux ou trois syndicats consentants suffisent à légitimer un charcutage de la Loi. Mais où vivons-nous ?
Les autres souffrances je les laisse à votre intimité, mais elles comptent peut-être plus que tout le reste. Quel est ce monde où le trajet qui mène de la naissance à la mort n'est plus qu'une courbe de croissance économique ? Quel est ce monde où l'exotisme et le voyeurisme touristiques à la petite semaine ont remplacé le sens de l'aventure, de la découverte et du partage ? Quel est ce monde où nous avons accepté malgré tous les avertissements de nous transformer en travailleur de la consommation, en agents actifs de l'exploitation néantisante de la planète, en chiens de Pavlov de la publicité et du spectacle ? En chiens de garde de l'arrogance des grands ? Quant à moi, ma vraie souffrance est là, devant ces fatalités dont l'avant-scène bruyant n'est qu'un symptôme dont n'importe quel Grenelle peut venir demain cautériser la blessure sans rien changer. Vous souvenez-vous que l'Ecole est l'apprentissage de la vie avec autrui et non pas la tréfilerie des meilleurs ou des plus forts ? Avez-vous oublié que la retraite est au contraire le retrait de la vie avec autrui, le chemin vers la solitude de la mort et la seule véritable époque de l'existence où chacun de nous peut enfin lui donner le sens qui lui permette de la quitter dignement ? Le moment est peut-être venu où ce sens s'imposera de lui-même ? Qui sait ? Et qui est prêt à lui ouvrir sa porte ?
Lundi 26 mai 2003
Je me pose ce matin la question de la convergence entre mes méditations philosophiques et mes commentaires en apparence hétérogènes et dispersés par rapport à une réflexion et une recherche qui pourrait ne pas se payer le luxe de se partager entre tant de soucis, de sujets, d'objets, de choses à penser. Depuis quelques semaines la tentation grandit pour moi de faire place nette à la spéculation ontologique, une fois pour toute. J'ai tenté d'entamer des dialogues sur quelques forums journalistiques et culturels sur tous les sujets qui émergent dans une histoire apparemment de plus en plus tourmentée, mais surtout parce qu'une nation s'est autorisée de sa puissance pour détruire un régime politique et un pays en contradiction avec tous ses engagements historiques envers la communauté internationale. Le problème qui se pose dans tout ça est le rapport entre une parole et une réalité en partie tragique, sanglante et mortelle pour des êtres humains quelles que soient leurs identités, leur culpabilité ou leur innocence. Et puis il y a aussi des questions de politiques qui touchent à l'ontologie en ce sens qu'une affaire comme celle des retraites contient dans ses données de départ, qu'on le veuille ou non, des définitions touchant de près, non seulement la moralité en tant que telle, mais les définitions possibles de l'existence même des êtres humains. Dans un message lu au hasard ce matin sur l'un de ces sites, un internaute se pose par exemple la question de la nature du travail en la replaçant dans l'histoire à travers les diverses définitions et les divers jugements qui ont été portés sur lui par des hommes retenus par l'histoire de la pensée et/ou de la politique.
Il se joue donc en moi un vrai drame intellectuel dont la complexité et la dialectique interne met sur la sellette le temps qui me reste à vivre, un temps que je juge relativement court même si je peux me tromper. Or là est peut-être la réponse : puis-je me référer à une quantité quelconque de temps pour prétendre achever quoi que ce soit dans l'un ou l'autre des domaines qui semblent s'affronter ? Certainement pas. Je m'explique : la recherche ontologique est impossible à programmer au sens où de toute manière je ne peux ambitionner qu'une sorte de perfectionnement dans la manière de poser les apories fondamentales. Au contraire, si je décidais de me consacrer entièrement aux question politiques et sociales, je pourrais avoir une chance, en planifiant et en menant une action déterminée en fonction de mes convictions, de parvenir à " boucler " un programme, quitte à ce que ce bouclage se réduise à lancer dans le débat général les éléments suffisants pour porter une action plus large, collective et indépendante de ma participation immédiate. Bon, je ne veux pas me faire le champion de l'humilité ou de la fausse modestie et je prétends même n'avoir jamais fait autre chose que de poser des idées neuves pour la praxis, pour une praxis politique et sociale dont je suis l'un des rares à apercevoir des transformations plus essentielles que celles auxquelles on se réfère habituellement.
En fait, la gestion de ce drame est extrêmement délicat précisément parce que je me suis toujours attaché à donner une image cohérente et globale de la relation qui unit la praxis et la théorie. Mon philosophème fondamental repose entièrement sur une identification de l'histoire humaine et de la recherche ontologique. Mes récentes lectures portant sur les rationalistes du 19ème siècle, me suggèrent d'ailleurs que ma démarche se situe dans une véritable tradition française. Nulle part ailleurs dans l'histoire, sauf peut-être dans une Grèce ou une Rome que nous connaissons malgré tout beaucoup plus mal, ne s'est produit une telle synthèse entre la fonction de penseur, l'état de philosophe, et la fonction d'homme aux prises avec le politique. De Kant à Hamelin, c'est à dire exactement d'un bout à l'autre de ce siècle, le moteur de la pensée aura été la liberté et son exercice dans la vie et dans la Cité. L'Ecole de Jules Ferry n'est pas le fruit d'un hasard du calendrier politique que certains individus ont mis en pratique parallèlement à la réflexion qui se menait en même temps sur les notions d'être, de liberté ou de raison. Ces notions étaient les munitions de la pratique si je puis m'exprimer ainsi, et c'est bien cet idéalisme rationaliste - à la nuance près que dans ce siècle comme dans tous les siècles précédents et sans doute suivants l'idéalisme demeure toujours relatif d'un penseur à l'autre même lorsque le penseur lui-même se réclame de l'étiquette - qui a conduit à cette praxis qu'incarne encore pour nous aujourd'hui le mot de République. Je note au passage que la France est le pays où cette harmonie s'est produite, où cette harmonie a réellement posé un nouveau paysage politique, une nouvelle praxis dont la structure essentielle a survécu à toutes les tragédies du siècle suivant. Il est probable que cette survivance est la cause principale de l'isolement de plus en plus patent et inquiétant de la France dans une Europe et dans un monde qui semble avoir opté majoritairement pour le pragmatisme anglo-saxon.
Au fond la question qui est traitée ici est celle de ma capacité à mener de front la recherche théorique et l'action politique. Aujourd'hui je tranche en faveur de la théorie, non pas que l'urgence des réponses ontologiques soient de quelque manière prioritaires sur tout le reste (et je rappelle ce que je disais plus haut sur le fait que dans le politique contemporain des hommes meurent au nom de pratiques aberrantes ou du moins réprouvées par une majorité planétaire), mais parce que, au fond, l'essentiel pour moi dans l'action politique aura toujours été de m'y préparer moralement, plutôt que de mouvoir des masses, des groupes ou des partis. Or, ma vie étant ce qu'elle a été et ce qu'elle est, je me sens totalement prêt. Que signifie être totalement prêt ? Seulement ceci : le moment venu je n'aurai aucune difficulté à choisir, à me situer et, au besoin, à me mettre totalement en jeu dans le sens que j'ai donné à toute ma vie. On peut ironiser sur cette position et parler d'une sorte d'occasionalisme évanescent, mais l'expérience m'a doté d'une " phronesis ", d'une sagesse pratique qui se trompe rarement sur le rythme actuel de l'histoire, ses événements prévisibles et ses tendances profondes. J'ai donc beaucoup de raisons de penser que l'occasion se présentera comme elle s'est déjà présentée à moi à plusieurs reprises. Chaque destin a ses cycles inscrits dans le grand cycle de l'être, or mon obstination à penser la question de l'être et celle de son cycle qui ont toujours été les objets les plus denses, les plus lourds et les plus précieux de mon existence, me confère une sorte de voyance pratique dont je tire les jugements qui me permettent de me préparer pratiquement à affronter des situations concrètes toutes nouvelles. Par conséquent je n'ai même plus l'ombre d'une hésitation en quittant définitivement le commentaire répétitif et lassant du détail des événements de l'être, commentaire qu'au demeurant personne ou presque ne comprend assez pour le prendre en compte pratiquement. Il ne me reste plus qu'à assumer cette solitude de fait dans la spéculation la plus absconse et la plus échevelée, comme dirait un ami cher, c'est à dire au fond, à m'adonner sans limites à ce que cherchent tous les hommes sans le savoir. Contempler ? Oui, mais à condition de garder à l'esprit que toute contemplation est travail, négativité en action, jeu avec l'être dans l'être, apprentissage de la bonne mort, artisanat de la mort noble, d'une noblesse qui sauve la vie elle-même, lui donne son absolution et son sens. Sartre disait que nous naissons plusieurs et mourrons seuls, je pense qu'il s'est trompé, nous naissons seuls et mourrons pour plusieurs à condition d'assumer la solitude dans laquelle nous naissons. Cette solitude s'appelle liberté.
Mardi 27 mai 2003
Conformément à la décision prise hier, les textes qui vont suivre demeureront à caractère purement philosophique. Ils formeront, au fil des jours, la réécriture et une toute nouvelle élaboration d'un manuscrit déjà ancien et qui portait à l'origine le titre suivant : " L'Usure de l'Être ". Pour répondre au souhait exprimé par certains lecteurs de cette chronique, je joindrai désormais un index rerum et nominum aussi précis que possible. Il figurera directement en note de bas de page. Bonne lecture.
INTRODUCTION
Il existe une antinomie radicale entre le concept d'histoire et celui d'être. L'expression " histoire de l'être " telle qu'on peut la trouver par exemple chez Heidegger1 n'a donc aucun sens sauf à la réduire à la description bibliographique de la succession des différents traitements du mot être dans le temps. Ce serait alors l'histoire du mot (ou éventuellement du concept) être, mais en aucun cas l'histoire d'un sujet qui s'appellerait l'être. Cette antinomie saute aux yeux car comment l'immobile pourrait-il se mouvoir ? Pour que l'être puisse être le sujet d'une histoire, il faudrait admettre que cet être se meut selon l'une ou l'autre ou toutes les catégories du mouvement tels que définis par exemple par Aristote. Or si l'on reprend la distinction classique systématiquement utilisée par Heidegger entre être et étant, ontologique et ontique, l'être est bien le concept qui doit pour ainsi dire maîtriser le mouvement de l'étant, ou bien, selon une autre tradition en constituer l'essence immobile et transcendante. En fait on se trouve devant une aporie jamais représentée sous cet angle : être comme étant sont des idées impossibles. En effet, le mot étant, le ens latin ou le on grec veut signifier le monde tel qu'il se manifeste dans notre perception et dans notre sensibilité (le fait ou non d'étendre ce monde aux objets de la pensée, de la mémoire ou de l'imagination ne change rien ici). Or, la déclinaison verbale du mot étant est grammaticalement déterminée comme la forme du présent passif et donc immobile ; une chose étante est pour ainsi dire figée dans l'immobilité du participe présent. Le voilà donc qui prend la place de l'être dont nous avons analysé plus haut la fonction sémantique alors que ce participe présent est chargé de désigner le monde des choses changeantes et incertaines : il ne peut donc pas y avoir d'étant, le temps et son mouvement ne le permettent pas, que ce mouvement soit réel ou qu'il ne soit qu'une forme de l'intuition. D'un autre côté, l'être est un infinitif. Sémantiquement l'infinitif est une abstraction, un universel désignant une succession indéfinie d'occurrences d'une action quelconque. Il est un actif pluriel en son essence et par conséquent il contient le mouvement. L'idée " boire " ne pourrait jamais désigner un acte singulier et unique, pas plus que n'importe quel autre verbe : l'infinitif est le seul mouvement qui puisse exister dans un mot indépendamment de l'idée qu'il représente.
Être : nous décrirons ultérieurement avec tout le soin qu'une telle description requiert, la substantivation du mot être, à savoir sa transformation en substantif qui permet de faire état d'un objet nommé " être ". Pour l'instant interrogeons-nous sur l'infinitif être lui-même. En tant qu'infinitif, infini-tif, le mot être s'applique à ce que nous avons appelé plus haut une répétition ou une possibilité de répétition de l'action signifiée : " un objet est " ne signifie pas qu'il y a un objet devant nous où ailleurs, mais qu'un objet demeure là sous la constance de l'action d'être. Si je peux me permettre une image je dirais que tout objet qui est est agi en permanence par l'action d'être. Cette action, qui est, comme nous l'avons dit une action répétée, pourrait alors se comparer à une vibration qui introduit dans la position de l'objet la constance qui en fait une chose apparemment inerte, une matière qui occupe des coordonnées spatiaux-temporelles irréfutables dans son identité propre, même si la forme de cette chose se trouve altérée dans le cours des modifications de ces coordonnées. L'exemple classique consiste à évoquer la différence qui séparerait ontologiquement un être vivant du même être mort. Or à ce sujet, le langage ne nous trompe nullement : si je viens rendre une dernière visite à un parent ou à un ami décédé, la personne qui me conduira à sa chambre mortuaire ne me dira pas -" son cadavre est dans cette chambre ", mais il me dira " il est dans cette chambre ". Exactement comme s'il me disait : -" la machine à laver est dans la buanderie ". Je note en passant que la physique contemporaine semble avoir intégré dans ses définitions de la matière la notion d'énergie en mouvement, et ce de manière assez définitive. Ce qui unifie la nature de la matière au-delà des différences inhérentes à son appartenance à l'un ou l'autre règne élémentaire. Evidemment, ce consensus autour d'une définition de la matière ne règle nullement la nature de son être, c'est à dire le fait pour cette matière d'être-là plutôt que non.
Si donc il fallait réconcilier les concepts d'être et d'histoire, il faudrait pratiquement affirmer que le mouvement inhérent à l'énergie matérielle, à savoir en somme sa fréquence, se modifie elle-même quant à sa nature dans le cours du temps, ce qui me paraît pour le moins problématique même si l'invention et la production des hautes énergies pourraient, elles, modifier considérablement notre aperception de la matière sans rien changer quant à la question de son être. Demain nous nous pencherons sur le paradoxe qui fait que les concepts d'être et d'histoire apparaissent dans le temps de manière totalement solidaire. Non seulement ils naissent à la même date, mais encore dans le même lieu : les commencements de l'histoire en tant que science correspondent à la naissance du concept d'être, comme si les hommes de cette époque avaient voulu consciemment produire deux instruments dont l'un serait la limite de l'autre. C'est là tout le mystère de la naissance de notre civilisation, reposant dès son commencement sur deux piliers antinomiques qui ont sans doute chacun sa raison d'être, sa fonction et une évolution qui dépend précisément de leur caractère antinomique. Être et Histoire sont des options conceptuelles dont il faut comprendre ou peut-être seulement deviner poétiquement la raison d'être sur l'échiquier de notre propre existence.
Jeudi 29 mai 2003
Les dernières phrases de mon texte d'hier doivent être prises cum grano sali, c'est à dire à travers une grille de lecture délicatement nuancée. On pourrait en effet en déduire par exemple que la question de l'être elle-même date des Grecs, ce qui signifierait à peu près que la création du monde daterait de la même époque (Les thèses créationnistes ne se gênent pas pour nous asséner de pareilles idées même si pour ce faire elles se servent de ce dont nous parlerons plus tard, savoir la substantivation de l'être). La Grèce n'a pas été le lieu de l'éblouissement primordial, il a seulement été l'espace privilégié où le traitement de cet éblouissement a pu être repris dans la pureté de son énigme originaire. Il semblerait, en effet, que la question de l'être soit a priori la question qui échappe à toute pluralité, qui ne saurait de par la singularité des éléments de toute parousie se soumettre sans autre à une païdeia, une " scolarisation " ou à un embrigadement religieux. Il aura d'abord fallu que les Grecs inventent une réalité sociale qui puisse recevoir ce traitement de la question de l'être " en dialogue " et cette réalité est celle d'un peuple parlant, c'est à dire celle de la démocratie. Dialectique et démocratie sont inséparables, vérité qui aura manqué à la plupart des philosophes qui ont prétendu s'approcher de près ou de loin de la dialectique. Bien sûr, le communisme fantasmatique du Christianisme permettait toutes les illusions et toutes les manipulations faussement dialectiques. Or les schismes qui déchirent en permanence cette communauté chrétienne s'expliquent par l'impossibilité de donner à la dialectique des fondements dogmatiques. Une dialectique dogmatique est une contradiction dans les termes que pourtant quelqu'un comme Hegel a cru pouvoir mener à bien au risque d'identifier la démocratie avec l'état moderne tel qu'il naissait à Berlin sous la monarchie des Hohenzollern.
Ce qui naît en revanche à Athènes entre les 7ème et 3ème siècles avant JC, c'est le mode conceptuel de traitement de la question de l'être. Pour illustrer ce que nous entendons par là, nous nous servirons de l'idée moderne de conscience, une idée que les Grecs n'ont pas connue en tant que telle. Pour eux n'existent que trois manières de parler de ce que nous concevons sous le mot de conscience : la sophia et la phronesis, sagesses théorique et pratique, l'épistémè, ce que nous appelons plus précisément le savoir ou la science, et le nous, idée non encore traduite correctement mais qui s'apparente le plus près possible à la conscience en tant qu'âme. A mon sens, la traduction de ce mot nous avancerait au moins autant que celle de on dans notre recherche du sens destinal de la question de l'être. En résumé, le rapport qui nous est connu comme une dyade, celle de la conscience et de la réalité, se montre chez les Grecs plutôt comme une triade qui se distribue entre le zoon, l'animal, l'on, l'étant, et le nous, l'âme. On peut donc distinguer immédiatement le chemin qui s'est effectué en quelques deux mille cinq cent ans, chemin que l'on pourrait nommer la parturition du sujet. Le grand moment où l'ousia cède la place à la conscience est sans nulle doute celui du cogito cartésien, moment où la certitude du sujet prend définitivement la place de l'âme des scolastiques, même si l'ontologie de Descartes le contraint in fine à un retour à une nouvelle triade supérieure de l'homme, du Dieu et de la réalité.
La conscience, de soi et du monde, est donc une sorte d'aboutissement d'un processus de simplification qui a un double pouvoir de dévoilement et d'occultation de ce rapport entre l'être et nous. La simplification historique est le produit d'une pédagogie dialectique qui a fait de la question de l'être non plus le domaine exclusif d'une minorité d'initiés assez riches pour acheter les leçons particulières des sophistes, mais un domaine démocratiquement réparti, c'est à dire propre à chacun d'entre-nous. En revanche, cette pédagogie sophistique a en même temps jeté un voile épais sur l'essence de la question de l'être, en transférant la logique ontologique dans le rapport au divin. Le processus qui a fait que l'être infinitif devient l'être substantif ou encore la vérité, le Bien ou le Beau, a élevé un mur presque infranchissable entre la conscience moyenne des hommes et la question de l'être. La mort de Dieu doit donc se concevoir comme le retour à une sorte de nudité primitive de la position humaine en face de la réalité, nudité qui demande impérativement un abri, c'est à dire un sens.
Vendredi 30 et samedi 31 mai 2003
L'objet de cet essai n'est pas la mise en texte d'une nouvelle philosophie ou d'un nouveau système métaphysique ou ontologique, même si l'ontologie constitue le cœur de son dispositif stratégique. Car l'ambition de cette mise en perspective de la question de l'être est de confronter ce qui passe pour l'Histoire et ce que les philosophes ont fait du mot être. Nous avons déjà souligné le fait que l'un et l'autre concepts sont nés ensemble. Ce sont des concepts jumeaux et pourtant antinomiques. Cette confrontation se veut elle-même historiale au sens que donne Heidegger à ce mot, c'est à dire en prise avec nos destins présents, avec la présence du présent dans le déroulement du temps. D'une certaine manière Martin Heidegger a fait une tentative semblable ayant repéré ce lieu privilégié de la spéculation. Il a sans doute échoué, mais cet échec doit se mesurer à l'aune de ce que peut-être un échec ontologique, c'est à dire la performance d'un coup avec l'Être dans son propre jeu. Pour autant qu'il puisse rester un soupçon d'ouverture du champ philosophique, c'est ce jeu-là qu'il s'agit d'envisager. La partie sera d'autant plus rude que le nihilisme a frappé les deux éléments de la manière la plus totalitaire qui soit, destruction ou déconstruction sans doute fatale au regard du défi initial. Mais il ne nous reste en fait pas grand chose d'autre à faire qu'à continuer l'effort du philosophe allemand de l'ontologie fondamentale en explorant l'archaïque, c'est à dire ce qui ressurgit aujourd'hui dans la fermeture de la parenthèse ou de l'époque métaphysique. Cette métaphysique a commencé il y a plus de deux millénaires, ce qui n'est pas grand chose à l'échelle du temps humain, par cette mise en consigne que représente la conceptualisation de l'être.
L'ÊTRE CONSIGNE
Oui. l'être s'est un jour mis à la consigne des hommes sous la forme transcendantale du concept d'être. Quelques individus dont il ne nous reste guère que les noms sont allé à la gare de l'histoire pour mettre en gage un trésor que leur léguait le passé. La mythologie ? La tradition orale ? Ces deux pratiques ont certes eu une fonction importante dans la manière de préparer le terrain de la métaphysique, mais nous ne nous intéresserons pas à ces sortes de décors conjoncturels sous peine de nous perdre dans les marécages de l'érudition et de l'histoire de la philosophie. La difficulté pour nous de développer une spéculation qui prenne le relais du questionnement heideggerien provient d'abord de la possibilité qui existe qu'elle puisse être comprise malgré l'anéantissement métaphysique de ses objets. A relire soigneusement les textes cardinaux de notre philosophie occidentale, à commencer par Descartes et en poussant jusqu'à Hegel en nous arrêtant longuement sur Leibnitz, on se prend à douter que ces grands penseurs aient jamais eu une conscience claire de l'objet de leur propre questionnement. Heidegger a beau tenter le plus hardi des sauvetages en montrant en quoi Kant demeure génialement fidèle à la question de l'être2 - n'affirme-t-il pas à la page 74 de son Kantbuch3 que " Kant appelle " synthétique " une connaissance qui nous révèle le ce-que-contient-l'étant, c'est à dire qui dévoile l'étant lui-même "4 ? - il reste que la question de l'être demeure refoulée par le parti-pris de départ du criticisme kantien. Faute de reconnaître cette évidence, il faudrait admettre que toute philosophie qui se contente de prendre une disposition déterminée une fois pour toute par rapport à l'être, ce qui se trouve être le lot de la plupart des philosophies, se trouve toujours d'une certaine manière dans le lieu de la question de l'être. La difficulté provient donc directement du manque d'instruments logiques, les fameuses catégories elles-mêmes se révélant en définitive n'être que des outils formels de la saisie conceptuelle de l'étant. Lorsque Charles Renouvier critique ces catégories pour ne retenir que celle de la relation, il ne fait que nous donner une image d'origine transcendantale de la réalité ontique, telle qu'elle se représente dans la personne.5 Il sera d'ailleurs accusé par les idéalistes purs et durs d'introduire par ce biais l'idée d'un existence ontique, c'est à dire dans les termes du siècle, matérielle. La difficulté dont nous parlons a une origine commune à toutes les philosophies. Cette origine est précisément la mise au rancart dès l'entame de la question elle-même de l'être pour ne plus s'intéresser qu'aux visions théologiques ou anthropologiques qui dérivent pour ainsi dire de l'ignorance dans laquelle on s'installe en ostracisant d'emblée l'être lui-même.
Mais la difficulté est encore ailleurs : plus proche de chacun de nous elle est tout simplement l'aveuglement général. Le mythe de la caverne de Platon6 ne dit pas autre chose, mais il passe sous silence l'essentiel, il ne dit rien sur la vérité relative à la mécanique qu'il décrit, à savoir le caractère aléatoire, singulier, miraculeux d'une possible sortie de cette caverne. Qui est cet esclave que l'on arrache du rang pour aller vers la lumière, et QUI est l'instance qui décide d'arracher cet homme à son sommeil ontique ? Et QUI peut avoir la volonté et aussi la prétention de libérer l'esclave (et ses compagnons) afin qu'ils s'habituent à l'éblouissement de la vérité ? La seule réponse possible est que celui qui peut faire tout cela a déjà fait cette expérience de l'être et qu'il estime qu'il est possible de la transmettre, ce que Platon confirme un peu plus loin en donnant à l'éducation la mission de convertir l'âme, qui ne " consiste pas à donner la vue à l'organe de l'âme, puisqu'il l'a déjà, mais comme il est mal tourné et ne regarde pas où il faudrait, elle s'efforce de l'amener dans la bonne direction ". Il existe donc quelqu'un qui a de l'être une connaissance telle qu'il peut se prévaloir d'orienter les autres dans la bonne direction. Or cette connaissance est proprement miraculeuse. Elle est miraculeuse car comme disait Marx le formateur a besoin d'être formé et à moins de se référer aux fables qui tournent autour de la Révélation délivrée à quelques génies privilégiés, il faut admettre que l'origine de la connaissance du pédagogue, de celui qui oriente les autres dans la bonne direction, demeure parfaitement mystérieuse.
A moins que, à moins que ce ne soit le contraire. A moins que le mythe de la caverne n'ait été qu'un renversement de ce qui s'est réellement passé, c'est à dire une perversion sophistique de la description de ce qu'était la relation à l'être au temps de Platon. Il faudrait alors tout bouleverser dans le scénario du chapitre VII, et mettre les esclaves rangés, non pas dans la caverne aux prises avec des images qui ne sont que les ombres de la vérité, mais franchement à l'extérieur, là où brille le vrai soleil, et alors le pédagogue ne serait plus qu'un traître chargé par les puissants de conduire les esclaves par la violence à leur véritable place, celle de l'ignorance. Dans ce cas, plus besoin de miracle, plus besoin de formateur formé, car la vue du soleil est toujours déjà une faculté humaine, une disposition naturelle de l'âme, peut-être même son essence c'est à dire aussi l'humanité en tant que telle. L'Ecole de Platon, celle de sa République, devient alors aussi autre chose ainsi que tout ce qui va découler de cette école dans les millénaires qui vont suivre. L'Ecole deviendra ce à quoi s'attaqueront malgré eux tous les esclaves dont la mémoire est plus forte que ce qu'ils voient avec leurs yeux et entendent avec leurs oreilles. Descartes fera table rase de tout ce dont on a voulu le convaincre et après lui comme avant d'ailleurs, chaque esprit miraculé, au sens cette fois de sauvé de la caverne, voudra chercher le bon chemin, non pas seulement celui de la vérité formelle par rapport à tous les discours qu'on lui tient, mais la vérité pratique et morale qui suit ce chemin en apparence si nouveau, en réalité si antique. Platon, encore lui, n'a pas manqué de remarquer que toute connaissance était anamnèse, fonction de la mémoire, or rien n'est plus intimement singulier que la mémoire, rien n'appartient plus étroitement à chaque individu que ce qu'il possède de souvenirs, c'est à dire aussi bien de connaissance. La métaphysique a bien opéré tout au long de ces vingt et quelques siècles comme une fantastique lessiveuse de la mémoire humaine, comme un vulgaire lavage de cerveau auquel peu ont échappé spontanément. Je n'en citerais qu'un seul pour conclure aujourd'hui, c'est Spinoza, penseur impérial de notre histoire intellectuelle qui se dresse seul dans une agitation universelle qui ne parvient nulle part à se loger dans l'être comme il a su le faire sans avoir la prétention de nous entraîner dans son abri personnel. Je voudrais bien citer aussi Heidegger, mais le destin de cet homme aura été tragique dans le sens le plus haut, à savoir dans l'échec à refaire le geste de Spinoza, car il n'y a au fond pas grand chose d'autre à faire sinon à traduire dans notre langue son immense amour de l'existence.
notes
1) Martin Heidegger, Nietzsche, deux volumes, Gallimard, Paris, 1971.
2) Martin Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, Trad. A de Waelhens et W Biemel, NRF Gallimard, Paris, 1968.
3) Ouvrage cité
4) Traduction modifiée par nous. Les traducteurs ayant choisi de traduire Wasgehalt par talité, mot inutilement abscons.
5) Fernand Turlot, Les catégories chez Renouvier in Idéalisme Dialectique et Personnalisme, Ed. Vrin, Paris, 1976.
6) Platon, La République, chap. 7, Ed. Garnier Flammarion Poche, Paris, 1966.
Mardi 3,mercredi 4 et jeudi juin 2003
L'ÊTRE CONSIGNE (suite)
La consigne de l'Être, ce n'est donc rien d'autre que son concept, sorte de geôle linguistique destinée à une double opération : gérer la sortie historique de l'Être. La dualité de cette opération est incluse dans le double génitif qui s'entend dans l'expression " sortie historique de l'Être ". D'un côté il convient à l'homme d'entreprendre le licenciement de l'Être, de l'autre c'est l'Être lui-même qui fuit, traqué par sa saisie sous forme de concept. Mais comment s'opère cette saisie ? En deux temps. La première manœuvre consiste à diviser l'Être, à créer une dichotomie qui deviendra pleinement opérationnelle chez Aristote. Cette dichotomie se propose de soumettre le présent à deux signifiants, c'est à dire plutôt de l'extraire de son infinitude originelle et immédiate en le plongeant dans la multiplicité logique. Le présent, la présence en tant que telle va désormais se dire de deux manières : la première s'appelle l'étant, en Grec le on , la deuxième manière de considérer la présence s'appellera l'Être, nous dirons dorénavant simplement l'être, en Grec le einaï. Dans son commentaire du Sophiste7 Heidegger semble avoir raison de suggérer que le principal travail d'Aristote aura été de sauver en quelque sorte Platon et la dialectique en leur offrant ces deux instruments de chirurgie ontologique, je dirais presque de chirurgie ontologique plastique que sont la duplication de l'Être en étant et être. Car Platon en était resté à une sorte de stade primitif de la dialectique où l'Être n'avait comme antithèse logique que ce dont le chemin était barré depuis Parménide, savoir le non-être. La dialectique en elle-même était déjà présente dans le texte de Platon, au grand complet, avec tous ses objectifs, stratégies et tactiques possibles qui font de la République une anticipation du Prince de Machiavel, et rien d'autre.
L'étant ce n'est pas le non-être. L'étant est ce que Hegel conditionnera sous le concept de certitude sensible, dans le même geste chirurgical que celui d'Aristote. Les historiens de la philosophie ont tous reconnu cette filiation directe entre Aristote et Hegel, l'un comme l'autre se refusant à confier leur spéculation à du non-être en tant que tel, non-être qui demeure étranger de facto à toute logique et donc à toute dialectique. Et c'est pourquoi il faudra sans cesse revenir sur la dialectique du Maître et de l'Esclave pour comprendre le tour de passe-passe métaphysique opéré par un Hegel qui n'est pas commandité pour défendre le principe démocratique, mais pour installer ontologiquement la Maison Royale de Prusse. Le mythe de Fritz le Grand est l'image d'Epinal de cette dialectique d'une République sans peuple, d'un droit sans contenu principiel, en bref de l'appareil totalitaire aveugle d'une humanité qui a pris le pouvoir dans l'oubli de son pourquoi. Dans cette soit-disant dialectique qui se jouerait entre un maître et un esclave il y a un passage en force entre la position de l'auto-affirmation du Soi magistral dans le duel où l'esclave doit reconnaître l'autre ou mourir, et celle de l'affirmation du Soi de l'esclave moyennant l'éducation et l'obéissance. Car l'état originel de la maîtrise repose en son essence sur la négativité absolue ou sur son affrontement. En revanche, la maîtrise conquise par l'esclave dans le travail, c'est à dire par la négativité relative du report de jouissance, l'économie bourgeoise pour tout dire, est déjà par essence tout autre chose que la maîtrise réelle. C'est bien pourquoi le geste historique de la révolution demeure incontournable tant que le destin du travailleur demeure rattaché à un défi mortel originel. Ce serait faire fi de la vertu cardinale du maître qui porte le nom d'honneur que d'identifier l'aristocrate batailleur au bourgeois capitaliste. En réalité Hegel raisonne déjà comme Lénine au moment où la Révolution Française est en train de se répandre à travers l'Europe. Il postule la nécessité historique d'une formation de la conscience de soi, conscience de soi qui, dans sa forme spontanée ou innée, serait miraculeusement réservée à une élite. Nous retrouvons là le même mystère que celui de la caverne de Platon à savoir l'existence inexpliquée d'un maître sui generis. Même Marx est tombé dans ce panneau d'une aliénation de la conscience de soi qui exigerait une pédagogie, une " conscientisation " des masses prolétariennes, c'est à dire un parti. Robespierre et Saint Just n'ont jamais commis pareille erreur alors qu'on les pressait de le faire, c'est à dire de construire un véritable appareil politique, une nomenklatura stalinienne. La Terreur n'a donc rien à voir avec les massacres ou les génocides totalitaires du vingtième siècle comme une certaine pensée scélérate ose aujourd'hui l'affirmer avec l'insolence des nervis de la propagande anti-républicaine.
Si Platon avait pu profiter des leçons de son disciple Aristote et s'il était resté fidèle à l'enseignement de Socrate lui-même, il aurait pu donner à sa dialectique un fondement bien plus solide. D'abord il aurait évité les apories inutiles que génère l'anti-concept de non-être en travaillant sur la triade dialectique de l'on, du on è on et du nous. On è on est un équivalent pour einaï, c'est à dire pour l'être puisque cette expression dit textuellement l'étant en tant qu'étant, c'est à dire le présent en tant que présence. A l'âme, par ailleurs, appartiennent aussi bien l'étant que l'être. L'ontologie, ou la question de l'être, se joue donc dans cette dialectique de la conscience aux prises avec l'étant qui la porte et l'étant qui l'entoure. Or le non-être (l'idée de non-être) est réellement un chemin impossible pour l'esprit, pour le nous, car elle implique le non-être du nous lui-même, c'est à dire de la possibilité logique, du logos qui prétend spéculer sur l'étant. L'âme ne peut pas avoir affaire à du non-être, d'aucune manière puisqu'elle appartient elle-même à l'être : postuler la possibilité du non-être c'est en fait mettre fin à toute postulation possible car l'âme disparaît dans l'énoncé lui-même de la négativité absolue. Raison principale pour laquelle Hegel lui-même s'est tenu à distance respectueuse d'une négativité absolue absolument antinomique à toute dialectique. La négativité relative quant à elle est un sous- produit du traitement infligé à l'on grec depuis Platon, une manière de relativiser l'accès à la réalité, c'est à dire d'introduire dans l'âme ce qu'on retire par ailleurs de l'étant. En termes cartésien l'étant se transforme en Être sous la forme de la Mathesis universalis tandis que l'âme descend dans les enfers de l'attribution qualitative , la conscience devient un instrument plus ou moins performant dans un mouvement qui deviendra pour les uns la simple pédagogie, les autres l'Histoire. C'est ici, et nous y reviendrons demain, que prend place la distinction fondamentale entre sophia et phronesis, les deux formes de la sagesse, les deux formes de la conscience telles que l'entendaient les Grecs de l'époque classique et nous tenterons de rendre compte des raisons qui ont amené ces Grecs à opérer une telle distinction.
Notes
7) Martin Heidegger, Platon, le Sophiste, trad. Courtine, David, Pradelle, Quesne, NRF, Gallimard, Paris, 1999
Vendredi 6 juin 2003
L'ETRE CONSIGNE (suite)
Toute l'analyse qui va suivre se fonde sur le commentaire du Sophiste de Platon par Heidegger dont nous avons parlé plus haut. La distinction entre Sophia et Phronesis, sagesse théorique et sagesse pratique, est essentielle si l'on veut comprendre quoi que ce soit à l'ontologie fondamentale. Comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est chez Aristote que le philosophe allemand cherche les matériaux conceptuels pour ensuite s'attaquer au dialogue de Platon dont le sujet est la définition du sophiste. L'enjeu est énorme, car il s'agit en fait de faire travailler une dichotomie logique de la pensée elle-même. La pensée ou l'âme possèdent une double orientation : la première procède du taumazein, l'étonnement. Heidegger fait dériver taumazein de tau maston, à savoir (la conscience) de ce " qui ne colle pas ". La sophia est cette orientation de l'âme qui part de l'étonnement par rapport au plus proche et se dirige vers le panta, le tout. Cette direction est en réalité une impasse au sens où elle prend son départ dans ce qui est à portée de main, l'étant, mais se perd dans l'aporie, l'aporos , le sans passage. La sagesse théorique aboutit toujours à une aporie, elle est " d'une certaine manière au fait de l'étant, et pourtant (elle ne parvient pas) à se frayer un passage " vers la science de l'étant en tant qu'étant, le on è on. Par ailleurs la caractéristique de la sagesse théorique est qu'elle ne peut être d'aucune utilité technique, elle n'a, comme dit Heidegger, " en vue qu'elle-même " ", même si elle constitue une aspiration fondamentale du dasein, de l'existence. La sophia se présente donc comme un désir qui appartient à l'essence du nous8. Heidegger ajoute une remarque particulièrement importante qui alimentera ultérieurement notre propre spéculation sur ce que j'entends pas usure de l'Être : la Sophia est mnémè , elle est la mémoire elle-même, affirmation que nous connaissons depuis Socrate, mais sans jamais en avoir compris les implications essentielles. La première de ces implications est l'idée que le taumazein originel, l'étonnement moteur du désir de connaissance, est lié à l'histoire, à la temporalité. On peut donc en déduire qu'il s'est passé quelque chose dans le temps par rapport à ce désir, une occultation que nous retrouvons sous l'expression heideggerienne de l'Oubli de l'Être.
L'autre forme de la sagesse s'appelle donc la phronesis9. Avant d'en poursuivre l'analyse, disons tout d'un bloc que la dialectique repose tout entière sur cette dichotomie attribuée par Heidegger à Aristote sur la base d'une analyse philologique dont je suis bien incapable d'esquisser la moindre critique. Mais nous n'oublions jamais qu'il s'agit ici d'un jeu conceptuel, d'une spéculation qui, de toute manière blesse la vérité en tant que telle, le seul résultat cherché demeurant la cohérence systématique qui pourrait offrir la possibilité de l'action, et çà c'est bien la finalité première de la dialectique. Le nous , la force de connaître, possède donc un autre aspect, une autre facette dirigée elle vers la praxis, vers la teknè, le savoir technique mais aussi la sagesse politique. La phronesis a trait à l'expérience et donc à l'acquis, elle donne à l'homme la faculté de réagir aux événements de manière conforme et de prendre les bonnes décisions. Les professionnels de la philosophie connaissent les exemples classiques que l'on trouve en particulier dans l'Ethique à Nicomaque d'Aristote et qui illustre le processus de la formation scientifique propre au différents métiers, la médecine, l'achitecture etc… Pourtant, cette sagesse pratique possède également la prétention au savoir du tout, et d'un tout débarrassé des obstacles de l'aisthésis, de la perception qui déforme ou voile la vérité " scientifique " de l'étant. Nous sommes là en présence d'un nœud de l'histoire de la philosophie, disons d'un ventre de la résonance permanente ou du retour perpétuel de la disqualification de l'étant perçu, des objets des sensations, de la matière et en définitive de la présence en tant que présence. On pourrait représenter tout le débat philosophique qui traverse les deux millénaires qui viennent de s'écouler comme opposition théorique entre la prééminence de l'une ou de l'autre qualités de la connaissance, la sagesse pratique et la sagesse théorique, cette dernière définitivement rejetée par le pragmatisme, ce qui résume peut-être le mieux ou définit parfaitement ce dont il est question lorsqu'on parle de phronesis9, savoir la science telle qu'elle est comprise aujourd'hui, processus d'appropriation des éléments constitutifs de l'étant. Au point que la connaissance dite fondamentale la plus élevée dans la hiérarchie des sciences, celle qui s'occupe de la constitution de la matière dans ses éléments les plus purs, la physique des particules, science qui, mutatis mutandis, composait le fond de la recherche ontologique des présocratiques, se révèle aujourd'hui comme simple instrument auxiliaire de la conquête technique de l'étant, du monde.
La mise en consigne de l'Être ressemble donc à une dissection dont chaque élément obtenu se détache pour ainsi dire du reste. Il ne s'agit rien moins que d'un démontage ou d'une mise en kit de l'Être et de sa question, comme on démonte un canon pour le transporter plus facilement sur le lieu de son utilisation. Un tel démontage ne laisse pas de détruire d'un seul coup le milieu réel de la question de l'être ou du moins d'interdire a priori toute utilisation de la question dans son ensemble. Il introduit de surcroît la possibilité de choisir entre faire porter le poids du souçi sur tel ou tel aspect rendu indépendant par ce démontage. C'est tout l'enjeu du platonisme en général, même si Platon était parfaitement conscient de la manipulation qu'il opérait ainsi dans une époque encore entièrement dominée par la prééminence de la question de l'être au sens de la sophia. Platon se tire d'une possible accusation d'escroquerie ontologique en donnant à son analyse du désir ontologique le fondement le plus irréfutable à savoir l'amour. De Saint Augustin à Kierkegaard on sait l'usage que fera la théologie de ce sentiment, sorte de brouillard qui a le pouvoir de se revendiquer à la fois du désir lié à l'étonnement originel mais aussi à l'hybris, la lubricité dévorante de l'appropriation du monde. Ce que Heidegger nommera l'arraisonnement de l'être, traduction relativement fantasmatique du mot allemand Gestell qu'un esprit éduqué dans l'ambiance germanique comme moi a bien du mal à accepter. Mais comme Heidegger l'a lui-même accepté, il ne reste qu'à s'incliner. Pour ma part Gestell est un mot d'une simplicité limpide, il signifie édifice, structure en construction, à la limite planification précédant une fabrication, un bleu d'atelier. Y ajouter l'intention d'un arraisonnement implique à mon sens une projection ou une extrapolation qui seraient plutôt les signes d'une difficulté à nommer ce dont il est ici question, à savoir les intentions, l'intentionnalité propre à l'homme quant à l'élaboration de sa relation à l'étant. Mais le lieu n'est pas ici de reprendre cette interminable discussion sur laquelle nous serons malgré tout contraints de revenir lorsque nous entrerons dans l'effort qui consistera à nous dégager de la spéculation proprement heideggerienne. Reconnaissons pour l'instant que l'essentiel de ce qui précède n'est qu'une explication de texte plus ou moins bonne, à vous de juger, de quelques philosophèmes de base de Martin Heidegger.
Notes
9) A partir de maintenant et pour des raisons de complexité techniques de mise en ligne nous cesserons de mettre en italique et en gras les mots grecs que nous estimerons être devenus familiers à nos lecteurs. Nous conserverons cependant cette pratique pour les mots nouveaux.
Samedi 7 juin 2003-06-06
L'ÊTRE CONSIGNE
Il demeure, quant à cette mise en consigne de l'Être, un mystère : comment et pourquoi ce sont les Grecs qui ont forgé ces outils dialectiques, c'est à dire pourquoi est-ce ce petit peuple morcelé en cités indépendantes dont on ne peut même pas dire qu'ils constituaient une nation ou un empire qui a opéré ce tour de force que l'on ne trouvera ni chez Lao Tseu, ni chez Confucius, encore moins dans les civilisations bien plus puissantes à la même époque comme les Egyptiens ou les Perses. D'autant que cet ensemble disparates de cités n'a jamais réussi ni à s'unir ni même à vivre en paix plus de quatre ans de suite. L'Histoire en tant que science naît, et c'est un comble, au beau milieu du déchirement décisif pour la Grèce, celui qui mettra fin à tout espoir de voir un jour naître une véritable nation grecque, la guerre civile du Péloponèse. Thucydide fut sans conteste le premier historien au sens moderne du terme, il prendra part à cette guerre de quarante ans, parfois peut-être même en compagnie de Socrate qui s'est également battu pour défendre sa patrie Athènes. On peut poser la question autrement : comment un tel ordre conceptuel, un outil de précision dont la solidité n'a pas encore cessé aujourd'hui de faire ses preuves, a-t-il pu voir le jour dans le chaos d'une péninsule fragmentée, d'un peuple divisé a priori par ses origines doriennes et ioniennes dont au surplus le tempérament tenait plus d'une aimable ivrognerie que des vertus guerrières qu'on leur prête souvent trop généreusement.
La réponse est peut-être inscrite dans la question elle-même : c'est l'élément de la division, du divers assumé comme nulle par ailleurs dès l'origine par deux peuples nomades qui se sont rencontrés sur les rives de l'Attique, de la mer de Corinthe et du Péloponnèse. Nulle part les conditions étaient plus mauvaises pour assumer ce mouvement général de sédentarisation qui s'était emparé de l'humanité quelques trois mille ans plus tôt et auquel il était bien trop tard pour se soustraire. Les concepts centraux de l'ontologie platonicienne mais tout aussi bien de celle d'Aristote sont les concepts de kinesis et de stasis, le mouvement et l'immobilité. En fait l'un et l'autre représentent le débat qui se livre avant Platon et Aristote ente Parménide et Héraclite. Les programmes de philosophie des lycées ont au moins banalisé cette opposition présocratique et il n'est guère de bachelier qui ne connaisse l'UN immobile de l'Être parménidien, et le fameux fleuve d'Héraclite dans lequel on " ne passe jamais deux fois ". La Grèce classique est en réalité déchirée entre deux éthiques pratiques, déchirement de part en part historique : tandis que Lacédémone (Sparte) opte de manière décisive pour la position sédentaire absolue, Athènes et l'Alliance qu'elle domine, choisissent la mer et le mouvement du commerce maritime comme base de leur puissance. Or, ces deux agrégats vont devoir s'unir étroitement face à la menace de l'immense empire perse, ce qui signifie bien plus qu'une alliance de circonstance. La menace est mortelle de part la simple disproportion des force. Là où le camp des Mèdes rassemble près d'un million de guerriers et une flotte qui avoisine le millier de bâtiments, les Grecs se comptent en dizaines de milliers et comptent à peine deux à trois cents navires de guerre. Et pourtant la victoire sur la Perse sera totale. Sans l'immensité de ses ressources quasi inépuisables, les victoires célèbres, terrestres et navales de Marathon et de Salamine, aurait mis fin définitivement à la puissance de la Perse. Elle n'aurait pas pu continuer à jouer le rôle délétère qui eut finalement raison de la Grande Grèce.
Cette victoire est essentiellement symbolique de la possibilité d'une alliance entre l'immobile et le mouvant, entre le sédentaire et le nomade, entre stasis et kinesis. Or si cette alliance est possible et si elle est féconde à ce point, c'est qu'il existe la possibilité d'une médiation entre les deux, ce que Platon va nommer le dialegesthaï, le dialectique. Sans être helléniste ni philologue, il n'est pas difficile de distinguer au moins deux éléments constitutifs du mot, à savoir dia, deux, et legesthaï, la pratique du logos, la parole. Historiquement, l'hostilité naturelle qui oppose Sparte et Athènes peut trouver un terrain d'entente par la parole. Mais pas n'importe quelle parole, non pas la parole qui se contente de confronter des positions de force, mais d'harmoniser l'action, le conjuguer les forces originellement opposées. Or cette nouvelle puissance de la parole, du logos, est le produit d'une invention athénienne, la démocratie. La dialectique est très exactement la logique interne du débat démocratique. Certains historiens de l'Antiquité prétendent que la monarchie spartiate aura finalement été plus fidèle à l'essence du débat démocratique, étant entendu que la société spartiate n'avait rien de commun avec celle d'Athènes, c'est à dire que cette dialectique démocratique n'avait pour acteurs qu'une infime minorité opposée par une violence permanente aux deux-tiers de la population formés d'immigrés et d'esclaves. A Athènes la situation est légèrement différente car d'une part le sort fait aux esclaves n'est pas en permanence fondé sur la force et la menace, d'autre part la constitution ouvre toutes sortes de portes aux étrangers qui leur permettent d'acquérir la citoyenneté athénienne. Sparte est en état de guerre civile permanente, la chasse aux rebelles fait partie de l'entraînement des jeunes guerriers, de leurs jeux auxquels ils sont encouragés. Le résultat historique pour la Grèce entière de cette différence sera catastrophique. La naissance de la démocratie provoquera à terme une scission qui traversera toute la société grecque, qu'elle appartienne à l'Alliance d'Athènes ou à celle de Sparte. Chaque cité sera elle-même divisée entre forces démocratiques et forces monarchiques ou oligarchiques ce qui donnera à la guerre du Péloponèse l'allure d'une véritable guerre civile à l'échelle de toute la péninsule hellénique et de la Grande Grèce dont les cités partagent à distance les opinions de leurs cités-mères. Nous conclurons ce chapitre en mettant l'accent sur la proximité elle-même dialectique entre l'élaboration des concepts ontologiques et la réalité historique des Grecs. Cette dynamique restera l'élément dans lequel se déroulera l'Histoire occidentale elle-même et nous verrons demain comment le Christianisme s'est emparé de la dialectique pour la pervertir dans le sens du monarchique, c'est à dire dans le sens de ce qui à cette époque se jouait comme l'échec d'Athènes et un peu plus tard comme l'échec de la République romaine.
Mardi 10 juin 2003
La chronique que vous allez lire est une parenthèse qu'impose non pas ce qu'on appelle l'actualité, mais un sentiment de profonde indignation qui me saisit depuis près d'une heure à l'écoute de France-Culture, une radio du service public qui vient semble-t-il de torpiller le forum Internet sur lequel ses auditeurs pouvaient encore se manifester. Ce lien a été rompu, et pour cause, les interventions que l'on pouvait y trouver peuvent se résumer en une litanie de critiques de plus en plus amères et de plus en plus indignées de ce qu'est devenu le programme d'une radio qui était le refuge de beaucoup de Français sincèrement dévoués à la cause de la réflexion, d'un traitement intelligent et courageux de l'actualité, d'une méditation plus profonde des paramètres de nos existences. Traditionnellement, France-Culture était le seul contrepoids au matraquage droitier de la quasi totalité des médias français. Courageusement les journalistes, les animateurs et les producteurs, les techniciens aussi qui ont eu fort à faire dans le passé pour que cette radio financée par le contribuable puisse passer correctement à l'antenne sur des fréquences que le privé grignotait chaque jour un peu plus. Je peux encore me souvenir d'une époque dans les années 90 à Strasbourg où NRJ s'était placé à quelques millihertz de FC, je ne sais pas si c'est une mesure correcte mais peu importe, le résultat faisait qu'il était pratiquement impossible de recevoir France-Culture correctement. Or, depuis que la ligne éditoriale a totalement changé, depuis que cette radio, autrefois libre dans le sens le plus réaliste du terme, est devenu un porte-parole de plus des forces aveugles du marché et des idéologies qui le soutiennent, France-Culture a obtenu toute la puissance qu'il faut, presque la même que Radio Vatican en Italie, cette radio qui couvre tout le pays avec une puissance fabuleuse et sur de nombreuses fréquences.
Ces derniers mois, les auditeurs ont pu constater une dérive de plus en plus évidente vers une multiplication de sujets religieux. La religion peut avoir une place dans la culture, personne ne conteste cela, mais la place que FC a décidé de donner au religieux frise aujourd'hui le scandale. Ce matin nous avons eu droit à l'invitation de Monsieur Henri Tincq, que tous les lecteurs du Monde connaissent bien pour avoir été le chroniqueur religieux de ce quotidien dont nous avons hélas aussi dû constater le déclin intellectuel et moral. Monsieur Tinc a donc écrit un livre, raison pour laquelle il était invité. Ce matin j'ai cru rêver en entendant cette expression surréaliste au cours de la discussion : l'intégrisme laïc. La seule présence de cette expression sur l'antenne d'une radio qui passe pour celle des gens qui pensent librement et honnêtement me révulse. Que peut bien signifier dans la réalité, celle de tous les jours, celle que vivent les gens qui lisent la presse, regardent la télévision et écoutent les radios, l'intégrisme laïc ? Je rêve. Evidemment, le sujet caché, le magot de l'affaire, c'est évidemment ce qui se passe en ce moment à Bruxelles où des " Constituants " préparent une Constitution sous la houlette de Valéry Giscard d'Estaing. Or le Pape, oui le Pape, vous avez bien entendu, exige que l'on fasse référence à Dieu et à la religion dans ce que les Allemands appellent la Loi Fondamentale de la future Europe. Monsieur Tincq n'est donc pas là par hasard, il est là parce qu'il fait parti du lobby qui prétend introduire dans notre future constitution européenne quelque chose du genre " Gott mit Uns ", ou bien encore comme à Washington : " With God on our side ". Et France-Culture donne la voix au représentant de ce lobby !!!!
S'il faut passer pour un intégriste de la laïcité, alors je veux bien endosser cet attribut, mais je voudrais bien savoir ce que cela veut dire ? Comment la laïcité, qui n'est rien d'autre que la liberté de penser, la liberté d'opiner pour ce que vous voulez sans imposer vos vues à qui que ce soit, comment cette laïcité peut-elle se transformer en intégrisme ? C'est à pleurer. Mais ce n'est pas tout, Monsieur Tincq, et le journaliste complaisant qui fait mine de l'interviewer, mais qui en réalité se contente de lui tendre un micro, se chagrinent du fait que Dieu ne soit plus présent dans l'école française, tombent dans les bras l'un de l'autre en reconnaissant que l'on est allé trop loin dans l'exclusion des églises de l'école, dans le maintien des élèves dans l'ignorance des fables religieuses !!!! Je rêve ! Le cursus secondaire se termine par un degré dans lequel on enseigne la philosophie, philosophie qui se trouve être à 99 % de la simple théologie masquée, et il faudrait encore enseigner la Bible et le Nouveau Testament dans les écoles, et aussi, bien entendu le Coran et le Talmud !!!! Je rêve. Non la religion ne fait pas partie des connaissances, désolé, elle fait partie des fables idéologiques qui ont toujours prétendu prendre la place de la réflexion et, ce qui est plus grave, de la liberté de penser. Ce cri d'indignation auquel je vais mettre un point final, n'est pas si étranger au contexte de ce journal N°7, car la réflexion ontologique qui s'y développe est précisément une analyse de fourvoiement de la pensée dans le théologique, cette manière de dominer les masses sous des règles aléatoirement déterminées par quelques prêtres et appliquées d'une main de fer par un appareil ecclésiastique qui n'a jamais faibli dans ses tentatives pour s'emparer du pouvoir.
Mercredi 11 juin 2003
L'ÊTRE CONSIGNE (suite)
Cette parenthèse n'aura été qu'une demi parenthèse, il s'agirait plutôt d'une sorte de saut temporel de l'analyse des faits qui forment le cadre réel de la réflexion philosophique qui, elle, a lieu au deux extrémités de notre histoire. Car le problème de la laïcité peut trouver son pendant chez les Grecs même si les dieux du polythéisme demeurent, là, tout à fait en-dehors du coup, passez moi l'expression. La laïcité chez les Grecs, et ceci est une thèse tout à fait nouvelle du moins dans sa forme, concernait le culte du génos, la famille. Les véritables dieux des dèmes ou des tribus de l'Hellade n'étaient rien d'autre que leurs ancêtres ou leurs lignées. Le problème de leur laïcité se posait donc en termes tout à fait différents : fallait-il donner à la famille une importance et un caractère sacré qui pouvait justifier que l'on organisât la société d'après son modèle, ou bien fallait-il tirer un trait sur les empiètements du culte des ancêtres sur la vie politique. En termes moderne cela pourrait se dire simplement : fallait-il rester bien ancré dans le tribalisme, celui que nous décrions avec tant d'arrogance partout où subsiste encore des formes tribales d'existence sociale, ou bien fallait-il rompre avec la suprématie du dème, du clan et de la tribu. En d'autres termes, nous retrouvons ici la problématique de Monsieur Le Pen qui préfère son frère à son cousin, son cousin à son voisin etc… Il faut bien saisir toute la dimension révolutionnaire d'une volonté exprimée à cette époque dans le sens d'une remise en question de la prééminence du génos, de la famille. L'invention de la démocratie constitue cette révolution qui donne sur l'agora d'Athènes : un vote, une voix, autrement dit le pouvoir dissous dans une société qui efface d'un coup l'influence des tribus (on peut leur donner le nom si bien venu de lobby, puisque les famille se définissent par rapport à un lieu qui est l'oïkos, le domicile, le lieu où la famille se rassemble comme se rassemblent dans les lobbies des hôtels les groupes qui défendent des intérêts privés par rapport à la chose publique) l'influence des castes soudées autour du patriarcat le plus traditionnel. Mais cette alchimie politique s'accompagne d'une mutation du langage : les tenants d'une politique fondée sur le principe dynastique ou familial, ne mâchons pas les mots, défendront deux points de vue légèrement différents mais sur le fond identiques : la forme despotique et/ou la forme oligarchique, aristocratique. Les autres vont inventer le Démos, le peuple anonyme qui se forme à chaque fois qu'il se rassemble. Le fait que ce peuple n'est constitué que de citoyens, c'est à dire d'hommes libres, ne change rien à la différence radicale qui s'installe ainsi dans la pratique politique grecque, disons athénienne puisque Sparte n'acceptera jamais cette forme démocratique même si, je l'ai déjà signalé quelque part, des historiens affirment que les mœurs des lacédémoniens se seraient toujours révélé d'une plus grande pureté démocratique à l'intérieur même de son cadre monarchique. Oui, vous ne rêvez pas, il y a même une grande dose de vérité dans cette affirmation contradictoire en elle-même car la monarchie spartiate pratiquait dans son cercle une démocratie encore plus rigoureuse que celle d'Athènes, mais ce cercle ne sortait pas de la famille. Sparte, un peu comme Carthage, était en fait dirigée par une gérontocratie donnant ses ordres de près ou de loin. Il ne manque pas d'exemples de monarques qui se sont heurtés à ces conseils d'anciens au point d'en perdre leur pouvoir et même parfois d'en périr.
Cette révolution (loin d'être terminée, exactement comme la grande Révolution Française), va de pair avec une vie littéraire et philosophique dont on ne peut pas la dissocier. La tragédie classique, celle de Sophocle en particulier, Sophocle qui fut le camarade de classe de l'inventeur de la démocratie Clisthène. La trilogie d'Œdipe est le récit de la critique sur scène d'une existence placée sous le pouvoir de la famille. Un certain doigté littéraire nous obligerait à éviter de comparer le théâtre grec avec le théâtre que nous connaissons aujourd'hui, au sens où la plupart des chercheurs ou penseurs qui se sont penchés sur ce phénomène ont dû reconnaître une grande dimension religieuse de cette forme artistique. On est assez d'accord aujourd'hui pour voir dans le déroulement d'une tragédie classique de cette époque une sorte de rite religieux plutôt qu'un divertissement. La thèse d'Aristote sur la représentation théâtrale comme catharsis relève plutôt des effets d'un rituel collectif ayant une finalité précise qui est d'exorciser les démons du génos pour ouvrir l'espace public, en fait pour inventer l'espace public. Du point de vue philosophique les choses se passent différemment, mais suivent de près l'évolution de la situation concrète de la République grecque. Si Platon construit une République oligarchique dissimulée sous le concept d'un état dirigé par les philosophes, il faudra attendre quelques années pour que Aristote donne ses concepts fondamentaux à la raison oligarchique. Le texte fondateur de toute la rationalité philosophique des monarchies qui vont suivre l'effondrement de la démocratie grecque et romaine, est bien la Politique d'Aristote où la famille redevient le sème originel, le paradigme de l'être-ensemble des humains, c'est à dire où la dimension sociale de l'être humain passe du côté de la physis, de la nature. Comprenons-nous bien : Aristote est le premier penseur à poser la famille comme fondement de la Cité. Il faut en finir avec le flou artistique qui entoure la vie politique gréco-romaine et rendre compte rationnellement de l'échec de la République et de la démocratie, puisque aussi bien l'époque où Aristote donne ses premiers cours arrive après l'effondrement définitif de l'Alliance démocratique athénienne écrasée dans la guerre du Péloponèse. Je rappelle à tout hasard qu'il fut aussi le précepteur d'Alexandre le Grand, fils de Philippe et futur empereur d'une Grèce qui durera le temps de ses conquêtes. Cette opération littéraire et philosophique sera reprise et durcie lorsqu'il sera question quelques siècles plus tard de fonder le droit naturel et tout ce qui tourne autour de cet être que désormais tout le monde considérera naturellement comme un être naturellement social. Marx donnera quelque temps dans le piège, mais comprendra finalement que le social, expression moderne du familial, n'est qu'une utopie ou plutôt une idéologie dont le capitalisme a encore besoin pour gérer son propre pouvoir oligarchique. La société en fait, n'existe tout simplement pas, elle n'est qu'une fiction rassurante destinée à cimenter un système d'exploitation qu'illustre parfaitement l'expression contradictoire en elle-même " société anonyme ". Si la société, en effet, est l'expression développée de la famille, comme le prétend Aristote, l'anonymat constitue une contradiction insoutenable, ou plutôt la manifestation concrète de la disparition, non seulement de l'illusion sociale, mais encore de ce qui restait de la famille concrète. Le capitalisme est bien l'avènement de l'individu solitaire et en même temps, et c'est ce qui nous intéresse le plus, le démenti de la thèse aristotélicienne sur la naturalité de la Cité. Car il s'agit moins d'un avènement que d'un retour à une situation où il n'était même pas encore question de cité.
Nous sommes nous éloigné de la problématique du Sophiste et de la méditation sur le mouvement et le repos, sur l'un et le multiple, en bref de la question de l'Être ? Non seulement je ne le pense pas, mais je pense au contraire que nous sommes au cœur de la question. Dans les jours qui viennent nous tâcherons de montrer comment se met en place l'oubli de l'Être, c'est à dire comment on le relègue dans une substantivation qui ouvre la voie à deux millénaires et quelque de monothéisme dominant toute réalité politique, sociale et individuelle. J'ajoute que le retour à un homme seul, à l'individu libre de tout lien clanique ou tribal est une sorte de retour naturel (parce que historique) à la situation du citoyen grec dans la République, mais aussi à celle de l'homme d'avant toute société, toute cité, l'homme nomade de la préhistoire.
Jeudi 12 juin 2003
Ce douze juin sera une journée historique. Avez-vous suffisamment conscience de ce que signifie la qualité d'historique ? Pour s'en approcher au mieux on peut faire appel à l'idée ou au concept utilisés et inventés par Martin Heidegger avec son mot " Destinal ". Destinal est un néologisme parallèle à cette autre idée de l'historial qui se distingue de l'historique précisément dans le sens d'une valeur essentielle qui s'opposerait à une valeur épiphénoménale. Phénomène contre épiphénomène. Pour les idéalistes, et notamment ceux du dix-neuvième siècle, ceux qui ont fondé notre République et en grande partie le sens et la structure idéologique de notre existence, le phénomène n'est pas seulement l'aspect immédiat des choses, leur reflet qui nous parvient à travers notre perception, mais bien le résultat de la volonté et de la liberté de la pensée, de la conscience de la personne. L'une des transformations les plus remarquables de l'enseignement de la philosophie dans nos écoles et dans nos universités, est l'occultation quasi absolue de cette philosophie tardive, au sens qu'elle vient dans une sorte de fin de course de la métaphysique occidentale, mais aussi dans une véritable tentative de synthèse de toutes les grandes philosophies idéalistes des siècles précédents. Renouvier, Comte, Hamelin ou Lequier sont des noms qui ont pratiquement disparu des enseignements les plus pointus, et pourtant tout le débat politique, social, ontologique ou religieux qui traverse notre réalité française demeure profondément informé au sens d'Aristote par la pensée de ces demi-fous qui croyaient à la liberté, à la laïcité même si leurs système demeurent tous comme verrouillé par un théisme logiquement incontournable et un rejet littéralement maladif de tout substantialisme (Spinoza), de tout matérialisme ou même des réalismes en clair-obscur tels que nous pouvons en trouver chez l'un des plus célèbres penseurs, à savoir Descartes. Ces philosophes de l'ombre qui hantaient les couloirs des universités mais aussi ceux des allées du pouvoir politique, avaient une ambition, celle d'allier une idée de la praxis sociale placée sous l'impératif de la liberté de conscience et d'expression et celle d'une recherche permanente de la vérité, un recherche qui allait plus loin qu'une simple étude sans fin des logiques, des structures sémantiques ou des systématisations possibles des idées de tout bord, mais qui avait la prétention de changer la réalité dans son actualisation même : vous avez bien compris, ces hommes qu'on a oublié pensaient très sérieusement que c'est la pensée qui crée le monde. En idéalistes absolus, leur monde est un monde de phénomènes créés par les conscience liées entre-elles, les déterminations n'étant que le produit de l'accumulation des déterminations historiques des volontés individuelles tout au long de l'histoire humaine. Le point d'achoppement d'une telle thèse, qui ne se distingue pas tellement du monadisme leibnizien10 , est évidemment le lien qui unit ces consciences démiurgiques, et ce lien ne peut se concevoir autrement que par la postulation d'une conscience absolue, d'une conscience divine qui demeure le paradigme ou l'idéal absolu des consciences individuelles soumises au " finitisme " ou à la finitude. Le comble dans la situation de ces hommes d'une honnêteté scrupuleuse et qui appartiennent à cette bourgeoisie européenne qui pensaient élaborer sincèrement une ère nouvelle pour les peuples et pour l'existence de l'homme sur cette terre, est que ce théisme, non seulement ne renie pas la laïcité mais l'exige avec la volonté la plus énergique. C'est que le Dieu qui est la clé de leur façon de penser est une clé logique dont chacun peut se faire sa représentation pourvu qu'elle tende vers les valeurs fondamentales qui se subsument (pardon pour ce jargon) toutes sous la dichotomie devenue célèbre dans les philosophies dites existentialistes comme celles de Kierkegaard, Sartre ou Heidegger : liberté - vérité. En fait il s'agit d'un problème proprement technique : les consciences individuelles, les " monades " de Leibniz, sont piégées par la nécessité d'une définition de ce qui les relie. Baignent-elle dans une substance qui fait la liaison, mais alors nous sommes dans un réalisme ou un matérialisme inacceptable qui remet en question la liberté elle-même, ou bien sont-elles pour ainsi dire connectées par une conscience première qui " enveloppe " l'ensemble des consciences en leur fournissant les contenus des valeurs absolues, objets de la volonté individuelle ?
La réponse est : Spinoza ou pas. Ce qui est inacceptable pour ces hommes épris avant tout de liberté, c'est le panthéisme qui, selon eux, implique une absolue nécessité, une fatalité qui exclue toute possibilité de liberté. Spinoza aura été depuis son passage dans le ciel de la pensée occidentale l'objet d'un " Vade retro Satanas " général, mais non pas à cause des arguments que nous venons de présenter, mais parce que le système de Spinoza écarte d'un geste empreint d'une douce mais irréductible volonté toute idée d'une légitimation possible des églises et des fabriques d'idéologies. Pour les idéalistes dont nous parlons depuis le début de ce texte, c'est la République qui était en cause, et c'est là toute l'erreur de ces demi-fous de la liberté qui n'ont eu qu'un seul et unique tort, celui d'avoir intégré l'Etat hégélien tout en réfutant massivement sa logique et son ontologie. Ils ont confondu République et Etat, confusion dans laquelle se déroule tout le drame du présent, sa tragédie et qui a créé ce monde où se côtoient les surhommes sous leurs gilets de GI, les hommes qui s'entretuent en Palestine, et les sous-hommes qui se massacrent ici et là sous l'œil bonace (j'utilise ici sans pitié le mot de Rimbaud) des observateurs de l'ONU qui n'y comprennent goutte et ne cherchent même pas à comprendre ce qui se passe autour d'eux.
Cette journée est historique parce que cette réalité d'une triple humanité se noue aujourd'hui même dans tous les domaines où l'on peut porter le regard. Mais vous me direz que cela ne change guère d'une journée à l'autre depuis des mois, des années, des décennies. Certes, mais l'historial se joue aujourd'hui sur ce site qui ne se joue pas la fête de l'anniversaire, le dixième, pour se gratter le nombril et se complaire dans le narcissisme général. Cet anniversaire, qui est un faux anniversaire parce qu'en réalité ce n'est pas le site qui a dix ans, mais le Journal qui en fait la substance, la substance dans laquelle se déroule tout le reste et se condensent parfois des textes plus systématiques, plus construits, parfois littéraires, parfois poétiques, toujours tendus vers la recherche de la liberté et de la vérité. Les textes qui figurent sur ce site ont été déposés, non pas dans une quelconque association de protection des droits d'auteurs ou de je ne sais quel copyright, mais dans les fonds de l'Association pour l'Autobiographie, cette association fondée par Philippe Lejeune et gérée de manière dynamique par une équipe d'idéalistes qui, au fond, tentent de se faire une idée de l'homme du présent. Or, ces textes ne sont pas simplement empilés dans une cave sous l'étiquette Dupont ou Durant, mais ils sont lus et commentés, et ces commentaires sont alors publiés dans la revue qui commence à sortir de l'ombre et qui a certainement un grand avenir devant elle, la revue qui s'appelle " La Faute à Rousseau ". Rousseau, je le rappelle, a été l'un des premiers individus à oser s'exposer au regard des autres dans des confessions auxquelles on ne peut pas comparer d'autres journaux personnels comme ceux de Montaigne. Rousseau a ouvert, déchiré faudrait-il dire, le sujet vivant, palpitant de vie, de douleur, de plaisir, de peur et de souffrance. Il a osé.
Mes textes ont donc été lus, mes journaux interminables ( je renonce à afficher le poids informatique des textes car je pense qu'ils ont découragé plus d'un lecteur ) ont fait craquer l'un des lecteurs et ceux qui ont pris la relève sont resté perplexes. C'est que mes journaux sont, selon leurs commentaires, très difficiles à classer et surtout impossibles à identifier simplement comme un Journal intime, personnel, étalant mon intérieur dans la vitrine de l'écriture. Non, mes journaux sont des textes " hybrides ", mélange de réflexions personnelles, d'élaboration philosophiques ou politiques, de descriptions d'expériences personnelles, mais aussi parfois aveu de mon monde intérieur, de mes sentiments, de mes douleurs, de mes peurs et des mes bonheurs, surtout de mes bonheurs. Le problème est ce que disait l'un de mes professeurs de l'Ecole de Journalisme de Strasbourg, mes textes sont, paraît-il, invendables. Invendables car la norme, le critère de l'écriture aujourd'hui c'est bien entendu la " vendabilité " de chaque chose y compris l'écriture. Pourquoi invendable ?
Là est la question et là est la réponse. L'homme que je suis est tout entier dans ce Journal et comme je l'annonce dans la toute première introduction, je ne fais rien d'autre en écrivant chaque jour ou presque - il m'est arrivé aussi de rester longtemps sans produire de chronique parce qu'il me fallait me consacrer à la rédaction d'un ouvrage différent, de ceux dont je parle plus haut - en écrivant mes journaux, je ne faisais donc que laisser passer ce qui traînait dans ma tête, ce qui hantait jour après jour ma conscience et dont j'avais acquis par mon travail de journaliste, par la vie de tous les jours et aussi par mon expérience de professeur de philosophie, le talent de la description, la faculté d'en rendre compte par l'écriture. Il est grandement vrai que l'on n'écrit jamais que ce que l'on lit, et il est vrai que beaucoup de mes chroniques portent sur mes lectures, mettent au jour mon débat avec ce que je lis puisque la lecture est mon activité principale, quel que soit le domaine ou le support où je vais chercher des textes et des sujets traités par l'écriture. Autrement dit il peut aussi bien m'arriver de critiquer un article du Monde qu'un traité de métaphysique où d'un commentaire à la télévision, autre forme de lecture. Mais il peut tout aussi bien m'arriver d'écrire tout simplement ce qui s'est condensé dans mon esprit à propos de n'importe quel sujet, qu'il porte sur l'histoire de l'Empire romain ou de la guerre en Afghanistan, ou encore de la question des retraites. Alors, vous pensez, comment vendre tout ce fatras, car il s'agit d'un fatras, non ? Vous avez déjà mis votre nez dans mes journaux, ne s'agit-il pas d'un fatras tout à fait bordélique (il paraît que le mot bordélique est désormais accepté par l'Académie, alors je ne me gêne pas) ? Comment vendre un produit aussi informe, aussi dénué de substance commercialisable parce que non ciblé, parce qu'il refuse de s'intégrer dans un domaine, dans un espace déterminé et labellisé, dans un ordre littéraire, philosophique ou simplement professionnel ? Non Monsieur Kobisch, votre camelote ne se vendra jamais, et de fait ON E ON est resté quasiment lettre morte pendant 5, 6 ans ? Au début, curieusement, le Web était presque désert, c'était en 1996 et Internet était à peine né en Europe, et curieusement c'est à cette époque que j'ai le mieux vendu mon site, mais vendu au meilleur sens du terme, c'est à dire tissé des liens avec d'autres internautes que mes textes semblaient intéresser et qui eux-mêmes se lançaient dans la pratique de la libre expression, de la bouteille à la mer comme je le dis souvent. Mais subitement les choses ont changé, le réseau s'est tu et je me contentais d'enregistrer grâce à ces petits compteurs qui existent depuis très longtemps, le nombre abstrait de personnes qui accédaient chaque jour à mes textes.
Beaucoup d'entre vous connaissent le parcours du combattant de l'informatique. Ceux qui comme moi pratiquent ce sport depuis les années 80, ont suivi l'évolution technologique toujours aux dépens de leur porte-monnaie, et je ne sais plus combien de fois j'ai changé de PC et de tous ces logiciels qui ne cessaient de monter en puissance et en fonctionnalités. A chaque nouvel engin, il fallait tout recommencer, tout remettre en ordre, en ligne, en forme, transcoder, bref refaire le monde que l'on avait péniblement mis en ligne avec l'aide du fils ou de la compagne surdoués, car je peux vous l'avouer, mes compétences réelles en informatique ne dépassent guère celle d'un usager certes expérimenté, mais restant toujours en-deçà du mystère des fonctions et de leur langage. Tout ça pour dire que mes compteurs sont souvent reparti de zéro, et si je devais faire une estimation du nombre total d'Internautes qui sont passés chez moi, je dirais une dizaine de milliers de personnes, un chiffre qui s'étale sur sept ans, époque de la mise en service du site immédiatement nourri par le travail de préparation stocké sur mes différents disques durs. C'est peu et c'est énorme. C'est peu si vous faites une simple division dans le temps, c'est beaucoup si vous comparez ce chiffre à la vente d'un livre en librairie. Un tirage de dix mille exemplaire, c'est pas mal et je ne suis pas mécontent de ce résultat. Tout cela pour en revenir à l'essentiel, à savoir la raison pour laquelle je prétends dans la première phrase de cette chronique exceptionnelle, que ce jour est historique. Hé bien, il l'est pour deux raisons essentielles : la première est que les compteurs se sont emballé et que mes lecteurs se comptent désormais en centaines par jour. Il est vrai, pourquoi ne pas l'avouer, que j'ai eu recours à des outils du réseau Internet qui ne sont rien d'autre que de la publicité. Oh, peu de choses, des bannières ici ou là, pendant quelques jours, selon les échanges que je peux effectuer gratuitement car je suis bien trop démuni pour me payer une véritable publicité. Si j'étais riche, mon site aurait depuis longtemps connu les honneurs des rubriques informatiques de la presse nationale et internationale, mais je n'ai jamais cultivé ces liaisons qui m'ont toujours paru artificielles. J'avais tort. J'avais tort à cause de la deuxième raison, et cette deuxième raison va répondre à la perplexité de mes lecteurs de l'APA qui n'ont pas encore compris réellement le fond et la finalité de mon écriture, de ce genre " éclaté ", de ces commentaires de café du commerce ou d'amphithéâtres d'universités. Cette raison est simple et limpide : je suis comme tout le monde, je représente à ma manière l'homme du présent, l'homme issu de 62 années d'existence dans ce monde de la guerre et de l'après-guerre. Je ne suis donc pas Montaigne, ni Rousseau ni même celui pour lequel je cultive une admiration quasi métaphysique à savoir ce Pascal moderne qu'est Valéry. Voilà, je donne, je vous donne ce que je suis, et je ne suis qu'une monade parmi les monades qui se ressemblent beaucoup plus que personne ne pourra jamais le penser. Depuis quelques années ceux qui me lisent admirent mon écriture. Oh tu écris bien, Ah si j'écrivais aussi bien que toi je serais déjà Président de la République (sic). Si je peux vous donner mon avis sur la question, je dirais qu'un seul de mes textes recèle quelque valeur littéraire, c'est mon texte auto-biographique, dont on a d'ailleurs également critiqué le caractère hétérogène : décidément ce Kobisch ne peut pas rester dans son sujet, lui-même, il faut toujours qu'il aille commenter ce qu'il y a au dehors !! Zut et Flûte ! Oui zut et flûte, je suis ainsi fait et je pense que je représente un modèle plus commun que ne le pensent ceux qui ont fait la critique, certes toujours élogieuse de mes textes, mais sous-entendant une sorte de trahison du genre auquel eux-mêmes ses sont consacrés. Tant pis pour eux, mais il fallait comprendre autre chose qu'une simple dérogation au principe de l'autobiographie, il fallait comprendre que l'époque de ces autobiographies étaient passées comme sont passés Montaigne, Pascal ou Rousseau. Refaire ce qu'ils ont fait n'a pas de sens, car qu'est le sens sinon l'appartenance au présent, le fait de faire partie de ce patchwork de consciences hic et nunc, de ce tableau vivant de pensées et d'actes qui défile sous le soleil d'aujourd'hui. " Sous le soleil " est le titre d'un sitcom bien connu et que j'ai bien du mal à supporter, mais le concepteur est un malin car il a compris cette solidarité de fait des actions et des pensées humaines sous le sourire moqueur de l'astre qui chauffe St Tropez mais aussi le monde entier.
Oui je suis moi, mais je suis aussi le Tutsi des massacres, l'Irakien torturé par les sbires de Saddam Hussein ou traité en sous-homme par les surhommes de Bush. Oui, je suis le Palestinien qui appuie sur le déclencheur fatal et l'Israélien qui appuie sur le bouton rouge du manche de son hélicoptère. Je suis le monsieur qui va chez le docteur tous les mois pour se faire délivrer les remèdes à ses maux, le père d'enfants qui cherchent vaguement un futur tout en se prélassant sans pudeur dans le présent, l'amant angoissé d'être ou de ne pas être, le Chef de Cabinet de là où ça décide sans rien décider, bref je suis un échantillon que la vie a éclaté dans de multiples peaux, dans de multiples consciences, la vie mais aussi ces nouveaux moyens d'être témoin, voyeur des choses lointaines. Tenez, cette femme qui se bat contre les généraux birmans, je suis avec elle depuis des années. Mais je suis aussi avec Ben Laden, je n'hésite pas à m'approcher d'une telle horreur, cette horreur que le hasard m'a fait vivre en direct, rien ne me rebute car tout est humain. Et je suis sûr que nous sommes tous pareils, la seule différence étant que nous n'avons pas tous le loisir et le talent de le dire comme je le fais. Aussi le courage, la fausse modestie me révulse, le courage car je sais que ON E ON me vaudra un jour autre chose que des compliments et de la gloire, peut-être même le pire. Car je suis aussi Galilé ou Giordano Bruno qui est mort sur le bûcher pour beaucoup moins que tout ce qu'ai écrit dans ce journal. Lorsque les services de surveillance de Big Brother auront fait leur rapport définitif sur ON E ON et que la conjoncture se sera dégradée au point que la violence reprendra le dessus du réel, alors on viendra me chercher là d'où j'émets, là d'où j'écris, là d'où je reproduis ce que beaucoup de citoyens du monde pensent sans pouvoir le dire, parce qu'ils n'en ont pas le droit ou parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Oui, je les attends, ou plutôt je m'attends à tout comme en Mai 68 lorsque les commandos Delta de l'OAS dressaient les listes des étudiants à descendre en premier et trépignaient dans les antichambres des Préfectures pour qu'on leur donne le feu vert.
Le présent, c'est tout ça. Ou plutôt ce sont tous ces possibles. Car l'histoire, et je pense que le seul mérite de mon Journal est de le montrer, n'est jamais exactement la réalisation et la répétition des mêmes causes et des mêmes effets. Elle suit aussi et d'abord la ligne que lui impose la seule réalité créatrice, la libre pensée, la pensée libre au point d'unir par sa seule présence les hommes qui s'y reconnaissent. Vous êtes de plus en plus nombreux à distinguer dans ON E ON des choses qui vous concernent, qui vous disent quelque chose qui vous est propre, des idées que vous pensiez intimement vôtres, des pensées dont vous croyiez être la source unique et originale. Alors bien sûr il y a toujours quelque chose de gênant dans cette sorte de rivalité qui se dessine. Certains écrivains et penseurs actuels me font peur tant leur pensée et leurs idées ressemblent aux miennes. Mais cette peur est ridicule parce que sur ce point les idéalistes de l'école de Jules Ferry avaient parfaitement raison : nous sommes des consciences en rapport les unes avec les autres, que nous dialoguions ou non à longueur de journée, et le langage lui-même naît et se transforme dans ce rapport qui passe par le monde qui sort de nos mains. Combien de mot pensons-nous avoir inventés nous-mêmes alors qu'ils naissent en même temps dans des milliers de têtes, comme la rencontre des émanations d'un présent travaillé par les consciences, souffert par les consciences, rendu assez cohérent précisément par ces relations à la fois secrètes et à la fois tellement évidentes, tellement visibles dans la clairière de notre époque. Alors ON E ON, qui signifie en fait " la clairière en tant que clairière ", le " visible en tant que visible " ou le " présent en tant que présent ", n'est qu'un lieu de rencontre. C'est un point de vue, comme un belvédère, où chacun peut chercher en quoi nous sommes tous identiques et en quoi nous demeurons chacun essentiellement singuliers : l'autobiographique ce n'est que cela, le singulier ; alors comme je ne suis ni une star du cinéma collectif, ni une star de la pensée ou de la science, je vous offre le tout, le commun, le collectif et un peu de singulier par-ci par-là parce qu'il ne faut pas cracher dans sa propre soupe. Et pour en finir avec ce pensum qui commence à vous taper sur les nerfs, je ne dirai plus qu'une seule chose aujourd'hui : bon anniversaire à ON E ON et bon vent !
Vendredi 13 juin 2003
Gauchisme et Démocratie.
Las ! une fois de plus je vais déroger à ma décision de vouer ce journal à la réflexion philosophique, ce qui n'était sans doute pas une si bonne idée, d'autant que personne ne semble saisir l'intérêt du suivi quotidien de la construction d'un ouvrage aussi ambitieux. Ecrire en direct devrait constituer un " spectacle " excitant pour ceux qui ont une expérience de l'écriture ou ceux qui apprennent à la pratiquer. La raison pour laquelle j'assume une telle dérogation est simple, je ne peux et ne veux pas me dérober à un débat politique ou d'actualité certes facticiel, mais je suis précisément de ceux qui ne font aucune différence entre la pensée et l'action, pas plus qu'entre l'être et la pensée. Ma seule réserve est la crainte de me voir me répéter sur des thèmes que j'ai déjà mille fois traités dans mes Journaux, mais le travail de journaliste qui fut malgré tout mon métier pendant plus de deux décennies, est précisément de répéter en adaptant ou d'appliquer des principes à des situations nouvelles, de faire travailler la morale sur ou dans le réel quotidien. Bref, toute véritable voix est " éditoriale " au sens où elle porte sur l'instant et constitue un traitement principiellement inchangé de faits sans cesse changeants.
Aujourd'hui les débats sont multiples et confus : la guerre qui revient, les réformes de la République qui s'intègre à l'Europe, d'autres réformes fondamentales pour l'existence des citoyens et le sort de droits acquis, non pas comme semblent le suggérer les ennemis de la démocratie, par des ruses malsaines, mais par des luttes réelles dans lesquelles il y a eu des victimes qui ont payé de leur vie ou par une moins-value de leur existence, le prix de ces acquis. Il existe un exemple d'acquis dont on ne parle jamais et pour cause. L'exemple qui m'est cher remonte à Rome, deux siècles avant JC lorsque la patrie était menacée par les hordes d'Hannibal. Dans les moments cruciaux de la campagne militaire, la République romaine a demandé à la grande bourgeoisie riche de financer cette guerre parce que l'état était tout simplement incapable de le faire, le trésor étant vide. L'aristocratie romaine s'est exécuté en échange d'une reconnaissance de dette grevé d'intérêts qui était un acquis certain puisque l'état aurait pu tout aussi bien réquisitionner les richesses exigées par le salut de Rome sans reconnaître une quelconque obligation de remboursement d'un bien qui a servi à sauver tout le monde. Or Romme a remboursé rubis sur l'ongle, et cela pendant des siècles au point qu'il a fallu multiplier les conquêtes pour accumuler les sommes énormes qu'il fallait récupérer sous la forme de butin. Selon certains historiens cet épisode aura été la cause profonde de la naissance de l'Empire et du déclin de la République, la guerre perpétuelle étant devenue une nécessité morale intérieure, celle de respecter les engagements envers l'oligarchie, ses acquis, capital et intérêts.
Or l'inverse n'a pas d'exemples autres qu'épisodiques. Lorsqu'un général s'engageait à relever la solde avant une bataille ou de raccourcir le temps d'engagement, ce qui était fréquent, la chose allait de soi faute de quoi le général se faisait trucider. Mais examinons maintenant le cas des acquis sociaux de l'Europe au cours de ces deux derniers siècles. Rien ne distingue moralement ces deux genres d'acquis, d'un côté comme de l'autre il s'agit d'un engagement réciproque, de la signature d'un contrat qui met fin à telle situation de lutte où qui exprime la victoire d'une fraction de la société sur une autre par le biais de l'action démocratique. Mais dans tous les cas le principe contractuel est clairement établi. Or les réformes entreprises par les divers gouvernements depuis presque trois décennies se révèlent, à l'aune de cette comparaison, comme de véritables délits de ruptures de contrats. Lorsque le gouvernement actuel décide de modifier les critères de la retraite dans le sens qu'on sait, il manque à son engagement démocratique originaire. Les citoyens, qu'ils appartiennent à la classe des fonctionnaires ou pas, se voient littéralement spoliés par un système politique qui se fonde sur une légitimité électorale qui ne lui donne en rien le droit de rompre des engagements antécédents. Je l'ai déjà dit ailleurs, le contrat qu'un jeune citoyen passe avec l'état en devenant par exemple facteur est un contrat qu'aucune légitimité majoritaire ne peut avoir le droit de rompre ou de modifier sans son accord. Le droit contractuel est clair sur ce point.
Face à la rigidité morale de cette attitude, l'état a deux arguments, ou plutôt un argument et un instrument à faire valoir. L'argument est le réalisme d'une situation qui réclame objectivement des réformes. Le financement des retraites est menacé à terme etc… A cela il faut répondre ceci : si Rome a su rembourser ses compradores richissimes, l'état français peut en faire autant dans une situation inquiétante. L'état peut même changer la loi d'une manière tout à fait démocratique, mais en en réservant les effets aux générations qui vont entrer dans le marché du travail et sans rompre ses engagements envers ceux qui ont déjà signé. La démocratie peut toujours amender des lois qu'un gouvernement trop cupide pourrait rendre par trop drastiques. Or dans le cas présent, il ne s'agit même pas de la situation présente, mais d'une projection sur l'avenir, ce qui est en effet le devoir des politiques, mais ce qui renforce encore l'obligation de réserver ces réformes aux entrants sans trahir les actifs. Rome est un exemple lointain, mais aujourd'hui l'endettement de l'état est exactement de même nature, or ces engagements-là ne sont jamais remis en question, ces contrats seront respectés quoi qu'il arrive !!! Seuls quelques états africains terriblement pauvres ont eu le privilège de se voir attribuer un moratoire sur tout ou partie de leur dette extérieure. Ce qui, je le rappelle en passant ne fait pas perdre un centime aux prêteurs, car l'argent prêté est depuis longtemps revenu dans les banques de ces mêmes pays riches.
L'instrument dont dispose l'état pour lisser ou arrondir l'aspect trop voyant de sa trahison, ce sont les syndicats. Les syndicats prétendent se substituer à la volonté des salariés en décidant de refuser ou d'accepter les réformes au nom de ces mêmes salariés. Mais de quel droit ? Quel article de la Constitution donne le droit aux syndicats de négocier directement avec les pouvoirs publics au nom des salariés ? Aucun. Le statut des syndicats n'a aucune assise juridique qui leur attribuerait un tel pouvoir : ce pouvoir ils le prennent parce que l'état en général le leur tend dans son propre intérêt. Il n'en va pas de même dans certains pays comme l'Allemagne où les syndicats ont un pouvoir de cogestion de l'économie, un pouvoir démocratiquement géré dans les entreprises et dans les services publics. Mais lorsqu'on examine de près le fonctionnement et la base juridique du syndicalisme français, on se rend compte que le droit du travail est aux mains d'un appareil parfaitement anarchique. Je ne citerais qu'un exemple de l'anarchie du rôle joué par les syndicats en France : lorsqu'un conflit dégénère, le gouvernement ou l'entreprise s'arrangent toujours pour obtenir l'agrément d'un ou deux parmi les dizaines de fédérations et passez muscade. Or quelle loi permet à l'état de décider de la représentativité de tel ou tel syndicat plutôt que tel autre ? C'est ce qu'on appelle le bordel juridique, un bordel qui rend caduque toutes ces réformes qui trahissent la confiance des citoyens frappés au beau milieu de l'exercice de leur contrat. Si les syndicats étaient intégrés sur une base juridiquement légitime, on ne verrait même plus la nécessité d'entretenir des Inspections du Travail.
Alors les grévistes sont des gauchistes irresponsables ? Non, ils font usage de l'article de la Constitution qui autorise le citoyen à se rebeller contre l'état en cas de trahison de cette même constitution. D'ailleurs le vote de la future loi sur les retraites devra passer devant la Cour Constitutionnelle, et malgré la couleur politique de cette institution, le jeu est loin d'être joué, il reste encore quelques êtres moraux dans ce pays quelles que soient leurs convictions politiques. Pour terminer, je voudrais dissiper d'un coup l'opinion qu'on pourrait se faire sur mes idées politiques : si, en effet, je milite pour le respect des contrats passés, je n'ai rien contre une renégociation de chaque contrat au cas par cas, une telle attitude du gouvernement prouverait sa bonne foi et surtout la logique de son soit-disant libéralisme. J'ai proposé ailleurs cette solution qui peut paraître ahurissante mais que je n'hésiterais pas un seul instant à accepter si l'état me le proposait, à savoir le remboursement de toutes mes cotisations, personnelles et patronales en Euros constants augmentés d'un intérêt moyen minimum pour les périodes considérées. En l'état actuel de mes prévisions de retraite j'ai calculé que je serais gagnant en gérant moi-même le capital ainsi remboursé. En tant que citoyen je ne suis pas différent d'un chevalier romain possédant dix mille hectares de bonne terre ou d'un PDG d'une transnationale qui possède dans ses coffres des montagnes de Bons du Trésor. Vale.
Samedi 14 juin 2003
Soyons positif. Le libéralisme dont j'entends parler à l'instant sur France Culture semble avoir coincé toute opposition dans une position de critique et de défense. Tout ce qu'on peut faire, semble-t-il, c'est d'être contre, et l'opposition socialiste la première se montre incapable de faire des propositions qui soient autre chose que la défense de principes, ce que je ne remets pas en cause, mais lorsque la défense se replie sur elle-même comme défense pure et simple de ce qui est, cela n'a même pas de sens, car cela révèle seulement l'impuissance de ces responsables politiques d'imaginer autre chose, de contrer les libéraux sur le terrain du mouvement des choses et de l'évolution que le temps, nolens volens, impose aux choses.
Je partirai du point de vue selon lequel le libéralisme représente une tendance profonde de la société contemporaine, mais une tendance qui date de très longtemps puisqu'elle se confond pour moi avec l'histoire de la métaphysique, cette forme de pensée qui a produit l'individu et donc le libéralisme. Il est malheureux que les rationalistes du 19ème siècle soient littéralement passés sous silence dans notre enseignement, car on peut y distinguer les fondements d'une vision " monadique-indivualiste " de la personne. La personne est devenu une composante de base de nos " sociétés ". Je mets société entre parenthèse car je suis d'accord avec Marx pour penser qu'il n'existera de société que composée d'hommes libres et égaux. Autrement dit toutes les formes de société qui ont existé et qui existent ne sont que des conglomérats organiques d'êtres humains plus ou moins bien, justement, " organisés ". Oui, je veux dire par là qu'il faut assumer l'individu une fois pour toute dans toutes les conséquences qu'entraîne une telle reconnaissance de la personne. Cela ne signifie pas la destruction ou la négation de ce derrière quoi tout le monde se réfugie pour dénoncer cet individualisme concret, à savoir la solidarité.
La solidarité (in solidum) n'est pas un principe de charité ni le culte des beaux sentiments. C'est cette confusion qui aveugle tout le monde et surtout la gauche. La solidarité est une forme structurelle et juridique qui doit garantir la liberté et l'égalité des citoyens, et cette forme est parfaitement adaptable à un monde dans lequel doit disparaître la dépendance réciproque dans laquelle nous vivons. La droite surfe sans problèmes sur cette nécessité de modifier les conditions sociétales dans lesquelles la personne ne peut jamais se définir comme telle et pourtant ici et là affleurent des idées qui se concrétisent dans des mécanismes secondaires et qui pourtant nous donnent des perspectives beaucoup plus vastes pour l'ensemble de la structure de fonctionnement de l'être-ensemble des humains. Ainsi les socialistes ont inventé le chèque anonyme qui simplifie totalement la gestion des petits travaux de ménage et qui couvre ces salariés précaires automatiquement. Cette petite idée est une grande idée car elle sous-tend la possibilité d'imaginer de nouvelles formes de salariat extensibles à de vastes espaces comme l'Europe par exemple. Il faut en effet détacher le travailleur des contingences liées aux entreprises dans lesquelles il est appelé à travailler au cours de son existence et au caprice des entrepreneurs par rapport au pouvoir d'achat qu'il distribue sous forme de salaire. Si l'état peut encore jouer un rôle dans l'économie, c'est celui de la régulation et tout le monde le reconnaît. Il faut donc donner à cette régulation ses véritables dimensions, c'est à dire une généralisation qui mette les producteurs et les consommateurs à l'abri des phénomènes aléatoires liés au caractère privatif qu'impose l'individualisme : le capitalisme ou la propriété privée doivent, non pas être rayés de la réalité au profit d'une classe sociale, mais au contraire étendus universellement dans leurs principes : ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les salariés ou les travailleurs ne sont même pas propriétaire de leur travail parce qu'il n'existe pas de véritable marché du travail. Mais cette absence n'est que le pendant de l'absence de marché tout court. Je rappelle ma vulgate économique en deux mots, tant qu'il n'y aura pas d'équivalent général universel, c'est à dire de monnaie unique dans le monde, il ne peut y avoir de marché. L'Europe vit en ce moment même cette réalité en découvrant son marché interne dans toute sa vérité grâce à l'Euro. Imaginez le phénomène au plan mondial ! Ma vulgate n'est pas une affirmation gratuite, il faut préciser, pour ceux qui ne me lisent pas régulièrement, qu'une monnaie nationale demeure un représentant politique et un marché qui repose sur une multiplicité de monnaie est forcément un marché politisé d'office. Vous n'avez qu'à constater les effets des manipulations politiques sur le dollar pour tout comprendre.
Il est évident qu'au plan politique d'aujourd'hui on ne peut rien envisager en-dehors de l'Europe, même s'il est vraisemblable que le processus de mondialisation réel, c'est à dire l'unification des conditions d'un véritable marché, va avancer à un rythme beaucoup plus rapide qu'on ne l'imagine parce que la crise du faux marché actuel est en train d'atteindre ses limites. Le monde est en voie d'anarchisation totale parce que le capitalisme tel qu'il est représenté par les puissances anglo-saxonnes a lui-même perdu son dynamisme créateur et l'imagination nécessaire à sa survie. L'anarchie politique qui règne dans le monde n'est que le reflet de ce désordre fondamental. La régression vers le religieux, qui n'est pas un phénomène réduit aux pays en voie de développement mais se manifeste avec éclat dans le pays le plus puissant du monde, ne traduit que le désarroi réel de tous les décideurs. Ce désarroi provient de deux grands facteurs : le premier est la fin du colonialisme (dont on voit la nostalgie dans le comportement des Bush, Blair et consort)(l'anti-colonialisme américain est le mythe le plus ridicule qui soit, la doctrine Monroe n'est guère différente de la bulle du Pape qui donna à l'Espagne le privilège de l'exploitation des Indes Nouvelles), et le deuxième est l'acculturation massive des peuples. Le temps du troc colonial est révolu et la conscience s'unifie autour de la nature réelle de la richesse c'est à dire de l'existence, voilà ce qui échappe aussi aux penseurs actuels du marché. Le modèle de vie comme consommation de verroterie ne se vend plus ni dans les marchés intérieurs ni dans les marchés extérieurs. Personne n'est dupe : l'attentat du onze septembre est une contestation essentielle du mode de vie et non pas un terrorisme politique ou religieux.
Il est d'autant plus essentiel que l'Europe prospère et se développe dans la dynamique de l'unification. Unification = ouverture. Elle doit faire en sorte de demeurer à l'écart des initiatives politiques du géant américain, les fauves blessés sont dangereux et on le constate déjà dans la poursuite de la logique de guerre qui se manifeste dans le Moyen-Orient. Depuis quelques jours on sait que Bush a lancé une opération de déstabilisation de l'Iran. Dans quelques semaines il est à prévoir que les Européens vont à nouveau se trouver devant des choix cruciaux.
Dimanche 15 juin 2003
J'ai parfaitement conscience d'avoir un peu tourné court sur les aspects concrets de ce que je nommais hier le positif et les produits possibles d'une imagination dégagée des préjugés politiques actifs. Pour la gauche comme pour la droite ont peut à l'infini rechercher les responsabilités idéologiques, les anciens cancers à moitié résorbés et qui continuent de suppurer en produisant surtout de la confusion. Par exemple la théorie du phalanstère de Fourrier porte une aussi grande responsabilité dans la paralysie pratique de la gauche que le principe dynastique continue de pourrir tous les soubassements des discours de droite. Pourquoi ? Parce que, fidèles aux postulats qui tiennent pour acquis la naturalité de toute société, la socialité comme essence humaine, les socialistes n'ont jamais su s'adapter à une philosophie du sujet, de l'individu responsable, continuant de faire confiance aveuglément au sentiment. La gauche est coupable de sentimentalisme sociétal et n'a pas le courage de rendre à l'homme sa responsabilité essentielle. La droite refuse, elle de rendre à l'individu les conditions réelles de l'exercice de cette responsabilité tout en la prônant haut et fort.
Hier j'avais évoqué les miettes d'idées qui pouvaient ensemencer la méditation sur de nouvelles pratiques, sur une nouvelle praxis qui dépasserait cette double paralysie. Le salaire universel peut, en effet, se concevoir sur la base d'un anonymat lié à la compétence. Ce que j'ai omis hier d'ajouter, c'est que pour concevoir une pareille réforme, il fallait également repenser l'évaluation des individus par rapports aux compétences exigées par le marché. Or, là aussi il existe des idées déjà largement élaborées sur le concept d'une carte de compétence, c'est à dire d'un programme informatique qui pourrait servir de carte d'identité des compétences. Il ne s'agit de rien de très différent que de la Carte Vitale. Cette idée provoque à gauche un véritable scandale alors qu'elle n'offre à l'individu que des avantages si toutes les précautions légales sont prises pour évacuer de la constitution de ces cartes tout possibilité de la voir fonctionner comme un vulgaire " sommier " c'est à dire comme une Extrait de casier judiciaire. L'idée est simple, il ne s'agirait ni plus ni moins que d'un CV électronique comportant à la fois les compétences acquises dans l'enseignement, c'est à dire les titres ( il est clair que doivent demeurer exclus de ce genre de résumé toute indication portant sur des jugements de valeur), d'où aussi la nécessité d'universaliser, en Europe en premier lieu, la valeur des diplômes, mais aussi l'expérience professionnelle. On peut dès lors établir des péréquations qui permettent de calculer des valeurs et déterminer automatiquement le montant en pouvoir d'achat. Ainsi le travail deviendrait enfin une propriété véritable, au sens d'une richesse librement exploitable sur le marché. J'ajoute que cette forme pratique permettrait aussi à la personne d'ajouter en permanence de nouvelles compétences et de s'enrichir réellement par l'étude. L'un des problèmes sur lesquels avait achoppé Marx était la différence de qualité qu'on ne peut pas nier entre des compétences dont l'investissement de formation à duré des années avec les compétences qui se passent pratiquement de formation. Il avait déjà compris qu'il était possible d'établit ces péréquations et de faire un calcul juste, au demeurant capitalistique puisque des études longues représentent en effet une prise de risque (on le voit aujourd'hui avec le problème des retraites et les gens qui commencent à travailler avec du retard sur ceux qui entrent sur le marché du travail à 16 ans) autant pour les parents que pour le sujet.
Voilà, je reviendrai sur ces questions qui me paraissent essentielles et je ne voudrais pas qu'il s'introduise des malentendus que de telles positions peuvent créer. La prudence est ici de mise tant sont proches les limites des possibilités d'adapter la technique contemporaine à nos destins individuels. Mais c'est possible, comme il est possible - et tout le monde commence à le savoir - d'adapter notre démocratie aux nouvelles technologies et de la transformer dans le sens d'une démocratie plus authentique.
Lundi 16 juin 2003
J'ai parlé hier de cancers qui suppurent, ce qui n'est pas une image très exacte, mais elle est une métaphore et rien qu'une métaphore. Or, la société, comme le savent ceux qui commencent à être familiers avec mes thèses, est malade par définition, mais avec des nuances selon les nations considérées. Par rapport à ces pathologies sociales le citoyen a des droits et des devoirs, le droit d'être informé et protégé, le devoir de se tenir informé et de partager son savoir et ses analyses. L'affaire de Toulouse est l'un de ces abcès de collectivité auquel on ne saurait soustraire son attention et son jugement, même s'il est impératif d'éviter de se substituer d'une manière ou d'une autre à la justice ni même d'exprimer des convictions qui pourraient influencer l'opinion. Dans toute affaire de justice, la conviction est l'affaire des juges et des jurés et personne ne peut se substituer à ces représentants légaux de l'exercice de cette justice. Il est donc très difficile de participer en tant que citoyen à ce lavage de linge sale national.
On a pu voir hier sur Canal + le drame d'un journaliste, Karl Zero, aux prises avec un problème de conscience qui consistait à se demander s'il était légitime par rapport à sa déontologie de diffuser une interview particulièrement chargée d'émotions et dont les conséquences sur l'affaire elle-même seront lourdes. Honnêtement, Karl s'est adressé à trois de ses confrères pour analyser son propre travail, brainstorming moral qui n'a pas donné grand chose d' autre que le soutien de deux d'entre eux contre la hargne évidente du troisième. En tant qu'ex-journaliste de télévision j'ai été extrêmement sensible à cette situation, un cas qui se présente fréquemment dans ce métier et mon jugement sur l'attitude de Karl Zero est simple : la télévision informe, et l'interview qu'il nous a présentée est un élément d'information, point final. Il faut accepter la singularité de l'effet télévisuel et le formidable pouvoir de participation aux événements qu'il offre aux citoyens. Il n'y a donc aucune raison de cultiver quelque remords que ce soit à propos de cette interview. On sait depuis longtemps que le reportage télévisé est un stimulus ou un accélérateur fort des processus sociaux parce qu'il mobilise l'opinion autour des faits qui troublent leur existence. Il s'agit d'un progrès dans la participation démocratique à la vie collective dont on connaît depuis longtemps les conséquences du musellement pratiqué ici et là dans le monde et dans l'histoire.
Cela dit, la seule critique que j'aurais faite à cette exposition sans commentaire d'un témoignage aussi fort, est l'absence d'un cadre analytique. Le journaliste de Marianne a fait allusion à cette carence, et il avait parfaitement raison, mais, à la décharge de Karl Zéro, je dirais que la télévision ne peut pas tout faire parce qu'elle ne dispose pas toujours des images qui doivent soutenir une analyse ou bien que ces images sont hors de prix. Une minute d'image de la guerre de 14-18 coûte, si je me souviens bien, la bagatelle de 600 Euros. Par ailleurs la presse écrite est bien là pour donner aux faits ce cadre historique qui fait défaut au témoignage brut de décoffrage. Alors, quelle analyse peut-on faire d'une telle affaire, sans empiéter sur les prérogatives de la justice et sans préjuger de quoi que ce soit aux dépens de l'un ou l'autre de ses protagonistes. Pour ma part, j'ouvrirais une analyse sous forme d'interrogation : est-ce-que cette affaire, si elle se présente comme le laissent entendre les témoignages auxquels on a déjà pu être confronté, représente un changement ou une évolution par rapport à la pathologie française moyenne ? Autrement dit, y-a-t- il du neuf dans cette affaire par rapport à l'état général de la société française telle que nous nous la représentons aujourd'hui ?
Pour répondre à cette question sans prendre parti, je proposerais une autre question alternative : cette affaire représente-t-elle un rapprochement de nos mœurs avec celles que l'on connaît dans d'autres pays ou non ? Je m'explique. La situation telle qu'on peut la fantasmer à partir des faits qui sont désormais connus (même s'ils ne sont pas encore vérifiés ou du moins régulièrement enregistrés par un juge d'instruction) est à peu près la suivante : une grande ville, des meurtres commis par un tueur, tueur qui aurait bénéficié de protection politiques et judiciaires pendant un certain laps de temps. Moi, cela me fait penser immédiatement à ce qui fait le fond classique du polar américain. Mais pas seulement du polar, car je tiens pour une différence sociologique essentielle entre l'Amérique et l'Europe, le fait incontestable que les meurtres de sang sont beaucoup plus fréquents aux EU qu'en France et en Europe. Je rappelle des chiffres que j'ai déjà donnés quelque part dans ce journal, à savoir une moyenne française de 800 assassinats par an, pour 24 à 25 000 aux EU. J'ajoute que la moyenne française est représentative de la moyenne européenne. La disproportion est donc facile à calculer, de même que celle qui existe entre le nombre de crimes élucidés et de crimes non élucidés. Je vous renvoie aux statistiques des Ministères de la Justice américain et français, avec de la chance et beaucoup de ténacité vous trouverez confirmation de ces chiffres.
La question s'éclaircit donc progressivement : sommes-nous victimes d'une " américanisation " de nos mœurs ? C'est une question qui me paraît la plus cohérente par rapport à d'autres évolutions qui vont exactement dans le même sens. La " libéralisation " sauvage qui envahit la vie économique n'est rien d'autre qu'une américanisation de nos comportements économiques. Je ne parle même pas des aspects apparemment mineurs de l'américanisation culturelle de notre existence, tout ce qui va de la consommation alimentaire jusqu'à celle des produits médiatiques qui forment un pourcentage énorme du loisir culturel des peuples du monde entier au demeurant. Faut-il en conclure que l'Amérique exporte non seulement des habitudes liées aux produits de sa technique, mais qu'avec ces habitudes s'introduisent en même temps pour ainsi dire clandestinement des attitudes morales nouvelles, ou, autrement dit, une nouvelle amoralité qui semble directement liée aux mœurs sociales et économiques qui font le cadre de la vie des Américains ? Encore plus simplement : la criminalité américaine est-elle en train d'essaimer à travers le monde ? La signification profonde de cette question est en fait celle-ci : le mépris de la vie que reflètent les chiffres de la criminalité américaine gagne-t-il du terrain à travers le monde, parallèlement à l'extension de ce qu'on appelle le marché libéral ? Voilà, me semble-t-il, la question que la presse devrait prendre à bras le corps, en mettant cette interrogation en parallèle avec la religiosité de plus en plus ostentatoire des autorités aux USA et des menaces qui pèsent sur l'avenir des institutions européennes de voir s'y introduire ce même esprit sectaire, ce même mépris pour la vie des individus. Les faits divers sont tout sauf divers. Ils sont le reflet exact de l'état moral d'une société. Nous devrions y être d'autant plus attentif que nos sociétés européennes sont loin d'avoir trouvé leur homéostase, la stabilité que reflète le nouveau concept de développement durable. La perspective de voir cette Europe présidée par un personnage aussi douteux que le Chef de l'état italien me fait froid dans le dos : nous sommes à la veille d'une crise européenne décisive, prenons-en conscience, c'est déjà ça.
P.S.
J'aurais pu et dû ajouter à toute cette ébauche d'analyse que le phénomène qui porte le nom fumeux d' " insécurité " ainsi que toutes les violences que l'on attribue si généreusement au jeunes générations des banlieues appartiennent à cette américanisation des mœurs et à ce mépris grandissant pour la vie. Les anciens truands se disent eux-mêmes écœurés par la radicalité aveugle et glaciale des nouvelles méthodes de brigandage. Il faut remonter à des siècles bien obscurs, je pense au 17 ème en particulier, pour retrouver cette sauvagerie qui ne mérite même pas le nom de prédation. Le Marquis de Sade ne racontait pas de boniments.
Mardi 17 juin 2003
La fatalité de l'Europe.
Je pense que le 11 septembre 2001 était calculable. Non pas sur la base de l'accroissement des forces terroristes ou seulement hostiles au géant américain, mais parce qu'il était nécessaire qu'il se produisit un événement de taille à ébranler les relations transatlantiques. Curieuse manière de raisonner diront immédiatement beaucoup d'entre-vous, et cependant il faut bien constater aujourd'hui que c'est l'attentat du WTC qui a provoqué à moyenne distance une entame de fracture entre le continent nord-américain et le continent européen. En remontant en arrière dans ce journal, vous pourrez constater que cette dérive était prévue depuis fort longtemps dans mes spéculations, dérive qui donne lieu aujourd'hui au fond des commentaires inquiets des experts et des décideurs gouvernementaux français et européens. Je veux ici les rassurer.
Primo, des affirmations hâtives comme celles de Monsieur Moïsi aujourd'hui dans le Monde et autrefois mieux inspiré, selon lesquelles l'Europe aurait subi des dégâts quasi irréversibles du fait des choix français et allemands lors de la guerre irakienne, ne doivent pas être prises au sérieux. Depuis que l'on sait qu'il y a dans l'air plusieurs projets de transferts des locaux de l'OTAN en Pologne ou en République Tchèque, on comprend beaucoup mieux les enjeux des choix faits par ces pays dans les moments qui ont précédé l'attaque anglo-américaine. Il s'agit seulement et rien que seulement de ce travers du présent politique qui affecte tout l'espace occidental et qui consiste dans ce que l'on pourrait appeler la politique des " coups ". Imaginez le gâteau que représente le transfert de plus de quatre mille emplois de Bruxelles à Varsovie ou Prague pour des pays qui dépendent essentiellement du marché européen pour ce qui concerne la préservation de leur croissance. Messieurs Kwasznievski, pardon pour l'orthographe, et l'étonnant Monsieur Vaclav Havel n'avaient que cette belle pâtisserie alléchante en vue lorsqu'ils ont pris aussi résolument le parti de Washington. Lorsqu'ils auront enfin compris que le coût de ce transfert est de nature à décourager les Américains eux-mêmes, et qu'il n'aura en réalité jamais lieu, et ceci pas seulement pour des raisons à court terme mais parce que l'OTAN est condamnée à disparaître du fait que la scission transatlantique est bien plus essentielle qu'il n'y paraît.
Elle est de nature rationnelle, et les raisons sont toujours calculables. Quelles sont ces raisons ? L'actualité économique en dessine chaque jour avec plus de précision les contours : si l'Europe ne s'affirme pas face à l'Amérique, elle est condamnée à une tiersmondisation à très court terme. J'avais annoncé il y a déjà plusieurs années le trend qui va conduire au retour des protectionnismes, et les nouveaux conflits qui naissent sur le terrain des relations commerciales transatlantiques ne font qu'accélérer ce processus. L'Amérique est économiquement sous une contrainte de repli protectionniste de loin plus pressant que l'Europe qui possède un poumon pratiquement illimité à l'Est. C'est la formule de De Gaulle et de son Europe de Brest à Vladivostok ou de l'Atlantique à l'Oural qui prend maintenant tout son sens. Nos remuants candidats, qui viennent de prouver avec éclat qu'il sont en fait demandeurs massifs d'Europe, vont donc se calmer rapidement et nous verrons cela dans les compromis auquel ces pays se montreront bientôt prêts lorsque les choses deviendront sérieuses. Car il ne faut pas oublier que le construction ou la reconstruction de ces pays a déjà commencé avec notre argent, l'argent des premières Europes, et que ce processus ne saurait durer sans un sage alignement sur la philosophie de Bruxelles et de Strasbourg.
L'Europe est fatale, non pas parce que l'on aurait posé des bases inébranlables et optimales, il y a beaucoup à dire sur pratiquement tous les accords signés depuis le Traité de Rome jusqu'à celui de Nice. La fatalité vient d'ailleurs, elle provient de l'Histoire, d'une histoire dont le reste du monde, à l'exception du Japon, a été préservé, l'expérience de la mort totale, d'une barbarie telle qu'elle n'a jamais existé dans l'histoire connue des êtres humains. Et à ce sujet je voudrais rappeler l'incompréhension profonde dont a fait preuve l'Amérique face à cette barbarie pendant la deuxième guerre mondiale, au beau milieu du problème. Je pense que tous les Juifs, y compris les Juifs américains, resterons toujours hermétiques à toutes les explications réalistes qui voudraient justifier la non-intervention des Alliés conscients de ce qui se passait à Auschwitz et dans les 499 autres camps de concentrations disséminés en Allemagne. Washington aura beau continuer à tenir Israël à bras le corps envers et contre les pires menaces, ce pardon-là ne sera jamais donné. Je pense que l'alliance anglo-américaine actuelle, même si elle provoque déjà des tensions très fortes en Grande-Bretagne, repose sur le partage de cette double culpabilité dans les années 43 et 44. Ne soyons pas naïfs, les impératifs stratégiques nés avant même que Hitler ne lance ses forces sur l'Union Soviétique, ne permettaient pas de distraire la moindre force tactique, voire seulement diplomatique, étant entendu que Berlin et Washington n'ont pas cessé de se parler jusqu'au dernier moment. Un grand Suédois est mort pour avoir voulu nager à contre-courant de cette stratégie. Le rôle du réseau Canaris- Gehlen pendant et après la guerre a été de prolonger cette stratégie en réalité concoctée en commun dès le début de l'opération Barberousse.
Pour finir revenons à notre sujet : l'Europe est déjà détachée du Bloc Atlantique et le demeurera vraisemblablement longtemps, c'est à dire très exactement jusqu'à ce que l'Amérique soit guérie de son indigestion hégémonique. Il faut sortir d'une idée de l'Histoire statique, idée qui ne permettrait pas de comprendre, par exemple, pourquoi Rome, malgré sa puissance pratiquement illimitée, a fini par sombrer dans un déclin inéluctable et qu'aucune force ne pouvait arrêter. Bien sûr, l'Europe devra affronter des épreuves dont l'assomption n'est pas garantie et le risque demeure pour elle de se soumettre finalement quand-même au paradigme américain, mais ce sera alors de l'intérieur, par un manque de vigilance sur la question centrale du religieux, objet réel de ce qui définit aujourd'hui l'américanitude, si on me permet ce néologisme hideux, hideux comme la guerre.
Mercredi 18 juin 2003
Gouvernance, connaissance, naissance. Ces trois mots sur le modèle desquels s'est créé un concept aussi prestigieux que la différance, adaptation du mot différence qui forme une sorte de base logique de la vision " anti-métaphysique " de Jacques Derrida, ont un statut verbal et grammatical étrange. Il ne sont ni de véritables substantifs, ni de véritables verbes. Ils sont un entre-deux qui manifeste peut-être le mieux la grande difficulté du langage à rendre compte de ce qu'on appelle la dialectique, c'est à dire la dynamique des rapports entre les êtres, les réalités, les monades, bref tout ce qui passe pour singulier dans l'universel de l'Être. Ces mots, néanmoins, ne sauraient exister sans leur socle chosal, c'est à dire sans un substantif qui en désigne de manière logiquement délimitée le concept et le sens. C'est en quelque sorte la revanche de Parménide sur les prétentions à la mobilité des réalités ontologiques. Ainsi, le mot gouvernance ne saurait-il être remplacé par gouvernement, puisque ce mot est lui-même un adverbe dont la substantivation est une grossièreté stylistique et logique. Le seul mot qui puisse désigner la chose de la gouvernance est le mot " souveraineté ", mais on voit tout de suite les différences qui distinguent radicalement les signifiants gouvernance et souveraineté. Ce qui cache beaucoup de choses, on n'en doute pas. Le mot connaissance a plus de chance, puisqu'il possède pour les initiés un double chosal qui s'appelle la cognition. Mais, mais qui se sert d'un tel mot, sinon quelques érudits totalement débranchés du registre linguistique commun ?
Le cas du troisième mot est beaucoup plus complexe, la naissance ne possède, semble-t-il, aucun droit à la choséité, et cela paraît assez logique puisque naître est en soi une action qui appartient à la continuité du mouvement de la génération, et on ne voit pas comment on pourrait lui trouver un correspondant chosal, un substantif qui puisse le représenter en tant que phénomène stable au point de mériter l'immobilité ontologique d'un substantif. Il en va ainsi du mot donner, dont il existe bien un substantif sous la forme de donation, mais la donation (sauf en philosophie qui se permet comme la poésie toutes les fantaisies) ne désigne en réalité non pas le fait de donner, mais la chose donnée elle-même, ou bien, tout au plus une autre forme verbale cachée par un article, le fait de donner. Or, il existe bien un mot pour substantiver l'action de donner, ce serait le don, mais le don souffre également d'un faiblesse logique par rapport à l'action propre de donner, car il représente plutôt une attitude morale logiquement opposée à deux autres actions, celle de recevoir et celle d'échanger. Lorsque je donne un objet à quelqu'un, il n'existe pas de mot pour désigner cette opération sans l'enfermer dans un cadre moral, c'est pourquoi je dois toujours faire usage de l'expression " faire don de ", ce qui nous renvoie à nouveau à l'absence d'un véritable substantif. Or il se trouve que les impératifs de la circulation des œuvres d'art aient contraints, sans doute pour des raisons juridiques, le linguiste et l'académicien à fabriquer un véritable substantif qui est le mot dation. Une dation n'est ni la donation elle-même, ni le fait de donner, mais l'idée concrète d'une action de donner débarrassée de toute valeur morale. Les dations Garnegie ou Gulbekian sont bien des dons, mais des dons d'une espèce particulière parce qu'ils s'adressent aux collectivités et impliquent certaines conditions et règles qui les distinguent autant d'un legs que du simple fait d'en aliéner la propriété au profit de quelqu'un d'autre. Une dation transfère en réalité un Droit, transfert qui s'opère entre celui qui jouit privativement d'un bien et ceux qui en jouissent collectivement, d'où la nécessité juridique de " solidifier " le concept.
Hé bien la naissance a également trouvé, un jour, son équivalent chosal, le substantif qui permet de considérer le phénomène de la naissance à la fois sous les traits d'une action passagère et sous la forme d'un objet concret qui en renferme l'essence ou le principe, et ce mot c'est le mot de nation. J'ai parfaitement conscience de radoter d'une certaine manière parce que j'ai déjà fait allusion, il y a quelques années à cette postulation parfaitement personnelle, mais qui me paraissait indispensable si l'on voulait comprendre la notion même de nation. Concept qui, contrairement à ce que dit ce matin Théodore Zeldin sur France-culture, remonte au moins à la République romaine, et pour cause. Je veux bien admettre que le comportement sociologique n'a pris réellement en compte la notion de nation que très récemment, et que l'on ne se sent British ou Français que depuis relativement fort peu de temps. Mais là n'est pas la question, car notre historien britannique très francophile affirme que la nation est une notion en déclin, tout en admirant la France où elle survit encore brillamment, donnant au monde un exemple de moralité universaliste unique. Mais là, il y a contradiction puisque le nationalisme et tout ce qui se rattache au mot nation semblent au contraire essentiellement signifier une différence territoriale qui implique des frontières, des limites, bref tout le contraire de l'universel. Monsieur Zeldin semble donc nous admirer non pas pour une qualité morale incontestable, mais plutôt pour notre capacité à nous dresser ensemble contre le monde entier, comme ce fut le cas récemment à propos de l'Irak. Bref, Monsieur Zeldin est victime du syndrome du village gaulois et de la potion magique. Ah ces Français, tous des Astérix et des Obélix !
Mystère et boule de gomme. Pas du tout, Monsieur Zeldin a parfaitement raison sans le savoir ou sans dire qu'il le sait. Car en réalité le mot nation est le substantif tant cherché du mot naître et de rien d'autre. La nation est le fait même de naître et de subsister en tant que naissance ce qui change tout. Mais comment une chose peut-elle pour ainsi dire " rester naissante ", demeurer suspendu dans cet instant de la parution, de la manifestation, du surgissement dans la réalité ? Pourquoi aurait-on le droit de prétendre que la nation possède un tel pouvoir ? Réponse : parce que la Nation n'est pas un territoire ni une communauté d'êtres humain, ni un pays ou un empire ou je ne sais encore quoi, la Nation est la vie de ce qui fait constamment renaître une communauté, un pays, un ensemble déterminé, renaître dans toutes ses dimensions, comme l'Europe aujourd'hui renaît régulièrement sous une autre forme, élargie et différente à chaque fois, la vie de sa Constitution. Une nation est une communauté qui fait vivre sa constitution au point que l'on peut dire qu'elle est en constante naissance ou renaissance. Cela s'appelle modestement la démocratie.
Monsieur Zeldin, ce que vous admirez chez les Français n'a rien à voir avec leur caractère national au sens d'un troupeau particulier qui aurait bénéficié de conditions miraculeuses pour devenir et rester ce pays phare du monde et exemplaire de ce qui peut encore demeurer de l'ordre de l'universel dans un monde pulvérisé par l'appropriation privative. Ce que vous admirez chez les Français, c'est ce qui leur reste de leur Grande Révolution et aussi des petites révolutions qui ont forgé, au dix-neuvième siècle, la nation laïque et républicaine formellement et fondamentalement la plus proche du modèle gréco-romain. Oui, Monsieur Chirac est digne d'admiration pour avoir pris le risque de mettre notre pays en porte à faux avec l'allié le plus puissant, le quasi donneur d'ordre de la réalité mondiale actuelle. Et ce courage il le doit bien à notre Nation et au sens que nous, Français, avons su garder à ce mot. Cela dit, vous avez vous-même souligné ce qui différencie radicalement l'attitude théiste, religieuse de messieurs Blair et Bush, de notre glaciale laïcité qui seule nous permet de rester fidèle au concept et à la réalité nationale, de la Nation. Et ce concept doit être étendu à l'espace européen, je ne dis pas territoire, je dis espace, c'est à dire continuum indéfini dans lequel prend force et vigueur une constitution vivante dont la gestion démocratique fait la naissance et la renaissance quotidienne de la réalité politique dans laquelle vivent des citoyens libres et égaux. La passion contre la raison. Vous avez raison, Monsieur Zeldin, le tandem Blair/Bush est celui de la passion et la vieille Europe continue, comme au temps de Kant et de Hegel attendant les troupe libératrices de Napoléon, à être le temple de la Raison parce qu'elle ne peut pas se soustraire à la force du concept de Nation tel que la France l'a forgé selon l'esprit des Anciens. Cette Raison sera aussi ce qui nous sauvera, nous Européens de la folie passionnelle et religieuse des anglo-saxons qui, au revers de leur existence réelle, ne sont que des épicuriens sans foi ni loi prêts à tout pour pérenniser leur pouvoir de jouissance, des formes les plus triviales de la jouissance, s'entend. Les anglo-saxons seront les derniers à comprendre que le luxe est une vieillerie pathologique qui n'a rien à voir ni avec le bien-être ni avec le progrès de la culture.
Jeudi 19 juin 2003
Philosophie, Religion et Politique.
La philosophie est comme une forêt dense et obscure dans laquelle il faut trouver son chemin. Sa densité et son obscurité rendent le succès difficile et aléatoire, mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que de la traverser, d'entamer sa recherche et d'aller de l'avant avec rarement le privilège de posséder les bonnes cartes et la bonne boussole. Il n'y a pas le choix parce que le mot philosophie n'est qu'un grand mot pour une toute petite chose de l'existence sans la quelle cette existence n'a tout simplement pas lieu. Si on comparait la vie à une automobile qui roule, la philosophie serait quelque chose comme ce simple cylindre d'acier que l'on appelle axe autour duquel tournent les roues du véhicule. On pourrait sans doute dépouiller cette machine de la plupart de ses accessoires, mais on ne saurait se passer de ses axes sans lui enlever en quelque sorte tout ce qui permet de la concevoir comme un véhicule. La philosophie est l'axe souvent cachée de la vie, maquillée de telle sorte qu'elle apparaisse toujours comme autre chose que comme philosophie tout en apportant un minimum des fonctionnalités propres à cette même philosophie. Le meilleur exemple en reste la religion qui se présente comme une sorte de vade-mecum existentiel. Cette recette simplifiée par une catéchèse pour analphabètes est en réalité la partie visible d'un iceberg philosophique et systématique. Un vrai croyant ignore la plupart du temps tout ce qui, en réalité, l'autorise à croire alors qu'il s'imagine faire un usage normal du libre-arbitre. Il ignore tout de la Tradition, cet appareil intellectuel massif et gigantesque qui possède des sortes de guichets où sont délivrés les droits de croire, enveloppés ou non, selon les besoins du contexte, dans un cadre qui prend en compte la liberté de penser et de croire. Lorsque Charlemagne christianise ce qui reste de la Germanie orientale, il fait l'impasse sur cet impératif d'allier l'idée de liberté à celle de la foi, pratique commune à toutes les factions fanatiques de toutes les religions. Or cette impasse aura des conséquences incalculables sur le destin ultérieur de l'Allemagne, des conséquences que l'on peut discerner jusque dans la naissance dans cet espace de cette nouvelle éthique politique qui porte le nom d'écologie. La Réforme demeure, bien entendu, la réponse la plus cinglante et la plus efficace à ce passage en force sur toute nécessité de fonder philosophiquement la foi. Si le Christianisme a bénéficié de véritables autoroutes en Gaule, c'est uniquement parce que la Gaule avait été profondément romanisée. La Grande Bretagne se retournera également contre l'orthodoxie vaticane à cause d'une christianisation bâclée et qui de surcroît prend son essor dans une île relativement étrangère l'Irlande. Si vous voulez comprendre la guerre civile religieuse qui s'éternise en Irlande, il n'est pas inutile de remonter jusqu'à Saint Patrick et à son activité de missionnaire chez le grand voisin majoritairement peuplé de Saxons, de " païens " qui avaient justement fui les exactions des Carolingiens. L'anti-papisme britannique est l'autre conséquence de cette absence de fondements rationnels, une forme de philosophie qui ne s'en est pas tenue à ce refoulement de l'absolutisme papal, mais qui a rebondi sur la philosophie elle-même dans un refoulement décisif de la forme métaphysique inhérente à la théologie de la recherche de la vérité. En fait dans le déni de toute vérité comme objet pertinent de la philosophie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empirisme ou le pragmatisme.
Entre une éducation qui repose sur une structure philosophique déterminée et celle qui simplifie le problème en renvoyant tout tout simplement à la religion, il y a aujourd'hui un état pédagogique intermédiaire qui renvoie à une liberté de penser vide, phénomène due à la gravité de la crise qui a secoué l'idéologie globale qui se dissimule sous le concept hâtivement inventé de métaphysique occidentale. Les enfants qui ont vécu et qui continuent de vivre cette crise aussi appelé " clôture " de la philosophie, se retrouvent dans une sorte de nudité morale, un athéisme philosophique qui a produit, avec une nécessité d'airain, ce qui passe aujourd'hui pour les Sciences Humaines. Les Sciences Humaines sont des sortes de lazarets de la pensée, de dispensaires où l'on peut venir chercher soi-même, si ce n'est pas une ambulance qui vous y amène, des recettes d'urgence totalement empiriques pour régler l'absence de soubassement philosophique au Dasein, à l'existence quotidienne dont le sens s'écoule en hémorragie comme le sang. Freud a compris le premier l'importance de l'apport de raison dans la dynamique psychique qui doit unifier le sujet et lui donner son identité, et malgré son pessimisme quant au succès historique de cette opération, il reste attaché à la reconnaissance d'un besoin de clarté tel que l'a exprimé Goethe sur son lit de mort. Au cours de ces toutes dernières années, on assiste à un retour en force de la pédagogie religieuse. On peut comparer sans crainte de se tromper, le président Bush évangélisant la politique, à Charlemagne construisant son Empire sur un choix stratégique qui impliquait une Alliance sans faille avec Rome et la papauté. Le Grand Charles, décidément, n'avait en réalité qu'une idée philosophique extrêmement vague de la religion chrétienne et de ses fondements métaphysiques. Etant lui-même un barbare germain, dont le paganisme se rapprochait davantage d'un écologisme spontané, comparable à l'animisme universellement pratiqué dans les zones dites primitives comme l'Afrique, l'Amazonie ou encore les pays dominés par le chamanisme, Charlemagne n'a opté pour Rome que par conviction politique et sans doute parce qu'il avait compris que toute souveraineté devait s'appuyer sur une vision ontologique forte. Or en Italie et au Moyen Orient, le Christianisme avait touché le jack-pot en remplaçant molécule pour molécule tout le rationalisme romain fondamentalement agnostique par une métaphysique du salut, une eschatologie lumineuse de simplicité parce qu'elle réglait d'un coup non seulement les questions domestiques, mais aussi celles de l'au-delà, question centrale de la condition humaine sous toutes les latitudes. Bush raisonne certainement de la même manière et se voit déjà maître d'une sorte de seconde phase de la christianisation, mais une christianisation qui cette fois vise l'échelle mondiale. C'est là l'explication ou le secret de polichinelle de la naissance et du développement du terrorisme islamiste. Pour l'instant il reste un Tiers exclu de cette dualité qui en réalité ralenti tout le processus imaginé par les évangélistes de Washington, à savoir Israël. Théologiquement, Bush est coincé dans un double-bind sans issue, un piège métaphysique qui finirait par ruiner, non seulement sa carrière et celle du parti Républicain, mais l'Amérique elle-même s'il devait être conforté dans le pouvoir l'an prochain ainsi que la secte qui l'entoure et l'entraîne dans les aventures d'ores et déjà les plus folles de ce siècle. Les monothéisme judaïque et musulman ont une base métaphysique beaucoup plus proche l'une de l'autre que ne l'ont le Christianisme et l'Islam. Ce qui fait, et l'actualité le montre tous les jours, que la volonté de liquidation de l'Islam qui se cache derrière l'impérialisme religieux de Bush s'en prend en même temps au judaïsme lui-même. Ce président peu cultivé, c'est le moins que l'on puisse dire sans le diffamer, oublie la complexité extraordinaire de la construction philosophique chrétienne. Il ne sait rien de la sophistication de l'édifice théologique catholique, qui à l'inverse de l'Islam ou du Judaïsme, est un véritable système philosophique, là où les deux autres monothéismes restreignent volontairement la définition de leur être à celle de la fonction de révélation.
Rome et les conciles fondateurs n'ont pas perdu de temps avec le " fait divers " de la Révélation. Il faudra attendre 19 siècles pour qu'un philosophe égaré dans un contexte déjà en crise, Schelling, revienne tenter de sauver le Christianisme menacé de ruine à cause de cette négligence essentielle. Et personne ne l'écoutera, même pas celui qui l'a le mieux compris, son ami-ennemi Hegel. La Révélation est le corps même du Coran et de la Thorah. Ces deux livres, en fait, ne sont pas des livres, ils sont Dieu en personne, et réciter ou étudier ces ouvrages revient à entretenir un dialogue avec le divin. Il n'en va du tout de même avec l'Evangile, un texte qui n'est pas rédigé par des prophètes, mais par des disciples de prophète, des groupies de celui dont la divinité sera longtemps contestée et dont la divinisation deviendra immédiatement le problème central de la doctrine elle-même. Aucun Juif ni aucun Musulman ne se pose la question de savoir si Mahomet ou Moïse étaient des dieux ou pas, ils étaient des Prophètes, et à ce titre des hommes désignés par Dieu pour accomplir une mission déterminée et précise sur cette terre. Jésus-Christ, lui, est (ou n'est pas) Dieu lui-même, venant faire directement sur terre du maintien de l'ordre. La différence quant à la force du religieux inhérents à chacune de ces positions et quant à la nécessité plus ou moins grande de fonder philosophiquement ces religions est immense. Mais que signifie fonder philosophiquement une religion ? Rien d'autre que de l'adapter au contexte rationnel dans lequel il veut se développer. Si l'Islam était né dans l'espace romain au lieu de surgir au milieu d'un désert stérile et menaçant du Hedjaz, il se serait sans aucun doute " christianisé " de la même manière que la religion qui semble être née en Palestine, mais dont l'essentiel du scénario a été mis au point dans l'espace romain, c'est à dire dans un contexte encore polythéiste et républicain du point de vue de la structure. Rien à voir avec le despotisme oriental ni avec le communisme nomade du Judaïsme. Voilà qui devrait faire réfléchir Monsieur Deubeliou car il existe une solidarité occulte très profonde entre le Judaïsme dont il se fait le héraut et le défenseur (pour des raisons pauvrement politiques, ce qui risque de l'achever du point de vue de sa propre éthique évangélique ou bien de finir par le coincer dans un antisémitisme de circonstance) et l'Islam vis à vis duquel il est tout simplement démuni de toutes les manières possibles, diplomatiquement, dialectiquement et esthétiquement. Ce qui signifie qu'il est dans une impuissance de compréhension absolue de ce qu'est l'Islam et donc dans une paralysie politique concrète quant aux relations qu'il est obligé d'entretenir avec ses propres amis musulmans. Qui n'a pas encore constaté, pratiquement de visu, l'incroyable caractère surréaliste des relations américano-saoudiennes ? La contradiction matériellement constatable chaque jour d'un pays qui se déclare l'ami le plus intime de Washington et qui en même temps dispense où il peut tout ce qui peut nuire à cet ami et forme la jeunesse de son peuple avec une pédagogie d'exclusion fondée sur le fanatisme le plus avéré. La nationalité de Bin Laden est le symbole de l'échec futur de l'Amérique dans tout ce qu'elle entreprendra contre l'Islam, tout cela pour n'avoir aucune formation philosophique qui lui permette précisément de comprendre ce qu'est réellement le soubassement ontologique, c'est à dire en même temps sociologique de l'Islam. Le plus grave pour nos amis américains, tant qu'ils confieront leur destin à ceux qui le tiennent en main en ce moment, c'est que l'Islam gagne chaque jour des millions d'adeptes grâce à la simplicité philosophique de son message, simplicité qui est pure absence puisqu'il ne s'agit, comme dans le judaïsme, que d'un catalogue éthique, d'un simple mode d'emploi de l'existence à usage immédiat et sans complications catéchistiques. Ailleurs j'avais analysé la situation existentielle de rêve d'un Juif orthodoxe : la vie de tous les jours expliquée phase par phase, pour ainsi dire minute par minute du soir au matin, du matin au soir, de mois en années et d'années en décennies etc… sans le moindre interstice où pourrait se glisser une question, une peur de se tromper, une angoisse face au danger de la liberté. La Kashrout, ensemble de règles très matérielles et très triviales, règle tout, et son respect scrupuleux règle également une fois pour toute toutes les questions de l'existence et du rapport à Dieu, rapport qui est inscrit dans cette Kashrout comme son effectuation. L'Islam c'est exactement la même chose : les cinq prières, l'hygiène corporelle et le respect de la Charia et tout est dit, pas de question existentielles, pas d'angoisse et pas de perte de sens. Evidemment, je plaisante un peu, et même beaucoup, mais il n'empêche que l'idéal ou l'objectif de ces deux monothéismes se jouent de cette manière là, et il offre des satisfactions terrestres certainement aussi importantes et juteuses que le Christianisme empêtré dans ses controverses morales et politiques. Avez-vous déjà réfléchi à ce simple fait : la chrétienté possède plusieurs centres géographiques, autant de centres que de sectes distinctes. Juifs et Musulmans ne possèdent les uns comme les autres qu'un seul centre, et le véritable casus belli qui les opposent aujourd'hui est la seule exception à cette simplicité géopolitique, à savoir le statut de Jérusalem, revendiquée par les uns comme par les autres comme centre. Dans ce débat, c'est Israël qui semble avoir historiquement raison, Jérusalem n'est pas un centre théologiquement défendable pour les Musulmans, il n'est que l'objet trouvé d'une archéologie subitement confrontée à l'histoire vivante, celle du Sionisme ou du retour en catastrophe des survivants de la Shoah. Je suis à cent pour cent convaincu que si la seule et unique question du statut de Jérusalem pouvait trouver un accord réel entre les deux parties, c'en serait fait de ce conflit maudit, mais qui ne me fait pas plus d'effet que le conflit irlandais ou sri-lankais.
Et la philosophie dans tout ça ? La philosophie est l'autre voie de l'eschatologie personnelle, de la quête de la sérénité et de l'abandon de toute peur et de toute angoisse. A vrai dire, la philosophie avait aussi, dans les temps de sa naissance, une contrepartie pratique qui a disparu, à savoir la nécessité pour chacun de faire preuve des vertus compatibles avec la connaissance philosophique, quelles que soient les formes et les croyances inhérentes à chacune de ses philosophies. Contrairement aux religions, la philosophie implique d'office le libre-arbitre mais il engage du même coup dans le respect des vertus non seulement réclamées par le système choisi, mais par l'éthique qui conduit toute recherche philosophique. Ce que les religions imposent par la force d'un appareil pour ainsi dire naturel, ce qui en fait la force, la philosophie le laisse au libre choix de l'individu, mais n'en est pas moins exigeante quant au respect de la morale qui est inscrite dans ce choix. Même lorsqu'un Athénien se proclamait hédoniste, il devait le montrer dans sa vie quotidienne et partout où la République l'appelait pour s'y montrer digne de la liberté de penser qu'elle lui concédait. Or comme on l'a vu, la voie philosophique dont je dirais qu'elle est tout à l'honneur du Christianisme qui l'a choisie, est une voie difficile, dangereuse et qui n'offre nullement les abris naturels de décalogues existentiels tout fait, de ready-made de la vie qu'il suffit de respecter pour assurer et rassurer le salut partout où on peut le chercher. Pour philosopher, il faut donc être un aventurier prêt à se lancer dans la forêt vierge des concepts, des logiques, des catégories et de tout ce langage qui, lui aussi, remplace molécule pour molécule le langage utilitaire. Il existe sans doute deux sortes d'aventuriers disposés à se lancer ainsi dans cette brousse : il y a ceux qui font confiance au dispositif qui revendique le traitement officiel labellisé par une certaine tradition garantie par les institutions, et puis ceux qui doivent ou veulent se débrouiller seuls. La professionnalisation de la philosophie la rend évidemment suspecte car là où les hommes investissent de la richesse collectivement, il ne s'agit pas ici de mécénat, ils le font rarement de manière désintéressée. La philosophie universitaire est donc a priori suspecte parce qu'elle reçoit quasi aveuglément le soutien de l'Autorité, du souverain, qu'il soit monarchique ou démocratique, cela ne change rien ou pas grand chose. Nous ne vivons pas encore, et ne vivrons sans doute jamais j'espère, dans la République des Philosophes et la philosophie n'a rien à voir avec les stratégies de gestion des communautés. Celles-ci ne sont rient de naturel a priori, elles sont sans doute des accidents passagers entre deux époques où l'homme a vécu et revivra pleinement son essence nomade. La philosophie, il n'y a rien de plus personnel, de plus singulier dans son approche, dans son assimilation et dans la fleur existentielle qu'elle peut donner. Elle est l'assomption même de la singularité, assomption signifiant non pas quelque mystérieux phénomène religieux, mais le fait d'assumer sa personne, de prendre la responsabilité de sa singularité dans un monde qui fait tout pour gommer l'essence singulière de tout chose.
En terminant aujourd'hui ce texte, j'avoue avoir un sentiment d'intense satisfaction. J'ajoute à cet aveu que je ne savais que partiellement où me mènerait cette réflexion qui se rattache plus ou moins à ce que j'écrivais hier. En fait, elle m'a ouvert à moi-même les yeux sur une immensité de spéculations possibles, elle m'a simplifié d'un coup des questionnements complexes sur l'Histoire et la question de l'Être, sur le traitement rationnel de l'histoire la plus présente, ce qui est quand-même un petit exploit dont les bénéfices ne se feront pas attendre. A pluss, bande de petits veinards ! Et n'oubliez pas de cliquer où il faut, car il faut bien que je continue de vivre si vous voulez partager avec moi ces bénéfices.
Vendredi 20 juin 2003
Sexe, politique et Europe.
Je suis loin d'être une Madame Pernelle que l'âge non seulement met à l'abri des passions lubriques, mais qui l'autorise en plus à s'occuper et à juger les affaires d'autrui. Non, Tartuffe demeure l'un des personnages que je déteste le plus dans le panthéon littéraire et théâtral. Or il se trouve que la race des Tartuffes semble envahir le panorama que nous offre le présent social et politique, un peu partout dans le monde. Qui aurait pu supposer un instant que le Gouverneur de l'Australie, l'équivalent du Vice-Roi des Indes, l'homme qui représente personnellement la Reine d'Angleterre, c'est à dire la souveraine de cette démocratie qui n'en demeure pas moins une colonie quelque soit la nature et le degré de son association avec la Grande Bretagne ; oui, qui pouvait supposer qu'un tel personnage allait devoir démissionner en demandant publiquement pardon à la télévision pour un délit apparenté à la pédophilie ? Vous allez me répondre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que depuis la nuit des temps grecs et romains, l'amour des enfants n'a non seulement été lyriquement célébré par les philosophes et les littérateurs, mais pratiqué sans honte jusqu'à ce que l'Eglise vienne mettre le holà à ces pratiques désormais condamnés à la honte la plus intense et aux peines pénales les plus lourdes, sauf lorsqu'elles concernent un homme aussi important que le Lord Governor dont nous parlions plus haut. Je passe les affaires qui défraient la chronique depuis les Ballets Roses de la Quatrième République jusqu'à l'affaire Dutroux et le scandale plus récent qui frappe la Ville Rose.
Que se passe-t-il donc ? Pas grand chose sans doute dans les mœurs elles-mêmes, au sens où la libération sexuelle, enfin ce qui porte ce nom, a rendu un semblant d'honorabilité à des pratiques jusque là condamnées avec la dernière vigueur. Clubs de rencontres, affichage public des opportunités pour chacun et tout le monde de s'adonner à presque tout ce qui était considéré comme perversion, commerce lucratif autour de ce genre particulier de l'activité de l'être humain qui se concentre sur les plaisirs érotiques, tout se conjugue pour ouvrir toute grandes les vannes de la permissivité la plus absolue. Bon. Reste que le législateur n'a pas osé aller aussi loin qu'un Platon ou un Socrate, et qu'il demeure strictement, mais alors très strictement interdit d'associer des mineurs à ces ébats autrefois prohibés. Il semble que la Loi veuille distinguer dans le fait même du commerce amoureux celui qui s'établit librement entre adultes consentants, et celui qui implique des enfants dont le consentement n'est pas un argument de défense et que personne d'ailleurs ne veut plus envisager comme possiblement réel : l'enfant est, dans le cas de la pédophilie, violé par définition et quelques soient les preuves que les accusés sont en mesure ici ou là de fournir devant un tribunal. Rien de plus juste au demeurant, les enfants restants dans nos société des êtres sans pouvoir ni sans l'expérience suffisante pour établir des rapports d'égalité entre eux et un adulte. C'est la raison principale pour laquelle je m'associe à la condamnation de la pédophilie et de l'inceste lorsque ces derniers ont lieu entre un adulte et un mineur. Mais, je ne veux pas m'étendre sur une méditation du juste et de l'injuste dans un domaine qui, à tort ou à raison, me répugne assez profondément. Non, ce qui m'intéresse ici c'est l'intensification de ses manifestations dans notre présent et la signification de cette sorte de passion qui prend tous les risques à quelque niveau que ce soit de nos sociétés. Ici un Gouverneur de l'Australie, là un personnage si haut placé qu'il en donne le vertige, des hommes de loi, des policiers, des pères et des mères de famille, bref, des gens que la lubricité aveugle au point de les contraindre la plupart du temps à des formes de crimes encore plus ignobles allant jusqu'à l'assassinat.
Ce qui me frappe dans tous les cas évoqués c'est d'abord la qualité des personnes concernées. Attention, ne vous méprenez point, le statut social d'un individu ne le prive d'aucune liberté et l'histoire colorée, pour employer un euphémisme, de nos deux dernières Républiques, montre qu'on peut être au sommet de la hiérarchie d'une nation et mourir dans les bras d'une hétaïre sans que cela ne provoque autre chose qu'une interminable série de jeux de mots et de plaisanteries de plus ou moins mauvais goût. On sait aussi que la plupart des politiques sont pour ainsi dire " victimes " d'un stress inhérent à la pratique de la politique, stress dont l'activité sexuelle serait un exutoire nécessaire. Ce n'est peut-être qu'un discours, après tout, je n'ai pas été vérifier quoiqu'il me soit arrivé de côtoyer certains hauts personnages assez longtemps pour me faire une idée de la pertinence de ce lieu commun. S'il existe vraiment, ce syndrome me paraît pourtant révélateur de quelque chose d'important, à savoir la proximité ou la familiarité de la pratique du vice avec celle de l'autorité. Le Marquis de Sade a fort bien illustré cette particularité d'une société pourrie par le haut, pourrie selon une géométrie qui renforce le vice avec le pouvoir. Phénomène qui souffre de surcroît d'une sorte de logique de la réciprocité qui fait que le pouvoir produit le vice et que ce dernier à son tour consolide le pouvoir. Il y a non seulement une affinité entre vice et pouvoir, il y a une relation logique, ontologique au sens d'existentiel.
Les choses en réalité ne se passent pas comme le pense un vain citoyen lambda. L'homme n'est pas un être qui ambitionne le pouvoir pour acquérir les moyens d'assouvir sa lubricité, mais son ambition est déjà sa lubricité elle-même. L'ubris grecque n'est pas sexuellement connotée, elle porte sur le désir en général d'être plus que les autres, de subvertir la norme pour s'assurer une sorte de pouvoir divin, transcendant au point de rendre impossible tout jugement des autres à son encontre. Et c'est bien pourquoi cette ubris est condamnable par le peuple et passible de l'ostracisme, c'est à dire de bannissement et de séquestration des biens. Dans la République Athénienne, le seul fait de manifester cette ubris de manière trop ostentatoire et d'étaler ses richesses même en les partageant avec le peuple, peut provoquer dans l'heure la chute de l'individu, quelles que soient par ailleurs ses qualités et les désagréments que son absence pourraient entraîner pour la Cité elle-même. L'histoire du cinquième siècle regorge de personnages dont la vie se partage entre les exils retentissants et les retours tout aussi flamboyants. Pour ces hommes-là en particulier, il est totalement inutile d'invoquer l'argument sexuel. En Grèce classique, les pratiques sexuelles sont l'équivalent des pratiques gastronomiques et n'occupent aucun statut particulier dans la morale sociale. On sait au contraire combien les intellectuels de cette époque ont célébré les transports amoureux de toute nature. Aujourd'hui, et même en France, il faut prendre une loupe pour trouver un intellectuel de haut vol qui parle librement de sa propre lubricité et célèbre les beautés de la performance amoureuse et érotique en général. Tout se passe donc comme si aujourd'hui précisément, le pouvoir soit une condition sine qua non du libertinage seulement parce que le pouvoir peut acheter le silence qui doit l'entourer. A l'époque de Louis le Quinzième en revanche, il s'étendait chaque jour de Versailles à Paris, une sorte de rumeur gazetière qui rapportait au petit jour les performances amoureuses du Roi, rumeur qui lui a mieux garantit la popularité que sa politique et lui ont valu le titre envié de Roi Bien-Aimé envers et contre sa médiocrité personnelle de souverain manipulé par son entourage, gérant aussi mal les finances que la politique étrangère et la guerre.
Tout cela ne porterait pas à conséquence, même dans des temps contemporains où ces mêmes personnages de pouvoir son contraints à la discrétion. Si, s'il ne venait se mêler à ce qui pourrait ne rester qu'une manière d'illustrer la fécondité et la bonne santé, le crime et le sang. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, inquiétude renforcée par la mémoire d'un passé peu lointain où des barbares à deux S mélangeaient le plus cyniquement du monde la politique la guerre et le sadisme le plus féroce, c'est l'association de plus en plus récurrente de la violence au sexe. Il semblerait que les doses de lubricité soient en train de dépasser l'imaginable alors même qu'aucune circonstance particulière comme par exemple la proximité de la mort, une situation de guerre, ne viennent le justifier au moins partiellement. De la République de Salo on pouvait bien dire que les membres de son gouvernement s'enterraient eux-mêmes dans des fosses d'horreur sachant que la fosse où ils pourriraient un jour eux-mêmes les attendaient déjà. J'ai toujours tenu l'hédonisme absolu comme la philosophie la plus tragique, celle qui réduit l'existence à sa plus simple expression par pur désespoir de trouver d'autres jouissances que celles de la peau et des humeurs. Mais même les hédonistes n'avaient rien de sadiques et rien ne prouve que le sadisme soit un ingrédient naturel de l'érotisme, tout prouve au contraire que le sadisme soit le résultat de l'impuissance du pouvoir à générer du plaisir. Nous approchons ainsi du nœud qui se noue entre le sexe et notre présent, mais bien entendu de ce sexe très particulier qui a besoin de la souffrance d'autrui pour produire du plaisir. Et quelle conclusion devrons-nous tirer en tout premier lieu de cette multiplication évidente de l'association de l'hédonisme et du crime, du sexe et du sang ? Une conclusion bien angoissante, celle de l'appauvrissement de plus en plus évident de la démocratie et de sa justice. Jadis on ne parvenait aux piliers du Temple du pouvoir qu'en ayant fait la preuve de ses vertus, de toutes les vertus républicaines y compris celle de la modération dans la vie privée. Il n'y a pas si longtemps existaient encore des certificats de bonne vie et mœurs sans lesquels il ne fallait pas songer à occuper des emplois élevés dans une hiérarchie publique ou même privée. De tels papiers ont à peine encore le pouvoir d'infléchir un délibéré de jury dans une affaire de divorce ou de proxénétisme, et encore. Aujourd'hui le suffrage universel délivre un pouvoir régalien où la transgression des règles mineures, le détournement par exemple de l'argent du contribuable, ne sont que des étapes vers le crime qui organise sa propre impunité dans ses propres sphères.
Que peut-on ajouter à ce sinistre constat ? Une vision anticipative du monde qui semble nous attendre tranquillement : celle d'une réalité où l'état aurait cédé la place aux entreprises et où donc le pouvoir serait l'apanage des hiérarchies économiques. Depuis quelques années, un phénomène s'est imposé dans la réalité du monde du travail, un phénomène dont l'amplification a contraint le pouvoir à légiférer, celui du harcèlement dans les entreprises. Pour l'instant, le harcèlement semble surtout faire partie des nouvelles stratégies destinées à se débarrasser des salariés devenus indésirables en raison de leur âge, de leur caractère récalcitrant ou trop intransigeant, ou tout simplement parce qu'ils représentent un danger syndical. De plus en plus, cependant, le harcèlement porte sur des affaires sexuelles au point qu'est né l'expression même de harcèlement sexuel : le pouvoir de donner et de reprendre un emploi donne le pouvoir de prendre des libertés avec le corps des autres. La question est donc de savoir jusqu'où peut aller le développement de cette tendance, si par ailleurs les institutions chargées de la réprimer se trouvent elles-mêmes gangrenées par le mal. Vous allez me dire que cela ne fait pas de différence et vous aurez raison, sauf à considérer que le monde du marché, de l'économie, ne devrait pas être concevable comme un monde du pouvoir. Nous avons conclu plus haut que le vice et le pouvoir entretiennent des relations si étroites qu'ils finissent par s'identifier l'un à l'autre comme dans les contes de fées les plus épouvantables. Nous nous trouvons donc à un carrefour. D'un côté le pourrissement de l'état se présente comme un symptôme de son déclin, déclin qui, je le rappelle, n'est pas seulement désiré par les puissances libérales, mais aussi par les forces de gauche restées cohérentes par rapport aux analyses des fondateurs de leur mouvement. La nostalgie républicaine elle-même ne va pas forcément avec une défense aveugle de l'état et des formes dites " bourgeoises " des institutions. A ce carrefour nous attendent deux voies possibles : la première serait celle d'un simple transfert du pouvoir de l'état vers l'économie, le Medef est prêt, semble-t-il, à occuper définitivement les salons de Matignon et de l'Elysée. Mais il y a une autre possibilité, une autre voie possible, une Aufhebung ou un dépassement de ce dilemme, à savoir la naissance d'un véritable marché dans lequel l'économie jouerait pleinement son rôle fantasmé jadis par un certain Adam Smith, celui de régulateur naturel des passions par l'équilibrage permanent de l'offre et de la demande. A ce sujet, j'observe avec beaucoup d'optimisme l'évolution de l'Europe et de ses institutions, et je constate l'étonnante souplesse avec laquelle est abordée aujourd'hui la question des institutions européennes. L'unification du marché a produit des résultats inespérés sur les mentalités politiques dans un sens beaucoup plus républicain que beaucoup ne le soupçonnent. L'Euro a introduit une cohérence politique à laquelle peu d'idéologues des deux bords ne pouvaient s'attendre. Je peux me souvenir des blocages en tout genre qui s'accumulaient les uns sur les autres il y a encore à peine un lustre. De la PAC à la politique d'immigration en passant par l'harmonisation fiscale, tout paraissait tellement immuablement non-réformable que l'Europe s'annonçait plutôt comme une vaste blague comparable aux tentatives grecques de s'unir face aux menaces orientales et occidentales.
Or l'Europe est devenu un étonnant laboratoire du simple fait que dans un an elle aura unifié vingt-cinq marchés différents. Aujourd'hui on ne fait même plus mention de cette unification dont on attendait les pires conséquences, on a même subitement trouvé l'audace d'amplifier le phénomène en l'étendant presque sans limites à l'Est. La conséquence la plus étonnante de cette unification nous est annoncée en ce moment même : alors qu'il y a encore quelques années régnait le plus grand scepticisme sur l'avenir politique de notre continent, le voilà sur le point de se doter d'une Constitution ! Peu, voire aucun observateur ne semble avoir pris conscience de l'aspect miraculeux du changement qui s'est opéré en quelques mois et l'événement que constitue le consensus qui semble se dessiner autour du projet de Valéry Giscard d'Estaing. Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il s'attendait de voir naître une Constitution aussi vite, et surtout de lui voir une chance d'être adoptée alors que tant d'obstacles semblaient devoir empêcher à tout jamais l'Europe de devenir une entité politique cohérente. Bien sûr ce n'est qu'une étape, et l'affaire n'est pas encore dans le sac, mais je connais la mélodie des bruissements préliminaires aux annonces fracassantes, et je suis prêt à parier que notre ancien Président de la République est sur le point de remporter une victoire personnelle qui est d'abord une victoire européenne. Pour en finir, je dirais qu'il n'y a pas que le mal et le vice qui progressent dans notre société dite en " crise ". Je dirais même qu'ils régressent car Bruxelles n'a pas seulement su avancer sur le dossier le plus urgent, celui de la politique commune, mais aussi nettoyer ses écuries d'Augias et mettre un terme discret à la corruption massive qui caractérisait l'Europe d'avant l'Euro. Il y a plus de souveraineté réelle dans une monnaie commune que dans cent Commissions, la preuve nous en est administrée par le constat d'un courage politique inattendu avec lequel le " vieux " continent a osé s'opposer aux projets belliqueux de la super-puissance américaine, au risque de briser la Sainte Alliance de l'Otan. Il fallait bien ça pour découvrir qu'elle ne servait plus à rien d'autre qu'à entretenir une dépendance unilatéralement coûteuse.
Dimanche 22 juin 2003
Pactrole, Afghanistan, Irak, Iran, veau, vache, couvée…
J'ai voulu vérifier ce matin ce que je disais le 12 septembre 2001, au lendemain de ce dont on ne rappellera jamais assez l'horreur dont j'avais par hasard pu suivre le développement minute par minute par TV interposée. J'ai fait cela pour vérifier ce que m'ont fait remarquer quelques amis, à savoir s'il était bien vrai que j'avais à peu près prédit dès cette époque tout ce qui allait arriver et ce qui va encore suivre. Ce qui donc va arriver dans les mois à venir. La lumière s'est faite en moi dans les jours qui ont suivi immédiatement ce jour fatal sur la logique mortelle dans laquelle nous nous étions déjà laissé intriquer en laissant se développer là-bas, pire en encourageant sa naissance, le mouvement des " étudiants en religion " nommés talibans. Le fait que je m'attendais à un attentat de n'importe quelle envergure n'a rien ôté à la force de mon indignation et j'ai soutenu de toute ma conviction la destruction rapide qui a suivi de ce repaire du fanatisme. Il n'en demeurait pas moins que la guerre d'Afghanistan ne représentait pour moi rien d'autre que le fait pour les Etats-Unis d'effacer une tache qu'ils avaient eux-même laissé s'étaler après lui avoir permis d'exister. Une manière d'effacer les traces de leur propre culpabilité historique, car ce pacte passé entre le Pentagone et quelques psychopathes religieux demeure le fondement réel de l'existence de cette machine du terrorisme qui était condamnée à tourner quoi qu'il arrive, à vide ou non, avec ou sans objectif rationnel.
Le seul lien donc que je n'ai pas fait par la suite entre l'attentat de Manhattan et les événements du monde, est l'incroyable résultat électoral en France, et pourtant je suis à présent convaincu que le réflexe sécuritaire qui a suivi dans le monde entier a également influencé le corps électoral de l'hexagone. Chirac doit une grande partie de sa popularité à la même dynamique que celle qui a propulsé Bush dans le dernier quart supérieur des sondages dans les semaines qui ont suivi le 11 septembre. J'avais le nez collé sur les erreurs tactiques du PS, oubliant en passant que le sécuritarisme d'un Chevènement fait partie des causes du succès de Le Pen au premier tour. Or, si je reviens sur ces événements aujourd'hui c'est un peu par angoisse, une angoisse qui naît en moi-même devant la justesse tragique de mes propres prévisions. J'avoue qu'à l'heure qu'il est j'aurais préféré me tromper sur toute la ligne à propos de ce qui allait suivre la pseudo-victoire sur les Talibans. Et pourtant il a bien fallu que j'encaisse le fait que mes comptes étaient bons, trop bons. L'Irak, entre-temps, a bien été attaqué, le régime détruit et au passage le fragile équilibre structurel des tribus et des religions irakiennes mis définitivement à mal. Pendant cette guerre j'ai pris contact par Internet avec des Américains pour tenter de comprendre d'une autre manière, mieux, hors de ma propre expérience et de mes propres préjugés cette nouvelle ruée belliqueuse provenant de la nation considérée comme celle qui a porté par deux fois la Paix dans le monde. Et je me suis découragé face à une étrange mauvaise foi, mais surtout à une inculture crasse, tellement crasse qu'elle me faisait penser à ce résultat rêvé par toute les tyrannie de décerveler les masses pour mieux asseoir leur pouvoir. Bien sûr le fin mot de tout demeure la peur, et je sentais bien, dans la colère des Internautes américains avec lesquels il m'arrivait de communiquer ce sentiment hideux qui commande tout dès lors qu'un événement fatalement capital prend tout l'espace du raisonnement. En réalité les citoyens les mieux intentionnés d'Outre-Atlantique ont commencé, le 11 Septembre 2001 à se laisser envahir par la peur, à laisser la peur commander toutes leurs réactions, et notamment la pire de toute, la fuite en avant vers ce qu'on pourrait appeler le " préventionnisme " néologisme que la science politique ne saurait ignorer bien longtemps encore. Bush a inventé le préventionnisme, forcé qu'il s'est senti de donner au peuple de son pays des gages immédiats de son courage, des réponses immédiates, dimensionnées et synchronisés à la vitesse du monde actuel, des réponses et des résultats qui doivent confirmer, non pas la justesse de sa politique, mais ce fait trivial que lorsqu'on se sent en danger, on redécouvre la famille, un Père et une Histoire. Le 11 Septembre, les Américains ont cherché leur Lincoln, leur Roosevelt voire même leur Kennedy. Ils ne savent pas encore qu'ils n'ont trouvé qu'un Nixon, et peut-être même pas.
Alors pour moi la question angoissante est celle-là : comment se fait-il que j'ai eu raison à ce point, au point que nous voilà déjà dans les zones d'une agression de l'Iran, maintenant que l'affaire irakienne a été bâclée et qu'un premier petit Vietnam a été pondu là-bas dans le Moyen-Orient qui n'en avait pas besoin ? Depuis quelques heures je commence à comprendre ce que veux dire l'expérience et la culture historique : à Téhéran Washington est en train de rejouer, mot pour mot, la pièce de théâtre qu'elle avait déjà mise en scène dans les années cinquante-soixante lorsqu'elle a fait liquider le premier chef charismatique laïque et compétent d'un Iran sortant d'une colonisation anarchique et pétrophilique. Tout alors se passait entre l'Anglo-Iranian, la compagnie pétrolière britannique qui avait préempté d'un coup tous les gisements du pays, et des gouvernements fantoches qui se succédaient à coup d'assassinats. Un démocrate cultivé avait surgi, le Dr Mossadegh, qui, bien avant Nasser, instruisit une politique de nationalisation progressive du pétrole iranien au grand dam de Londres et de son commensal et néanmoins concurrent Washington. Londres crût alors pouvoir étrangler Téhéran en boycottant son pétrole, mais Mossadegh le vendit aux Russes et le Foreign Office en avala ses chapeaux. Mais c'était sans compter sans le cousin d'Outre-Atlantique qui ne pouvait pas abandonner le rejeton britannique et qui guignait aussi une part du " pactrole ". Que fît-on donc ? On (la CIA) distribua des millions de dollars dans les rues de Téhéran pour fomenter une révolte qui emporta d'un coup Mossadegh et ses réformes, enterrant d'un coup l'avenir d'un Iran indépendant, l'Iran qui allait devenir d'abord celui d'un Shah pro-occidental aussi despotique et cruel sinon plus que ne l'a été Saddam Hussein, puis la plate-forme de tout ce qui porte aujourd'hui le nom de fondamentalisme, intégrisme, fanatisme terroriste. Bref, le 11 septembre commençait déjà à se profiler derrière les fatwas célèbres comme celle qui contraignit Salman Rushdie à passer quelques années de sa vie dans une totale clandestinité. Auriez-vous déjà oublié tout cela ?
Moi pas. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Au moment de la nouvelle histoire de l'Iran qui s'est ouverte avec la disparition de Khomeïni, au moment où la démocratie s'installe vaille que vaille, avec des avancées et des reculs, mais dans un processus apparemment positivement irréversible ? Washington découvre que Téhéran possède un programme nucléaire, programme vendu par Paris au Shah bien avant la Révolution et qui est resté pendant des années (affaire Eurodif) un motif de conflit franco-iranien auquel certains attentats terroristes en plein Paris dans les années 80 ne sont pas étrangers. Surgit ainsi une nouvelle affaire d'Armes de Destruction Massive. Un Irak-bis. Et comme l'imagination n'est pas le fort du Pentagone, on ressort les vieilles recettes qui ont déjà marché, là-bas, dans cet Iran dont on possède aussi de cuisants souvenirs, de quoi réveiller la colère sacrée du Peuple le plus puissant du monde. La recette est simple, comme pour Mossadegh, on va fomenter des troubles. Stipendier quelques étudiants en mal d'avenir et tenter de renverser le régime, histoire de ne pas se répéter dans les aventures militaires coûteuses. Car la guerre en Irak a eu un prix, à tel point que Bush fait la manche partout où il peut pour que les autres prennent la relève de l'occupation, y compris la France comme l'a révélé le Canard cette semaine. La semaine dernière, Washington ne s'est pas gêné pour demande 70 000 hommes à l'Inde, qui s'était opposé avec la dernière vigueur à l'invasion de l'Irak. Le Premier Ministre Vashpayeeh n'en est pas encore revenu et se demande encore aujourd'hui s'il a une marge suffisante pour refuser.
J'avais donc raison. L'Afghanistan, puis l'Irak et l'Iran. La Syrie tombera ensuite comme un fruit mûr. Or si le programme s'arrêtait là, ce ne serait pas encore si tragique. Après tout, ce seront les Américains qui devront assumer à la fois la destruction du système dur mais stable mis sur pied par Saddam Hussein, et le gel d'un processus qui conduit en ce moment l'Iran vers une démocratie à l'occidentale, un résultat que personne n'aurait imaginé il y a encore dix ans. Le vrai problème est que tout cela n'est qu'un début, une propédeutique pour un cours forcé de la violence qui atteindra progressivement tout l'espace oriental et extrême-oriental. En ce moment-même, les " experts " US hésitent encore entre le déclenchement d'un conflit armé avec la Corée du Nord et la liquidation du régime des Ayatollahs. Ils ignorent que quelle que soit leur option, c'est la Guerre qui en découlera, une Guerre aux limites de plus en plus floues dans lesquelles se jouera l'avenir des pays de l'Océan Indien, du Pacifique et de la Mer de Chine. Avec un peu de chance, la résistance française au diktat américain servira de modèle aux autres pays européens, à moins que nous n'ayons d'ici-là, ce qui n'est pas impossible, un Ministère Européen des Affaires Etrangères qui veillera à nous laisser en-dehors de tout ça. Cette prédiction aussi je l'ai faite, il y a déjà bien longtemps et dans un tout autre contexte. Pour aujourd'hui je vous fais grâce de mon narcissisme, mais croyez-moi, je préférerais me contenter d'une conscience moins aiguë, d'autant qu'elle me paraît appartenir à ce que Debord appelait le chômage de l'intelligence. Chômage non indemnisé. A votre bon clic, mssieu-dames, merci !
Lundi 23 juin 2003
Le phénoménisme, petit cours de philosophie.
Connaissez-vous le phénoménisme ? Non. Bon je vous comprends. Ce mot appartient au jargon de la philosophie, de cette philosophie qui s'est vraiment prise enfin pour de la philosophie au plein sens du terme, celle du dix-neuvième siècle français. Donc vous allez avoir droit à un cours de philosophie en bonne et due forme, et le sujet en sera le phénoménisme. Oh n'allez pas croire que je veuille vous apprendre quoi que ce soit, que je veuille jouer au professeur de philosophie, même s'il est vrai que j'ai une grande nostalgie de ce métier que j'ai pratiqué pendant quelques années. Non. Je vais faire ce que font tous les chercheurs qui profitent de leur position de professeur pour chercher en douce à l'intérieur de leur relation dite pédagogique. Je veux tenter d'y voir clair en même temps que je vais vous en parler.
Donc qu'est-ce-que le phénoménisme ? Le mot lui-même contient évidemment le mot phénomène. Il s'agit donc d'une théorie concernant le phénomène. Cependant, le suffixe en isme nous invite plutôt à considérer le mot non pas comme une thèse sur le phénomène, mais une thèse sur le phénomène comme thèse, c'est à dire d'une philosophie qui reposerait toute entière sur une primauté absolue du phénomène : le phénoménisme est une théorie qui affirme que tout est phénomène et seulement phénomène. Ne voyez pas dans le mot seulement une note de mépris ou un jugement négatif, il s'agit en fait d'affirmer que seul le phénomène existe en tant que réalité. Tout les contenus de notre expérience se réduisent à des phénomènes. Alors que signifie une telle réduction ?
D'abord un peu d'histoire condensée de la philosophie occidentale, car le phénoménisme est l'un des aboutissements de plus de deux millénaires de travaux, de thèses et de constructions de systèmes explicatifs du monde. En gros on peut établir une première distinction relativement simple des positions philosophiques : il y a d'un côté les réalistes et de l'autre les idéalistes. Quelles que soient les nuances dans lesquelles peuvent s'enfoncer telle ou telle théorie particulière, elle appartient toujours par un bout ou un autre à l'une de ces deux positions de base. A l'intérieur de chacun de ces deux camps, nous les appellerons des genres, existent différentes espèces ou sous-genre. Ainsi au camp des réalistes appartiennent les matérialistes et les substantialistes. Matière et substance étant presque des synonymes. Dans l'autre camp, celui des idéalistes, nous avons en gros des spiritualistes et des phénoménistes. Cela établi, il faut ajouter à ces deux ensembles de croyances philosophiques, car il est difficile hélas d'exclure la croyance de quelque théorie que ce soit, des espèces intermédiaires ou mixtes. Il y a des idéalistes semi-réalistes et des réalistes semi idéalistes, c'est à dire des penseurs qui tentent, Descartes en est le plus illustre exemple, de ménager la chèvre et le chou, même s'il semble établi que ce soit toujours le chou qui, en fin de compte, se fasse manger par la chèvre et non le contraire. Ainsi la philosophie de Kant est-elle à la fois idéaliste et à la fois réaliste, même si le philosophe de Königsberg s'attache à démontrer que la réalité est absolument hors de notre portée et que nous devons nous contenter des apparences phénoménales sans chercher à percer les mystères des réalités qui se trouvent en somme derrière ces apparences qu'on appelle les phénomènes. Il faut reconnaître que le phénoménisme français naît dans et par la critique du kantisme.
Qu'appelle-t-on alors exactement phénomène ? Dans le langage courant il y a deux sens que l'on attribue en général à ce terme. Le premier signifie un fait ou un événement scientifique. Une éruption volcanique est un phénomène que l'on peut contempler ou dont on peut être victime. Une comète est un phénomène observable périodiquement. Le second fait allusion au caractère exceptionnel de quelqu'un ou de quelque chose : un tel est un vrai phénomène, ce concombre de trente kilos est un vrai phénomène, sous-entendu inhabituel. Dans le vocabulaire philosophique, le sens du mot phénomène se rapproche davantage du premier que du second et il suffit en quelque sorte d'étendre ce sens à tous les faits et événements qui nous entourent, y compris la simple présence des choses et des êtres. Du point de la technique linguistique, tous les philosophes, qu'ils soient de telle ou telle chapelle, se servent du mot phénomène pour désigner la même chose. Il y a une grande unité dans le langage des philosophes à travers toute l'histoire de cette activité intellectuelle. Les " concepts " demeurent sémantiquement relativement stables, ce qui permet précisément à des penseurs très éloignés les uns des autres dans le temps de spéculer sur des bases communes. Ainsi, le mot phénomène aura fondamentalement le même sens pour n'importe quel idéaliste que pour n'importe quel réaliste ou semi ceci ou cela. En bref, est phénomale la forme sous laquelle nous percevons le monde, autrement dit, quels que soient les contenus ultérieurs que l'on pourra donner à ces phénomènes, il demeurent pour les uns et les autres simplement l'image globale que forme ce dont avons conscience. Ici il faut faire attention car est également phénomène une apparition psychique comme le rêve ou un sentiment ou le produit de l'imagination. C'est à dire que les phénomènes ne sont pas réservés à une extériorité autre que celle de la conscience.
Précisons encore un peu avant d'aller plus avant dans l'étude du phénoménisme. A vrai dire il est difficile de distinguer quelque chose qui serait, dans ce dont nous avons à chaque moment conscience, quelque chose qui serait en particulier un phénomène autrement qu'en le distinguant par une crispation de l'attention, une restriction du champ de perception. Car je le répète, un état de conscience est en soi un phénomène qui reçoit des variations qualitatives et quantitatives, mais qui constitue le champ phénoménal ou simplement un ensemble de phénomènes qui ne se distinguent entre eux que par des choix opérés par notre conscience. Dur ? Encore : pour les idéalistes la vérité du monde est constituée d'idées ou de représentations dont les phénomènes ne sont que des reflets ; pour les réalistes ou les matérialistes, la vérité est dans la substance unique qui forme le tout ou dans la matière que nous pouvons toucher, sentir etc… Mais pour les uns comme pour les autres, il y a entre nous et ces vérités le monde des phénomènes. Pas facile, hein ?
Si, nous avons progressé dans la direction du phénoménisme puisque nous savons que les philosophes qui prônent cette théorie, affirment que le monde que nous sentons, percevons, vivons, etc.. que ce monde n'est formé que de phénomènes : il n'y a rien ni devant ni derrière. Rappelons que la question porte sur la vérité du monde, qu'on la nie ou qu'on l'accepte. Lorsque les sceptiques affirment qu'on ne peut rien savoir, on leur demande d'où ils peuvent tirer une telle certitude si par ailleurs il est impossible d'atteindre quelque vérité que ce soit. Bien joué. Mais qu'est-ce-que cette vérité ? Pour la majeure partie d'entre-nous la vérité réside dans l'origine, dans le commencement de ce monde, de la vie, de l'existence, une existence qui doit un jour se terminer par la mort. Pour les philosophes la question de la vérité n'est pas exactement celle-là, celle de l'origine, ou plutôt si mais en un autre sens : les philosophes demandent : d'où provient, d'où surgit le monde qui nous entoure. Ce monde on peut en dire qu'il est, le monde est. Bien sûr, les choses passent, elles changent, elles vivent et meurent, elles changent de couleur et le temps passe, mais ce monde continue malgré tous ces changements à ETRE, il y a une continuité indubitable. Donc c'est de son être qu'il s'agit, et comme une chose semble certaine, à savoir que tout ce que nous percevons d'une manière ou d'une autre, par les sens ou par l'imagination ou l'esprit, que tout cela EST, deux questions peuvent se poser alors, d'abord pourquoi ce monde est-il et ensuite comment est-il ? La première question est la question propres aux philosophes et la deuxième est celle des savants de la science.
Si donc on admet qu'il n'y a que des phénomènes, et que ces phénomènes n'ont ni base matérielle ni fondement idéel, alors on est un phénoméniste. Se pose alors immédiatement la question : mais d'où viennent ces phénomènes ? Qui les fabrique ? La réponse est simple : c'est le sujet qui fabrique le monde, ce sujet portant le nom, nouveau à l'époque, de personne. Le phénoménisme est corollaire du personnalisme à l'intérieur duquel on rencontre plusieurs nuances. C'est la personne qui construit le monde en construisant une logique faite de concepts, et, bien entendu, en construisant le monde, elle se construit elle-même. On peut donc parler ici d'idéalisme absolu, au sens où il n'existe ni matière ni " substance ", c'est à dire pas de sujet ou de fondement sur lequel viendrait se greffer ou se former des phénomènes. Ces derniers sont si entièrement dépendants de la seule conscience de la personne que lorsque cette personne disparaît, le monde disparaît avec elle. Ce phénoménisme est largement tributaire de la Monadologie, c'est à dire de la théorie des monades de Leibniz. Cette théorie donne du monde une image qui ressemble à un mur fait de briques, d'unités qui sont les monades et qui sont entièrement indépendantes les unes des autres et dont l'assemblage se fait dans un temps et un espace d'essence divine, ce qui règle en grande partie un problème redoutable que soulève le personnalisme, à savoir les relations qu'entretiennent entre-elles ces monades, ou personnes. Et là on retrouve, à l'intérieur même du phénoménisme deux positions opposées, l'une qui fait appel à une extériorité d'ordre réaliste, une sorte de structure substantielle dans laquelle vient s'inscrire le patchwork des personnes. Mais on voit tout de suite que la thèse fondamentale se trouve ainsi trahie puisqu'on fait appel à une réalité extérieure aux phénomènes à la manière de Kant. L'autre est plus rigoureuse, ou intégrale, elle pose que les limites des monades, des êtres déterminés par un ensemble de phénomènes, sont posées par Dieu. Les monades particulières sont enveloppées dans la monade divine dans la quelle elles ont une place qui correspond à leur degré de proximité avec les vertus divines. On retrouve ainsi la vieille thèse de la vision divine de Dieu de Berkley, idéaliste absolu, qui pensait que la conscience (c'est à dire l'être) n'était qu'une partie de la vision divine, une partie qui se trouverait plus ou moins éloignée du centre du faisceau de cette vision, c'est à dire de l'essence de la vérité divine.
Je vais m'arrêter provisoirement là. Tout cela demeure un peu énigmatique, mais le souci premier des personnalistes étaient de fonder logiquement la liberté, et le monadisme qui servit à Leibniz surtout à prouver la liberté divine (par rapport à l'existence du mal) est bien l'une des seules manières de rendre possible la représentation de la liberté humaine, avec les restrictions que nous avons constatées au passage, à savoir d'une part un soubassement réel dont la personne ignore tout (Leibniz comblait cette ignorance par les mathématiques et pensait qu'on pourrait trouver une sorte d'équation de ce fameux mur qui portait aussi le nom rendu célèbre par Voltaire de " Meilleur des mondes possibles "), et d'autre part un Dieu qui en réalité forme le ciment du monde, monde dans lequel la liberté redevient ainsi également problématique car sans Dieu on voit mal comment l'homme pourrait exercer sa liberté. Comme je travaille en ce moment sur les textes cardinaux du phénoménisme, je reviendrai sur ce sujet pour tenter de comprendre ce que peut bien signifier une philosophie qui a besoin de nier à la fois la matière et à la fois les idées innées de Platon pour rendre possible la liberté dont la nécessité devient elle aussi absolue dès lors que l'on veut légitimer tout progrès, souci premier des rationalistes qui inspirèrent très largement la création des outils de ce progrès, l'école publique et obligatoire, la laïcité et les institutions républicaines que nous connaissons encore aujourd'hui. En fait c'est le grand intérêt de l'étude de ces philosophes qui vivent, écrivent et pensent en même temps que des gens comme Nietzsche dont la pensée se trouve à des années-lumières de cette philosophie qu'il qualifierait de petite-bourgeoise.
Mardi 24 juin 2003
Le phénoménisme (suite et fin)
En fait les phénomènes sont les choses les plus simples qui soient, il sont simplement les choses que nous percevons autour de nous et à propos desquels il ne nous viendrait jamais à l'idée de nous quereller. Cette table est là pour tous ceux qui sont assis autour d'elle, de même que le plancher sur lequel reposent les pieds et le plafond qui est suspendu au-dessus de nos têtes. Et aussi la mer, le ciel, le soleil et tous ce que les poètes et les agences de voyages fêtent à longueur de films et de textes. Toutes ces choses-là ne semblent pas prêter le flanc à des questions ou à des doutes quelconques. Elles sont là, point-barre, comme on dit aujourd'hui. Et pourtant, et pourtant. D'abord, mettons déjà de côté, dans notre bas de laine intellectuel, cette première constatation, et disons, affirmons qu'il y a bien un accord là-dessus aussi loin que l'on puisse retourner en arrière dans les discours et les théories philosophiques. Les phénomènes forment une sorte de barrière de corail entre quelque chose d'autre et nous, mais cette barrière est bien là, solide, riche en poissons et dangereuse pour les quilles des bateaux.
Pourquoi entre quelque chose d'autre et nous ? Puisque nous avons dit hier que les phénoménistes ne croyaient pas qu'il existât quoi que ce soit d'autre que ces phénomènes. Ah oui, mais ce n'est pas si simple : ces phénomènes, d'où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Ils pourraient fort bien ne pas être là et ne pas nous embêter par leur présence le plus souvent douloureuse, dangereuse et inconfortable. Et pourtant ils sont là, imperturbables, et le pire est qu'avec la science et la technique nous en ajoutons tous les jours des nouveaux, des qui n'ont jamais existé et qui deviennent rapidement des fardeaux parce qu'il faut absolument les posséder, donc les acheter, donc posséder de l'argent, donc travailler, voler ou avoir de la chance. Bref, si ce monde ne nous causait aucun souci, on n'en parlerait même pas, on coulerait des journées silencieuses de bonheur inconscient. Et dans l'Antiquité il y avait une secte de philosophes qui avaient conclu qu'il n'y avait rien à dire à propos de ces phénomènes, rien du tout. Qu'il fallait vivre sans aller chercher midi à quatorze heure, dans la simplicité la plus dénuée de désirs et le plus silencieusement possible. Diogène, le bien connu, appartenait à cette secte des cyniques, du mot chien, non pas parce qu'on les considérait effectivement comme des chiens, ce qu'ils acceptaient de bon cœur, mais parce que leur mouvement était né dans un endroit qui s'appelait le chien quelque chose, j'ai oublié. Bref, au fond comme nos phénoménistes presque contemporains, les cyniques et puis plus tard les sceptiques, s'en tenaient là. On dit que certains d'entre-eux avaient voyagé en Inde et rencontré des yogi qui leur auraient enseigné le bouddhisme qui venait à peine de naître dans ces régions. Les sceptiques, eux, ont développé le point de vue selon lequel on ne pouvait absolument rien dire sur la provenance de ces phénomènes, ni pourquoi ils étaient là. Quant au comment il valait mieux laisser tomber et vivre dans le plus total dénuement, pas la peine de construire des maisons que la prochaine guerre allait de toute manière détruire, ni prendre des habitudes de luxe nuisibles à chacun et à tous. Ils ne prêchaient pas l'ascèse ni l'auto-flagellation, mais une sorte d'écologisme avant la lettre, chercher à exister dans un accord a minima avec la nature.
Or la Grèce et surtout Rome n'était pas peuplés de clochards, et les villes resplendissaient à travers le monde entier par leur architecture, leur confort technique et surtout la puissance des armes. Ce qui signifie que nos pauvres cyniques n'ont pas fait fortune, et que ce sont plutôt leurs adversaires qui ont imposé leurs idées qui finalement ont abouti au monde dans lequel nous vivons maintenant. Ces gens-là, évidemment, n'avaient pas les mêmes idées à propos des phénomènes que les cyniques et les sceptiques. Pour eux, il y avait autre chose devant et derrière les phénomènes. Devant ça veut dire de notre côté, du côté de ceux qui les perçoivent. Ceux qui sont attablés sur un plancher en-dessous d'un plafond, en fait, reçoivent ces phénomènes par des mécanismes spirituels déterminés, par des sens dont le produit est mis en ordre par la pensée qui possède des cases hiérarchisées nommées catégories. Exemple, si je perçoit cette table, je perçois bien une masse de bois dur et froid, et plat et à la bonne hauteur pour pouvoir y déposer mon assiette pour manger. Les platoniciens pensaient que dans notre âme existait une idée de table, une sorte de modèle qui nous permet de déterminer tel objet comme étant une table. Alors disons que si une masse de bois est telle qu'elle présente une surface propice au fait de manger et d'écrire ou d'étaler de la pâte par exemple, alors je me trouve devant une table. En fait, il se produit dans ma tête la même chose que dans celle du menuisier, je trouve le modèle, le paradigme éternel et absolu de table qui existe quelque part dans un autre monde, mais aussi dans notre mémoire. Alors comme les philosophes étaient payés pour nommer les choses après les avoir analysées, ils ont donné à ce minimum vital d'idée de table, le nom de sujet, ou d'essence. Pour qu'une table soit une table, elle doit posséder l'essence d'une table, à savoir le fait d'être plat à une certaine hauteur. Ce qui fait d'ailleurs qu'un rocher plat peut aussi servir de table sans qu'il soit besoin de faire intervenir la métaphysique. Donc les choses ont chacune un élément fondamental qui le différencie des autres et cette chose est son " essence ", d'où provient le mot essentiel qui signifie simplement important ou " le plus important ". Les autres qualités, la couleur, la dureté, la brillance ou encore la douceur au toucher ne sont que des attributs contingents, c'est à dire qui peuvent être ou ne pas être sans toucher à l'être de la table. Ma table peut être de couleur blanche ou noire, mais elle reste une table. Mais, lorsque nous regardons telle table, nous sommes bien obligés de constater, si nous voulons la décrire, qu'elle possède telles ou telles qualités particulières. Ce qui faisaient d'ailleurs dire aux cyniques qu'il ne pouvait pas exister d'idée de table parce que précisément chaque table était unique, comme chaque individu qui compose nos sociétés est unique, singulier, dont on en peut donc rien dire de général, dont on ne peut pas faire de science. C'est pourquoi la meilleure attitude face à cela est le silence et la modestie. Mais les autres philosophes ne l'entendent pas de cette oreille, car le phénomène est encadré, nous l'avons dit, devant et derrière. Nous venons de voir ce qu'il y avait devant la table, c'est à dire entre nous et elle, maintenant nous allons voir de l'autre côté pour voir ce que les philosophes y ont découvert.
De l'autre côté de cette image que forme notre esprit, la " table - phénomène " possède donc aussi quelque chose, derrière elle en somme : par exemple la matière dans laquelle elle est taillée, formée. Et bien entendu, ça ne s'arrête pas là, car il y a plusieurs sortes de matières, et il y a des quantités et des qualités et des matières lourdes et légères etc…Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, le menuisier qui l'a fabriquée et puis le monde dans lequel vit ce menuisier. La table, telle qu'elle nous apparaît est donc une sorte de frontière entre l'idée de table qui est à ma disposition dans mon âme en permanence et la matière qui la supporte pour ainsi dire et tout le reste. Elle est donc un composé de plusieurs choses dont il faudra, après, également rendre compte, idées, matières, mémoire etc.. Oh là là ! ça se complique grave. Le fait est que la vie des Grecs était un combiné de guerre, de bavardage et de plaisirs, et qu'il fallait nourrir tout cela, techniquement et idéologiquement. En résumé, on peut dire qu'à part nos braves cyniques, qui étaient restés fidèles aux philosophes de jadis, les Eléates et les Mégariques, notamment Parménide (dont je vous signale la présence dans mon adresse E-mail, ce qui n'est pas innocent…). Parménide disait que le monde EST. Point. Il n'existe rien d'autre que de l'Être, et que tous les discours qui prétendent nous enseigner qu'il existe des demi-mondes, des essences et des attributs, des choses nécessaires et des choses contingentes etc.. bref du non-être réparti en plus et en moins, sont du pur bavardage. Or, vous avez dû remarquer que dans la description platonicienne de la table, on a bien vu qu'il y avait des éléments qui étaient plus importants que d'autres, plus réels quant à la table, et qui avaient donc plus d'être que les autres qualités secondaires. Qualités secondaires qui prêtent paraît-il à confusion, car on pourrait vous faire une farce, par exemple, et tendre une toile rigide pour vous faire croire à une table, et votre assiette aurait bien du mal à rester stable. Descartes a repris cette histoire de farce en disant que lorsqu'on regarde un bâton plongé dans l'eau, on croit qu'il est cassé parce qu'on le voit cassé. Or le premier imbécile venu sait qu'il s'agit d'une illusion d'optique, sauf le savant opticien qu'était Descartes, semble-t-il, puisqu'il reprend le même schéma que Platon pour nous convaincre que ce que nous voyons est faux et que la vérité, est ailleurs…
Où est-elle, cette vérité ? Il y autant de réponses que de philosophes, mais chacun de ces penseurs a toujours déjà choisi son camp : ou bien il est plutôt cynique et sceptique, ou bien il est plutôt platonicien, idéaliste ou matérialiste. Si maintenant vous suspendez un instant votre lecture pour méditer ce que vous avez déjà lu, vous allez remarquer que ces cyniques et ces sceptiques (qui ont toutes mes propres sympathies, pourquoi le cacherais-je ?) ressemblent beaucoup à nos phénoménistes puisqu'ils sont d'accord sur un point essentiel, à savoir qu'il n'y a que des phénomènes et qu'il n'y a rien à chercher ni devant ni derrière, indiscret, va ! Mais il y a plus qu'une ressemblance entre ces deux groupes de penseurs qui se situent si loin dans le temps les uns des autres. Pour aller vite je dirais que ceux qui sont le plus proches de nous ferment en quelque sorte une boucle historique et reviennent sur les traces de ces Anciens penseurs. Ils ne sont pas les seuls à faire ce retour vers les origines, ils ne sont pas les seuls à tenter de sauter par-dessus plus de deux mille ans de philosophie monopolisée par la théologie chrétienne et le platonisme qui l'alimente à travers Saint Augustin et Saint Thomas, les deux grands auteurs qui font l'essentiel de la pédagogie de nos séminaires. Martin Heidegger et en gros la phénoménologie qui porte bien son nom, ont tenté et continuent de tenter le même geste de retour à la situation " ante Plato " et, bien sûr, " ante Atistoteles " le penseur qui a parachevé le système un peu désordonné de Platon. Tout cela a un air de famille qui est plus que cela, car ce qui est en jeu c'est la liberté elle-même, assassinée intellectuellement par des générations de penseurs dévoués à toutes les formes de pouvoirs spirituels et temporels. Mais n'entrons pas dans ces détails, ce qui nous mènerait bien trop loin de notre sujet, répondons donc d'abord à la question que nous posons au début de ce paragraphe : si la vérité n'est pas dans le phénomène lui-même, alors où est-elle ? Il y a une riche palette de réponses à cette question, une palette qui va de l'idéalisme platonicien (son fameux ciel des idées où résident les vérités des choses, les essences sur lesquelles se règlent en somme l'existence de ces choses ici-bas, un bas très bas et qui ne vaut pas grand chose, en fait le même niveau de bassesse que la Chute du couple Adam et Eve ont provoqué par leur transgression) à l'empirisme qui nie toute idée même de vérité (se plaçant ainsi dans le même paradoxe que les sceptiques qui affirment ne rien pouvoir affirmer…) ou encore les matérialistes.
Il y a plusieurs cas, dans toute l'histoire de la Pensée occidentale, qui semblent ne coller avec rien de tout cela, ni avec les phénoménistes ni avec les autres, et ces cas subiront, dans l'histoire à peu près le même traitement que celui des cyniques et des sceptiques. Je pense notamment à certains penseurs du Moyen-Âge comme Guillaume d'Occam, pourtant moine et clerc assermenté de l'Eglise, mais dont le génie honnête a refusé de s'aligner sur la ligne idéologique en vigueur à son époque. Ce nominaliste refusait tout simplement d'admettre les genres et les espèces, par conséquent les Idées et les concepts. Pour lui, comme pour les cyniques, chaque chose est irrémédiablement singulière et il est impossible de prononcer un discours global sur le monde autrement qu'en formant une grammaire artificielle pour les besoins des causes les plus diverses. Nominalisme = à chaque phénomène correspond un nom et un seul. Si je vois deux lits, je dois utiliser pour les désigner chacun deux mots différents, faute de quoi je simplifie mensongèrement. Alors pour des objets cela paraît en effet ridicule, mais lorsqu'il s'agit des êtres humains, il en va tout autrement, voire la question des clones…
Le deuxième grand exemple est évidemment Spinoza, qui construit une véritable forteresse philosophique que la plupart de ses adversaires (pratiquement tous les autres philosophes) reconnaissent comme inexpugnable. En fait, Spinoza revient tout simplement à Parménide en y ajoutant la notion de Dieu et en précisant la place que les hommes peuvent occuper dans cet Être formé par le panta, c'est à dire le Tout. On a appelé sa philosophie le panthéisme parce qu'il prétendait que Dieu n'est rien d'autre que le Tout de l'Univers. Ce tout portait le nom de substance, un mot que n'importe qui peut analyser en deux partie sub = sous, stance = se tenir, être. La Substance mystérieuse de Spinoza, qui permettra à ses détracteurs de l'attaquer grâce à la possibilité des interprétations abusives que l'on peut faire de ce terme, par exemple dire substance = matière, n'est rien d'autre que l'idée que quelque chose, Dieu, se tient de manière immanente en tout ce qui est. Autrement dit, le monde ou l'univers forment Dieu lui-même, et nous sommes partie de ce tout avec la même liberté et les mêmes prérogatives et devoirs que ce tout, les mêmes possibilités aussi de faire le bien ou le mal, bref d'assumer le degré de liberté que notre place dans ce tout nous abandonne mais qu'il nous est loisible de découvrir et de respecter ou bien de mépriser et de foncer dans l'irrationnel. Au fond, on est tout près des cyniques et le système que forme l'Ethique, l'œuvre principale de Spinoza, nous délivre de Dieu, de ses anges et de ses clercs qui aspirent surtout à se goberger avec nos richesses. On a dit de l'Ethique qu'elle était la traduction laïque de la Cabale, raison pour laquelle, paraît-il, Spinoza a été excommunié de sa communauté judaïque, fait rarissime dans le judaïsme, tant le Talmud offre de possibilités de rachats et de pardon. Sommé de retirer son œuvre et de renier sa pensée, le philosophe néerlandais qui gagnait sa vie en polissant des lunettes, refusa tout compromis et quitta sa communauté pour vivre dans une solitude presque absolue mais d'une sérénité que peu de philosophes peuvent se vanter d'avoir atteint. Prenez l'exemple de Leibniz, immense penseur et célèbrissime écrivain connu dans toute l'Europe et invité dans toutes les cours et qui mourut dans la misère et à la limite de ce que pouvait tolérer un sujet qui avait atteint de tels honneurs. D'ailleurs à part quelques cyniques comme Antisthène ou Diogène, de penseurs originaux et isolés comme Guillaume d'Occam et Spinoza, je ne connais pas beaucoup de philosophes qui ont vécu des existences qui correspondent à la sérénité qui règne dans leur œuvre. Si, je ne veux pas oublier Nicolas De Cues, ce prélat aventurier et philosophe génial dont l'œuvre principale porte le nom suggestif de " La Docte Ignorance ". Beaucoup plus près de nous Heidegger est sans doute une exception des temps contemporains, lui qui a dérapé gravement à l'époque nazi, mais qui a su s'en détacher et continuer d'habiter ce monde dans une sérénité enviée par tous ceux qui l'ont approché.
Vous aurez compris que l'enjeu du phénoménisme est la liberté, comme elle était aussi celui des phénoménologues comme Husserl, Sartre, Merleau-Ponty ou Lévinas. Quelle différence entre eux et nos phénoménistes ? Deux choses, si on peut appeler cela des choses, Dieu et la différence ontico-ontologique. Pour un phénoméniste pur, il n'y a pas de différence entre ce que nous voyons être et ce qui EST puisque ce qui EST est ce que nous produisons nous-mêmes : nous sommes les auteurs ou les créateurs de notre propre monde, et cette création continuée se fait avec l'aide de la Raison qui nous structure, que nous sommes. L'homme est animal rationale, ce que Descartes avait déjà plus ou moins affirmé, mais les rationalistes des siècles suivants iront beaucoup plus loin, ils intégreront toute la vie psychique dans la Raison, leur systèmes seront des panpsychismes de la Raison. En fait, on décèle sous cette manière de penser, la dialectique hégélienne d'un Esprit qui s'incarne dans l'Histoire et qui retourne à lui-même par cette même Histoire. Car Hegel est le totem de ce siècle par ailleurs si mouvementé, le totem et le modèle à refouler pour toutes sortes de raisons qu'il n'y a pas la place ici de développer. La grande différence qui fait le phénoménisme, qui par ailleurs intègre parfaitement le mouvement dialectique hégélien, est le refus de considérer qu'il existe quelque dépendance que ce soit entre la monade - personne et le reste. Il n'y a d'histoire que celle des hommes et de leur volonté, c'est à dire de leur liberté. Quelles que soient les difficultés logiques qui surgissent dans la manière de rendre cohérent le tableau d'ensemble de l'homme aux prises avec le phénomène social et la religion, les phénoménistes auront eu le mérite immense de refuser la fatalité des déterminismes transcendantaux et théologiques. Ils ne forment pas pour rien le cœur de l'esprit de notre République, et je ne vous ai torturé avec ce sujet si complexe qu'à cause de cette position dans notre histoire. Aujourd'hui la République, dit-on, est en danger. Elle l'a toujours été et il appartient pour ainsi dire à son destin d'être le cœur même du danger d'être, et c'est le mérite de ces demi-fous de notre culture nationale que d'avoir tenté de le montrer. Ils ont bien mérité cet humble hommage sur mon humble Homepage.
Mercredi 25 juin 2003
La naissance de la liberté
Aujourd'hui je vais tenter de traduire un peu tout cela dans mon propre vocabulaire, c'est à dire un vocabulaire que je pense être à la portée d'à peu près d'importe qui, mais sans exagérer mon optimisme, car Karl Marx pensait aussi avoir conçu ses œuvres à l'intention des ouvriers, en oubliant, peut-être, que ces mêmes ouvriers ne possédant déjà rien en tant que prolétaires, possédaient encore moins le temps qu'il fallait pour se lancer dans le travail que représente la lecture de la philosophie, et en ce qui concerne Marx, je sais de quoi je parle. En réalité, le langage conceptuel a deux avantages indéniables : il permet en premier lieu de gagner du temps. Mais ce n'est pas le plus important, son plus grand privilège est de pouvoir servir de code au clergé de l'intelligence, aux clercs, c'est à dire à tous ces gens qui sont payés, patentés pour distribuer le savoir, ou plutôt pour l'imposer selon les désirs du Prince. La pédagogie est depuis longtemps devenue l'affaire du souverain et de ce qu'il attend du comportement de son peuple. Rien de plus difficile donc que d'échapper à cette double nécessité d'être bref et efficace : les clercs sont là pour décourager les jeunes du savoir, rien de plus facile avec le jargon mis au point dans les Académies.
Je vais donc tenter aujourd'hui de parler de la liberté, ou plutôt de poser des questions sur cette délicate question qui se présente dans la philosophie occidentale comme une sorte d'épicentre de tout système de pensée. Ma première question ne sera pas du genre : sommes-nous libres ou non ? ou encore qu'est-ce-que la liberté, ou bien encore " il y -t-il contradiction entre la Toute-Puissance de Dieu et l'existence du Mal ? ou encore : Dieu peut-il autoriser la liberté si son pouvoir sans limite lui permet de savoir d'avance tout ce qui va se passer ? Non, non et non. En analysant bien ce genre de question on se rend immédiatement compte que chaque mot est piégé et qu'on pose des questions avec des mots vides de sens et dont il n'y aucune définition qui permette d'en discuter. Ma démarche sera beaucoup plus modeste, et je vais commencer par me demander comment naît le sentiment qui correspond à ce concept, et puis ensuite seulement comment naît le mot lui-même. Même si le contraire nous eût bien facilité la tâche.
Comment peut donc naître dans l'esprit d'un individu la notion de liberté ? A priori, le seul événement qui paraisse universel dans le destin des enfants qui apprennent la vie et qui puisse les mettre sur la voie de ce qu'est la liberté, est la situation conflictuelle dans laquelle ils se trouvent dans leurs rapports au monde. La plus grande partie de l'éducation des enfants, quels qu'ils soient d'un bout à l'autre du monde, est consacrée à la gestion des interdits qu'on oppose à leurs " instincts ", à leur désir spontané et à leur passions. Pour un enfant la liberté, qui n'est pas encore une notion, s'apprend dans le rapport à l'interdit, c'est à dire dans l'opposition avec autrui. Selon le régime politique dans lequel naissent ces enfants, il y a certes des différences immenses : le rejeton d'un souverain est éduqué en fonction de l'exercice de la souveraineté, et celle-ci pouvant être absolue, il faut admettre que son éducation est logiquement structurée sur ce modèle. Ainsi, un dauphin doit être éduqué de telle sorte qu'il apprenne à satisfaire sur le champ le moindre de ses désirs : un fils de Roi ne peut pas se soumettre à quelque interdit que ce soit puisqu'il représente dans son corps et dans son esprit le désir et la volonté profonde de son peuple. Tout ce qui est bon pour lui est bon pour le peuple. La monarchie constitutionnelle a déjà introduit dans l'éducation de ses héritiers, la logique bourgeoise d'un pouvoir politique exercé selon certaines règles rationnelles liées à des choses totalement extérieures à la politique proprement dite, à savoir l'économie. Ce n'est pas pour rien que les Anglais ont été les premiers démocrates modernes, et les premiers monarques à dresser leur progéniture en fonction de tâches rationnelles et non pas de pure jouissance du pouvoir.
Voir le monde s'opposer à son désir est donc le lot commun des enfants. Cette logique est liée directement à celle de la propriété territoriale, ou plutôt à l'existence de territoires réservés aux adultes, comparables à ce qu'on appelle territoire pour un animal qui délimite son champ de souveraineté. Les parents d'un enfants doivent délimiter leur territoire par rapport au désir de leur engeance s'ils veulent mener à bien leurs propres initiatives et leurs propres ambitions dans l'existence. Je ne veux pas mêler à tout cela les analyses freudiennes qui nous mèneraient trop loin et qui ne respecterait pas le pacte de simplicité auquel je me suis astreint au début de ce texte. Mais il est évident que l'interdit de l'inceste est l'un des premier obstacles que rencontre le candidat à l'humanité dans son existence. Son destin dépendra d'ailleurs largement de la gestion de cette opposition pour ainsi dire naturelle. Interdits de toutes sortes, protection du territoire des adultes, dressage du rapport à autrui, châtiment pour les infractions etc… voilà en somme le terrain sur lequel naît un sentiment de révolte ou d'injustice par rapport à la situation différente des adultes. Mais cela ne fait pas encore la notion ni le mot de liberté.
Hé bien, en parlant des enfants, nous avons mis sans le savoir dans le mille, puisque le mot liberté vient directement du mot latin enfant, qui ne se dit pas seulement puer, pueris, mais aussi liber, liberis. Puer signifie enfant d'un point de vue général s'appliquant à tous les enfants sans distinction d'origine, esclave, étranger ou citoyen . Liber ne se rapporte au contraire qu'aux enfants nés libres, c'est à dire nés dans une famille d'hommes libres. Chez les Romains, comme chez les Grecs ont pouvait avoir l'avantage et le privilège de naître libre et de n'avoir pas à conquérir cette liberté d'une manière ou d'une autre, même si la préservation de ce statut exigeait malgré tout un comportement déterminé et des vertus jugées par les autres. Or, de nos jours cette situation n'apparaît plus dans toute sa clarté, c'est à dire que l'on naît en principe libre, principe inscrit dans une Déclaration et une Constitution, mais où demeurent des différences liées à la position sociale des parents. Si les enfants de condition bourgeoise ou aristocratique demeurent en général soumis à une discipline familiale minimale, liée à la qualité des mœurs sociales d'une époque, ils bénéficient quand-même d'un surcroît de liberté dans le domaine de la jouissance. La pauvreté est synonyme de nécessité, c'est à dire de limitation du désir. Naître dans le besoin, c'est naître avec le bénéfice d'une liberté abstraite mais d'une dépendance directe concrète dont les " liberi " d'aujourd'hui ne souffrent pas. Sauf dans les cas où les parents seraient parés de toutes les vertus au point de traiter leurs enfants avec la dernière rigueur et sur un plan qui ne les distinguerait en rien des autres enfants. J'ai connu, dans mon collège catholique, des jeunes aristocrates issus de familles richissimes fagotés comme des enfants de la rue, tandis que leurs voisins d'origine petite-bourgeoise portaient déjà les marques de la relative aisance de leurs parents.
Le sujet de cette chronique m'est passé par la tête ce matin en descendant en ville dans le bus et en regardant autour de moi en me rappelant ma propre enfance dans les rues de ma ville. Et je me suis dit qu'il y avait dans notre appropriation de la rue dans nos jeux d'enfants, quelque chose qui fait défaut aujourd'hui aux enfants et à la jeunesse en général. Aujourd'hui la rue appartient aux automobiles ou aux commerçants des quartiers piétonniers. Plus question de transporter dans l'espace sans limite des rues, le cadre ludique de l'enfance. Aujourd'hui l'existence des hommes commence par une sorte de confinement à l'intérieur de quelque chose, au mieux dans l'espace qui entoure immédiatement les immeubles sociaux des banlieues. La libre disposition de la rue avait de nombreux avantages dont celui du brassage social naturel à une époque où les villes étaient encore relativement homogènes quant à la distribution des classes sociales. Il y a là aussi un confinement majeur dans une classe sociale déterminée, et plus on monte dans l'échelle sociale, plus on se trouve confiné dans la consommation de gadgets plus ou moins sophistiqués. Car au confinement concret, la société à répondu par une liberté virtuelle ou par un simulacre de liberté qui passe par les objets de l'imagerie moderne, la télévision, les jeux vidéo etc…En fait il s'agit d'un redoublement du confinement lié à la disparition des rues comme espace de jeu. J'insiste beaucoup sur cet aspect parce que la rue était une réponse naturelle, ou un moyen de répondre à l'avalanche d'interdits inscrite dans le cadre du domicile familial. Il y avait un équilibre entre la vie familiale directe et la vie personnelle qui se formait dans la rue. La personne se formait très largement dans la rue, tandis que le sujet ou le citoyen prenait ses marques à l'école et dans le cercle familial.
Un autre aspect me donne depuis longtemps des inquiétudes quant à cette acquisition de la notion de liberté, notion sans laquelle on ne saurait imaginer que se perpétue une société démocratique fondée par et pour la liberté, dont la valeur fondatrice était précisément cette liberté dont nous parlons. Cet aspect est l'époque dans laquelle on naît. Je me suis souvent demandé comment ont pouvait historiquement en venir à se soucier de sa propre liberté si on n'a pas vécu de près des périodes d'absence totale de liberté ! Autrement dit, et nous sommes là au cœur de notre méditation, est-ce-que la liberté est un sentiment naturel inné qui n'est pas seulement relié à tout ce que nous venons de décrire, ou bien la liberté est-elle un concept que l'on doit toucher avec son corps, et cela dans le paradoxe de son contraire ? Nous qui avons vécu au beau milieu de l'absence la plus absolue de liberté qu'ait pu connaître l'Europe, la situation imposée par les Nazis, avons-nous du mérite à défendre l'idée de liberté dont nous avons eu une expérience aussi intense ? Qu'en est-il, d'un autre point de vue, des enfants qui naissent aujourd'hui dans une apparente absence générale de contraintes, d'atteintes permanentes à la liberté, que l'amour et la faiblesse des adultes mettent le plus souvent à l'abri d'une rigueur nécessaire ? Aujourd'hui il semblerait que tous nos enfants naissent LIBER, enfants libres nés d'hommes libres. Mais qu'en est-il des milliards d'enfants qui voient le jour dans les pays où ils ont à peine le temps de respirer que les voilà déjà attelés aux travaux les plus durs et les plus dangereux ? Que peut-il se passer pour ces enfants-là, sinon l'apprentissage in concreto de la liberté, apprentissage que les nôtres n'ont même plus l'occasion d'imaginer ? Hier encore j'ai vu de ces enfants congolais de dix-douze ans, kalachnikov en bandoulière et sourire au lèvres, que pourraient-ils faire d'autre que de sourire comme nous souriions en jouant librement dans les rues, car ces enfants jouent, et ils jouent de surcroît pour leur propre survie, le jeu le plus vrai qui puisse exister, le Grand Jeu que même notre pire barbarie avait à peu près réussie à éviter aux plus jeunes. Gageons que tous ceux qui survivront à ces épreuves et à ces jeux cruels seront ceux qui transmettront le plus fidèlement à leur descendance cette notion dont nous oublions chaque jour un peu plus l'origine et la nature.
PS : dans un journal comme celui-ci, les répétitions sont inévitables et ceux qui ont eu le courage de lire tous les volumes qui précèdent me pardonneront certaines répétitions à la faveur d'un traitement tout à fait nouveau d'un sujet comme celui-ci. Pour avoir lu les volumineux Carnets d'Ernst Jünger, je connais l'agacement que provoque ce genre de répétitions, mais toute écriture ressasse forcément, ce n'est pas encore du radotage.
Jeudi 26 juin 2003
Qu'est-ce-qu'un journaliste ?
En tant que journaliste moi-même depuis plus de 25 ans, après une carrière multiple dont une grande partie dans l'enseignement, je pense avoir quelque légitimité à m'attaquer à la définition de ce métier, de sa véritable finalité et de sa déontologie. J'ai même cru bon, avant de m'installer définitivement dans cette profession d'acquérir le diplôme de journaliste dans l'une des écoles à ce jour l'une des plus réputées de France. La première remarque que je ferai donc est que cette école, dont je tairai le nom, ne m'a pas appris grand chose car dans les années 70 le ton était donné : le produit d'un journaliste était avant tout un produit qu'il fallait vendre. Heureusement il restait un honnête homme à la tête de cette école et je n'oublierai jamais les leçons de dignité, de modestie et son immense connaissance de l'histoire contemporaine. Il est aujourd'hui à la retraite et je pense que personne n'aura su ni pu le remplacer, d'autant que la motivation commerciale a fini par prendre le dessus dans l'enseignement du journalisme. Je dois aussi reconnaître que j'ai mené ces études tardivement, à plus de quarante ans, et que je possédais donc une maturité intellectuelle qui manquait cruellement à mes jeunes collègues, ce qui me permettait de tirer le meilleur profit de tous les enseignements positifs de cette école. Car le programme était encore relativement équilibré, au sens où l'on y enseignait encore des matières universitaires qui sont aujourd'hui supposées connues puisqu'on ne peut entrer dans ces écoles sur concours et avec en poche le minimum d'un Deug, et il vaut mieux avoir déjà une maîtrise dans sa besace, car il ne faut plus compter sur une pédagogie de contenus, mais seulement sur une initiation au marketing, et cela dans tous les secteurs de la presse, écrite et audiovisuelle. Nous avions même, je m'en souviens avec une certaine tendresse, un cours de Culture Générale pour lequel la plupart des étudiants réservaient un profond mépris. Je sortis major de ma promotion, et je ne fais état de ce détail narcissique que parce que cette victoire était celle du journalisme contre le commerce. Peut-être l'une des dernières. Mon professeur de presse-écrite avait barré mon premier papier d'un grand " invendable ", je me devais de lui montrer que j'étais capable sinon de vendre mes papiers, de me vendre moi-même à mes examinateurs sinon plus tard à mes employeurs.
La grande confusion qui règne aujourd'hui autour du métier de journaliste est celle qui le confond avec le métier de la communication. Jadis il existait d'ailleurs un contentieux qui paraît aujourd'hui réglé, à savoir le statut des rédacteurs de collectivités territoriales. C'était le début des " Lettres à leurs concitoyens " des maires, des conseillers généraux et régionaux, bref c'était un travail de publicité politique pour lequel il n'y avait aucun titre à la Carte de Journaliste. Mais je crois que cette chose a été réglée en faveur de cette nouvelle espèce de journalistes, bien que la fameuse carte elle-même n'offre plus le moindre privilège, ce dont il faut bien prendre conscience pour comprendre qu'à l'instar de l'enseignement, ce métier a également perdu son prestige et du coup son indépendance. Deux de mes professeurs de ces années quarante-cinquante sont honorés dans notre ville par des noms de rue et de place. Je crains que ce genre de récompense méritée soit passé de mode en même temps que la respectabilité de leur enseignement. Comme quoi, je ne parle pas ici seulement d'un métier, mais d'une évolution qui frappe tous les secteurs de notre société. Je dis bien qui frappe, car il s'agit bien de coups, de blessures irréparables dans le tissu intellectuel et spirituel de notre pays. Bien sûr on va me répondre que la démocratisation de l'enseignement ne pouvait pas se faire sans casser des œufs, mais la réponse est évidente, la culture n'est pas une omelette. Pas plus que le sens de la citoyenneté, chose étrange que nous distillaient nos maîtres sans en parler, alors qu'aujourd'hui tout le monde en parle sans rien laisser passer dans la conscience des jeunes élèves. Donc, être journaliste n'a rien à voir avec le métier qui consiste à communiquer. Dans aucun sens du terme, car même une pissette qui rapporte ce qu'on appelle un chien crevé dans le métier, un fait divers banal, est signée, c'est à dire représentée par un individu qui a son propre regard, sa propre expérience, son opinion et sa déontologie. Cela signifie qu'une information n'est jamais neutre. L'objectivité est elle-même un enjeu moral et cette objectivité est le fruit d'un travail et d'une ascèse intellectuelle à laquelle on est initiée ou non, fidèle ou infidèle. Il n'existe aucune information sans arrière-plan ou sans contenu moral, qu'il s'agisse d'un assassinat ou d'un tremblement de terre. Bref, un journaliste n'est pas un communicateur mais toujours déjà un interprète de la réalité qu'il décrit. L'apolitisme ou le neutralité politique est la plus vaste blague, mais aussi la plus terrible réalité qui s'est imposée au fonctionnement du métier dans tous les médias, je dis bien tous les médias. Les deux ou trois exceptions sont tellement célèbres que je ne les nommerai pas ici, il suffit de se rappeler que l'honnêteté intellectuelle de ces vecteurs d'informations tire sa preuve du fait qu'ils vivent sans publicité.
Mais je ne veux pas, ici, refaire un procès mille fois jugé et en particulier dans le petit livre d'un confrère courageux : Serge Halimi, qui en cent pages rend compte des " Nouveaux Chiens de Garde ", en référence à un autre livre plus ancien qui portait déjà le titre " Les Chiens de Garde ". Ce que je voudrais expliquer ici, c'est l'essence du métier, l'essentiel de ce qu'est informer l'opinion par le biais des moyens que l'on connaît aujourd'hui. Jadis il existait une forme qui a pratiquement disparu et qui s'appelle le téléphone arabe ou la rumeur, les pouvoirs politiques ont fait un remarquable travail pour faire taire une fois pour toute cette rumeur qui est devenu le monopole des médias selon leur stratégie propre, et celle de leurs commanditaires. Pour décrire le travail de journaliste, je le diviserais donc en trois partie : la première est le simple rapport ou reportage de l'événement, sa description selon les cinq fameux principes : Qui, Quand, Où, Comment, Combien. Le pourquoi qui semble manquer dans cette liste appartient déjà à la seconde partie du travail à savoir le cadrage historique de l'événement. L'un des principaux devoir du journaliste est de trouver les liens cachés entre les événements, autrement dit le cadre historique dans lequel il s'inscrit. En fait, un journaliste digne de ce nom est un historien du présent, d'un présent qui a des racines et qui est relié au passé par des logiques que seules la culture et l'expérience peuvent délivrer au professionnel de l'information. La troisième partie de cette description porte évidemment sur la déontologie ou la moralité, c'est à dire avant tout le refus de soumettre le message que l'on émet aux intentions ou aux intérêts d'un ou de plusieurs tiers. C'est là le problème le plus douloureux aujourd'hui et la liberté d'expression des journalistes n'a jamais été aussi bafouée que depuis une vingtaine d'années.
Je comptais m'étendre sur l'aspect culturel de ce métier et de cette nécessité pour tout journaliste sérieux de posséder une solide culture générale et des connaissances étendues de l'actualité présente, mais je pense en définitive qu'il est plus important de parler de la moralité de nos journalistes, et là c'est pas triste. Dans la France d'aujourd'hui, il y a en gros deux secteurs qui s'ouvre à un jeune journaliste qui sort de l'une des écoles dont j'ai parlé plus haut, le secteur public et semi-public, car les choses sont loin d'être claires (Tout le monde pense qu'Arte est un service public, or cette chaîne de télévision est une entreprise privée par le biais de participations de collectivités locales allemandes mâtinées de participation minoritaire de telle ou telle chaîne privée, le but étant de ne pas générer de fonctionnaires supplémentaires…) et puis le secteur privé. Dans ce dernier secteur les choses sont claires, elles sont même conventionnellement claires : le journaliste d'une entreprise privée est soumis à la ligne éditoriale de son entreprise, quelle qu'elle soit. La ligne éditoriale est un euphémisme pour désigner l'appartenance politique du média en question. La convention collective des Journaliste prévoit même qu'en cas de changement de ligne éditoriale pour raison de vente du journal ou de la chaîne, le journaliste peut demander la fameuse " clause de conscience " c'est à dire une indemnité de démission ou de licenciement. Dans le secteur public et semi-public les choses ne sont guère différentes, sauf que le statut moral du journaliste ne l'engage pas à la soumission à une ligne éditoriale, puisque le service public n'est pas sensé en avoir une en particulier. Cela dit tout le monde sait bien que la télévision a rarement bénéficié d'une réelle indépendance vis à vis du pouvoir politique, ce qui rend la position des journalistes extrêmement fragile bien qu'elle soit protégée par la Charte inscrite dans la Convention collective, Charte sur laquelle s'assoient la majorité des patrons de presse privée. Aussi, les journalistes peuvent-ils refuser de se soumettre aux oukazes de leurs rédacteurs en Chef, au risque de se retrouver dans les fameux placards, sorte de geôle professionnelle que j'ai bien connue tout au long de ma carrière. Le placard peut n'être qu'un bureau avec quelques trombones à tortiller et un téléphone, mais il peut aussi signifier qu'on vous spécialise dans un secteur indolore. J'ai ainsi hérité de l'agriculture jusqu'au moment où j'ai compris que l'agriculture était en soi un secteur aussi pourri que la politique elle-même, et dès mon premier reportage un peu véridique sur les dessous de la FNSEA, la direction de ma chaîne m'a rendu à mon bureau et à mes trombones. La Maison Ronde de Paris, l'ancien siège de l'ORTF, fourmille de petits bureaux où d'anciens rédacteurs en chef et adjoints attendent des jours meilleurs, c'est à dire des changements de régime. Heureusement pour eux, on ne leur demande même pas de pointer. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je reviendrai sur ce sujet, car il me semble que j'ai manqué le développement de l'idée principale que je souhaitais faire passer, ma sacrée tendance à digresser, mais aussi le temps qui presse car je travaille en temps réel. Ce qui me permet de vous dire presque tous les jours : à demain !
Lundi 30 juin 2003
Petits et grands plaisirs de la lecture.
Plus j'avance dans la lecture de Renouvier, plus je sens souffler en moi ce vent de l'histoire républicaine qui a formé des citoyens qui peuvent se reconnaître sur des bases solides sans se confondre dans l'uniformité. C'est un de mes plus grands plaisirs que de me reconnaître ainsi dans le style et la pensée d'un auteur du passé, parfois de très loin, comme ce fut le cas d'abord avec ce magicien d'Empédocle et puis Plutarque dont l'œuvre hélas s'épuise sur mes rayons. Se reconnaître ainsi ne signifie pas du tout établir une quelconque comparaison de valeur, bien entendu, mais c'est sentir que l'on a un monde en commun, une aperception qui aboutit aux même conclusions pratiques et théoriques. A ma connaissance, Heidegger est complètement passé à côté de cette transmission-là de l'instinct républicain depuis Athènes jusqu'à Jules Ferry, alors que toute sa passion gisait dans la nostalgie des origines grecques de l'être au monde occidental. D'où d'ailleurs son respect prudent et souvent admiratif du texte de Platon et une inféodation intellectuelle totale à Aristote, ce qui trahit l'anti-républicanisme viscéral de Heidegger et éclaire cruellement son échec. Il sait que l'un comme l'autre ont trahi la question de l'Être, ses conférences sur Temps et Etre en sont la preuve, car il y a chez lui une forme de démocratisme germanique du Volk rassemblé autour du feu. Le Völkisch, mal traduit par populiste, ne trahit pas vraiment chez lui la fameuse idéologie du Blut und Boden, vague idée d'une symbiose romantique du sang et du territoire, mais plutôt ce qu'il ne veut pas prendre au sérieux dans l'ontologie des Grecs, à savoir la place qu'occupe la démocratie dans le dispositif du savoir et de la sagesse, c'est à dire de l'élaboration collective de la question de l'Être.
C'est à un carrefour de ma méditation sur l'Usure de l'Être, c'est à dire de l'Histoire en tant que double phénomène d'élucidation et de liquidation portant intérêt de l'Être, que les rationalistes, ou plutôt les intellectuels bourgeois du Dix-Neuvième sont apparus. Ils surgissaient dans le procès retentissant et scandaleusement injuste que leur faisait Nietzsche, cette créature ex-nihilo d'une aristocratie allemande mélancolique mais précisément chauffée à blanc par la question du politique. C'était l'ivresse bachique du génie wagnérien tentant de réchauffer la mythologie face à une religion orpheline qui amena Nietzsche à récuser d'un bloc toute l'histoire de l'occident, cependant que des fourmis érudites tentaient de construire une Tradition de la Raison dans l'Histoire. Jacob Burckhardt, qui fît la carrière universitaire de Nietzsche à Bâle, n'était pas entièrement dupe des dangers vers lesquels les visions anti-historiques de son jeune Maître de Conférence risquaient d'entraîner le monde (voir la remarquable petite mise au point de Karl Schlechta dans Le Cas Nietzsche)11. J'avais en quelque sorte déduit a contrario de la haine de Nietzsche pour les " philistins " de la culture germanique, l'éminence de leur rôle intellectuel. Mon analyse dépassait d'ailleurs le cadre des oppositions théoriques pour aller voir dans le statut réel de la bourgeoisie européenne de ce siècle, coincée entre le prolétariat fantasmatique de Marx et l'aristocratie bien réelle de tout ce qui faisait l'anti-France de ce siècle. Dans mes postulats je n'avais pas non plus oublié l'immense travail des Aufklärungen12 à travers toute l'Europe, y compris l'Allemagne.
Mais à cette époque, je ne connaissais que de loin les rationalistes français, ces penseurs oubliés, simplement remisés dans les curiosités de seconde main dont on ne citait d'ailleurs la plupart du temps que celui qui s'est retranché massivement de leur camp en inventant un certain nietzschéisme à la française, à savoir Bergson. Mais de Renouvier ou de Hamelin, pas un bruit, Lachelier et son élève Alain ayant encore un petit quartier d'hiver dans les programmes de Terminale, du moins avant la révolution des manuels de philosophie de 1960. Lorsque les Huysman et Vergès (je ne suis pas sûr de l'orthographe et je n'ai pas de quoi vérifier, veuillez m'en excuser) prirent le relais des anciens manuels, ils avaient déjà fait de la métaphysique un vague chapitre des Sciences Humaines. C'est à cette époque que commença le lavage de cerveau freudo-marxiste dont on est pas encore sorti. Mais il restait encore, dans l'université, quelques exemplaires de ceux que l'on a subitement considéré comme les habitants du Jurassic Park de la philosophie, et l'un de mes professeurs continuait imperturbable ses études hameliniennes, tandis que provenait des amphithéâtres une cacophonie à base de Heidegger, de Marx, de Freud et de Derrida à peine sorti de sa coquille. Lorsque j'ai entrepris mes études, j'avais déjà vingt-cinq ans et de grandes lectures derrière moi, dont celle de Marx, de Nietzsche et de Hegel. Du jour au lendemain, je n'ai plus rien compris, ni de ce que je savais, ni de ce que j'ignorais tant la confusion régnait dans l'esprit même des pédagogues. Il m'est déjà arrivé de vouloir rendre mes diplômes de philosophie à l'université tant le remord me tenaille au souvenir de cette perplexité qui n'a pris fin que bien longtemps après l'obtention de ma licence. Fort heureusement à cette époque, nous étions entre 66 et 69, l'action politique pris avantageusement la place de l'action de pensée, la dialectique sur le terrain valait bien trois années de bavardages.
Je reviens donc à Renouvier, ce génie méconnu pour deux raisons assez évidentes, d'abord parce qu'il a refusé toute sa vie de s'agréger au corps académique, et ensuite parce qu'il était trop radical dans sa façon de penser le rationalisme. Il faisait partie de ces républicains laïcs qui mangeaient du curé à chaque petit déjeuner, race qui s'éteint dans l'indifférence sinon dans un lâche soulagement. Mais l'intérêt prodigieux, pour moi, de la découverte de cette Ecole de pensée, se rattache à une question ontologique fondamentale : en réinterprétant l'histoire selon les catégories ontologiques du personnalisme, les disciples de cette école ne font rien d'autre que de donner un sol stable à ce que Martin Heidegger nomme pompeusement l'oubli de l'Être. Et ce n'est pas un hasard si ces penseurs articulent leur travail exactement comme Heidegger sur une interprétation minutieuse d'Aristote, une herméneutique qu'il vaudrait mieux considérer comme un débat assez féroce comparé au respectueux examen conceptuel opéré par Heidegger dans un cadre de pensée rempli du respect de l'ancien étudiant en théologie thomiste et augustinien. Ah quel bonheur de lire enfin la vérité sur le " surveillant "13 d'Hippone, l'évêque Augustin devenu Saint pour services rendus au platonisme et aux conciliaires de Nicée, les inventeurs de la Transsubstantiation ! Quel bonheur de tomber ainsi sur des conclusions que l'on avait tiré soi-même de l'histoire de la philosophie et surtout sur le courage de l'énonciation tel qu'il a toujours fait défaut à l'école allemande de la Phénoménologie, mais aussi aux Français de la même tendance. L'écho médiatique scandaleux donné à la petite comédie de Gérard Depardieu lisant Augustin en chaire de Notre-Dame est un sous-produit de cette attitude de carpette des intellectuels français devant les Pères de l'Eglise, et en particulier le surveillant d'Hippone, ce Kierkegaard qui aurait oublié en passant de demeurer honnête envers lui-même.
En entamant la lecture de Renouvier je ne m'attendais certes pas à une si grande jouissance, jouissance dans laquelle entre pour une grande part une corroboration permanente de nos visions de l'histoire grecque et romaine. J'y décèle bien sûr des sources communes, de Montesquieu à Gibbon et peut-être déjà Mommsen, des historiens qui ne s'en sont pas laissé compter sur la véritable histoire du Christianisme sous les Empires romains. Mais cela n'est rien à côté de l'option décisivement laïque, c'est à dire logiquement athée, une position jusqu'à laquelle la plupart des contemporains et disciples de Renouvier n'ont pas osé aller, ce qui les a pénalisé tant dans leur rapport historique avec Nietzsche que dans leur propre théorie. Même Bergson a gâté les meilleures parties de son œuvre par une bigoterie stupide et inutile. Je conclurai aujourd'hui par un acte de probité intellectuelle inattendu : il est clair que la Raison + la dialectique ne peuvent se passer de Dieu. Mais Spinoza avait réglé ce problème une fois pour toute dans un langage beau et clair : " Par Dieu, j'entends un étant absolument infini, c'est à dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie"14. Ce dieu-là, je le prends, et il me suffit pour asseoir la Raison et la dialectique, ce que nous verrons plus loin.
11
Karl Schlechta, Le Cas Nietzsche, tel Gallimard, 1997
12 Philosophies des Lumières
13 Le mot évêque, en grec episcopoi, signifie " surveillants ", un pion quoi…
14 Spinoza, Ethique, Traduction Pautrat, Seuil, 1999.
Mardi 1er juillet 2003
Dieu, substance et raison.
Je me suis avancé hier à propos de Spinoza, avancé d'autant plus loin que les personnalistes du genre Renouvier étaient eux-mêmes totalement réfractaires à ce fameux " panthéisme ". Hamelin éprouvait une véritable frayeur à son propos, il voyait de la substance partout, c'est à dire de la matière, ou du moins, autre chose que des phénomènes ou idées. Autre chose ? Est-ce bien sûr ?
" Par Dieu j'entends " :
j'entends
! La représentation que je me fais de Dieu, l'idée du divin, la manière dont l'attribut fini que je suis peut rendre compte de son appartenance à l'infini de l'étant "absolument " infini ( ne peut pas être autre chose qu'une idée). La définition V dit clairement ce qu'est la " manière ", elle est une affection de la substance, la substance telle qu'elle est en "
autre chose
", sous-entendu pas en elle-même. Ma " manière, mon " entente " ne correspondent donc pas aux essences éternelles et infinies, et Spinoza n'ignore certainement pas la contradiction qu'il y a entre " étant " et " infini " ( Aristote : "
rien d'infini ne peut exister ou alors l'infinité n'est pas infinie
"
15
15). L'étant c'est ce qui m'apparaît dans la finitude des attributs, c'est à dire dans les attributs qui existent hors de l'infini et, si l'on veut, de l'absolu. Infini et absolu sont des attributs spéculatifs de la substance, et donc aussi de l'étant, sans que ces attributs me soient donnés dans un présent autre que celui de l'esprit spéculatif. Dans la Définition IV Spinoza le dit clairement : "
Par attribut, j'entends ce que l'intellect perçoit d'une substance comme constituant son essence
essence " : ce que l'intellect perçoit, point. Or l'intellect est " borné " comme peut l'être le corps (Définition II), donc " ce que j'entends " n'est que le reflet de ma spéculation : il n'y aucune affirmation véritative dans la définition de Dieu. Ni surtout de matière : la substance est un rapport logique de l'intellect, ce qui nous laisse une toute petite marge de manœuvre, à savoir en faire le présent ou la présence, mais en aucun cas la matière (ou autre chose que l'idée, la présence étant une idée).
De quoi ont peur les idéalistes du Dix-Neuvième ? Leur objet d'élection, et il est aussi le nôtre, est la liberté de la personne. Or, le chapitre cinq de l'Ethique porte ce titre qui exprime tout d'un seul coup : "
De la Puissance de l'Intellect,
autrement dit,
de la Liberté Humaine
Pour nous, cette puissance réside en un seul lieu, dans le pouvoir plus ou moins clair de l'esprit de se représenter la présence en tant que présence. J'ai toujours pensé très naïvement que la pensée de la présence en tant que présence allait pour ainsi dire de soi, or il n'en est rien, il en est moins que rien : déjà perdue de vue dès Platon, et malgré les efforts de Plotin, la présence est devenue, aujourd'hui, l'affaire des poètes et des artistes, et encore, je dis bien l'affaire, ce qui nous éloigne beaucoup du concept, ou de cette " puissance " de l'intellect. En fait, la poésie et l'art en général oscillent entre la jouissance sensible du présent dans la manipulation de ses formes finies, et la claire volonté de mettre en scène le concept lui-même, comme le fait par exemple Yves Bonnefoy. Mais il demeure évident pour nous que même la mise en scène du concept est suspecte, car le concept est une pure performance de l'intellect et n'a pas besoin de décors. Il n'y a pas ici quelque iconoclastie cachée ou quelque morale anti-artistique. Il y a seulement la distinction entre la force libératoire du concept, et celle forcément moindre de la représentation du concept, car un concept se suffit à lui-même et n'a nul besoin de représentation. L'idée même d'une représentation d'un concept est un comble de la contradiction sauf à réduire cette représentation (cette scène) à l'espace logique du concept, son topos dans la dialectique des significations, dialectique dont procède le sens. Le concept (de présence) lui-même est un produit dialectique qui a son origine dans le combat entre le corps et l'esprit, entre l'esprit et l'esprit, voir toute l'introduction du chapitre sur la Liberté de l'Ethique de Spinoza. Mais attention, pas de malentendus, produit dialectique signifie bien produit anamnétique : la présence en tant que présence est le don initial de l'humain, ou l'étonnement primitif (la certitude sensible) qui ouvre, dans les bonnes ontogenèses et phylogenèses, le procès de la conceptualité elle-même. Platon simplifie en faisant de la cognition une action mnésique, une remémoration d'un su pour ainsi dire génétique, une connaissance innée. Pour notre part, nous nous contenterons de parler de la lutte individuelle que chacun mène ou abandonne sur la base de sa constellation personnelle, de ses rapports initiaux avec autrui et de la " puissance " de son " intellect ". Etant entendu que cette lutte commence avec l'étonnement du don de la présence tel qu'il s'effectue dans chaque destin.
Renouvier accepte encore l'idée de la présence en tant que présence comme rapport au monde. Ce rapport est le bain dans lequel s'affrontent et se relient les phénomènes libérés par les personnes, leurs représentations intellectuelles. Hamelin n'accepte pas un tel fond de tableau, le rapport est immédiat et continu mais cette immédiateté et cette continuité n'est possible que sur fond d'enveloppement divin. Je m'explique : chaque personne est libre de ses phénomènes puisqu'elle est une monade autonome, libre de la construction de son monde phénoménal. Mais cette liberté se règle elle-même sur une monade " absolue et infinie ", et bien entendu parfaite et toute-puissante, et aussi parfaitement libre, celle de Dieu. J'ajoute que je ne peux me rapporter à d'autres monades que sur fond de ce paradigme qui nous rappelle le Ciel des Idées de Platon. C'est à mon tour de demander ce que devient la liberté pour une monade soumise d'office à une monade paradigmatique et transcendante. La monadologie se perd elle-même dans ce retour brutal à la garantie cartésienne de la connaissance : c'est pourquoi le rationalisme échoue à gérer le problème que soulève une pédagogie qui doit reposer sur ses deux jambes : la singularité et le rapport à autrui. Tout l'humanisme repose sur le caractère sacré de la singularité humaine et de l'impératif qui doit régler ses rapports avec autrui. Ces deux réquisits sont originairement contradictoires puisque le premier est naturel et le second historique au sens de la manipulation technique de l'option pour la Cité ou la société. Sauf à répéter indéfiniment, selon une méthode Coué désormais universelle, que l'homme est un animal social, il faut bien prendre conscience du fait que la première science humaine est la politique, celle qui parvient précisément à respecter la nature singulière de l'individu, sa personne. Et c'est là-dessus que viennent butter toutes les représentations contradictoires du point sensible du personnalisme, à savoir le cadre du rapport entre les personnes. Je dois interrompre impérativement mes spéculations pour aujourd'hui, mais je vous promets de reprendre cette question là où je la laisse, bien conscient du caractère abscons de certaines formulations, alors que je me suis fais la promesse de devenir et de demeurer le plus intelligible possible pour tous.
15 Aristote, Métaphysique, Alpha 3, 28-29, Tricot, Vrin 1974
Mercredi 2 juillet 2003
Un brin de Spinoza.
Je vous propose donc de revenir sur la formulation fondamentale de Spinoza définissant Dieu, car cette proposition contient en germe à peu près tout le système si mal nommé panthéisme, ou si mal compris, car panthéisme se réfèrerait davantage à la notion de la divinité du tout qu'à celle d'un tout-Dieu, nuance qui est à méditer. Elle nous dirait, cette nuance, que c'est la notion du panta, du tout qui, en tant que tel mérite la fonction logique de divin au sens de l'arkè, origine explicative du mystère de l'étant : autrement dit, le caractère divin attaché à la notion du tout est l'éclaircie elle-même de l'étant : sans tout pas d'étant, sans tout aucune notion, aucun concept, aucune logique ontologique. Or ce tout se présente lui-même de multiple manières : il est le tout de l'être comme présent indubitable, celui qui fait dire à Parménide que le non-être est impensable, il est le tout de la totalité comme ensemble de parties, mais aussi et surtout le tout de la dialectique, c'est à dire de la relation qu'entretiennent les deux étants qui semblent s'opposer par la différence qui les caractérisent dans leur rapport aux sensations. Le corps et l'âme, l'étant immanental16 et l'étant transcendantal, forment ensemble le tout de la possibilité du vrai, ou du moins le tout de la cause de la possibilité de la question de l'être.
Il faut revenir un instant sur la notion de substance, concept s'il en est propre à décourager tout lecteur débutant de Spinoza. La confusion entre substance et matière provient de la vision réaliste d'Aristote, pour qui aucune matière n'existe sans forme et inversement, aucune forme ne peut être sans matière. Or nous avions dit hier que la substance était une forme logique des rapports ontologiques : la sub-stantia se tient en-dessous, elle est l'être qui rassemble en pivot ou en racine (ou encore en principe) l'objet, l'étant, le monde. Ce qu'elle rassemble dans l'ordre transcendantal, car la vision de ce rassemblement est essentiellement intellective, ce sont les attributs de l'objet, de l'étant, du monde. Elle est formatrice du tout dont nous venons de tracer le caractère nodal dans toute transaction spéculative. D'où le pas facile à franchir entre cette fonction de la connaissance et le principe absolu, l'arkè comme cause " de soi " comme le dit Spinoza. La première partie de l'Ethique de Spinoza contient une curiosité que quelques-uns ont sans doute déjà relevée, c'est la relégation en sixième rang ou position, de la définition de Dieu, la première portant précisément sur la " cause de soi ". Ce qui indiquerait pour le moins qu'il n'est pas possible logiquement de parler de Dieu AVANT d'en avoir défini l'essence indépendamment de sa notion propre, à savoir 1) ce dont l'essence enveloppe l'existence, 2) ce dont la nature ne peut se concevoir qu'existante. La causa sui, ce dont la provenance se situe en soi est compris par moi (j'entends) logiquement comme ce dont l'essence enveloppe l'existence. Envelopper ? Oui, bon, formellement l'essence est topographiquement toujours au centre, ou en-dessous (substance) de ses attributs, mais elle peut aussi, en un seul cas, se présenter comme enveloppant la chose, en l'occurrence l'existence. Il est ici question de l'Être, c'est à dire ce que nous désignons provisoirement (car pris dans l'histoire des concepts) comme présence ou présent en tant que présent. Question : quelle est la primauté logique de cette question de la cause de soi ? On distingue bien une racine historique ou philologique dans le concept grec de physis, précisément conçue comme par essence cause d'elle-même, par opposition à ce qui a sa cause en-dehors de soi c'est à dire les choses de la teknè, faites de main d'homme. Il faut donc chercher dans le mouvement des six propositions concernant Dieu, car le titre enveloppe à sa manière le tout des définitions, Dieu se retrouvant en chacune d'elles. Mais le dessein de Spinoza est visiblement de prendre un point de départ éloigné de la notion même de Dieu, tellement éloigné qu'il se présente plutôt comme l'origine du questionnement qui y conduit : autrement dit, la nature présente en tant que se manifestant d'elle ou par elle-même ouvre l'ordre des questions ou des réponses préalablement préparées. Et, articulation essentielle pour la compréhension de la primauté de cette définition : cette présence de la physis est incontestable : " elle ne peut se concevoir qu'existante ". Parménide. Au-dessus de toute philosophie, de toute théorie de la vérité, de toute vision particulière du monde, il y a d'abord monde, étant voulu ou non voulu, paysage fondateur et fondement incontournable et impossible à nier. Athènes est Athènes pour tout le monde, comme la Grèce et ce qui l'entoure, comme la maison et le temple, comme le champ et les arbres. Après cette auto-certification de l'Être, on peut raconter tout ce qu'on veut et même aller jusqu'à dire que tout cela n'est qu'illusion. Mais cela est là et rien ne pourra le faire bouger. C'est bien pourquoi, je pense, Descartes a cru malin d'intégrer la perception et donc les sensations dans la pensée elle-même, l'intellection n'est pas étrangère, ne peut pas rester en marge de l'aperception générale du monde quelles que soient les garanties mathématiques qu'elle offre contre la confusion des sens. D'où l'accusation portée contre lui de réalisme, disons tout net matérialisme théologique.
Enfin, cette physis est étroitement liée, en tant qu'existante, à la forme, à la morphè. Or la forme est exactement ce qui enveloppe comme un gant enveloppe une main : elle est la réplique conceptuelle de la substance, car la forme est déjà aussi une relation logique ou analytique de l'être de l'étant. Forme / matière, première dualité - fonction de l'analyse au même titre que le tout dont on évite soigneusement de citer le mot dont la notion doit pour ainsi dire naître d'elle-même du raisonnement développant des six définitions de Dieu. En fait, les définitions ne parlent de rien d'autre que des fonctions logiques de l'intellect, c'est à dire elles donnent les véritables limites, la finitude en soi, de toute représentation, elles préparent le terrain de ce que l'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire, tout en gardant prudemment le ton et le style propre à la présentation de l'opinion.
Le deuxième degré de l'interrogation porte sur la notion de fini dont il faut rendre compte avant d'en venir à l'essence infinie de Dieu. La définition commence par l'expression " Est dite finie ", ce qui n'engage que celui ou ceux qui le disent, rappelons-nous toujours ce foyer du raisonnement spinozien, qui n'a rien du tout d'une affirmation axiomatique ou, comme j'ai dit plus haut véritative. Spinoza n'a aucune prétention à la vérité, il rapporte ce qui se dit ou bien la manière dont il " entends " les choses. De même il rend responsable de cette opinion sur le fini le fait que " nous concevons toujours ", habitude de pensée propre aux hommes, en aucune manière vérité infuse ou même logique. D'où on peut déjà inférer que le Dieu qui va apparaître dans la définition VI est le Dieu de Spinoza, le dieu qui correspond à la puissance intellectuelle du philosophe néerlandais. Il ajoute cependant une remarque qui demande explication. Il dit qu'un corps ne peut pas être borné par une pensée, de même qu'une pensée ne peut trouver de limite dans un corps. Cela indique un choix qui semble aller de soi, et pourtant il n'en est rien : est-ce-qu'un corps soumis à la torture ne peut pas déformer l'esprit de celui qui souffre, lui infliger en quelque sorte des limites ? Et inversement, un esprit égaré par une drogue peut mettre le corps dans des frontières critiques, non ? C'est qu'il n'est pas question, en réalité, de psychologie, mais de relation à l'Être. Nous retrouvons ici l'autre principe parménidien : être et penser sont le même. Même sous la torture et sans doute encore davantage sous la torture, la pensée grandit elle-même en tant que pensée, c'est à dire en tant que saisie de la présence. Le poème de Boèce peint cette souffrance qui durcit le réel en exacerbant sa saisie en tant que réel. On pense aussi au cénobitisme et aux tortures que s'infligent les mystiques. Ce masochisme, au demeurant, agit lui-même comme une drogue dont l'usage prescrit par les Eglises explique largement la soumission " folklorique " à toute l'imagerie névrotique de la Révélation mise en scène par les Pères de l'Eglise. Cela nous conduit logiquement à la substance, c'est à dire au sujet propre à la pensée.
La substance se passe en fait de la pensée, au sens où elle s'impose d'elle-même sans une instrumentation conceptuelle. Elle est ce qui EST en soi, et se conçoit par soi : identification de l'être et de la pensée. Voilà qui fait table rase de toutes les interprétations antérieures de l'Être ou de la substance, qu'elles s'appuient sur des éléments comme l'eau, le feu etc… ou sur des Idées ou paradigmes. Lorsque les pré-socratiques déterminent la substance comme eau, feu ou terre, ils sont contraints de se servir d'autres concepts comme la fluidité, la chaleur, le mouvement ou la force etc … pour la rendre concevable. De même pour la réalité idéelle de Platon qui a besoin pour la fonder de concevoir une dualité forme / matière, essence et attributs, dualité de monde etc... La substance de Spinoza est absolument extérieure à toute conceptualisation, elle est son propre concept, étant la pensée elle-même. La grande illumination parménidienne réadaptée par Spinoza au langage et aux préoccupations de son époque nous délivre un message inouï et qui est une véritable délivrance : ces deux hommes nous disent seulement ceci : nous les hommes avons un accès direct à l'être, nous sommes de l'être par le simple fait de la conscience. La théologie vient de passer des siècles à tenter d'obscurcir cet accès qui fait qu'être et penser (pour l'homme) sont un, et de plus l'homme qui a voulu briser cette chape de plomb, Descartes, en parvenant même à formuler son cogito qui, si on le lit bien, ne fait que répéter le mot de Parménide cogito, sum / je pense, je suis, cet homme finit par trahir la simplicité retrouvée pour retomber dans une inféodation théologique orthodoxe. Spinoza écrit essentiellement contre son propre enthousiasme pour Descartes.
16 néologisme personnel qui répond à la forme implicite de son opposé. Transcendantal signifiant de l'ordre du transcendant, immanental veut donc de même indiquer un ordre du vécu ou de l'expérience ayant affaire à l'immanence corporelle. Bien entendu, cette dichotomie ne tient pas la route une seconde, on travaille cependant là-dessus depuis des millénaires et il faut bien en passer par là si on veut en sortir.
Vendredi 4 juillet 2003
Irakgate or not Irakgate ?
Allons-nous vers un Irakgate ? L'Amérique a-t-elle encore les ressources morales nécessaires pour rendre son honneur à une administration livrée au caprice d'un cow-boy qui ne collectionne que les mauvais côtés de celui qui fut " empêché " à la suite du Watergate ? Les médias US donnent en tout cas l'impression d'hésiter à lancer l'opération d'envergure qui avait mis fin au règne de Nixon. Cette nuit j'ai entendu Larry King interroger un journaliste vedette de ABC News, et quand Larry sort de son trou c'est que la machine s'est mise en marche. Je dois reconnaître que c'est une solution à laquelle je n'avais même pas osé penser, tant les scandales Enron et Co m'avaient donné une image plutôt misérable de ce grand pays. Et pourtant quel soulagement pour le monde ! si…
En fait ce qui se passe en Irak correspond si peu aux prévisions de la grande machine politique de Bush que l'opinion commence sérieusement à s'émouvoir de la possibilité d'un nouveau Vietnam, traumatisme dont on est pas encore sorti outre-Atlantique, ce qui en soi est un très bon signe. Je me souviens d'une autre guerre qui avait aussi commencé fraîche et joyeuse. De toute manière, le jugement de toute l'opération se fera sur la capacité des " coalisés " de remplacer celui qu'ils ont si facilement chassé. Pour l'instant tout cela paraît plutôt mal parti et chaque minute de perdue reconstitue dans l'imaginaire des Irakiens, les traits de leur tyran. Tous les experts que j'ai entendus jusqu'à présent sont unanimes, tant que Saddam ne sera pas mort ou sous les verrous, la guerre sera loin d'être réellement terminée. Les occidentaux ont oublié la véritable essence de la souveraineté, celle qui faisait les Thémistocles, les Tibère et autres Néron. Combien de fois les Grecs ont-ils fait revenir parmi eux en triomphe ceux qu'ils avaient chassé comme des animaux ? La personne est indestructible tant qu'elle n'est ni jugée ni éliminée physiquement et les Américains devraient bien y réfléchir. On oublie d'ailleurs que certains experts avaient tenté, avant l'opération militaire, de convaincre Saddam de démissionner quitte à lui donner un havre sûr pour le reste de ses jours. S'il a refusé cette proposition c'est qu'il avait ses raisons et le courage pour les rendre concrètes.
Cela dit, le tableau mondial est de plus en plus sombre en ce qui concerne la moralité des chefs d'état. Il y a comme un pourrissement général qui depuis hier a atteint l'Europe. De la Maison Blanche à Toulouse, en passant par Rome et Paris, on a l'impression d'entrer dans un nouveau monde, celui que nous promettait Hobbes : homo lupus hominem.
Samedi 5 juillet 2003
Le devoir de mémoire.
L'exercice de mémoire est un devoir. Je ne sais plus qui a dit ça, mais à regarder en arrière dans notre histoire la plus récente, cela va de soi. Il m'arrive d'être réellement angoissé voire effrayé par les trous de culture que décèle telle remarque en passant chez des jeunes et des moins jeunes. Hier soir, j'ai été d'une certaine manière piégé dans un dialogue sur une radio qui se dit libre et qui opère sur le réseau Internet. Je n'accuse pas l'animateur d'avoir voulu me piéger délibérément, mais nous avons longuement conversé au téléphone et j'ignorais à ce moment-là que toute notre conversation passait sur le réseau Internet. Ne connaissant pas la procédure de ce site, c'est sans doute de ma faute. Bref j'en parle parce qu' en donnant mon pseudo, Parménide, j'ai dû me rendre compte qu'aucune des personnes qui participaient à ce forum radiophonique ne connaissait cet homme. Heidegger parle d'oubli de l'Être, mais de quel oubli faut-il parler ici ? Je suis à peu près persuadé que tout le monde, sans exception, connaît le dénommé Jésus-Christ, dont on n'est même pas sûr qu'il ait existé, sans parler de tous les personnages mythiques qui l'auraient entouré il y a de cela environ deux mille ans. Mais Parménide est un personnage de notre histoire occidentale spirituelle au même titre que Platon ou Descartes, on connaît même à peu près le lieu et les dates qui délimitent son existence, sans parler de l'influence immense qu'il a eu sur tout ce qui se pense depuis son époque.
Mais ce n'est pas pour cela que j'ai évoqué le devoir de mémoire, pour moi la mémoire c'est une sorte d'exercice quotidien, comme ma gymnastique personnelle, et aujourd'hui je me suis posé une question simple : à quoi me suis-je opposé en premier dans ma vie, au point que cette opposition joue encore aujourd'hui un rôle essentiel dans tout ce que je fais et pense ? Cette question de l'opposition est par soi-même la question de la formation, parce que je pense que l'on se forme d'abord par ce à quoi on s'oppose et non pas par rapport à ce qu'on vous oblige à imiter ou à apprendre de mémoire. La réponse est simple : c'est la religion qui provoqua chez moi le premier malaise, dans ma toute petite enfance, alors que le prêtre nous délivrait sa catéchèse, nous racontait ses fables sur l'origine du monde, de la chute originelle et de la rédemption. Ce qui m'avait frappé alors que je n'avais qu'une demi-douzaine d'année, c'était la consistance irréaliste du récit de la révélation. Je me souviens même être intervenu très vigoureusement sur la question précise de savoir d'où provenait ce texte nommé Bible, ou encore ces Tables de la Loi du Mont Sinaï, et que j'ai maintenu envers et contre la colère de l'abbé que tout cela ne tenait pas debout. J'avais encore une sorte d'instinct immédiat d'autodéfense contre les fables et les représentations qui ne correspondaient en rien à mon expérience de tous les jours, à mon être-là dans un monde concret et rationnel. Le plus paradoxal dans tout cela, est que je me suis quand même fait avoir in fine, au point d'arriver vers treize ans à ma Grande Communion dans un état quasi mystique. Il s'était produit un trou, un oubli que j'attribue aujourd'hui à une douloureuse expérience de culpabilité imposée, qui a fait déraper le bon sens naturel dont j'avais fait preuve alors que j'atteignais à peine l'âge de raison. Par bonheur, l'on m'envoya alors dans un collège de Jésuites où je retrouvai d'un coup toute l'atmosphère délétère de mensonge et la contradiction de fait entre un récit merveilleux et une pratique sordide dont j'ai assez parlé ailleurs. Mon mysticisme se perdit alors rapidement corps et biens et je retrouvai mon scepticisme qui me valut pratiquement instantanément l'ostracisme c'est à dire le renvoi immédiat de l'établissement en question.
C'est donc à partir de mon opposition à la religion que j'ai formé ma personne ou ma personnalité, car mon scepticisme d'enfant s'était entre-temps transformé en ce qu'on appelle l'athéisme. Il faut croire que ma culture, mes lectures et mes discussions avec mes camarades était déjà assez étoffées pour me donner assez de force pour résister à la pente de l'instinct eschatologique, ce besoin de s'inventer un salut, salut qui commence par un but dans l'existence. Et dieu sait si cet athéisme a bien correspondu à une véritable perte de repère quant à tout projet d'avenir. En perdant la foi, j'avais perdu toute place possible dans les desseins de la société qui m'entourait. A la nouvelle croyance d'un monde sans dieu correspondait un monde sans avenir pour moi, sans logique et sans substance. Cela peut se comprendre assez facilement, car en Alsace, la religion enveloppe pour ainsi dire les destins individuels de manière totalitaire. Elle s'insinue dans tous les aspects de la vie, la pédagogie, la vie familiale et professionnelle, bref toutes les valeurs de l'existence normales sont affectées par ce facteur théologique. Alors on peut comprendre que la perte de cette confiance implique de facto, un exil intra muros, une déréliction qui affecte tous les domaines par lesquels et sur lesquels j'étais censé construire ma vie. Il ne me restait plus qu'à programmer mon départ vers une errance sans but, qui sera longue et qui résistera à toutes les installations dans tout ce qui, de près ou de loin, est inscrit idéologiquement dans et à partir de la religion.
Il en sera ainsi notamment pour ce qui concerne la guerre, déclarée possiblement juste par St Thomas, alors que l'article du décalogue est formel : Tu ne tueras point. La casuistique ou le jésuitisme c'est très exactement cela : le compromis entre l'impératif divin, la Loi avec un grand L, et les exigences de la réalité politique et sociale. Aujourd'hui j'éprouve un plaisir sans bornes à relire les Provinciales de Pascal où le penseur un peu fou mais si attachant, se moque de ces jésuiteries qui finissent par donner l'absolution aux crimes les plus inconcevables. J'ai donc aussi refusé la guerre, non pas à cause de l'existence de Dieu, mais parce que cet impératif du décalogue me paraissait rationnel et que l'idée de tuer blessait ma sensibilité naturelle. Je pense d'ailleurs que l'initiation religieuse n'était pour rien dans mon sens de respect pour la vie, car se respect allait beaucoup plus loin que le simple tabou du meurtre, je réprouvais déjà avec toute la force possible les jeux sadiques que mes compagnons pouvaient inventer pour faire souffrir les animaux. J'étais jahiniste ou écologiste avant la lettre. Mais ça c'est vraiment personnel, quoiqu'il me paraisse évident que le phénomène de la vie possède une telle unité qu'il ne saurait laisser la moralité qui le concerne se fragmenter en secteurs particuliers. Ce sentiment semble aujourd'hui grandir dans nos sociétés et il ne s'agit là nullement d'un romantisme passager, mais plutôt d'une prise de conscience de cette unité de la vie au moment où elle se trouve menacée de toute part.
Mais ce n'est pas tout. Le déclin des pratiques religieuses à partir de la dernière guerre avait fini par me faire baisser ma garde par rapport à ce phénomène que l'on pouvait croire obsolescent et condamné à terme. Or la réalité est aujourd'hui toute différente, dangereusement différente. Nous avons d'un côté une religion dont certains sectataires se sont lancés dans une véritable conquête du monde au prix de la terreur. Je parle évidemment des groupes de musulmans qui tentent de replonger le monde dans l'horreur des guerres de religion, pire, de la guerre Sainte mondiale qui prétend soumettre l'univers aux fantasmes d'un illuminé du septième siècle. Ce phénomène n'a pas manqué de favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui le retour du religieux dans nos propres contrées que l'on pensait délivrées de cette emprise dont peu de gens ont assez de culture pour évaluer l'importance qu'elle détenait il y a encore un demi-siècle. Il suffirait pourtant de regarder un film comme " Le Journal d'un Curé de Campagne ", qui retrace l'intrigue d'un roman de Bernanos, pour bien s'imprégner de l'ambiance que faisait régner la religion dans la France profonde d'il y a encore à peine cinq décennies. Ambiance que nous avons encore connue ici en Alsace bien plus longtemps qu'ailleurs grâce à ce statut spécifique du Concordat qui donne d'immenses pouvoirs culturels aux églises de tout bord, y compris bientôt l'Islam puisque les statistiques vont avérer sous peu qu'il y a plus de fidèles musulmans pratiquants que de pratiquants de toutes les religions chrétiennes et israélites réunies. Bref, malgré mon mauvais départ dans l'existence lié à mon refus de croire aux fantômes, j'avais réussi à m'y glisser et même y prendre une place normale lorsque en 1981 la gauche vint conforter en apparence la laïcisation de notre histoire. J'ai néanmoins compris immédiatement l'importance décisive de l'échec de 1984, lorsque l'Eglise réussit à mettre un million de manifestants dans les rues de Paris pour s'opposer à la réforme scolaire qui devait mettre un terme aux privilèges de l'école confessionnelle, et que Mitterrand recula. Ce recul fut sa plus grande erreur politique et il n'est pas sûr que son seul grand succès que fut l'Europe se relève de cette erreur-là, car aujourd'hui le religieux prétend avec insolence se mêler de l'avenir constitutionnel de notre continent, avec l'appui évident de tous les gouvernements guelfes comme l'Espagne, l'Italie ou la Pologne.
Il faudra donc que la religion, cette ivrognerie spirituelle, me pourrisse la vie jusqu'au bout. Ceux qui n'accordent aucune ou peu d'importance à ces dispositions formelles ou symboliques que l'on pourrait introduire dans la future constitution européenne se trompent lourdement. Si Dieu et ses fables devaient être associés à la sémantique de nos textes fondateurs, le sabre n'attendrait pas longtemps pour se mettre au service du goupillon, que ce soit dans la guerre déclarée au terrorisme ou dans toutes les violences sociales à venir. On a pu voir en Amérique latine comment l'Eglise s'est mise au service du pouvoir temporel pour conforter sa position dominante dans les consciences tout en légitimant la violence de ce même pouvoir temporel. Le Vatican n'a fait qu'une bouchée des quelques ecclésiastiques égarés qui avaient opté pour la défense des pauvres et des opprimés, au besoin en les laissant se faire assassiner par leurs commensaux comme Mgr Romero, archevêque de San Salvador.
|

|
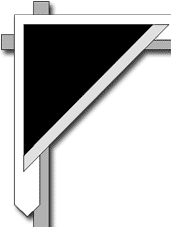




![]()