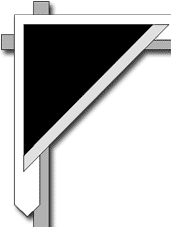
|

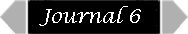
Jeudi 22 novembre 2002
Le temps a cessé de couler à la manière d'un fleuve ancien. Les méandres du destin flottent comme des cadavres vers les cataractes de béton. Les flux désormais rugissent. Les tensions entrent en manifestation à une échelle nouvelle, partout. Partout la force quotidiennement latente s'exhibe, l'histoire est passée dans sa salle de musculation. Dans mon for intérieur d'archaïques pulsations reviennent vibrer la peur diffuse de tout, le crissement de dents des évolutions incontrôlées dans l'espace et des progressions militaires.
Lundi dernier j'ai condensé en une allocution semi-publique toute une théorie du monde actuel dont ce que je viens d'écrire n'est qu'un reflet. J'ai osé même axiomatiser ce réel bordélique et menaçant pour lui rendre un sens qui à l'évidence échappe à tout le monde. Que n'ais-je fait ! D'abord mon auditoire est resté coi, comme sonné, puis ce fut une sorte d'hallali qui ne m'a laissé qu'une tristesse qui a bien du mal à se dissiper. Mais, lisez d'abord, je vous ai fait une photocopie de mon discours qui porte ce titre :
MONDIALISATION ET PROJET OCCIDENTAL
Mesdames, Messieurs,
Vouloir penser son présent expose à un danger majeur, celui de penser dans l'aveuglement de l'idéologie dominante. Curieusement, Martin Heidegger et Louis Althusser se servent tous les deux d'une même expression pour désigner ce qu'il convient de faire dans une telle situation. Ils disent qu'il faut " faire un pas en arrière ". Marx aurait ainsi échappé à l'Idéologie Allemande en partant contempler la politique en France et l'économie en Angleterre. Quant à Heidegger, il aurait évité le danger de la théologie qui se dissimule derrière toute métaphysique en se démarquant de la philosophie de la Raison et du concept.
Avant de prétendre penser le présent, c'est à dire ce qui se présente sous la vignette de la mondialisation, je vous propose donc de suspendre pour quelques instants la pensée, de faire un pas en arrière et de contempler le tableau que l'histoire réelle nous offre, indépendamment de ce que l'on peut ou non en penser. N'ayons pas la prétention de réussir dans l'absolu car il n'existe malheureusement pas de regard scientifique, c'est à dire de regard capable de distinguer l'homme et ses actes comme un objet. Je vous offre donc un tableau en trois points de vue :
- l'idéologie dominante
- la réalité économico-politique
- le futur disponible, un concept que nous retrouverons plus loin.
I. L'IDEOLOGIE DOMINANTE.
On pourrait dire ceci : en parlant du Style dans la littérature, Guy Debord disait que l'époque moderne se distingue par le style de l'absence de style. On peut dire la même chose de l'idéologie la plus courante, notre idéologie est une idéologie de l'absence d'idéologie. La fameuse idée de la fin de l'histoire procède exactement de cette idéologie-là, dont nous ne saurions être dupes d'aucune manière, parce qu'il existe encore des hommes qui rêvent les yeux ouverts.
Cela dit, il faut quand même affiner le constat général, car il subsiste des lambeaux des anciennes idéologies qui pèsent encore très lourd et de nouveaux vêtements qui prennent la relève. J'en distingue trois :
-
L'existence d'une foi diffuse dans le principe démocratique occidental. Le caractère diffus de cette foi réside :
- dans l'imprécision du concept qui permet de multiples interprétations : la démocratie européenne, la démocratie américaine, la démocratie directe ou indirecte, pure et impure etc…
- dans l'usage politique qui en est fait. On a fait beaucoup de guerres au nom de le démocratie (entre autre le Vietnam et l'Irak), et puis on a mis cette belle démocratie à la disposition des nouvelles formes de fascisme qui naissent ici et là. Or il s'agit là d'une contradictio in terminis, une contradiction dans les termes inadmissible pour tout démocrate.
- Le retour en force du religieux dans la sphère idéologique. Comme si, conscientes du Trou Noir que constitue notre idéologie de l'absence d'idéologie, les religions trouvaient là une occasion unique de reprendre les rênes de la conscience mondiale.
- La publicité, qui est devenue la première force idéologique parce qu'elle conjugue le sens avec la marchandise (même Marx n'avait pas pensé à ça). Il faut être conscient que la publicité planifie et dessine à longueur de journée l'image du monde dont le marché a besoin. Loin de ne chercher qu'à faire vendre des objets particuliers, la publicité formate nos besoins et nos désirs en prenant soin de gommer nos angoisses. La publicité est devenue une nouvelle forme de religion.
Voilà pour l'idéologie. Mais il faut ajouter un détail essentiel : si les utopies collectives sont mortes, comme les religions devraient l'être, l'utopie a trouvé refuge dans l'individu qui est né du processus capitaliste. Chacun de nous fantasme à sa manière son combat contre le Mal et son propre salut, c'est à dire la disponibilité qu'il a de son futur. Dans ces circonstances, pas si neuves que cela, il arrive toujours un moment où le conditionnement sociétal, c'est à dire l'idéologie dominante, craque, et où ces fantasmes individuels se coagulent en action de masse révolutionnaire. Je n'invente rien, ce sont les faits de notre propre histoire.
II. LA REALITE ECONOMIQUE POLITIQUE
Deux domaines seront examinés :
-
La souveraineté
-
La jouissance du présent
-
La souveraineté.
Peu de choses à dire à ce sujet que vous ne sachiez déjà : la souveraineté n'est plus l'enjeu démocratique des peuples. Elle se tient déjà toute entière dans la rivalité qui opposent les grandes puissances économiques et financières. Ces puissances se débarrasseront du modèle démocratique dès que les dernières digues historiques seront rompues, c'est à dire dès que l'Europe aura cessé totalement de résister au modèle libéral.
-
La jouissance du présent.
Le triomphe de l'économie a opéré une transmutation de notre vécu du présent. Il en a fait un souci portant exclusivement sur la disponibilité de futur. Le salarié, condition universelle de l'humanité programmée par le capitalisme, ne vit plus que dans la question du combien : combien m'est encore accordé d'une part de temps de travail, ou bien de temps de non-travail rémunéré, loisir, retraite etc…Selon le rythme et à la vitesse à laquelle ces forces économiques vont s'emparer de la totalité des prérogatives de l'état, il s'ajoutera à ce constat classique, le supplément de la précarité appelée à devenir universelle. De même que le capital n'a pu naître que sur les cadavres des paysans, le capitalisme ne franchira sa prochaine étape qu'au prix de cette précarisation totale du marché du travail. Nous régressons donc vers un nomadisme qui n'a jamais existé mais qui a été prophétisé par le célèbre Homo lupus hominem de Hobbes, modèle d'Adam Smith. Le capitalisme planifie sous nos yeux un monde où le salarié sera un nomade seul contre tous car ni l'espace ni le temps ne lui sera plus garanti. Il faut bien saisir ce que cela signifie : si le souci porte en permanence sur le futur disponible, alors il n'y a plus de présent, et si le présent disparaît, il ne se forme plus de passé dans la mémoire humaine, le passé disparaît corps et biens, ce que l'on peut constater dans l'appauvrissement dramatique de la culture. Pour finir un exemple du souci sur le temps : la réforme des retraites se fera aux frais exclusifs du salarié, à ses risques et périls et dans une conjoncture mondiale de l'employabilité où le pouvoir d'achat et donc d'épargne est à la baisse indéfinie. La main-mise des Entreprises sur les salariés deviendra en tous points comparable à l'esclavage : écoutez ce qu'écrivait Marx dans la première mouture du Capital : " Si l'économie politique se dilate en une énergie cosmopolite universelle, qui renverse toute barrière et tout bien pour se poser elle-même en lieu et place comme la seule politique, la seule universalité, la seule barrière, le seul bien, elle rejettera nécessairement au cours de sa dilatation son hypocrisie et apparaîtra dans tout son cynisme ". J'entends, pour ma part, un certain monsieur Sarkozy qui ricane.
III. LE FUTUR DISPONIBLE.
Après ce que je viens de développer je peux être bref : ce futur ne peut être que de deux sortes :
-
Celui que nous venons de décrire. Ne nous voilons pas la face, les Américains vivent déjà ainsi avec le privilège de le faire aux frais du reste du monde, mais cela non plus ne durera pas.
-
Révolutionnaire. Mais n'oublions jamais que toute révolution est à double face, l'une peut consister dans la régression définitive à l'état sauvage, sans doute le premier état sauvage connu par l'homme. Nous avons vu cela avec le Stalinisme. L'autre peut servir de tremplin à une dissolution démocratique du sociétal et de la dépendance réciproque qu'implique le sociétal
Il est certain que beaucoup d'entre-vous vont penser que je force le trait en passant sous silence les acquis de l'histoire. Pour ma part je pense et je vis le contraire, et si le temps ne m'était pas compté j'aurais pu mieux illustrer mon constat. Nous en arrivons donc à présent à la deuxième partie de ce discours, en quelque sorte la réponse aux questions qui se bousculent à l'issue de ce constat.
Je cherchais une transition pour amener cette suite quand je vois le visage en gros plan de Max Gallo surgir sur l'écran de ma télévision. Il vient de faire son coming-out de converti à la foi catholique dont il fait désormais le vecteur de Sa recherche du sens. Quoiqu'il en soit, la quête du sens ne peut pas ne pas avoir une place essentielle dans ce que j'ai appelé en titre le Projet Occidental. Pour tenter de vous montrer de quelle manière tout cela se relie, je procéderai désormais More Geometrico, c'est à dire à la manière géométrique de Spinoza. Sur la base d'axiomes et de propositions, nous dégagerons des commentaires, des corollaires et des conclusions.
AXIOME I
La conscience, c'est à dire cette différence simple entre notre esprit et le monde, est propre à l'homme aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps. Et en tout temps cette conscience est restée identique à elle-même.
Commentaire.
La conceptualité n'a en rien changé la nature de la différence entre nous et le monde et à la question qu'elle suscite. Elle n'a fait que fournir des réponses imaginaires, affectives et émotionnelles au mystère de cette différence. Les idéologies sont les systèmes sociaux d'explication qui s'appuient sur la faiblesse constitutive de toute association humaine.
Dans Etre et Temps, Martin Heidegger exprime cette idée de manière très concise, en voici la traduction personnelle simplifiée
" L'essence du fait d'exister est de s'interroger sur la différence ".
Autrement dit : exister veut dire poser la question du sens de l'existence, et quoi qu'on fasse ou qu'on pense, cette fonction de compréhension demeure directrice dans la vie quotidienne.
Conclusion
La conscience n'est pas une faculté passive, elle est pensée et donc action, c'est à dire volonté.
Corollaire
La question du sens de l'existence n'a jamais changé de nature. Elle commande toute l'activité psychique et pratique de l'être humain, et donc aussi sa volonté depuis le commencement de l'histoire.
AXIOME II
L'Histoire, et donc le présent, sont le produit de la volonté humaine dans sa relation avec la nature extérieure et sa nature intérieure.
Corollaire
L'objet principal de la volonté étant la question du sens de sa relation avec le monde, l'histoire devient la scène principale de l'élaboration de cette question.
Commentaire
On pourrait confondre cet axiome avec la pensée de Hegel, mais elle en est l'exact contraire. Hegel a fait de l'histoire la substance de la conscience de soi qui s'aliène dans la nature pour retourner dans le Soi qui n'est autre que Dieu, tandis que nous faisons de la conscience la substance de l'histoire, sa cause active qui ne contient aucune fin en elle-même sinon de s'expliquer avec l'étant, le monde. Il n'y a ni divorce, ni aliénation productive, seulement une question de l'Être qui nous est commune à tous et cette communauté est la seule qui exige moralement l'égalité.
AXIOME III
L'Histoire en tant que science n'est qu'historiographie, c'est à dire constitution d'un Musée des faits, des témoignages et des documents. La seule certitude concernant la manifestation d'une volonté finalisée dans le passé est la fondation de la Cité, c'est à dire le passage de l'état nomade à l'état sédentaire.
Corollaire
En raison des axiomes I et II, cette décision concerne l'élaboration de la question du sens de l'existence.
AXIOME IV
La vie sédentaire implique nécessairement l'inégalité de la répartition des richesses.
Commentaire
Dans le capital, Marx commet à mon sens la même erreur, ou le même passage en force qu'Aristote, en qualifiant la commune primitive de naturelle. Il dit :
" la communauté tribale, la commune naturelle, apparaît non pas comme le résultat, mais comme la cause ou la condition de l'appropriation (provisoire) et de l'utilisation commune du sol ".
Or, à la fin du même chapitre il rappelle ironiquement l'étymologie du mot capital, qui, dit-il appartient exclusivement au monde nomade, car il signifie originairement " bétail ". En fait, Marx fait partout l'impasse sur ce monde nomade auquel il ne fait qu'allusion, ce qui n'est pas le cas d'Engels son ami, qui s'est longuement interrogé sur le néolithique et sur le mystère du passage du nomadisme au sédentarisme, notamment dans un ouvrage extraordinaire qui s'appelle l'Anti-Dühring
En réalité la commune est la première forme d'appropriation privative de l'espace aux dépens des nomades. Par la suite cette appropriation se fera de plus en plus systématiquement aux dépens des membres de la commune elle-même. Marx fait une description impressionnante de l'accaparement des terres par les compradores romains, au dépens des citoyens laboureurs. Nous avons donc ici une preuve que le capital est d'origine et d'essence nomade, il porte en lui la critique du rapt de l'espace par la décision de la sédentarisation, la revanche des barbares, un plat qui se mangera très froid quelques millénaires plus tard.
Corollaire à l'axiome 4
La forme sociale naturelle des sociétés nomades est le communisme.
Commentaire
Les formes tardives du nomadisme comme Gengis Khan, Attila ou Tamerlan, de même que les formes résiduelles actuelles, sont des formes réactives au sédentarisme, c'est pourquoi elle apparaissent toujours sous une forme délictueuse. Voir le projet de Loi Sarkozy. La dérogation au communisme s'explique par l'état de guerre permanente. Voir la longue histoire de la guerre millénaire entre les Mongols et l'Empire de Chine.
AXIOME V
La sédentarisation n'a été rendue définitivement possible que grâce à la découverte de la démocratie
Commentaire
Comme nous le postulons plus haut, la commune, c'est à dire aussi la famille, n'ont rien de naturel a priori, c'est à dire qu'on ne possède aucun argument objectif pour affirmer que l'homme est un être social. La tragédie d'Œdipe montre très bien ce qui est en train de devenir évident aux Grecs, c'est que la famille est fondée sur l'inceste, sur le mensonge et qu'elle est politiquement inutilisable. Deux millénaires plus tard, Sigmund Freud confirmera ce diagnostic. L'affirmation selon laquelle la famille serait naturelle fait partie de la métaphysique du sujet qui s'impose depuis Platon et Aristote, mais elle n'est qu'un postulat aléatoire. Les formes de vie animales et leurs modifications dans le temps sont aussi diverses que la forme des paysages de la planète, et rien ne permet de classer notre espèce dans telle ou telle catégorie. Cela est essentiel pour comprendre notre critique.
L'axiome III avait postulé l'existence d'une volonté des hommes de s'associer à un moment de leur destin. Il fallait donc trouver les moyens objectifs de rendre possible une association qui mettait en relation permanente des nomades dont l'éthique fondamentale était la liberté. Comment sacrifier cette liberté pour arriver à tirer parti de cette association destinée à donner une valeur ajoutée à la recherche sur le sens ? La réponse se situe bien au 5ème siècle AJC en Grèce lorsque le minuscule peuple grec réuni dans une confédération a défait l'immense empire perse. La menace de l'anéantissement de l'Hellade a provoqué une sorte de communisme de guerre dont Clisthène a tiré les éléments structurels qui n'étaient rien d'autre que la démocratie. Les Romains ont ainsi anéanti Carthage par les mêmes moyens. Cela me permet de rappeler que la démocratie est capable de se servir de la dictature quand les circonstances l'exigent, mais une dictature qui demeure démocratique puisque le peuple conserve le droit de rejeter le dictateur, même s'il donne satisfaction dans la guerre comme ce fut le cas pour le fameux Fabius.
Définition
Mais, qu'est-ce-que la démocratie ? Elle n'est pas le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple parce que la notion de peuple n'est pas un concept mais une notion idéologique (selon le commentaire de l'axiome 5). En revanche la République est un concept clair, il définit l'objet de l'association des hommes, à savoir la Chose Publique, ou commune. Cette expression est longuement commentée par Martin Heidegger. Il fait dériver das Ding, la chose, de l'ancien allemand Ring, le cercle, cercle qui n'est autre que le cercle des hommes autour du feu discutant des problèmes communs. En clair, la politique. Mais cela nous indique du même coup que cette discussion porte essentiellement sur la chose et sa choséité, c'est à dire sur la différence que pose la conscience avec le monde.
Se pose alors une question : comment fonctionne la démocratie ? J'ai fait une planche là-dessus et ce n'est pas tant le fonctionnement qui nous pose question, que le pourquoi de son efficacité. La réponse : la République, c'est à dire l'ensemble que représente la Constitution (évolutive, parce que la constitution conserve en elle le choix primitif de l'association et peut donc, elle seule, tout remettre en question), les Institutions de l'Exécutif et le processus de la représentation, cette République donc, est cela seul qui permet de
détacher le gouvernement de la Cité des idéologies
L'Utopie n'est que le négatif des autres formes d'association comme la tyrannie ou l'oligarchie, c'est pourquoi elle est dangereuse, quel que soit le degré de pureté de ses intentions. Solon conseillait aux Républiques naissantes de faire fabriquer leurs constitutions à l'étranger pour éviter à la fois le pouvoir de la richesse et celui des idées (voir la République de Platon, que ce dernier a bien essayé de vendre en Sicile, sans succès d'ailleurs).
L'essentiel de ce qu'il faut arriver à concevoir, et ce n'est pas facile, c'est que la démocratie est d'essence spectaculaire ou théâtrale : la République est la scène, à la fois fixe et à la fois mouvante des représentations qui alternent selon le rythme du suffrage. Chaque gouvernement est une pièce jouée dont les conséquences peuvent être multiples à l'exception de toute modification de ce qui est inamovible, à savoir la Constitution. Nous avons vu dans quelle mesure cette constitution peut être modifiée, et d'ailleurs notre système montre à quel point il est difficile de s'en prendre à elle.
Corollaire
La démocratie postule l'égalité des citoyens.
Commentaire
A l'origine la constitution d'Athènes interdisait deux choses :
-
l'accumulation de trop grandes richesses
-
l'accumulation d'une trop grande popularité
Elle opposait à ces deux dangers le fameux droit d'ostracisme, c'est à dire le bannissement à vie ou provisoire.
Deuxième commentaire
L'esclavage n'est pas un argument pertinent contre Athènes ou la Rome républicaine. Pour deux raisons :
-
Contrairement aux affirmations des économistes contemporains, l'Antiquité est étrangère au capitalisme. Même Marx le reconnaît.
-
La société antique repose sur une sociologie de la Dignitas, de la valeur personnelle. Elle distingue donc deux catégories d'hommes
-
la classe des hommes libres, c'est à dire de ceux qui sont capables à la fois de défendre leur propre existence et celle de la République
-
La classe servile, c'est à dire ceux qui ont préféré l'esclavage à la mort au cours d'une guerre ou bien les étrangers qui refusent de se plier à l'initiation républicaine. Je rappelle que l'affranchissement était un droit pour lequel il existait une procédure que chaque esclave pouvait entamer. Je souligne aussi que le refus de se plier à l'initiation républicaine est bien l'un des problèmes majeurs que pose l'immigration, au nom surtout des religions.
Troisième commentaire
Le statut de la femme. Comparable, mais seulement comparable à l'esclavage, le statut de la femme nous éclaire sur la non-naturalité de la société, c'est à dire sur le fait que la famille n'est qu'une invention dérivée du passage du
matriarcat
, qui est aujourd'hui encore actif chez les derniers nomades (et aussi chez les Juifs), au
patriarcat
qui a pris le relais dans le monde sédentaire pour des raisons évidentes : la propriété du sol entraîne la propriété des femmes. Le sol et la femme sont ce qui donne la vie et la richesse, ils sont symboles de la fertilité. Pour rappel, Kant lui-même disait du mariage qu'il s'agissait de l'acquisition mercantile des facultés sexuelles d'une femme
Quatrième commentaire
La démocratie est principiellement d'origine nomade. C'est la raison qui explique que le capitalisme, nomade par définition, a choisi finalement cette forme de gouvernement. C'est sa contradiction interne. Elle peut le mener à sa perte mais il lui reste une chance de survivre, s'il parvient à donner à la marchandise le monopole du sens de l'existence, ce à quoi s'attelle la nouvelle religion, la publicité
AXIOME VI
Il n'existe pas de relations économiques entre les êtres humains, il n'existe que des relations politiques. Ce qui met face à face deux agents économiques n'est jamais une relation, mais à chaque fois un duel.
Commentaire
Ce qui était évident au temps du grand banditisme féodal, et qui l'est aujourd'hui encore dans la réalité mafieuse, a été recouvert du voile de la métaphysique des valeurs chrétiennes. Il demeure qu'à chaque fois qu'un consommateur consomme, il se soumet à un autre homme en lui payant une taxe qui est le profit, il en va de même du salarié producteur.
Corollaire
La mondialisation se présente effectivement comme le surgissement de cette vérité sous la forme de l'assomption de la violence comme état permanent. Ce qui porte le nom de terrorisme aujourd'hui n'est rien d'autre que le commencement d'une guerre civile qui, loin de se résumer en une conflagration de cultures, est appelée à miner toutes les unités territoriales de la planète. Les forces armées des états sont appelées à devenir à terme des sociétés de vigiles privées.
CONCLUSION
Notre conclusion va porter sur le non-dit de ce discours, à savoir cette question : pourquoi les hommes auraient-ils choisi de s'associer pour élaborer la question du sens de l'existence ? C'est une question difficile dont la seule réponse immédiate rejoint les philosophies scientifiques modernes du hasard et du jeu. Je pense à Jacques Monod ou à Eugen Fink. On peut donc penser que les sauvages nomades ont misé sur la société, non pas pour vaincre la nature ou je ne sais quelle pénurie imaginaire, ni pour améliorer leurs conditions d'existence Je vous pose une question : comment expliquer qu'aujourd'hui non seulement des millions d'êtres humains encore nomades continuent de préférer la précarité des terres glacées, de la Toundra ou des lois Sarkozy à la vie dans la patrie d'origine, et aussi pourquoi de plus en plus de citadins ne rêvent plus que d'une chose c'est de retourner à une vie naturelle ?. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est que le choix du sociétal a été globalement fertile puisqu'il a donné un résultat fondamental : celui de la communication instantanée dans une seule langue commune. Nous sommes à la fin du cauchemar de Babel et les hommes sont enfin devenus capables de se parler d'un bout à l'autre de la planète et d'échanger ainsi ce qu'ils n'avaient, du temps du nomadisme, l'occasion de faire qu'autour du feu de rencontres aléatoires et rares : la véritable pénurie était celle-là, à savoir le déficit de relations pratiques c'est à dire de progrès théoriques. Il faut aussi longuement méditer ce que signifie ce progrès en termes de pouvoir. En 1920 le peuple allemand a écrasé la dictature militaire du général Kap par une grève générale qui n'a pas duré quinze jours. Cela signifie en réalité que si aujourd'hui le pouvoir semble s'être concentré entre quelques mains dans cet Occident capitaliste, la force, elle, n'est plus à sa disposition comme elle le fut sous l'égide des états. Cette force est désormais entre les mains des travailleurs, des producteurs et des consommateurs. Que ces hommes et ces femmes décident du jour au lendemain d'imiter les Allemands de la période révolutionnaire d'après-guerre, et il faudra redistribuer la totalité des cartes du destin humain. L'Homme choisira alors le meilleur des mondes possibles.
-----------------------------------------------
Je viens de terminer la mise en place de ce texte dont la présence ici semble un peu surréaliste. J'assume. Or, ce texte m'apparaît soudain, ce matin, comme parfaitement adjoint à la réalité du discours le plus pointu qui se tient aujourd'hui. A France-Culture, pas tout à fait en grève, j'entends ce matin même les échos d'un colloque new-yorkais auquel assistait principalement Derrida, colloque qui portait sur une question qui a fait l'objet d'un livre récent du grand penseur sur l'amitié. J'écoute donc depuis neuf heures une discussion alambiquée et souvent parfaitement absconse sur l'amitié, la perversion de ses formes et leur utilisation politique. En gros Derrida regrette la désérotication de l'amitié au profit de son " phalloegocentrisme " si j'ai bien compris et donc de son utilisation dans le politique, depuis Platon, Aristote et la Révolution Française. Pourquoi pas ? Toute cette discussion me paraît cependant assez dérisoire dans la mesure où la véritable question se trouve dans la régénérescence du génos, de la famille comme noyau métaphysique du politique, installé définitivement par Aristote. Voir le discours plus haut et l'erreur de Marx qui naturalise quasi automatiquement, sans même y penser, la société en posant la nature humaine comme sociale à la manière des grands idéologues de cette naturalité, à savoir Hobbes et Rousseau. Pourquoi ne pas appeler un chat un chat ? Enervant aussi la manie de Derrida de nous ramener ses néologismes (qui se voudraient concepts ?) comme l' " aimance " ! Non mais, ça va pas ? Je remarque aussi, en passant, le silence de ces philosophes en colloque sur l'existence même de cette fraternité dont il se font les nostalgiques, celle des Francs-Maçons. Ces hommes et ces femmes associés dans des " obédiences " seraient-ils des curiosités du zoo social ? Alors qu'il me paraît parfaitement évident que cette fraternité sans frères de sang et sans forclusion de la femme est précisément ce qui fait l'essence et l'originalité de leur existence.
Et puis vient l'Edito de Nancy sur la philosophie et la vie. Ouèèèèèèè ! la philosophie comme exercice de la vie : que dis-je d'autre depuis trente ans ? Ni refus du concept, ni déni du vécu, n'est-ce pas le fond de tout ce que j'écris ? Mais peu importe, ce qui manque là-dedans, Jean-Luc, c'est le rapport à l'Histoire, franchement, sans faux-fuyant. Va donc lire mon Atopie, et puis, bientôt sur mon site, " L'usure de l'Être ". Mais quand donc les " publicateurs " vont-ils mettre leur vanité dans la poche ? Pour ma part je m'en fous, ça s'appelle déjà Nachlass.
Lundi 25 novembre 2002
Constat ce matin en relisant le Taminiaux sur la lecture de l'ontologie fondamentale de Heidegger : je manque cruellement de confiance intellectuelle en moi-même. En fait je n'arrive pas à m'arrêter dans une, dans des opinions fermes et qui me permettraient peut-être d'avancer plus vite que je ne le fais. Cela se traduit pas un état de doute permanent sur la sûreté de ce que je pense, sur l'ordre qui règne ou ne règne pas dans ma tête. C'est toujours un immense bordel autour d'une fragile question, celle de l'Être. Et pourtant, en ce moment je ne fais que relire, et je vois partout les traces de mes lectures passées car j'ai la mauvaise habitude de souligner et même de commenter en marge. Et, contrairement à ce qui m'est déjà arrivé de parvenir soudain à une compréhension claire, là où j'ai travaillé des semaines et des mois pour rien - notamment pour la lecture de Heidegger ou même de Marx - je constate que tout est en ordre dans ma mémoire. Il y va sans doute du caractère particulier de la question de l'Être, qui toujours à nouveau me, vous contraint à retourner en arrière, toujours à la situation la plus simple, la plus triviale, la plus facticielle (comme disent les initiés), de toujours recommencer à zéro. Dans la gnoésologie classique, pas de problème, on avance on avance sans problèmes, il suffit de réguler métaphysiquement le progrès scientifique et technique, ce que Kant a fait tout le premier, sauf à considérer que le premier Bacon (Roger) avait déjà tout dit à ce sujet. Dans l'ontologie il en va tout autrement, et le parcours de Martin Heidegger en fait foi.
Le défaut inhérent à ce travail particulier qui est de penser la relation de conscience avec le monde me paraît être l'absence totale de dialogue. Il me semble que la métaphysique a détruit toute possibilité de partage de cette question par la parole en lui substituant un monde de concepts dont l'essence est la crise. J'imagine au contraire la parole sur l'Être comme la Parole appartenant par essence au partage, et en particulier au partage poétique, d'aucuns diraient dionysiaque. L'Afrique recèle des trésors dans ce domaine, en ce sens que les peuples de ce continent ont le génie du syncrétisme, pratique qui est loin de n'être que ce qu'en disent les ignorants et les prêtres. Le syncrétisme est la pratique actuellement possible de la rencontre disante et poétisante. Le fait qu'elle rassemble des religions constitue en lui-même une critique de chacune d'elles et nous fait remonter au temps des monotéismes primitifs, et il ne faut pas omettre que toutes ces pratiques syncrétiques se font sur des bases artistiques et chamanistes. Reste l'absence du concept, or le discours africain reçu aujourd'hui sur nos terres elles-mêmes, que ce soit dans la littérature ou dans le simple rap, montre que les Africains sont beaucoup plus malins qu'on ne veut bien l'admettre. En tant qu'ex-enseignant de philosophie au Gabon, j'en sais quelque chose. Je pense tout d'un coup à Lévinas et à ce qu'il aurait pu nous dire à ce sujet.
Enfin, je suis ravi d'avoir repris le cours de ce journal, j'en avais un réel besoin et je tâcherai à l'avenir de le rendre un peu plus personnel, ou disons, encore un peu plus personnel.
Mardi 26 novembre 2002
La pensée peut-elle progresser ? C'est une question que je me pose depuis longtemps déjà, et mes réponses se ressemblent toutes, à chaque fois que cela se produit, elles disent toutes non. Je suis en train de le constater une fois de plus en parcourant les pages du volumineux commentaire du Sophiste de Platon par Heidegger qui a été publié, enfin, dans la langue de Molière. Ces cours datent de 1924, trois ans avant Sein und Zeit, et appartiennent donc à la partie la plus fraîche de la pensée du philosophe. Or ce que je constate, c'est que d'une certaine manière, ce commentaire est en avance sur ce que Heidegger va penser beaucoup plus tard, après ce qu'on a coutume de nommer sa Kehre, son virage théorique. Mais si je pose cette question de la progression d'une pensée, c'est que je viens de faire une découverte énorme, de franchir un pas décisif, un pas qui s'esquisse ici et là dans notre monde apparemment cinglé, mais qui n'arrive pas à se formuler. Je viens de découvrir qu'il est impossible de penser la question de l'Être seul, il est même, je pense, (hé hé) impossible de penser la question de l'Être. Elle ne se pense pas dans l'ipséité d'un sujet pensant mais dans le partage festif.
Voilà l'échec de Heidegger. Il a raté son Da sein pour cette unique raison qu'il a cru pouvoir cantonner la question de l'Être dans un traitement solitaire, traitement qu'il a d'ailleurs largement contribué à instaurer comme cadre théorique nécessaire. Dans le commentaire de Taminiaux sur les lectures de l'Ontologie Fondamentale, on est confronté à cette surenchère que met en place Heidegger sur les notions de son maître Husserl, et surtout celle de vécu. Si Temps et Être a été un échec, dans tous les sens du terme puisque cette œuvre n'est même pas achevée, c'est précisément, à mon sens, parce que Heidegger a cru pouvoir poursuivre le travail de Husserl en accentuant la position solitaire du penseur et en même temps la position solitaire du Da sein, de l'existence. Il est impossible de penser la question de l'Être dans n'importe quelle position, justement, et pas du tout dans celle de la Verfallenheit, de la déréliction de l'individu, tragiquement planté dans la Vorhandenheit, dans le présent. Non, non et non, la question de l'Être est la seule raison pour laquelle les hommes se sont mis un jour autour d'un feu, c'est à dire on réussi à se mettre autour d'un feu. Je dis ailleurs, et je le répète bien assez, que ces mêmes hommes ont plus tard choisi de s'installer en société parce qu'ils pensaient pouvoir avancer ainsi plus vite dans le " traitement " de la question de l'Être. Sans se faire d'illusion, ou pas trop, sur les risques qu'ils prenaient en procédant de la sorte.
Le problème est un problème hautement théorique : il n'y a pas de vécu intentionnel purement individué, comment pourrait-il alors y avoir une pensée de l'Être isolée, un ergon qui surgisse d'un cerveau perdu dans l'absolue déréliction de la subjectité ? Une Maison de l'Être dont le philosophe serait l'architecte dans son cabinet retiré ? Ce que j'écris aujourd'hui me paraît d'une importance qui dépasse de loin absolument tout ce que j'ai pu penser jusqu'à présent : la question de l'Être ne peut être que son mystère, la fête de sa question, et nous ne pouvons rien être d'autre par rapport à cette question que les mystes de cette fête. Voilà le sens réel du dionysiaque de Nietzsche et sans doute aussi la raison essentielle pour laquelle ce génie a perdu la raison. Voilà un homme qui vit ses premières années fécondes dans la fête wagnérienne, dans la célébration quotidienne des mystères d'Eleusis au cœur du foyer festif de l'Allemagne gonflée de sa puissance acquise et à venir. Les progrès philosophiques que nous devons à Nietzsche proviennent directement de la fertilité ontologique de son Da sein dont on peut suivre le déclin progressif au fur et à mesure que se termine sa relation avec Wagner lui-même, mais aussi avec la plupart de ses amis. Nietzsche est devenu fou de la perte d'amitié et d'amour dans le feu de sa manière de poser la question de l'Être. D'où cette énorme baudruche métaphysique qu'il a baptisée du nom de Surhomme, baudruche qui lui a explosé sous le nez, là-bas quelque part dans les sentiers solitaires du Cervin.
Cette découverte me ramène évidemment tout de suite à Lévinas, qui a compris intuitivement qu'il se passait quelque chose d'abyssal dans le fonctionnement de la Philosophie de son époque, situation qu'il a vécu au contact de Heidegger. Lévinas, ne l'oublions pas, était Juif. Il appartenait à une communauté réelle, une communauté qui est la dernière au monde à traiter en commun de la question de l'Être, pour autant qu'on admette que la fête chrétienne est depuis longtemps terminée. Que ses restes théologico-universitaires ne sont plus que les cendres d'une fête qui a eu lieu il y a bien des siècles. Lévinas a donc construit son cri de révolte contre la prétention subjective autour du thème de l'autre, de l'autrui et d'un Être qui ne serait que dans quelque chose comme la relation à Autrui. Tout cela est mal dit, mais il en ressort quand-même que l'absolu priorité, je dirais l'apriorisme fondamental de Lévinas réside dans le dialogue, dans le parler avec autrui de…l'Être. Je dois cette découverte à la relecture de l'analyse impitoyable de Taminiaux sur la relation Husserl-Heidegger. Les maîtres-mots de la Phénoménologie sont : Intentionnalité et donation. Faut-il encore expliquer ? Je me souviens vaguement d'un livre de Marion sur cette Donation, et je me rappelle m'être fâché d'y retrouver en fait, l'auto-donation husserlienne via la transcendance religieuse. Je viens de téléphoner à Jean-Michel, mon gourou juif, et sa réaction a été instantanée : Dieu a dit à Jacob qu'il était seul. Cela augure d'une belle empoignade à venir sur le sens de la communauté, le " vécu " des yeshivot et son aventure avec ses maîtres à penser. Sur le coup je me prends à repenser à l'actualité soudaine de ce thème de l'amitié relevé par Derrida, ce renard toujours à l'affût. Pourquoi penser l'amitié ? Quel intérêt philosophique pourrait bien avoir une des déclinaisons de l'affectivité au regard de la profondeur insondable des questions ontologiques ? Hé bien, je viens de le découvrir, pour ma part, car sans doute Derrida est-il déjà beaucoup plus loin, qui sait ?
Encore un mot en vitesse : l'indiscibilité de l'Être, attribut que lui confèrent toutes les religions sérieuses, atteste ce paradoxe que l'Être ne peut se dire car il ne contient aucune quiddité1, comme le dit si bien Molla Sadra Shirazi, on ne peut que le saluer humblement : " les faces s'inclinent devant le Vivant, l'Eternel ". Les mystères d'Eleusis étaient donc la version laïque des cultes religieux, mais ces mystères ont donné, entre autre, le pythagorisme et tout le reste. Le Molla dont il est question est le seul penseur qui ait osé appeler un chat un chat. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré dans tout l'Islam (en particulier sunnite) comme un hérétique. Et encore, pour ceux qui le connaissent. Le paradoxe est donc total, puisque si l'on ne peut dire quoi que ce soit de quelque chose, encore moins peut-on le partager avec autrui. Voilà la question qui va retenir toute mon attention dans les temps à venir et vous en entendrez parler. Si ça vous intéresse.
La journée n'est pas finie. Grande densité, le temps s'écoule en force entre l'écriture, le cours que je donne à mon étudiant, la cuisine rapide mais succulente, la télé avec un Blondel plus puant que jamais et la tristesse sur les routes bleues d'uniformes omnipotents. Je peux donc encore écrire avant que Jean Michel ne m'appelle pour discuter de ma découverte, je pense que la température va encore augmenter. En fait, dans la discussion qui devrait avoir lieu, il en ira d'abord du statut de la parole. Parole et Être. Mais la parole en quel sens ? Allons-nous retomber sur l'opposition de l'oral et de l'écrit ? Peut-il y avoir une parole dans l'écriture ? L'Ecriture peut-elle prétendre s'emparer de la Parole ? La métaphysique, y compris ses contre-développements les plus récents, donne à ces questions toutes les réponses que l'on veut, comment donc y voir clair ? Existe-t-il un chemin de vérité qui passe par l'une ou l'autre de ces réponses ou bien qui réussisse à les éviter toutes ? Je pose la question sans avoir en vue aucune réponse, je ne peux me reposer que sur le socle de mon opinion, disons de mon intime conviction qui ne veut rien avoir à voir avec la vérité ou la science.
En tout cas il y a une histoire de l'écriture, que Derrida le veuille ou non, il n'y a même d'écriture qu'historique ou d'histoire qu'écrite. Nous voilà, semble-t-il, renvoyé une fois de plus à l'histoire. Pourquoi pas, l'Histoire n'est jamais que le tracé ou la trace écrite, bel et bien, de beaucoup de choses, d'événements et de produits d'idéations diverses et variées, je veux dire qu'il n'y d'histoire que dans l'écriture. Mais il n'est pas interdit de sortir de l'Histoire, horizontalement et verticalement comme dirait mon ami Jean Michel. Horizontalement par décalage de toute historicité des faits quotidiens, verticalement par annulation de causalité dans le temps, je dis bien de causalité, ce qui ne signifie nullement volonté. La volonté peut s'inscrire dans la matière sans pour autant devenir une causalité interne à cette même matière, un peu comme on dresse bien vainement des obélisques et des monuments aux morts. Verticalement aussi en remontant en-deçà du règne de l'écriture si tant est qu'il soit possible de discerner une hominité sans écriture, ce qui dépend de la définition de ce mot écriture. Mais le discernement ou la possibilité de voir n'est pas ici un critère absolu, nous ne voguons pas sur les vagues d'aucune science ni n'aucune vérification métaphysique. Nous poétisons les yeux bandés sur un passé, sur des rétentions de conscience qui ne forment histoire que pour les actifs, les acteurs de la Praxis qui utilisent le concept à leurs fins. L'histoire comme récit et comme construction eschatologique n'a jamais été qu'un moyen régulier pour des fins séculières. A commencer par l'Histoire dite Sainte. Mein Gott ! Mais revenons à la Parole. Une question me vient à l'esprit inopinément : Adam a-t-il entendu Dieu comme l'a entendu Moïse ? Il me semble que les termes de la Genèse ne ressemblent pas du tout à ceux de l'Exode, mais je ne pourrais pas être affirmatif sur ce sujet, la Bible que j'avais coutume d'utiliser étant restée aux mains d'une voleuse qui se reconnaîtra et qui n'y mettra jamais le nez, même si elle lui appartient. Donc Adam ; pourquoi cette question ? A cause, bien entendu du caractère mixte de la relation de Moïse à Dieu, mixte au sens de oral et écrit, puisque non seulement il l'a entendu dans le désert, mais encore qu'il a reçu les Tables écrites, alors qu'Adam, on ne sait même pas si Dieu lui a parlé ou bien si l'interdit de l'arbre lui a été prescrit d'une manière subliminale. Je vérifierai cela avec mon gourou juif. L'intérêt de cette question est évident pour qui connaît un peu mes poèmes théoriques, car l'oralité s'interrompt avec Moïse qui demeure quand-même l'auteur du Pentateuque, alors qu'on ne sache pas qu'Adam ai rien écrit, même si sa chute entraîne l'ouverture de l'Histoire Sainte. Entre lui et Moïse on n'a fait que parler. Imaginez cela ! Tout cela est bien entendu symbolique, ou mythologique, mais cela parle d'un parcours, d'un trajet parfaitement historique dont une partie, une section, a lieu sans écriture. Abraham n'a jamais fait que parler. Lui aussi, d'ailleurs, a entendu Dieu ou son Ange, peu importe. Non pas peu importe, car le problème des anges est aussi une question de fond, essentielle et nous y reviendrons.
Le moment de Moïse est donc une césure absolue. Moïse est le premier consignateur de l'Être, et co-consignateur de la Loi, même si sur le coup la colère lui a fait briser ces Tables de la Première Ecriture. Que se passe-t-il avant ? Quel sens peut bien avoir la notion de peuple de Joseph, exilé dans l'Egypte des Pharaons ? Il n'y a pas de peuple sans écriture, tout au plus des hordes nomades pour qui le monde est écrit dans la tête, dont les têtes sont tous des bibliothèques immenses, sans doute incomparablement plus grandes que les plus grands de tous nos stocks de bouquins. Les Juifs d'Egypte étaient tous des érudits, tellement érudits qu'ils suivaient déjà les rites issus de leur propre futur, de même qu'Abraham fêtait avant la lettre Yom Kippur et Shabbat. Cercle. Partout des cercles. De paroles. L'histoire ontique du peuple juif, l'histoire événementielle, n'aura été que la répétition du rituel, l'effectuation de ce qui était depuis des millénaires programmé ou discerné dans leur manière de répondre oralement et ensemble à la question de Dieu (del'Être). Moïse n'est qu'un sous-ange qui donne le signal des trois coups de la pièce de théâtre.
Pourquoi n'en irait-il pas exactement de même pour notre histoire à nous, les Chrétiens ? Platon / Moïse ? Il faudrait pouvoir démontrer que la thèse centrale de Platon est impossible sans l'incarnation, ce qui ne devrait pas être si difficile que ça puisque tout son système, disons le plus cohérent de ses systèmes, repose sur l'incarnation des âmes, de leur voyage entre l'ouranos des idées et le gé de la matière.
Mercredi 27 novembre 2002
Le fait d'être philosophe peut aider, répondait Nancy à un brancardier qui l'emportait vers l'hôpital pour l'une des centaines d'interventions en tous genres qu'il a subi depuis qu'il le cœur d'un autre. Il raconte ça lui-même et je suis témoin que pour lui, au moins, cette affirmation est vraie. Pour moi aussi, mais Jean-Luc ne dit pas tout. Je vais donc compléter son dire sur la souffrance et la maladie : le philosophe, et seulement lui, désire la mort, ou, disons pour être plus précis, a du désir pour la mort dont il connaît la valeur de délivrance. Mais il ne faudrait pas s'y tromper, ce désir ne diminue en rien la jouissance de l'exister, le désir de durer dans l'ek-sistant, et c'est là tout le paradoxe de la position de la sophia ou plutôt de la phronésis, la sagesse de ce qui n'est jamais identique, la sagesse de ce qui est affecté par le temps et la pratique, la praxis. Dans le flot des " choses à faire ", il faut choisir, toujours, et toujours il faut choisir la bonne chose, voilà comment Aristote définissait la sagesse, et il faut choisir en dépit de la connaissance de l'issue, cette issue dite fatale. Et que sont ces " choses " ? Que sont ces rei, dont le singulier res, accolé à l'adjectif publique donne République ? Hé bien, cette chose c'est l'Être et c'est aussi la bergsonienne durée, c'est ce dont l'homme a le souci le plus profond, mais non pas pour lui-même, non pas pour le temps que son cadavre matériel va mettre à pourrir pour finir par s'éteindre, mais pour la durée de tout ce qui est autre, le temps qui souffle sur les blés et les montagnes enneigées, les océans et les villes enfumées, le coin de fenêtre qui délivre ses perspectives abyssales et la douceur du sourire de l'Autre. Alors la res c'est le cœur de ce que nous nous disons. Si Freud n'avait pas été, comme Heidegger, emprisonné dans sa tour de Londres académique, il aurait pu dire aussi que le fond de TOUT ce que nous nous disons, disons réellement, pas pour faire du bruit avec les lèvres mais pour émouvoir, faire comprendre, affecter autrui, s'unir à lui, tout cela procède de la question de la Chose et seulement elle. A tel point que cette vérité de la chose partagée ne peut se dire qu'à travers l'amour, l'amour de la res, res dont Autrui est le primum essens et le primum movens. Je t'aime n'est que l'alpha du langage philosophique, le philosophe, lui, prend la peine de parcourir tout l'alphabet de cet amour. Parvenu près de la lette Omega, il peut parler comme Jean-Luc Nancy, parce que la mort est devenu un aller vers l'éternité que le présent ne cesse de nous dérober pour nous contraindre à l'action. Comment dire pour éviter tout malentendu ? Ceci peut-être : aux alentours de l'Omega, l'initiation à la res s'achève, que la vie soit longue ou qu'elle dure, comme pour Jean-Luc, au-delà du raisonnable. Attention, ne pas confondre la phronésis avec le Savoir Absolu. Encore que.
Vendredi 29 novembre 2002
José Bové. Il faut bien de temps en temps ausculter le temps présent, or ce nom est un symptôme. Ayant couvert pendant de longues années les affaires agricoles de ma région, j'ai une certaine expérience du comportement des Français qui cultivent la terre, des gouvernements qui ont à gérer la liquidation des derniers paysans, et des partis politiques qui, d'une manière ou d'une autre ont à prendre position dans ce dossier. La raison pour laquelle Bové est devenu en quelque sorte notre commandant Marcos n'a rien à voir avec sa moustache ou avec une médiatisation particulièrement bien organisée : il n'y a que les médias eux-mêmes qui organisent leur impact et ce n'est pas la Confédération Paysanne qui aurait soudain découvert le secret pour attirer les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Tsss tsss, l'affaire ou les affaires Bové marquent un tournant radical dans l'évolution des attitudes politiques, syndicales et judiciaires françaises, et européo-mondiales. Ce sont donc les médias, fidèles serviteurs des pouvoirs économiques et politiques qui ont fabriqué Bové sur ordre par un suivi et une attention purement stratégiques. Ce n'est pas l'un des moindres reproches que l'on puisse faire aux socialistes d'avoir négligé l'affaire Bové en la traitant par-dessous la jambe et en laissant les forces de droite avoir les derniers mots dans cette affaire, en ce moment.
Au plan syndical et judiciaire, l'affaire Bové est un vrai scandale, rarement dénoncé pour ce qu'il est. C'est très simple, les destructions d'édifices publics, les sabotages, les atteintes à la propriété privée, les violences de toute sorte que l'on peut attribuer à la FNSEA, le syndicat majoritaire des Exploitants Agricoles, petit chouchou de la droite depuis sa création et dernier bastion de l'ancienne puissance politique que représentait la paysannerie pour les droites de notre pays, tous ces délits ont été, et sont encore un million de fois plus grave que ce que le petit syndicat de gauche s'est permis autour d'un chantier de MacDo ou d'un champ de maïs génétiquement modifié. La hargne et la rigueur avec laquelle Bové est poursuivi, littéralement embastillé par le gouvernement revanchard élu par surprise est à vomir d'injustice. Chirac, le grand protecteur des grands compradores - grands importateurs d'immigrés salariés au noir - se montre bien cruel à l'égard de ce pauvre petit syndicaliste qui n'a sans doute jamais demandé une telle célébrité. Mais justement, le pouvoir avait besoin de cette célébrité pour que le châtiment programmé soit véritablement exemplaire. Ce qui indique immédiatement le véritable objectif de notre bonne vieille droite : détruire ce qui reste de propre dans le syndicalisme tout en ménageant les bons vieux complices de la FNSEA mais aussi de FO ou de la CGT-CFDT. Et surtout mettre fin à la traditionnelle impunité syndicale en milieu agricole à l'égard des militants qui oseraient marcher en-dehors des clous. Lorsque en Bretagne ou en Aquitaine il arrivait que la FNSEA et la Confédération fasse alliance pour des affaires brûlantes de prix ou de concurrence européenne, le pouvoir passait l'éponge pour tout le monde. Oh les apparences restaient sauves en général, et régulièrement on voyait quelques meneurs à la barre du Tribunal de Grande Instance, mais je n'ai jamais, jamais vu condamner une de ces brutes à de la prison ferme, jamais. Bové, si.
La droite a toujours eu le désir conscient et organisé de " nettoyer " le milieu syndical. Chirac est un grand spécialiste du " dialogue " avec les organisations de salariés depuis qu'en Mai 68 il se baladait entre Matignon et les centrales, revolver en poche. Vieux rêve qui pourrait bien prendre forme, les derniers rebondissements sur les routes et dans le service public le montre, mais ce n'est reculer que pour mieux sauter. Le syndicalisme français est ainsi fait qu'il dépend beaucoup plus, du point de vue de ses appareils, de l'état que de ses militants, ce qui confère au pouvoir en place une puissance de dissuasion radicale. Il n'y a donc rien à en attendre. Mais le contrôle des syndicats ne change rien au mécontentement des Français, et lorsque les données concrètes l'exigent, ils savent parfaitement se passer des syndicats. Et plus le gouvernement va s'attacher à encadrer politiquement les organisations syndicales plus il renverra les Français dans les bras du " spontanéisme " dont il a su, par le passé, montrer la puissance et l'efficacité.
Mais l'affaire Bové est aussi un tournant pour l'Europe et le marché mondial des OGM. Les grands producteurs d'OGM, les Novartis et consort, sont dans une situation plus que délicate. La recherche et la production d'OGM ont coûté cher, très cher et il n'est pas question de faire passer cette affaire par pertes et profits. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le véritable but des OGM n'est pas financier mais politique : à terme, l'utilisation massive d'OGM donnera aux multinationales de l'agroalimentaire le monopole des semences. Autant dire le pouvoir absolu sur les choix et le travail même de n'importe quel paysan de France ou d'Afghanistan. Il s'agit bel et bien d'un bras de force entre l'esprit des reîtres de l'industrie et de la finance et celui des hommes qui pensent encore consacrer leur existence à la culture de la terre et à palper de ce choix les quelques avantages qui en découlent encore dont celui de la liberté. C'est donc pour tout cela que ce cher José Bové va peut-être passer encore quelques mois en prison, ce qui n'est pas rien d'autant que je crois savoir que le dirigeant de la Confédération Paysanne a fort mal vécu son premier passage dans les geôles de la République et on le comprend. Courage, mon vieux. Je n'ai qu'un conseil à te donner, laisse tomber l'affaire des OGM, c'est trop gros pour ton petit syndicat et tu peux laisser les consommateurs s'en occuper beaucoup plus efficacement, nous nous y attellerons, Bruxelles ou pas.
Mercredi 4 décembre 2002
Au menu de France-Culture ce matin, les flux migratoires sur fond de l'affaire de Sangate. Beaucoup de commentaires passionnants sur les motivations des migrants dont on possède une image largement faussée par les images d'Albanais débarquant en Italie, de boat-people risquant leur vie sur des embarcations de fortune et la misère apparente de tous ces nouveaux clochards planétaires. Mais les choses sont bien différentes. En réalité les ex-sangatiens sont pour la plupart des " gens très bien ", issus de classes moyennes-supérieures, bref, on en déduit qu'il s'agit de véritables options soit politiques, soit économiques et sociales. Le médecin irakien d'origine kurde en a raz le bol d'une vie quotidienne comprimée dans le fonctionnement de la tyrannie sadamienne. L'occident, que ce soit l'Europe ou l'Amérique du côté mexicain, attire parce que les images d'une autre vie, la démocratique, viennent nourrir l'imaginaire des infortunés du politique. Ce qu'on oublie dans tous les commentaires, c'est que ce mouvement d'attirance, de raz le bol et de romantisme de l'aventure, n'a pas cessé d'agiter l'Europe et l'Amérique elles-mêmes depuis deux siècles. Impérialisme et colonialisme n'ont été possible que sur la base du fantasme du mieux-vivre ailleurs, de la facilité d'assurer le destin, économiquement certes, mais aussi ontologiquement. Je suis moi-même un exemple parfait de la migration volontaire et risquée à l'occasion de la guerre d'Algérie, mais aussi sur la base de mon rejet de la vie en France dans les années 60 et 70. En fait, mon retour et ma réintégration dans ce pays se sont opérés sur la base d'un changement de destin personnel, à savoir le choix de procréer et de tenter l'aventure de la famille, mais aussi, et c'est bien plus important, en tant que réponse à une longue méditation, un long travail de réflexion sur le lieu légitime et vraie de mon destin. Dès la mort de mon père, en 1946, ma vie avait pris un tour qui faisait de mon Alsace natale et de ma patrie la France un lieu de perdition et de mort. Il en est résulté un exil suicidaire, et souvent je pense à tous ces migrants qui traversent le monde dans des conditions limites, au fond d'une barge prête à couler à la moindre vague ou tassés par dizaines dans des conteneurs dont rien ne prouvait au départ qu'ils en ressortiraient vivants.
Or, mes pérégrinations ont été globalement une grande réussite existentielle. Je n'ai jamais été plus heureux, en termes de plaisir de vivre, de sérénité et même de santé, que dans les pays étrangers, pour la plupart des pays pauvres, de ce Tiers-Monde que semblent fuir aujourd'hui ceux qui m'on accueilli il y a seulement quarante ans. Mes deux années passées aux Antilles ont été paradisiaques et j'ai toujours parfois du mal à comprendre pourquoi je n'y ai pas construit le reste de ma vie. Et pourtant ma décision finale aura été de rentrer au pays. Pourquoi ? J'en ai déjà parlé dans l'un de mes ouvrages que vous pouvez trouver sur ce site et où je mets en scène quelques grands moments de ma biographie. Mais en bref, je suis rentré en Alsace tout simplement parce que j'y suis né et que j'y ai été élevé. Dans les calculs ontologiques, j'avais compris une chose étrange, c'est que mon destin était inscrit ici. Cela signifiait, non pas que j'y vivrais un jour selon les canons de la réussite, de la fortune ou de je ne sais quelle carrière personnelle, mais que l'Alsace (aussi la France, l'Europe et en un mot l'Occident) était le seul champ de bataille de mon existence : le défi au monde, ou disons plus modestement le problème que constituait ma naissance dans ce monde est né ici, en Alsace, dans une martingale déterminée (en particulier le problème du franco-allemand, et du catholique-protestant, ce qui n'est pas rien, croyez-moi). Cela signifie que des êtres humains déterminés, les Alsaciens, ont été ceux qui m'ont reçu dans ce monde, ce sont permis de me juger et de me lancer une sorte de défi fondamental, celui de construire ma vie, mon existence, de prouver mon être avec et contre les conditions qu'ils m'offraient.
Il m'était loisible de fuir, bien sûr, mais à quel prix ? Au prix de mon honneur. Vers trente ans, cette vérité s'est fait jour dans mon esprit, je me suis rendu compte qu'on s'était en quelque sorte débarrassé de moi, qu'on voulait le faire et que j'avais foncé tête baissé dans le piège. Soudain je me suis rendu compte qu'il me fallait absolument assumer ma présence là où j'avais échoué au nom du destin, de ma constellation parentale et de leurs rêves et fantasmes à eux. La vraie question de ma vie n'était pas de trouver à m'installer le mieux possible dans cette existence, vieux souci trivial qui fonde la plupart des discours idéologiques de notre occident fatigué de vivre, mais de réaliser ma propre persistance dans ce monde, et je dis bien persistance, c'est à dire rester debout là où on attendait de moi que je tombe en tant que moi et que je m'agrège dans l'alsacien sans poser de question.
Je fais l'honneur à tous ces migrants du monde entier, qui ne sont que les acteurs du retour d'un nomadisme nouveau, de croire qu'ils honoreront ce même parcours. D'ailleurs je constate avec plaisir que la plupart des anciens immigrants maghrébins, ceux que la France a été chercher chez eux pour les exploiter en profondeur dans ses usines et ses services, ceux-là rentrent tous vieillir et mourir chez eux, parfois en prenant des risques mortels mais en s'abandonnant à l'impératif de leur origine. Et je suis sûr que comme moi ils en trouvent plus ou autre chose que le béotien bonheur de jouer les patriarches dans leur mechta ou leur village. Ils viennent achever le cycle qui a commencé là-bas dans les Aurès ou dans l'Atlas, là où la vie les a posé dans les fracas de la tribu ou du clan, dans la préparation souterraine d'événements qu'ils auront à affronter, dans leur propre histoire, la seule patrie digne de ce nom. Tout cela est paradoxal. L'âme humaine, la conscience, est par essence errante. Nulle part la conscience ne peut se reposer et faire corps avec le monde qui l'entoure, partout elle continue fatalement à chercher sa voie, comme le dit le Tao. Depuis des siècles, l'homme a inventé la formule de la Cité, lieu supposé du repos du guerrier errant, de la conscience sans boussole, mais jamais, aucune d'entre-elles n'a réussi à offrir cet abri ontologique qui n'existe pas. Le nomadisme est donc au programme de toute l'humanité, négatif dans notre lointain passé, positif dans le monde qui nous attend. Et pourtant ce devoir insiste, demeure, de résoudre son équation personnelle dans un jeu déterminé. Je suis né sédentaire. Mes plus beaux souvenirs d'enfance sont ceux d'un jeune paysan du dimanche chez mon grand-père retiré dans un village du piémont alsacien, dans le vignoble tant chanté et pour de bonnes raisons. En naissant, j'ai été pris dans les filets de cette vie fondée pour la paix et la prospérité, dans le rester sur place pour continuer l'œuvre des pères. Et j'en ai joui en tant qu'enfant, car dans les fantasmes eschatologiques des peuples, ce sont finalement seulement les enfants qui tirent réellement parti des choix des adultes. Alors je dois assumer, payer la facture de cette enfance d'une manière ou d'une autre, et je le ferai coûte que coûte. Coûte que coûte je montrerai, je dirai comment l'on s'est trompé sur le monde en le posant de la manière qu'on a fait, je corrigerai pour les générations à venir les images de la vie bonne et vraie. D'une certaine manière tous les champs de vie qui s'ouvrent à un être sont mensongers dès le début et trahissent forcément sa singularité et l'essence de sa présence. Il peut choisir de fuir ce mensonge et s'en fabriquer un autre ailleurs, mais ça, c'est nul.
Samedi 7 décembre 2002
La Chiraquie est quelque chose d'étrange mais de bigrement révélateur. D'un côté les vérités de la Cité semblent enfin émerger de leur non-dit séculaire, de l'autre cette émergence est tellement formelle qu'elle semble condamnée à une paralysie encore plus handicapante que la précédente. Cette contradiction est visible à l'œil nu dans les secteurs " sensibles " comme l'économie, la fiscalité, les politiques sociales ou dites de " sécurité publique " qui, prises toutes ensemble ne font qu'afficher une fois de plus le retard de la France - et donc aussi de l'Europe - sur la dynamique du capitalisme américain, retard que l'on peut aussi qualifier d'allergie. Le comportement du Chef de l'Etat illustre d'ailleurs fort bien cette contradiction quand, contre toute attente, il force la vapeur en direction du renforcement, il faudrait dire du rétablissement, de l'Axe Paris-Berlin, alors qu'on pouvait tout attendre en direction du social-démocrate Schroeder sauf ça. De même dans le secteur social, il est remarquable de constater avec quelle énergie le gouvernement Raffarin s'attaque à ce que le Canard Enchaîné qualifie de la France du " sous-sol ", c'est à dire un degré plus bas que la France d'en-bas du Premier Ministre. C'est donc un gouvernement de droite (française) qui comprend enfin que la modernisation du pays passe avant tout par la lutte contre une tiers-mondisation rampante, même si les réflexes d'un Sarkozy semblent aller à contre-courant, nous rappelant ainsi qu'il fut balladurien, c'est à dire partisan d'un clan qui, à l'instar du centrisme giscardien, se donne pour tâche fondamentale de " libéraliser " la France coûte que coûte. La rivalité qui se dessine entre les deux futurs candidats à la présidentielle de 2007 n'est pas seulement une affaire de personnes ou d'ambition. Elle révèle des oppositions beaucoup plus fondamentales entre un Sarkozy déterminé à américaniser tout ce qui bouge et un Juppé qui a compris la leçon de 1995 et qui a choisi l'humilité envers un Président jadis méprisé mais dont le triomphe politique a révélé une dimension inattendue de puissance personnelle. Le Ministre de l'Intérieur table sur une évolution qu'il pense inéluctable, montrant ainsi son côté idéaliste, alors que son rival se résout enfin au pragmatisme machiavélien. Jacques Chirac est ainsi devenu l'ultima ratio politique, et ce fait condense et éclaire la situation ambiguë dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui.
L'exemple le plus frappant de la contradiction quasi ontologique que contiennent les choix politiques qui sont fait depuis l'élection présidentielle, est celui du choix du Ministre de l'Education. Qui eût pu croire, aux lendemains de cette victoire à la Pyrrhus, qu'un Président de droite aussi puissamment élu, avec et grâce à une image essentiellement triviale et franchouillarde, puisse désigner comme Ministre de l'Education un professionnel de la philosophie sinon un philosophe proprement dit ? Réfléchissons. On pourrait dire, connaissant bien la bête politique nommée Chirac, qu'il s'agit d'un pas de clerc très malin de la part d'un homme qui sait avant tout écouter son entourage et prendre la température de l'opinion. C'est la toute première fois, me semble-t-il, qu'un philosophe est appelé à occuper une telle fonction dans les rouages de l'Etat. On peut donc affirmer qu' à l'Elysée les flux de pensée, mais il vaudrait mieux dire les spéculations de démagogie métaphysique, ont rejoint avec Jacques Chirac, les eaux de la République de Platon. Pour la première fois de son histoire, l'Etat français règle son apparence sur le niveau moyen d'acculturation de son système éducatif, tant il est vrai que la Répubique de Platon demeure la seule référence philosophique qu'aucune réforme de l'enseignement de la philosophie n'a remise en question. Depuis la nuit des temps de l'Enseignement public et gratuit, Platon tient le haut du pavée pédagogique et il était presque temps qu'un gouvernement se serve de cette image pour en quelque sorte garantir a posteriori la justesse de cette option idéologique. Les philosophes au gouvernement, voilà une audace de nature à rassurer l'opinion de millions de Français sur la " classicité " et le sérieux des premières décisions. Au plan de l'apparence il s'agit donc d'un coup formidable. Mais ce coup n'est pas seulement formidable par son côté machiavélique qui le fait ressembler au rachat d'une culpabilité ancestrale, d'un défaut invétéré des gouvernements passés, mais parce qu'il prend le risque de porter sur la table du souci public le véritable sens de la Cité.
Ceci donne cela : Jacques Chirac, le buveur de bière et le mangeur de tête de veau, devient le premier Président de la République qui s'intéresse au projet de la Res Publica, de la chose de tous, de la choséité de la chose, à savoir l'énigme métaphysique du monde. En désignant comme il l'a fait le responsable de l'Education des jeunes Français, il promeut l'idéal le plus haut possible de la Cité, à savoir le partage de la question du sens de l'Être, du sens de la vie et de l'existence. Fabuleuse décision dont la puissance symbolique va bien au-delà de tout ce qui est projeté ailleurs en vue de la sécurité et du bien-être des citoyens. En fait, le Bien-Être passe au second plan pour céder la place au " qu'est-ce-que l'Être ", question dont les Grecs avaient fait l'Alpha et l'Oméga de toute praxis politique, l'idéal en somme qui devrait porter en lui tous les désirs et toutes les passions des citoyens. Pour un peu, je voterai désormais Chirac, quoi qu'il arrive, tant je considère comme nodal, fondamental et juste, d'attribuer au politique ce destin-là, fort éloigné de cette gestion domestique dans laquelle il est tombé dès le lendemain des guerres. Pour en rajouter une louche, je dirais encore que même le grand Général De Gaulle n'avait pas osé aller si loin, se contentant d'inventer un Ministère de la Culture et d'y placer un écrivain célèbre et reconnu. Car Malraux, même s'il dépasse de mille têtes intellectuelles le dénommé Luc Ferry, n'était qu'un aventurier dans la métaphysique déclinante mais en aucun cas un fonctionnaire de l'ontologie
Tout le chiraquisme se condense dans cette nomination surprenante, et on suppute les influences conjuguées de l'exemple gaullien, car l'affaire Malraux fut quand-même en son temps un très joli coup, et de la poésie d'un certain entourage dont le caractère bigarré appartient au caractère même du Prince, à la mosaïque de sa culture. On pourrait dire que l'ancien Maire de Paris, l'ancien Premier Ministre malchanceux et l'éternel candidat piaffant d'impatience pour assurer son règne, a enfin trouvé ce qui lui a toujours fait défaut à savoir une pensée politique sur la base même de son absence de pensée. En nommant un philosophe aux plus hautes responsabilités de l'Etat, Jacques Chirac se débarrasse du douloureux fardeau de la légitimation idéologique, et il peut renvoyer tous les courants de sa vaste UMP dans la salle de jeu des institutions, se réservant la seule chose qui l'intéresse vraiment, le pouvoir réel. Rien n'empêche plus désormais le Prince de rassembler le non-rassemblable et de picorer où il veut les forces intellectuelles dont il pourrait avoir besoin comme simple alibi ou même comme véritable instrument de gouvernement. Chirac devient sérieux, et faute de compétence historique réelle, il a compris comment pallier ce défaut fondamental. Comment comprendre autrement le ralliement de véritables philosophes de gauche comme cette dame qui domine depuis quelques années maintenant le débat philosophique sur France-Culture ? Je tairai son nom tant m'horripile cette voix arrogante bardée de tout et en particulier d'ontologie heideggerienne et de philosophies politiques parfaitement dosées entre Machiavel et Hannah Arendt. Bref, notre Président de la République est réellement en train de devenir gaullien, et d'une certaine manière cela me rassure car l'irréalité traditionnellement manifeste de son propre gaullisme plombait bien lourdement son image.
Rassuré mais pas idiot. Rassuré parce que d'une certaine manière les choix du nouveau Prince montrent au moins une chose, c'est qu'il est conscient de ses propres carences, c'est à dire de ses vraies carences, celles d'une pensée politique valant pour l'histoire et non pas seulement pour l'historiographie. Il semble avoir l'humilité de faire appel à ceux qui sont ses supposés sachants, ce qui n'est déjà pas mal, même si les personnes concernées, c'est à dire celles qui acceptent de jouer dans son jeu, sont fort loin d'être à la hauteur de cet appel. Le sort actuel de Luc Ferry ne semble d'ailleurs guère enviable précisément parce qu'il a déçu un Prince pressé qui en attendait plus et plus vite. Jacques Chirac a, semble-t-il, découvert beaucoup plus rapidement que prévu l'incompétence foncière de son ministre au point de le traiter de salonard, ce qui ne manque ni de la lucidité ni de la cruauté requises. Ce qui montre aussi que ce Président, si soucieux de son image bonhomme, est capable d'exhiber sa méchanceté quand un projet lui tient à cœur, donnant ainsi une marque probante de l'importance qu'il attribue à ce choix politique. On pourrait aller jusqu'à le créditer pour une fois de rigueur intellectuelle ou au moins de suite dans les idées. Cela dit, il ne faut pas rêver. Luc Ferry semble déjà condamné, mauvais choix de personne. Mauvais choix de personne lié à la conscience trop confuse qu'a le Président de la réelle importance de la chose, car s'il avait eu en tête un projet comparable à la République de Platon, il aurait pris un soin tout particulier au choix du responsable de l'opération. On aurait pu voir sollicité au moins quelqu'un comme Derrida sinon carrément Baudrillard, Morin voire Legendre, des gens qui s'efforcent réellement de penser, même si ceux-là aussi semblent tourner en rond, bien à l'écart (et à l'abri) de cette Cité dont ils ne pèsent l'importance que dans leurs spéculations. Même un Conte Sponville ou une Virilio auraient fait une meilleure affaire que ce Luc Ferry, répétiteur très moyen d'une métaphysique depuis longtemps enterrée. Il faut donc bien admettre que notre Prince est courageux mais pas téméraire et qu'il est permis de douter qu'il réalise ne fût-ce que partiellement ce que le Général avait réussi avec Malraux.
Reste l'étrangeté de cette aventure politique. On comprend l'affaire Malraux parce qu'elle ne pouvait pas rater. D'abord de par l'allégeance sans faille du Grand Homme au Grand Général, puis de par son courage personnel et son mépris des ambitions triviales. Malraux était un homme désespéré au point que les dernières années de sa vie furent celles d'une déréliction intime et familiale rarement étudiée avec soin. Cette déréliction n'était pas étrangère à la situation politique du pays et notamment à l'état dans lequel se trouvait alors le système éducatif. Malraux avait à gérer trop de contradictions entre ses idéaux révolutionnaires de jeunesse, l'Etat qu'il servait fidèlement, et l'éducation de ses propres enfants, eux-mêmes engagés dans une mimésis tragique vis à vis de la figure de leur père. Mais Malraux a vécu cette tragédie en grand acteur et le Général lui doit plus qu'un succès d'estime dans le domaine de la Culture. Par son influence intellectuelle sur le Général, l'écrivain avait su étendre son action bien au-delà de son Ministère et de ses prérogatives particulières, et c'est peut-être bien ce que Chirac attendait de son Ferry. Mais étant donné la personnalité de ce personnage sorti du néant, on ne devait ni ne pouvait s'attendre à un autre résultat. Il y a donc quelque chose aussi de désespéré dans le geste de Chirac, la conscience obscure d'un besoin d'aide réelle dans une conjoncture inextricable. Or ce désespoir, c'est bien celui de la France et de l'Europe, confrontés à la martingale historique la plus complexe et la plus perverse qu'on puisse imaginer. On peut résumer cette situation d'une simple phrase : quel nom donner à la Cité européenne, c'est à dire quel but peut-on attribuer aujourd'hui à l'action politique confrontée à la puissance du marché ? Ce n'est pas Jacques Chirac qui a pris conscience de cette question, c'est la réalité qui la lui a imposé. Heureux encore qu'il en ai capté un tout petit bout
Vendredi 10 janvier 2003
Retour vers la présence. Depuis quelques jours les choses ses tendent dans mon esprit. Il y a une semaine environ, j'ai dû faire un constat douloureux : je n'ai rien trouvé. Comment alors justifier tout ce travail d'écriture et surtout comment continuer ? Ma réflexion tourne autour d'une sorte de cercle historique dont le concept circule pour ainsi dire sur deux pistes à la fois. Pour rester bref je dirai, une piste ontogénétique et l'autre, la phylogénétique. Il n'existe aucun chercheur dans les domaines philosophiques ou des sciences dites humaines qui ne soit, je pense, contraint de procéder de la sorte. Or cette circulation en double-file est extrêmement difficile, même si cela peut donner des œuvres fertiles voire révolutionnaires comme celle de Rousseau, par exemple. Encore que Rousseau s'est bien gardé, à ma connaissance, d'inscrire sa réflexion directement dans le contexte de son temps propre, de son actualité.
Je m'explique. L'ontogenèse c'est le développement de l'individu par opposition à la phylogenèse qui s'en tient à un supposé développement des sociétés, ce qui pose tout de suite les questions de l'évolution et de l'Histoire. Or le fond du problème est de définir ou de rechercher, pourquoi ne pas le dire directement, le bonheur tant des individus que des ensembles d'individus. Le problème du salut, terrestre ou éternel, se pose à ces deux niveaux et on peut observer que sa solution, ou du moins les recettes connues pour sa solution, ont toujours cherché à établir une cohérence entre ces deux niveaux. La définition du bonheur individuel correspond toujours à une définition plus générale du bonheur collectif, et inversement les efforts collectifs devraient logiquement tendre à se référer aux aspirations singulières au bonheur. C'est d'ailleurs la raison principale d'être des idéologies d'assurer cette cohérence entre en gros les Lois et la représentation que s'en font les individus par rapport à leurs désirs. Nous avons toujours postulé, cependant, que le sociétal, le collectif, n'allait pas de soi. C'est à dire que rien de prouve, mais alors absolument rien, que l'homme est un être social. Le doute sur une telle définition provient du fait même qu'elle surgit dans une humanité déjà depuis longtemps socialisée. Aristote, l'homme qui fait dériver la société de la famille, écrit de l'intérieur d'une société, et d'une société extrêmement structurée, où la Loi est plus qu'une chose commune, elle est une création commune continuée selon les canons de la démocratie. Un tel doute pose par conséquent la question la plus redoutable de toutes : est-il possible d'harmoniser le désir singulier et la vie en société autrement que selon une morale strictement répressive, un peu comme l'affirme Hobbes.
Postuler que l'homme est naturellement bon ou bien le contraire ne change rien aux difficultés que soulève le doute sur la possibilité même pour l'homme de vivre collectivement. Car le doute provient de la différence irréductible à mon sens entre la situation singulière et la situation collective ou sociale. Les Chinois sont pour le moins circonspects à ce sujet, qui ne sont pas convaincus, ni du côté taoïste ni du côté confucéen, que la socialité soit réellement jouable autrement qu'avec une extrême prudence. Le principe du rite, colonne vertébrale de la philosophie de Confucius, ne s'applique pas seulement à la vie en commun, il est aussi la recette du bonheur individuel et nous reviendrons sur cet aspect de la vie subjective, ou de cette possibilité qui finalement s'avère dans notre époque comme ce que le " on " adopte le plus fréquemment sans se poser de questions, par une contrainte qui provient de ce dont nous allons parler maintenant, la présence et le vécu de la présence.
La présence est ce à quoi est confronté l'individu dans son existence diurne et nocturne, le rêve se déclinant pour le sujet exactement de la même manière que la présence d'une réalité in concreto comme disaient les scolastiques. Elle est aussi, à un autre degré, la substance de l'Histoire, c'est à dire la matière de ce qui est remémoré, classé, relié par des hypothèses en des logiques évolutives ou pas, bref évaluée en termes de bonheur collectif vécu ou pas par les sociétés passées. En fonction de quoi, les historiens s'installent pour ainsi dire malgré eux dans la tendance à évaluer les modes d'acquisition de ce bonheur pour le futur. Ca donne les utopies ou bien des théories du progrès, ou encore une dénégation de toute évolution, c'est à dire l'absence de destin. Quel est alors le problème ? Il est simple : dans la perspective constante du temps qui vient, un temps déjà mesuré selon un conditionnement précis, comment concevoir l'usage de ce temps en vue du meilleur rendement possible en termes de bonheur ?
Comme nous l'avons suggéré tout à l'heure, le rite, individuel ou collectif, est une manière d'introduire une cohérence dans la succession des phases du temps prévu, la journée, la semaine, etc… Mais, pourquoi un rite ? Le rite, si l'on y réfléchit bien, se présente comme une économie de l'usage du temps, autrement dit une économie entre périodes qualifiées par rapport, toujours, à la définition et à la gestion du bonheur personnel. Or, la nécessité d'une économie implique rigoureusement celle de l'existence d'une pénurie : si le bonheur était le produit spontané et permanent de la présence, c'est à dire de l'écoulement du temps individuel et collectif, il n'y aurait aucune nécessité de considérer cet écoulement selon une économie, c'est à dire un calcul ou une gestion de situations différentes. C'est au contraire parce qu'il se creuse des sortes de trous dans la présence heureuse, dans l'acceptation immédiate de tous les événements qui se déroulent dans le temps, que le sujet ou la société sont contraints de planifier une économie de l'être dans le temps. Une économie signifie concrètement en ce qui nous occupe ici, une répartition des quantités de valeurs selon un déroulement fixe : de telle et telle heure à telle et telle heure je souffre, dans telle autre période je me repose, je jouis, je décide d'ouvrir le temps à la liberté d'être présent comme je l'entends. Le rite vient en quelque sorte enrober cette planification, lui donner un rythme dont le respect assure précisément l'équilibre économique entre les qualités de vécu de telle sorte que le vécu global soit supportable et que les passerelles entre les périodes de qualités différentes soient assurées minutes après minutes.
Le sentiment de crise domine et a dominé toute l'histoire occidentale depuis son origine repérable, c'est à dire depuis la naissance de l'historiographie et de l'histoire en tant que telle. Ce sentiment est traité par les philosophes et les penseurs en général tantôt du point de vue ontogénétique, tantôt du point de vue phylogénétique, la religion, elle, se contentant de s'intéresser au fantasme d'une autre existence radicalement différente de l'existence in concreto et au bonheur qui y est ou non lié. En gros, cette crise repose sur le constat d'une différence entre la réalité et le désir, c'est à dire d'une difficulté à recevoir la présence sur le mode le plus parfait du bonheur, quelles que soient les conditions in concreto. Pour gérer cette difficulté les différentes philosophies ont donné des recettes qui vont de l'assomption du malheur considéré comme essence de la réalité, en gros toutes les pensées qui procèdent du stoïcisme et donc aussi les religions, à des rites savants, c'est à dire économiques, qui établissent des normes de comportement qui visent un équilibre entre les vécus, équilibre qui donne le meilleur rendement en termes de bonheur général. Les Epicuriens et les matérialistes en général, engagent l'individu à profiter de tous les instruments que la nature a mis à leur disposition pour jouir, en évitant les exagérations qui pourraient compromettre à terme cette jouissance elle-même. Mais il apparaît tout de suite qu'une telle vision intègre aussi la conscience d'une crise, d'une pénurie ou d'un désaccord entre l'être existant et la présence qu'il vit.
L'Occident mais surtout l'Orient a aussi produit des pensées de la possibilité du bonheur absolu, mais d'un bonheur qui n'est jamais le produit d'une relation immédiate avec le présent, mais d'une stratégie comportementale et spirituelle qui conduit, in fine, au bonheur. De Spinoza aux bouddhistes, il y a cette idée qu'il est possible d'acquérir une sagesse qui porte en elle le secret du bonheur. Pour Spinoza, comme en définitive pour tous les philosophes de la Raison, le bonheur est un état spirituel qui permet de passer outre les souffrances infligées par des périodes de présent qui sont en désaccord avec le désir spontané du sujet ou de la société. Pour les orientaux, il faut non seulement exercer l'esprit et le munir du concept, mais il faut aussi éduquer le corps afin qu'il trouve une sorte de place précise dans la présence in concreto quel que soit l'aspect sous lequel il se présente.
Enfin, dans la pensée confuse commune, mais dont aucune philosophie ne se distingue fondamentalement, la crise comporte une origine, une cause, et une fin qui se présente comme un retour dans la situation qui prévaut avant cette cause ou cette origine. Cette pensée invoque alors l'existence d'un accident historique qui a brisé l'homogénéité de la présence, détruit la fusion permanente entre le désir et le monde, et elle pose une moralité de l'eschatologie, c'est à dire aussi bien une éthique individuelle qu'une attitude sociale qui conduise volontairement les hommes à la situation ante, c'est à dire au bonheur fusionnel qui unit spontanément l'être humain à l'Être en tant que tel, Être qui se présente comme l'attribut universel de toute chose. Karl Marx pose l'Histoire, ou plutôt ce qu'il appelle prudemment la préhistoire humaine, comme une période de lutte au bout de laquelle l'homme recouvre ce qui a aliéné dans cette même histoire, à savoir sa liberté. Cette pensée n'est pas qualitativement différente de celle de tout l'idéalisme allemand et même au-delà jusqu'à Nietzsche ou Heidegger, quoi qu'on en dise.
Notre position dans ce débat est légèrement décalée. Nous reconnaissons l'existence d'un trou, d'une crise existentielle présente dans les constats de l'Antiquité et dans tout ce qui se dit et se pense aujourd'hui-même. Nous pensons même avec les idéalistes allemands, dans la forme marxienne, que ce trou s'est élargi et ce cesse de s'élargir : que la présence se dilue de plus en plus essentiellement dans des circonstances. Ce qui devrait être présence devient une pure contingence de l'existence elle-même, une circonstance de l'action et de l'accomplissement des désirs et des volitions humaines, mais non plus le sujet lui-même de la pensée et donc de l'action. C'est ce qu'on appelle l'aliénation, c'est à dire la délégation ou la cession d'une partie de soi en vue d'un but lointain, d'un report de jouissance ou de bonheur nécessaire et conditionné par l'Histoire elle-même (par exemple des rapports de production), ou par l'individu dans des placements différés de jouissance. Ce que nous affirmons, en revanche, contre toutes les pensées considérées jusqu'ici, c'est que l'aliénation a une origine historique, précisément délibérée, qui se situe dans le choix opéré à un moment du temps passé par les hommes de se rassembler en société. Pour raccourcir, disons que le sociétal implique l'aliénation. Ce qui signifie aussi que cette aliénation (les trous, la crise etc..) non seulement a pris son essor lors du choix primitif, mais que l'universalisation du sociétal n'a pas cessé d'agrandir ce trou, de refondre le présent en pure circonstance et d'approfondir l'abîme qui sépare les hommes de leur monde réel. D'où un résultat proprement catastrophique, ce que Georg Lucacks, philosophe marxiste hongrois, a nommé la réification. Ce mot, ou ce concept, se comprend du point de vue des marxistes, comme la transformation de la relation sujet-objet en relation marchandise-marchandise, car en même temps que le temps aliéné devient uniformément du temps déterminé par les rapports de production, l'homme s'identifie à la marchandise, devient une marchandise qui entretient des relations avec un monde de marchandises. C'est pourquoi la crise finale, la révolution, passe par la crise de la marchandise elle-même, à savoir le déclin du capitalisme qui aurait, selon la thèse marxiste, accomplit son cycle de transformation du monde, comme l'Esprit absolu de Hegel accomplit sa sortie de l'Être dans l'Histoire et son retour sous la forme du Savoir Absolu
Cela, c'est pour nous de la métaphysique, en tout points identique à n'importe quelle religion. La plupart des marxistes pensent aujourd'hui se dédouaner de l'échec de l'URSS précisément en avançant l'idée que Lénine et toute l'histoire de l'Union Soviétique était décalée par rapport à la maturation du capitalisme. Au lieu de remettre en question la faute de Lénine qui a consisté principalement à reproduire l'Etat hégélien en tant que dictature du prolétariat, les Althussériens entre-autres s'en remettent à l'analyse historique du Capital et au caractère inéluctable de la décomposition finale du capitalisme, programmée à la fois par la disparition forcée du travail humain et donc du profit issu de la plus-value et à la fois par la diminution tendancielle continue du taux de ce profit. Simple à comprendre : lorsqu'il sera devenu impossible de produire de la plus-value par l'exploitation de la matière humaine, par le travail, le profit s'absentera définitivement du fonctionnement global de l'économie. Ce schéma serait juste si l'objet du capitalisme était purement économique, mais sur le fond même un tel dénouement ne changerait rien parce que nous entrerions dans ce cas dans un monde de fonctionnement aveugle de marchandise à marchandise. Dans un monde-marché, le rêve d'Adam Smith, l'homme en tant que conscience et désir ne peut pas coexister avec la logique totalitaire de la marchandise car il ne serait que de la marchandise et serait par là condamné à résumer toute son action et toute sa présence dans le monde à l'échange de ce qu'il représenterait en tant que marchandise contre d'autres marchandises. D'une certaine manière, et dans les sociétés les plus " avancées ", nous vivons déjà dans un monde de ce type. Mais le marché est encore loin en tant que totalité homogène, et l'homme conserve une sorte de liberté marginale ou interstitielle qui lui permet de s'illusionner sur lui-même. L'illusion est de toute façon maîtresse, dans un sens ou dans un autre, que ce soit l'eschatologie métaphysique et religieuse, ou que ce soit cette nouvelle forme de l'hédonisme qui porte le nom de consumérisme. En notant au passage que l'hédonisme est une philosophie tragique qui pose le monde comme une vallée de larmes dans laquelle n'existe qu'une seule consolation, le plaisir, avec toutes ses limitations physiologiques et donc temporelles. L'hédoniste pur est un homme qui se suicide lentement, argument de poids pour la théorie bourgeoise de Freud sur la nécessité du report du plaisir au profit du principe de réalité, c'est à dire du refoulement.
Mais ne nous éloignons pas de notre sujet, la présence. Comment pouvons-nous illustrer de manière simple comment se présente ce problème pour nous. De la manière suivante : le plus simple d'abord est de quantifier, dans une journée, par exemple, le temps qui ne nous appartient pas, ou plus. Puis on fait la même opération avec le temps qui nous appartient en partie et enfin on tente de repérer les périodes où nous sommes presque certain de maîtriser le temps, et donc la présence. Ce qui signifie aussi que nous trouvons à ce moment-là la présence elle-même puisque nous avons cherché à intégrer ce temps dit " libre ", le temps dans lequel je dispose de ma disposition à l'égard du monde. Ensuite il reste à se demander comment faire cohabiter ces différentes phases de la journée (cette étude ou cette planification se fera ensuite au plan de l'année entière, puis de la carrière et enfin de la vie), c'est à dire comment introduire une continuité qui permette à la conscience de gérer toutes les oppositions qui se révèlent à l'occasion de la succession de ces états de conscience. La réponse paraît sinon simple du moins rigoureusement déterminée : les phases doivent s'enchaîner selon la logique dominante de la liberté et le sujet doit être en mesure de s'illusionner, de se leurrer en permanence sur la maîtrise globale qu'il a de son temps en général, même s'il croit pouvoir désigner telle ou telle période comme une période de liberté, ou comme on dit, de loisir. La société, ou plutôt le sociétal, offre, de ce point de vue, plusieurs moyens à l'individu pour lui permettre de se réfugier derrière ces apparences. En gros la société capitaliste avancée s'est dotée d'un modèle politique qui fait la part des choses entre une véritable démocratie et une oligarchie plus ou moins contrôlée. Cela permet au citoyen de dégager sa responsabilité d'homme libre par rapport aux entorses que les lois de cette démocratie pourraient entraîner à sa propre liberté. De même, ce sujet a le pouvoir de signer ses engagements pour les phases qui ne lui appartiennent pas en propre : dans la société contractuelle, le travailleur ou le salarié signe un contrat, dont le respect le dégage des réalités sous-jacentes à la période dans laquelle il ne s'appartient plus du point de vue de son désir immédiat. L'honneur est sauf, et la possibilité de la rébellion demeure toujours une possibilité constitutionnelle. Quel luxe ! Pour le reste, le capitalisme offre toute une panoplie de " libertés préfabriquées ", de marchandises qui permettent à l'individu de mimer, au moins par une sorte de passivité consommatrice, un état de liberté personnelle. Dans le meilleur des cas, l'homme peut introduire des coupures radicales dans son temps aliéné et se réfugier dans certaines pratiques ou certaines réalités dans lesquelles il semble disposer de lui-même.
Donnons des exemples. Le spectacle est une marchandise qui a pour fonction d'abolir le problème même du présent puisqu'il s'y substitue totalement. Prenez un scénario de film, il n'est constitué en général que par une représentation de ces différentes " époques " du destin d'un homme. Ce qui change tout par rapport au vécu in concreto, c'est que le metteur en scène s'est chargé de gérer les transitions de telle manière que le temps devient homogène, et au résultat c'est le présent du spectateur qui devient lui-même homogène et sans trous. S'il a affaire à un œuvre d'art, à un chef d'œuvre, alors l'identification est tellement forte que la magie est totale, car l'œuvre d'art ne fait que représentifier du présent. Un bon film est toujours forcément hyper réaliste et fait appel à une anamnèse permanente du spectateur de son propre vécu, même s'il traite des sujets totalement fantastiques ou imaginaires. Un film est un morceau de présent à double usage : il comble le trou du présent du spectateur en lui offrant un autre présent travaillé de telle sorte que le problème des transitions et de la gestion n'est plus du ressort du spectateur, et d'autre part il se présente bien comme le présent-même du spectateur, un présent fort, librement choisi. En fait, si un individu parvient à bien ritualiser sa propre existence, à trouver les transitions entre les périodes variées de sa vie selon un bon rythme, il peut faire ressembler toute sa vie à un bon film, et c'est au mieux ce que l'on peut ambitionner de nos jours si l'on ne veut pas sombrer dans la mélancolie, l'alcool, le suicide ou la folie. Les bons rituels sont ceux qui reposent non pas sur la consommation passive de marchandises de cette sorte, mais ceux qui impliquent des activités pratiques qui mobilisent toute la personne, le corps, l'esprit, certaines vertus comme le courage. Les citoyens les plus sereins sont ceux qui planifient en permanence l'excursion du dimanche, la croisière de l'été ou encore les sauts en parapente du week-end. Ces pratiques peuvent s'apparenter à la passion précisément parce qu'elle permettent au sujet de s'illusionner sur sa propre créativité et sur sa propre participation au présent. Mais dans les deux cas il n'est jamais question que d'efficacité sociale et jamais de véritable liberté.
Je reviendrai sur ce sujet, qui n'est que la méditation préparatoire au dernier chapitre de mon ouvrage en cours, Tolma ou l'Usure du Temps. Bonsoir.
Samedi 11 janvier 2003
Présent ! Vous n'avez jamais pensé que l'on pourrait utiliser des souris expérimentales en philosophie ? Hé bien vous vous trompiez et je m'en vais vous le démontrer. Rendez vous dans l'un de ces magasins animaliers où vous ferez l'acquisition d'une petite souris de la couleur que vous voudrez. Vous vous munirez également d'une cage de bonne dimension et de tous les objets qu'on y place habituellement pour rendre la vie de cette pauvre petite bête possible et, dans notre imagination seulement, attrayante. Nourrissez la bien et faites en sorte qu'elle soit abreuvée en permanence de bonne eau fraîche, bref, soyez bon pour cet animal que vous allez désormais observer à des fins ontologiques.
L'observation devra durer environ six mois, à la condition que votre souris survive, ce qui n'est pas certain, et ce qui engage d'ailleurs à en prendre deux pour avoir une plus grande certitude de durée de l'expérience. De quoi est-il ici question et que pouvons-nous bien observer qui nous concerne nous les humains ? En fait, rien. Rien sinon que l'observation neutre du comportement de ce petit animal va nous permettre de spéculer, et non pas sur les thèmes habituels du struggle for life ou de l'adaptabilité des espèces ou je ne sais encore quoi sur le bonheur des animaux d'homme(estiques), comme disait Lacan, mais sur la présence. Oui, c'est bien ce sujet tabou que nous nous autoriserons de traiter à partir du regard que nous allons porter sur un petit animal qui n'y peut rien. Double scandale, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La première observation que nous allons faire, disons la base ou le fondement même de l'expérience, c'est que la mise en place du dispositif correspond à peu de chose près à la naissance de l'animal, étant donné le changement radical de conditions dans lesquels il survit. En effet, à peine né, le petit animal stationne en général pendant quelques jours au milieu d'une tribu d'autres souris, dans un espace vaste et généralement conçu selon une science de l'élevage que nous ne nous permettrons pas de critiquer ici. En fait, cette base est la nécessité pour la souris de se reconstruire une existence sur la base d'un tout nouvel environnement et selon le caprice d'un humain qui est loin d'être un spécialiste de l'élevage de souris et qui n'est qu'un témoin impuissant d'un laisser-vivre aléatoire.
A partir de ce fondement, on observera chez l'animal une extraordinaire activité qui va consister en une série d'actes dont on ne comprendra pas immédiatement les raisons ou les causes comme on voudra. Car le problème que l'on imagine à la place de la souris s'appelle la mise en place de son existence. Nous disons mise en place car nous en avons le droit après avoir constaté des semaines plus tard, que cette activité fébrile du début s'est calmée et que la souris s'est pour ainsi dire construit un environnement propre et un rite correspondant à cet environnement. Nous dirons donc pour cette période initiale que la souris, plongée dans l'inconnu d'une situation nouvelle, se démène en vue de certaines fins. Quelles sont ces fins ? Nous n'en savons rien, mais l'observation permet néanmoins d'arriver à certaines conclusions. La première est que l'animal, fatigué de chercher naturellement la sortie de la cage, a décidé de s'installer pour aménager son existence carcérale. Encore que nous noterons que le comportement ultérieur de la souris montre que la recherche de la sortie, c'est à dire de la liberté, restera toujours présente, même s'il n'est pas facile d'en déceler les symptômes, tant cet animal est capable de faire état d'intelligence par rapport à son geôlier. Cette installation passe par des quantités de modifications expérimentales qui concernent d'abord l'aménagement de l'espace. On observera pratiquement à coup sûr que l'emplacement primitif de la maisonnette en plastique, du baquet de nourriture et des diverses babioles qui traînent dans la cage vont changer de place sans cesse. Que la maisonnette va tantôt perdre son toit démontable, tantôt le récupérer selon une logique que nous attribuerons d'abord naïvement à la recherche d'un équilibre thermique, puis, las de constater que ça ne marche pas, que nous cesserons de questionner jusqu'à ce que la maisonnette finisse par conserver une forme permanente. Encore qu'il faille garder à l'esprit que certains changements que nous ne pourrons pas identifier pourront venir à chaque moment bousculer cet équilibre que nous avions cru définitif. Pourtant, la souris va finir par exister d'une manière relativement sereine et nous finirons par posséder certaines clefs de lecture de son comportement, des clefs qui ne vont pas très loin dans l'explication, mais qui permettent au moins de prévoir un certain déroulement devenu traditionnel ou classique de l'animal.
A ce moment-là, lorsque la souris ne vous réservera plus aucune surprise, ou presque, car la souris est un animal tout à fait hors du commun (comme tous les animaux…) et la prévisibilité tient essentiellement aux conditions que nous lui faisons, bien entendu, à ce moment-là s'achève pratiquement l'expérience. A ce moment-là nous pouvons commencer à spéculer. Ce qui nous intéresse, c'est l'existence d'une dynamique ou d'un processus qui conduit la souris à chercher par elle-même de nouvelles conditions destinées à lisser son existence, c'est à dire à y introduire une certaine continuité concrètement observable. Par exemple, on pourra constater une certaine exactitude dans la pratique de l'exercice musculaire que s'impose l'animal dans la petite roue qu'il fait tourner en courant sur place. Ce qui nous fait immédiatement penser au comportement des humains observable dans l'univers carcéral. Bref, la souris finit par trouver une sorte d'homéostase existentielle qui nous servira de reflet pour penser notre propre comportement dans cette même existence. En examinant attentivement la structure de l'activité de la souris, ses itinéraires et ses horaires, on se met à penser à nous-mêmes et à une bien étrange ressemblance avec le petit animal.
Non, ne croyez pas que je vais me livrer à une quelconque comparaison ou évaluation comparative de l'homme et de l'animal. Pas du tout. Seulement, dans cette expérience nous sommes situés à une certaine place, un certain dehors à partir duquel nous pouvons nous voir nous-mêmes. En spéculant sur les causes ou les raisons de chaque étape du processus, ou du moins des étapes repérables et tant s'en faut qu'elles le soient toutes, on découvre des analogies avec notre propre comportement qui semblent exhiber de manière tout à fait identique la volonté de lisser le comportement, de le rendre rituel et de lui donner une sorte d'automatisme. La psychologie a tout dit sur les habitudes et toutes ces sortes de choses, mais nous ne parlons décidément pas de cela. Ce qui nous frappe, c'est que si nous nous observons nous-mêmes à l'occasion d'un changement de situation aussi intégral que celui que subit un jour cette souris, nous découvrons qu'au bout d'une certaine époque, nous trouvons comme la souris une sorte d'itinéraire de la journée, de programme rituel quasi automatique qui finit par nous donner satisfaction et auquel nous nous arrêtons presque maladivement.
Il ne s'agit ici pas moins que de ce que nous avons appelé plus haut une économie de la présence. De minutes en minutes, car les choses ne vont pas n'importe comment, mais alors pas du tout, les gestes finissent par s'enchaîner, même et surtout lorsque, contrairement aux assertions des psychologues-philosophes du dix-neuvième siècle, nous restons conscients de chacune des étapes de ce procès, de manière extrêmement soigneuse, quasi cultuelle : dès notre réveil nous entamons notre culte de la présence, rite rigoureux et qui ne souffre pas beaucoup de fantaisie, ou du moins qui finit par perdre toute fantaisie lorsque le soubassement fondamental de la survie, de la nécessité économique, est définitivement en place. Bien évidemment que l'être humain jeune semble posséder une plus grande marge de manœuvre et une plus grande place aux événements aléatoires. Le romantisme de la jeunesse est tout entier dans ce refus d'insérer l'existence dans un rite, mais il faut noter que ce refus provient toujours du fait qu'il s'agit d'un rite imposé. Comme la souris, le jeune humain cherche d'abord la porte de sortie de la cage, il rue dans les brancards, puis, lorsque les réalités s'imposent, il se résigne à adopter un rituel qui sociologiquement se trouve rarement très différent de celui de la plupart de ses pareils. Quelques individus marginaux résistent mieux à l'enrobement immédiat, au bétonnage à prise rapide de l'existence, et ce sont ceux-là en général qui, parvenus à une certaine indépendance lorsqu'ils on réussi à survivre, se créé eux-mêmes des rites qui s'avèrent infiniment plus scrupuleusement respectés que ceux de la masse. La raison de ce phénomène est aisé à comprendre car ces individus ont fait une recherche entièrement personnelle, ou du moins beaucoup plus personnelle que la plupart, et en ont tiré des conclusions beaucoup plus efficaces en regard de la finalité qui consiste à lisser le vécu, la présence des choses et des êtres tout au long du temps. Le marginal est comme on dit malin parce qu'il s'est heurté plus longtemps à des souffrances dont il connaît parfaitement l'étiologie. L'hypocondriaque est en général un de ces marginaux dont le corps ne comprend pas les conséquences du refus persistant du sujet mental à se plier aux exigences de l'heure et qui donc proteste en permanence contre le traitement qui lui est ainsi infligé.
La présence. Car il s'agit bien de cela, la présence. Dès que nous ouvrons les yeux, le matin, le monde apparaît dans son habit personnel : les sensations actuelles du corps, la tonalité de la lumière selon la saison, l'humeur des autres et la sienne propre, les nouveautés événementielles, bref toute une esthétique brutale qu'il faut gérer immédiatement pour que les différences qui semblent vouloir s'imposer avec les conditions moyennes du rite ne perturbent pas la conscience de l'accomplissement normal du rite. Comprenons-nous bien : chaque journée possède sa singularité, ses déterminités particulières et ses conditions, des conditions qui parfois s'opposent violemment au culte normal. Mais c'est justement la lutte pour la continuité lisse du vécu qui caractérise l'improvisation à laquelle on est contraint. Ce culte, par ailleurs, ne peut en aucun cas se permettre l'automaticité aveugle sous peine de tomber à chaque moment dans l'accident : la conscience doit rester le pilote absolu dans la plus habituelle des habitudes, sinon l'habitude ne peut absolument pas produire son effet. Ca me rappelle une certaine dissertation. Or, ce qui est cause n'est pas un objet neutre, une œuvre ou un produit qui s'appellerait le Rite, non, ce qui est en cause est notre bonheur, bonheur qui dépend précisément de notre éveil à l'intérieur du sommeil de l'habitude. Nous ne parvenons à lisser réellement notre vécu, notre existence, que si nous le prenons à bras le corps à partir du moment où nous avons pris les décisions primordiales, c'est à dire la ligne de conduite qui est le rite proprement dit. Si je ne m'efforce pas de me lever à tel moment exact de la journée, je m'interdis de réaliser ce qui appartient à ce moment précis, et ce manquement va produire des effets qui contiennent le risque de se cumuler et de perturber pour de bon le déroulement optimum de toute la journée, et de bien plus. Je pense notamment au baiser que je dois à ma compagne sur le pas de la porte, avant qu'elle ne quitte le foyer pour son travail, baiser qui ne saurait en aucun cas manquer au déroulement de ma relation affective et effective avec ma compagne. Si donc, les douleurs de l'arthrose souhaitent me clouer au lit, en me susurrant l'innocuité ou l'insignifiance de ce manquement, je dois les réprimer durement, et leur enseigner à elles-mêmes la hiérarchie des valeurs. Vous me direz que mon bonheur va en souffrir et je devrais bien reconnaître que sur le moment mon corps va émettre quelques protestations, mais ces protestations ne sont rien, elles ne sont en rien comparables à ce que signifie à ce moment-là de la journée, la présence évanescente de ma compagne. L'accompagnement vers son absence va fermer pour ainsi dire immédiatement la blessure qu'ouvre l'effort qui m'est imposé à l'encontre de mes muscles douloureux.
Dans le présent présent, je dois aller achever la confection de ma choucroute, et par conséquent vous abandonner à vos réflexions. Nous reviendrons encore là-dessus, car j'ai l'impression désagréable d'avoir essentiellement bavardé. Comme d'habitude. A demain.
Dimanche 12 janvier 2003
Ouaff, que c'est mauvais ! Bon enfin pas si catastrophique que cela, la chose est difficile, ne l'oublions pas. Vous avez compris ce dont il était question : nous tentons de nous faufiler en quelque sorte à travers les arcanes de la présence. Celles-ci se présentent, reprenons une vieille image, comme un film, c'est à dire comme une succession de plans de présence qui s'enchaînent, plus ou moins bien. Un bon filé (mouvement de caméra qui suit l'objet de manière panoramique) sur un train ou un véhicule quelconque qui passe, vous donnera cette étrange et forte impression de la confusion entre arrivée et départ, confusion instantanée qui donne une cohérence ou, si on veut, une sorte de compacité à la succession des instants que vous vivez sur l'écran. En l'occurrence, ce filé annule symboliquement le mouvement, il le pacifie tout en se plongeant au cœur même de la dynamique de l'événement, et en général il se termine par un plan fixe du véhicule au loin, alors que l'on ne perçoit pratiquement plus son mouvement réel. L'existence pour nous se présente exactement comme cette machine qui enregistre des images sur de la pellicule. De plus il semblerait que l'on puisse déceler, après réflexion, les mêmes variations de qualité des images que déroule le temps autour de nous. Tantôt elles sont totalement surexposées ou au contraire tellement dépourvue de lumière, et dans ce cas il n'y a pas d'image, il ne reste qu'un écran blanc ou noir. Bref, l'existence est formée de " rush ", des enregistrement bruts qui sont de qualité plus ou moins précise, plus ou moins parfaits dans leur ressemblance avec les instants vécus. Ce matériel livré par les sens et la perception est à la fois la source immédiate du bonheur ou de son contraire, et à la fois le matériau qui va devenir la matière première de la mémoire. L'exemple scolaire pour montrer les imperfections de ces sensations ou de ces perceptions est celui qui ressortit au témoignage lors d'un accident ou d'un événement violent. On sait que la mémoire trahit la plupart du temps les témoins les plus directs.
La cause de cette hétérogénéité de la qualité des instants vécus et transférés dans la mémoire peut se définir comme l'hétérogénéité de la qualité des actes de conscience qui affrontent les présents qui défilent. En simplifiant le plus possible, on peut discerner trois états de conscience qui vont donner des résultats totalement différents sur tous les plans. Le premier est tout simplement son absence, l'absence de la conscience à l'instant, sa distraction absolue : le témoin a vu la scène, mais il en était absent car il pensait à autre chose, était paralysé par la peur, etc… Le deuxième est une conscience simplement présente, comme un objectif de caméra, moteur en marche, le témoin à tout vu, mais l'enregistrement n'est pas bon parce qu'il n'a pas eu le temps de focaliser l'appareil sur cette partie du panorama présent ni de régler la quantité de lumière dont il aura besoin selon l'exposition des choses. Le troisième enfin, est l'état de la conscience averti, préparé d'avance à l'événement et qui n'attend en réalité que les détails pour les classer immédiatement dans sa mémoire. Vous aurez compris que ce scénario s'applique à la lettre à tous les vécus qui se succèdent dans l'existence. Nous avons dit plus haut " sur tous les plans ", et cette précision est essentielle, car on pourrait avoir l'impression ici qu'on s'amuse à faire une sorte de phénoménologie de la perception tout à fait banale et qui stagne, à vrai dire, dans des lieux communs archi connus par tous ceux qui ont fait de ces phénoménologies leur métier. Sur tous les plans signifie d'abord qu'il ne s'agit pas, dans le vécu (faute d'un concept simple, nous continuerons d'utiliser celui-ci même s'il n'a pas grande signification en dehors justement de la science de Husserl.
Mais cette diversité des plans de l'expérience indique surtout que tout en dépend. A savoir qu'il n'est pas question ici de se contenter d'illustrer le rapport simple de la conscience percevante avec le monde des objets et d'analyser les mécanismes et les fonctionnements. Il y va, en réalité, de tout le reste aussi, et à commencer par le bonheur. En faisant retour à ce que nous avons décrit comme rite quotidien, et à son rôle réel dans la formation de la satisfaction ou de son contraire, nous allons maintenant coller le tout ensemble : d'abord en répétant que le rite n'est ni une habitude, ni un cérémoniel vide dont l'effet positif résiderait entièrement dans le soulagement qu'apporte de manière éphémère l'assurance du pouvoir de la répétition, ou encore un protocole qui sert de médiation avec autrui et en particulier avec ses geôliers. Non, le rite, nous l'avons signalé, est un culte actif dont la répétition elle-même fait partie des choix initiaux. Or un culte s'adresse en général à quelqu'un, à une entité transcendante dont nous dépendons partiellement ou totalement. Dieu est l'exemple par excellence, mais nous y viendrons plus tard. A qui donc peut s'adresser un rite personnel, qui ne nous concerne que nous-mêmes et qui, plus il est pur plus il est autonome par rapport à toute transcendance ou à toute maîtrise. Nous parlons ici, comme le fit autrefois Confucius, d'un rite athée, laïc, et qui, si dans ses textes il porte la plupart du temps sur les étiquettes des cours, désigne bien un rite que le sage conseille aux puissants eux-mêmes. Confucius était un conseiller de cour et ses conseils s'adressaient d'abord au monarque afin qu'il en décide et qu'il comprenne l'intérêt qu'il peut retirer de ces conseils.
Nous voulons dire par là que le rite est d'abord affaire personnelle, individuelle dont dépend la satisfaction et le bonheur du sujet qui s'en sert. Comment s'en sert-il ? Voilà la question centrale. Métro, boulot, dodo, tout le monde connaît cela à divers degrés, et tout le monde s'arrange pour régler la synchronisation de la meilleure manière selon une structure rituelle la plus exacte possible. Les événements du jour, qui ne vont guère se distinguer de ceux de la veille, doivent trouver un mode d'écoulement qui permette d'absorber les charges négatives contenues à titre permanents par le destin singulier, disons pour rester modérés, les ennuis habituels d'une carrière médiocre et la " pénibilité " foncière de cette carrière peu ou prou choisie selon un offre aléatoire et des possibilités personnelles hasardeuses. Autrement dit, le rituel doit faire passer la pilule des obligations liées à la survie et aux autres responsabilités qui s'y rattachent, familiales entre-autres. Or cette fonction, ou cet objectif est insuffisant en termes de bonheur, ce serait mélanger les torchons et les serviettes que de limiter le rôle du rite avec cette simple recette destinée à supporter les parties dures ou douloureuses de l'existence. Le rite vise le bonheur, et à ce titre il ne fait aucun tri, il ne se permet pas de porter des jugements définitifs, cela serait d'ailleurs psychologiquement intenable, sur certaines périodes de la journée ou de la vie. Le fait de ritualiser l'existence vise en fait de transformer globalement tout le négatif en positif, de contrecarrer avec assez de puissance les nuisances naturelles de la vie. Et comment cela est-il seulement envisageable ?
C'est ici qu'entre en ligne de bataille l'éveil de la conscience et son degré de mobilisation permanent à l'intérieur même des pires difficultés : il n'existe aucun instant de la vie que la conscience ne puisse dominer afin d'en tirer tout les fruits attendus ou de se détacher des vicissitudes inattendues qui se dressent sur le chemin de la vie individuelle. Cela pourrait s'exprimer ainsi : la conscience doit devenir l'outil principal ou l'arme principale oeuvrant contre le temps, le rattrapant chaque fois qu'il fait mine de s'enfuir, le saisissant à bras le corps quels que soient les traits sous lesquels il se présente à chaque instant. Il faut garder à l'esprit que, quels que soient les similitudes fonctionnelles qui se présentent d'un instant à l'autre, d'une période à l'autre voire de grandes plage de destin, la conscience ne peut pas se permettre de se mettre en veilleuse parce que le temps est aventure, il est le monde qui s'avance vers vous selon sa guise à lui et non pas selon votre obscure désir, besoin ou volonté. Dans ce combat, car c'en est un, la conscience est seule à pouvoir affronter l'impondérable si et tant qu'elle demeure au maximum de son éveil. Ce qui signifie qu'elle est capable de recevoir, d'enregistrer et de prendre des dispositions adéquates à tout moment, exactement comme ce que requiert des situations extrêmes comme par exemple sur un champ de bataille. Pour bien comprendre ce que nous venons de dire, il faut évidemment accepter l'idée d'un monde qui ne se présente jamais deux fois de la même façon, quelles que soient les illusions que l'on peut se faire à ce sujet. A ce point on pourrait mettre en scène les deux penseurs que l'on oppose toujours, et à tort semble-t-il. Parménide et Héraclite illustreraient, selon la tradition, deux visions contradictoires de l'Être, ou de l'existence. Pour l'un le monde est UN, immobile et il demeure intact éternellement. Pour Héraclite, au contraire, jamais un homme ne peut mettre deux fois les pieds dans le même fleuve parce que ce fleuve change à chaque instant. Or cette opposition n'est qu'apparente, car si le monde est bel et bien une sorte de tempête permanente qui ne cesse de se transformer, la conscience, elle, demeure une et immobile, seule mais solide comme une montagne face aux mouvements désordonnés de l'étant, de la réalité. Parménide avait dit, souvenez-vous : Être et penser sont le même. C'est la clef de toute l'affaire. Si l'Être est bien attesté seulement, comme le dit Molla Sadra, par l'existence in concreto des choses, cette attestation se fait dans l'esprit, cette existence porte alors bien son nom puisqu'il s'agit d'une ex-sistance, c'est à dire de quelque chose qui est à l'extérieur, non pas de soi, mais du Je qui n'est que la même chose que le monde à savoir un corps.
Ainsi, la conscience est le véritable lieu de l'Être, ou, pour être plus juste, le seul lieu où l'Être se manifeste à nous les hommes. Aiguiser cette conscience, la rendre d'une absolue vigilance, lui donner le pas sur l'étant de manière puissante et efficace, c'est le seul moyen de lutter contre les effets des perturbations aléatoires de la temporalité sur nous-mêmes. Pour aller vite dans ce qui n'est qu'une méditation préparatoire, je le répète, je dirai que l'emprise de la conscience peut être telle, lorsqu'elle est cultivée, c'est à dire élevée au plan du culte, qu'elle peut délivrer instant par instant le bonheur lui-même. A quel type de divertissement préférons-nous nous livrer lorsque l'ennui devient trop lourd ? Au spectacle, à la fiction qui prétend inventer un monde imaginaire dans lequel la temporalité est scénarisée pour plaire, alors que le monde lui-même est la plus prodigieuse des scènes et que les événements qui s'y déroulent, du plus petit au plus immense, sont infiniment plus captivants que la plus éminente des tragédies. Ce que je dis ici ne correspond à nul anathème sur la fiction et les artistes, il ne fait que révéler que le monde lyrique n'est qu'une prothèse qui vient soulager des consciences faibles et impuissantes à décrypter l'aventure quotidienne, à vivre pleinement la symphonie du temps qui passe, là sous nos yeux à chaque instant. Voyez : je me sens envahi par une sensation de sommeil qui m'indique que mon sac à mots est vide et que derrière moi, dans mon lit, m'attend un délicieux repos et quelques moelleux oreillers. Sans parler du reste.
Nous sommes loin d'en avoir fini de ce bavardage. A demain. Fidèle lecteur. Si tu existes !
Lundi 13 janvier 2003
Poursuivons. Je fais une légère entorse au protocole car nous sommes encore dimanche 12, ce sera mon premier manquement à l'exactitude de ce journal, mais je pense que je ne terminerai pas cette cession ce soir, par conséquent le texte sera à cheval sur deux jours, ce qui n'est pas gravissime. N'est-ce-pas ?
Pas de réponse. Donc nous étions parvenus à une sorte de plotinisme moderne qui semble intégrer la dimension de la contemplation dans le quotidien afin de le rendre passionnant. Il y a de ça, je le reconnais, comme je reconnais ce dernier mot d'une certaine métaphysique qui cherche et semble trouver le bonheur dans la réalité toute crue, sans ajouts, sans salut, sans fiction artistique ni politique, cette dernière étant la seule réellement dangereuse. Cela ne signifie nullement que je sois de ces gens qui, sous prétexte de ne pas faire de politique, se trouvent toujours dans les moments décisifs du côté du plus fort. Loin de là. Au contraire, l'aventure politique appartient aux événements présents au même titre que la température ou les nuances du ciel. Ici, nous rencontrons cependant une difficulté réelle, je dirais presque LA difficulté qui traverse, parfois masquée, toute la métaphysique, toute la pensée et tous les soucis des humains depuis, sans doute, qu'ils existent. Cette difficulté est le problème de la morale qu'il semble a priori impossible de traiter autrement qu'en déléguant la solution à une transcendance législatrice, c'est à dire toujours et encore Dieu et les lois contenues, paraît-il dans la Révélation. Je me demande pourquoi je mets une majuscule à révélation, puisque je ne crois en rien à cette fumisterie, ou plutôt aux fumistes qui tentent de nous faire croire qu'elle provient non pas de la sagesse humaine mais d'un lointain ciel des idées ou du divin. Deux choses me désespèrent vraiment, au point parfois de faire sourdre chez moi une réelle fatigue de vivre : les religions et la consommation aveugle. Freud s'est intéressé au Trieb, à la pulsion religieuse et il en a parlé avec beaucoup de bon sens, mais il a totalement ignoré, à ma connaissance, ce phénomène de l'automatisme du conformisme des mœurs. Son siècle, les siècles dans lesquels il a vécu étaient loin d'ignorer la standardisation des modes d'existence, l'industrialisation des comportements qui connaissaient alors leur premier boom. La visite de son domicile de Vienne montre d'ailleurs que le bon docteur avait des goûts en parfait accord avec son époque, c'est à dire lamentables. En fait, je pense qu'il s'en fichait d'une certaine manière, comme je suis contraint de le faire aujourd'hui, et qu'il se réfugiait, comme moi, dans la contemplation de quelques bibelots antiques ou primitifs pour faire pièce à ce délirant décor de nos vies contemporaines.
Pardon pour la digression, mais elle ne sera pas inutile, car la conscience ne se contente pas de contempler le monde : elle intègre des données afin d'agir dans ce monde selon son jugement. Au cours de l'ontogénèse, cette conscience a dû faire face à des réalités a priori étrangères à sa pureté originelle, à son degré zéro de connivence avec le monde dans lequel elle naît. Pensons un instant à la situation réelle de l'humain commençant, de l'enfant et du jeune. Pensons aux tâches immenses et innombrables qui leur incombent et la disproportion entre leurs forces et les moyens dont ils disposent et la complexité de ce qu'ils ont réellement à mettre en œuvre, nolens volens. Pour en prendre toute la mesure, rappelons qu'un adulte vit dans le confort relatif de ses habitudes, dans un monde organisé dont nous avons donné plus haut une image assez complète. La nécessité pour lui de déployer des investissements nouveaux d'efforts, de volonté et d'imagination est relativement faible rapportée à celle à laquelle les apprentis de l'existence sont confrontés. Un enfant a tout à apprendre, depuis la gestion de son corps dans l'espace, l'identification des itinéraires probables de sa quotidienneté, toute la gamme des habitudes triviales les plus simples et les plus complexes, mais aussi tous les jugements relatifs au comportement moral. A tout cela il faut ajouter dans notre époque, les savoirs et savoir-faire qui portent sur l'avenir. Incroyable ! En passant, je déplore de la manière la plus énergique la tendance française d'abaisser chaque année davantage l'âge des obligations pédagogiques. Dans quelques années, on peut prévoir qu'il sera exigé d'un bébé de deux ans de savoir lire et écrire ! Sans blague ! Mais que va-t-il rester d'énergie à ces êtres à peine nés pour accomplir les tâches dont nous n'avons fait qu'esquisser les principaux points plus haut ? Et cela dans un monde qui, loin de se simplifier, se complexifie d'heures en heures.
Je vois dans ce processus la plus patente des preuves d'un retour de l'histoire, disons d'un retour en arrière sur des positions où la différence entre jeune humain et adulte était à peine discernable. Ceux qui ont passé du temps dans les zones les plus retirées de l'Afrique, par exemple, ont pu constater qu'en gros l'âge adulte d'un jeune Africain commence aux alentours de trois ans, moment où sa mère le dépose définitivement par-terre, l'abandonnant aux aléas de la vie et à ses propres talents nécessaires à la satisfaction de la plupart de ses besoins et de ses désirs. Le vingt et unième siècle capitaliste et humaniste nous conduit droit à cette même situation, et la violence dont nous pouvons constater le développement dans les générations commençantes n'a absolument rien d'étrange ni de scandaleux si l'on spécule honnêtement sur les tenants et les aboutissants de ce que le monde des adultes les enjoint de prendre en charge. En bref, le dressage moderne se réfère à une seule finalité : l'augmentation de la rentabilité des individus et l'abaissement du coût de leur éducation, c'est à dire de leur véritable jeunesse. Se pose alors brutalement la question : quelle place reste-t-il à ces individus surchargés de tâches tout à fait décalées par rapport à leur présent pour gérer ce présent lui-même ? Pour affronter tout simplement le fait brut d'exister dans un environnement qui ressemble pour l'essentiel à un château de conte de fée ? Comment un même être saurait-il se consacrer à lire la réalité brute tout en passant le temps où il aurait le loisir de le faire à des apprentissages et à des lectures qui appartiennent tous à la fiction de leur avenir ? Cela me rappelle assez douloureusement ma propre expérience d'enfance, lorsque ma mère, dépassée par l'événement de la mort de mon père et contrainte de gérer toute seule un vaste commerce, a fini par mobiliser ses trois enfants pour l'aider tout en les destinant par l'école à des avenirs totalement décalés.
Le plus grave, et nous revenons ainsi à notre sujet principal, est la question de la maturation morale. Si le jeune humain est ainsi surchargé d'apprentissages de toute sorte, de pratiques qui ne comportent en elles rien qui exige de l'apprenti autre chose que l'exercice et l'effort de mémoire, comment et à quelles occasions peut-il encore avoir une chance d'expérimenter les situations où s'esquisse la problématique du bien et du mal et donc la nécessité d'exercer aussi le jugement ? Car ce dont il faut tenir compte pour qu'une telle pratique puisse lui être concédée, c'est que la liberté est le seul champ possible à l'intérieur duquel l'enfant peut trouver des situations où le jugement ne revient qu'à lui seul. Si toute son existence quotidienne se voit réglée, structurée et orientée en permanence vers des activités a priori contrôlées par les adultes (ce qui pose un tas d'autres problèmes d'ailleurs), l'enfant perd toute autonomie de jugement de facto parce que les situations où il devrait exercer son entendement lui font tout simplement défaut. Comment alors s'étonner que ces mêmes enfants, parvenu à l'adolescence, c'est à dire à l'âge où se décide le sort de la fiction oedipienne et des frictions générationnelles, n'hésitent plus à choisir la violence pour imposer des jugements qui ne sont plus que des comportements mimétiques par rapport à ce qu'ils peuvent alors observer dans leur conflit devenu permanent avec le monde adulte ? Il est malheureux de constater qu'à l'époque où nos sociétés se targuent d'être parvenues à une prospérité soit-disant inégalée dans le passé, les enfants soient les premières victimes du dévoilement de ce mensonge. La prospérité actuelle est le leurre le plus incroyable et l'illusion la plus surréaliste que l'Histoire ait sans doute connue, et ce leurre fournira encore d'innombrables causes à des malheurs de plus en plus grands et d'un déclin de plus en plus rapide du respect des idéaux humanistes.
Ce long développement sur la jeunesse n'avait pas d'autre objectif que de mettre en valeur ce que signifie en réalité exister : il s'agit en effet du principal travail de l'être humain, de la principale activité à laquelle il ne saurait se soustraire sans courir le risque de devenir autre chose qu'un être défini jusqu'à présent comme humain. Or ce travail d'existence a ses exigences d'apprentissage au même titre que le langage et tous le reste : d'ailleurs c'est bien la richesse relative du langage environnant de l'enfant qui lui donne ou non des prédispositions à gérer avantageusement son avenir, et non pas de son propre talent à apprendre à parler et à écrire le plus tôt possible. La mimesis, l'imitation, est bien le premier outil de la pédagogie, et sans doute le seul si on analyse avec rigueur le phénomène de l'enseignement. Si un Martin Heidegger peut se permettre de déclarer que dans la relation pédagogique ce n'est pas l'étudiant qui apprend mais le professeur, alors on a tout compris de ce qu'on appelle " l'acquisition " du savoir. A croire que par une perversité interne à notre histoire occidentale, toute la paideia, toute la pédagogie se soit littéralement vidée de son sens et qu'en réalité nous entrons dans un monde fou où les adultes cannibalisent les jeunes à leur profit. Le rajeunissement prodigieux des populations salariées ces vingt dernières années confirme totalement ce point de vue, et c'est loin d'être fini. Mais le plus grave dans cette tendance à transformer notre jeunesse en réservoir d'esclaves c'est la conséquence qui se rattache à cette transformation, c'est à dire à la carence essentielle qui se creuse dans la puissance de l'individu à harmoniser ces formes d'existence avec le jugement moral. Au fond, la société actuelle se comporte comme si elle était décidée, de toute façon, à se passer du jugement moral individuel au profit d'un fonctionnement des lois conçu de manière à dispenser le citoyen de quelque jugement que ce soit. On appelle cela l'état de tyrannie ou de dictature, ou encore de totalitarisme. A suivre.
Mardi 14 janvier 2003
Reprenons donc ce problème de la formation de la moralité. D'abord en posant une question essentielle : la moralité se forme-t-elle chez l'individu indépendamment de la société, ou bien est-elle une création ou une conséquence de l'association ? Apparemment cette question est insoluble et personne n'oserait, hormis Kant, donner une réponse autre que théologique. Tâchons de voir les choses autrement et de trouver une solution qui permettent de considérer de concert ce problème de la moralité chez l'individu et dans la société.
Et d'abord posons une question : pour quelle raison la moralité serait-elle exclue de toute autre relation que celle à autrui ? Respecter, aimer, attribuer un caractère sacré voire vénérer sont des actions qu'on a vu dans l'histoire humaine concerner aussi bien des animaux que des humains. Voir les Egyptiens en particulier, voir aujourd'hui encore les Indiens en général qui refusent d'abattre les vaches et les Indiens jaïnistes qui, en plus, refusent toute destruction de vie, sous quelque forme qu'elle se présente. Par ailleurs, il est devenu évident pour tous que l'affection et le respect est devenu un trait spécifique de la relation des humains avec leurs animaux de compagnie, sinon pour tous leurs animaux domestiques. Même la loi punit les dérogations à une certaine dose de moralité envers les animaux. On peut même dire, du point de vue historique, que l'option morale individuelle envers les animaux s'est imposée comme une véritable moralité qui est loin d'avoir pris toute son extension. Cette évolution de l'attitude humaine vis à vis des non-humains montre en tout cas que la moralité subit des fluctuations dans le temps. Elle ne peut pas être considérée comme une donnée stable de l'Histoire. Cette dernière en témoigne d'ailleurs sans difficultés, les Droits de l'Homme sont une " acquisition " morale récente, même si on peut n'y voir qu'une vaste hypocrisie tactique, voire un piège verbal qui ne serait qu'une phase rhétorique de la réduction subjective de l'être humain : le droit est en un certain sens antinomique à la moralité.
Jeudi 16 janvier 2003
Comme la lettre peut être antinomique à l'esprit. Il faut postuler une véritable invention du mal dans le passé humain. Invention corollaire de celle du bien : dans la nature il n'y a ni mal ni bien. Qui oserait, sans prendre le risque de se couvrir de ridicule, mettre un dauphin en accusation pour avoir tué un requin, ou un lion pour s'être repu d'une gazelle ? Mais encore, qui oserait faire un procès au mâle dominant d'une harde de rhinocéros pour son comportement tyrannique ? Et encore, faut-il condamner de jeunes cynocéphales qui se ligueraient pour tuer le dominant de la tribu devenu vulnérable ? Plus près de nous, les vieux que l'on envoie " au cocotier " pour y mourir, avons-nous de quoi alimenter réellement un procès pour assassinat délibéré ? Chez les eskimos les vieux acceptent d'eux-mêmes de disparaître dans le grand froid. Il faut donc admettre au moins une chose, c'est qu'il y a eu une modification dans l'attitude morale non pas seulement en comparaison de ce qui se passe dans le règne animal, mais aussi dans l'espèce humaine. Or, si on examine de près les exemples que nous venons de citer, on peut dire au moins une chose, c'est que chacun des cas cités possède sa raison, disons pour éviter tout malentendu une place dans le dispositif naturel qui programme pour ainsi dire le passage à l'acte. On ne tue pas les vieux pour le plaisir, mais parce que la situation de pénurie l'exige, ou peut-être seulement parce qu'une tradition, issue d'un accident de pénurie a pris force de jurisprudence ou de rite. Ou peut-être encore pour des raisons humanitaires que nous faisons semblant d'ignorer alors que certains d'entre-nous militent en faveur de certaines formes d'euthanasie. Mais une chose est certaine, dans tous ces cas, il n'y a pas une trace de mal au sens pur, mal que l'on ne peut trouver que dans la gratuité totale des actes mauvais, dans ce que nous appelons la cruauté, ou, depuis un certain Marquis, le sadisme.
Je m'enfonce ici dans les sables mouvants de la question de la prédation. On ne peut pas éluder le fait de devoir considérer la réalité naturelle comme une logique de la prédation. On ne peut pas non plus se voiler la face devant le fait que l'homme a été une proie pour l'homme lui-même, même si les raisons du cannibalisme ne ressortissent pas aux mêmes catégories de causes que toutes les autres formes de prédation. En étudiant de près les formes résiduelles du de l'anthropophagie qui existent encore dans bien des zones du monde, on peut en effet conclure globalement que le cannibalisme ne concerne pas le besoin alimentaire mais ce présente comme une captation spirituelle des facultés ou de la personnalité de la victime. On ne mange l'autre que pour s'attribuer son essence. On peut considérer cette forme de prédation comme une perversion directement issue de la sociation, car la personne n'existe que dans le contexte d'une société, jamais de manière isolée. Il n'en va pas de même de l'habitude qu'avaient certaines sociétés de manger leurs ennemis tués, coutume qui peut être renvoyé dans la catégorie de la prédation simple. Il suffit de se souvenir qu'au début du vingtième siècle, on pouvait encore acheter des morceaux d'humains suppliciés en public à des fins de consommation.
Il faut donc une fois de plus s'en remettre, comme le fit Rousseau lui-même, à la conjecture. Je préférerais, quant à moi, parler de poétique, comme on parle aujourd'hui de Poétique de l'Histoire (voir le remarquable ouvrage de Philippe Lacoue-Labarthe qui porte ce titre flamboyant et, à la fois humble, je m'expliquerai un jour là-dessus). Dans les limites absolues d'une condition sine qua non, à savoir qu'une telle poétique ne désire en aucun cas dépasser l'explication. Disons que le poétique en tant que tel n'a rien à faire avec l'action, je pense que l'on a assez constaté les résultats de politiques ressortissants à une poétique, ou à la poïesis. La conjecture que nous pouvons tracer ici, est la rencontre nomade primitive. L'homme solitaire se trouvant face à face avec un autre homme solitaire. La ressemblance morphologique joue ici un rôle important puisque nous postulons toujours : homme = question de l'Être = conscience. Ce qu'il faudra alors désigner comme moralité (primitive), ce serait un comportement qui différerait de celui que l'un et l'autre ont coutume d'avoir en présence de gibier, de nourriture en puissance. Dans un film américain assez somptueux qui s'appelle " Instinct ", la situation met en présence un homme et un grand singe d'Afrique, un gorille. La fiction va très loin puisqu'en définitive il semble que le lien s'installe du gorille à l'homme et non l'inverse. C'est à dire que c'est le singe qui semble provoquer l'homme à une vision du monde tout à fait neuve, à une véritable ontologie d'un monde édénique spolié par l'homme. Nous n'allons pas si loin, nous mettons en présence deux exemplaires d'une même espèce, espèce dont l'essence est la conscience. C'est à dire que les deux êtres qui se rencontrent ont le même problème à résoudre, totalement différent de tous les autres problèmes auxquels ils ont à faire face habituellement. Dans notre fiction, nous supposons une sorte d'immédiateté certaine de la moralité dans la mesure où l'intérêt supérieur des deux êtres qui se rencontrent se trouve dans un élément extérieur aux actes propres à la prédation. La conscience, pourrait-on alors conclure, est le fondement immédiat de la moralité. Il faut insister ici sur l'expression " intérêt supérieur ", car il se pourrait que l'un des deux hommes préhistoriques, voire les deux, se trouvent à ce moment-là dans une situation de pénurie, raison qui pourrait provoquer un duel. Or si la conscience, et donc la question de l'Être, est réellement l'essence de l'animal humain, et non pas le langage qui n'est qu'un instrument secondaire par rapport à la conscience, alors la nécessité ou le besoin s'impose dans cet élément essentiel, reléguant au second plan les nécessités ou besoins secondaires.
On peut poétiser cela différemment, dans la tonalité biblique de la terreur spontanée ou l'angoisse naturelle de l'homme face la présence du monde. En déduire ensuite que si le sentiment dominant de l'homme seul rencontrant un autre homme seul est la terreur, ou la peur simplement, alors cette peur est premièrement commune, deuxièmement partagée. On peut en déduire qu'une rencontre dans de telles conditions est a priori un soulagement provenant du simple fait de constater qu'il y a quelqu'un d'autre dont l'apparence nous suggère qu'il partage les mêmes craintes. Tout de suite, pourquoi pas, on peut déduire de cette mise en scène que le langage s'engage de lui-même, se construit immédiatement, non pas sur le partage des techniques de chasse ou de pêche, mais de gestion de cette même question de l'Être : le langage n'a pas d'autre source que le désir d'affronter en commun la question de l'Être. A tel point que j'ai postulé ailleurs que les humains ont déjà disposé, avant notre histoire, d'un langage commun parce qu'il n'y avait pour la création de ce langage qu'un seul sujet et aucune réalité idiomatique ou génératrice d'idiomes. Les idiomes sont tous d'origine sédentaires et ne cachent rien d'autre que la volonté de codifier pour un ensemble d'initiés des moyens secrets de communication. D'où une autre conclusion : la moralité naturelle que nous venons de peindre ne peut qu'être condamnée à la négation dans une réalité sédentaire qui se pose elle-même comme crime originaire, comme rapt de l'espace à l'espèce humaine. Qu'elle se reconstruise ou pas au plan social est une autre question, mais au plan de l'ontogénèse la moralité demeure le premier mouvement de l'âme. L'identification que nous décrit Rousseau pour expliquer la pitié, et donc la moralité, est malheureusement soumise à des conditions historiques bien déterminées (celles qui recouvrent en gros notre récit), ce qui explique que la poissonnière a plus de chance d'être accessible à la moralité qu'un intellectuel. Car dans le cadre d'une société déjà formée sur la base de castes, l'identification devient problématique parce que l'animalité se glisse dans la comparaison spontanée. Un aristocrate ne peut plus s'identifier à un galérien parce que ce dernier est du genre " gibier ".
Dimanche 26 janvier 2003
Mon ami Jean-Luc Nancy a désormais sa chronique sur France-Culture. Je n'y fais pas assez attention mais lorsqu'on est saisi par sa voix rauque, difficultueuse, à la limite de l'extinction mais si profonde et si inspirée, on a du mal à s'en détacher, même si le thème du jour, ou son obstination hegelophile vous agace. Hier le Commandeur a parlé politique. Enfin il s'est contenté de parler des usages du mot politique dans la désormais classique dialectique du Heidegger des Essais et Conférences. Comme je n'ai pas le texte sous les yeux je ne peux pas entrer dans le détail, dont au demeurant il ne nous abreuve jamais. Sobriété. Sévérité. Savoir-faire. Sans trop de rhétorique, juste ce qu'il faut en ce début de siècle où les Bossuet sont de retour avec leur nous de bergers qui ne cessent d'y croire tout en déplorant l'incroyance générale. Jean-Luc est de ces philosophes - mais il n'aimerait sans doute pas qu'on le désigne comme tel - qu'il faut admirer pour le tour de force qu'un certain Derrida a rendu d'une nécessité sine qua non pour tout intellectuel qui ose passer le mur de l'expression publique, savoir dire sans rien dire. Laisser devant la porte tout désir de dire tout en parlant en une belle langue, incontournable, syllogistiquement rigoureuse à faire peur, bénigne et maligne à la fois, belle et effrayante, jouissive et castigatrice juste ce qu'il faut.
Il y allait donc de l'emploi du mot politique, l'idée centrale étant, si je me souviens bien, le danger d'un certain usage totalitaire du mot, usage extrême dont la banalisation serait précisément le symptôme. Je m'exprime mal. En réalité Nancy veut dire qu'un certain usage du mot politique révèlerait un véritable fond totalitaire, surtout là où il s'empêtre dans le croisement des genres. La politique, le politique, tout est politique. Si tout est politique, alors nous voguons dans un univers totalitaire. L'inflation du politique dans le langage trahit la présence de la peste brune. C'est vrai, quoi ! Il n'y a plus de frontières entre ce qui ressortit au vrai politique et ces qualifications de politique de la première réalité venue. En clair, si la gestion de la Res Publica se confond avec celle des crottes de chiens, la Cité est perdue.
Je m'en veux un peu de ce persiflage voltairien car Jean-Luc a raison. Il n'y a pas vérité plus vraie que cette dérive du langage qui permet à n'importe qui de s'emparer des mots pour en tartiner son pain doxique à n'importe quelle heure de la journée. Et il ne s'agit pas seulement des brèves de comptoir, hélas. Ce qui m'agace un peu, je reprends ce mot car il me gratte depuis des années, c'est cette manière de rester derrière les lignes, derrière la Ligne Maginot du réel, en évitant de se mouiller ou de se brûler à la gueule de la grosse Bertha. Mais oui, le mot politique est mis à toutes les sauces. Mais oui, il peut aujourd'hui désigner à peu près n'importe quoi. Mais oui, tout ça pue le fascisme à plein nez. Mais oui.
Mais pourquoi ? Pourquoi mon cher Jean-Luc ? Aurais-tu peur d'appeler un chien un chien ? Craindrais-tu de franchir le Rubicond qui consisterait à énoncer cette pauvre vérité d'un totalitarisme réel, concret, palpable au coin de ta rue strasbourgeoise, là où un peu plus loin on construit le futur Palais du Media Culturel le plus prestigieux d'Europe ? Tu vois de quoi je parle, n'est-ce-pas ? Et si tu regardes les programmes de ce média, ce que tu fais sans doute de temps en temps à ton corps défendant, c'est bien là, dans ces étalages de discours actuels que tu pêches ton diagnostic sur l'emploi du mot politique. Non ? Et même dans ce média-là où tu tiens ta propre Chronique. Je l'écoute aussi, tous les matins, malgré la dose d'offuscation qui me prend le nez à chaque fois ou presque, car je dois dire que cette antenne-là est presque la seule à aussi laisser parler la réalité, de temps en temps. L'après-midi, ou tard la nuit. L'autre jour je me suis fait engueuler par un rédacteur en chef alsacien pour avoir osé révéler en direct la puissance de l'Archevêché de Strasbourg dans le secteur des médias. Osé demander pourquoi Strasbourg et Mulhouse restent interdit de Skyrock ou Fun-Radio, ces médias qui parlent un peu de la réalité tous les jours aux jeunes. Osé évoquer le vrai politique, le caché, celui qui met des années à se négocier en douce entre les vraies puissances et les institutions démocratiques.
Oh, je n'oserais pas, moi, traiter ces petits manquements politiques de totalitaires, meuh non, il s'agit seulement du Concordat. En revanche, je n'hésiterai pas une seconde à qualifier le tout de la réalité sociale de totalitaire, non mais ! Nous, les tard-venus de la Guerre, nous avons tout vu et tout enregistré. Nous savons que les portes d'Auschwitz ne se sont pas fermées en 1945 derrière la dernière jeep américaine. Ici en Alsace, mais tu n'y étais pas encore, on a même vécu encore vingt bonnes années de vichysme après 45. Pourquoi tu crois qu'on s'est remué en Mai 68 ici plus qu'ailleurs ? Pourquoi c'est à Strasbourg qu'on bat les records de bagnoles cramées ? Si en 68 certains de tes collègues sont allés jusqu'à prêter main-forte à ces étudiants cinglés, c'est qu'ils avaient, eux aussi, des souvenirs tout frais. Les autres, les vieux philistins, ils venaient d'ailleurs, pouvaient pas comprendre cette flambée qui semblait s'en prendre aux Humanités alors qu'elle fêtait leur enterrement.
Mais encore Jean-Luc. Les choses sont ce qu'elles sont : to-ta-li-taires. Il n'y a plus d'économie ou de je ne sais quoi d'autre, et c'est tant mieux car il n'y a jamais rien eu d'autre que du politique. Parce que le politique est la praxis humaine dans toute son acception, parce que la Res Publica, la chose qu'on discute autour du feu est cela même qui fait l'humain. Que cette politique soit descendue aux échelons les plus bas de l'Auseinandersetzung, le degré où la Chose devient la dignité et la vie de l'autre, ça c'est l'affaire de l'Histoire. C'est l'affaire de l'assomption de l'Etat, cette machine neutre que tout le monde confond aujourd'hui avec la Démocratie et qui passe avec armes et bagages dans les entreprises pour parfaire ce monde politique-là, du totalitaire. Relis donc le petit ouvrage de ce Juif italien qui a travaillé dans les camps, protégé par la chance et la science, et médite ce qui constitue pour cet homme qui en est mort pas si longtemps après, l'essence du totalitarisme lui-même. Ce n'est pas la Shoah, ce n'est pas le génocide, ce n'est pas l'annihilation industrielle d'une race, conséquence pathologique de cette Histoire, non ce n'est pas tout ça : c'est l'annihilation permanente de la dignité et de la liberté de tous les pékins que nous sommes.
Il ne s'agit pas ici de communisme ou de je ne sais quelle utopie. Les vrais hérétiques du Seizième siècle n'étaient pas des utopistes, ils ne faisaient que dénoncer l'hypocrisie de tous les appareils politiques, qu'ils soient papistes, luthériens, calvinistes ou jésuites. Les vrais révolutionnaires de tous les temps n'étaient pas des poétiseurs de politique, des visionnaires d'eschatologie diverses et variées, c'étaient des hommes qui défendaient leur dignité, la leur propre parce que leur situation était devenue intolérable. Pourquoi Robespierre et Saint Just se sont-ils laissés assassiner sans se défendre ? Réponse : à cause de la modestie de leur cause, de l'humilité profonde de leurs desseins, lesquels n'avaient rien à voir avec la poïesis totalitaire des Platon, les visions dantesques de Nietzsche ou les errements trop proches du doublet Jünger / Heidegger. Alors s'il faut risquer le titre d'hérétique, je vais le faire sans tourner autour du pot : si le mot politique " schwärmt " dans l'air, si on n'entend plus que ce mot d'une chronique à l'autre, c'est qu'on y est presque. On est presque arrivé dans le nouvel Empire de la dictature des décideurs. Es-tu capable de te mettre dans la peau des humbles de ce monde, des vrais humbles, par exemple les jeunes, qui n'ont plus qu'une seule alternative, baisser la culotte d'un bout à l'autre de leur destin ou brûler des voitures ? N'aurais-tu pas compris que l'avenir des beaux salariés de la République c'est vraiment le Léviathan de Hobbes, à peu de choses près le statut des blacks dans la République d'Afrique du Sud de Verwoerd ?
Bien sûr tu vas me dire qu'on en est pas là. Si, on en est là. Si je te le dis, si j'ose te le dire, c'est que je n'ai jamais, pour ma part, quitté le monde de ces gens-là, qui ne parlent pas de politique mais en subissent l'absence, qui se taisent en se soignant comme ils peuvent et en livrant les combats d'arrière-garde des vaincus du sociétal. Car vois-tu, les " libéraux " jouent sur du velours. Ils savent la dépendance réciproque condamnée. Les capitalistes, du mot capital qui signifie bétail, savent que les Républiques y a pu, y aura pu dans pas longtemps. Eux ont depuis longtemps pris leurs quartiers nomades, régissant le monde de partout et de nulle part, construisant et détruisant ici et là des pyramides humaines qu'ils nomment Entreprises dans lesquels les salariés n'ont plus qu'à spéculer sur ce que j'appelle la disponibilité de futur. Ce capitalisme, devenu enfin ce que Hobbes prophétisait, n'est pas un futur probable ou improbable, il est le présent vidée de sa substance à un point tel que la mémoire commence déjà à faire défaut pour les événements les plus proches. Tellement vide qu'il en est devenu insaisissable c'est à dire que l'esprit ne peut plus rien imprimer dans ses bandes magnétiques pour faire une culture. Ailleurs, évidemment, qu'à France-Culture, sorte de cadavre du Christ autour duquel se réunissent quelques centaines de disciples affamés. Comme toi, avec ta voix tragique et émouvante, écho du seul événement qui est resté philosophique, la mort.
Lundi 27, Mardi 28 et Mercredi 29 janvier 2003
Ce matin je vais continuer de m'adresser à toi, Jean-Luc, comme hier, mais aussi comme il y a quelques trente-cinq ans lorsque nous refaisions le monde en tentant de le défaire. Je pense en effet, en me relisant, que tu ne me comprends pas tout à fait, il traîne encore ici et là quelques allusions, mon péché le plus courant, et aussi d'autres mots que celui dont tu parles et qui risquent de n'être pas compris de ceux qui t'écouteraient, toi. Car je dois reconnaître que tu parles clair, haut et clair, et je ne me souviens même pas d'avoir entendu un mot aussi compliqué que poïésis dans ton discours, ou peut-être me trompé-je. Quoiqu'il en soit je vais préciser encore un peu plus ce que j'osai avancer hier dans le langage le plus simple possible et sans ces incursions dans les complicités sémantiques qui vont d'elles-mêmes sauf pour la plupart des auditeurs ou des lecteurs.
Ce sera une méditation sur le temps présent et sur la présence du temps. Quelque chose du genre du fameux " parce qu'y en a marre " de Coffe. Ce temps, Jean-Luc, il se présente dans les bacs des rayons des grandes surfaces tous les matins qui passent, et ceux qui sont là pour acheter parce qu'ils doivent le faire, font la grimace parce que la marchandise est suspecte. Les chalands ne voudraient pas faire l'acquisition de ces clémentines parce qu'ils savent qu'elles ne valent rien, mais il n'y en a pas d'autres, de cette viande de veau qui va faire des litres d'eau dans la poêle, de ces conserves qu'on ne mange que par esprit d'économie…de temps et tout cet Ersatz des bonnes choses dont on aurait tant de plaisir à garnir son caddie. Oui, le temps qu'on nous sert, surgelé ou pas, est devenu de la merde, voilà le genre de mot qui manque dans ta rhétorique, notre époque est bien un Waterloo de l'Histoire, on peut bien se servir du mot de Cambronne, allez !
Mais enfonçons-nous plus profondément encore dans la mélasse du Dasein présent. Tiens parlons de l'exclusion, terme tellement à la mode que même le Président de la République s'en sert, ce qui prouve d'ailleurs quelque part, qu'il se sent lui-même exclu de quelque chose. Lorsqu'on interroge un politique à ce sujet, il se passe toujours quelque chose de très curieux, il se met à bafouiller, à chercher à quoi peut bien correspondre cette catégorie des exclus. Et ça finit toujours aussi par ce SDF passe-partout, qui veut bien prendre sur lui toute l'exclusion du monde. Même Monsieur Raffarin n'est pas tombé dans le piège de ce mot, préférant l'étonnant néologisme de la " France d'en-bas ", ce qui ne laisse de faire mourir de rire les plus modérés des citoyens du centre modéré.
C'est que, dans notre présent, il y a tout ça : de l'exclu (et donc de l'inclus), de l'en-bas (et donc de l'en-haut). Ce qui me fait aussi hurler de rire, c'est quand les éditorialistes se mettent à parler de la classe moyenne qui " prolifère " (sic), posant ainsi des limites imaginaires à l'exclusion et à l'en-bas de l'en-haut. Mais admettons qu' il existe une énorme classe moyenne, des millions de Français qui passent les caps des fins de mois sans pointer dans les restos du cœur. Ah les restos du cœur, voilà le lieu, le topos ou le peras de l'exclusion, là on peut faire des décomptes exacts de ceux d'en-bas, tant pis pour ceux qui préfèrent crever de faim, mais surtout tant pis pour ceux qui mangent le temps moyen auquel ils ont droit en tant que classe moyenne. Il y avait une certaine médiété - désolé pour ce concept aristotélicien mais il n'existe rien d'autre pour désigner son objet et ce n'est pas par hasard non plus - il y avait une certaine médiété donc dans la pensée de Coluche, une grande dose d'humilité et de modestie dite pragmatique. L'idéal, au demeurant, du Stagirite, une sagesse concrète qui évite tout excès et qui incarne finalement une certaine perfection. Et Coluche avait quelque chose de parfait, c'est certain, il avait une forte nostalgie de la communauté, d'une communauté retrouvée. Et ça marche ! Et ça marche au-delà de tous les espoirs puisque l'Etat a compris lui-même le message et s'est mis à prendre une grosse partie de tout ça en charge, ce qui était de son devoir avant tous les Coluches et abbé Pierre du siècle.
Cela dit, la communauté qui se retrouve est plutôt celle qui administre cette charité non déguisée que celle qui n'a pas le choix que d'aller s'alimenter au degré zéro du temps présent. Auquel je reviens à présent pour fermer une quasi digression, autre de mes défauts insupportables. Car on se fiche de l'exclusion et de tout ce jargon vraiment politique celui-là, car c'est du temps qu'il s'agit ici, du temps qui passe sous forme de ce présent qui se reproduit indéfiniment dans toutes ces fonctionnalités, ses médiocrités et ses humiliations auxquelles ON est asservi sans vouloir s'en faire l'aveu, en jouant les singes sourds, muets et aveugles. Indéfiniment se reproduit le métro-boulot-dodo qui constitue désormais un privilège de nanti, de non-exclu, à tel point que ça fait belle lurette que le cynisme dont parle Marx en parlant du capitalisme débarrassé de l'Etat fait sa loi partout et à toute heure. Nous y sommes, chers philosophes, dans la petite tyrannie quotidienne de l'arrogance patronale, banquière et cléricale. Nous sommes dans le château de Kafka, en rangs d'oignons et par classes de revenus.
Bon, le philosophe est payé pour regarder tout cela à l'envers, n'est-ce-pas, et à nous livrer, clef en main, une lecture positive de ce monde. C'est là que se noue le problème car une telle lecture existe, pour … le philosophe, dont le langage n'arrive malheureusement pas jusqu'à ceux qui doivent comprendre. Si tout le monde, tel le Candide de Voltaire, pouvait comprendre, que dis-je sentir, à quel point ce monde est le meilleur des mondes possibles, à quel point cette réalité contient ce que Dieu pouvait vouloir créer de mieux, c'est à dire choisir de plus parfait entre tous les modèles possibles d'univers imaginables ! Si tout le monde pouvait comprendre spontanément qu'il est fait un usage abusif du mot politique, et qu'un tel usage se présente comme un symptôme de plus d'une crise sempiternelle dans laquelle nous souffrons, alors nous ne souffririons même plus. Mais pour comprendre cela, il ne suffit certes pas de nous morigéner sur ce seul point-là, sur ce résultat sémantique et linguistique de la crise qui endolorit notre existence, il vaudrait mieux, plutôt, nous refaire le coup de Leibniz, nous rendre ces beaux développements qui nous feraient applaudir à tout ce qui nous entoure et nous rendre aussi le charme naturel de la réalité. Suis-je ironique ? A peine. A peine, car que voit-on refleurir régulièrement dans le discours national, ce discours retransmis pour tous sur le ton bien connu du qui bene amat bene castigat, ce qu'on entend sur les ondes ce sont les antiennes du stoïcisme, sortes d'engueulades voilées où il est surtout question de châtier son langage et de ne pas prendre au sérieux au point de le dire, dire ce qu'on pense.
Que signifie dire ce que l'on pense ? La littérature a toujours eu ou pris le droit de dire tout haut le tragique de l'existence, de le reconnaître sans faire de chichis au point que le tragique est devenu, avec le temps et l'argent, le must de tout art. Au point que l'art lui-même est devenu la représentation quasi exclusive de la parturition de la souffrance, de sa naissance et de son acmé passionnelle. Or le quidam n'a pas ce droit, autrement dit, le sujet de la souffrance n'a aucun droit à revendiquer son état, à faire état de son état. On n'a pas le droit de faire état de ses symptômes en désignant le mal comme le politique, alors que tout ce qu'on veut dire c'est que le politique est mal, qu'il est mauvais, qu'il n'est pas comme il devrait, et qu'en plus il envahit tout, même la carrière, même la vie quotidienne la plus intime et la plus retirée de toute politique ? Voilà une situation historique peu banale dont il est vrai qu'on peut dire qu'elle n'a rien à voir avec celle d'un Leibniz ou même d'un Hegel, même si les idéologues du temps présent persistent à nous le faire croire. Peut-on raisonnablement penser qu'un Hegel aurait pu penser comme rationnel le réel qui n'a pas mis un siècle à surgir dan son propre pays ? Que dire de Leibniz, de ses réactions si on lui avait fait un compte-rendu de ce que signifie l'expression " arme de destruction massive " ? Mieux encore, si ce compte-rendu avait porté sur les destructions massives réelles, sur la réalité réelle de la capacité de néantisation de l'Homme, cette merveille de Dieu ? Croyez-vous que sa Théodicée aurait résisté à ce choc ? Pensez-vous que la Phénoménologie de l'Esprit aurait survécue autrement qu'à l'aide des ficèles du petit théâtre de la politique ?
Allons. Soyons sérieux. Même Nietzsche, qui avait certaines raisons pour anticiper les horreurs que nous évoquons, après tout il a fait l'expérience, même si elle fut brève, des charniers de la guerre de 1870, même lui et son système n'auraient pas résisté. Voilà la raison pour laquelle le politique est partout parce qu'il s'est imposé une fois pour toute partout et qu'on ne referme pas, je le répète, les portes d'Auschwitz dans la mémoire des hommes. Et qui aurait le culot de protester contre une critique politique qui met Auschwitz en exergue ? Jean-Luc, je te pose la question, qui peut aujourd'hui vivre sans y penser ? Sans y penser ne signifie pas sans avoir pour objet permanent de sa conscience la Shoah. Sans y penser signifie sans y référer à chaque instant ses propres souffrances, sans les élever à cette puissance incalculable d'horreur ? Tu vas me répondre en parfait stoïcien et tu vas me dire, mais justement ! Auschwitz est un contre-modèle suffisamment puissant pour nous détourner de toute comparaison ridicule et malvenue. Peut-être même devrait-il, à l'instar de l'Enfer du Christianisme, nous consoler d'un présent si doux, non ? Tilt, Jean-Luc, refais tes calculs, comme disait Debord, la souffrance des hommes et sa relation à sa pensée, ça ne marche pas comme ça, on ne la lui fait pas deux fois, il faudrait même dire trois, hélas. D'autant plus que le monde qui a produit la Shoah a si peu changé dans sa forme politique que toutes les raisons sont là pour penser le contraire et penser que le totalitaire, non seulement ne nous pends pas au nez, mais qu'il est déjà là, figeant notre Dasein dans la terreur une fois pour toute.
Alors que faudrait-il dire ? Pas facile. Sartre l'a fait dans l'après-guerre, lorsque les gouvernements à peine sortis de Vichy se sont lancés dans les guerres coloniales, ont consacré l'aide que les Américains nous avaient octroyés pour bouffer au réarmement dare-dare de la France. Sartre s'est battu en honnête homme pour produire moins de souffrances, pour que le politique totalitaire cesse d'envahir le Dasein, pour permettre qu'un jour la France se mette à danser parce qu'un Président socialiste a été élu. Aujourd'hui on lui crache dessus et les intellectuels qui ont pris sa place se voilent la face en externalisant la souffrance qui revient avec la peur, en transformant cette peur en sacs de riz et en restos du cœur. Non mais ! La vie est belle, Jean-Luc, elle est comme Plotin la peint et comme Heidegger la suppute, comme la Cabale le démontre. Lumineuse et pleine de chaleur. Mais le politique est nul, totalitairement nul. Il faut que la vie soit terriblement belle pour faire concurrence à la nullité du politique, c'est à dire à la nullité du mode de vie en commun et permettre à ces milliards d'êtres humains de continuer malgré tout. C'est que nous sommes tous devenus des chapardeurs de bonheur, des contrebandiers de bien-être dans un paysage de plus en plus gris, de plus en plus menaçant, dans une fanfare générale de plus en plus sinistre. Alors faites vos choix, mesdames, messieurs, continuez à faire semblant de vous rengorger de fierté avec votre démocratie de quatre sous et de glisser vers la répétition de l'ignoble, ou bien commencez donc de dire ce que vous ressentez vraiment, la souffrance que vous éprouvez réellement de voir la démocratie tournée en farce, de hurler votre raz le bol de cette hypocrisie qui noircit chaque jour davantage le ciel de notre existence.
Vendredi 31 janvier 2003
Bravo Adler ! Bravo Esine ! Nos Alexandre et nos Jean-Louis du matin ont donné toute la mesure de leur talent ce matin, et je m'en réjouis. Tous deux nous ont décrit avec le cynisme et l'humour nécessaires le coup de Jarnac américain qui vise à couper le jarret de cette Europe qu'ils ont eux-mêmes fomentée sur mesure, la mesure de leurs besoins stratégiques contre l'URSS. Nous y voilà : nous sommes allés au-delà du modèle mitonné par Washington, nous avons trop bien réussi dans ce projet que beaucoup d'anciens empires ont tenté de mener à bien, c'est à dire retrouver la puissance réelle dans l'unité de façade. Aujourd'hui, la seule harmonie entre Paris et Berlin suffit à donner au vieux continent de la puissance politique face au moloch américain. Rendez-vous compte, c'est comme si dans les années cinquante avant JC, Athènes avait réussi à freiner voire bloquer les Légions de César envahissant la Gaule ! Une Athènes, bien sûr qui aurait réussi à donner un contenu quelconque, politique ou économique à ses amphictionies, cette Commission de Bruxelles antique qui unissait religieusement à Delphes toute l'Hellade.
Mais jusqu'où va pouvoir aller ce complot ? Gonflés les Américains, non seulement ils jouent sur les traditionnelles relations électives qu'ils entretiennent depuis la guerre avec les deux méditerranéens de l'Europe, l'Italie et l'Espagne, mais ils vont jusqu'à se servir de ceux qui sont à peine européens, qui ne le sont même pas encore du tout avant l'an prochain, tous ces anciens satellites de Moscou qui n'hésitent plus à donner dans l'insolence - voyez la Pologne, ah que le Tsar Alexandre avait raison de se méfier de cette enclave vaticane du Nord ! - alors que tout le monde sait qu'ils se foutent de tout sauf du dollar. Autrement dit, non seulement ils veulent diviser l'Europe de l'Euro, ce qui me paraît assez ridicule sauf à penser que Berlusconi et Aznar soient prêts à la politique du pire, ce qui n'est jamais exclu dans l'Histoire, mais ils prétendent donner du pouvoir à des pays qui ne sont toujours encore que des candidats à l'Europe ! Des candidats auxquels certains Européens de la première heure donnent le privilège de signer un document de politique étrangère européenne qui restera sans doute le tout premier document réellement politique. Je rêve ! L'Europe crève de ce vide politique intérieur autant qu'extérieur, et à la première occasion on s'adresse à des outsiders pour signer un torchon concocté par le Pentagone !
Voilà qui devrait servir de leçon et qui nous permet d'ailleurs de prévoir l'alternative qui va décider si Bruxelles va rester cette machine à gérer la prise de pouvoir des transnationales ou bien si on va s'y décider, dans l'urgence s'il le faut, à fonder une Europe digne de ce nom, capable d'agir comme si notre Washington existait déjà, notre Pentagone et notre Palais du Congrès. Quand va-t-on comprendre que cette paralysie à donner un contenu politique à la machine de Bruxelles n'est que le résultat du dividare ut regnare américain ? Bush est un renard culotté qui tente de diviser ce qui n'est même pas encore unifié comme pour manifester tout son mépris pour cette entité qui prétend se hausser au niveau de grande puissance. Mais on s'en fout d'être ou de ne pas être une grande puissance, Monsieur Bush, nous ne raisonnons plus comme vous, vous qui ne représentez plus que la nostalgie des impérialismes catastrophiques de notre propre passé ! Ce n'est pas un hasard si vous êtes incapables de venir à bout de vos véritables ennemis, ceux qui ont détruit deux de vos symboles les plus visibles de votre vanité. Si vous vous en prenez à Saddam Hussein c'est parce qu'il vous correspond, qu'il raisonne comme vous en archaïque conquérant de territoire. Moi je vous mets en garde, Monsieur Bush : votre pays a connu son plus amer échec contre une nation qui appartient à l'ensemble qui avait réussi sa sédentarisation, l'Extrême-Orient. Le Vietnam ne vous a rien appris car l'Irak est précisément la seule nation arabe qui se soit moulée dans cette éthique sédentaire pour des raisons qui remontent sans doute à Sumer où le sédentarisme est né. Vous vous y casserez donc le nez de la même manière, après vous y être embourbé pendant des années et entraîné derrière les Irakiens tous les autres pays hostiles au nomadisme qui caractérise vos pratiques capitalistes. Apprêtez-vous à élargir votre front jusqu'où vous voudrez, car je pense qu'en réalité vous êtes conscient de tous ces dangers et de toutes ces perspectives, mais laissez-nous en-dehors de cette Troisième Guerre Mondiale que vous préparez.
Au fait, pourquoi cette hystérie guerrière ? Parce que vous êtes incapables d'imaginer, de réaliser et de réussir une politique de paix. Vous, le Républicain Bush, car votre pays a donné des Présidents qui sont allé au charbon dans les pires conditions pour faire avancer l'idée et la réalité de la paix. Vous, vous êtes impuissant à transformer la réalité bordelique de cette planète tout en prétendant la régir démocratiquement et à vous ériger en puissance hégémonique. Les temps ont bien changé et tous ceux qui ne vous mégotent pas leur admiration pour ce que vous avez fait entre 1917 et 1945, mêmes eux commencent à douter de vos véritables intentions. Et comme le présent ne fait jamais que manifester le passé et l'avenir, on doit commencer à douter de vos véritables intentions dans le meilleur de votre comportement. Prenez garde à ce que l'on ne soit contraint de réécrire toute l'histoire de votre anti-impérialisme pangermanique et de votre antinazisme. Nous pourrions nous mettre à méditer sur les bénéfices palpables que vous ont apporté nos conflits stupides et oublier que votre prospérité a décuplé sa croissance sur la pourriture de nos démocraties décomposées. Aujourd'hui vous jouez encore sur la dépendance que ces catastrophes historiques ont installé entre certains d'entre-nous comme la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne pour faire passer vos projets fous. Pourquoi ne pas traiter Schroeder de nazi tant que vous y êtes ? Le Président Mitterrand et le peuple français n'ont pas hésité à soutenir la cause de votre père parce que cet autre renard avait réussi à décrocher la légitimation universelle représentée par l'ONU. Mais là aussi, tout le monde n'ignore pas que l'affaire du Koweit a été un piège tendu par vos propre services à Saddam Hussein. C'est votre Envoyée diplomatique spéciale qui a donné à l'Irak le feu vert d'une attaque contre ce petit pays médiéval bourré de pétrole. Faut-il que vous y teniez à ce pétrole ! Un conseil, relisez le livre du général Gudérian, celui qui a dirigé l'opération Barberousse en juin 1941. En plein milieu de sa progression éclair sur Moscou, Hitler lui a donné l'ordre de détourner ses forces vers les champs de pétrole de Bakou, détournement qui a joué un rôle essentiel dans l'effondrement du Reich. En attaquant l'Irak, c'est exactement ce que vous faites, tenter de vous emparer des réserves de carburant pour une autre guerre, bien plus vaste et pour laquelle vous n'êtes pas prêt à faire des prélèvement sur vos propres gisements qui restent encore de loin les plus grands du monde.
A l'issu des élections présidentielles françaises, j'avais écrit une lettre au Président réélu. J'y faisais en quelque sorte acte d'allégeance citoyenne dans la mesure où le suffrage universel reste la dernière action sacrée de nos peuples d'aujourd'hui. Je lui ai fait crédit d'accéder à l'Histoire malgré tous ses handicaps qui pourraient n'être qu'anecdotiques, tant l'Histoire nous enseigne que c'est l'action qui fait les hommes et pas le contraire. Alors voici venu le moment, Monsieur le Président de la République, de " faire Histoire " et de vous opposer en toute tranquillité à cette folle aventure. Notre droit de Veto est le dernier atout, et cet atout est entre vos mains. Mais s'il le faut, si vous hésitez à soutenir le Chancelier Schroeder et son peuple qui paraissent tellement plus fermement décidés à éviter le pire, alors adressez-vous à nous, faites un référendum sur cette question : nous peuple français, acceptons-nous de nous allier à une puissance qui prépare une guerre dont on ne voit ni la fin ni les conséquences sur nos vies ? Avons-nous une raison de mettre en danger le fragile équilibre de notre existence actuelle parce que l'Amérique est impuissante à vaincre ses véritables adversaires, les terroristes d'Al Qaida ? Demandez-nous, Monsieur le Président, vous resterez le premier homme d'état français à ne pas s'être contenté de sa majorité parlementaire pour déclarer l'ouverture du massacre. Ce ne serait pas rien, ce serait même le sacre de votre présence dans la lignée des grands souverains de cette Europe renaissante, mais aussi le début de la constitution d'une citoyenneté renouvelée et peut-être avec l'aide de quelques autres pays amis, le vrai baptême de l'Europe républicaine.
Samedi et dimanche 1 et 2 février 2003
Attention, plongée. Dans une section d'un commentaire de commentaire, celui du Sophiste de Platon par Martin Heidegger. De quoi est-il question dans la partie dont je vais traiter aujourd'hui ? En fait, non pas du commentaire de Platon, mais d'une introduction à ce commentaire à travers Aristote, une introduction tellement volumineuse qu'on met plusieurs centaines de pages avant de trouver Platon. Mais ce détour en vaut certainement la peine, car Heidegger, visiblement, a tout trouvé chez Aristote, tout et y compris son concept de Dasein. Curieusement il emploie déjà ce mot en Allemand comme pivot de son analyse de deux concepts fondamentaux d'Aristote, la Sophia et la Phronesis. Dans la Tradition latine et occidentale en général, ces deux mots sont pratiquement synonymes, ils disent tous les deux quelque chose comme " la sagesse ". Le Dasein, donc, aux prises avec l'alèthéuein, c'est à dire le dévoilement de l'étant, substantif aletheia, traduit par veritas ou vérité, ce qui n'a rien à voir, bien entendu avec l'entente heideggerienne du mot grec. Ce qu'il faut donc déterminer, c'est de savoir laquelle des deux sagesses, la Sophia ou la Phronesis, est la plus apte a favoriser l'alèthéuein, la manifestation du vrai, de l'essence de l'étant.
Je ne sais pas où je vais, je vous préviens tout de suite, car les choses ne sont pas simples et je compte sur l'écriture elle-même pour me donner des pistes de recherche, écriture qui est comme une seconde lecture, la note ultime. Mais une chose se dégage tout de suite de l'analyse des concepts que les Grecs veulent différents, sinon, en effet, on ne comprendrait pas pourquoi ils en ont inventé deux. Heidegger examine donc la nature de Phronesis et de Sophia, constatant que Aristote donne l'avantage à la Sophia. D'où le triomphe historique du mot philosophia plutôt que phronesia dans la tradition de l'étude de la vérité. Quelles sont alors pour Heidegger les différences qui marquent les usages de ces deux mots chez les Grecs. Apparemment les choses sont simples : la phronesis porte sur la praxis, c'est à dire sur l'action, celle de tous les jours, mais aussi l'action politique, technique, bref le comportement d'un Dasein, d'un existant qui a affaire aux choses changeantes, mouvantes par opposition aux " choses " fixes, immuables et dégagées de tout mouvement, de toute kinesis. La phronesis, au fond, est ce qui permet de faire les bons choix au bon moment dans le défilement des choses mouvantes de la vie, tandis que la sophia, elle ne prend en compte, ne se propose comme objet que les choses immobiles et éternelles. Vous avez peut-être déjà compris que Heidegger nous conduit ainsi vers la distinction platonicienne entre l'apparence changeante, et donc du discours qui la prend pour objet c'est à dire la doxa, l'opinion, et la vérité qui, elle, a pour objet, ou sujet comme on veut, les idées situées ailleurs, en-dehors du monde mouvant et sujet à la naissance et à la mort, aux changements liés au temps.
La première conséquence, ou plutôt la première condition qui est liée à de telles définitions, est paradoxale. La phronesis est sagesse, mais elle est sagesse naturelle, ce qui signifie rien moins qu'innée : on est sage, vertueux et aussi habile, malin, par soi, de nature ou de manière innée. On ne peut pas acquérir la phronesis. Il y a des gens sages et puis il y a les fous, dans la juste répartition sur laquelle s'appuie Aristote pour construire sa république oligarchique, dirigée donc par des existants en général spontanément vertueux, ce qui n'exclue pas les vertus d'une bonne pédagogie, donc sages, mais aussi de préférence riches parce que le poudaios, le bourgeois aisé, a prouvé qu'il avait la main heureuse dans les affaires changeantes de ce monde évanescent. Tout le reste est fou, aphronétique, insensé et mérite d'être dirigé par une main de fer pleine de sagesse. La sophia, au contraire, ne va pas de soi dans l'existant, dans l'homme. Elle n'est pas là spontanément à la naissance, mais comme la science, l'épistémè, elle s'acquiert. Comme elle porte sur le monde des idées, c'est à dire sur les paradigmes intemporel des choses réelles du monde changeant, par exemple les mathématiques, il faut aller les chercher là où elles sont, dans le ciel, dans l'ouranos des idées. Il faut, vous l'avez deviné, sortir de la caverne. De plus, la sophia est gratuite au sens où elle ne rapporte rien par elle-même : la sagesse qui s'intéresse aux idées ne rapporte rien tandis que la phronesis permet d'accomplir les actions positives qui donne de l'hédonè à l'existence, du plaisir de vivre. Mais attention, la sophia lui demeure supérieure parce que son eskaton, son point d'arrivée ou sa réalisation, culminent dans la contemplation qui est une hédonè, un plaisir, d'un genre supérieur, c'est à dire absolu.
Une circonstance vient compliquer tout ce schéma que nous connaissons bien depuis que l'Eglise Catholique l'a repris pratiquement tel quel en se contentant de forcer un peu le trait. Cette circonstance est le rôle du langage, car phronesis ou sophia, tout est " méta logou ", c'est à dire au-delà de la parole, ou plutôt à travers la parole. Tout passe par le Logos, lui-même topos essentiel qui appartient à la définition même de l'homme " zoon logon ekon ", animal " faisant passer les choses par la parole ". Or ce logos a aussi le pouvoir de recevoir l'aletheia, de produire le dévoilement de l'étant en son être, mais ce dévoilement comporte deux modes, à savoir l'aléthéuein et le pseudesthai, le dire de l'être et le dire du non-être, le mensonge. Ce dernier appartient aussi à la catégorie du dévoilement, Heidegger dixit, ce qui nous rappelle une logique dialectique dont on ne comprend pas tout de suite ce qu'elle vient faire ici, sauf annoncer le Sophiste et le sophisme, c'est à dire l'art de dire la vérité en mentant. Ou encore l'art de prétendre dire la vérité en mentant. Du point de vue de Platon, le pouvoir de faire être le non-être. Nous verrons ça plus tard.
C'est là que tout va se compliquer et Heidegger va prendre une précaution classique chez lui pour éclairer quelques contradictions qui sautent aux yeux les moins initiés du monde. En effet, je vous invite à essayer d'oublier un peu tout ce vocabulaire qui semble compliquer d'une manière outrancière tout le sujet. Heidegger lui-même semble s'en excuser en expliquant qu'il a été contraint d'en passer par là, c'est à dire par le langage d'Aristote pour éclairer correctement celui de Platon (qui pourtant le précède largement) et il dit ceci : " Aristote barre d'emblée pour ainsi dire tout accès à Platon. C'est là une évidence, si nous nous avisons que nous provenons toujours de ce qui est plus tardif et que c'est en tant que tard venus que nous marchons à reculons vers ce qui est plus précoce ; une telle démarche n'a rien d'arbitraire dans le champ de la considération philosophique fondamentale. / Quand il s'agit de retour historique aux sources vives de notre existence spirituelle, il importe surtout de maintenir le ressort intime du développement historique. Le choix d'un philosophe ou d'une philosophie n'est jamais fortuit. S'il est permis, en fonction de motivations diverses, de prédilections, de se choisir dans l'histoire des possibilités d'existence, des idées, des modèles, et donc de fureter au petit bonheur dans l'histoire, cela ne vaut pas pour la recherche philosophique, si du moins celle-ci doit découvrir le Dasein dans ses fondements et si ce Dasein, nous-mêmes, nous sommes l'histoire ".
Deux conditions donc sont à vérifier pour une véritable recherche philosophique : 1) si celle-ci doit découvrir le Dasein dans ses fondements, 2) si ce Dasein, nous-mêmes, nous sommes l'histoire. Mais malgré ces doutes noté au passage dans un " si ", la messe heideggerienne est dite : il s'agit avant tout de " maintenir le ressort intime du développement historique ", autrement dit il ne faut pas rêver d'une vérité transcendant l'histoire, récupérable " au petit bonheur " dans tel ou tel texte de tel ou tel penseur : tout s'enchaîne pour former destin, et si Aristote barre la route de la compréhension de Platon, c'est que son langage est plus proche du nôtre, d'autant plus proche qu'il a été beaucoup mieux conservé par la théologie, et notamment le pilier de cette dernière " science ", celle de Saint Thomas d'Aquin, sujet principal des études du jeune théologien Heidegger. Je n'ironise pas, car dans l'esprit du philosophe allemand c'est de sa propre histoire qu'il s'agit, de la compréhension du dasein qui l'a atteint lui, au travers d'une herméneutique d'Aristote, Aristote critiquant le point de vue de Platon. Mais au-delà, ou en-deçà du caractère singulier de cette circonstance personnelle de ce penseur nommé Heidegger, il y a autre chose de plus important, et qui va remettre en question le tout de la métaphysique de l'Occident platonicien : c'est l'immersion de la pensée dans l'histoire. Mieux que cela : l'identité de la pensée et du destin.
Reste un doute, ou plutôt deux doutes. La recherche philosophique a-t-elle réellement pour vocation de " découvrir le Dasein dans ses fondements (et que signifie fondements ?) ; et puis ce Dasein, est-il, en vérité fait d'histoire, est-il l'histoire elle-même ? Quelle horreur une telle affirmation aurait-elle soulevée à ce moment-là de l'histoire de la philosophe si elle avait été portée sur la place publique, médiatisée, comme on dit aujourd'hui, à la vitesse de nos ondes et de nos images mouvantes ! Mais cette hypothèse est pour ainsi dire passée en douce dans quelques considérations en passant, exprimées dans une salle perdue de l'université de Marburg devant quelques étudiants médusés et sans doute bien loin de se douter de l'importance du propos. Importance pourquoi ? Car la suite montrera que le jeune assistant savait déjà parfaitement de quoi il parlait, il savait qu'il allait passer sa vie à montrer qu'il n'y avait pas de pensée ni d'existence indépendante de l'histoire. Il osait même déjà dire carrément que l'existence EST l'histoire. Vous rendez vous bien compte de l'énormité de la chose ? Relisez donc l'Histoire biblico-historiographique d'un Bossuet, rappelez-vous seulement qu'il y a , traditionnellement deux histoires, une histoire profane et une histoire Sainte, et que la vérité de l'existence, le Dasein dans ses fondements, est bien loin de résider dans l'histoire profane, c'est à dire dans quelque chose comme les quelques décennies qui séparent Platon d'Aristote, mais dans le Sacré du Texte immatériel et matériel à la fois, de la Vérité gravée une fois pour toute dans la Bible, seule pensée ayant accès aux " fondements ". Le maître du jeune Heidegger, Edmond Husserl, passait alors son temps à démêler justement l'intuition insolemment exposée par son disciple d'avec les transcendantaux qui sauvaient, comme chez Descartes, les apparences d'une fidélité à la tradition occidentale et vaticane.
Alors, pour conclure ce petit commentaire, il faut quand-même en revenir à phronesis et à sophia. Car il y a des contradictions encore cachées dans l'exposition aristotélicienne des deux concepts, contradictions que nous verrons sans aucun doute à l'œuvre dans la critique qui commence maintenant du Sophiste de Platon après 180 pages d'introduction. Lesquelles ? C'est assez simple. La phronésis est sagesse naturelle, elle appartient de ce fait à la physis, à la nature innée chez le sage. Par conséquent elle appartient aussi à la vérité, ou à l'essence de ce qui est à dévoiler, à savoir la vérité de l'étant. La phronesis est ontique, mais malgré cette appartenance douteuse à la réalité mouvante, changeante et mélangée, composée, elle réussit son accord avec l'être des étants puisque le résultat de ses actions sont des réussites. Il faut rappeler que la phronesis est dirigée vers l'action, la praxis, c'est à dire la vie de tous les jours, la politique, l'économie, la guerre etc… , alors que la sophia, elle, ne s'intéresse qu'aux vérités éternelles, immobiles et intangibles, inaltérables. Or cette sophia, elle, elle s'apprend, elle est le résultat d'une païdéia, d'une pédagogie. La sophia s'enseigne par le truchement, notamment des sophistes, payés pour cela, alors que la phronésis est un don, un talent ou un génie (le mot n'est pas encore prononcé mais il le sera chez Kant quelques siècles plus tard), et par conséquent directement et naturellement en harmonie avec l'étant. L'apprentis philosophe peut avoir ou ne pas avoir le talent nécessaire à l'acquisition de la sophia, alors que la phronésis, la sagesse pratique ne peut pas s'acquérir, on la possède ou non, ce qui d'ailleurs opère naturellement le tri entre les dirigeants et les dirigés, les poudaios, les bourgeois auxquels tout réussit, et les autres pauvres fous, incapables de prospérer par eux-mêmes dans ce monde qui bouge tout le temps. Bref, la sophia s'avère comme une machine que chacun peut acquérir (le monde des Idées et ses logiques), quelles que soient les qualités de celui qui fait cette acquisition, alors que la phronesis est une qualité de l'étant lui-même, de l'étant-homme, du Dasein. Alors, qui des deux a le plus de chance de pouvoir s'exprimer sur les fondements du vrai, sur les fondements du Dasein ? Réponse dans le prochain numéro, mais ce ne sera pas pour demain car il reste du pain sur la planche. Je voulais seulement montrer comme ça en passant que le jeune Heidegger savait déjà où il allait en insistant tellement sur la prééminence de la phronesis active sur la sophia contemplative. C'est à dire d'une pensée immergée dans l'histoire réelle et non pas dans un ciel des Idées fantasmatique. J'ajoute ceci, pour que l'on me comprenne bien : à la date où Heidegger écrit cela, la Première Guerre Mondiale vient de s'achever et l'Allemagne n'arrive pas à s'en relever, Dasein peu favorable. Mais le nazisme n'est pas encore au menu du jour, Hitler est encore un peintre autrichien parfaitement inconnu. Mais le jeune Allemand Heidegger ne pense pas à se réfugier dans l'irréel d'une éternité théologique, alors que tout dans sa propre histoire l'y prédispose, il pense à une relève pratique, il pense en Dasein historique, ou en " Dasein = Histoire ". Alors…Alors il reste à se demander si Martin Heidegger était un phronétiste ou un sophiste. Pour Hitler, l'histoire a déjà répondu.
Mardi 4 février 2003
Journée importante, que dis-je plaque tournante de l'Histoire de France, à cause de deux individus qui se rencontrent au Touquet. Il s'agit, comme vous l'avez deviné, de notre Président, désormais seul détenteur du pouvoir exécutif français, tant son ombre de Matignon paraît complètement décroché des réalités. Encore que. Encore qu'il ne faudrait pas négliger le rapport qu'il y a entre les complaisances envers Washington qui se négocient au Touquet et le dossier des retraites dont les Américains attendent la rage au cœur depuis si longtemps qu'on en finisse : ils ont besoin de notre argent, c'est à dire de celui de l'Europe. Au demeurant c'est le seul moyen pour eux de sauver leur dollar en lui accrochant l'Euro sous la forme des placements boursiers. A ce propos une remarque en passant à tous les naïfs et à tous les faux-culs syndicalistes et gouvernementaux qui voudraient nous faire croire à la pérennité de la retraite par répartition : je crois avoir déjà faire remarquer que lorsque toutes les grandes industries seront privatisées, il n'y aura même plus de placements de pères de famille permettant de garantir cette répartition, étant donné qu'ils seront tous condamnés à financer les caprices et les stratégies aveugles des grandes firmes. Encore autrement dit, la Caisse des Dépôts et Consignation, qui gère la plus grande partie de notre argent de retraite, sera obligé d'acheter du Vivendi ou de l'Enron pour capitaliser. Avec quelles garanties ? Donc, tirons déjà un trait sur la retraite par répartition, ce n'est plus qu'un mot creux. Oui, les Américains veulent aussi qu'on en finissent en Europe avec notre " statut de privilégiés " et qu'on raque comme tout le monde en prenant les mêmes risques, il n'y a pas de raisons que nous ayons droit à la sécurité de notre vieillesse alors que les anglo-saxons risquent leur fric tous les jours.
Bon, revenons au Touquet. Chirac et Blair vont peut-être décider sans que nous n'en soyons nécessairement averti. Ce soir on risque fort d'entendre le genre de langue de bois habituel sur la nouvelle Entente Cordiale et autres sornettes comme du temps du sommet de Saint Malo. S'entendre sur quoi ? Alors question : Blair est-il ou non le petit télégraphiste de Bush ? That's the question. Ce matin les éditorialistes de France-Culture ont rivalisé de talent pour analyser la situation de l'Europe au lendemain de la fameuse lettre des huit pays européens qui soutiennent la position américaine. J'en ai déjà parlé l'autre jour en insistant sur le culot des Est-Européens qui ne sont même pas encore membres à part entière de cette Europe et qui s'arrogent le droit (sous la pression de Washington) de signer un torchon qui voudrait engager tous les autres Européens. C'est donc au Touquet que tout va se jouer, entre les deux seuls européens qui possèdent le fameux droit de veto au Conseil de Sécurité. Rappelons que si Berlin y a son siège, l'Allemagne ne possède pas ce fameux droit de veto, sinon je ne me ferai pas de souci. Chirac et son partenaire britannique vont donc devoir, aujourd'hui, accorder leurs violons ou briser là. Accorder leurs violons signifierait que la France et l'Angleterre seront ce soir d'accord pour soutenir ou non l'élaboration d'un nouvel oukase de l'ONU contre Saddam. Soit que Chirac suive les " avis " de Blair, soit que Blair s'incline devant les conseils de Chirac. Ai au contraire ils brisent là, alors nous saurons avec une certaine certitude que Chirac est décidé à faire valoir notre droit de veto. En résumé, si les deux sont d'accord, et là la presse aura bien du mal à le dissimuler, on ne saura rien de ce qui se passera demain à l'ONU, dans le cas contraire on sera soulagé, du moins en ce qui concerne le rôle de la France dans la future guerre.
Cela dit, nous avons tous entendu ce midi, que le porte-avion De Gaulle est parti en " manœuvres " en compagnie d'un porte-avion américain en Méditerranée. Cette mer ne conduit pas dans trente-six directions, il n'y en a que deux : Port-Saïd et la Mer Rouge, ou bien le Détroit de Gibraltar et l'Atlantique. Savoir dans quelle direction sont partis ces deux navires nous renseignerait donc hautement, raison pour laquelle la presse ne dit rien à ce sujet. On ne va pas me faire croire que ces deux villes flottantes vont se contenter de polluer ce qui reste de propre dans la mare aux canards pour vacanciers baléardiens, car il faut savoir que nos vaillants galions se défaussent gaiement de leurs ordures en pleine mer, où qu'ils soient, y compris les produits chimiques périmés et les munitions devenues obsolètes. Je tiens ça d'un informateur tout à fait fiable de Greenpeace. En tout cas on peut déjà conclure une chose de ce petit ballet marin, c'est que la messe n'est pas dite au Touquet, et qu'il y aura vraiment une discussion de tout premier ordre, une négociation dont on parlera dans le futur comme d'un Munich ou, pourquoi pas, comme celle que Pompidou a menée peu avant de mourir aux Açores avec Nixon pour éviter la guerre sino-soviétique et donc mondiale, aussi. Sinon, le Charles De Gaulle serait resté en rade de Toulon, il faut penser au prix de chaque journée de navigation qui doit atteindre le budget annuel de pas mal de communes françaises de grande taille. On peut dire, sans se tromper, qu'on nous mène en bateau, cette croisière est peut-être même le prix du Sommet lui-même. Et qu'on nous fiche la paix avec les autres accords prévus sur l'éducation et je ne sais quoi d'autre.
Aussi, reste-t-il une possibilité pour les deux personnes à qui incombent de telles responsabilités (cela ne s'est pas vu depuis des lustres, car même Mitterrand n'a pas plié avant que l'ONU ait tranché de manière nette et incontournable) : cette possibilité je l'ai déjà évoquée plus haut, c'est que les deux hommes se mettent d'accord pour faire endosser cette responsabilité par leurs deux peuples, et pourquoi pas par toute l'Europe. Nous avons tout le temps qu'il faut pour organiser le tout premier Référendum européen sur la question de la guerre ; ainsi nous verrions bien de quel côté pèse la Raison, à moins que ces messieurs ne soient guère différents de ces autres personnages qui ont conduit l'Europe dans les plus sanglantes des guerres sous prétexte qu'ils étaient l'élite de cette Europe. En même temps nous, les Européens, poserions le premier acte politique. Ce serait notre baptême du feu et peut-être la naissance d'une démocratie digne de ce nom. Faut-il rêver ? Mais non, je suis un fou, c'est bien connu.
Vendredi 7 février 2003
Beaux discours sur la ville sur FC (une fois pour toute FC c'est France-Culture, FT = Financial Times, les deux seuls médias que je fréquente avec le Canard Enchaîné, le meilleur de tous, et de loin, la dernière publication propre et française, de quoi demeurer fier d'être un citoyen de ce pays). On a commencé, évidemment, avec le discours de la Méthode de Descartes et de son introduction sur la nécessité de la tabula rasa. Bon, en gros il me paraît certain que le Chevalier philosophe n'avait rien à dire sur la ville en tant que telle, mais que sa ville à lui était la conscience. Mais soit, on peut tout faire avec tout et faire marche arrière avec une métaphore pour l'utiliser au niveau de la lettre en faisant litière de l'esprit. Bon, cela dit, j'écoute la suite de cette introduction cartésienne et je n'entends rien. Sinon des attaques côté fonction, religion, femmes et le fameux " humain ". Parmi les invités parle un certain Jean-Louis Borloo, Ministre de la Ville, qui me paraît de loin le plus avisé de ces bavards. C'est toute la différence entre les phronétistes et les sophistes. Borloo est en prise directe avec la pratique (enfin dans la mesure où ce gouvernement désordonné et dépassé par les événements lui laisse un peu d'argent pour le faire, ce que je ne pense pas), et par conséquent il ne peut pas bavarder sur la ville. On sent chez ce jeune politicien un réel questionnement sur l'être même de la ville : à quoi ça sert ?
Ce que je ne comprends pas, de la part de philosophes aussi distingués que ceux qui réalisent cette belle émission (…) du vendredi matin, c'est qu'à dix heures moins le quart, c'est à dire trois quart d'heures après le début de l'émission, on n'a pas encore prononcé le mot de Cité. Le cœur originaire de cette réalité qu'est la ville n'est pas encore même évoqué ! Polis, Civis, Cité, cette condensation d'une praxis si nouvelle, si récente dans le destin des hommes que la première question ne peut-être que celle de savoir quel est le sens pratique de cette fabrication ex-nihilo de tas de cailloux (c'est le nom que je préfère quand il s'agit de dépeindre une ville ou une église) qui doivent abriter, servir d'abri aux humains. Car, réfléchissez, la ville n'a rien d'évident, c'est même une véritable folie au sens où le ville met les humains en contact, provoque la violence innée à l'altérité, cette altérité fondée en dernier ressort sur le rapt de l'espace. Ces messieurs qui parlent n'ont pas même avant tout constaté que la ville est le symbole d'un rapt de l'espace par les individus qui ont un jour décidé de s'installer dans un endroit délimité et de s'approprier les surfaces qui le composent. Quel est le document essentiel d'une ville, quelle est son essence graphique ? C'est le cadastre, la vérité sur l'appropriation de ces surfaces végète dans des centaines de volumes que pratiquement personne ne peut jamais approcher, en-dehors de quelques notaires et de quelques juges,.
Et on parle de monuments de prestige, d'église, d'architecture, comme si l'âme des ville étaient l'objet de gestion des urbanistes, des hommes de la science de l'espace et de l'art de l'arranger. Vieille obsession kantienne sur les structures de la Raison Pure et de ce qu'elle produit sur son environnement. On parle, je l'entends à l'instant même, de " belles villes ", non mais, on se fout de nous, une fois de plus. Et cela dans un cadre philosophique ! Où sommes-nous ? Mais la ville c'est toute l'aventure métaphysique de l'Homme, en Occident certes, mais aussi en Chine ou au Japon, où sans doute le sens de la ville demeure autrement conservé, au point d'inscrire dans une ville, une autre ville "interdite ", lieu parfait où s'exerce l'état sédentaire dans son eskaton ou plutôt dans son entéléchie, sa floraison la plus extrême et la plus réussie. Réservée à celui qui régit tout, l'espace, certes, mais aussi le temps. Ah ces Chinois ! Quelle intelligence pratique, quelle phronesis millénaire et qui résiste à toutes les intrusions idéologiques, coloniales, impérialistes et, on le verra bientôt, même économique.
Cette chronique est originale, c'est la première fois que j'écris en écoutant ce dont je parle. A cet instant précis on développe ad libitum le rapport de la ville et de la mort. Nous y voilà, toute l'idée occidentale du Dasein, de l'existence reposant sur cette invention qui s'appelle la mort ! Quelle tristesse ! Mais aussi quelle idiotie, car ces messieurs ne sont mêmes pas assez honnêtes pour constater que les cimetières sont eux-mêmes morts, que la mort est en voie d'évacuation totale de la ville elle-même. L'espace ne veut plus des morts car ils n'ont plus aucun statut dans le pragma, dans l'utile. D'ailleurs les morts n'ont pas été, et de loin pas, les auteurs involontaires de la ville, comme semblent le laisser entendre ces bons commentateurs. Enfin j'entends le mot " habiter ", et tout de suite celui de Heidegger ! Mais seulement en passant, alors que tout est dans ce petit mot d'habiter, de volonté artificielle et alors-là pour le compte vraiment transcendantale, d'atteindre la position immobile, de défier la kinesis, le mouvement, essence de la réalité. J'entends que l'on va bientôt parler de Debord et de la dérive, de la psychogéographie des villes et enfin de ce dont parlait vraiment Descartes, à savoir la volonté méthodique de détruire ce que le sentiment et l'affect humain avaient péniblement aggloméré au cours des millénaires, détruire pour remplacer par l'espace rationnel, le vide de la Raison. Et pourquoi se ruer sur ce vide de la raison ? Réponse simple : rendre l'homme à son essence nomade, rendre l'espace à son mouvement naturel, naturel au sens de l'Essence, celle qu'Aristote n'a pas manqué d'établir pour l'éternité et jusqu'à Einstein.
Même pas. Debord se trompait largement sur le sens de la représentation et du spectacle, mais sa découverte géniale a été de comprendre le rapport charnel concret, la symbiose inconsciente qui unit l'homme à son espace, à son univers. Au point de lui donner les formes qui lui sont intérieures ! Regardez attentivement le château de Versailles : vous pourrez y voir toute la psychopathologie de Louis, comme vous pouvez vous effrayer de l'horreur qui se dégage des cirques romains ou de Cinquième Avenue. On peut lire dans ces monuments toute la folie paranoïaque et mégalomaniaque des humains qui ont conçu ces bâtiments ignobles. Oui, on peut dire que l'attentat du Onze Septembre s'en est pris au cœur même de notre civilisation, à son âme babélienne dévoyée en puissance matérielle, rationalisée selon les instincts les plus triviaux et les plus répugnants que l'homme est capable de contenir en lui. Ce n'est pas un plaidoyer pour Ben Laden, seulement un éclairage de ce qui se joue aujourd'hui dans la réalité de la planète. Etrange : tout le monde se demande pourquoi Bush veut détruire le seul pays arabe réellement sédentaire, et par dessus le marché jacobin, au lieu de concentrer ses forces contre les nomades d'Al Qaida ? Pourquoi ? Fastoche : Bagdad a été, et demeure encore, le seul espace où les musulmans ont réussi leur propre tentative de sédentarisation. Au fond, Bush méprise Ben Laden, ce clochard de la politique mondiale, il ne peut pas accepter de se colleter avec lui. En revanche, Babylone est une ennemie honorable, à la mesure de toute cette puissance ridicule que l'on voit se déployer au nom d'un fantasme inconscient.
Il est dix-heures vingt-cinq et on commence enfin à parler de la circulation et de la mobilité. Dans quelques minutes, lorsque l'animateur va enfin dire qu'il ne reste que quelques secondes, il va enfin être question de la crise de la ville, crise qui n'est que le symptôme du déclin et de la disparition de l'habiter la ville, de l'habiter le monde dans la fixité urbaine et dans l'appropriation de l'espace, ce lien extra-terrestre entre l'homme et son monde. Banco, l'émission se termine à l'instant même. Borloo parle de Séoul, ville sans commerce de rue paraît-il, où devrait se condenser, et ce n'est pas faux, l'universel décrit par Descartes lui-même, la res extensa. Le néant.
Dimanche 9 février 2003
Sangate, Kuntchevo, des camps-symboles où s'entassent des milliers de vagabonds planétaires qui ont fait le pari de l'occident, ont pris tous les risques imaginables aujourd'hui, pour se retrouver dans une banlieue grise de Dortmund ou Liverpool, à la place et dans les taudis des ex-prolétaires dont on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas, je vous l'avoue sans détours, comment penser ce phénomène de migrations massives, dont le mouvement global, et le résultat, ressemble à une course de spermatozoïdes. Pourtant je devrais boire du petit lait puisque ce rush aléatoire corrobore à merveille ma thèse sur le retour du nomadisme. Sauf que les gens qui arrivent, qui traversent des épreuves sans nom pour se retrouver un jour dans une ANPE européenne n'ont eux qu'un rêve : s'installer comme nous paraissons l'être, comme nous le sommes. Ils ont assez, ils en ont marre de quelque chose que nous ne connaissons plus, mais quoi, exactement ? Comme j'ai passé une bonne partie de ma vie dans leurs pays à tous, où je n'ai connu pratiquement que le plus complet bonheur de vivre - et cela non pas comme un toubab richissime envoyé par mon gouvernement ou par je ne sais quelle transnationale mais toujours comme un solitaire, échoué là plutôt qu'ailleurs, ou à la limite recruté chez moi par un gouvernement du Tiers-Monde - j'ai du mal à me mettre dans la peau de ces gens qui ne demandent qu'à fuir, revendiquant, disons en gros, de la " civilisation ".
Je vais donc retourner dans mes propres escapades pour comprendre pourquoi je ne suis pas resté dans ces bonheurs exotiques. Oui, au fond, pourquoi ne suis-je pas resté dans ces pays de rêve où j'atteignais parfois une sorte d'extase totale, quelque chose qui vous prend entièrement, le corps et l'esprit, vous plongeant dans des fantasmes édéniques incroyables, ceux-là mêmes que je vois aujourd'hui pillés et mis en coupe réglée par la publicité touristique. Pourquoi ne suis-je pas resté, j'aurais pu, dans cette île des Caraïbes où ma liberté personnelle et mon confort n'avaient d'égale que la beauté du paysage. Je me souviens, un jour de m'être décidé à me retirer à l'intérieur même de l'île, loin de mon travail qui consistait à gérer une Radio pirate, et à me transformer en anachorète, en ermite vivant des plantes et des fruits qui poussaient là-bas sur le flanc du volcan comme ici dans les serres des maraîchers. Par-terre des ananas en veux-tu en voilà, sur les arbustes des avocats délicieux, des mangues, des fruits que l'on ne connaît même pas encore ici tant ils sont fragilement délicieux. Et puis même des petits cochons noirs tout sauvage qu'il suffit d'amadouer avant de les faire griller sur un feu rudimentaire. Et cet océan en pierre précieuse dont le seule contemplation remplissait toute une journée sans faim et sans soif, sans le moindre souci de retrouver quelqu'un d'autre, d'entendre de la musique ou de boire des liquides qui vous donnent le vertige. Je me serais même arrêté de fumer, et alors là ce n'est pas rien, je peux vous l'affirmer, moi qui fume encore trois à quatre paquets de cigarettes fortes par jour, à 62 ans !
Je raconte quelque part dans mon journal, cette histoire de la rencontre avec un de ces ermites, un prêtre missionnaire perdu sur un petit îlot des Grenadines et qui ne restait là, absolument seul, que pour, disait-il, assurer le salut de quelques pêcheurs antillais plus ou moins nomades, qui lui apportaient en retour quelque sacs de riz et du poisson séché. Je l'avais longuement regardé dans les yeux, en évaluant la maigreur effrayante de son visage et en me demandant ce que cachait encore de pire la soutane élimée mais toujours noire qu'il s'obstinait à exhiber aux rayons brûlants du soleil des Caraïbes. Il était mourant, en fait, mais le cachait si bien qu'il fallut que je dépose le ravitaillement que j'avais chapardé à bord de Chantaloup dans un coin sombre de son église, une bâtisse certes très ancienne, en pierre de taille, une ruine déglinguée sans la moindre porte ou fenêtre, sans le moindre meuble, même pas un lit. Je me souviens d'avoir eu un accès de jalousie, et ma cruauté fut sans pitié. Je lui ai fait comprendre sans détour que j'avais compris, tout compris de son choix " héroïque ". Quand je suis reparti il pleurait. De rage, je pense.
Mais lui au moins, il est resté. Il est sans doute mort là, au sommet de ce petit morceau de corail à peine couvert d'une maigre végétation où ne poussait presque rien, rien en tout cas de ce que je pouvais trouver sur n'importe quel sentier de Montserrat que j'ai bien fini par quitter, presque à toute vitesse. Alors pourquoi ? Je crois que c'est un sentiment végétal qui a mis fin à mon rêve de m'incruster dans cette existence paradisiaque, l'impression qu'en moi poussait un immense tronc mort, que je me transformais en statue de sel. Oui, c'est ça, j'étais devenu un légume, satisfait de ce qu'il tire de sa terre, ouvrant tout grand ses feuilles et ses pétales à la générosité du soleil, du sable fin et de l'eau tiède où grouillait la vie. Un jour j'ai eu un signal en moi : Danger ! Mon rêve se transformait en cauchemar parce qu'en moi quelque chose commençait à paniquer. Oh je n'étais pas claustrophobe comme beaucoup de ces Européens qui débarquaient et reprenaient l'avion un mois plus tard sur ordonnance médicale. Non, je sentais tout simplement que la vie s'arrêtait tout doucement, pour moi, que j'avais entamé une sorte d'agonie spirituelle, un tunnel dont la lointaine extrémité était la mort.
Mais lui au moins, il est resté. Il est sans doute mort là, au sommet de ce petit morceau de corail à peine couvert d'une maigre végétation où ne poussait presque rien, rien en tout cas de ce que je pouvais trouver sur n'importe quel sentier de Montserrat que j'ai bien fini par quitter, presque à toute vitesse. Alors pourquoi ? Je crois que c'est un sentiment végétal qui a mis fin à mon rêve de m'incruster dans cette existence paradisiaque, l'impression qu'en moi poussait un immense tronc mort, que je me transformais en statue de sel. Oui, c'est ça, j'étais devenu un légume, satisfait de ce qu'il tire de sa terre, ouvrant tout grand ses feuilles et ses pétales à la générosité du soleil, du sable fin et de l'eau tiède où grouillait la vie. Un jour j'ai eu un signal en moi : Danger ! Mon rêve se transformait en cauchemar parce qu'en moi quelque chose commençait à paniquer. Oh je n'étais pas claustrophobe comme beaucoup de ces Européens qui débarquaient et reprenaient l'avion un mois plus tard sur ordonnance médicale. Non, je sentais tout simplement que la vie s'arrêtait tout doucement, pour moi, que j'avais entamé une sorte d'agonie spirituelle, un tunnel dont la lointaine extrémité était la mort.
Quand je suis rentré définitivement chez moi, j'ai mis un certain temps à justifier ce retour, j'ai dû écrire et réfléchir, car ce n'était pas simple de comprendre pourquoi j'étais revenu souffrir ici en Alsace, au milieu d'une population dont j'ai toujours ressenti la plus grande hostilité depuis ma naissance. Ma réponse a été métaphysique, je me suis dis que l'homme ne doit pas fuir la martingale de sa naissance, quels que soient les désagréments de la conjoncture dans laquelle il a vu le jour. Comment dire, les jeux étaient faits à ma naissance, dans le lieu que le lancer de dés de mon destin m'avait réservé, et ce simple fait m'est devenu un défi, une contrainte de régler ce problème de ma naissance ici, là où ce crime a eu lieu, là où d'autres humains ont cru qu'ils pouvaient me faire ça à moi, me porter à la vie et me forcer à durer en elle. Amie ou ennemie, la vie m'est apparu ici, à Mulhouse, et, amie ou ennemie j'en finirai ici à Mulhouse où je suis revenu comme par miracle et où je soigne déjà ma future tombe entre mes parents. Amie ou ennemie la vie de tous ces migrants a aussi pris ses racines ailleurs que là où ils vont désormais tenter de s'adapter, de s'intégrer, de disparaître dans une normalité qui leur est essentiellement étrangère. Ils repartiront aussi, tous, comme ils sont venus, mais ça prendra du temps, un temps qui ne dépend pas tellement d'eux, car moi, j'avais toute l'éternité de cette France teigneuse devant moi, tandis que Ahmed ou Chang ne savent pas encore aujourd'hui quand l'eau de l'histoire recommencera de couler dans le fleuve qui baigne la terre où ils sont nés. Bonne chance à vous, mais n'oubliez pas qu'on n'échappe pas à la coordination originaire de la naissance, au point de rencontre entre vous et votre destin.
Lundi 10 février 2003
Que se passe-t-il dans la tête de Georges W. Bush ? Cette question m'a choppé au réveil, ce matin, avant même que je ne prenne connaissance des derniers rebondissements des événements qui agitent les relations américano - européennes. Dans la tête veut dire au plus près le souci dominant, permanent, présent à la conscience de Bush : qu'est-ce-qui peut expliquer cette obstination du président américain à vouloir lancer ses forces sur Bagdad ? Bon, il faut bien comprendre comment j'établis la perspective de cette question : Bush est un homme comme vous et moi, il n'a rien d'un dieu ou d'un démiurge quelconque, il n'est qu'un pion dans un jeu de forces, de contraintes, de besoins et de désirs tout à fait personnels mais aussi qui le dépassent de très haut et de très loin. Quels sont les dates de ses créances et surtout leurs objets ? A qui doit-il de faire, de dire et de penser ce qu'il fait, dit et pense ? Doit-il d'abord quelque chose à lui-même ? Faut-il évoquer sa relation filiale à un père qui avait en quelque sorte commencé le travail contre Saddam Hussein ? La réponse n'est pas évidente lorsqu'on apprend que Bush père a lui-même été surpris par le projet soudain de son fils de s'en prendre à l'Irak pendant que les troupes américaines pataugent dans les montagnes afghanes.
Al Qaida et le onze septembre. Première explication psychologique. Tout de suite après l'attentat de Manhattan, il s'est produit une chose étrange. On se souvient que l'élection de Bush avait été une sorte de non-événement, la première élection américaine dont il a fallu attendre le véritable résultat pendant plusieurs semaines. Autrement dit, Bush n'était qu'un demi-président, un pseudo - Gore en quelque sorte, les Américains montrent qu'ils n'ont aucune raison de distinguer ces deux personnalités. La carrière et la carrure de Bush commence à prendre forme le douze septembre 2001, neuf mois après son élection. Alors bien sûr on peut dire très vite que le peuple américain n'a fait que ce que ferait n'importe quel peuple agressé de la sorte, c'est à dire chercher un père, une protection et une protection qui commence d'abord par une explication d'une telle catastrophe. Sans doute peut-on dire que n'importe quel Gore ou quel Clinton aurait " fait l'affaire " en ces heures dramatiques et qu'il n'y a aucun miracle personnel, aucune raison de talent ou de génie personnel de Bush pour expliquer la montée vertigineuse de sa popularité. Ses réactions, ses discours, ses attitudes théâtrales ne sont que des fabrications médiatiques dans lesquelles l'improvisation strictement personnelle est négligeable. Chaque mot, chaque phrase prononcée en ces minutes de climax intense sont forgés dans le cabinet par les " agrégés " du Président, les hommes payés pour " parler " la politique du président. Ce qui ne signifie pas que l'homme Bush soit insensible, qu'il n'ait aucun talent pour exprimer d'une manière originale et relativement sincère ses propres sentiments. Mais, ces sentiments étaient alors des sentiments collectifs, des sensations et des idées partagées par tout le monde. En tant que journaliste je peux confirmer ce talent naturel qui surgit en n'importe lequel d'entre nous lorsqu'il est confronté directement avec l'événement, pas besoin de notes, de cartons, de préparations rhétoriques pour affronter la caméra, les choses viennent toutes seules, on raconte et les mots et les sentiments guident l'action sans efforts, balayant toute timidité et tout bafouillage. Bush pouvait même improviser sans que cela ne mette en danger les fondements de la politique de l'entourage.
Or, la suite est tout à fait différente. A l'heure qu'il est on peut affirmer que le premier projet central du discours de Bush, anéantir Al Qaida dans son repère afghan est un échec total. La libération du territoire n'est même ni totale, ni certaine, les Talibans continuant de survivre et de nuire dans le plus grand silence médiatique. Autrement dit, la grande première promesse du Président pour venger l'Amérique de l'horreur des Twin Towers tombe à l'eau, l'immense majorité de citoyens rassemblés autour de Bush se désagrège lentement et la seconde naissance du Président perd selon le même rythme tout le brillant dont l'événement aléatoire l'avait gratifié. Ce sur quoi il faut insister ici, c'est le mouvement qu'imprime un tel développement à la conscience du président américain, le dépit qui grandit au fur et à mesure qu'apparaissent les faiblesses de la réponse militaire et aussi les faiblesses du bouclier d'intelligence qui a failli au moment fatal. NSA, CIA, FBI, tous ces services censés protéger de manière absolue le territoire même n'ont pas été à la hauteur de la situation alors même que des renseignements rendaient imminents une catastrophe en quelque sorte annoncée. Beaucoup de citoyens ont pris conscience d'un scénario affreux : en fait l'attentat aurait été attendu par les autorités, qui ont sans doute fait tout ce qu'elles pouvaient pour l'éviter, comme dans un film, mais un thriller qui, cette fois, s'est très mal terminé. Voilà une sorte de vérité qui devient de plus en plus patente, un fantasme peut-être mais qui prend le devant de la conscience collective pendant que là-bas, en Afghanistan, les Talibans disparaissent sans laisser d'adresse et sans livrer le bouc émissaire Ben Laden dont la capture aurait pu mettre une sorte de point final à tout l'affaire.
Tout cela n'est que le cadre général de ce que la conscience du président a vécu ces derniers mois, mais n'explique sans doute pas entièrement le transfert de toute l'agressivité américaine sur la problématique irakienne. Bon, on peut supposer que l'Irak aura été une opportunité de détourner l'opinion américaine, voire mondiale, du véritable problème si difficile à résoudre. C'est là qu'il faut chercher quelque chose comme une dimension originale de la pensée du jeune Bush : son mandat commence pour ainsi dire par une gifle extraordinaire, qu'aucun président américain n'a eu a affronter jamais : quarante et quelques présidents dont aucun n'a été humilié à ce point. Il faut bien méditer cela, Bush est dans une situation unique dans sa propre histoire, une situation qui, en diminuant son prestige historique, affaiblit d'une manière inattendue une hégémonie économique et culturelle qui s'annonçait mondiale sans grande opposition. Même l'Europe était en voie d'admettre une allégeance définitive sur la plupart des dossiers qui embêtaient encore le Pentagone et surtout Wall-Street. C'est à cela qu'il fallait trouver une réponse, un moyen d'effacer les conséquences de la fatalité pour ne pas rester ce Président unique dans l'histoire d'un pays jamais agressé par personne sur son propre territoire. D'où peut-être un réflexe psychologique que l'on peut comprendre, c'est à dire une volte en direction du père, ce homme qui fait partie de tous ces présidents qui non seulement sont restés intouchés par une telle calamité, mais qui se sont illustrés par des victoires dans le monde qui font encore aujourd'hui la gloire des USA. La suite se comprend facilement, l'Irak étant le succès personnel de papa, mais un succès dont toutes les conséquences n'ont pas été tirées en termes d'intérêts pour le pays. Papa n'a pas fini le boulot, même si Clinton lui-même n'a jamais cessé de faire bombarder régulièrement ce pays rebelle à la logique politique pétrolière du Moyen-Orient.
Et c'est là que le problème de conscience de Bush rejoint les intérêts de ses principaux grands électeurs, car dans les créances personnelles de Bush, il faut honorer d'abord ceux par qui on est devenu ce qu'on est. L'entourage. L'histoire du demi-siècle qui vient de s'achever telle que nous la voyons sans doute grossièrement, mais il n'y a pas de fumée sans feu, nous a montré une Amérique politiquement divisée en deux clans que l'on peut aussi définir comme deux ensembles de forces économiques. On a l'habitude de désigner cette division de manière ironique en parlant du parti de Coca Cola et de celui de Pepsi Cola en rappelant que chaque parti qui arrive au pouvoir veille à ce que sa marque de cola soit distribuée dans tous les locaux publics, quitte à virer tous les distributeurs de la marque adverse. On parle par exemple du lobby militaro-industriel pour désigner les magnats de la finance et de l'industrie qui soutiennent traditionnellement les Républicains. On attribue entre autre à ce groupe l'assassinat de Kennedy, prêt à faire une paix au Vietnam hautement nuisible aux intérêts de l'industrie militaire en pleine expansion. Cette industrie représente un vrai problème parce qu'elle a ses racines dans les deux guerres qui ont ravagé le monde entier. Il faut bien saisir un état de fait réel : l'Amérique a mis sur pied une fantastique puissance de production militaire entre 1914 et 1945, une puissance qui représente autant d'importance en termes de politique intérieure, d'économie, d'emplois etc … que du point du vue extérieur en termes de marchés et de concurrence pendant la guerre dite froide. Ce pays est dans une large mesure devenu incapable de gérer une civilisation de paix à cause du poids que représente cette industrie dans l'activité générale. Pas facile de se réadapter à des formes économiques dont la production de biens militaires serait absente, il suffit de songer à la condensation capitalistique que représente l'ensemble d'une industrie qui comprend aussi, par exemple, toute l'avionique, c'est à dire ce qui représente aujourd'hui le poste le plus important des PIB.
Ca fait beaucoup de choses dans la tête de ce pauvre Bush ! Beaucoup de choses qui se condensent aujourd'hui, demain, après-demain et encore pour de longues semaines, dans l'idée d'une victoire nécessaire, d'un triomphe total et réel, palpable, pas comme cet enlisement en Afghanistan qui commence déjà à ressembler à l'autre, là-bas dans notre ancienne Indochine. D'autant que cette victoire-là pourrait arranger tout le monde, tout le monde américain bien entendu, car le contrôle du pétrole irakien, ce n'est pas rien. Dix pour cent de cette matière première mondiale se trouve sous le sol irakien qui transpire littéralement l'or noir, et si les Arabes en général ont trouvé des accords satisfaisants avec les anciens propriétaires des champs pétrolifères du Moyen-Orient, les choses se sont mal passé autant avec l'Iran qu'avec l'Irak. L'Irak devient en même temps un moyen de se venger aussi de l'humiliation infligée par Téhéran aux troupes américaines dans les années quatre-vingt. C'est peut-être ainsi, en mélangeant bien tout cela que l'on peut commencer de comprendre l'objet petit a nommé Irak de Georges W. Bush.
Tout cela est assez inquiétant car tout cela ne ressemble pas beaucoup à l'image que nous avons de l'Amérique traditionnelle, ce grand pays tranquille, qui vit dans son splendide isolement et qui a conquis depuis longtemps son homeostase historique. On peut sentir à travers les éléments de cette analyse, qui ne se veut en aucun cas exhaustive voire réellement pertinente, que l'histoire américaine est en train de changer. Washington a pu faire oublier beaucoup d'échecs et beaucoup de conneries à travers le monde. La Corée, le Vietnam suivi du Cambodge, le Chili et des tas d'autres péchés froidement accomplis dans le cadre de la fameuse vulgate de Monroe qui attribue à l'Amérique le monopole de tout l'hémisphère amérindien et canadien. Mais c'est fini, on ne lui pardonnera pas, cette fois, une nouvelle ânerie qui pourrait conduire le monde dans un nouvel enfer. Car, nous n'avons pas parlé jusqu'ici de toutes les autres préoccupations géopolitiques de Bush : il y a toute l'Asie qui doit le tracasser, et son agressivité était déjà présente avant le onze septembre, il suffit de se souvenir des petites manœuvres en mer de Chine, la Chine qui paraissait être devenue, du jour au lendemain, le premier but de guerre de Washington. Par bonheur Pékin ne s'est pas laissé provoquer par ces coups d'épingle destinés à donner du ventre à tous ces sénateurs qui votent les crédits militaires. Or l'affaire irakienne pourrait bien, si elle avait lieu dans les termes définis par le Pentagone, aboutir à tout autre chose qu'un triomphe à la César des temps nouveaux. En imaginant que l'Irak tombe dans l'escarcelle américaine, on se retrouverait avec un tout nouveau front en Orient, un front qui modifierait du jour au lendemain tous les équilibres géostratégiques de la région. Un Irak américain, le rêve de Bush, représenterait une plate-forme militaire extraordinairement bien placée pour nourrir des rêves de Pichrocole de plus en plus fous. Et c'est peut-être cela qu'il y a tout au fond de la conscience de notre Bush, une idée diabolique de prendre enfin une initiative extérieure pour affermir l'hégémonie américaine, pour la rendre matérielle, d'une substance que l'histoire jusqu'ici n'a jamais connue, même du temps de Guam ou d'Hiroshima.
Sommes-nous en plein Rabelais ? Qui sait ? En tout cas les réactions européennes montrent qu'on est pas loin de le penser de ce côté-ci de l'Atlantique. Il nous reste donc, à nous autres Européens de la " Vieille Europe " aussi une alternative : nous contenter de nous laver les mains de l'action américaine et tenter de rester en-dehors du coup, mais réfléchissez : nous sommes avec l'Otan tellement imbriqués dans la puissance militaire américaine que je ne vois pas comment nous pourrions rester indéfiniment à l'écart de ce qui risque de se passer. Nous avons aussi une autre possibilité, celle de nous affirmer résolument contre ce qu'il y a dans la tête de Georges W.Bush. Mais la stratégie pour une telle opposition reste à définir et pour conclure je redirai ce que j'ai déjà écrit il y a quelques jours, le projet fou de Bush, si projet il y a car rien ne prouve encore qu'il soit décidé à se passer du blanc-seing de l'ONU, doit contribuer à fonder l'Europe politique. Le climax offert par une guerre imminente dont nous ne voulons pas doit nous servir à nous unir enfin politiquement et, pourquoi pas, au niveau le plus démocratique qui soit, celui de la question posée directement aux quinze peuples qui constituent cette vieille Europe.
Mardi 11 février et Jeudi 13 février 2003
Oui, c'est bien ça, plus je vieillis, moins je comprends le monde. Quel paradoxe ! Au moment où je crois saisir enfin le fin mot de l'histoire, et de l'Histoire dans la même foulée, je me rends compte que je patauge de plus en plus dans la gadoue de l'innommable et dans les champs du mystère. Deux espaces qui, fort heureusement, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors question : où est-ce-que ça ne se comprend plus ?
Commençons par la gadoue. Dans l'enfance, puis dans l'adolescence et encore plus tard, il y a une logique ou des logiques qui fonctionnent sans demander leur reste, celles du désir, des affects, de l'envie et de la recherche, disons, grosso merdico, du plaisir.. La vie alors paraît simple et tout s'explique par des positifs et des négatifs qui entourent ces domaines. Bon, il est vrai que je n'ai jamais fonctionné ainsi, jamais. C'est à dire que jamais le désir lié à ce domaine n'a commandé le moindre geste. La réalisation de toutes les choses du besoin, des tendances, de l'envie plate et brute, a toujours été pour moi un simple geste immédiat, lorsqu'il était possible. Me masturber ne demandait jamais, du moins n'en ai-je aucun souvenir, de planification intellectuelle ou de volition clairement planifiée. Ca venait, point final. Et ainsi de suite pour n'importe lequel de ces plaisirs qui doivent remplir un moment du temps mais qui me paraissent toujours plutôt dépendre d'une pulsion plus ou moins contrôlée. Oui, c'est ça, le problème pendant ces années de fermentation du corps est de limiter les débordements, d'introduire une économie dans un foutoir souvent contradictoire de projets qui doivent, somme toute comme d'autres le feront par la suite, remplir les interstices du vide temporel. On joue sa vie comme d'un instrument selon les vibrations parfois simplement musculaires de son être. Ce qui est remarquable dans cette phase de la vie, pour celui qui en a déjà entamée une autre ou plusieurs autres, c'est que cette quête un peu aveugle lisse le temps, lui donne une consistance assez régulière. La vie est un bel étron, pardonnez l'image, qui vient sans se faire prier. D'ailleurs l'une de mes insultes favorites, que je ne prononce jamais qu'intérieurement par respect pour le genre humain, c'est l'expression " chieur de gros ", comme on disait dans le temps scieur de long ou débiteur de brut. On chie gros lorsque le corps est aveuglément satisfait de l'existence. Rien ne retient le chyle ontologique dans les tripes du temps.
Dans les phases qui suivent, les choses changent du tout au tout. Lorsqu'elles changent, évidemment. Je pense qu'on peut rester un chieur de gros toute sa vie et d'ailleurs toute une partie de la littérature s'extasie sur des modèles de ce genre, voyez Balzac ou encore, mais en beaucoup plus fin, Dostoïevski. Les vrais héros du roman ne sont pas l'Idiot ou même D'Artagnan, mais le cardinal Richelieu ou le général Dourakine, les personnages sur lesquels pivote en vérité la réalité du tissu de l'action, les chieurs de gros, quoi. Ou ceux que l'on imagine comme tels. La stabilité du temps, le temps lui-même, est assuré par des personnages entiers, sans failles et qui garantissent tout, le bien comme le mal, la cause et la conséquence, et qui finalement sont ceux qui restent, demeurent au-delà des péripéties. Hé bien, moi je n'ai pas réussi à devenir un chieur de gros. Et c'est la raison pour laquelle je me sens de plus en plus paumé par rapport à ce champ qui sépare tout ce domaine dont j'ai parlé plus haut, celui du désir et du besoin, et le reste. Il y a perte de sens et donc d'intérêt. Ce qui se passe alors ressemble à une sortie de jeu, on dit pouce, on ne joue plus avec et comme les autres, et on finit par ne plus rien comprendre.
Bon, mes maîtres ont bien saisi cette dimension de ma personnalité déjà dans mon adolescence. Chez les bon Pères on me punissait pour manquement au jeu, pour le fait de me vautrer en marge du groupe et de faire la fine bouche sur les jeux de groupe. Punissait ! On ne me plaignait pas, ce qui aurait été logique car le résultat de mon comportement était une solitude et une distance aussi douloureuse pour moi que navrante ou vexante pour les autres. Encore que ce statut d'autre était défini et géré par les Pères, car en réalité mes copains se foutaient éperdument que je joue ou non avec eux. Sauf quelques uns d'entre-eux qui sont devenus tous de bon gros chieurs de gros. J'en ai encore vu un l'autre soir dans un restaurant chinois, énorme, fier de son gros bide et de sa moumoute à cent mille balles, il était devenu une sorte de Tapie régional, brutal, cynique mais croyant, un croyant d'une espèce très spéciale, celle qui a foi dans sa seule satisfaction. Vous savez, comme ces mafieux de thriller américain qui sont content lorsqu'ils ont réussi à humilier un individu pour démontrer que leur étron est toujours le plus lisse et le plus volumineux. Le moindre doute et c'est la colère, la haine, la violence et le meurtre. Le moindre doute, alors que je vis, moi, dans le black total. La satisfaction me tombe parfois dessus comme un ange, un moment de jubilation de moi-même que je ne comprends même pas, mais la règle générale c'est : c'est quoi tout ce merdier ? De l'autre côté, en revanche, mais comment caractériser cet autre côté, ma vie, mon existence s'éclaircie de jour en jour. Moins elle est liée à des volitions qui me concernent moi, mon corps ou je ne sais quoi d'autre, plus mon monde se nimbe de lumière. Et cette lumière n'est pas simplement une clarté, un savoir immédiat au sujet d'un objet qui serait ce monde, mais la complétion de moi et du monde. Des retrouvailles.
Mais pour en revenir au sujet, à ma déroute originelle, même si elle n'a pas une très grande importance, finalement, je dirais que je comprends de moins en moins le cours des affaires du monde. La simplicité de la dynamique de la jeunesse, dans la réalisation de ses désirs et de ses passions n'est pas lisible dans le groupe, dans ce qui passe pour la " société " (Vous savez que je demeure totalement sceptique sur l'existence de quelque chose comme une société, fidèle en cela à l'analyse de Marx dans l'Idéologie Allemande. Cela demande peut-être quelques précisions, mais pour aller vite, je dirai seulement qu'une société demande, dans sa définition, une cohérence éthique, c'est à dire une justice délimitant soigneusement l'espace du groupe d'humains que l'on désigne comme une société, or cette cohérence éthique fait défaut quelle que soit l'ensemble social considéré. Une société serait, selon l'analyse marxienne, un ensemble stable dans lequel la relation entre l'individu et les autres aurait un caractère direct, c'est à dire que la justice serait en mesure de régler tous les conflits, sans compromis statistique, compromis qui dissimule toujours des alliances de classe à caractère violent. Au fond, le concept de société implique au moins la paix sociale sans reste, mais allez imaginer un tel état ! ). Autrement dit, je ne vois plus d'autres mouvements passionnels que ceux qui se manifestent à travers la consommation, une consommation dirigée, encadrée, programmée par une économétrie dont personne ne mesure la puissance : le marketing est la vraie dictature du présent, celle-là même qui empêche toute existence de société. Cette constatation est d'une gravité immense car elle expose sans voile une vérité inquiétante : les désirs, les affects, les passions des hommes d'aujourd'hui trouvent leurs objets de manière totalement inconsciente, c'est à dire ne trouve que des objets de substitution. L'exemple le plus évident reste la ruée sur l'automobile, la vitesse et cette recherche inconsciente de l'accident et de la mort, et qui n'est qu'une affaire banalement sexuelle.
Le sexe n'a pas seulement été refoulé au plan individuel, il est autrement plus grave de devoir se rendre compte que la sexualité a été collectivement réorientée vers des comportements de plus en plus difficiles à contrôler. D'où vient la violence sociale qui semble augmenter de jours en jours ? On peut résumer la réponse par ce slogan devenu pour beaucoup simplement risible, et qui pourtant contient toute la vérité du mensonge actuel : faites l'amour, pas la guerre. Celle qui se prépare en Irak n'est que la plus récente illustration de l'impuissance pitoyable de l'humanité à se trouver un état de paix dans lequel elle serait capable de se vivre dans l'échange, le don et le plaisir d'être. Je rappelle en passant que le massacre des Cathares a eu comme raison fondamentale le fait que ces hérétiques avaient trouvé le moyen doctrinal, la réponse métaphysique qui leur permettait d'être heureux : les seigneurs de l'orthodoxie catholique ont tué dans l'œuf la foi dans la possibilité de vivre en paix avec soi-même et avec les autres dans autre chose que la répression du désir.
Ma perplexité se transfère donc en permanence dans le politique. Ce matin encore (nous sommes déjà jeudi) tout le monde s'interroge sur l'impuissance des intellectuels à parler, à se prononcer et à influer sur les événements tragiques qui se préparent un peu partout dans le monde. Je suis l'un de ces intellectuels et mon impuissance ne provient pas de mon incapacité à analyser ce qui se passe, mais à faire passer mon analyse dans le discours social. Ce discours social est clos, fermé, censuré à un degré que le monde n'a sans doute jamais connu parce que fil de fer culturel est devenu technique, imparable. Cathares, résistants, intellectuels honnêtes, " bonshommes ", nous sommes tous condamnés à la fermer et à subir, comme ce fut le cas dès le lendemain de l'assassinat de Jaurès. L'heure des Vilain est arrivé.
Vendredi 14 février 2003
Depuis quelques semaines ma conviction grandit que les plus distingués des marxistes n'ont pas compris l'idée principale de leur maître Karl. Quelle est cette idée ? Mais avant d'y venir posons une autre question : Karl Marx lui-même était-il au clair avec cette idée au point de l'exprimer distinctement et sans ambiguïté dans l'un ou l'autre de ses écrits. Je me flatte de bien connaître ces écrits, bien qu'il faille rester prudent autant à propos de l'exhaustivité des publications qu'au délicat problème de la traduction. Mais je dois dire que l'idée en question ne saurait être que déduite de l'œuvre, mais qu'elle ne figure nulle part telle quelle, ou telle que je vais l'exposer à ma façon.
Cette idée concerne l'interprétation de l'Histoire humaine : cette histoire est-elle l'histoire de la lutte des classes (En ce cas il faudrait, selon Marx, plutôt parler de pré-histoire, puisque selon lui la véritable histoire ne saurait commencer qu'avec le Communisme, et, je le précise, non pas le socialisme qui n'est qu'une phase transitoire.) ou bien cette lutte des classes ne commence-t-elle réellement qu'avec l'apparition du capitalisme ? D'un point de vue orthodoxe, la réponse des marxistes consiste à dire que la lutte des classes ne peut apparaître en tant que telle que là où le capitalisme a déjà créé des classes sociales qui doivent entrer nécessairement en conflit. Cela pose évidemment de redoutables questions sur la définition des classes sociales pré-capitalistes, et ce depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, considérée en général comme la première phase du capitalisme réel. Si le capitalisme est bien la seule réalité qui puisse expliquer les phases historiques précédentes, cela ne signifie pas que la lutte était déjà la rationalité dominant les relations entre les classes sociales de la période qui précède la Renaissance. Voilà tout le problème que nous allons tenter d'élucider aujourd'hui. C'est d'ailleurs toujours, dans ma vision historique, une constante que de me soucier " d'humaniser " ce que l'idéologie courante a jusqu'à présent considérée comme une réalité évolutive qui aurait transformé progressivement le barbare, ou l'homme sauvage, en être humain ou civilisé. Mes lecteurs savent combien je tiens à cette intuition, mais il s'agit là beaucoup plus que d'une intuition, qui dit que l'homme a toujours été l'Homme et jamais moins que ce qu'il est aujourd'hui, ou même moins que ce qu'il aurait pu être à certains moment de son Histoire (ce que laisserait entendre certaines interprétation métaphysiques sur le miracle grec, par exemple, ou encore certains mythes d'un âge d'or etc…).
Cette idée à laquelle je reviens à présent est simple : les classes sociales, dès le moment où elles apparaissent en tant que telles, que ce soit donc en tant que castes ou en tant que différences de statuts (homme libre / esclave / métèque / salarié / cadre et je ne sais quoi encore), sont en lutte. Autrement résumé, dès lors que les humains décident de vivre en collectivités, et que cette décision aboutit à la formation de classes sociales, ces classes sont en opposition violente, même si la violence peut se condenser ou se replier sous des formes politiques, selon le théorème de Clausewitz. Le principe de la guerre prévalant pratiquement comme culture fondamentale depuis la nuit des temps, cette violence apparaît toujours dans l'histoire comme une violence de collectivité à collectivité, et ceci non seulement à l'intérieur du champ des nations, mais encore à l'intérieur de limites idéologiques comme les religions ou même tout simplement les langues. On n'a pas besoin ici de détails pour comprendre ce que j'écris. Cette violence qui relève de l'historiographie officielle masque en réalité une lutte bien plus générale et tout aussi permanente que la guerre telle que nous la définissons aujourd'hui, c'est à dire à la veille de sa résurgence au Moyen-Orient à l'initiative du génie des Appalaches, monsieur Jojo Deubeliou Bush. Ce n'est que ma haine pour cet imbécile qui vous vaut un aussi mauvais jeu de mots et je m'en excuse d'avance sans qu'il soit question que j'efface ces quelques lignes.
Le seul intellectuel, à ma connaissance, qui ait repris l'idée de Marx dans toute la rigueur que je reprends ici à mon compte, est Brecht. Lui seul a saisi intuitivement, et sur la base de son expérience théâtrale, l'idée que dans l'histoire occidentale il existait deux chemins (cela nous rappelle la Déesse de Parménide qui envoie le poète sur Deux Chemins, celui de l'Être et celui du Non-Être). Le premier est celui de la chronique officielle des événements, celui de l'histoire telle que la Tradition plus ou moins homogène nous la rapporte et qui porte en bref sur la succession des souverains et des formes de souveraineté. Dans cette histoire-là, on n'omet certes pas les divisions qui se forment à l'intérieur de l'exercice du pouvoir par ces différents souverains et formes de souveraineté, telles que les divisions religieuses ou irrédentistes. Mais sur cette voie on affirme parallèlement à l'analyse centrale une sorte de statut quo, de toutes choses égales ailleurs, c'est à dire d'inertie historique voire de quasi inexistence de tout élément intégrable à de l'histoire ou à de l'historique. La nouvelle histoire ne change rien essentiellement à cet état de chose dans la mesure où elle ne s'intéresse elle-même que marginalement à des mouvements sociaux infra-politiques dont on ne parle pas et que l'on ne reconnaît pas comme des faits historiques. Un exemple récent permet de comprendre ce que je veux dire ici : pendant toute la durée de la Guerre d'Algérie, et pendant longtemps après encore, il n'a jamais été question de voir dans ces actions militaires autre chose que des péripéties secondaires, ressortissant au maintien de l'ordre. Mais cet exemple est extrême, il suffirait de citer aujourd'hui la plupart des actions terroristes (ou non) liées à l'irrédentisme - dont le meilleur exemple demeure l'actualité du Pays Basque - pour bien constater que personne n'oserait intégrer l'activité des nationalistes basques à de l'histoire réelle, mais qu'il convient nécessairement de considérer ces événements comme des faits divers à la limite de la pathologie qui peut s'emparer de certaine collectivités.
Or il n'en est rien. De l'Irlande au Sri Lanka, en passant donc par le Pays-Basque, le nationalisme reflète bien le malentendu entre l'histoire officielle et l'autre histoire, celle qu'il faut à tout prix enfouir au plus profond de l'oubli commun. Ces exemples forment en un certain sens paradoxalement des sortes d'abcès de fixation qui permettent d'ailleurs de renforcer les oublis qui affectent des domaines bien plus vastes et plus universaux. C'est ça, c'est au concept d'universel qu'il faut faire appel pour comprendre qu'à côté de l'Histoire universelle qui a cours forcé dans nos écoles et dans nos têtes, il y a une autre Histoire tout aussi universelle qui, elle, a été effacée de nos références pédagogiques et de notre mémoire elle-même. Pour décrire cette histoire-là, que la plupart d'entre nous ignore, dont la plupart des manuels et des études les plus discrètes ne font aucune mention alors qu'elle représente au minimum la moitié de toute l'Histoire elle-même, je ne prendrai que trois exemples, trois exemples qui devraient cependant suffire à faire la soudure entre toutes les époques, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.
La première remonte aux Grecs. Je fais remarquer que mes connaissances historiques, mais aussi la connaissance historique en général, ne me permet pas de remonter bien plus haut, bien qu'une étude attentive des Livres Sacrés, tous les grands textes mythiques et religieux, suffirait à montrer que cette dualité des réalités historiques remonte bien en-deçà de l'époque antique qui nous sert si facilement de référence. Mais laissons cela et limitons-nous à notre programme qui nous conduira d'Athènes et de Sparte à Bilbao et Madrid. Ainsi, la société grecque, et donc les événements qui y sont liés, aurait été construite selon le schéma classique que j'évoquais plus haut. Ces castes plus ou moins en paix selon que les lois étaient plus ou moins libérales et plus ou moins bien respectées. Car il faut rappeler que le statut des esclaves à Athènes n'a pas grand chose à voir avec celui des esclaves à Sparte, où l'on avait une conscience quasi constitutionnelle de l'état d'hostilité permanent entre les citoyens libres et leurs serviteurs dénués de tout droit. A Athènes, l'état d'esclave était réputé plus doux même si là encore il faut distinguer entre les serviteurs qui oeuvraient à l'intérieur de la Cité, et qui de par cette situation même étaient voués à des tâches relativement humaines, comme la gestion des domaines, le service domestique ou encore l'éducation des enfants, et les esclaves qui se tuaient à la tâche dans les mines d'argent ou d'or toutes situées à l'extérieur des murs de la grande ville dont elles dépendaient. L'esclave athénien pouvait espérer vivre plusieurs dizaines d'années avant de mourir d'épuisement ou de disette, alors que le mineur de chez Thucydide et Cie ne devait pas s'imaginer dépasser les trois ou quatre ans de survie. Or, parallèlement à cette réalité sociale que l'on pourrait imaginer comme pacifique, ou disons pour le moins stable - ce qu'elle était beaucoup moins à Sparte où la chasse aux rebelles faisait partie de l'entraînement des jeunes citoyens, il y en avait une autre, une autre opposition permanente qui traversait toutes les cités grecques depuis les côtes libanaises, turques ou même aujourd'hui russes, jusqu'à celles qui émaillaient les côtes et l'intérieur de l'Italie, des Balkans, de la Sicile, en bref de toute la Méditérranée.
Cette opposition était politique et nous n'allons pas nous étendre là-dessus, tout le monde devrait d'abord connaître à fond la Guerre du Péloponnèse, et ensuite les raisons profondes de cette guerre qui n'était pas autre chose que le conflit permanent entre les démocrates athéniens et les tenants de l'aristocratie ou de la dictature lacédémoniens, c'est à dire originaire de Sparte. Au demeurant, cette guerre qui a duré quarante ans et qui a signé le déclin définitif de la Grèce antique, n'aura été que le prolongement et l'achèvement au bénéfice provisoire de Sparte, de l'opposition politique fondamentale entre le modèle démocratique de Clisthène l'Athénien et l'entêtement de Sparte à défendre partout où elle le pouvait les modèles oligarchiques et tyranniques. Il faut bien saisir cette image d'une Hellade où chaque village, chaque cité, chaque conurbation telle qu'en a connue Athènes où Syracuse, étaient divisés en deux clans qui s'affrontaient en permanence, donnant à la guerre en général un aspect mixte de guerre nationale et de guerre civile. En résumé, nous pouvons déjà voir d'un seul coup d'œil ce dédoublement de l'histoire grecque qu'aucune chronique (à l'exception de quelques thèses qui osent s'approcher de cette analyse sans toutefois lui donner toute sa dimension sociologique, je pense notamment à la monumentale histoire de la Grèce de Gustave Glotz et de quelques textes cardinaux comme ceux de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet).
Vient ensuite la période dite obscure, l'histoire des Empires romains que l'on peut diviser en gros en deux partie, l'une qui répond sur le territoire italien à celle des Grecs et qui suit les mêmes oppositions et le même destin impérial et impérialiste, l'autre qui constitue le début de l'histoire du Christianisme qui, elle, finit par s'emparer de l'Histoire toute entière pour aboutir deux mille ans plus tard à sa crise finale dont nous n'avons pas encore essuyé tous les plâtres. Et c'est précisément à l'intérieur de cette histoire religieuse que se situera désormais et jusqu'à nos jours cette autre histoire recouverte du voile de l'oubli et du refoulement tant officiel que sociologique, au point qu'on pourrait presque dire que la société moderne a refoulé dans son inconscient collectif la moitié de son passé.
Il y a plusieurs phases dans la guerre religieuse, guerre qu'il faudra désormais considérer comme la véritable lutte de classe qui traversera toute l'autre histoire, celle que l'on prétend connaître à l'aide de dates et de noms de seigneurs féodaux, de monarques, de dynasties et même de gouvernements impériaux ou républicains. En gros trois phases : la première est la plus ma connue et la plus dissimulée aux consciences des peuples de l'Europe chrétienne, c'est celle des luttes internes entre sectes chrétiennes. Nous avons assez parlé des sept ou huit siècles pendant lesquels se sont allègrement massacrés les ariens, les orthodoxes, les manichéens, les gnostiques et les mille autres minorités de Chrétiens dits Primitifs. Nous avons même souligné, n'en déplaise à Bossuet et à son histoire bidon de la persécution romaine, combien ces conflits internes à la religion du Christ avaient coûté de sang, une quantité à côté de laquelle les ravages dont se sont rendus responsables quelques empereurs romains paraissent infimes. Il faut préciser que l'enjeu de ces guerres n'étaient pas rien puisqu'il reposait tout entier sur des interprétations doctrinales dont les conséquences sur la réalité politique et sociale des peuples étaient immédiates. Un seul exemple, celui des manichéens, les toutes premières victimes massives de la répression des forces orthodoxes toujours appuyées par des forces politiques profanes, c'est à dire par des gouvernements romains convertis comme ceux de Constantin et de Justinien. Justinien a fait tuer à lui tout seul plus de Chrétiens Ariens que tous les empereurs de Néron jusqu'à Dioclétien, le terrible Dioclétien qui aurait, selon Bossuet, anéantit la quasi totalité de la communauté chrétienne de son temps, alors qu'il s'est contenté de démanteler des diocèses devenus plus puissants que ses propres préfectures en contraignant les élites chrétiennes à se renier ou à mourir. Le crime des manichéens était de penser que le monde était conduit par deux forces opposées, le Bien et le Mal, et comme le Mal s'illustrait d'abord par l'injustice et la tyrannie, il devenait logique que ces Chrétiens s'en prennent d'abord au pouvoir temporel et à ses représentants. Le refus d'admettre la divinité du Christ comportait les mêmes inconvénients pour les autorités laïques dans la mesure où si on ne reconnaissait pas la possibilité pour un homme réel d'être en vérité un dieu incarné, on ne pourrait jamais admettre qu'un Prince puisse détenir son pouvoir d'une divinité quelconque. Or ce n'est que de cette reconnaissance que peut dériver tout possibilité monarchique. Nous en avons aussi déjà longuement traité.
La suite est plus neuve, car elle va de la révolte Cathare, à partir du dixième siècle, jusqu'à la paix par épuisement du conflit qui prend feu au dix-septième siècle entre les jansénistes et les molinistes ou les jésuites, conflit dont nous avons également suffisamment traité, ici et là. Mais si je reviens aujourd'hui sur cette partie de notre histoire, c'est parce que j'ai découvert, levé le voile un peu par hasard, sur toute une époque extrêmement révélatrice de ce qui se passe réellement dans cette histoire classée monument académique et dont le mensonge par omission constitue une véritable tradition de faussaires. Cela se passe au début du seizième siècle, le siècle de la Renaissance, mais aussi celui du début des guerres de religion, et pour cause. En fait, entre les Cathares qui avaient inventé une société non pas sans classes mais sans tyrannie, et la Réforme de Luther, de Calvin et de Swingli, il y a une continuité sans faille. Je rappelle que je suis allé, il n'y a pas si longtemps jusqu'à une interprétation quasi religieuse de la guerre de Cent Ans, époque où l'anglicanisme était déjà né, l'anglicanisme dont la doctrine contient déjà toutes les semences du Protestantisme ultérieur et dont l'influence expliquerait la férocité avec laquelle les Britanniques ont exterminé celle qui représentait encore le catholicisme légitimiste des Français, la pauvre Jeanne d'Arc. Or le plus important dans ma découverte n'est pas cette continuité qui va du Christianisme primitif à la Réforme, mais qu'à l'intérieur de la Réforme elle-même, exactement comme à l'intérieur du Catholicisme officiel, s'est constitué une fissure colmatée provisoirement, et heureusement pour l'Eglise Luthérienne et les autres églises protestantes ou évangéliques par le sang de centaines de milliers de paysans germaniques massacrés avec l'aval des Réformateurs et des Humanistes comme Erasme, Bucer ou Mélanchton.
L'histoire de l'un d'entre-eux, Sébastian Franck, révèle cette scission, qui en réalité est une scission entre les nouveaux bergers et leurs brebis, entre les Luther soumis aux Princes et les paysans qui avaient naïvement cru en Luther et en sa force de rébellion contre Rome et ses spadassins. Je reparlerai de Franck, car son destin est fascinant. Ce fils du peuple doué a d'abord cru au message de Luther qu'il a vu en déclamer le contenu du haut d'une chaire de la cathédrale de Strasbourg. Devenu pasteur, il a assisté alors à deux réalités contradictoires, inassimilables pour lui aux commandements de la nouvelle doctrine : d'une part le massacre des paysans, légitimé et encouragé par Luther lui-même, d'autre part la déliquescence des mœurs que cette même doctrine du salut individuel venait en quelque sorte démultiplier en la libérant des griffes des envoyés du Vatican. Au résultat, Franck fut pourchassé comme un pestiféré par tous les Réformateurs et les Humanistes, y compris Erasme et Melanchton, qui allèrent même jusqu'à entreprendre un lobbying impitoyable afin qu'il ne trouvât plus nulle part un abri pour lui, sa femme et ses huit enfants. Les lettres et les rapports qui circulaient de Rotterdam, Wittenberg, Nüremberg à Strasbourg, Ulm et Bâle où il mourut à quarante trois ans de la peste, me font penser à ces rapports de sommier de la DST ou des Renseignements Généraux qui plombent aujourd'hui encore de leurs mensonges la vie de centaines de citoyens honnêtes et courageux. Au fond, Sebastian Franck n'est qu'un petit exemple de la trajectoire naturelle de tous ces hommes qui se battent depuis la nuit des temps antiques et pré-antiques pour défendre, non pas des idéologies farfelues et irréalistes, mais les idées les plus simples de paix et de vertu sociales. Il ne pouvait pas savoir, lui le sédentaire pourchassé et devenu nomade, qu'aucune collectivité ne tolérerait ces qualités, avant, du moins, qu'elle devienne une véritable société. Mais ça, c'est un autre problème.
Mercredi 19 février 2003
Le pluriel de bonhomme est bonshommes. Mais ça se prononce bonzommes et non pas, comme la plupart des gens le font avec une scandaleuse assurance en disant des bonhommes, des bonne-hommes. Des bonnehommes, ça n'existe pas, pire, c'est une insulte, non pas à la grammaire dont on se contrefiche, mais aux véritables bonshommes, qui ont existé, jadis entre le dixième et le quinzième siècle. Et qui, dieu merci, existent encore de nos jours. Mais avant de parler de ces derniers, quelques précisions sur les bonshommes. Dans le Haut Moyen-Âge il existait une multitude de sectes chrétiennes pratiquement toutes condamnées pour hérésie. A côté des célèbres Cathares, ignoblement massacrés par les forces conjuguées de l'Eglise de Rome et de la noblesse soumise au Pape, il y avait aussi par exemple les Patarins en Italie, les Publicains en Champagne, les Populicani en Angleterre ou encore les Vaudois de Lyon, adeptes de la doctrine du dénommé Valdès, la seule hérésie qui a survécu jusqu'à nos jours et qui possède même une université à Rome et un centre important à Turin. Ce trait commun à tous ces groupes dispersés dans l'Europe des Capétiens et des Empereurs Germaniques était précisément le Bonhomme, l'homme bon, le militant de base de ces sectes qui n'avaient rien de sectaire puisqu'ils ne faisaient que prêcher le retour au Christianisme primitif, aux vertus de pauvreté des premiers Chrétiens, des disciples du Christ et la condamnation de toutes les perversions qui corrompaient alors l'appareil ecclésial romain. Tous les historiens des religions étudient les relations qu'il pourrait y avoir entre ces mouvements hérétiques et la Réforme protestante, lancée dans l'espace européen à la fin du quinzième siècle par quelques illuminés nommés Luther, Calvin, Müntzer ou Zwingli, des mouvements qui ont eu comme on sait des fortunes fort diverses. Il n'est pas surprenant de constater que la quasi totalité de ces savants ont répondu non à la question de savoir si la Réforme protestante avait quelques racines dans ce passé hérésiarque. Que Luther ait fait sa carrière au milieu des paysans révoltés contre la corruption du clergé et le cynisme de la noblesse, que sa doctrine primitive et surtout ses appels à la révolte rappellent étrangement toutes ces hérésies anciennes, tout cela est farouchement nié d'abord par Luther lui-même, qui approuvera le massacre des paysans, et par tous les " humanistes " ou théologiens protestants jusqu'à nos jours.
Ce n'est pas un hasard ni une incongruité car, comme j'ai tenté de le laisser entendre dans ma précédente chronique, ces mouvements religieux forment dans la réalité pré-médiévale et médiévale un véritable front de classe, luttant non seulement contre l'Eglise toute puissante et toute possédante, mais aussi contre ses mercenaires, ces hommes de sac et de corde qui allaient former plus tard la noblesse française. Le fait avéré que la féodalité de base, celle qui se forme déjà au cinquième siècle après la débâcle des Huns, n'est pas d'origine gauloise ni occitane ni même bourguignonne, mais franque, c'est à dire germanique, prouve sans contestation possible, qu'en vérité l'Eglise catholique s'est servie de mercenaires étrangers pour mater les autochtones. Le mot de Français dérive bel et bien du mot Franc, tribu germanique qui a envahi la Gaule affaiblie par l'anarchie qui déchirait l'Empire romain et les invasions de toutes parts. J'ai analysé ailleurs combien cette origine étrangère allait peser sur les relations entre les populations autochtones et leurs seigneurs et comment cette solidarité tribale des nobles allait former une classe sociale dirigeante en rien comparable avec les noblesses des autres pays européens. La noblesse française restera en tout temps réellement étrangère à son propre pays, vivant dans une réalité artificielle marquée par un état de guerre civile quasi permanent, une guerre tempérée par le développement de la bourgeoisie, bourgeoisie que l'on pourrait sans rire comparer à nos syndicats d'aujourd'hui. Dès Louis XI, cette anomalie pour ainsi dire chromosomique sera combattue avec force et détermination par un pouvoir central né par hasard et grâce au caprice de l'empereur Julien qui s'était pris d'affection pour Lutèce et le bassin parisien. Louis XIV achèvera de domestiquer cette noblesse sauvage encore toute imprégnée des mœurs nomades et altiers de ces Germains qui ont été les seuls à tenir tête à toutes les légions de Rome. La Fronde, ce Mai 68 des petits seigneurs vexés, permettra encore à certains d'entre-eux, comme les Condé par exemple, à exhiber quelques vestiges de leur ancienne audace et de leur ancien mépris pour toute autorité autre que la leur. Mais la victoire de l'enfant qu'était Louis à cette époque prouve que la horde d'origine avait perdu toute sa puissance, toute sa cohérence tribale et tout son sens de la liberté du Germain tel que le décrit Tacite. Les Francs qui se sont emparés de la France pendant les siècles obscures étaient devenus ces Allemands ramollis par l'occupation et devenus par la suite ce peuple de techniciens habiles mais dont le Deutsch Mark si puissant n'aura finalement servi qu'à occuper en touristes tout ce sud qu'ils ont de tout temps convoité.
Je ne voulais pas faire un cours d'histoire, et j'espère que je ne vous ai pas trop barbé avec ces récits qui on un petit air pédantesque. Je voulais en venir, ou en rester à notre Bonhomme, à nos Bonzommes, pour vous faire part de cette découverte étrange mais dans le fond extrêmement réjouissante : nous sommes tous devenus des bonzommes, à l'exception peut-être de ceux qui sont restés des Francs français, ces barons transformés tardivement en capitaines d'industrie et dont tous les gouvernements depuis la Grande Révolution ont eu besoin comme Lénine avait fait sa NEP pour s'attirer les faveurs des ingénieurs de l'industrie. Dans notre France actuelle, il y a bien lieu de constater un durcissement des mœurs, la violence qui produit la fameuse " insécurité ", mais aussi et surtout une mutation de plus en plus prégnante, palpable et sensible de la situation des salariés, quel que soit le secteur considéré. Depuis le choc pétrolier des années soixante-dix, une belle farce américaine destinée à sonner la fin de la récréation des Trente Glorieuses et à rendre à la paupérisation ses lettres de noblesse, les chefs du personnel sont devenus des Directeurs de Ressources Humaines. Plus aucune pudeur. L'homme est devenu du jour au lendemain une ressource, un matériau à l'instar du charbon ou du pétrole, un matériau dont ont peut aujourd'hui mesurer la productivité minute par minute grâce aux logiciels informatiques. Ajoutez à cela un discours soigneusement lissé qui se promène des tribunes politiques jusque dans les manuels scolaires pour semer la terreur du chômage, le fléau moderne. Il y a encore vingt ans, le capitalisme français avait beaucoup de retard sur le grand-frère américain et on était encore loin de l'expression fatale et si banale : t'es viré. Aujourd'hui on s'en est dangereusement rapproché et le sentiment de la précarité est allé se nicher jusque dans les foyers des fonctionnaires les plus protégés par leur statut et par leur histoire. Oui, j'ai entendu l'expression l'autre jour dans une interview d'un opposant, le capitalisme français se démasque et il le fait aujourd'hui à peine plus adroitement qu'en 1995. Mais qu'il se méfie, et qu'il n'aille pas s'imaginer que les Européens vont se plier purement et simplement au diktat du capitalisme américain et à sa mentalité, car l'hérésie est non seulement encore bien vivante, mais elle est devenue la morale universelle de cette classe internationale appelée salariée.
Oui, l'Europe est pleine de bonzommes. D'Eglise il n'y en a plus, et ce qui en tient lieu, c'est à dire Wall-Street et le monde des entreprises transnationales, n'a pas encore trouvé son centre de gravité sur un continent pratiquement autarcique. Car ce que nos journalistes économiques ne s'attardent jamais à analyser, ce sont les chiffres vitaux, ceux qui nous intéresseraient demain, au cas où il faudrait s'opposer à des puissances étrangères à l'Europe. Or que disent ces chiffres, si jamais ils ont un sens car la vie se passe bien des chiffres lorsque la terre tremble, ils disent que l'Europe perdrait un petit dixième de son chiffre d'affaire si elle était condamnée du jour au lendemain à vivre de son seul commerce intérieur. Par ailleurs, ces mêmes journalistes ne disent jamais avec assez de vigueur que l'Europe, la vieille Europe qui ne veut pas faire la guerre derrière l'Oncle Sam, reste le principal client solvable de toutes les autres puissances. Alors les bonzommes n'ont rien à craindre. Pour la première fois dans l'histoire du monde, les hérétiques peuvent dormir en paix, et ils le font malgré toutes les vulgates des crisologues, malgré le travail paranoïde sans relâche des médiatiques dont la plupart a oublié jusqu'au mot de liberté de pensée et d'expression. Mais cela n'a aucune importance, l'Europe est désormais peuplée de Bonzommes et celui qui les mettra au pas n'est pas encore né. Pas plus à gauche d'ailleurs qu'à droite, et ça, ça va se savoir !
Mercredi 26 février 2003
La Seconde Guerre du Golfe, que tous les médias s'efforcent de nous faire apparaître comme inéluctable, n'est pas seulement une immense absurdité qui nous fait immédiatement penser à Rabelais et à son personnage Pichrocole, elle est la rupture d'une fragile période de paix et d'intense travail intellectuel à travers le monde destiné à comprendre pourquoi la guerre en était arrivé aux degrés d'anéantissement que l'on a connus depuis les dates fatales de 1870, 1914 et 1939. Ces efforts pratiques et spirituels parfois surhumains, pensons à l'œuvre historique d'un homme comme Ghandi, avaient commencé à porter des fruits, et par toutes sortes d'avancées théoriques et institutionnelles à ouvrir une nouvelle ère que quelques-uns, comme moi-même, ont eu la naïveté de désigner comme l'ère de la culture de paix. L'idée était simple et reposait sur une historiographie relativement cohérente qui disait que le destin des humains d'avant Hiroshima et d'avant Auschwitz étaient construits sur une volonté constante de guerre hégémonique. Autrement dit, dans cet en-deçà de l'horreur les hommes vivaient toujours en fonction d'une guerre à venir, que cette attente soit conçue sur le mode défensif, ou bien qu'elle parte de la volonté hégémonique ou de ce qu'on a appelé à la suite de Nietzsche la volonté de puissance. L'au-delà de l'horreur combinée d'Auschwitz et d'Hiroshima aura, il est vrai, bénéficié d'une durée historiquement anormale de non-guerre, même si cette " paix " qui suivit la Deuxième Guerre Mondiale dissimulait une guerre dite froide et qui ne tuait plus qu'aux franges des empires qui autrefois n'avaient d'autre but que de s'anéantir réciproquement. Il faut ici rappeler que quelques hommes seulement on gardé la conscience de ces petits massacres de poche qui ensanglantaient dans la plus grande discrétion des continents tellement excentrés que leur destin laissait le monde entier dans l'indifférence la plus totale. C'est tout juste si le Vietnam a fini par réveiller en Amérique même une conscience de ces crimes qui se commettaient en douce au nom d'une guerre qui ne portait pas de nom. La guerre d'Algérie elle-même commence à peine à exister dans la conscience historique des Français.
Le Président Bush va donc mettre un terme à une illusion, celle d'un changement historique profond dont la mondialisation est un aspect qui a eu ses heures de gloire lors des fondations de la SDN et plus tard de l'ONU. On se doutait bien, depuis quelques années, que la mondialisation prenait un tour où l'hégémonie américaine jouait le premier rôle, mais on était loin de penser que les Etats-Unis, berceau supposé de la seule Démocratie réelle, de la seule praxis politique fondamentalement positive, allait à nouveau se servir de la guerre pour asseoir cette fois cyniquement une volonté d'hégémonie soigneusement dissimulée depuis tant de siècles. L'Amérique est sur le point de détruire d'un grand coup de pied tout l'édifice d'espoir accumulé depuis plus d'un demi-siècle et montrer qu'en dernier ressort l'occident retombe dans ses fautes sans tenir aucun compte des leçons qu'il s'est infligé à lui-même au cours des trois derniers siècles.
Pourtant, les choses ne se passent pas dans la forme occidentale classique. Ou plutôt on doit constater que cet occident s'est divisé dans l'appréhension de cette nouvelle perspective de guerre. Même si certains gouvernements européens se déclarent prêts à soutenir aveuglément la puissance de feu américaine, il apparaît en même temps comme certain que tous les peuples de cette Europe à peine née refusent de passer à l'acte en méprisant d'un geste tous les progrès politiques accomplis dans la gestion de la planète, progrès dont l'ONU demeure l'emblème principal. Pour la première fois, peut-être, dans l'histoire de cette Europe dont je me plais souvent à comparer le morcellement politique à celui de la Grèce antique, l'opinion publique fait la démonstration d'une unité ferme et parfaitement distincte. Au point, sans doute, que les quelques gouvernements qui se sentent liés à l'Amérique de Bush par toutes sortes de pactes occultes tenant à leur histoire particulière risquent d'en perdre gravement leur crédibilité interne et tout simplement de tomber pour une cause qui n'est même pas la leur. Tony Blair a beau se camper dans l'attitude de Churchill annonçant l'Apocalypse à son peuple, il est loin de jouir du soutien spontané et sans failles de l'opinion, ce soutien qui a donné au discours du Premier Ministre de Georges VI son véritable sens et sa véritable efficacité. Les Anglais ne veulent pas plus de la guerre en Irak que les Français, les Italiens ou les Espagnols. On ne peut qu'espérer que les quelques gouvernements raisonnables vont trouver assez de ressources diplomatiques et politiques pour faire peser dans la balance cette unanimité des habitants du continent européens. Y compris évidemment les quelques peuples " candidats " dont les gouvernements se sont permis de prendre position en faveur de Washington. Mais je vous le demande sans rire : croyez-vous que les Bulgares ou les Hongrois soient favorables à une guerre en Irak ? Je pouffe.
Or je voulais aller plus loin aujourd'hui que ces quelques notes journalistiques et éditoriales. C 'est d'un véritable changement culturel qu'il s'agit dans notre Europe, c'est d'un véritable résultat spirituel dont nous héritons aujourd'hui après une méditation douloureuse et parfois houleuse. Depuis 1945 ces intellectuels tant vilipendés ont fait du bon travail et la plupart d'entre eux ont fait progresser cette culture de paix dont je parlais plus haut. Beaucoup de commentateurs font remarquer depuis quelques jours que le projet de Georges W. Bush pourrait bien accélérer la naissance de l'Europe politique que nous attendons tous depuis si longtemps sans grand espoir. Il se pourrait bien qu'à la faveur d'une volte de la conscience occidentale inattendue et encore latente, les peuples, c'est à dire les femmes et les hommes qui vivent sur ce continent, décident d'un seul coup de se manifester contre la décision du plus fort d'entre-eux. Car qu'on le veuille ou non, l'Amérique fait encore partie de l'occident, même si elle apparaît soudain comme la lanterne rouge de notre histoire et de son progrès.
Mais, quel est ce progrès, et comment peut-on le caractériser avec plus de précision qu'en le classant dans un vague pacifisme humaniste et légitimiste ? Au fond, quel désir avons-nous, nous Européens, à opposer à l'instinct conquérant des Yankees, à cette volonté de puissance qui a été si longtemps le cœur de notre propre philosophie politique et qui, au fond, trouverait dans cette alliance toute-puissante une acmé longtemps recherchée ? Ne passons-nous pas à côté d'une sorte de résultat final enfin rendu possible en termes de puissance d'un projet ancien de domination absolue du monde barbare ? Pour dire les choses autrement, ne passons-nous pas à côté d'une occasion de faire du monde entier un empire occidental sous la bannière américaine ? Pourquoi refuser maintenant ce que nous avons tous si longtemps et si ardemment souhaité, à savoir devenir les vrais maîtres du monde, même si nous n'occupions pas en l'occurrence les premières places et si les meilleurs morceaux du gâteau resteraient réservés aux initiateurs ? La réponse à ces questions se trouve, je pense, dans la prise de conscience qui s'est faite ici, sur notre continent, du défaut fondamental de ce qui passe pour l'occident. Ce défaut n'est ni un faute morale ni surtout une tendance foncière au rapt de l'espace planétaire. Il est une simple errance entre des entreprises qui ne se sont jamais comprises dans leurs tenants et leurs aboutissants et pour cela ont toujours échoué.
Cette errance se meut entre ce que les Grecs appelaient la praxis et ce qu'ils désignaient comme la poïésis. La praxis, c'est la réussite que l'on pourrait attribuer aux Chinois, c'est à dire la sagesse d'une gestion réaliste du réel, d'un réel auquel on a donné les frontières de la sédentarité une fois pour toute, rejetant le reste du monde dans l'inexistence barbare qui ne mérite même pas un désir de conquête parce qu'en tant que pur espace abstrait, non installé dans la praxis rituélique impériale il n'est rien d'existant. Le concept d'existence chinois, ce qu'on pourrait glisser sous le mystérieux mot de Tao, est lié à une volonté délibérée de vie qu'il convient de combiner avec la vie de la nature selon une sagesse pratique, ce que les Grecs appelaient la phronesis, par opposition à la sophia qui est la sagesse contemplative et détachée, précisément, de tout instinct de vie. Cette réussite n'est certes pas mesurable à la Chine d'aujourd'hui, du moins dans les termes qui définissent habituellement nos critères de bonheur terrestre. On peut cependant créditer l'Empire du Milieu d'une stabilité plusieurs fois millénaire dont l'occident ne peut en aucun cas se prévaloir. Il en va ainsi en premier lieu de son tenant, de son aire géographique qui n'a pratiquement pas varié depuis cinq mille ans, même si la menace tibétaine a finalement contraint Pékin à s'emparer des réserves d'eau de l'Himalaya. Comparons avec le destin géographique de la Chine nos agitations terrestres et océaniques et nous verrons alors que nous ressemblons plutôt à ces fantômes chevauchant désespérément de l'autre côté du Mur qu'à une puissance rivale d'un peuple qui a su conserver sa culture, son art et ses philosophies à travers les pires avanies provenant précisément de l'occident.
La poïesis, voilà l'autre pôle d'attirance de l'occident : la volonté de se substituer à la nature au lieu de pactiser avec elle, mais surtout le délire qui inspire des gestionnaires incompétents et qui les porte toujours à nouveau vers la régression du nomadisme conquérant. L'Occident aussi n'existe que par le choix de fonder une Cité et d'installer l'homme dans une société. Il se targue même d'avoir découvert les lois humaines qui s'harmonisent le mieux avec les lois naturelles. En foi de quoi il s'invente à chaque carrefour de son histoire de nouvelles raisons de sortir de cette Cité pour aller porter son délire et le fer à travers le monde entier. Dans la religion, dans l'économie, dans ses querelles dynastiques, dans des délires psychotiques comme la supériorité raciale, l'eugénisme ou encore l'élection métaphysique, partout l'occident a trouvé prétexte à rompre la digue de la Cité qu'il a mis tant de talent à fonder, instabilité pathologique dont on voit aujourd'hui encore qu'il n'arrive pas à se débarrasser. Il y avait pourtant beaucoup de traits communs entre les principes fondateurs extrême-orientaux et ceux de notre empire du couchant. Les Grecs comme les Chinois avaient découvert les secrets du rythme comme rapport cyclique de l'homme avec la nature et des hommes entre eux. Comme l'Empereur Houang Ti, Clisthènes avait compris qu'il fallait combiner le découpage de l'espace, en l'occurrence celui d'Athènes, avec le découpage du temps. La démocratie c'était le partage des terres + le cycle du renouvellement des mandats.
Bref, l'Europe d'aujourd'hui en a assez de faire n'importe quoi. Quelques concepts émergent ici et là qui font comprendre qu'on veut durer ou plutôt s'entourer de choses durables et qui répondent à de vrais désirs. En Chine, les fêtes étaient des articulations du rite de la création continue du temps et de l'espace par le politique, par le souverain. La fête est en train de devenir l'alpha et l'oméga de la vie de toute notre jeunesse, et le fait qu'elle y ait pris goût n'est pas le moins essentiel des événements de ces dernières décennies. Et tant pis pour ceux qui n'ont rien compris à Mai 68.
Vendredi 28 février 2003
Je me sens comme soulagé par ce qui arrive au journal Le Monde. Cela fait des années que ma colère ne cesse de grandir contre l'équipe qui y a pris le pouvoir il y a déjà de nombreuses années et en particulier contre Edwy Plenel que la haine pour Mitterrand a conduit ce journal à participer à la déstabilisation de tous les gouvernements socialistes depuis 1981. Je l'ai toujours considéré comme un sous-marin de la droite (représentée aussi par Minc dont le discours réactionnaire me hérisse depuis le tout début des années quatre-vingt). Par ailleurs je connais Pierre Péan depuis la guerre d'Algérie et le Gabon et je sais que c'est un homme de courage et d'honneur. Enfin, en tant que journaliste, il y a longtemps que j'attends que le scandale éclate pour de nombreuses raisons que je développerai plus bas, mais surtout parce qu'il ne fallait pas être un grand initié pour savoir que la Rédaction du Monde est coupée en deux depuis des années, et que beaucoup de très grands collaborateurs qui ont toujours travaillé dans l'esprit de Hubert Beuve-Méry passent le plus clair de leur temps dans des placards à peine dorés. L'un d'entre eux, un homme du calibre d'Alexandre Adler, ce qui n'est pas peu dire, a même passé son temps à pondre des articles sur les mœurs alimentaires des belges. Ceux qui le connaissent savent qu'il aime la bière, mais ignorent pourquoi.
Je ne peux pas me permettre d'entrer dans la querelle proprement dite, ma critique sera donc celle d'un lecteur, et d'un lecteur assidu depuis 1961, année où j'ai d'ailleurs rencontré Hubert Beuve Méry lui-même à Bruxelles où j'étais réfugié politique. Je peux ainsi rappeler à ceux qui douterait du bien fondé de ce shampoing infligé à ce quotidien dit " de référence ", que dans les années soixante, le journal faisait environ trente pages denses et sans la moindre publicité. Seul son carnet mondain et sa nécrologie parisienne ont toujours figuré dans ses colonnes. Son tirage, à cette époque, était d'une stabilité remarquable, tournant autour de deux cent mille exemplaires et tout le monde savait que c'était le seul journal parisien à ne pas connaître ce qu'on appelle dans le jargon de " bouillon ". En termes économiques, Le Monde s'autofinançait, c'est du moins ce qu'affirmait Hubert Beuve-Méry à l'époque, et il n'y a pas de raison de ne pas le croire lorsqu'on constate que le Canard Enchaîné parvient encore aujourd'hui à se passer de publicité tout en faisant du bénéfice. Oui, de sa fondation après la guerre, sur les cendres d'un canard collaborationniste qui s'appelait Le Temps, jusque dans les années quatre-vingt, Le Monde est resté un journal de référence. Pour l'anecdote, j'ai rencontré un jour le père d'un ami, ingénieur des Poudres à la retraite, dont la journée commençait invariablement par la lecture de l'Editorial du Monde, et il me disait à l'époque sans rire qu'il avait vraiment besoin de ce rite intellectuel pour savoir que penser de la conjoncture, et il ne lui serait jamais venu à l'idée de mettre en doute la moindre ligne d'un Beuve-Méry et des quelques éditorialistes qui ont pris sa place jusqu'à la nomination de Colombani à la Direction du journal.
Pour de tels lecteurs, l'arrivée de la publicité dans les pages du Monde a été une cruelle désillusion et a provoqué une grande inquiétude et un profond dégoût. Inquiétude parce qu'il fallait peut-être bien reconnaître que la haine du pouvoir de droite a toujours tout fait pour contrer la prospérité de ce journal grinçant et honnête, qui s'est toujours refusé à suivre le menu concocté au petit matin dans certains cafés parisiens par une poignée de spadassins des états. Guy Debord avait, déjà dans les années cinquante, une opinion qui valait ce qu'elle valait mais qui avait le mérite de la clarté, il disait que Le Monde était le journal " des états ". Il incluait dans cette définition du quotidien proprement dit son annexe de luxe, le Monde Diplomatique, qui, il est vrai, contribuait à équilibrer les finances du journal (Beuve-Méry le reconnaissait lui-même froidement). Et ceux qui avaient les moyens de se procurer Le Monde Diplomatique dans les années soixante, savent combien comptait à l'époque les relations réellement diplomatiques qu'entretenait le quotidien de la rue de Rivoli avec les communicants des gouvernements du monde entier. D'une certaine manière, il s'est opéré dans les années quatre-vingt, un retournement de situation : Le Monde Diplomatique s'est paré des vertus du quotidien, cependant que Le Monde lui-même perdait son âme dans son débat économique avec les groupes de presse et les gouvernements français. Au point que de nos jours, Le Monde Diplomatique est devenu un brûlot de gauche que j'ai moi-même parfois du mal à supporter pour son ton caricatural et son humanisme marxo-gorço-lapassadien (seuls les vrais situs comprendront cette expression, mais tant pis, la culture ça se mérite aussi).
Pour de tels lecteurs, l'arrivée de la publicité dans les pages du Monde a été une cruelle désillusion et a provoqué une grande inquiétude et un profond dégoût. Inquiétude parce qu'il fallait peut-être bien reconnaître que la haine du pouvoir de droite a toujours tout fait pour contrer la prospérité de ce journal grinçant et honnête, qui s'est toujours refusé à suivre le menu concocté au petit matin dans certains cafés parisiens par une poignée de spadassins des états. Guy Debord avait, déjà dans les années cinquante, une opinion qui valait ce qu'elle valait mais qui avait le mérite de la clarté, il disait que Le Monde était le journal " des états ". Il incluait dans cette définition du quotidien proprement dit son annexe de luxe, le Monde Diplomatique, qui, il est vrai, contribuait à équilibrer les finances du journal (Beuve-Méry le reconnaissait lui-même froidement). Et ceux qui avaient les moyens de se procurer Le Monde Diplomatique dans les années soixante, savent combien comptait à l'époque les relations réellement diplomatiques qu'entretenait le quotidien de la rue de Rivoli avec les communicants des gouvernements du monde entier. D'une certaine manière, il s'est opéré dans les années quatre-vingt, un retournement de situation : Le Monde Diplomatique s'est paré des vertus du quotidien, cependant que Le Monde lui-même perdait son âme dans son débat économique avec les groupes de presse et les gouvernements français. Au point que de nos jours, Le Monde Diplomatique est devenu un brûlot de gauche que j'ai moi-même parfois du mal à supporter pour son ton caricatural et son humanisme marxo-gorço-lapassadien (seuls les vrais situs comprendront cette expression, mais tant pis, la culture ça se mérite aussi).
Alors comment ne pas croire Péan et Cohen ? Et je dois dire que je leur suis d'autant plus reconnaissant de crever l'abcès qu'il est grand temps d'entamer une véritable réhabilitation de l'homme qui est en réalité au centre du débat actuel, à savoir un certain François Mitterrand. C'est une ironie du sort de constater que c'est sous un gouvernement de droite, et d'une droite que la France n'a plus connue depuis le Maréchal, que les contre-feux de toutes les calomnies et de toutes les intrigues contre Mitterrand et ses proches s'allument soudain. Du jour au lendemain des citoyens traînés dans la boue et que l'on croyait liquidés pour l'éternité recouvrent leur honneur et bientôt, je l'espère, leur puissance de feu. Dumas, Bérégovoy, les policiers contre lesquels Edwy Plenel s'est en particulier acharné sous prétexte d'avoir été mis sur table d'écoute alors qu'on découvre (mais beaucoup d'entre nous le savaient déjà) que ce faux journaliste, qui ne doit son entregent qu'à ses accointances idéologiques avec d'autres intellectuels dont on ne va manquer de parler bientôt dans les mêmes termes (les François Furet et autres débineurs de la Révolution Française), n'a jamais cessé d'intriguer avec cette même police. Pardon pour ce style torturé, mais cette affaire me torture moi-même, car j'ai moi-même souffert de la haine de certains membres de cette camarilla que dénonce si bien l'ami Halimi. Mais la place n'est pas ici, encore, d'en parler. Je réglerai mes comptes quand le moment sera venu et que la mémoire reviendra à ceux qui ont laissé croire que la Résistance à la Guerre d'Algérie c'était tout beau et tout gentil, cependant que déjà les manipulations et les haines de toute sorte divisaient ce beau monde. Cette résistance a eu ses héros et ses traîtres. Mais l'histoire avance à très petits pas, l'affaire du Monde en est la plus belle illustration. En tout cas, merci Pierre. L'autre Pierre, Pierre Bernard, que tu as connu comme moi à Libreville, doit sourire dans sa tombe car nous avons souvent évoqué le triste destin de cette presse de la liberté. Tu te rappelles du premier Libé ? J'étais à Fresnes où je purgeais le crime de résistance lorsque ce journal s'est éteint comme s'éteint une torche de la liberté. C'était le dernier journal de gauche parisien. Aujourd'hui il faut vivre en écoutant les éditos des vedettes du jour sur France-Culture, un média qui prend lui aussi la pente fatale qui a perdu Le Monde.
Lundi 3 mars 2003
Ce matin je me sens l'âme du Feu Follet de Drieu La Rochelle. Nous aurons tous été des feux follets lorsque nos amis viendront, ou ne viendront pas, voir notre cercueil descendre à reculons vers le seul endroit que personne ne pourra plus nous contester. Et pourtant j'ai le sentiment d'être encore plus évanescent dans le regard des autres que ne le sera jamais le plus obscur de ces êtres de chair, d'os et d'esprit qu'on appelle l'homme. Tu parles, tu parles, tu lis, tu lis et tu relis encore, tu écris, tu écris, tu penses penser et tu écris encore. Tu cherches, tu cherches, et tu crois avoir trouvé et tu écris encore. Pas la recette de la blanquette de veau, oh non, l'essentiel, ce que tout le monde semble chercher, le secret, la pierre philosophale, le dernier mot de la sagesse humaine, ce qu'il y a de plus proche du mystère de l'existence. Et tu écris encore. Et puis ? Et puis rien. L'essentiel, c'était bien la blanquette de veau, connard.
Mardi 4 mars 2003
Sens, résistance. Belle rime. Mais ne s'agit-il que d'une rime ? Prenons les banalités platoniciennes devenues le béaba des cours dits de philosophie en terminale. Que signifie la quasi négation du sensible que prône le texte platonicien sinon un geste de résistance à ce que nous apportent les sens ? Ne pas accepter l'évidence, résister à la tentation d'acquiescer à ce qui se voit, se lit, s'entend et finalement se pense. Pas de doute, le platonisme est déjà une éthique de la résistance. Ou plutôt on peut créditer Platon, un certain Platon, d'avoir au fond vécu la même oppression que la nôtre avec le même sentiment de révolte. Ce qu'il semble par exemple vouloir démontrer est que sa recherche du sens passait d'abord par la résistance au sophiste, au maquillage idéo-logique de la réalité, au pouvoir des mots et de leur agencement. En ce cas précis de la possibilité de présenter l'être comme non-être. Que de grands mots pour désigner tout simplement le mensonge. Au fond, la philosophie, la recherche du sens de l'existence, ne serait rien d'autre qu'une guerre menée contre le mensonge. Rien d'autre.
Voilà qui remet en perspective le statut de l'intellectuel, si tant est que sa vocation est bien, en son essence, la recherche du sens. Mais que pourrait-elle bien être d'autre ? Qu'il soit philosophe, littérateur, savant ou artiste, quelle autre finalité pourrait-il bien assigner à son travail ? La caractéristique principale de ce travail est toujours la recherche, or que peut-on rechercher sinon ce qui n'est pas encore présent, ce qui se cache, ce qui n'est pas apparent, ce qui est dissimulé par un certain mensonge, l'erreur elle-même pouvant être classée dans cette catégorie. Même si l'intention d'Euclide, par exemple, n'a jamais été de mentir en posant ses axiomes, il n'en demeure pas moins que si personne n'avait résisté à ces axiomes, on en serait toujours à la représentation euclidienne de la réalité, qui, étant fausse, participe du non-être, c'est à dire du mensonge, l'intention en moins. Ceux qui ont continué à chercher envers et contre les évidences euclidiennes étaient des résistants, et l'histoire toute entière montre que la résistance est le moteur de tous les changements, qu'on les considère ou non comme des progrès. Même l'Eglise s'est périodiquement mise en résistance contre elle-même parce que les vérités établis par ses Pères finissaient toujours par trouver des résistants, des chercheurs de sens insatisfaits par les Canons. Luther lui-même, n'avait pas fini de peaufiner sa théologie personnelle, une pensée qui devait révolutionner le Christianisme tout entier, que la Résistance s'organisait déjà, et cela non seulement dans le camp adverse, l'Eglise de Rome, mais à l'intérieur même de ses propres rangs. Sa propre doctrine était dénoncée comme fausse, comme in-sensée, comme participant du non-être. Il est vrai que les contemporains de Luther purent constater eux-mêmes le fossé qui séparait l'esprit de sa Réforme et sa pratique personnelle. Celui qui prêchait le retour au Christianisme des origines, celui de la pauvreté et de l'amour, acquiesçait aux massacres des paysans par les Seigneurs et justifiait cette lâcheté par un canon ridicule, un mensonge qui reprenait à sa manière le Droit Divin des puissants et.. de l'Eglise Catholique elle-même.
Plus près de nous. Les deux derniers siècles fourmillent d'intellectuels en tous genres. De Rousseau, Voltaire ou Condorcet à Sartre, on a vu des hommes rechercher du sens, consacrer leur existence à lui trouver une raison d'être, et d'être ainsi plutôt qu'autrement, c'est à dire de lui trouver un cadre moral. Hier, dans ma déprime périodique, j'ai fait allusion à Drieu. Quel talent ! On peut le lire, croyez-moi, il vaut le détour car il y a une correspondance miraculeuse entre les résultats de sa recherche littéraire et son comportement, entre son écriture et son destin, entre sa représentation de l'existence et sa vie elle-même. Drieu s'est en quelque sorte abîmé dans le mensonge sur lui-même, avec art, certes, mais un art qui finit par écœurer comme celui de Céline, destin extraordinairement parallèle. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience qui consiste à passer des deux grandes œuvres de Céline, Le Voyage au Bout de la Nuit et Mort à Crédit à la série des platitudes bilieuses et enragées qui ont suivi. J'ai entendu récemment quelques-uns de ces intellectuels aller jusqu'à réhabiliter des torchons comme Guignol's Band ou D'un Château l'Autre, qui valent en effet, mais à peine en tant que révélateur du néant personnel dans lequel était tombé l'esprit de Céline. C'est exactement comme Drieu dont tout le génie a consisté dans la légitimation de son suicide. Comme si on pouvait donner un sens à un tel geste. Oui, c'est bien ça, c'est bien le renoncement à ce qu'on est lorsqu'on appartient au genre intellectuel, c'est bien le renoncement au statut de chercheur du sens et donc de Résistant. Mais à cracher sur la vie, comme le firent bien d'autres, je pense à Schopenhauer ou Cioran, on finit par cesser d'être un homme.
Sens. Résistance. Je veux rendre ici un hommage particulier à Jean-Paul Sartre, cet homme presque martyrisé aujourd'hui par le on-dit, jeté à la poubelle de l'histoire littéraire et philosophique, ostracisé post-mortem parce qu'on n'a pas pu le faire de son vivant. La vengeance qui le frappe aujourd'hui, car c'est une vengeance, est la meilleure preuve de la pureté de son être de Résistant. Voilà un homme qui a conjugué dans notre langage et dans notre réalité les mots sens et résistance. Quand j'entends les gnomes de la pensée se gausser aujourd'hui de cet homme extraordinaire, en parler comme d'un quidam parmi les autres qui a écrit et produit des traités de philosophie, je frémis de colère. Quand j'entends ces mêmes gnomes oser porter des jugements sur sa pensée, alors qu'à l'évidence ils n'ont rien compris ni de l'œuvre intellectuelle ni de la lutte politique de Sartre, alors je baisse les bras de désespoir, car ces gnomes sont majoritaires parmi tous ces pseudo intellectuels qui peuplent les médias et noircissent à eux tout seuls le plus gros de la production de papier. Sens, résistance. Cette consonance pose toutefois un problème, soulevé vendredi dernier par Jean-Luc Nancy à propos de Martin Heidegger. Voici un homme dont on peut dire qu'il avait la question de l'Être pour ainsi dire inscrite dans ses chromosomes, que la recherche du sens de l'existence hic et nunc le constituait lui, autant que son texte. Et pourtant il n'a pas résisté. Si dans son texte il ne cesse de répéter, précisément, que l'essence du sens résidait dans la résistance, il a craqué dans sa propre existence, il a, pendant au moins quelques mois, cessé de résister, et pis que ça, il a collaboré avec la pire poïésis qu'ait produite l'histoire, le nazisme.
Jean-Luc décrit très bien le malaise qu'a introduit dans toute l'intellectualité contemporaine cette " faute " du grand penseur. Je développe ailleurs ma propre analyse sur ce comportement, un geste qui a des racines profondes dans le siècle allemand de Nietzsche, dans cette sorte d'absolution anticipative donnée par le génie des Alpages à toutes les catastrophes et à toutes les atrocités qui se commettraient dès le siècle suivant. En gros, l'euphorie Nietzschéenne, qui l'a mené, lui, effectivement à de draper dans le rôle du grand résistant à la métaphysique occidentale et à ses valeurs, cette euphorie platement historique s'est emparé de Heidegger sous sa forme historiale, la forme qu'il avait lui-même inventée dans sa propre résistance à l'histoire métaphysique et eschatologique. Pour bien comprendre la faute de Heidegger, car ce fut une faute, et une faute qui est la raison certaine de l'échec relatif de sa pensée, il faut aussi comprendre sa géniale découverte, le produit de sa propre résistance à une métaphysique qui se moquait de la présence. Dans son commentaire sur le Sophiste, il avait alors à peine 22 ans, il a déjà tout compris de ce que sera sa thèse de Etre et Temps et même au-delà. Ce tout est simple à dire et à comprendre, mais il contient une sorte de tabou inacceptable pour tout intellectuel qui refuse justement de confondre sens et résistance parce que c'est bien trop inconfortable et trop risqué. Ce tabou c'est l'idée qu'on ne peut pas penser le présent en-dehors du présent. La pensée qui ne s'abandonne pas au présent, mais qui l'abandonne, cesse de résister et cesse donc d'assumer son être.
Je ne peux pas pardonner à Heidegger d'avoir gardé sa carte de la NSDAP jusqu'à la libération, même si certain prétendent que c'est sa femme qui payait les cotisations et qu'il ne voulait plus en entendre parler. Mais ce que je peux confirmer, c'est que même dans son erreur de 1933, son fameux Rectorat avec ce discours lamentable, même alors il se pensait résister, il se pensait dans la résistance. Et on pourrait se servir de ses discours ultérieurs sur le communisme et l'américanisme comme deux faces d'une même impasse historique, cela ne changerait rien à sa passion ontologique, à sa passion de résistant. Cela ne s'explique que d'une seule manière, ou bien plutôt par une seule vérité toute simple dans sa nudité, c'est que dans la résistance comme dans la quête du sens on est et on reste toujours seul.
Mercredi 5 mars 2003
Toujours sur le même air : la solitude est garante de la pureté de toute recherche. Sacré problème pour une caste qui n'a guère le choix que de s'agréger pour accéder aux moyens de la recherche. Je peux me souvenir exactement de ma tentative d'agrégation et du moment précis où il m'est paru évident que cette agrégation n'était rien d'autre qu'une allégeance, une pure allégeance. A une certaine époque, le rituel parisien était devenu une véritable farce où l'essentiel pour le candidat était de bien connaître la sensibilité (tenons-nous en à ce terme) du Président du Jury. Mais l'intellectuel a toujours une bonne arme pour défendre son honneur, c'est son propre esprit, sa propre certitude d'une intégrité intérieure, d'un quant à soi inattaquable, quelles que soient les compromissions auxquelles il faudra bien sacrifier pour se voir décerner le privilège de la recherche. Il ignore encore à ce moment là, encore qu'une telle naïveté ne devrait pas le prédisposer à devenir un vrai chercheur, que la compromission comme critère de son Dasein de chercheur ne cessera jamais de contrôler étroitement tout débordement de son quant à soi ou de son intégrité.
Je m'intéresse en ce moment à un certain Sébastien Franck, dont je vous ai, je crois, déjà parlé. Un de ces intellectuels, dont le statut ne saurait être contesté puisqu'il se trouve cité par Leibniz en personne. L'histoire de cet hérétique du début du seizième siècle, chassé de partout contient un aspect assez ironique en regard de ce qui se passe aujourd'hui. Franck, en effet, non seulement écrivait, remplissait des centaines de pages de ses critiques et pensées, mais il parvenait à se faire publier ! Il faut dire qu'à cette époque il n'existait pas d'éditeurs, mais seulement des imprimeurs. Mieux encore, un livre était considéré comme un livre dès lors qu'il était imprimé, c'est à dire avant toute campagne médiatique ou toute publicité. En ce qui concerne Franck, ces œuvres étaient d'ailleurs la cause première de la persécution qui n'a jamais cessé de le suivre jusqu'à sa mort. Le lieu n'est pas ici de développer sa pensée, il suffira de signaler que de Luther à Melanchthon en passant par Erasme, la plupart des intellectuels européens se sont trouvés naturellement agrégés contre Franck. Mais une telle alliance n'avait rien d'une rigolade, elle aboutissait toujours à des poursuites judiciaires, des emprisonnements et à l'exil. Aujourd'hui les choses sont plus simples, beaucoup plus simples. Les éditeurs font la loi. L'ami agrégé n'est pas au bout de ses peines lorsqu'il sortira triomphant de la salle de l'oral, mais les éditeurs lui feront au moins l'honneur de lire ses travaux.
Jeudi 6 mars 2003
Cher Monsieur Alain Gérard Slama, vous êtes un génie de l'amalgame. De la perversion dans laquelle se roulent ces intellos dont je fais le portrait depuis quelques jours, avec de surcroît une pointe de culot que vous exhibez de jour en jour avec plus d'insolence, encouragé par la passivité de vos interlocuteurs fascinés par votre culture historique et votre ruse d'éditorialiste expérimenté, mais profitant surtout du degré désolant pris par la pente idéologique de plus en plus réactionnaire de France-Culture. Ce matin votre culot était à son comble car votre rubrique était encadrée par l'interview d'une dame, Antoinette Fouque, qui se bat depuis des décennies pour les valeurs sur lesquelles vous crachez en masquant à peine vos crachats avec tout le talent de l'amalgame dont vous êtes un maître. Mais vous savez, on a l'habitude de votre syllogisme qui conduit par un dégradé de grand style de l'ogre Staline à Karl Marx et en tout dernier ressort aux valeurs qui se cachent derrière ces monstres, valeurs enrobées par d'opaques papiers bonbon marqués une fois pour toute du label communisme. Ce matin vous n'avez pas osé, mais ça vous chatouillait de remonter jusqu'à Robespierre et Saint Just, voire, pourquoi pas, de proche en proche et de lointain en lointain jusqu'à ce Jésus-Christ qui a foutu un tel bordel dans la bonne Realpolitik de Rome.
Mais Monsieur Slama, tombez donc le masque une fois pour toute, et dites ce que vous pensez tout au fond de vous-mêmes, si toutefois il existe chez vous un fond singulier tant vos propos ne font que tourner sempiternellement autour des lieux communs de droite qui ont fait votre carrière de grand journaliste parisien. Quelle tristesse de voir France-Culture contraint, on se demande pourquoi, d'en passer par une voix de droite comme la vôtre. Je sais bien qu'à par vous il n'existe pas beaucoup de ces gens de droite assez " smart " comme disent les Américains, assez machiavéliques pour faire passer pour humaniste des philippiques indignées et si répétitivement réactionnaires. Vous appartenez, et je vous en accuse sans détours, à tout ce dispositif d'intellectuels qui depuis trente ans ne songent plus qu'à dissoudre dans son essence l'esprit des Droits de l'Homme. Depuis trente ans, c'est à dire depuis que la mission la plus urgente pour la droite française est devenue d'effacer jusqu'aux dernières traces de Mai 68, cet événement si humiliant pour la caste de l'aristocratie anti-républicaine qui tente de sortir de sa tombe comme les morts-vivants de nos films d'épouvante.
Mais analysons de plus près votre sophisme de ce matin. On en rirait si les enjeux n'étaient pas si graves. Donc, le sujet était Staline, et l'étonnement que provoquait dans le studio de France-Culture le fait que ce " monstre " a trouvé ici et là, à l'occasion de l'anniversaire à venir de sa mort, un traitement parfois empreint de bénignité voire de complaisance qui pourrait passer pour une réhabilitation masquée. Belle occasion pour bondir sur votre proie habituelle, non pas le tyran lui-même, non pas l'appareil soviétique qu'il a fabriqué, cette nomenklatura qu'on n'hésite plus depuis longtemps à comparer au parti nazi, même pas le premier de tous les responsables de la Révolution d'Octobre à savoir Lénine et sa propre doctrine, mais à ce fantôme idéologique, à ce fourre-tout notionnel qui s'appelle le marxisme-léninisme, enfer de la défense de valeurs désormais totalitaires elles-mêmes : l'égalité, la justice, la dignité humaine et tout ce que vous-mêmes n'hésitez plus à targuer d'un arrogant " droit de l'hommisme ", faut-il écrire droitdelhommisme pour bien exprimer tous son mépris ?
Monsieur Slama, vous êtes un homme de droite, vous ne vous en cachez pas, et après tout il faut se résoudre, dans le décompte des coups, à reconnaître que votre botte de ce matin était de bonne guerre. Très efficace. Ce qui me chagrine en revanche, c'est la passivité de votre hôte, censé représenter la dernière antenne française qui se réclame de l'honnêteté intellectuelle, de l'intelligence et donc de la présence d'esprit. Il n'avait même pas besoin d'être de gauche pour dénoncer vos sophismes, il était de son devoir de discerner, dévoiler et critiquer vos amalgames publicitaires, tellement énormes que Madame Fouque elle-même en a parue toute effarée, impuissante à trouver une parade à un discours qui visiblement ne lui plaisait pas plus qu'à moi. C'est ça, elle est restée sans voix, comme la France reste sans voix devant le culot de ses nouveaux dirigeants, leur cynisme souriant qui pratique le même sport que vous, l'amalgame. Je vous invite à vous précipiter sur les œuvres d'un auteur que vous connaissez certainement très bien, mais dont vous avez peut-être oublié certaines analyses qui font froid dans le dos. Je veux parler d'Hannah Arendt, dont je suis loin d'approuver un certain aristocratisme culturel et historique, mais qui a quand-même démasqué une fois pour toute la stratégie sémantique décisive des nazis et du fascisme en général, et cette stratégie s'appelle l'amalgame.
Le même jour. 13h30.
Je voudrais revenir à Staline. Dans l'histoire il y a toujours un effet du zoom provoqué par le fait que nous avons le nez collé à l'immédiateté des événements, à une proximité qui leur donne une sorte de valeur ajoutée de véracité. Quelle que soit la nature de ces événements. Exemple : le débarquement américain en Normandie nous apparaît à tous dans un halo de positivité et de bonne intentionnalité qu'on serait bien mal venu de remettre en doute (comme je l'ai fait ailleurs à mes risques et périls). En revanche, De Hitler à Milosevic en passant par toute une famille de Staline, Idi Ami Dada et autres Mobutu, le mal est là, évident dans une mémoire qui est une quasi présence. Hitler, c'est comme s'il était encore là, dans toute sa stature démoniaque, une stature qui a sans doute longtemps été celle de Napoléon dans l'Europe d'après Waterloo. Or, la neutralité historiographique qui a entouré un temps cet individu étrange et ambigu se transforme, ces derniers temps en véritable bonapartophilie qui ne se cache même plus derrière l'alibi du Consulat ou du sauvetage des institutions républicaines. Moi-même, après avoir lu, comme d'habitude, des quantités d'ouvrages sur le sujet, je dois bien admettre que la thèse d'un Napoléon comparable à Hitler ou Staline est une abomination idiote. Ce n'est pas le lieu ici de faire un plaidoyer historique, mais je ne me dépars jamais de la certitude que la France, et non pas Napoléon, a été provoquée à la guerre de manière décisive et obstinée par la Grande-Bretagne, pour des raisons essentiellement mercantiles, mais aussi pour des raisons identiques à celles qui ont failli provoquer une alliance entre Berlin et Londres avant 1914, c'est à dire afin d'anéantir dans son foyer la démocratie républicaine française.
Pardon pour la digression et revenons à notre sujet. Voyons donc un peu les choses sous un angle nouveau. Il n'est pas question de réhabiliter qui que ce soit, ou de condamner d'un autre côté des gens généralement considérés comme des hommes ou des femmes qui ont mérité des peuples, il ne s'agit pas de jouer ici au jeu des paradoxes. L'angle nouveau que je vous propose serait d'inverser, disons, le sens de la considération que nous avons pour l'histoire selon la géographie. De rendre au fond au concept de géopolitique toute sa valeur, c'est à dire toute la valeur du poids de la géographie sur l'histoire. Si je reviens à Staline, c'est que son cas est exemplaire, car la géographie de la Russie contient en elle-même des contraintes qui font que si on compare entre eux les grands souverains de ce pays et leurs méthodes de gouvernement, il faut bien reconnaître qu'il y a plus de ressemblance entre eux que de différences. D'Ivan le Terrible, dont la pire cruauté ne fut pas de faire mourir son propre fils sous la torture, à Poutine dont la main de fer a bien du mal à se cacher sous le velours encore rouge de ses gants, il n'y a pas beaucoup de grands Tsars ou de grands souverains de l'après Révolution d'Octobre dont on peut dire qu'ils ont fait le bonheur de leur peuple (il faudrait dire leurs peuples, mais…). L'exemple le plus célèbre restera Pierre 1er Le Grand, véritable héros de l'humanité si on le juge sur les progrès qu'il a fait accomplir à son vaste pays. Mais à quel prix ? Inférieur, supérieur à l'équation de Lénine qui était Communisme = Socialisme + électricité ? Qui peut le dire ? Il y a un livre de Platonov dont l'intrigue se déroule dans le cadre du creusement des canaux décidé par Pierre Le Grand et qui a mobilisé des millions et des millions de moujiks, mourant de faim et de froid, crevant à la tâche avec le même entrain que les habitants des goulags staliniens. Pierre Le Grand, mais et tous les autres ? Les Alexandre et les Romanov qui ont suivi Pierre, des monarques qui ont joué avec le servage jusqu'au vingtième siècle, massacré au sud, à l'Est et à l'Ouest sans se poser de questions, entretenu ou anéanti des classes nobles ou bourgeoise selon leur caprice. Bref, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que la géographie de la Russie lui interdit en quelque sorte un autre bonheur pour son peuple que celui de s'oublier dans la vodka. Selon ma théorie, elle revient toujours sur le tapis, l'état sédentaire n'est pas tenable pour un espace aussi vaste et aussi différent d'un bout à l'autre quant aux conditions géologiques et climatiques. Tout simplement. Tenable signifie quelque chose de très simple, c'est à dire capable de faire le bonheur des peuples.
Prenons quelques autres exemples dans un sens ou dans l'autre. La Chine a sans aucun doute été la plus belle réussite de sédentarisation. J'en ai assez parlé ici et ailleurs. Mais cette réussite a-t-elle pour autant permis au peuple chinois d'accéder au bonheur, ou au moins à des périodes de paix et de prospérité assez longues pour faire, comme on dit histoire ? Je veux dire, avons-nous connaissance pour la Chine de quelque chose comme d'une ère de bonheur sans nuages et tellement longue que le monde entier s'en souvient ? J'ai beau chercher, et si déjà je suis obligé de chercher c'est qu'il n'a existé rien d'assez légendaire pour que je le sache sans le chercher. Ouvrez la Bible, vous y trouverez la Palestine de Salomon, véritable paradis enfin reconstitué par l'héroïsme de David et le génie de Salomon. Voilà un peuple marqué par une époque, par un âge d'or. Un peu comme notre seizième siècle européen, illustré par les représentations festives à la Breughel ou les splendeurs des peintres italiens de cette époque. Non, comme pour la Russie, la géographie chinoise est un obstacle absolu à toute bonne " gouvernance ". Aux frontières menacent les étrangers. A l'intérieur menacent les catastrophes naturelles, fléaux aussi terribles que les guerres ou les pires tyrannies. En Chine aussi des millions de bonshommes ont perdu la vie dans le creusement sempiternel de canaux de dérivation pour les crues du Fleuve Jaune ou dans la construction jamais achevée de digues. La méthode communiste des Souei n'a rien changé au résultat final. Combien aussi sont morts d'épuisement dans la construction du Mur ?
Un mot sur Rome, la Rome antique bien sûr. A partir du deuxième siècle avant JC, Rome eût son acmé, voilà une certitude. On peut dire que tant que la République romaine est restée Italienne après avoir écrasé son principal adversaire Carthage, le peuple romain a vécu plusieurs siècles dans un état politique et social de paix et de prospérité que nous ne pouvons guère nous imaginer. De même plus près de nous, en France même, au cours des huit et neuvième siècle, régnait une paix et une justice sociale (dont d'ailleurs on ne parle que très rarement, ça fait tache dans l'histoire du Progrès) à peine soupçonnable. Mais c'était comme ça, les Carolingiens avaient instauré un mode de partage des terres qui, sans enrichir outrageusement qui que ce soit, permettait à chacun de vivre agréablement et de construire non seulement une existence sans cesse menacée de destruction, mais une existence qui posait un avenir pour une descendance. La légende de Charlemagne est largement tributaire du souvenir de cette paix sociale qui aurait même permis l'invention de l'école. Mais voyez comment ça se passe : l'Empire devenu immense, s'étendant de l'Atlantique aux confins de la Pologne, devenait une entité ingouvernable. Charlemagne à peine mort, il fallu découper cet espace pour le rendre gouvernable.
Et puis, l'actualité. A examiner l'Europe, que constate-t-on ? A l'évidence que les petits pays, les plus petits en surface, sont les plus riches et les plus paisibles. La Scandinavie demeure le modèle des pays démocratiques où la redistribution de la richesse n'aboutit pas à des situations quotidiennes de drames et à leur climat de violence. La Suisse, naguère encore pays le plus pauvre d'Europe qui faisait de ses enfants des mercenaires ou de simples émigrés, est aujourd'hui un petit pays riche, prospère et paisible, quoi qu'on en dise et médise. Sa démocratie est subtilement complexe, mais elle est sans doute la meilleure du monde, la plus respectueuse du principe même de la démocratie.
Enfin, que voulais-je dire ? Ou voulais-je en venir ? Ah oui, à encourager le lecteur à s'entraîner à prendre de la distance dans ses jugements sur l'histoire passée et sur l'histoire présente. Arrêtons de croire que le présent qui nous est donné dans sa forme pompeusement scientifique corresponde vraiment, c'est à dire dans sa vérité, à ce que nos faibles capacités de jugements finissent par prendre pour le véritablement vrai. Des hommes ont à exercer des responsabilités, comme on dit pudiquement aujourd'hui, dans des conditions que nous ne pouvons pas nous représenter tout simplement parce que nous ne sommes pas à leur place. Voyez Bush : nous sommes tous contre son projet de guerre, et il faut bien reconnaître que les arguments qu'il nous sert n'ont rien pour nous convaincre, mais que savons-nous des conditions globales objectives dans lesquelles cet homme se trouve pour en arriver là où il est ? Que ces conditions soient internes à l'Amérique ou qu'elles se réfèrent véritablement à un danger que représenterait Saddam Hussein, peu importe. Le destin de l'Amérique ne se joue pas dans les discours que nous entendons pour ou contre la guerre, mais tout à fait ailleurs, dans un cours destinal dont les éléments nous échappent, une causalité si complexe qu'aucun ordinateur ne pourrait en rendre compte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Européens sont tellement méfiants et comptent bien, en tout cas je l'espère, rester en-dehors de cette extravagance surréaliste. Les derniers développements montrent que le président américain va prendre ses responsabilités en se passant de l'aval de l'ONU. Au moins il sera jugé pour ce qu'il aura entrepris lui-même, même s'il faut reconnaître qu'une telle décision illustre la faiblesse de la seule institution mondiale légitime. Cela augure d'une mondialisation réellement sauvage.
Vendredi 7 mars 2003
Encore vous Slama ! Décidément je vais ouvrir une contre-chronique quotidienne. Ce matin en effet, vous nous avez encore servi un morceau choisi d'amalgame avec votre histoire de droit d'ingérence. La dame qui vous a répondu a tout dit, et je n'ai pas grand chose à ajouter, mais quand-même, Monsieur le Journaliste de droite, venir patelinement vous plaindre de voir disparaître ce beau " Droit d'ingérence " dont vous attribuez la paternité à la gauche dans la seule intention de coincer cette même gauche maintenant qu'elle s'oppose à cette ignominie de guerre bushienne, c'est un peu fort de café. Je ne vais pas répéter les propos de votre voisine de studio, mais quand-même, vous ne pensez-pas que l'ingérence, non seulement a eu lieu légitimement sous le drapeau de l'ONU en 1990, mais qu'elle a continué en Irak jusqu'à présent avec le bilan social et humain que l'on sait, car il ne suffit pas d'évoquer les conséquences du blocus économique scandaleux, mais rappeler que les bombardements de ce pays n'ont pas cessé depuis la guerre, et ce en dépit de l'ONU. Washington et Londres font ce qu'ils veulent et continueront simplement de le faire pour assurer leur contrôle ancestral sur l'or noir du Moyen-Orient. Vous oser parler de droit d'ingérence pour Saddam Hussein, mais pourquoi pas pour la Chine, la Corée du Nord, la brochette de nations où la démocratie n'a jamais existé que le jour du Carnaval des élections et j'en passe. Mais pourquoi ne pas en parler, mais je vais encore répéter cette belle et bonne dame tant pis, à propos de ces nations qui se permettent tout depuis qu'ils ont gagné une grande guerre ? Pas de droit d'ingérence pour les laboratoires diaboliques des USA où se concoctent les catastrophes humaines futures, quand les Bush devront commencer à rendre des comptes ? Pas de droit d'ingérence pour toutes ces puissances qui arrosent le monde de leurs armements, allant jusqu'à vendre l'atome au premier venu, pourvu qu'il soit solvable ?
Allons Monsieur Slama, un peu de bonne foi ne nuirait pas à votre carrière et vous n'êtes pas obligé de vous en prendre à chaque occasion à la gauche de votre pays. A force de dire de pareilles sottises, je ne donne pas cher de votre chronique à France-Culture où on ne badine quand-même pas encore tout à fait avec l'éthique et la déontologie du journalisme. Slama.
Samedi 8 mars 2003
Comment défroquer de sa subjectivité ? Comment détruire en nous ce personnage qui ne cesse de gonfler extérieurement mais aussi intérieurement et qui profite de chaque inattention pour rendre un culte à ce qu'il conçoit si pompeusement comme son identité ? Je ne trouve pas d'autre mot que défroquer pour dépeindre cette désacralisation du moi que l'histoire a conduit à condenser en lui toute une réalité égocentrique, monarchique. Mais d'abord d'où provient cette question ou ce souci ?
Drôle d'expérience. Ou plutôt ce qu'on appelle en sa véritable signification intuition. Comment parler de cela ? Comment décrire cette sensation d'abord fugace, à peine perceptible, de faire partie des choses et surtout de leur mouvement. Et puis cette sensation se précise - au point d'en arriver à l'audace aujourd'hui d'en parler, quitte à passer pour un fou - elle passe dans les mots : on se sent " charrié " par l'Être, charrié comme un fleuve charrie des troncs d'arbres ou des mottes de terre. Plus précis : on se sent pris dans un mouvement totalement général de la vie et de la mort. On est devenu un simple élément dans le cours de ce qui se passe, de ce qu'il y a, comme dit Heidegger. On demeure longtemps fasciné par la permanence de certaines choses, par une impression d'éternité qui s'en dégage, un monument ou une bille d'acier. Et puis quelque chose comme l'usage de la réflexion, l'habitude d'une certaine réduction, je ne veux pas encore dire éïdétique, mais quand-même une réduction qui fait partie nécessairement de toute interrogation ontologique, sur l'existence, tout ce travail vient comme user ces certitudes. On cesse de différencier la nature même des choses pour n'y plus apercevoir que le mouvement du passage dans le temps. On ne voit plus une pyramide millénaire, mais un tas de cailloux en voie de désagrégation, on ne s'émerveille plus de la cathédrale, mais on en sent la fatigue, les failles du matériau qui ne sauraient que s'agrandir. En persistant dans une telle méditation, je pense qu'on finirait par percevoir directement le vide de l'espace ou l'espace originel dans lequel des hommes ont placé ces choses.
Et puis soi-même. On prend conscience petit à petit de la laïcité de son nom, celui du père, de sa banalité d'étiquette collé sur un produit sur lequel la science devrait bientôt être capable très vite, dès la naissance, de noter la date de péremption. Frisson de terreur ? Non, oh non. J'ai plutôt l'impression de faire la planche sur l'océan de la vie, d'avoir trouvé enfin un position de repos, même de plaisir de descendre ainsi sans rien faire le cours du fleuve d'Héraclite. Celui-là a dû, j'en suis sûr, avoir fait l'expérience de cette immersion du soi dans le tout. Il avait de ce tout un tel sens du chaos qui le constitue, du bordel qui se cache sous les formes que nous passons notre temps à sauver comme des pompiers du sens. Le mot défroquer me plaît décidément énormément car il contient cette définition du soi comme défroque, que dis-je, comme soutane du clerc, de l'être transcendant, du zoon logon ekon, ce demi-dieu de la métaphysique. C'est à ça qu'elle a servi cette métaphysique, et aussi les religions et tout le reste, à sanctifier le MOI, à en faire dans la propre conscience des individus, l'idole permanente, le centre de la préoccupation sur le temps et l'espace, sur le passé, le présent et le devenir et sur la propriété qui est intégrée par acte notarié à ce nom sacré.
Ou bien tout ce que je viens d'écrire participe du pur délire, ou bien mes lecteurs commencent à comprendre, ce qui n'est pas une exigence de ma part, ou seulement à sentir, comme on sent la poésie. Mais je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire en accolant mentalement cette méditation aux revendications modernes du libéralisme et de la compétition de tous ces MOI sacralisés dès l'enfance par une pédagogie proprement risible. Et pourtant c'est ainsi que s'est construite notre " civilisation ", en hissant des statues et en divinisant des individus. Les Egyptiens ont donné l'exemple, il faut dire. Faire construire de tels monuments rien que pour contenir les traces de leur présence dans le cours de la vie ! Je pense que les pyramides ont été un tournant dans l'évolution des civilisations sédentaires. Avec elles est née cette prétention à la soutane, avec elles a disparu la simplicité des relations des hommes entre-eux et des humains avec le reste du monde. Aveu d'échec, ou conséquence. C'est là qu'on a abandonné le vrai travail de l'élaboration de ces relations et du percement de leur mystère pour se rabattre sur la déification des puissants, de ceux qui étaient un peu plus rusés que les autres, assez pour se faire sacrer centre de la préoccupation générale. C'est là que l'homme est devenu le centre de la question, alors qu'il n'en est qu'une petite partie, un bouchon qui flotte un certain temps et se perd dans les remous de la vie et du temps.
Dimanche 9mars 2003
Les mystiques allemands des Quinze et Seizième siècles, mais déjà Maître Eckhart deux cents ans plutôt, utilisaient l'expression " an sich sterben ", textuellement " mourir à soi ". Pour parler d'une personne qu'il admirait, Sebastian Franck disait de lui qu'il était " déjà complètement mort à soi ". Il y a des nuances dans les significations que donnaient ces gens à l'expression, mais en gros elle disait toujours la même chose : un homme qui était mort à soi était un homme dont l'esprit avait pris le pas sur le corps ou la matière. Pour Eckhart il s'agissait de " vider " l'âme de tout ce qu'elle contenait pour laisser la place à la venue en elle de Dieu. Dieu ne s'adressait qu'aux âmes vides, sous-entendu de tout souci autre que lui. Pour Franck en revanche, Dieu est déjà là, il a une petite place dans l'âme dès la naissance (ce qui règle d'ailleurs un problème ultra important dans la théologie chrétienne, à savoir le statut des nouveaux-nés morts sans baptême, mais aussi celui des infidèles ou plus simplement des peuples qui n'ont pas accès aux cérémonies et à la liturgie des églises). Pour Franck Dieu est donc présent quoi qu'il arrive, mais le corps, la matière, les sens occupent une place toujours trop grande par rapport à sa présence. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, c'est évidemment que le souci de l'individu, son attention, son désir, en gros ses pulsions, peuvent choisir de se cantonner dans les directives du corps, ce qui comprend aussi cette partie de la psyché, de l'âme tournée vers les désirs charnels, ou bien de sacrifier ces désirs et de les rassembler autour de la question de Dieu.
Question : comment peut-on en arriver à de telles analyses ? Comment peut-on décrire de cette manière la vie, l'existence, l'être dans le monde ? C'est en relisant ce que j'ai écrit hier que j'ai commencé un peu à comprendre un point de vue qui revêt a priori tous les oripeaux de la pure théologie, ou encore d'un platonisme poétisé, en tout cas, d'une perspective purement religieuse. Pour la plupart des intellectuels qui croisent ces questions en chemin, ces manières de voir ressortissent toutes à tradition théologique que l'on renvoie en général dans la catégorie dite mystique, c'est à dire pas très éloignée d'une psychopathologie dont il existe des exemples célèbres comme Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. Dans tous les cas de figure ce genre d'éthique qui rejoint sur le fond le monachisme, c'est à dire les pratiques monastiques ou celles des ermites et des anachorètes, demeure le fait de quelques illuminés, qu'ils soient ou non considérés comme modèles à imiter ou comme cinglés comme il y en a toujours eu dans notre société. Or il n'en est rien. Je pense au contraire que ces individus, qui ont eu accès d'une manière ou d'une autre à la culture, c'est à dire pour la plupart d'entre eux à l'écriture, à la connaissance du Latin, bref à la faculté de publier leurs pensées, sont des hommes comme vous et moi. A la différence près que ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement leur " Surmoi " possédait une force inhabituelle, ce qui faisait de ces mystiques des gens tout simplement un peu plus fous que les autres, dont le message ne semblait pas avoir grand sens. Plus de sens du tout dans notre monde qui prétend non seulement réguler le fonctionnement du corps par les techniques de la médecine, mais encore celui de l'âme, de la psyché, par des thérapies scientifiques aussi efficaces que celles qui traitent le corps. Les Américains, encore eux, ont fabriqué un catalogue psychiatrique qui accole pour ainsi dire une substance chimique à chaque cas de déviance mentale. Plus de problème Madame Michel.
Il n'y a ni spécificité religieuse ni folie dans les analyses mystiques. Je dirais même qu'elles comportent un degré de vérité extraordinairement fertile et qui nous concerne tous autant que nous sommes. Je fais remarquer en passant, que la plupart de ces gens dont je parle ici, ont tous été rejetés par les sociétés dans lesquelles ils ont eu l'audace de s'exprimer comme ils l'ont fait. Certains, comme Giordano Bruno, pour ne citer que le plus célèbre d'entre-eux, sont morts brûlés vifs sur la place publique. C'est dire si leur message chatouillait quelque part les autres religieux que Thomas Murner, un de ces fous qui fréquentaient les Réformateurs de la Renaissance, qualifiait de cochons bien nourris par l'argent des pauvres. De quelle vérité peut-il bien s'agir ?
Je vais utiliser un mot qui va non seulement nous rapprocher de ce que veulent dire ces mystiques, mais qui va aussi nous rapprocher de notre destin à tous, qui que nous soyons dans cette longue histoire que certains disent terminée. Ce mot est " écœurement ". Lorsqu'on est écœuré, cela signifie littéralement que notre cœur se vide, on sent comme un mouvement dans la poitrine qui indique que quelque chose s'échappe du corps, provoquant ainsi ce qu'on pourrait qualifier de " petite mort ". Le spectacle du monde nous écœure pour autant que nous soyons attachés à des valeurs que nous voyons chaque jour bafoués de plus en plus ouvertement. J'imagine par exemple le cas de Sébastien Franck qui a vécu pendant la guerre des Paysans en Allemagne et en Alsace au début du Seizième siècle. Il arrivait dans des villes entre des rangées de potences où pendaient les rebelles et devait assister à des supplices du genre de celui imaginé par le Comte Kasimir. Ce bon seigneur avait fait crever les yeux à quatre-vingt paysans en leur disant que puisqu'ils n'avaient pas voulu le regarder comme leur maître, ils cesseraient désormais de regarder tout court. Qui d'entre-nous n'a pas été écœuré par les images qui provenaient du Ruanda, du Vietnam et d'autres plus anciennes mais encore pire ? Ecœurement, voilà qui nous ramène à cette idée de vider l'âme chère à ces fous du Moyen-Âge. Il est vrai que l'écœurement n'est pas voulu, il a tout simplement lieu face à une réalité que nous réprouvons et qui nous dégoûte, qui nous " soulève le cœur ". Mais comme le dit si bien Rousseau à propos de sa poissonnière, tout le monde n'est pas écœuré par le même spectacle révoltant. Seul le juste, en l'occurrence la personne la plus simple, la femme du peuple, sans culture et sans ambitions, la poissonnière, éprouve de la pitié pour la victime de l'injustice qui se déroule sous ses yeux.
Mourir à soi ce n'est donc rien d'autre que vivre un certain écœurement. Mais un écœurement qui ne doit rien au hasard de la rencontre du mal. Mourir à soi dans le sens des mystiques c'est en quelque sorte piloter son écœurement, d'abord le vouloir, c'est à dire rechercher toutes les occasions d'affronter le mal et résister à la tentation de faire profiter son corps et son propre être de l'offre que contient toujours le mal de s'en rendre complice. C'est détruire en soi systématiquement tout désir qui pourrait conduire à enfreindre, non pas la loi extérieure de l'Eglise ou de la Société, mais celle du cœur, celle de la part qu'il y a en nous de Dieu. Tout cela, me direz-vous, reste encore du domaine de la moralité, c'est à dire justement de ce domaine dont la Religion s'est adjugé le monopole, et demeure encore très éloigné de ce sentiment de dépropriation que j'ai décrit hier, cette sensation de me fondre dans le tout en laissant " choir dessus la place " les pétales de mon identité. Or je pense qu'il s'agit là aussi d'une " mort à soi ", et demain je tâcherai de montrer comment se lient entre eux les deux moteurs de cette volonté de mourir à soi, à savoir Dieu et la question de l'Être. Les philosophes contemporains se sont à peu près tous mis d'accord pour dire que l'on ne peut plus faire de philosophie. On ne peut plus en faire parce que toute philosophie serait forcément rattachée à la théologie d'une manière ou d'une autre, toute philosophie serait ce qu'ils appellent de l'onto-théologie, c'est à dire une ontologie clôturée par un paradigme transcendantal, c'est à dire d'ordre divin. Je pense que cette situation n'est guère différente de celle de ces siècles où on ne disait pas qu'il n'y avait plus rien à dire, mais qu'il était interdit de dire autre chose que ce qui était permis. Dieu n'est jamais qu'une substantivation de la notion d'être, ce n'est pas une raison pour enfermer le concept d'Être dans la notion de Dieu. Les mystiques n'ont rien fait d'autre que d'enfreindre cette identification de l'Être à Dieu, tout en se servant du mot Dieu parce qu'ils n'avaient pas le choix.
Le même jour 17 heures.
Pourquoi le mot folie rôde-t-il autour de ces deux derniers textes ? Avant d'en arriver à ce que je promets plus haut, je voudrais d'abord dissiper un malaise qui aurait pu s'installer à la faveur de l'usage du mot folie, fou etc.. Dans le texte de vendredi j'ai bien senti le frisson qui s'est emparé de l'éventuel lecteur qui serait un familier de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Il n'est pas certain non plus, que ces mêmes représentants des sciences de l'âme et de ses maladies, n'aient pas hoché la tête d'un air entendu dans mon texte d'aujourd'hui sur les " Schwärmer ", mot allemand qui signifie les " inspirés ", mais aussi les " agités ", qualificatif qu'on attribuait alors à tous les hérétiques, et en particulier aux anabaptistes et aux Hussites que réprouvaient même Luther, Erasme et les autres grands réformateurs de l'Eglise Catholique. Cela me rappelle qu'à la même époque Sébastien Brant écrivait un livre qui s'appelait la Nef des Fous, mais chez lui, les fous c'était tous les autres, toute la société elle-même. En réalité, la folie a ici sa place à cause du vide dont il est partout question. Dans mon immersion dans le tout, je me vide de mon identité, je renonce en quelque sorte à mon moi pour m'en moquer, me moquer d'abord de son inanité en regard de la grandeur de l'univers, un peu à la manière pascalienne, et puis de son être tout court tant ce moi ne fait que participer au tout par toutes ses propres parties (je suis fais par exemple des matières qui sont aussi en-dehors de moi, je ne renferme du point de vue matériel absolument rien d'original, n'étant qu'un bout de matières assemblées ayant telle et telle forme), et encore, il participe si brièvement, à peine une étincelle devant l'éternité. Mon moi n'est rien d'autre qu'un pur point de vue sur le tout et à partir du tout. Si vous voulez, je peux m'imaginer me voir m'évaporer après ma mort et me dissoudre dans un retour dans les matières qui me constituent aujourd'hui et qui font tant de bruit (sans jeu de mot) dans les salles d'hôpitaux et les universités de médecine). Ce sentiment me permet d'ailleurs parfaitement de comprendre le cynisme qui finit par s'emparer de la plupart des médecins pour qui tous ces corps ne sont que des cycles de fonctionnement physiologiques et biologiques. Il ne doit pas être facile de respecter le serment d'Hippocrate dans de telles conditions, c'est à dire de tenir compte de l'identité propre du patient, même si la psychologie vient parfois mettre son grain de sel et ajouter le paramètre de l'expérience subjective pour éclairer tel ou tel symptôme. Je pense souvent à ces dissections didactiques de corps de clochards que personne ne réclame et donc dont personne ne paye la pompe funèbre. Le médecin appartient d'ailleurs à une corporation particulièrement exposée à la tentation de se faire complice du mal au lieu de s'effacer devant son devoir de secourir l'Autre. Pas si facile, et d'autant moins facile je suppose, que le savoir est grand sur les fonctionnalités de ce morceau de chairs et d'os.
Tout cela, le sentiment de n'être rien, la volonté de se vider de ses pulsions naturelles, tout cela peut porter le nom, lui-même pompeux, de tendance à la perte d'identité, et, un peu plus loin le diagnostic médical tombe comme un couperet, ce type est schizophrène. Si on a brûlé Bruno, comme on brûlait les sorcières, c'est que Bruno faisait peur comme faisaient peur les sorcières. A la différence près que pour Bruno, la peur avait un sens réel et réaliste, alors que pour les sorcières il en allait non seulement de superstitions infantiles, comme toute société en trimbale, mais encore d'un moyen bien pratique pour cultiver le patriarcat en le pimentant d'un rien de sadisme, lui bien pathologique. Le Divin Marquis n'avait pas tort de choisir ses personnages dans le clergé et dans la noblesse, car c'est bien dans l'exercice du pouvoir spirituel et politique que s'opèrent toujours les dérapages les plus criminels et les plus proches de ce qu'on désigne sous l'idée de mal. Ce n'est pas pour rien non plus que tous les pouvoirs spirituels et politique font illustrer en général ce même mal par des personnages tirés du monde des pauvres, comme aujourd'hui, n'est-ce-pas ? Sacrés petits voyous allez ! Si donc Bruno faisait peur, c'est qu'il portait en lui le risque de publier des vérités qui font mal, qui portaient en elles le risque de semer le trouble dans la société et de remettre en cause la légitimité des pouvoirs spirituels et temporels en place à cette époque en Italie. C'est exactement la même chose qui est arrivée aux " Schwärmer ", aux hérétiques qui parcouraient l'Europe, chassés de partout, massacrés ici et là, débinés dans des textes élégants par les grands intellectuels reconnus de l'époque, jamais remis en question, jamais menacés ni dans leurs corps ni dans leurs ambitions. Qui, aujourd'hui encore, mettrait en cause des noms comme Luther, Calvin, Zwingli ou Erasme, même si on sait que ces quasi Saints sont responsables de multiples pogromes et de meurtres sans phrases à travers toute l'Europe ? Qui sait qu'on a aussi brûlé des hérétiques sur la place publique de Genève, au nom du Protestantisme ?
Comment des Giordano Bruno pouvaient-il " publier des vérités qui font mal ", alors qu'il s'occupait principalement d'astronomie, de mathématiques et de philosophie ? Quel danger représentaient ses travaux ? Attaquait-il quelqu'un personnellement ? Critiquait-il le gouvernement de son pays ou même le Vatican ? Entretenait-il des activités terroristes ? Rien de tout cela. Bruno était un vrai penseur, et un penseur du vrai. Intolérable. Ce qu'il faut essayer de saisir ici c'est une chose proprement monstrueuse et qui n'est même pas l'apanage de ces temps dits anciens, car je pense et j'affirme que nous en sommes encore là : cette chose monstrueuse est que la vérité autorisée est totalitairement imposée, qu'aucune pensée qui refuse de s'inscrire dans le Texte idéologique qui a reçu l'onction, l'imprimatur des autorités temporelles, n'a pas droit de cité. De chaque côté du fleuve de la vie des peuples il y a des digues infranchissables, des digues qui maintiennent l'opinion dans le droit chemin, celui que tracent pour eux les puissants, les vrais, ceux qui mandatent aussi bien les généraux des armées que les mandarins des universités.
Je vous vois rire, ou sourire parce que vous n'êtes pas méchants. Soit, vous n'avez peut-être pas tort si vous pensez que j'exagère quelque peu, que je force le trait, et peut-être devrais-je balayer devant ma porte d'intellectuel raté, non reconnu, qui n'a jamais reçu l'imprimatur et qui ressasse son amertume. Peut-être, peut-être. Que répondre à ces doutes que moi-même je porte sur moi-même ? Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, disons, ce que je constate, c'est que les rares voix d'aujourd'hui qui n'acceptent par les " références " mais qui ont encore réussi à capter des vecteurs d'expression publique, ceux-là ne font pas long feu dans l'agora. Voyez le mur de l'Atlantique qui se dresse depuis quelques jours contre Péan et Cohen parce qu'ils ont osé s'en prendre à un quotidien qui a depuis longtemps trahi les idéaux de ses fondateurs. Je parie que malgré le succès de librairie qui a suivi l'éclatement du scandale, un silence de plomb ne va tarder à retomber sur les vérités qu'ils ont osé révéler au grand jour. Si vous aviez la patience de lire toute ma chronique, qui va bientôt fêter son dixième anniversaire, vous y trouveriez des critiques du journal Le Monde qui remontent bien en-deçà du livre de ces deux journalistes et qui portent d'ailleurs sur l'un ou l'autre des sujets qu'ils traitent. Il y a plus grave, mais j'ose à peine en parler. L'affaire Heidegger. A quoi assiste-t-on depuis une quinzaine d'années sinon à la liquidation définitive de la plus importante pensée depuis Parmenide ? On pense avoir des arguments en béton contre cet ex-nazi dont la pensée ne peut qu'être entachée de sa complicité avec les bouchers d'Auschwitz. J'ai assez écrit là-dessus et je ne tiens pas à en remettre. Je voudrais seulement poser certaines questions gênantes peut-être : a-t-on condamné Luther pour le blanc-seing qu'il a donné aux princes pour massacrer les paysans ? Et qui songerait à faire un procès à Platon pour avoir tenté de jouer au roi-philosophe avec la complicité d'un tyran ? Mais ce qui est plus grave en ce qui concerne Platon, c'est que sa République demeure le livre de référence de notre culture alors qu'il s'agit d'un quasi torchon fasciste. Et puis, croyez-vous que l'Eglise Catholique ait battu sa coulpe pour avoir calciné Bruno ainsi que des centaines de milliers de sorcières et d'hérétiques ? C'est tout juste si elle a trouvé le courage de réhabiliter Galilée qui, lui, s'est dégonflé à la dernière minute. Jean-Paul II qui a parcouru l'Amérique Latine du Nord au Sud, a-t-il demandé pardon aux Indiens pour les génocides que le Vatican a légitimé sans sourciller ?
Heidegger est bienvenu à cet endroit de mon développement, car dans la Théologie dont je viens de parler longuement, c'est de la question de l'Être qu'il y va. Ce que tous les hérétiques sans exceptions ont commencé par remettre en question, ce fut l'Eglise Catholique elle-même, cette nomenklatura nichée dans des palais, cet appareil qui s'est construit pratiquement et théoriquement sur le mensonge, c'est à dire sur l'abandon de la question de l'Être. Les pires des hérétiques, ceux qui n'ont trouvé grâce nulle part ont été assassinés comme Müntzer ou ostracisés de villes en villes comme Franck. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient rendu compte que la nouvelle Eglise, celle qui prétendait réformer la pomme pourrie de Rome, était devenue elle-même une pomme pourrie. Les sectes hérétiques se sont alors mises à fourmiller à travers toute l'Europe et jusque dans les nouvelles possessions d'outre-mer où il durent souvent s'enfuir. Franck est allé plus loin, il a montré qu'aucune Eglise n'était possible et que toute association était condamnée à subir le même sort que l'Eglise de Rome. Pour lui Dieu avait placé en chacun de nous un mot, son nom, et dès lors c'était à chacun de nous d'en faire ce que nous voulions. Nous avons en toute action le choix de nous tourner vers ce nom ou de nous en détourner, de trouver en lui la réponse juste et la vertu nécessaire ou de l'ignorer. On dirait du Kant avec son sentiment naturel en chacun du respect et de la dignité. On dirait Schelling et son concept de liberté révélée. On dirait Heidegger avec son idée du Dasein aux prises avec la facticité de la vie, c'est à dire ce que les médiévaux appelaient le " Fleisch ", la viande, les appétits et les occasions du quotidien.
Lundi 10 mars 2003
Ouvrons une petite parenthèse sur le présent qui semble subir une sorte de surchauffe nourrie par un feu à boulet rouge des médias. La planète, notre continent, notre pays, semblent être en proie à des convulsions qui laissent profiler toutes sortes de conséquences aux allures millénaristes. On se croirait justement dans l'un de ces siècles charnières, comme le dixième, où tout le monde était persuadé de la venue certaine de la fin du monde. Je dois néanmoins faire remarquer qu'à lire attentivement ma chronique on devrait trouver ici et là tous les éléments de compréhension de ce qui se passe, et même des prévisions déjà anciennes qui se vérifient au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Entendre ce matin Alexandre Adler déclarer que l'Europe était sur le point de naître réellement, c'est à dire politiquement, a de quoi me faire boire du petit lait. Et de surcroît exactement de la manière que j'avais décrite, c'est à dire en opposition avec les Etats-Unis. Et puis j'entends aussi des analyses enfin plus claires de Baudrillard sur la position du président américain par rapport à la guerre annoncée, des analyses que l'on peut aussi trouver dans une de mes chroniques d'il y a quelques semaines. J'y avais clairement établi le transfert sur l'Irak de l'humiliation de l'attentat de Manhattan et la nécessité ressentie par Bush d'effacer au plus vite cette position plus qu'inconfortable d'être le premier président américain à avoir subi un échec sur son propre sol. Voilà une vérité que l'on commence à comprendre un peu partout dans le monde, le fait que le projet monstrueux de faire la guerre à un pays par ailleurs ravagé et exsangue n'était qu'un simulacre de guerre, d'avance gagnée par un homme qui a un besoin subjectif de laver son honneur à n'importe quel prix.
Même en Amérique on commence à ouvrir les yeux puisque le New-York Times a retourné sa veste et exige un guerre propre, c'est à dire légitimée réellement par l'ONU. C'est dire si on sait pertinemment là-bas que Bush lancera ses troupes avec ou sans l'aval onusien. Mais tout n'est peut-être pas joué, car les retournements d'opinion possèdent aujourd'hui la vitesse du son. Newsweek a enfourché le même cheval, il ne reste que quelques heures à l'exécutif américain pour forcer le barrage qui est en train de s'élever contre la folie de son chef. Pareil en Grande Bretagne où des députés travaillistes demandent la tête de leur Premier Ministre, événement dont je ne connais aucun exemple dans l'histoire de ce pays. Bush se démène aux quatre coins du monde pour rassembler la majorité qu'il lui faut au conseil de sécurité, et j'entends d'ici les menaces et les chantages auxquels ont droit en ces heures mêmes des pays comme la Guinée, l'Angola ou le Chili. Plus grave, la France est directement menacée par Washington, ce qui est une imbécillité stratégique grave, car une telle menace ne peut que resserrer autour de Paris le soutien des capitales européennes.
Cette situation contient un paradoxe qui échappe à tout le monde. Cette France qui résiste depuis Mitterrand à l'ultra-libéralisme, c'est à dire au diktat de Wall-Street, commence enfin à donner des gages de sa volonté de s'y plier - il suffit de voir les chiffres de l'emploi, des délocalisations et les projets anti-sociaux que le Premier Ministre a mis en train - , et c'est à ce moment-là, au moment où les décideurs planétaires commencent à se frotter les mains de voir la France rentrer dans le rang que Paris se voit engagé dans un bras de fer avec Washington ! Je ne doute pas que le Wall-Street Journal, qui a soutenu Bush sans faillir jusqu'à présent, ne finisse également par changer d'avis, car en y réfléchissant bien, les stratèges de l'économie américaine pourraient bien finir par comprendre qu'une Europe politiquement unie, c'est à dire notamment une France décidée à partager son destin avec une Allemagne social-démocrate, va complètement modifier les données du problème. Quel est l'axe de la domination du libéralisme en Europe ? C'est le traité de Maastricht et sa doctrine sur l'endettement des états. Or la France comme l'Allemagne ont déjà franchi les limites concédées de 3%. Il y a fort à parier que si Washington mettait en action des mesures de rétorsion à l'égard de l'un ou l'autre pays européen, la réponse serait sanglante : fini les critères de Maastricht, l'Europe prendrait son destin en main sans plus tenir compte de la discipline imposée par le Fonds Monétaire International, porte-parole des décideurs de la Banque Fédérale. La guerre Euro contre Dollar commencerait alors dans des conditions toutes différentes et nous entrerions dans une époque protectionniste dont nous tirerions au moins provisoirement un grand profit. Car il ne faut pas oublier ma théorie des dominos.
En effet, admettons que Bush aille jusqu'à outrepasser un veto de l'ONU et fasse sa guerre, il faut alors prévoir des réactions en chaîne jusque dans la plus lointaine Asie. Car que signifierait le geste de Washington dans les chancelleries du monde entier ? Rien de moins que l'hégémonie américaine sans masque, avec toutes les menaces qui se profilent derrière le fait que le fauve est démuselé. L'ONU est la seule instance qui retienne encore le déferlement des troupes et des bombes sur l'Irak. Si demain ces troupes et ces bombes ne sont plus retenues, alors plus personne n'est en sécurité. Ce n'est pas pour rien que Kim Jong Il a remis le paquet pour renforcer sa puissance de feu nucléaire, il sait qu'il sera l'un des premiers visé par une Amérique triomphante d'un Saddam Hussein condamné d'avance. En fait, la guerre contre Bagdad serait bien, comme le dit Baudrillard, une guerre déjà faite, mais cette constatation doit aller plus loin, cette guerre déjà faite et déjà gagnée n'est rien d'autre qu'un passage à l'acte de l'instinct hégémonique. A partir de là toute la planète pourra se sentir menacé par le loup, à commencer par ceux qui n'ont pas encore tout à fait rompu avec l'éthique socialo-communiste, à commencer par la Chine. Si la Chine continue aujourd'hui de soutenir Pyongyang, c'est que Pékin n'ignore rien de ce que j'écris ici et sait pertinemment que Bush ne s'arrêtera pas à Bagdad. Que feront les Turcs ? Cette question m'intrigue particulièrement parce que Ankara a toujours pris les mauvaises décisions dans les dernières grandes occasions, toujours fascinée par la puissance pure. Son ralliement à Washington pourrait servir de symptôme alarmant pour l'avenir. A suivre.
Mardi 11 mars 2003
Je l'avais souligné il y a quelques années, justement à propos de Chirac, l'histoire fait les hommes et non le contraire. Hier soi j'ai écouté attentivement notre Président abattre ses cartes face à son peuple et au monde entier, et pour la première fois j'ai senti un homme bien dans sa peau. Chirac n'a jamais été bon face à une caméra, et je me souviens du portrait que j'avais fait de l'homme qui malgré tous les efforts de son entourage ne passait pas, il faisait peur aux téléspectateurs, alors que tous ceux qui l'on rencontré personnellement sont d'accord pour en faire un homme d'un charisme extraordinaire et d'un charme extraordinaire, je peux moi-même en témoigner. Ce malaise face aux médias n'a jamais eu qu'une seule raison à savoir l'absence chez lui de conviction politique, disons de point de vue théorique. Sa carrière jusqu'à présent a été celle d'un sujet ambitieux et assez habile pour éviter tous les pièges qui ne lui ont pas manqué en provenance de tous les camps politiques. Hier soir il a été pratiquement à la hauteur de François Mitterrand lui-même, et croyez-moi, ce n'est pas un petit compliment de ma part. Souvenez-vous de l'intelligence et de la sérénité de l'ancien président socialiste lorsqu'il s'adressait aux Français ou à des journalistes. Les mots venaient aisément, preuve d'une pensée ferme et claire et Mitterrand ne bafouillait jamais, ne marquait jamais la moindre hésitation et faisait preuve d'une clarté de construction et de style dans toutes ses interventions. Je me souviens notamment de son discours lors de la prise de position de la France par rapport au déploiement des missiles en Allemagne en réponse aux menaces soviétiques, ou bien encore de son intervention solennelle où il justifia la participation de la France à la Guerre du Golfe. Hé bien, hier soir Jacques Chirac s'est hissé à la hauteur de cette stature, sans même donner l'impression de jouer une sorte de comédie gaullienne.
A l'instant j'entends Alexandre Adler aller encore plus loin que moi en hissant le président de la République jusqu'au titre d'Empereur de l'Europe. Selon le commentateur de France-Culture, Chirac aurait réussi à rassembler les pays européens sur sa position, rassemblement dont je ne cesse de parler moi-même sans aller jusqu'à l'attribuer à un seul homme, même si cet homme joue admirablement sa carte. Il ne faudrait quand-même pas oublier que sans le soutien de l'Allemagne - Schroeder a largement précédé les Français dans une opposition radicale à la nouvelle guerre du Golfe - Chirac aurait eu du mal à tenir la position qu'il a adopté dans ce jeu de poker international. De Gaulle claquant la porte de l'Otan était une fois de plus un homme seul, comme en 39 lorsqu'il prit l'avion pour Londres. Il faut donc modérer nos louanges et nous contenter, pour le moment, de voir dans l'attitude positive de Jacques Chirac un phénomène qui le dépasse lui-même, celui d'une Europe qui commence à se sentir enfin dans la forme d'une entité parce que cette entité se trouve menacée par l'hégémonisme foncier des maître actuels de Washington. Chirac lui-même semble parfaitement comprendre les données du problème, car aux questions concernant les menaces qui planent sur les futures relations entre l'Amérique et l'Europe, il a gardé un calme parfaitement justifié, comme je l'ai montré dans mon commentaire d'hier. Les deux journalistes qui l'ont interviewé n'ont pas eu la présence d'esprit de lui poser des questions portant sur une stratégie à long terme à propos de ces relations, mais Chirac n'ignore certainement pas que le protectionnisme est au programme de l'avenir, et cela au profit de notre continent. J'en veux pour preuve le sourire ironique qui accompagnait sa réponse sur l'imbrication des entreprises transnationales et du rôle imparti à l'OMC, dont il n'ignore pas qu'elle est un jouet américain auquel l'Europe saura réserver le sort qui conviendra le moment venu. Soulignons aussi, pour éclairer la malice du sourire en question, que l'Euro a atteint hier son plus haut cours par rapport au dollar. La force de notre monnaie, hier encore menacée de mort subite, est une preuve concrète de la position de force de cette " vieille Europe ". Le croirez-vous, mais le destin de l'Euro n'est certainement pas pour rien dans la folie vengeresse de Georges W. Bush soutenue si rageusement par Wall-Street et son organe de presse. On peut d'ailleurs se demander ce qu'une victoire à Bagdad pourrait bien lui rapporter sinon un alourdissement fantastique de la dette extérieure, déjà apocalyptique. Voilà qui est d'ailleurs plus inquiétant que toutes les conséquences immédiates d'un conflit dont on sait, comme Baudrillard l'a dit hier, qu'il a déjà eu lieu et qu'il est déjà gagné par Washington. Car la dette américaine est en train d'entrer dans la zone de l'insolvabilité. Si on y ajoute les créances qui se baladent un peu partout dans le monde sous forme de Bons du Trésor américain, dont les japonais possèdent une quantité vertigineuse, on ne donne pas cher de l'équilibre financier de l'état américain. Or, que peut faire un état acculé dans une telle impasse, sinon fuir en avant dans des aventures de plus en plus risquées, de plus en plus ruineuses et dont les enjeux ne peuvent plus qu'augmenter au fur et à mesure, au point que les gains obtenus en Irak serviraient à peine à rembourser les intérêts des dettes qui se seront accumulées d'ici là. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que Washington ne pourra pas s'arrêter à Bagdad et se verra contraint de poursuivre sa politique de conquête hégémonique. Napoléon fut en son temps pris au même piège : la guerre coûte cher et les pertes décuplent à chaque fois le montant des investissements qu'il faut entreprendre. C'est ainsi qu'il a ruiné la France manipulé par des puissances extérieures qui possédaient toutes les réserves nécessaires pour épuiser à petit feu le monstre français.
Reste-t-il une solution à l'heure où j'écris ? Peut-être, et Chirac y a d'ailleurs fait allusion hier soir. Si Washington retrouve son sang froid et trouve le courage de revenir sur sa décision de déclencher l'Apocalypse en rapatriant ses troupes, je suis persuadé que ses Alliés seraient prêts à prendre en charge une partie de l'engagement financier gigantesque que représente d'ores et déjà le déploiement dans la zone du Golfe et en Turquie. Je n'oublie jamais les choses concrètes puisque j'y suis confronté moi-même tous les jours, tous les jours il faut que je compte mes sous pour voir où j'en suis et comment je vais m'en sortir. Alors je pense au prix de ce que les Américains investissent chaque jour, chaque heure, là-bas, dans leurs bases, dans le transport et dans la production haletante de tous ces moyens de destruction. Le refus européen de participer à la bataille de Bagdad, n'oublions pas ce petit détail, implique aussi et d'abord que l'Europe refuse d'engager des dépenses dont la charge pèserait sur des peuples déjà rendus inquiets par cette mondialisation américaine qui vide nos usines, nos ports et remplit nos institutions caritatives. Je ne peux que me réjouir des futurs bénéfices que nous tirerons de notre lucidité, bénéfices dont seront peut-être privés, hélas, quelques-uns d'entre-nous comme les Italiens, les Espagnols ou les Portugais. Washington doit être en train de leur faire croire le contraire en leur faisant miroiter des aides futures et des privilèges économiques à venir. J'ai bon espoir que les peuples en question sauront montrer qu'ils sont moins naïfs et moins corrompus que leurs gouvernants.
Le même jour à 13h50
Revenons à nos préoccupations métaphysiques, et laissons pour quelques temps l'actualité s'écouler comme s'il n'était que du temps pur, non décoré par tous nos sentiments, nos peurs, ces images qui impressionnent tant et cette certitude si naïve que la réalité, c'est nous, c'est maintenant, que le sort de l'univers se joue là parmi nous, seulement parce que notre sort individuel y est rattaché. Je viens d'entendre Raymond Aron parler d'épistémès différentes dans cette Histoire dont on parle tant, des époques séparées les unes des autres par des " révolutions coperniciennes " et donc de cette impossibilité qu'il y aurait à penser comme on a pensé il y a quelques siècle ou quelques millénaires. Bien sûr, je m'inscris totalement en faux contre ces thèses contemporaines, puisque si je ne me trompe pas, c'est un certain Michel Foucault qui a inventé cette notion de " rupture épistémologique ", ces fossés qui sépareraient des ensembles nommés Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, Epoque Moderne etc… Ce philosophe bien sympathique au demeurant, pensait notamment que l'homme n'avait jamais été l'objet de la pensée avant les Lumières, que le souci de l'homme était un affairement moderne, qui passerait un jour comme auraient passé les autres.
On peut dire des choses comme celles-là, ça ne mange pas de pain, car il est vrai sans doute que les Anciens s'intéressaient davantage au mystère de la réalité, de l'Être, que les médiévaux n'avaient de pensée que pour Dieu et que l'Homme moderne ne naît qu'à partir du moment où on commence à lui reconnaître des Droits aussi sacrés que les devoirs du Décalogue. Mais je reste sceptique malgré tout, car il ne faut pas attendre Freud et les sciences humaines pour retrouver l'homme au centre de toutes les problématiques, de tous les soucis moraux, partout, dans tous les textes, qu'ils soient de l'Antiquité, de la scolastique, de la philosophie moderne ou de la période phénoménologique. Au demeurant, même si par là on voulait dire que le véritable objet de la philosophie, et donc de la pensée, demeure l'Être, même alors demeure le fait que sa question passe par l'homme et non pas par le chimpanzé. Il y a deux mille cinq cent ans, Protagoras avait dit une fois pour toute : " l'homme est la mesure de toute chose, de celles qui sont et de celles qui ne sont pas ". Je cite de mémoire.
C'est d'ailleurs cette ambiguïté du statut de l'homme qui a provoqué cette méditation. Le fait de pouvoir se sentir perdre cette identité nommée anthropos à la faveur de certaines expériences personnelles. Il n'y a pas eu que les mystiques européens qui ont cultivé cette théologie " négative " qui engage l'homme à se vider de ses affects et des passions qui le relient au monde matériel, ou plutôt qui l'y emprisonne. Au Moyen-Orient, certaines sectes également désignées sous le nom de sectes hérétiques, comme les adeptes du soufisme par exemple, prêchaient exactement le même discours, avec des variantes quant à la méthode qu'il faut employer pour parvenir à cette fin. Mais quelle est cette fin ? Pour les différends discours théologiques, qu'ils soient chrétiens, musulmans voire taoïstes, le but est d'atteindre Dieu, d'entrer pour ainsi dire en contact avec lui, ou de lui céder la place en soi-même. Pourquoi ne pas dire les choses ainsi, si on appartient à une " épistémè " où la chose en soi, la chose essentielle, l'essence de toute chose, l'Être s'appellent Dieu ? Mais tout ça c'est une affaire de langage, de poésie dirais-je presque, et d'une poésie qui nous vient en ligne directe de la douce folie des Grecs qui avaient inventé des dieux plutôt pour s'amuser et se dédouaner de leurs conneries personnelles que parce qu'ils croyaient en l'existence de divinités s'appelant Zeus, Hermès, Athéna ou Poséidon. Par la suite se sont opérés des amalgames avec d'autres divinités dont celles du monothéisme, et les choses ont pris un tout autre tour. Croire dur comme fer en Dieu aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec les croyances des Romains, des Grecs ou des peuples du Croissant Fertile. En ce sens, oui, il y a " rupture épistémologique ", mais le langage ne constitue pas à lui tout seul ce que les Grecs appelaient l'épistémè ou la sophia, ou encore la phronésis, sorte de sagesse dont seul Heidegger a montré l'importance par rapport justement aux deux autres concepts. Car la phronesis ne renvoie pas à une sagesse qui s'intéresse à l'Être ou au divin, mais plutôt à la manière de vivre, de vivre en société et de diriger correctement sa vie et celle de la communauté. S'il y avait réellement rupture épistémologique, je ne vois pas comment on pourrait seulement lire ce qui reste des textes anciens et médiévaux, même s'il est vrai que chaque lecture demande ce qu'on appelle une certaine herméneutique, une interprétation. Mais quelle lecture ne le demande pas ?
Or, la dissolution dans le tout, le fait de " vidanger ", si je puis m'exprimer ainsi, son âme pour se rendre disponible à quelque chose d'autre qu'au spectacle immédiat et à ses tentations, me paraît être un phénomène naturel, inclus dans le cours de l'existence de chacun de nous dès lors qu'il s'est mis un jour en quête d'autre chose que de ce qu'il perçoit. Dès lors qu'il s'est mis un jour à distance de tout fonctionnement aveugle, de tout discours reçu, de toute croyance inculquée afin de chercher cela qui met en scène tout ce qu'il perçoit. La recherche peut se décrire ainsi : je suis dans un monde, j'existe en percevant un univers dont je tire d'ailleurs ma vie et aussi des jouissances et des souffrances. Je peux, dans cette situation me contenter de gérer ces trois aspects : survivre, jouir et éviter la souffrance, bref gérer ma vie selon des choix qui me font circuler entre les objets et les êtres d'une manière ou d'une autre, morale ou pas, efficace ou non. Je peux aussi ne pas me contenter de cette gestion de ma place dans le cirque, je peux refuser de me consacrer tout entièrement à assumer les fonctionnalités qui me sont offertes au mieux de mes moyens, de mon intelligence et de ma force. Pour faire quoi ? Pour tenter de comprendre pourquoi je suis embarqué dans cette gestion, qui au demeurant m'est imposée sous peine de souffrir encore plus et de disparaître plus vite que la moyenne des hommes ne le souhaitent. Maintenant bien sûr, cette mise à distance ne devient elle-même réellement pure qu'à partir du moment où on a fait table rase de toutes les explications qu'on vous offre clé en main. C'est ce que Descartes constate lui-même au début de son Discours de la Méthode.
La recherche qu'on entreprend ainsi de facto n'est pas chose facile, car on ne possède pas d'outil puisqu'on doit renier ceux dont on dispose. Pas question de s'en remettre à tel ou tel catéchisme, et pourtant il faut bien trouver des interlocuteurs, s'appuyer sur d'autres hommes qui semblent avoir aussi cherché dans la même direction. On ne peut pas tout tirer de soi-même ne fût-ce que parce qu'on ne vit pas en solitaire et que le débat naît forcément parce que chacun s'interroge un jour ou l'autre sur ce fameux sens de l'existence. Alors on lit. On se procure les livres dont le sujet se rapportent au plus près à notre question et on essaye de comprendre les réponses qu'on vous propose, même celles qui dénoncent l'inanité et l'impossibilité d'une telle recherche. En général ce sont d'ailleurs les plus intéressants. Passons. On lit et on lit et on relit, car il n'y a rien de plus hermétique que des textes de philosophie. D'abord on s'enthousiasme pour telle explication et on choisit alors son maître à penser, et puis on découvre des failles, on doute pour passer à autre chose. Je ne vais pas vous décrire toute une vie de lecture, tout ce que je peux vous dire c'est que plus on lit plus on y prend goût et plaisir. Comme un chasseur qui a trouvé une nouvelle piste on se précipite sur tel ouvrage qui ouvre d'autres pistes de recherches et parfois on tombe sur des gibiers de toute beauté. Mais l'important est ailleurs, l'important est dans le fait de ne pas perdre de vue son but, de ne pas lire pour garnir les bavardages de salon, mais pour trouver des pépites d'or philosophale qui vous donne l'impression de vous rapprocher de votre but. Seulement l'impression, et vous n'en demandez pas plus parce qu'il y a longtemps que vous avez compris l'alpha de toute cette recherche, à savoir que vous ne trouverez jamais. L'Oméga viendra bien plus tard quand vous aurez compris non seulement que cela n'a aucune importance, de ne pas comprendre, mais que cette impossibilité est elle-même le trésor en quête duquel vous vous êtes mis un jour.
Et alors seulement vous comprendrez les métaphores des mystiques qui parlent de vide et de docte ignorance. Nicolas de Cues fut un de ces maîtres qui m'a ouvert les yeux sur le plaisir que l'homme peut tirer du mystère de l'existence. Lui parlait de l'impossibilité de s'approcher de Dieu, nous, nous parlons simplement du mystère en tant que tel du monde et du fait qu'il soit là, autour de moi, en moi, sans que je n'ai la moindre idée de sa raison d'être. Mais Nicolas et moi parlons de la même chose, nous nous réjouissons de cette même épaisseur de l'apparente absurdité de toutes choses, de cette chose en soi qui nous échappe, qui échappe à notre domination mais avec laquelle nous partageons tout puisque nous appartenons à cela même que nous ne comprenons pas. Au résultat, je reviens au début de ma méditation, il y a cette immersion étrange dans le cours du temps, sans souci d'identité, sans souci de perdre un jour ce par quoi nous fonctionnons, c'est à dire notre corps, sans la moindre peur pour ce mot terriblement craint par tous, la mort.
Jeudi 13 mars 2003
La Tchétchénie. Curieux, Word ne souligne pas le mot Tchétchène, mais il considère le mot Tchétchénie comme orthographiquement faux. Faut-il en conclure que la Tchétchénie n'existe pas en tant que réalité géographique identifiée ? Ce qui peut s'interpréter de deux manières, ou bien le consensus taxonomique ne reconnaît pas l'existence d'un pays nommé Tchétchénie, mais seulement des citoyens russes qui sont tchétchènes comme nous sommes alsaciens ou basques, ou bien il y a une erreur tout simplement liée à la difficulté de traduction. On ne peut pas accuser Word d'être un instrument sémantique russe, les grammairiens qui ont programmé ce logiciel sont sans doute américains, et ils ont conçu leurs dénominations géographiques selon la carte politique la plus récente, vraisemblablement celle qu'a adoptée l'ONU. Autrement dit, la Tchétchénie n'existe pas en tant qu'entité politique autonome, pas plus que l'Alsace ou le Pays Basque. On sait que ce petit problème orthographique existe depuis la nuit des temps, depuis plus longtemps je pense que l'irrédentisme irlandais ou chypriote. Pour le Pays Basque je serai plus prudent, car en Espagne l'irrédentisme est une composante chromosomique de chaque région, et les Romains en ont tantôt payé le prix dans des guerres effroyables, tantôt tiré profit selon la politique déjà chère à César et qui consistait à manipuler les régions les unes contre les autres.
Il y a longtemps que je n'arrive pas à me faire une opinion claire sur Monsieur Glücksmann, qui ce matin s'égosille sur France-Culture pour crier son indignation devant la passivité de l'occident face au drame tchétchène. Je ne l'ai rencontré personnellement qu'une seule fois, dans un studio de télévision où se tenait le procès de Martin Heidegger, après la parution du livre de Farias qui se présentait alors comme une révélation sur la complicité du philosophe avec les nazis. Pendant cette cession, je dois dire qu'il ne m'a pas convaincu, se cantonnant dans une dénonciation bruyante qui ressemblait fort à ce qu'on pourrait définir comme un assassinat philosophique. Comme quoi, tout humanisme a ses limites. Et c'est justement à propos de ces limites que je voudrais dire quelques mots sur l'affaire de Grozny qui ressemble depuis plusieurs années déjà au Kaboul de l'ère des Talibans ou même à Dresde après le fameux bombardement de 1945. Car la position de Glücksmann ne varie pas d'un sujet à l'autre : Poutine (ou Eltsine avant lui) est un Saddam Hussein chouchouté par les occidentaux pour des raisons de basses Realpolitik. Le " peuple " tchétchène est un peuple martyr, comme, sans doute, mais je n'ai rien entendu à ce sujet, le peuple kurde.
Rude problème pour des personnes qui vouent leur existence à établir le martyrologe du monde entier. Dans quel catégorie faut-il classer chaque cas particulier et quels sont les éléments à partir desquels on peut, et on devrait, se permettre de privilégier la considération de tel cas plutôt que tel autre ? Peut-on introduire un ordre de préoccupation entre les divers foyers où coule le sang au nom de choses aussi diverses en apparence que la volonté d'indépendance politique, la religion ou encore l'appartenance ethnique et culturelle à un ensemble non reconnu comme une entité propre ? En vérité je n'ai pas de réponse toute faite à cette question, sinon cette ébauche d'éclaircissement qui consiste à dire qu'il y va ici de deux choses qui se complètent pour apporter au moins une direction légitime. Il y a d'une part le sentiment et la volonté humaniste proprement dite, le fait de se définir, comme le fait Glücksmann, comme le Cow-Boy qui s'occupe de la lessive du monde. D'autre part, il y a la question de la légitimité à se comporter ainsi : d'où peut-on tirer le droit de se mêler d'affaires dont nous sommes destinalement totalement détaché, c'est à dire d'affaires qui nous sont étrangères de par leur origine, mais surtout par la faiblesse de notre implication personnelle.
Dénoncer la cruauté et son théâtre, dénoncer les fleuves de sang et de douleurs qui ravagent telle ou telle partie du monde, paraît dans tous les cas légitime. Il semblerait qu'un ordre mondial humaniste soit désormais le paramètre de référence de tout jugement politique. Là où un fort massacre des faibles le parti à prendre est évidemment celui des faibles. Or les différents cas se caractérisent par des conjonctures totalement différentes, ou disons des arithmétiques de forces tout à fait inégales. Ainsi la barbarie religieuse qui oppose les Irlandais du Nord semble se faire sur une scène où les forces semblent à peu près égale, si on ne tient pas compte du fait que les Protestants bénéficient d'un soutien de facto de la Grande Bretagne à laquelle ils demandent à rester rattachés. Pas facile, dans ces conditions de prendre une position aussi claire que celle que prend Glücksmann face à la guerre en Tchétchénie. De même est-il extrêmement difficile de juger de la situation basque, où les forces en présence sont difficiles voire impossibles à quantifier. L'utilisation du terrorisme montre d'ailleurs que même pour les Tchétchènes, il n'est pas évident que les Russes soient aussi puissants qu'il le paraît. Glücksmann reconnaît d'ailleurs que la prise d'otage du Théâtre de Moscou est un dérapage de la part d'une " faction " des Tchétchènes. Mais où commencent et où finissent d'une part les dérapages, d'autre part la création de factions ?
Il faut donc trouver une éthique. Une éthique est toujours personnelle. Elle commande ce que JE dois faire hic et nunc, et non pas ce qu'une épée magique universelle doit faire, selon mon opinion du jour. Il est toujours un peu étrange d'entendre dans les médias, des femmes et des hommes s'exprimer sur le destin de tel ou tel endroit du monde comme s'ils étaient l'instance morale quasi divine, censée tout savoir et donc apte à tout décider de ce qui doit ou non être fait. Pour ma part, je pense qu'il faut redescendre à un échelon beaucoup plus modeste et se souvenir d'abord que l'on est un citoyen déterminé, d'un ensemble politique déterminé par lequel nous sommes déterminés et par rapport auxquels nous avons de réels décisions à prendre. Pour ainsi dire un droit d'ingérence naturel qui se soutient de la démocratie. Ce droit nous l'exerçons d'abord par le bulletin de vote, un exercice dont le résultat mérite notre respect, plus, un résultat qui nous contraint à ce respect, et donc au respect des décisions de ceux qui ont été élus. Cela ne signifie nullement que nous n'ayons aucun droit à la critique ni même au refus ou à la rébellion, ces droits figurent dans nos Constitutions sous certaines conditions. Aussi, je comprends parfaitement qu'un jeune russe décide de déserter pour ne pas se battre en Tchétchénie si sa conviction lui en intime l'ordre. Comme ce fut le cas pour de jeunes Français pendant la guerre d'Indochine ou d'Algérie.
Autrement dit, je pense qu'il faut s'impliquer démocratiquement dans le vaste débat du monde et de ce qui s'y passe sans se poser à propos de tout et de n'importe quoi en juge de droit intellectuellement divin. Pendant la guerre d'Algérie j'ai fait partie de ces jeunes déserteurs qui, par la suite, ont continué de militer pour la libération des pays colonisés. Mais j'avais un principe fondamental auquel je suis toujours resté fidèle, celui de ne pas me mêler du débat interne des pays pour lesquels je sacrifiai un peu de ma vie et beaucoup de mon existence future dans mon propre pays. Ce point de vue était loin d'être partagé par mes compagnons d'alors, qui prétendaient appliquer leurs jugements politiques à des réalités qui leur étaient parfaitement étrangères. Ils se comportaient en fait comme des sortes d'anges idéologiques, légitimement appelés à juger de toutes les situations selon les critères qui les avaient conduits à prendre, par exemple, le parti des colonisés contre le colonisateur. Ivresse universaliste qui leur permettait de se croire tout permis. Pourtant l'Histoire aurait dû leur servir de leçon au même titre que le fait qu'ils n'étaient pas des citoyens algériens ou angolais ou mozambicains voire cubains. Napoléon a finit par plonger la France dans la ruine et la désolation parce qu'il avait cru possible d'exporter le modèle républicain tel quel. Et au début ça ne marchait pas si mal, tant qu'il s'efforçait de respecter les spécificités des régions qu'il traversait et dont il faisait la conquête. A partir du moment où la conquête de l'Europe devint une manière de placer les membres de sa famille et de spolier les intérêts locaux, les victimes de cette dérive ne pouvaient que se coaliser contre lui et contre la France.
Les philippiques que Glücksmann adresse à Poutine, et à tous ceux qui semblent à ses yeux marquer une trop grande indifférence au sort des Tchétchènes, me paraissent non seulement ridicules, mais dangereuses. Ridicules parce qu'elles partent d'une prétention à la science de l'histoire russe et de la vérité de sa situation actuelle qui me paraît bien contestable. Que sait-il exactement sur l'histoire des relations entre cette région musulmane et les pouvoirs qui se sont succédés depuis les Tzars jusqu'à Poutine ? C'est comme le Sri Lanka dont on résume le problème par une caricature idéologique moderne d'une lutte entre des communistes et des non-communistes, alors que la guerre d'indépendance des Tamouls a commencé il y a plus de huit siècles pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la lutte de classe. Les vociférations de nos intellectuels sont également dangereuse parce que sous l'impulsion de sentiments grand-guignolesques elles prétendent se mettre à la place des institutions internationales chargées de juger de ces situations et de décider comme l'ONU le fait en ce moment-même pour l'Irak. Ils n'ont sans doute pas tout à fait tort de jouer les mouches du coche, et il faut bien que quelqu'un attire l'attention de l'opinion sur des questions que les grandes institutions semblent ignorer, mais à trop se servir du ton apocalyptique et négatif, on ne fait que marquer son mépris du sens et du véritable fonctionnement de la démocratie. Celle-ci n'est pas un ange qui peut et doit frapper selon les critères d'un Décalogue imaginaire, mais une construction politique fragile dont le destin ne cesse d'être à tout moment menacé. Ce que je voudrais dire à ces intellectuels qui en d'autres temps ont fait un véritable travail dans leur propre pays et dans le cadre d'une critique de leurs propres autorités, c'est qu'ils feraient mieux de balayer devant leur porte que d'aller jouer les Monsieur Propre là où ceux-là même qu'ils prétendent défendre se moquent d'eux la plupart du temps.
Vendredi 14 mars 2003
Encore toi Slama ! En tant que confrère je me permets de te tutoyer comme c'est la tradition, il ne s'agit donc pas d'un attitude insultante à ton égard. Je dois néanmoins reconnaître que tu m'énerves avec ton libéralisme hirsute qui n'est que l'expression de ton opinion d'homme de droite prêt à n'importe quelle approximation digne de France-Dimanche sur une diminution automatique des tarifs pourvu qu'on laisse la concurrence s'exercer sans limites. Les événements de ces dernières années ne font pourtant que prouver strictement le contraire, et à commencer par les tarifs de l'eau en France. Depuis trois décennies les inégalités tarifaires n'ont cessé de se creuser entre les communes qui ont privatisé leurs régies de gestion de l'eau, véritable poule au œufs d'or pour des groupes qui comme Vivendi ou Suez se sont emparé de l'eau française. Cette situation prouve exactement le contraire de ce que tu avances, car toutes les communes qui se sont vendues à ces groupes payent leur eau jusqu'à vingt fois plus cher que les autres. Alors camembert avec ce cliché de pseudo-économiste chargé de répandre la vulgate libérale. Ne crois pas que je ne tienne pas compte de certains paramètres qui expliquent le renchérissement de l'eau un peu partout à travers la France. Je sais pertinemment que nos nappes phréatiques se dégradent à une vitesse très inquiétante, ce qui ne peut que faire augmenter le prix de sa gestion, même dans les communes qui gèrent elles-mêmes leur eau. Or qui est responsable de cette dégradation des nappes ? Tu le sais aussi bien que moi, c'est l'agriculture libérale, qui fait ce qu'elle veut et qui se moque d'un gouvernement socialiste-vert qui veut lui faire payer ses pollutions dont Bruxelles se fiche éperdument. C'est une logique globale, cher confrère, qui a pour objectif de privatiser le monde entier au profit de ceux qui sont déjà en mesure de tout acheter et à court terme de fixer leurs propres prix sans aucun égard pour ceux qui ne seront plus en mesure de payer. Que dire du secteur de l'éducation ? Serons-nous un jour contraint d'abreuver les âmes de nos enfants avec les mêmes marchandises standardisées par les transnationales au tarif que nous serons en mesure d'honorer, tarif qui servira de paramètre fondamental à la détermination de la qualité de leur destin ? Je suis effaré par cette possibilité qui existe dans l'esprit de gens de qualité comme toi, de voir se désagréger tout ce que le modèle athénien a pu produire de positif et de réjouissant dans notre histoire.
Si tu as le courage de lire les quelques centaines de pages de ma chronique, tu pourras constater que d'une certaine manière je suis encore plus libéral que toi. Il y a longtemps que j'ai compris le piège dans lequel se sont enfermés les socialistes en tirant brutalement un trait sur le concept de lutte de classe, avant d'avoir compris ce qu'il fallait mettre à sa place. Le problème provient d'une erreur de logique, une confusion entre le domaine principiel et la réalité présente. Le concept de lutte de classe était un principe, et non pas une réalité, mais le monde auquel s'appliquait ce principe n'a pas disparu parce que le principe se voyait abrogé du jour au lendemain par un décret présidentiel. Au moment où le camp dit des travailleurs arrivait enfin au pouvoir, il pouvait bien prendre la décision de déclarer une paix dont la droite se fichait totalement, mais il fallait encore, dès ce moment-là, transformer le monde en fonction de cette déclaration de paix unilatérale. François Mitterrand a été assez cohérent d'une certaine manière, en matérialisant son décret par une libéralisation sans précédent des médias, par exemple, en même temps qu'il ouvrait la voie à une amélioration également sans précédant de la condition des travailleurs. Or il aurait fallu, dès ce moment, aller plus vite et plus fort dans le sens de la libéralisation de la condition des travailleurs, car il fallait anticiper immédiatement les immenses profits et avantages que le capitalisme saurait tirer de la nouvelle situation, bénéfices pratiques qui auront tôt fait de liquider tout ce qui avait été fait en faveur de la " France d'en-bas ". Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le capitalisme a pratiquement mis la main sur tout l'appareil d'information et de communication, ce qui lui permet de manipuler à sa guise l'opinion publique, et donc de se faire rendre le pouvoir au centuple. Un Chirac élu à 82 % et un Sarkozy qui transforme la France en cauchemar orwellien.
Tout n'est cependant pas perdu. Car Mitterrand a aussi joué la carte européenne, quitte à amplifier encore davantage les effets de son décret de libéralisation. Il n'ignorait certainement pas que Bruxelles allait devenir le cheval de Troie du capitalisme international, c'est à dire de Wall-Street. Si on se souvient bien, l'affaire était loin d'être dans le sac et l'Europe est resté un doux rêve jusqu'à ce qu'un jour les peuples de ce continent se réveillent avec l'Euro dans leurs poches. Kohl et Mitterrand avaient gagné, et l'Europe était devenu autre chose que la créature postiche de la diplomatie américaine anti-communiste d'après-guerre. Le premier symptôme de la réalité de son existence politique, car celle-ci a du mal a trouver quelque part où s'illustrer, fut l'échec de l'AMI, vous vous souvenez ? L'AMI était un projet de l'OCDE, organisme qui était la forme primitive de l'OMC, et ce projet prévoyait sans pudeur de soumettre les lois nationales aux intérêts du commerce. Si l'AMI était passé, les capitalistes auraient gagné un temps précieux pour mettre en place une réalité sur laquelle il aurait été impossible de revenir. Cette erreur due à l'arrogance d'une classe de décideurs qui voyait même les socialistes prêts à servir leurs intérêts, ne se reproduira plus dans cette forme caricaturale. En revanche, les bureaux de Monsieur Pascal Lamy, dernier dinosaure d'une idéologie ultra-libérale européenne, tournent à plein rendement pour tisser le piège fatal qui soumettrait l'Europe aux décisions de l'OMC. La libéralisation des Services, le gros morceau qui se joue en ce moment, n'est rien d'autre qu'un AMI maquillé aux couleurs d'une mondialité aussi américaine que celle du Fonds Monétaire International ou de la Banque Mondiale. L'ONU est en somme la clef symbolique de toutes ces institutions qui prétendent inscrire le droit et la justice dans les relations internationales, et créer un monde pacifique dans lequel la seule guerre autorisée porterait le nom de concurrence économique.
Ce qui se passe donc à New-York en ce moment est crucial, et les conséquences qui se profilent à l'horizon pourraient bien donner, une fois de plus, raison à notre ancien Président socialiste. Pourquoi ? Tout simplement parce que si l'ONU perd sa crédibilité politique, si cette création américaine (ne l'oublions jamais) devait en définitive s'avérer incapable de maintenir la paix dans le monde, ce qui est sa mission principale, alors toutes les autres dépendances institutionnelles, dont l'OMC, perdraient du même coup leur capacité d'action et, pour la plupart d'entre-elles, de nuisance. L'Europe s'est réveillé il y a quelques jours en s'opposant avec force à une guerre qui n'aurait pas reçu l'onction onusienne. Quels que soient les raisons concrètes et secrètes de l'attitude française et allemande dans cette affaire, cette politique qui ne fait que reprendre celle de François Mitterrand lors de la première guerre du Golfe, va avoir des conséquences sur l'ensemble du fonctionnement de l'Europe et de sa bureaucratie bruxelloise. Je ne peux pas m'empêcher de ricaner en pensant que cette guerre que s'apprête à lancer les " super démocrates " américains va leur coûter une fortune, cependant que nous ne dépenserons pas un fifrelin pour aller déloger Saddam Hussein de son palais de Bagdad. Les bourses d'ailleurs ne s'y trompent pas, elles ne se trompent jamais. En résumé, car il faut que je me dépêche, je dirai que les Européens ont toutes les raisons de se frotter les mains de ce qui se passe en ce moment, car cette idiotie de guerre, ce passage à l'acte d'un névropathe fanatisé par les idées farfelues de sa secte, va changer beaucoup de choses dans la gestion de la future Europe. Tous les réflexes acquis dans l'ambiance américano-libérale des bureaux de Bruxelles vont se briser contre les nouvelles réalités nées de cette guerre. Je pense d'ailleurs qu'on n'ignore pas tout cela à la Maison-Blanche, d'où les hésitations ultimes et les tractations intenses qui visent toutes à ramener les Européens dans le bercail d'une ONU dominée par les USA. Il faut sauver le soldat Lamy.
Samedi 15 mars 2003
Je savais que j'étais un prophète, mais pas à ce point là, mon cher Slama. J'ouvre mon poste ce matin, comme tous les samedis je m'apprête à me taper les jérémiades écolos en attendant celles des spiritueux qui offrent tous les samedis à boire et à manger, même si ça aussi ça commence à sérieusement déconner. Et qu'entends-je ? L'interview d'un certain Monsieur Marc Laimé (orthographe non garantie) sur le problème de l'eau en France. Je ne vais pas te répéter ce que j'ai entendu, tu peux aller réécouter l'émission sur Internet, ça vaut le détour. Seulement deux remarques en passant : une : écoute bien les détails de l'analyse des contrats léonins et proprement illégaux que les CGE et autres ont fait signer par les Communes pour s'emparer, non pas de la gestion de l'eau, mais du fric des contribuables. Deux : un chiffre : dans les cinq ans à venir, il faut trouver 500 Milliards de francs pour faire face à la dépollution des nappes phréatiques. Et puis, allez, encore un dernier chiffre : 6 à 8 millions de personnes vont se voir à moyen terme interdits d'eau potable. Bon, ça te suffit ? Non, messieurs de la Droite française, vous êtes fatigués et les magouilles de vos commensaux, des magouilles qui remontent à des décennies, montent chaque jour un peu plus clairement à la surface de la réalité. Des magouilles qui remontent, comme tu le sais, aux décrets du Maréchal qui a posé une fois pour toutes en 1941 que le service publique devait s'autofinancer, autrement dit, se dégager du budget de l'état et des collectivités publiques. Qu'allez-vous faire ? Bon courage.
Du coup, ma chronique va s'arrêter là, car je me sens incapable d'entreprendre une autre réflexion, tant je suis indigné, j'étouffe d'indignation. Alors même que je connais ce dossier depuis des années. Tu te souviens de l'affaire Carignon ? Il a été l'un des grands Maires de ce pays à vendre la bourse de ses concitoyens aux grandes compagnies. Hé bien figures-toi qu'à l'époque j'étais journaliste à France 3 et que mes chefs hiérarchiques m'ont purement et simplement interdit de mener une enquête nationale sur ce sujet. C'est ça la télévision française. Et pour cause. Et toi tu pérores tous les matins sur une antenne qui se veut encore au moins honnête sinon téméraire ? Comment tu fais pour dormir ? Quelles invraisemblables et tortueuses théories du libéralisme peuvent sauver ton honneur de journaliste, ce petit soldat du nouveau clergé mondial ? Quand j'étais encore du métier, je disais à l'encan et pour paraphraser une menace célèbre : on pendra les derniers fonctionnaires européens avec les tripes des derniers journalistes, sous-entendu tous ceux qui auront collaboré jusqu'au bout avec les mercenaires du libéralisme américain.
Non , ma chronique va continuer, et sur le même ton : je suis un prophète ! Hi Hi. Et en plus c'est vrai. Je viens de lire sur Internet, l'éditorial du Financial Times, ma lecture préférée. Hé bien voilà des journalistes qui réfléchissent vite et bien. Il sont pratiquement repris mot pour mot mon avertissement d'hier sur l'influence d'une désagrégation de l'ONU sur les autres institutions internationales, citant en premier lieu l'OMC, comme moi, mais sans ignorer toutes les autres, FMI, Banque Mondiale etc… C'est pourquoi demain vont se rencontrer aux Açores les trois vilains méchants, Bush, Blair et Aznar pour tenter de trouver une solution qui éviterait le pire, à savoir une cassure à l'intérieur du Conseil de Sécurité, cassure qui mettrait un sérieux coup dans l'aile à l'ONU elle-même. Bush annonce qu'il va accélérer le règlement du contentieux israélo-palestinien (comme si tout dépendait tout d'un coup de sa bonne volonté à lui), histoire de calmer le jeu à Londres où Blair est en train de sombrer corps et biens. Donc ces messieurs se rendent bien compte qu'on ne peut pas jouer au cow-boys comme on veut. Reste à savoir qui va l'emporter et surtout si Bush peut se permettre de se déjuger vis à vis de son peuple qu'il a chauffé à blanc et qui est persuadé que les avions vont décoller dans les heures qui viennent. Bravo donc pour bibi. Mais je vais aller encore plus loin. Je suis un adepte de la lecture symbolique des événements, ceux qui me lisent ont dû s'en rendre compte depuis longtemps. Or, figurez-vous que c'est aux Açores que la dernière " Troisième Guerre Mondiale " a été évitée, et ce en 1974, je crois, quelques mois en tous cas avant la mort du Président Pompidou qui s'était rendu là-bas pour dissuader Nixon de donner son feu vert à Moscou pour attaquer la Chine. Yang Zemin, à cette époque Ministre des affaires étrangères, venait de faire le tour de toute l'Europe pour appeler au secours, car en termes stratégique il était évident que l'URSS pouvait s'emparer de la Chine en quarante-huit heures. Cette fois, Pompidou a réussi à dissuader le Président américain de faire cette connerie qui aurait forcément abouti à une guerre mondiale. Depuis quelque semaines je me tue à affirmer que la guerre contre l'Irak, quelles que soient les conditions, les résultats et même si l'ONU donnait son accord, ne pourrait que nous mener vers cette troisième guerre mondiale. Il ne nous reste donc qu'à espérer que le climat des Açores, toujours très venteux quelle que soit la saison, leur fasse passer à tous les trois l'envie d'aller faire les cons dans les sables du plus vieux pays du monde.
Hé oui, personne n'en parle, comme si l'Irak était n'importe quel morceau d'espace quasi vide, une sorte de province australienne, alors qu'il est le vrai berceau de la civilisation sédentaire, un lieu sacré pour les archéologues, les historiens et les quelques êtres humains qui pensent vraiment. Babylone, Babel, Bagdad, des noms qui font frémir les amoureux de l'aventure humaine et aussi de la pensée, quand on sait que la capitale irakienne a été le lieu où se sont conservé des textes qui sont les piliers de notre propre culture. Sans Bagdad, pas d'Aristote. Oh je me doute que ça ne met pas grand monde en transes, mais si tout le monde savait ce que cela aurait changé dans notre histoire, alors on y regarderait à deux fois. Alors un mot encore sur Saddam Hussein, ce curieux affreux si coupable qu'il viendrait tout juste derrière Hitler et Staline. Non mais, il faut se calmer. Tant qu'à raisonner en terme de Realpolitik, comme personne ne se gêne pour le faire, alors disons calmement que Saddam a pu avoir été le plus grand salaud que la terre ait porté, encore que j'en doute fortement, rien ne dit qu'il ne soit pas capable de s'amender. Seule la presse internationale aux ordres le présente comme un incorrigible tyran sanguinaire d'un pays où le moindre gamin fait dans sa culotte en entendant son nom. On se fout de nous, c'est clair. Dans l'histoire récente il y a eu des tyrans d'un calibre encore bien plus dégoûtant que Saddam, il suffit de songer à ces dirigeants Hutus qui ont télécommandé le génocide le plus féroce depuis la Shoah, ou encore à un type comme Mobutu, qui faisait dépiauter ses adversaires politiques sur la table avant d'en servir les morceaux à ses invités. Ce même Mobutu entièrement fabriqué et tenu à bout de bras par
Washington au nom de ses seuls intérêts économiques. Mais merde alors, de quoi est faite la conscience de ces pentagoniens qui veulent diriger le monde ? Se sont-ils remué le cul, pardonnez-moi la colère qui me rend grossier, pour arrêter le génocide soudanais ? Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait, sinon parce qu'à l'époque ils étaient en train de fabriquer leur ami Ben Laden qui était l'ami des islamistes de Khartoum ! A cette époque, on pouvait bien massacrer et mettre en esclavage des centaines de milliers de Chrétiens et d'Animistes, ça ne faisait ni chaud ni froid aux locataires de la Maison Blanche.
Rien, non absolument rien ne justifie cette folie soudaine qui s'est emparé de ce Deubeliou dont la mine pateline commence à faire frémir. Il ne fait pas encore peur parce qu'il n'est encore que ridicule, mais si personne ne l'arrête les choses vont changer, croyez-moi. Avec ou sans moustache, le simple aperçu de son portrait va finir un jour par faire froid dans le dos de n'importe qui. Enfin, merci aux intellos du Financial Times, ils me confortent dans ma situation de commentateur pour oiseaux. Comme personne ou presque ne me lit, je peux toujours penser que les oiseaux m'écoutent à travers les vibrations des fils téléphoniques sur lesquelles ils aiment tant à se reposer. Et puis je suis sûr qu'au moins eux me comprennent sans difficulté. Slama
Dimanche 15 mars 2003
La vertu industrielle. On y reviendra, car il est intéressant de se demander si les ONG qui tentent de vendre la vertu aux grandes entreprises sont dans le vent de l'histoire ou bien si elles se font mener en bateau.
Aujourd'hui je trouve qu'il y a urgence à traiter un autre sujet : que faire si la guerre éclate ? Que faire pour rester logique avec la décision que nous semblons avoir prise de ne pas y participer. Hé bien il me semble qu'il y a un domaine où nous pouvons faire quelque chose de très positif et de très important : le domaine de l'information. Que va-t-il en effet se passer dès que les chars d'assaut vont se ruer dans les sables irakiens ? Nous en avons une grande expérience du point de vue de l'information. Nous savons que l'armée américaine va monopoliser du début à la fin toute la couverture journalistique de la guerre. Comme en 1990, les journalistes du monde entier vont devoir utiliser ce que les services de propagande US vont leur servir tous les matins dans leurs conférences de presse, ainsi que les images filmées par les caméras des avions américains ou des services d'information des GI's. Les résultats nous les connaissons d'avance, des images de nuit intraduisibles et des images de jour soigneusement triées pour donner une image propre de leur guerre " chirurgicale ".
Par conséquent, je propose à tous les journalistes du monde entier, à commencer par les européens, de faire une grève de la couverture de la guerre, tout simplement. Bien sûr il faudra au préalable s'assurer que l'armée américaine est bien décidée à se comporter comme elle l'a fait il y a douze ans, et puis ensuite décider selon ce qu'on va constater, de couvrir le processus de la guerre ou de l'ignorer. Les télévisions pourront toujours se servir des quelques images des EVN, cette agence d'échange entre Chaînes qui se trouve à Genève, pour faire des commentaires à minima de ce qui va se passer à Bagdag et autour. Des commentaires sobres et qui ne vont pas envahir tous nos journaux télévisés comme ce fut le cas pendant la première guerre. Je rappelle d'ailleurs que la première guerre du Golfe a financièrement ruiné nos chaînes de télévision, malgré les " fournitures " américaines. Si l'Europe décide de rester à l'écart de ces combats, il n'y aucune raison à ce que nous allions dépenser des millions d'Euro pour filmer ce que les officiers yankees vont nous permettre de filmer ou leurs propres images. La philosophie générale de ce que j'écris ici est de ne pas se laisser imposer cette réalité d'une guerre que nous réprouvons comme la colonne vertébrale de l'actualité et d'imposer à des milliers de téléspectateurs européens, africains ou asiatiques des récits bidons et des images mensongères à seule fin d'occuper tout le terrain du souci humain.
Il faut montrer aux Américains que nous nous moquons de leur guerre et que nous n'allons pas en faire notre spectacle quotidien ni le centre de nos soucis, même s'il est évident que les conséquences seront lourdes quoique longues à se manifester. Imaginons que la guerre commence demain matin à 5 heures, il est prévisible qu'en quelques jours nous assistions à l'écroulement du régime de Saddam Hussein et à la mise en chantier du plan qui a déjà servi en Afghanistan avec le succès douteux que l'on sait. Car une chose est de conquérir un espace aussi vaste que l'Irak, une autre est de recréer un autre état réel, une situation stable, mais aussi et surtout de faire face aux conséquences extérieures à l'Irak, à la réaction en chaîne qu'un triomphe prévu comme facile ne manquera pas de provoquer. Certains commentateurs pensent déjà que l'Iran et la Corée du Nord vont très vite figurer dans les cartons du Pentagone. La décision de Chirac et de Schroeder ( et de tous ceux que je ne peux pas citer ici) est donc d'autant plus importante qu'il faudra tenir ferme par rapport à toutes les ambitions futures des USA, quels que soient les résultats de leur promenade irakienne. Alors confrères, soyez lucides et courageux pour une fois, et refusez de vous plier au chantage de la censure américaine. Le meilleur moyen de le faire sera de rester chez vous, la caméra au pied. Au demeurant je ne pense pas que vous serez les bienvenus dans les zones sensibles. C'est donc aussi vos vies qui sont en jeu. Pas d'Euros pour la guerre, pas d'Européens pour la mort.
Lundi 18 mars 2003
Voilà. Tout est dit. Les poules diplomatiques vont cesser de caqueter dans la basse-cour de l'histoire présente et les doigts de centaines de milliers d'êtres humains vont se crisper, oh paradoxe infernal, sur la détente de leurs armes. Oui, pour libérer la balle ou le missile, on n'appuie pas sur une gâchette, mais sur une détente. Le fait que cette erreur de langage soit entrée dans l'usage n'est sans doute pas innocente, car comment faire avaler cette contradiction dans les termes, d'un geste de détente qui provoque la mort ? La détente a toujours été, dans la terminologie politique ou guerrière, le moment où la tension cesse, où s'installe une sorte de calme qui précède la paix elle-même. Si donc l'on veut désigner le moment où l'on déclenche l'apocalypse, il vaut mieux utiliser le mot gâchette, car elle, la gâchette, elle gâche, ça c'est certain. Mais bien évidemment, le technicien ne s'y trompe pas, lui, car la détente dont il est question, ce petit crochet sur lequel s'exerce la pression du doigt de celui qui tue, détend bel et bien quelque chose, elle détend le ressort dont l'extrémité va aller frapper le détonateur de la cartouche. La détente porte l'instrument de mort à son extrême tension. Comme il est facile de montrer comment le langage se ment à lui-même et comment la réalité dure, celle qui frappe et accomplit le destin, demeure indifférente à la forme des signifiants dont elle se sert. Savez-vous comment s'appelle la partie la plus délicate du canon d'un fusil ? Elle s'appelle l'âme, exactement comme l'âme d'un violon ou d'un violoncelle. Quelle poésie !
Ces détentes et ses âmes vont donc parler, là-bas, dans les sables du plus ancien espace de notre civilisation et leurs paroles vont atteindre des objectifs, concasser du réel, réduire à néant le fruit de la sueur de milliers d'autres êtres humains, transformer des milliers de vies en destins dont les corps ne seront même pas assurés de trouver un lieu décent pour leur dernier sommeil. La faucheuse va passer, un faucheuse planifiée, programmée, inscrite dans des logiciels aussi indifférents aux conséquences de ce pour quoi ils ont été conçus et fabriqués que la pierre de ce désert qui a peut-être vu passer les troupes d'Alexandre Le Grand il y a deux mille trois cents ans. L'orage humain va passer, laissant derrière lui des ruines et de la désolation. Et puis les survivants ressortiront de leurs abris, ramasseront ce qui reste d'utilisable pour recommencer à subsister. Le silence retombera sur cet incident météorologique sanglant, et les poules se remettront à caqueter dans les chancelleries jusqu'à la prochaine tempête.
Cette poésie va vous paraître étrange, au moment où semble arrivé le temps de s'engager, de vociférer son indignation, de faire trembler les prétoires de l'histoire et de se préparer soi-même à entrer dans les remous inévitables de cet ouragan. Certes, elle est étrange. Mais aujourd'hui j'ai besoin, dans ma tristesse, de me débarrasser des concepts, de vider mon âme à moi de ces âmes et de ses détentes qui fracassent au lieu de répandre la paix. Car les mots sont tous coupables, les concepts, comme vous venez de le voir, sont tous à double détente, si je peux encore faire ce jeu là. Aujourd'hui, vous le sentez comme moi, s'installe un grand silence, le silence de l'attente. C'est un temps bien choisi pour méditer car ce silence est l'ultime coquetterie de la mort. Pas la nôtre ? Peut-pas, sans doute pas, mais où est la différence ? Nous nous taisons dans l'attente de la venue de la mort, une venue décidée par des hommes comme nous, qui mourrons comme ceux qu'ils vont faire mourir, qui mourrons comme nous aussi allons mourir.
Alors, à cet instant que je prélève en quelque sorte sur le temps que j'utilise habituellement pour analyser, prévoir, prévenir, calculer, protester, mobiliser et me ruer vers le cœur du fonctionnement de ces malheurs climatiques, je pense au vent. Le vent souffle sur les choses, il fait pencher des immenses champs de roseaux en balayant les miasmes qui s'en échappent, et lui aussi s'indiffère. Je pense à un vent qui balayerait les mots, qui rendrait à mon âme à moi sa liberté sémantique, la détachant de toute confusion possible avec une pièce d'artillerie. Car voyez-vous, en un sens, Maître Eckart avait raison, ce qu'il y a dans l'âme et le mot lui-même qui la désigne, tout cela est contaminé par une polysémie qui permet au mensonge de cohabiter dans le langage avec la vérité. C'est pourquoi aussi je voudrais que ce que j'ai écrit ici, aujourd'hui, demeure silencieux. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas l'entendre, car ces mots sont seulement vrais et ils ne s'adressent qu'à moi, ils ne s'adressent qu'à ce qui de l'Être, peut m'entendre. Une prière ? Oui, mais la plus difficile, la prière sans dieu.
Vendredi 21 mars 2003
Les Anglo-Américains ont décidé de " décapiter " l'Irak, c'est leur propre expression. Quelles que soient les conséquences de cette exécution capitale, on peut penser que l'armada qui encercle le pays de Saddam Hussein parviendra à son but. Comme le disent désormais beaucoup de commentateurs, depuis que Baudrillard l'a annoncé, cette guerre est déjà terminée. Ce à quoi il faut donc penser désormais, c'est à la greffe qui rendra à ce pays martyr l'intégrité de son corps.
Avant de développer cet aspect fatal de l'avenir de cette région du monde, je voudrais vous faire partager les sentiments et les pensées qui me traversent à l'écoute et au vu de ce qui semble se passer là-bas du sud au nord et de l'est à l'ouest irakien. La principale question qui me taraude depuis le début de la guerre c'est celle de savoir ce qu'il en est de l'armée de Saddam Hussein. Où est-elle ? Que fait-elle ? Que prépare l'état-major irakien face à ce rouleau compresseur qui s'avance maintenant dans les sables ? J'entends partout cette étonnante affirmation selon laquelle l'anéantissement du président irakien et de son entourage mettrait ipso facto fin au conflit. Que signifie cette idiotie évidente ? Cela veut-il affirmer que l'Irak est gouverné par une dizaine de délinquants qui représentent à eux-seuls toute la force de la tyrannie irakienne ? Que les quelques centaines de milliers de soldats irakiens qui attendent quelque part l'ennemi n'attendent qu'une seule chose, la mort de leur leader, pour se rendre aux envahisseurs ? Mais expliquez-moi comment une poignée de dignitaires, les plus mafieux que l'on puisse imaginer, peuvent s'imposer pendant des dizaines d'années à des millions d'hommes et de femmes ? Quelles que soient les lacunes de ma culture politique, j'ai quand-même vécu du vivant d'Hitler et de Staline. J'ai vu des peuples soutenir par centaines de millions des régimes devenus entre-temps des modèles de cauchemars historiques. La mort de Staline n'a en rien mis fin au régime stalinien lui-même, quant à Hitler, il ne s'est suicidé qu'après la destruction quasi totale de son pays, défendu par le peuple allemand pratiquement jusqu'à la dernière goutte de son sang. Alors de quoi nous parle-t-on ? En raisonnant le plus cyniquement possible, il faut au moins reconnaître que la tyrannie se construit sur une pyramide de complicités qui descend du Palais central jusqu'à la plus infime casbah urbaine ou la plus éloignée des mechtas. Alors faut-il admettre qu'en même temps que l'ennemi approche, le sentiment de culpabilité générale, cette complicité habilement structurée par le pouvoir tyrannique, se dissout purement et simplement et que chacun peut prétendre, au simple vu d'un soldat " libérateur " qu'il n'a jamais péché, que même si tout le monde sait qu'il a dénoncé, trahit, profité des largesses du pouvoir, appliqué la sauvagerie et l'ignominie du gouvernement, que celui-là va simplement rendre son fusil en disant : " salaud de Saddam, j'ai toujours été sa victime et seulement sa victime ", parfaitement rassuré sur le fait qu'il va pouvoir continuer de vivre comme avant, continuant même de jouir de toutes ses propriétés bien ou mal acquises. Comment oublier ce mot si ambivalent et qui fait aujourd'hui encore frémir dans les campagnes françaises : le mot épuration ?
C'est ici que je reviens à cette nécessité prévisible d'une greffe de tête : il va falloir greffer une nouvelle tête sur tout un peuple, et encore, il faut tenir compte du fait que l'Irak est constitué par plusieurs peuples, pluralité qui explique, comme ce fut le cas en Yougoslavie du temps de Tito, ou encore comme c'est aujourd'hui encore le cas en Birmanie, pays tellement morcelé par la multiplicité ethnique que seul un pouvoir fort, une dictature peut maintenir un semblant d'unité. On connaît ce vieux problème de la relation mathématique qu'il y a entre l'unité culturelle d'un pays et son degré de démocratie. Alors imaginez l'Irak ! Pourquoi les Américains n'ont-ils pas fait en 1991, ce qu'ils décident tout d'un coup de faire en 2003, à savoir se débarrasser de Saddam Hussein ? Simplement parce qu'ils savaient que l'Irak serait ingouvernable, et que Saddam Hussein représenterait toujours un moindre mal. Alors pourquoi et comment a-t-on pu passer si vite d'un raisonnement à un autre ? Que va-t-on greffer à la place de la tête qu'on va couper ?
Il n'y a qu'une seule réponse à cette question : on se fiche de l'avenir de l'Irak, car on va se charger soi-même de gérer les affaires les plus importantes du pays, à savoir sa seule richesse, le pétrole. On peut prévoir avec une grande certitude que les Américains vont se servir des pires complices du régime de Saddam pour assurer cette gestion, répandre un grand pardon qui ne changera strictement rien à la situation politique interne de l'Irak. On retrouvera sur les banc du Parlement de Bagdad les mêmes députés, les mêmes " représentants ", les mêmes propriétaires de Mercedes et de BMW. On se servira des mêmes gardes du corps, si bien formés aux coups tordus par l'internationale des spécialistes des coups tordus. Bref, ce que la situation internationale du temps du père de l'actuel président américain représentait encore comme contrainte à une stabilité plus ou moins démocratique, est désormais périmé. Bush fils n'a rien à faire de ce qui attend le peuple irakien, de l'anarchie qui risque de s'installer entre Sunnites, Chiites, Kurdes, Turkmènes et aussi entre les vrais résistants à Saddam qui ont survécu aux épurations successives et les autres, tous complices, tous saddamistes, aussi saddamistes que les Français furent pétainistes il y a quelques décennies. Bush éteindra lui-même ce brasier qui se prépare, avec ou sans l'appui de l'ONU, selon qu'il se trouvera quelqu'un d'assez habile et intelligent pour réparer la casse.
Ce matin les analyses que j'entends se succéder sur les ondes se ramènent toutes à une hypothèse qui me paraît, excusez-moi si je me trompe, parfaitement stupide. La thèse est celle de la stratégie dite " horizontale ", c'est à dire ce qu'en d'autres temps et en d'autres lieux on nommait " Opération Jumelles " ou " Opération Pierres Précieuses ", la stratégie qui a permis à l'armée française de rendre le territoire hermétique aux rebelles, désormais contenus au-delà des frontières marocaines et tunisiennes jusqu'aux Accords d'Evian. Autrement dit, on pense que le général Francks va avancer dans les sables irakiens en stérilisant le pays au fur et à mesure et en ralliant les populations, notamment par le pardon dont je parle plus haut. A Bagdad pendant ce temps, on attend que Saddam se décide finalement à filer avec toute sa famille, comme on le lui propose depuis quelque semaines, mettant un point final à la guerre. Peut-être. Pourquoi pas. Pour ma part, je pense depuis le début que Saddam n'a jamais eu qu'un seul atout dans sa main, ce sont les puits de pétrole, et que toute la guerre va tourner autour du sauvetage de ces puits, toute la stratégie et toutes les négociations secrètes vont tourner autour de la préservation de ce pour quoi Bush a pris tous les risques qu'il a pris, le pétrole. Il y a longtemps que Saddam Hussein sait que la seule véritable armée dont il dispose est composée de puits de pétrole. Il est vraisemblable que la fin prématurée de la première guerre du Golfe ait été due à un chantage décisif autour des puits de pétrole. Le fils Bush a cru qu'il pourrait faire mieux que papa, il a vu ça au cinéma : Il faut sauver le soldat Pétrole.
Impossible de s'arrêter là. Il manque une perspective à tout ça. Je ne peux pas simplement diagnostiquer une certaine faiblesse mentale chez un Président que le monde entier commence à craindre, ou encore une sorte de rivalité freudienne entre le fils et le père qui finit dans un tel fracas shakespearien. Tss Tss, impossible. Admettons cependant que cette dernière hypothèse soit la bonne, le fils veut faire mieux que le Père. Figure archétypique de la tragédie qui oppose les nouveaux dieux aux anciens. Bon. Cela étant dit, on ne peut pas réduire l'ambition du fils à la volonté de finir le boulot de papa, ce n'est pas sérieux. Non, le fils veut faire mieux, beaucoup mieux, il veut réussir le projet reaganien qui était resté prudemment enfoui dans l'inconscient de son papa, c'est à dire maintenu par un Surmoi quand-même plus sérieux que celui de ce mâcheur de chewing-gum mal léché et pour tout dire à moitié débile. Il veut établir l'hégémonie américaine dans le monde. Du temps de papa, cette hégémonie existait certes déjà d'une certaine manière. Depuis Eisenhower, l'Amérique avait pris en main pratiquement tous les leviers politiques et économiques du monde. Fonds Monétaire International, Banque Mondiale, ONU, partout la voix de Washington était majoritaire seulement parce que sa contribution financière, sa cotisation, était capitale (47 % pour le FMI, ce qui lui donne le pouvoir quasi absolu de décision). Même en traînant les pieds pour payer, comme c'est le cas depuis Nixon, Washington est longtemps demeuré le Chef d'orchestre de l'ONU elle-même, mais avec le temps et quelques événements qui ont quand-même fini par crédibiliser le " machin ", l'ONU s'est dégagé de ce monopole sans qu'on s'en aperçoive, du moins depuis le point de vue étroit réservé aux opinions publiques. C'est la raison précise pour laquelle le Bush d'aujourd'hui se réjouit d'avoir réussi à ridiculiser le " machin ", à le renvoyer à la triste réputation qui était devenu la sienne au cours de la guerre froide. Je pense pouvoir affirmer que depuis le début de toute cette affaire, que l'on place au 12 Septembre 2001, mais que j'estime pour ma part pouvoir avancer de plusieurs mois, la stratégie prioritaire de Bush était de démolir l'ONU et le peu de pouvoir qu'elle avait acquis pendant la première Guerre du Golfe et dans les Balkans.
Après on verrait. Comme le raisonnement de papa en ce qui concernait l'Irak n'avait rien perdu de sa pertinence, le fils a donc commencé son règne en visant l'Asie. Comme tout apprentis Pichrocole, le nouveau président a tout de suite vu grand. Il a donc entamé une politique de harcèlement vis à vis de Pékin. Et, si un certain Ben Laden n'était pas venu commettre sur la terre même de l'Amérique, le pire de tous les crimes, on peut supposer que Bush aurait poursuivi sa stratégie anti-chinoise, stratégie qui comportait l'immédiat avantage de plaire aux Japonais qui possèdent un Himalaya de Bons du Trésor de la Fed. Mais voici que Ben Laden vient remettre sur le tapis ce qui avait déjà été le cauchemar de papa, à savoir les relations avec le monde arabe. C'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups : on finit le travail mal fait de papa en liquidant Saddam et en prenant le contrôle de son or noir, ce qui permettrait de disposer à la fois d'une base stratégique asiatique parfaite, un véritable porte-avion qui en plus produit son propre carburant, et puis on reprend le projet initial d'en finir avec tous ces " commies " coréens, chinois, cubains, devenant ainsi, enfin, la puissance mondiale à côté de laquelle l'Europe cesserait purement et simplement d'exister.
Tout cela vous paraît assez fou, n'est-ce-pas ? Savez-vous ce qui me prédispose à considérer les choses de cette manière un peu paranoïaque ? De tout petits symptômes, des petits bruits, un certain changement de ton, de style, la perception soudaine de choses inouïes comme ces Unes du Sun qui comparent Chirac à Hitler. Bref, le cynisme de ce capitalisme-là tombe le masque. C'est curieux, mais la rage anti-française est plus vulgaire et plus haineuse en Grande-Bretagne qu'en Amérique. Bien sûr, Murdoch, le grand magnat de la presse britannique n'est lui-même pas un Anglais, puisqu'il vient d'Australie (ce qui explique sans doute aussi pourquoi ce pays traditionnellement aussi pacifique que le Canada se soit finalement aligné sur Washington), mais cette résurgence de l'anti-France des britanniques me paraît le symbole le plus sûr et le plus angoissant du coup : nous sommes en train de revenir deux siècles en arrière et les anglo-saxons, piégés par des Droits de l'Homme qu'ils ont eux-mêmes rédigés, comptent bien en finir avec notre République, seul structure politique où ces Droits ont réellement cours. J'espère de tout cœur me tromper, et en tout cas je ne mêle pas le peuple britannique lui-même à toutes les manœuvres d'une toute petite partie de sa classe dirigeante, mais les prochaines rencontres de Bruxelles vont très vite montrer si le prochain soldat à sauver ne va pas s'appeler Europe.
Dimanche 23 mars 2003
Haine de Mitterrand.
Il y a quelque chose de pitoyable dans les ratés de l'histoire qui se succèdent depuis quelques semaines. Un mélange d'imbécillité et de haine envers l'œuvre et l'esprit d' un homme qui dort de son dernier sommeil après avoir mis un dernier point à son ultime devoir comme l'élève-homme droit et intelligent qu'il était. Qu'on le veuille ou non, c'est François Mitterrand qui avait réussi l'exploit de donner à l'ONU une sorte de baptême du feu, de lui ouvrir les portes de la réalité politique universelle. Calmement, avec la tranquillité d'esprit et l'intelligence qui ont réellement constitué le fond de son caractère, il avait fait plier les plus grands. N'attendez pas de moi de profiter de l'occasion pour médire de son successeur, je n'irai pas plus loin que de constater que Jacques Chirac a échoué là où le président socialiste a démontré son habileté et la fermeté de son caractère. Si l'expression " nouvel ordre mondial " a pu avoir, un moment, son heure de gloire, c'est à lui que le monde le doit, exactement comme on doit à De Gaulle d'exister encore comme Français et à Georges Pompidou d'avoir évité une guerre mondiale prématurée, une guerre qui pourrait bien avoir désormais commencé. Je n'ai rien d'un patriote, tous ceux qui me connaissent ou me lisent en sont convaincus, mais les derniers événements me plongent dans une perplexité sincère, un étonnement qui surgit comme l'amour, l'amour et l'admiration pour mon pays. Une culture historique se construit par coagulations successives de réalités dispersées qui finissent par faire un panorama, un tableau. Un tableau qu'on aime, qu'on déteste ou qui vous laisse indifférent. Pour la première fois de ma vie, j'aime mon pays, je laisse au bord du chemin mes hardes d'apatride dont la vie m'avait chargé et je me naturalise Français.
C'est lyrique, et je déteste le lyrisme. Je ne remonterai donc pas jusqu'à Vercingétorix pour faire l'Opéra de cette sorte de revirement, de profession de foi d' une appartenance pour laquelle je n'ai eu, jusqu'ici que du mépris. Je me contenterai de faire la comptabilité des " dommages essentiels " qui sont en train de détruire ce qu'un Français avait habilement réussi à bricoler pour cette planète chaotique. Je ne me moque pas, cela disant, des événements concrets qui se déroulent à raz de terre, là-bas en Irak, et je vis en moi les angoisses d'un peuple lâchement agressé, et aussi celles de ces jeunes soldats yankees ou britanniques dont les dents crissent de sable et de peur. Quel gâchis !
Le premier et le plus grand dégât essentiel, en réalité l'objectif premier des puissances coalisées qui ont déclenché cette guerre, c'est évidemment le renvoi de l'ONU dans sa cour de récréation, dans son inanité de " machin " comme se plaisait à le qualifier notre grand Général. Il était logique et fatal que Londres soutienne le point de vue américain envers et contre tout, tant les Anglo-Saxons nourrissent de haine envers le Droit républicain et toute institution qui pourrait en étendre l'application à la dimension du monde. En fait tout Ordre de quelque nature qu'il soit, toute légalité inscrite dans une Constitution et dans une Loi. C'est la lubricité parfaitement amorale du capitalisme qui ne tolère aucune digue, aucun frein à cette propriété privée de l'existence qui porte le nom d'hégémonie.
Soyons-y attentifs, dans la réalité qui nous entoure, où que nous soyons, quoi que nous fassions, cette volonté hégémonique agit, se manifeste. Comme des échos à peine affaiblis, les commentaires de nos médias, pratiquement tous asservis à ce capitalisme sauvage, prennent le parti de cette transgression dont presque plus personne ne parle. Télévisions, radios, journaux, les titres apparemment hostiles à cette aventure sanglante cachent mal une complicité foncière. Hier encore, j'ai pu voir comment TF1 a manipulé les images de l'immense manifestation qui a rassemblé des centaines de milliers de new-yorkais à Manhattan, là même où les " forces du mal " avaient fait le plus de victimes. Ces centaines de milliers d'Américains totalement hostiles à la décision de leur président ont été réduits à quatre plans de rue pendant que la speakerine n'arrêtait pas de répéter que la majorité du peuple américain soutenait le Président Bush. A l'heure où j'écris, il est cinq heure du matin, j'entends le même refrain sur France-Info : les sondages indiquent que les Américains soutiennent massivement cette guerre. Dans les commentaires de plateau, on ne parle même plus de ce qui s'est passé à l'ONU, on a déjà intégré la stratégie du Pentagone : l'ONU servira de voiture-balai et se chargera, demain, de gérer la charité internationale. Seule l'opinion publique s'acharne à rappeler à chaque occasion que cette guerre est illégale, est une transgression insolente des fonctions et du pouvoir du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Jacques Chirac et Gehrard Schroeder auraient-ils pu réitérer l'exploit de Mitterrand s'ils avaient été plus courageux ou plus habiles ? Difficile de répondre à cette question car le deuxième dommage essentiel et qui n'a rien de collatéral c'est bien la scission de l'Europe en deux camps. Paradoxalement ou dialectiquement comme on voudra, cette scission contient en germe l'épanouissement de l'Europe. A l'heure qu'il est des millions d'Espagnols défilent dans les rues de Madrid, de Barcelone ou de Cordoue, mouvant résultat des futurs élections qui attendent ce pays, résultat dont Tony Blair sera également la victime. Etrange sacrifice que font ces deux hommes. On dit qu'ils font un pari, mais quel pari ? Que peut-on parier sur un conflit déjà terminé, dont le monde entier connaît déjà l'issue et que le monde entier condamnera après comme avant. Question en passant : que va nous dire Georges Bush lorsqu'il sera devenu évident qu'il n'existe pas l'ombre d'une arme de destruction massive dans le pays qu'il a fait ravager ? La CIA et le NSA auront-ils le temps et la latitude d'en importer et de les placer de manière à convaincre le monde de la justesse de cette croisade ? En tout cas, si Saddam Hussein disposait de telles armes, on ne comprend pas pourquoi il n'en a pas déjà fait usage. Bizarre aussi : personne ne parle plus de ces fameuses armes, aucun speaker, aucun commentateur ne pose plus cette question : mais où sont donc ces armes de destruction massives ? Où se trouve le casus belli ?
Le dernier dommage, et qui n'a rien de collatéral, c'est ce retour vers le mépris des pertes humaines. La philosophie du " zéro morts " avait été le progrès le plus important du dernier siècle car elle impliquait le respect réel pour la vie, la prise en compte de la plus humble existence, du plus modeste désir de vivre. Bravo, Monsieur Bush, mais je ne crois pas que votre peuple partage votre arrogance, et il vous le fera savoir.
Jeudi 27 mars 2003
C'est étrange, mais j'écoute et j'écoute encore tous les commentaires, toutes les informations, toutes les analyses de ce qui se passe là-bas dans les sables de Mésopotamie, et je n'entends rien. Je n'entends rien qui me concerne, moi, citoyen lambda d'un pays européen moyen, moi, membre de ce qu'on appelle l'humanité, homme quoi, cet être qu'on a littéralement disséqué sur tous les plans, physiques, psychologiques, ontologiques et surtout moraux. Cet être, qui est devenu le MOI à travers quelques millénaires de vicissitudes et de souffrances sans nom, cet être n'intéresse personne. Personne ne parle de MOI.
Vous avez compris que je ne parlais pas de moi, l'auteur de ces textes qu'au moins une personne semble lire fidèlement chaque jour. De qui alors est-il aujourd'hui question dans ce MOI majuscule ? C'est pourtant simple : je parle de chaque individu. Je parle du " chacun " que l'on peut voir dans ces images de foules, de groupes, de chacun de ces hommes représentés sur les écrans, entendus dans les radios, imaginés même dans leurs situation quelle qu'elle soit. Hier vous l'avez vu comme moi, cette file de camions militaires américains fonçant sur une route bordée de cadavres, gisant dans l'indifférence la plus complète de l'image elle-même et du commentaire. C'est tout juste si le journaliste attire l'attention du spectateur sur ces corps, étendus dans cette position " dégonflée " du mort, étalé comme de la matière molle sans identité, seulement revêtue de quelques hardes brunâtres. Déjà oublié, à peine entré dans les données qu'un secrétaire quelconque a noté au passage parce que c'est son boulot.
Mais il y a des millions de MOI vivants. Aujourd'hui, maintenant, dans l'instant où j'écris. Chaque Irakien en est un, avec un monde autour de lui, une vie en perspective, une place dans une famille humaine, une famille restreinte mais aussi une famille élargie, au quartier, à sa ville, à cet au-delà de chaque ville qui s'appelle pays. Mais surtout avec son destin. A regarder la télévision, on a l'impression que tous ces personnages, que ce soient les soldats américains et anglais ou que ce soient ces fantômes d'humains qui sont déjà morts dans les planifications militaires des envahisseurs, que tous ces MOI n'existent pas, ne possèdent pas de destin personnels. Ils apparaissent sur l'image comme des poupées signifiantes de tout ce qu'on veut sauf de la conscience qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir de leur propre destin. Je pense à ce GI vu de dos, en train de nettoyer son fusil-mitrailleur et je ne peux pas me convaincre qu'il ne pense pas, qu'il dort debout, engagé dans sa " mission ", automate fatigué mais qui fonctionne selon les calculs de son état-major. Hé Bill, réveille-toi ! Demain tu pourrais mourir, frappé comme les autres, comme tes adversaires, dont tu te demandes sans doute encore pourquoi ils sont des hommes que tu dois, toi, tuer, rendre mort, exclure de la vie. Est-ce-que tu penses qu'un de ces jours tu pourrais suivre le destin de ce camarade dont tu as vu hier le visage disparaître sous la fermeture-éclair de son ultime sac de plastique noir ? Non ?
Qui sait ? Vous l'aurez compris, je tente de décrire une réalité que personne ne peut montrer avec des images ou des sons, je veux parler des enjeux en termes de destin qui motivent tous ces hommes, car ils sont tous des hommes, placés là par le hasard de l'histoire dans une confrontation qui n'était pas inscrite dans leur état-civil, ni dans l'avenir pour lequel chacun a fréquenté l'école, l'usine, l'université, fondé une famille, construit une maison ou loué un espace de vie.
Hier donc, j'ai écouté le Ministre irakien de l'Information déclarer presque dans un éclat de rire que les Américains affirment le plus gravement du monde qu'ils sont " agressés " dans leur progression sur Bagdad ! Avouez qu'il y a de quoi rire, ou plutôt de pleurer devant de tels lapsus, car de pareilles conneries, pardonnez le mot, ne peuvent pas se réclamer d'un autre statut, ou alors les Américains (de l'Etat-Major, bien entendu) sont devenus réellement fous. Je signale cette anecdote pour bien montrer de quoi il s'agit. L'armée la plus puissante jamais alignée dans l'histoire du monde se déclare agressée par quelques " salauds " déguisés en bédouins. Je rêve. Je rêve et en même temps j'essaye de m'infiltrer dans les peaux de tous ces hommes qui vivent ce cauchemar chaque minute depuis maintenant une semaine. Comprendre n'est pas vraiment mon but, car on ne peut pas comprendre ces moments de l'histoire où des hommes groupés en armées s'affrontent dans une sorte de suspension du temps individuel où chaque seconde peut prendre l'envergure du destin. Non, je veux seulement peindre les choses telles que je peux les percevoir d'ici, de mon propre destin apparemment sans dangers, calme, quotidien quoi, où les grands événements ne vont pas chercher plus loin qu'un voyage à Strasbourg qui m'oblige à interrompre le rite de tous les jours, où encore une assiette qui se casse parce que je deviens de plus en plus maladroit avec l'âge.
Et que puis-je alors distinguer ? Oui, je sais, l'Irak est une sorte de verrue historique, balafrée depuis deux siècles par le n'importe quoi des conséquences de notre histoire à nous, l'occidentale, l'européenne. C'est surtout aussi une immense réserve de cet or noir qui suinte de partout et qui, transformé en goudron, servait déjà à sceller les briques bleues de Babylone. J'imagine ces centaines de générations de bédouins qui ont vécu des vies entières à proximité de ces geysers de pétrole en s'en fichant éperdument et en en tirant tout juste l'utilité que ce produit pouvait avoir et en luttant contre ses inconvénients qui n'étaient pas négligeables. Et puis d'un coup, ILS viennent et s'installent, ouvrant toute une nouvelle destinée pour des peuples de bergers pour lesquels la grande histoire antique des empires mésopotamiens n'était plus qu'un vague souvenir. Quand les colonisateurs anglais, français et américains, pour les plus importants, ont surgi dans leur horizon, ces bédouins vaguement sédentarisés dans les ruines de leur splendeur passée, pensez à ce que fut Bagdad, Kerbala, Kom ou Téhéran, n'avaient rien à opposer à la puissance technique et à la volonté conquérante des descendants de leurs anciens adversaires grecs et romains. Alors on a découpé l'espace selon des logiques qui leur étaient totalement étrangères, c'est tout juste si on a daigné prendre en compte l'existence de ces peuples, leur fabriquer des structures de souveraineté, leur inventer des monarques et des gouvernements pour stabiliser les zones où règneraient désormais avant tout les derricks les puits et les pipe-lines. Les ouvrages d'Hergé en disent assez là-dessus, avec toute l'ironie d'un occident dont toute la moralité se condense en un petit personnage accompagné d'un petit fox-terrier, comme aujourd'hui notre bonne conscience se distille à travers les reportages de nos Tintin modernes.
Je veux éviter de faire de l'Histoire, car de toute façon toute histoire est une falsification de l'existence des tous ces MOI qui ont vécu, qui vivent et qui meurent. Encore une fois, je veux peindre ce qui se passe sous nos yeux prolongés par les faisceaux hertziens et par les satellites. D'un côté je vois des hommes tranquilles et souriant, les mêmes que nous avions déjà pu voir lors de la première guerre en Irak. Ils sont assis dans de grands cafés, dégustant leur thé dans de minuscules petites tasses ou tirant avec une certaine élégance sur les tuyaux ouvragés de leurs narguilés. Comme si de rien n'était. Demain, ce café sera peut-être réduit à l'état d'un tas de gravas, sous lesquels ces mêmes fumeurs de narguilés ne seront plus que des corps privés de vie. Mais aujourd'hui, là, sous mes yeux, ces MOI vivent en souriant, accomplissent les mêmes rites qu'il m'arrive à moi-même d'accomplir quand je descends en ville et que je m'assieds dans mon café préféré en commandant un express. Autres images : les rues et les marchés où s'amoncèlent les pyramides de fruits et de légumes et où déambulent les badauds et les marchands, cependant qu'à cent kilomètres de là avance une sorte de monstre qui crache à chaque seconde des projectiles hollywoodiens, du genre Guerre des Etoiles. Hier, un de ces marchés s'est vu effacé d'un coup par l'un de ces missiles du trentième siècle, qui ridiculisent mieux ceux qui les fabriquent et en font usage que n'importe quelle habituelle faute de goût telle que commander un Coca Cola avec un filet de bœuf Strogonoff.
Mais à quoi pensent-elles donc, ces blattes caparaçonnées dans des gilets pare-balles, qui à cinq cents kilomètres de ce marché ont appuyé sur un bouton, extrudant ainsi cette longue ogive brûlante dont le vol comique s'est achevé par le massacre de quelques femmes vêtues de noir venues là pour faire leurs emplettes ? Pardon pour le mot blatte, car il ne s'agit pas de blattes, mais d'êtres humains, des Joe et des William, des Brown et des Smith, des jeunes gens qui sont nés quelque part là-bas, au Texas ou en Californie, où ils ont leurs cafés, leurs narguilés et leurs marchés de fruits et légumes. Et où ils ont aussi leurs femmes, leurs mères et leurs épouses et leurs enfants et leurs amis. Pourquoi sont-ils là, sur ce tas de ferraille qui porte le nom pompeux de croiseur, à des milliers de kilomètres de la petite pelouse verte qui entoure leur jolie petite maison blanche, aux fenêtres ouvertes sur le soleil dont les premiers rayons frappent déjà le berceau du dernier-né ? Le savent-ils ou bien faut-il croire qu'en Amérique, là-bas, il existe désormais une sorte de machine qui décide brutalement que Joe irait s'asseoir devant un écran d'ordinateur d'où il devra commander le feu sur le monde ? Et Bob ? Le petit voyou de Brooklyn que le coiffeur du bataillon a transformé en ange blond kaki figé dans les plis de son uniforme, savait-il qu'il allait vraiment se faire chier (encore pardon, mais le langage évolue et il y a des choses que l'on ne peut plus dire autrement) pendant des heures, assis dans son blindé transformé en fournaise, où il passerait son temps à dénicher les grains de sable un à un dans les mécanismes de sa mitrailleuse de Rambo dont il était, là-bas, si fier ? Savait-il que tout d'un coup il prendrait conscience que le tas de ferraille qui le rendait invincible dans son imagination naïve, pouvait tout d'un coup exploser sous l'impact d'une minable fusée de bazooka irakien ?
On se dirait dans une mauvaise pièce de théâtre. Mauvaise parce que les metteurs en scène avaient tout faux. Ceux qui pensaient qu'ils n'auraient pas à mourir commencent à savoir que leur vie ne vaut pas plus cher que celle d'un de ces bédouins qui les faisaient encore rigoler hier. Ceux qui étaient sûr qu'ils mourraient d'une manière ou d'une autre, que ce soit exécuté par un sbire du régime ou par les missiles de leurs " sauveurs ", ceux-là reprennent espoir, non pas d'éviter la mort, mais de lui donner un sens qui va bien au-delà de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans leur vie, un sens qui remonte à la vie de bédouin tranquille d'avant la venue de tous ces gréco-judéo-romains sanglés dans l'arrogance et l'hypocrisie. Saddam ou pas, le problème n'est plus là. Le problème est : comment mourir ? Dans cette tempête soulevée par un seul homme les formes si fragiles de l'histoire politique récente de cette Mésopotamie qui est presque notre mère à tous, ont perdu toute leur signification, tout le sens de leur enchaînement depuis la conquête anglo-américaine du siècle précédant jusqu'à la tyrannie de Saddam, à peine différente des dictatures qui entourent l'Irak dans toutes les directions. Pour l'Irakien d'aujourd'hui, il n'y a plus d'Irak. Il y a un espace depuis longtemps profané par la modernité et cette drogue mondiale qui s'appelle pétrole.
Alors, alors les choses ne sont plus aujourd'hui comme elles étaient prévues hier, au Pentagone. Les étrangers pensaient qu'il allait se produire une coagulation des esprits contre le Dictateur. Ils se croyaient dans un film de Charly Chaplin où tout allait finir par des chansons et des danses sur la Place de la Concorde. La coagulation a bien eu lieu, mais pas celle qu'ils pensaient. Celle-là va coûter très cher au monde entier, car elle ne va pas s'arrêter aux frontières du pays actuellement agressé par l'Amérique. Une histoire antique se réveille, une histoire où l'Amérique était la Mésopotamie, où l'hégémonie était celle des Sumériens et des Mèdes. La religion y joue à peine un tout petit rôle et il ne faudra pas compter sur les conflits internes à l'Islam, Islam qui n'est qu'une toute petite partie du destin de ces espaces. Même si le mammouth américain finira pas écraser le peuple piégé par ces frontières artificielles, il faudra songer demain à l'Iran, à la Syrie, à la Turquie et au Kurdistan fantôme, mais aussi à la péninsule arabique et même à l'Egypte. Joe n'a pas fini d'en baver et les noms des morts d'allonger les listes des mémoriaux américains et peut-être aussi britanniques. Je dis peut-être parce qu'il semble que la Grande Bretagne soit en train de reprendre son sang froid, et justement de méditer déjà aujourd'hui les conséquences de cette idiotie à laquelle ils se sont laissé aller.
Moi aussi je vais mourir. Je ne peux pas l'oublier, et parfois, depuis quelques jours, il m'arrive d'envier ces Bagdadis qui découvrent, heure après heure, qu'on peut mourir gaiement, en faisant un pied de nez à des tueurs venus sous le déguisement d'humanistes. Ces Irakiens, puisqu'il faut leur donner cette identité-là que nous-mêmes leur avons fabriquée, ne vont pas mourir pour la justice ou l'égalité ou je ne sais quelle valeur du catalogue métaphysique de l'occident. Ils vont mourir pour leur liberté retrouvée, retrouvée sous le fatras même des accessoires de la dictature qui les opprime depuis trente ans. Et mourir pour la liberté, croyez-moi, ce n'est pas rien.
Mardi 1er avril 2003
Alexandre Adler, je ne sais pas si tu rêves ou si tu as des informations de toute première main, mais ton scénario de ce matin me paraît d'une invraisemblance étrangement absurde. Pour rappel : tu penses encore à un " eskaton ", un salut possible, une sorte de miracle qui transformerait d'un coup la tragédie qui se joue en ce moment en Irak en un happy end presque dansant, comme à Vienne ont dansé les grandes puissances cependant que Talleyrand que tu cites, tirait les ficelles d'une reconstruction européenne qui sauvait in extremis l'intégrité du territoire français. Au fond, tu crois à la répétition de l'histoire, tu penses que l'impérialisme occidental qui écrit le destin de la Mésopotamie depuis la chute du Grand Malade Ottoman va une fois de plus décider du sort d'une guerre qui n'est qu'un épisode de plus d'un nationalisme arabe condamné à patauger dans le sang d'un bout à l'autre du théâtre de ses opérations dont il ne faudrait pas exclure la Palestine. Car ton scénario, s'il existe et même s'il semble intégrer comme facteur important la Ligue Arabe, se dessine une fois de plus dans nos chancelleries européennes. Au fond, si je comprends bien ton message, il n'y aurait qu'à trouver quelque part un îlot du genre Saint Hélène susceptible de recevoir honorablement ce Saddam Hussein si gênant et passez muscade.
J'avoue que ta solution me plairait, ne fût-ce que parce qu'elle mettrait fin à cette boucherie surréaliste qui, elle, met chaque jour fin à des centaines de vies humaines. Car ce qui m'échappe le plus, vois-tu, c'est que le monde entier, soit-disant représenté à l'ONU, a été impuissant à s'opposer à cette aventure d'un autre âge et que nous assistons terrifiés non pas à un accident de parcours néo-colonial, comme ce fut le cas lors de l'invasion du Koweit (dont tu sais comme moi qu'elle a été encouragée en sous-main pas Washington), mais au retour de la culture de guerre, une culture dont on prend enfin conscience qu'elle ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Irak. Malheureusement, je crois que cette fois tu rêves et qu'en désespoir de cause, face à la réalité terrifiante qui se profile derrière ce premier acte d'une tragédie bien plus vaste, tu partages les fantasmes auto-sédatifs de quelques diplomates eux-mêmes parfaitement conscient des dangers qui nous attendent tous.
Tu rêves car il est trop tard pour tout ce que tu spécules. Je me souviens que la fuite de Saddam, avec l'accord des puissances, a toujours été l'une de tes thèses bien avant le rush des troupes coalisées vers Bagdad. Et il fut un temps pas si lointain où cette solution pouvait avoir quelque chance de résoudre le problème puisque les Emirats lui avaient bel et bien offert un pont d'or pour qu'il accepte de partir, mais à cette époque déjà tout le monde était convaincu qu'il n'accepterait jamais une telle humiliation. Or, aujourd'hui, je pense que la décision ne dépend même plus de lui et que même si notre Napoléon babylonien se mettait soudain à rêver à une retraite dorée, la réalité qui l'entoure le dissuaderait d'en faire l'aveu. J'ai du mal à comprendre comment un fin connaisseur de l'histoire du nationalisme arabe comme toi, peut encore, aujourd'hui, commettre de telles erreurs de jugement, à moins que, mais je n'ose le penser, tu ne sois de ceux qui pensent " inventer " des solutions de dernière minute parce que tu penses encore naïvement que la raison peut changer le cours de l'histoire. Non, Alexandre Adler, je suis convaincu qu'il est bien trop tard pour tout ça, le cours de cette guerre qui semble piétiner sur le terrain, a produit parallèlement une accélération extraordinaire de la prise de conscience du nationalisme arabe à l'ancienne, le pur et dur, celui du Baas des premières heures, celui des Nasser et des Kacem. Ce conflit, si bêtement lancé par les imbéciles du Pentagone, est en train de laïciser le problème du Moyen-Orient, malgré les efforts des islamistes d'ici ou là pour s'immiscer dans la pièce qui se joue. La théorie du château de cartes des idiots de Washington n'était pas si bête que cela, mais ils auraient dû mettre l'image à l'envers, et ils auraient compris que le château qui allait s'effondrer n'est pas celui du Baas et de la terreur Saddamienne, mais celui d'une Asie Mineure fabriquée selon les critères coloniaux britanniques, qui consistent avant tout à jouer sur les structures féodales, ethniques et religieuses en place. Surtout ne toucher à rien et laisser les Cheiks, les Imams et les Cadis continuer de régir l'espace dont on ne revendique que la richesse fondamentale, en l'occurrence le pétrole. Rappelles-toi en Afrique, ils ont fait pareil avec les mêmes résultats catastrophiques : Kenya, Ouganda, Nigeria et j'en passe.
En gros, voilà ce à quoi il faut désormais s'attendre, et pour la première fois je me permets une fiction, une fiction qui n'est pas une idée utilisable mais la réalité en marche : en ce moment se joue une course contre la montre, non pas entre les forces coalisées et le maître de Bagdad, mais entre les anglo-américains et tout le monde arabe et sa structure médiévale. Le retard pris par les envahisseurs risque de devenir le facteur capital dans cette perspective, car le temps passant, les peuples de tout le Moyen-Orient sont en train de prendre conscience de leur situation de peuples orphelins de tout mais surtout de liberté démocratique. Saddam Hussein est en train de servir de modèle-repoussoir avec l'efficace paradoxale de produire dans les pays voisins, la ferveur non pas religieuse, mais politique. Si le général Franks, cet arrogante nullité militaire, ne s'était pas trompé de cible, il aurait pu étouffer d'un coup l'affaire irakienne. Maintenant, il me semble qu'il est déjà trop tard pour enrayer ce qui s'est mis en route partout autour du bassin de la Mésopotamie et qui va produire ses effets encore bien au-delà vers l'Est jusqu'au Pakistan au moins, où les Américains ont commis, mais là ils n'avaient pas le choix, leur plus grande erreur, à savoir dresser le peuple pakistanais presque unanimement contre son propre gouvernement.
Nous sommes donc devant le paradoxe suivant : le modèle dictatorial irakien menacé d'anéantissement physique va ressusciter le vieux rêve nationaliste arabe qui n'a jamais été avare d'un Nasser ou d'un Saddam Hussein. Nasser était-il un démocrate ? Boumediene, qui a eu, un moment, l'ambition de prendre la place de Nasser, était-il un démocrate ? Existe-t-il dans toute l'histoire de cette région, à l'exception de Kacem et de Mossadegh dont on connaît le destin tragique télécommandé aussi de Washington, existe-t-il un seul dirigeant dont on puisse dire qu'il avait comme idéal la démocratie républicaine ? Pour rire, nommons-le, allez, Habib Bourguiba, mais seulement pour rire. Et pour conclure je vais même aller beaucoup plus loin que vous ne pourriez le penser, je vous prédis l'affaiblissement progressif de cette fabrication américano-saoudienne qui s'appelle l'islamisme. Ce fantasme soit-disant religieux n'a jamais été qu'une arme stratégique inventée contre Moscou et qui nous a donné des petits Ben Laden un peu partout. Bien entendu, on a connu les Frères Musulmans, mais justement, ces Frères-là n'ont jamais représenté autre chose que la réaction contre le mépris de Nasser pour un projet de véritable république démocratique. Nasser était comme De Gaulle un grand homme, mais il n'était en dernier ressort, comme De Gaulle en Mai68, qu'une culotte de peau qui n'a jamais su gérer son pays autrement que les armes à la main. Bref, messieurs qui dansez à Vienne, il faudra bien que vous finissiez par accepter que la démocratie est aussi un droit pour des peuples qui vont en apprendre les vertus sur le champ de bataille que vous leur aurez vous-mêmes offert. Merci pour eux.
Jeudi 3 avril 2003
Tous coupables.
Je ne sais pas ce que vous ressentez. Je ne sais même pas si vous ressentez quelque chose. Cette situation m'en rappelle une autre, moi qui ai vécu dans ma chair la dernière guerre que la France elle-même a livrée, cette fois au grand scandale de ceux qui envoient aujourd'hui leurs propres enfants " travailler " dans les sables irakiens. A cette époque je n'avais pas de sentiments, seulement l'obligation de choisir ce que j'allais faire ou ne pas faire. Aujourd'hui on parle de la guerre de l'information, mais il ne faut pas avoir la mémoire trop courte, car pendant les " événements " d'Algérie, le gouvernement français exerçait ouvertement une censure qu'une petite poignée de citoyens éclairés ne cessaient de dénoncer là où ils pouvaient encore le faire. Moi j'étais parmi les rares privilégiés qui étaient informés, j'ai donc déserté. Il faudra attendre quarante ans pour que la torture pratiquée sans le moindre scrupule par nos GI's, soit reconnue par l'Etat et les historiens, et ressurgisse dans la mémoire de ceux qui l'on pratiquée. Quelques journalistes sont même allés un peu plus loin, réveiller la conscience de quelques uns de ces bidasses contaminés par cette barbarie officielle et qui ne manquaient pas une occasion pour se ruer sur les mechtas et les petits villages isolés pour y égorger, violer, tuer. Mais aujourd'hui, quarante ans après, il y a heureusement le Prozac, et puis aussi les discours consolateurs de quelques généraux qui assument leurs crimes avec le sourire des borgnes heureux de ne pas être aveugles.
Je ne sais pas ce que vous ressentez. Aujourd'hui je n'ai pas à choisir d'aller là-bas en Irak pour casser du bougnoul. Mais aujourd'hui je souffre comme si j'y étais. Je vis dans un vrai malaise auquel le Prozac ne fait rien. Je ne sais pas pourquoi, j'habite une petite ville tranquille, loin de tout autre débat que nos prurits politiques intérieurs sur la retraite et les acquis, mais c'est comme si j'y étais et comme si je vivais la souffrance de ceux qui se demandent quand la bombe viendra mettre fin à leur existence, quand la douleur viendra déchirer leur corps sans qu'ils ne sachent pourquoi. O certes, j'ai eu quelques joies lorsqu'il s'est avéré que la France et les peuples européens choisissent le refus, décident de déserter la grande armée anglo-américaine qui, comme le faisait la France du temps de l'Algérie, prétend répandre la paix à coup de mortiers. Mais cette consolation ne me suffit pas, car en Irak on continue de mourir, de souffrir et de vivre dans la terreur, de quelque côté que l'on se trouve, on continue de faire couler le sang. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que j'y suis pour quelque chose, que mon pays et sa longue histoire coloniale appartient aux causes de ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous n'avons pas le droit de nous contenter de zapper sur CNN pour rester conscient, pour ne pas nous voiler les yeux face à ce que nous offre le présent.
Et ce que j'entends ce matin sur les ondes me confirme dans la légitimité de ce sentiment. Monsieur Powel vient à Bruxelles ! Il vient nous offrir de participer au partage des dépouilles ! Il vient dissiper le seul malaise qui compte, le divorce entre les grands de ce monde ! Mais au fait, pourquoi le Département d'Etat estime-t-il nécessaire maintenant de fermer les yeux sur la trahison européenne pour venir discuter du futur de la Mésopotamie ? Je vous le donne en quatre : parce que les Américains ne savent plus comment tout ça va continuer au-delà de leur victoire de ploucs surarmés comme nous l'étions dans les plaines de la Mitidja avec nos opérations Pierres Précieuses et nos hélicoptères de nettoyage systématique. Les USA ne peuvent plus se contenter de leur allié britannique, qui en d'autres temps était celui de la France lorsqu'il s'est agi de défendre les intérêts de la compagnie de Suez, ils ont besoin de notre aide et de notre complicité pour ce qui va maintenant se dérouler là-bas, dès que la fumée des bombardements se sera dissipée sur les toits de Bagdad. Pourquoi ? C'est simple : nous sommes les vieux briscards de l'impérialisme et du colonialisme, et nous somme censé savoir y faire pour gérer les après-guerre coloniales, d'autant que nos intérêts sont également en jeu. Le sang du peuple irakien, et aussi celui des soldats de la coalition, ne pèse pas lourd face au sang noir qui coule dans les pipe-lines et qui alimente tout au bout, là-bas, chez nous, nos pimpantes limousines. Hier j'étais planté à un carrefour de mon village, et je voyais passer ces jolies petites voitures, élégamment conduites par de belles dames et de beaux messieurs tranquilles et sereins. Et les questions se bousculaient dans ma tête. Mais comment ils font ? Comment elle fait la France pour étaler de telles richesses ?
Demain à Bruxelles on va travailler dur dans les bureaux des hauts étages, car c'est tout cela qui est en jeu. Comment faire pour que tout continue, voilà le vrai problème de ces messieurs. Il faut que nos pompes soient alimentées à des prix qui s'ajustent sur les revenus de nos conducteurs de limousines, et pour que cela puisse avoir lieu, il faut quelque part que rien ne change là-bas dans les vastes espaces d'où suinte l'or noir. Au fond, comment remplacer Saddam Hussein sans rien casser ? Imaginez que l'Europe continue de bouder la frénésie hégémonique américaine et qu'elle se mette à agir enfin dans le bon sens. Imaginez que l'Europe oppose aux ambitions de Washington le même veto qu'hier en exigeant par exemple que l'Irak puisse réellement s'autodéterminer par une véritable démocratie républicaine ? Mais il n'en est pas question. Vous comprenez, les réserves pétrolières mondiales constituent une entité dont la part irakienne est un élément qu'on ne peut pas laisser sous la responsabilité de n'importe qui. Ce n'est pas rien que de piloter les flux d'énergie dans un monde où tout dépend d'eux. L'Iran aussi est un grand producteur et le Docteur Mossadegh aussi a voulu rendre au peuple de son pays cette richesse que les anglo-français venaient pomper sans vergogne dans leurs plaines parsemées d'oasis. La CIA a fait assassiner ce gêneur et on connaît la suite. Aujourd'hui les données n'ont pas fondamentalement changé : les féodalités des Emirats s'entendent à merveille avec nos marchés et il n'y a plus que quelques gêneurs comme les Irakiens et les Iraniens pour menacer le gallon américain. Le gallon (environ 4 litres) de diesel est déjà à 3 dollars ! C'est plus que 4 franc le litre ! C'est un scandale intolérable. Tout cela devient intolérable pour nos yankees qui roulent presque gratis depuis un siècle, d'autant qu'à tout cela vient s'ajouter le Venezuela de ce néo-communiste de Chavez. Au secours l'Europe !
Voilà pourquoi je me sens mal. Je me sens au fond comme avant la déclaration de Chirac sur le veto à l'ONU : que vont faire nos fonctionnaires de la Commission ? Que vont faire nos députés de Strasbourg ? Allons-nous opter pour le statu-quo et les belles limousines ou bien allons nous faire en sorte que ce Moyen-Orient martyr sorte enfin de son Moyen-Âge politique et qu'on entre dans une ère d'échange en sortant résolument d'une histoire de la prédation ? En attendant, allez, je vais aller me prendre un petit Valium.
Vendredi 4 avril 2003
De face et de profil.
Vous le connaissez. S'il vous arrive de zapper sur CNN ou la BBC, vous ne connaissez que lui. Tous les jours à heure tapante il surgit des coulisses, masque fermé. Il jette quelques papiers sur le ridicule pupitre, instrument dont aucun designer, de Mitterrand à Chirac, ne semble vouloir améliorer l'aspect ridicule, puis lève des yeux glacés sur, changement de plan, une bonne centaine d'auditeurs bigarrés, bardés de carnets, de galettes enregistreuses et de caméras soigneusement gantées de bonnetes anti-vent. Le Colonel Brooks, car c'est de lui qu'il s'agit, vient informer les informateurs. Le Colonel Brooks porte la Parole de l'Etat-Major américain.
De face, l'homme est étrangement inclassable dans la taxinomie raciale apparente du melting-pot américain. Black ? Porto-Ricain ? Petit-fils d'un cueilleur d'orange mexicain ou descendance d'une famille de transfuges panaméens ? En tout cas une chose est sûre, Brooks a été choisi avec soin, dont chaque élément de présentation s'efforce de ne rien dire sur la personne qui occupe cet immense uniforme couleur camouflage, sobrement galonné et étonnamment privée de toute décoration. Bref, Brooks ne doit pas exister, il ne doit rien trahir de l'esprit qui l'a nommé à ce poste envié et l'image dans laquelle s'intègrent les lèvres qui sont appelées à se mouvoir pour apporter une parole doit, elle, observer un silence sémantique total. Ce camouflage ontologique nous éloigne à mille lieux du jeune capitaine sémillant qui passait plus de temps à faire rire les journalistes qu'à commenter les transparents mouvants de la première guerre du Golfe. Chez Brooks, rien ne sémille. Pendant ces interminables conférences de presse, on se surprend à attendre un sourire, que dis-je, un petit tremblement des zygomatiques, un clignement d'œil, le creusement soudain d'une ride signifiante, n'importe quel phénomène de vie dans et autour de ses yeux figés dans la glace du devoir. Rien. Hier, le pauvre Brooks a failli laisser échapper une déformation des lèvres qui auraient bien pu trahir une légère trace d'humour, tout cela très vite réprimé. Tout est d'ailleurs réprimé dans l'égrenage monotone de ses commentaires d'image, dans des réponses qui se résument toutes en un seul sémantème : la sécurité m'interdit de vous répondre.
De face, ça marche. Le monde est maintenu à distance, il reste cloué dans l'ignorance, il reste là, assis, comme fasciné par la stature et le visage de cette sorte de Robocop dont l'arrogance est habilement voilée par un air d'ennui et de souffrance christique profondément cachée. Le colonel Brooks, croyez-moi, en sait long. Il pourrait vous en dire à vous faire dresser les cheveux d'horreur. En fait, il est le tout-sachant, mais il vous aime et en aucun cas il ne voudrait vous faire partager sa souffrance, la souffrance de la vérité qui le taraude tranquillement. Les journalistes repartiront donc une fois de plus, ahuris, l'air égaré, comme s'ils sortaient d'un spectacle surréaliste dont il n'aurait rien compris sinon qu'il devait, quelque part, contenir toute la vérité du destin de l'histoire présente. Une vérité qui méritait le respect du silence et surtout un rapport fidèle du long pensum technologique en vidéo et en graphiques sans appel.
Or, il arrive que le colonel Brooks se retrouve soudain saisi de profil par une caméra latérale qui le met alors en scène dans une stratégie beaucoup plus mystérieuse. Autant l'image de face est clairement fabriquée en vue du " circulez, y a rien à voir ", autant celle de profil nous parle, même si ces plans sont en général très rares et très courts. Le colonel Brooks de profil n'est pas le même homme. De grande taille, il le reste, encore que ce satané pupitre trahisse quelque peu cet élément essentiel pour séduire et surtout impressionner, ce qui me fait d'ailleurs penser que ces plans de profil ne sont là que pour confirmer la Grandeur du Porte-Parole, la grandeur réelle, celle qui fit qu'un paysan croate qui faisait deux mètres et quelque, se retrouva un jour du trois ou quatrième siècle, Empereur des Romains sans qu'il l'ai voulu. Mais là où le soufflé retombe tout d'un coup, c'est quand le regard de l'observateur découvre la bedaine naissante du colonel Brooks. Quoi ? Robocop a du bide ? Cette légère rondeur non contenue par un corset médiatique fout tout par-terre. Tout. Le puissant automate qui porte la parole des Surhommes du Pentagone n'est qu'un vulgaire épicurien. Non seulement on voit qu'il se bourre de hamburgers, qu'il porte sur son corps sacré les stigmates du mal américain, l'obésité, mais on est sûr qu'il ne soumet plus, sans doute grâce à ses galons, son être à la muscu quotidienne, au devoir métaphysique d'entretenir la forme athénienne du soldat moderne de la consommation et de la technologie de l'esthétique ! Un soldat des Marines mou du genou ? Et là on se pose la question, messieurs et mesdames, comment ce Bouvard ou ce Pécuchet peut-il prétendre à nous rapporter la Parole du Général en Chef ? Quel manque de goût, ou alors quel mépris pour son auditoire.
Oui, c'est ça, n'allez pas chercher plus loin. Au fond, ils s'en foutent de leur image. Comme Bongo (Omar) ils sont tout imprégnés par cet adage venu du fond de l'Antiquité : les chiens hurlent, la caravane passe. Et, il faut bien reconnaître qu'elle passe, la caravane. Lorsque le colonel Brooks se retire, les lèvres toujours aussi serrées comme s'il se demandait ce qu'il foutait là, les journalistes s'envolent chacun dans leur coin pour écrire, s'agiter, chercher la formule sur laquelle ils tombent à chaque fois inévitablement : encore une conférence de presse pour ne rien dire : désolé, public, nous n'avons rien à vous dire. Demain pourtant, les journaux, les radios et les télévision répéteront mot pour mot ce " rien " si talentueusement étalé par le colonel Brooks. Moralité : Washington se moque du monde entier. L'opinion publique mondiale est le cadet de ses soucis, et pour cause : après l'écrasement du régime de Saddam, il y aura bien d'autres occasions de faire des briefings et des débriefings d'un bout à l'autre du monde. Ici, à Doha, l'Amérique ne fait qu'entamer sa longue marche vers sa Pax Americana cette fois bien mondiale.
Samedi 5 avril 2003
" Ce dont est ce qui existe est aussi ce vers quoi procède la corruption selon
le nécessaire ; car les êtres se payent les uns aux autres le prix de leur
injustice dans l'ordre du temps "
Lorsque tonne sur les plaines le fracas des canons, il est l'heure de sortir la grosse artillerie de l'esprit. Je me souviens très exactement que Revel a sorti de son holster cette citation d'Anaximandre, le plus ancien de nos philosophes grecs, à l'occasion du lancement des opérations militaires les plus sanglantes d'Algérie. A cette époque, ce journaliste-philosophe appartenait encore à la famille de la Gauche et se servait courageusement de sa plume pour lutter contre la guerre coloniale qui se déguisait alors sous le nom de maintien de l'ordre. Depuis, hélas, le mari de notre très adorable Claude Sarraute, est passé dans l'autre camp, mystère de la dénaturation des âmes ou de leurs mouvements erratiques. Peu importe, je ne rappelle pas cet épisode pour m'en prendre à cet ancien confrère de l'Express, mais pour montrer combien les vérités éternelles montent spontanément à l'assaut des barricades lorsque l'histoire s'ébranle
Cette phrase est compliquée, et mon homonyme, le vrai Martin Heidegger, en a fait une traduction qui en transfigure pratiquement totalement le sens. Pourtant, cette traduction-ci, qui est celle de Nietzsche, si je me souviens bien, forme un véritable totem de notre pensée occidentale et résume tout ce qu'on a pu dire d'intelligent sur le sens et la finalité de la morale. En réalité, la complication ou la difficulté n'est qu'apparente, et cette phrase en deux propositions qui se font écho, dit une chose extrêmement simple : elle prédit à ceux qui font le mal, qu'ils paieront un jour le prix de leurs actions. Je limite mon interprétation à dessein, un peu comme on choisit un gros calibre dans une action dont l'issue n'est pas sûre et qu'en temps de guerre, il vaut mieux la certitude du résultat que la beauté du hasard.
A cette citation d'Anaximandre j'aurais aimé en ajouter une autre, allez, ne n'est pas tous les jours dimanche, une phrase que je vais aller pêcher dans l'Evangile de Saint-Jean et qui dit, selon la traduction de Bossuet : -" Je suis la lumière du monde ; ma nourriture est de faire la volonté de mon Père : celui qui m'a envoyé est avec moi et ne me laisse pas seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît " -. Et voilà, le cadre est planté, nous pouvons commencer notre propre commentaire, je vous épargnerai la pincée de Freud qui pourrait encore venir relever le met qui mijote. Vous aurez donc reconnu le Père et le Fils, bien entendu, cette famille texane qui défraye la chronique de l'histoire du monde depuis bientôt deux décennies et vous aurez vaguement senti de quelle manière Anaximandre vient fourrer son nez dans cette affaire de famille d'évangélistes qui n'ont sans doute jamais entendu parler de lui ni surtout de son avertissement. Le Fils a décidé d'achever la volonté du Père, quoi qu'il arrive et parce qu'il fait toujours ce qui lui plaît. Il fera donc la conquête de l'Irak et finira le job que papa, en vérité, n'avait pas osé mener jusqu'au bout parce qu'il était trop intelligent, plus intelligent que son pauvre fils.
C'est donc son fils qui paiera les pots cassés dans l'ordre du temps que prend la justice de l'évolution historique. Au cours de la première phase de conquête, Dieu le père avait retiré ses Anges à temps, pour ne pas risquer d'enflammer l'Empyrée toute entière et de donner aux satans anti-impérialistes l'occasion de ressurgir unis de l'abîme dans lequel ils avaient été jetés. Mais le mal en soi était fait. L'intention était bien là d'en finir avec Lucifer Hussein pour " lisser " la politique du Moyen-Orient, véritable chantier où chacun fait n'importe quoi dans son coin, les mollahs à Téhéran, les sous-mollahs à la frontière du Golan, les Cheikhs en Cadillac soudoyant en sous-main de jeunes étudiants illuminés qui allaient un jour réserver au peuple du Père, sur son propre territoire, la plus mauvaise des surprises. Trop c'est trop. Comme si on n'avait pas assez d'emmerdements avec des Nord-Coréens qui se piquent d'atome, de Chinois qui ne connaissent que le dumping comme arme économique et de Russes qui reconstituent en douce une puissance militaire dont aucun Accord ABM n'arrive à bout, et même d'une Europe qui se permet de refuser le bœuf aux hormones. En résumé, Bush-père rêvait d'un Ordre Nouveau (au Moyen-Orient), un ordre qui devait ouvrir définitivement à ses potes pétroliers texans, une visibilité spéculative décisive. On avait déjà eu un mal fou à nettoyer les bavures d'un choc pétrolier dont on espérait alors qu'il réglerait précisément ce problème, alors qu'il n'avait fait que l'aggraver. Il fallait donc frapper vite et fort pour que le marché de l'or noir devienne enfin une piste de danse où nos rockers à Stetson pourraient s'en donner à cœur joie sans le moindre souci.
Mais voilà ce qui arrive lorsqu'on ne finit pas le boulot parce qu'on est trop pusillanime. On a beau tenter d'asphyxier la Mésopotamie à coups d'embargos et de bombardements nocturnes et pudiquement voilés par les amis des médias pendant douze ans, la situation continue de pourrir et le pire arrive. Les tours s'effondrent et le fils perd la boule. On le comprends, remarquez, car il est le premier Président américain qui prenne une telle baffe. L'intention " régulatrice " du Père devient alors l'impérieuse rage de vengeance du fils qui ne pense même plus au pétrole, mais ne songe plus qu'à mettre le feu à l'Empyrée toute entière. Et le voilà aux portes de Bagdad, sûr de sa victoire, quel qu'en soit le prix, faisant mine de mépriser jusqu'au bout la vaste lame de fond qui se lève déjà en-dessous de l'ensemble du dispositif géopolitique dans lequel le Père avait voulu, seulement, remettre de l'ordre.
La relativité du temps n'aura jamais été aussi palpable que pendant ces dernières heures. Un pays ravagé, déjà conquis ou presque, une ville assiégée et un régime condamné par un réel tonnant et fragmentant, un état-major qui a le triomphe modeste et " humanitaire " mais qui ne comprend rien à ce qui se passe réellement. Hier soir, le Ministre irakien de l'information a annoncé une arme non-conventionnelle qui allait détruire les ambitions américaines comme jadis les perdit la France à Dien Bien Phu. Les plus malins ont compris tout de suite qu'un tel trait d'esprit ne pouvait pas servir à autre chose qu'à empêcher les marines qui encerclent Bagdad de dormir et de faire durer le plaisir. Mais en réalité, chaque minute gagnée ainsi, et de surcroît dans une ambiance vaguement ironique, permet à l'immense armée des démons de se rassembler d'un bout à l'autre du Moyen-Orient, et bien au-delà encore de cette zone où on ne pense plus que pétrole, Kurdistan, démocratie onusienne et autres babioles. Oui Bush fils va payer le prix de l'injustice du père multipliée par la sienne. Je pense qu'à l'heure qu'il est le Département d'Etat lui a déjà fait la leçon, et que les derniers kamikazes de son entourage tentent désespérément de le calmer et de lui faire prendre la seule décision réaliste : arrêter les frais sur le champ.
Mais il n'entendra rien. Il sait que Moubarak en a raz le fez devant les millions d'Egyptiens prêts à tout faire péter. Il sait que dans tous les pays de la zone, les pouvoirs en place perdent à chaque minute un peu plus de crédibilité, de légitimité et d'emprise réelle sur la rue. Il n'ignore rien de ce qui se trafique pendant ce temps à Moscou, à Pékin, à Pyongyang et comment tout le monde met à profit cette aventure surréaliste qui n'est que le prix de l'injustice payé dans l'ordre du temps. Il sait trop bien, depuis le retour de Colin Powel de Bruxelles qu'il n'a rien à attendre de ses alliés de l'Otan. C'était ça l'arme non-conventionnelle du Ministre irakien. Au fond, le Fils est tombé dans le piège tendu par son propre papa. Le destin ne lui a guère laissé de marge de manœuvre et pour laver l'affront de Manhattan, conséquence directe des conneries de papa, il n'y avait pas trent-six manières de faire. Il fallait frapper, et frapper fort, et puis le Tout-Puissant Papa ne pouvait pas se tromper dans ses intentions de 1990, alors on y va, ONU ou pas, justice ou pas, armes de destruction massive ou pas. Belle bêtise, pulsion destinale dirait Heidegger (le vrai), idiotie ontologique où les entreprises de Père et Fils sont déjà condamnées à ne plus être que " ce dont est ce qui existe" et à devenir " ce vers quoi procède la corruption ". Pour les Grecs, la corruption n'est que le contraire de la naissance, à savoir la mort. En tant que philosophe moi-même, je ne peux pas me permettre de condamner ni de juger. Je veux même offrir mon aide à ceux qui se trompent. Alors, puisqu'on est dans le jour des grandes envolées spirituelles, je vais offrir celle-ci à Georges W. Bush, elle est de Ernst Jünger, un écrivain qu'on ne peut certainement pas accuser de pacifisme :
-" Que l'on veuille la guerre ou que l'on veuille la paix, la seule question en jeu est de savoir s'il existe un point où la puissance et le droit sont identiques - en mettant l'accent avec la même intensité sur ces deux mots. Alors seulement on pourra cesser de discourir sur la guerre et la paix pour en décider d'une manière qui fasse autorité ". Ernst Jünger, Le Travailleur, Editions Bourgois 1989.
Dimanche 6 avril 2003
Une situation morale déterminée peut-elle se renverser ? Un état moralement condamnable peut-il se transformer en son contraire ? Pour mieux comprendre le sens de cette question je vais procéder selon une méthode pour ainsi dire aposteriorique pour éviter d'être confronté au terrible piège des préjugés. Je choisirai donc comme premier exemple l'Espagne, dont le destin ne répond pas directement à ma question, mais qui campe l'envergure du problème que je soulève. En 1936, un général félon, comme dirait De Gaulle, déclenche l'une des plus sanglantes guerres civiles du vingtième siècle pour s'emparer du pouvoir. Avec le soutien des nazis, Franco finit par s'emparer du pouvoir après avoir massacré avec la dernière cruauté tous ceux qui avaient osé se battre pour défendre la République légale.
Franco est mort dans son lit, dans une Espagne qui sentait certes la poudre et où l'on venait à peine d'assassiner en public un Premier Ministre, mais qui semble avoir su se ranger parmi les nations européennes au même titre que les Pays-Bas ou le Luxembourg. De son vivant, le dictateur avait fait dresser à sa gloire un mémorial pharaonien, devenu entre-temps un lieu de tourisme que personne, jusqu'ici à ma connaissance, n'a songé à dynamiter. Comme quoi deux éléments se sont conjugués pour produire une sorte d'absolution historique : la victoire et le temps ont gracié un monstre dont quelques partis politiques n'hésitent même pas, aujourd'hui encore à célébrer le nom.
Imaginons maintenant que Léon Blum, inspiré par d'autres muses politiques que celles qu'il a écoutées, ait choisi dès le début de la guerre d'Espagne de mettre toutes les forces de la France au service des Républicains et que Franco ait fini dans une Madrid transformée en Bagdad façon Avril 2003. Que serait-il advenu, non pas de Franco lui-même, mais de l'idée de Franco, de son image morale qui, finalement, s'en tire à peine égratignée, tant la puissance de l'Eglise et du patronat espagnol conjuguée a su lui éviter le pire, à savoir la mise à l'index dans le livre de l'histoire espagnole ? La réponse me paraît peu douteuse : Franco aurait disparu encore plus vite de la scène que Mussolini, qui, lui aussi a su conserver son honneur dans une fraction non-négligeable de l'opinion publique italienne, mais qui reste le Duce.
Voyons à présent un second exemple. Vous avez tous compris que je veux soulever le cas de Saddam Hussein, qui, lui, non seulement vit encore à l'heure où j'écris, mais qui exerce encore de terribles actions de nuisances même si on peut difficilement lui en imputer, cette fois, la responsabilité directe. On ne pourra pas lui reprocher de tuer ou de faire tuer des envahisseurs qui, au demeurant se sont mis eux-mêmes au ban de la légalité universelle en méprisant la procédure de l'ONU et le veto préventif d'au moins trois membres permanents du Conseil de Sécurité. En revanche, on ne lui pardonnera ni de tuer, aujourd'hui encore, ceux qui refusent de se sacrifier pour lui, ni les milliers d'opposants ou de non-adhérents qu'il a fait disparaître pour assurer son trône de tyran à l'Antique.
Et pourtant, et pourtant, le temps ici aussi semble faire son œuvre de mutation. Non pas sur la durée de quelques décennies comme ce fut le cas pour Franco, mais cette fois étrangement sur celle de quelques semaines, quelques jours et même, je l'affirme, quelques minutes. Depuis que Bagdad est encerclée et que la stratégie à l'Hannibal des coalisés se transforme rapidement en combat au corps à corps au milieu des civils pris en otages de part et d'autre, la figure de Saddam Hussein se transforme, l'image morale de ce tyran d'un autre âge semble se vider de son horreur réelle pour prendre au moins celle d'un individu courageux dont le biographe américain le plus hostile au personnage sera bien forcé de modifier le portrait depuis longtemps sous presse chez son éditeur.
Et pas seulement dans son propre pays, où il semble désormais établi que ce dictateur, dit sanguinaire, conservera ses mémoriaux, ses panégyristes et au pire une légende qui au fil du temps lui rendra plus qu'une simple intégrité morale. Il semble peu douteux désormais, que ce fils de paysan modeste du petit village de Tikrit qui s'est élevé au plus haut niveau d'un état qui a été, pendant quelques années l'espoir des républicains arabes, n'atteigne le statut de héros du nationalisme arabe, cette menace qui vient de se réveiller brutalement à cause de la névrose obsessionnelle d'un magnat du pétrole texan. Mais, cela établi, qu'en sera-t-il réellement ? Que pourrons et devrons-nous dire nous, les humanistes impartiaux, de cet homme aujourd'hui pourchassé par la meute des justiciers et pourtant si maître de lui face à son peuple et face à ce que lui réservent les " renards " de l'occident dans leurs Guantanamo sans témoins ?
Le réalisme nous commanderait de répondre que seul les faits qui vont marquer les jours à venir vont pouvoir donner une réponse à cette question. Et d'une certaine manière ce réalisme est incontournable. Pourtant on peut imaginer plusieurs scénarii. Le premier serait qu'il prenne la fuite pour rejoindre sa famille réfugiée en Syrie, le second serait qu'il meurt au combat ou en se suicidant comme Hitler. Dans le premier cas, il est prévisible qu'il prendrait le risque de perdre en quelques minutes tout le crédit dont l'histoire vient de le gratifier auprès de son peuple malgré la terreur qu'il a inspirée et pratiquée pendant tant d'années. Encore qu'il ne faudrait pas non plus lui réserver une stature d'exception parmi les nombreux tyrans qui n'ont pas moins d'horreurs à se faire pardonner que lui. Septembre Noir. Sabra-Chatila. Le martyrologe de Damas. Les égorgés d'Algérie. La Révolution Culturelle. Les boucheries africaines en tout genre. Il me faudrait des pages pour en dresser la liste exhaustive. Dans tous les cas de figure, la fuite lui est interdite, pas question pour lui d'aller jardiner quelques arpents de terre syrienne ou pakistanaise en se faisant expédier des loukoums de Bagdad comme le fait encore aujourd'hui Idi Amin Dada, confortablement installé à Ryad. Idi Amin Dada qui jetait ses opposants aux crocodiles !
S'il ne peut pas envisager un telle lâcheté, il ne lui reste plus qu'à mourir au combat ou peut-être à se suicider, ce qui ne semble pas être dans son tempérament, ni possible à cause de ce retour du religieux qu'il semble avoir sincèrement cultivé ces dernières années et qui lui vaut d'ailleurs un étrange regain de popularité bien au-delà des Sunnites et du cercle de ses prétoriens. Catastrophe pour les coalisés, catastrophe pour tous les géopoliticiens payés pour veiller aux intérêts réels du monde occidental dans cette région si vaste et si essentielle du monde. Dans le mot essentiel, je n'ai pas besoin de vous faire remarquer le radical qui pèse si lourd dans nos budgets. Mais catastrophe aussi pour tous les théoriciens de l'histoire et de la morale qui vont être obligé de revoir leur copie pour d'abord faire leur mea culpa d'escrocs de la culture prompts à livrer à leurs mécènes n'importe quelle caricature, pourvu qu'elle soit efficace. Secundo de faire marcher leurs petites cellules grises pour essayer de comprendre qui était ce monstre aux mains couvertes de sang mais qui n'en est pas moins le vainqueur de la guerre contre les mollahs iraniens encore plus cruels que lui si c'est possible, et le seul représentant vivant après la mort de l'autre Saddam, le glacial Hafez-el Assad, de la tentative de quelques arabes de créer des états modernes indépendants, laïques, et surtout maîtres et possesseurs de leurs immenses richesses.
Il y a du travail pour comprendre ce qui passe entre le traître Fayçal, sorte de Farouk qui à l'instar du Roi Saoud préférait dormir sur des matelas remplis de Livres Sterling et rouler en voitures de sport que d'investir les royalties dans la construction de son pays artificiellement découpé par les vrais maîtres du Moyen-Orient, et un Saddam Hussein qui a fait exécuter son propre cousin et éliminer quelques centaines de concurrents putatifs avant d'instaurer sa dictature. Il y a d'autant plus de travail que les occidentaux ne l'entendent pas de cette oreille, surpris et médusés d'horreur qu'ils furent devant l'insolence de ces jeunes officiers sortis de leurs propres écoles militaires, comme Nasser, et qui d'un seul geste prétendirent mettre la main sur le pactole,. S'en suit alors un imbroglio dont je défie quiconque de refaire le scénario, un scénario qui va de l'assassinat de Mossadegh à la guerre irano-irakienne en passant par les différentes boucheries syrio-libanaises et l'abcès de fixation historique qui s'appelle Israël. Bonjour les dégâts et bon courage pour faire le tri des responsabilités morales que moi je n'hésite pas une seconde à attribuer non pas à tel ou tel tyran issu de toutes ces manipulations, mais à nos dirigeants à nous et à leur commensaux de la Royal Dutch, de la British Petroleum et de la Texaco, dernier petit venu dont il faut rappeler qu'il illustre l'immense retard que les Américains avaient pris dans cette course à l'or noir, raison de plus pour rattraper aujourd'hui le temps perdu. A noter en passant que nous autres, les Français, avons mis du temps à nous joindre à cette course et qu'une fois de plus ce fut notre génie scientifique technique, celui de la prospection et du forage, et surtout commercial qui nous permit de remonter le courant.
Alors, et Saddam dans tout ça ? Saddam, Franco, Suharto, Mobutu, Bokassa, Hitler, Le Duce, Néron, Commode voire Caligula, même combat ? Voyez l'ironie de cette affaire, le hideux Néron, hé bien il se trouve aujourd'hui des historiens qui tentent de le réhabiliter en en faisant rien d'autre qu'une sorte de populiste qui a cru bien faire tout en menant la vie de tous les César qui l'ont précédé. Alors Saddam ? Je ne sais quoi dire, sinon ceci : le présent de l'image et du son des médias est le plus terrible juge des êtres humains qui nagent dans le sens contraire des intérêts des plus puissants, qu'ils ne soient eux-mêmes que des petits dictateurs ou qu'il soient des militants comme Lumumba, un homme qu'on ne prit même pas le soin de diffamer avant d'en faire un cadavre. Malheur aux vaincus, leur échec les suivra longtemps, mais il y a aussi des échecs positifs, des épreuves qui révèlent autre chose que des lieux communs et qui, en quelques jours rendent une justice plus équitable que des années de propagande. Saddam Hussein a peut-être encore quelques chances de ne pas finir dans les poubelles de ce qui sera demain l'histoire.
Lundi 7 avril 2003
Hard Talk : intraduisible. Alors à peu près : discussion sans concession. C'est l'une des émissions de la BBC la plus pointue cornaquée par un certain Tim Sebastien. Petit bonhomme rond mais dont la carrure se devine à la seule puissance de sa voix. Le principe de ce talk-show est simple. Il consiste en une confrontation, en général avec un seul interlocuteur, sur les sujets les plus brûlants du moment et à des niveaux de compétence et de position politique maxima. Tim ne fait pas de cadeaux et attaque dans le vif des problèmes sans ronds de jambes et hors de toute langue de bois. Hard Talk veut aller au cœur du sujet et faire dire à ses interlocuteurs la vérité de ce qu'ils pensent. Et il y arrive remarquablement bien, même s'il laisse perler ici et là des lambeaux de conservatisme cambridgien qui forme le fond de l'objectivité Realpolitik d'un journal comme le Financial Times. D'où il ne serait pas étonnant qu'il soit issu.
Hier ils étaient quatre. Tim avait trois invités dont la distribution confirme ma remarque sarcastique sur le conservatisme indécrottable de ce grand journaliste. Seul contre tous notre Français Guillaume Parmentier, Directeur d'un Institut des Sciences politiques au ton et au pouvoir semi-Quai'Orsay, et puis en face un loup américain, Joshua Muraychick, représentant le cercle rapproché des mécènes de Bush, jeune blond bien en chair et rigolard. Les deux adversaires déclarés sont en " incrustation " comme on dit, c'est à dire qu'ils ne sont pas en direct, mais parlent depuis leur lieu d'origine. Sur le plateau par contre, faisant face à Tim, Lord Charles Powell dont le titre s'aggrave de son appartenance au parti conservateur et d'un aspect Lord de chez Lord. Sujet : évidemment l'Irak. Accusé, évidemment la France. Sourire arrogant tout au long de l'interview, le yankee, évidemment. Le Lord existe à peine, comme tous les Lords. Pour la première fois, je ne vois jamais Tim de face. Pas trop fier de son traquenard. Le Lord a dû lui être imposé, c'est pas possible autrement. Ou alors, pourquoi n'y a-t-il pas au moins un représentant de Berlin voire de Moscou ?
Mais Tim attaque dur : alors Monsieur Muraychick, les Etats-Unis ont décidé de faire cavalier seul ? réponse amusée : mais mon cher Tim (ces Messieurs se connaissent depuis toujours), les USA n'avaient pas le choix, l'ONU a failli à son devoir.
Aoh ! Alors plus besoin de l'ONU ?
Et ainsi de suite. Je n'ai pas la place pour ne fût-ce qu'un résumé de ce petit quart d'heure d'agressivité surligné par la moue figée de Guillaume, sans doute furieux de s'être laissé piéger par Tim, car Lord Charles ne se distingue qu'avec peine de la position hégémonique américano-britannique. Bref, on est venu lui régler son compte, à lui, à l'Allemagne et à la Russie, trois pays dont l'agrégat possible réussit à peine à dissiper l'ironie arrogante de l'Américain. De toute façon on s'en fout, on est les plus forts. Chanson connue et devenue refrain depuis le retour à Paris d'un certain Chamberlain.
Trois personnages de tout premier rang qui s'engueulent, ça fait froid dans le dos, surtout lorsqu'on entend la France accusée de " nationalisme égoïste " par des satrapes qui n'hésitent pas à étaler comme argument décisif la toute-puissance militaire de l'Amérique. Muraychick : mais nous n'avons besoin de personne, nous sommes capables de faire régner l'ordre tout seuls. Car Lord Charles est quand-même mal à l'aise. Le peuple britannique commence à en avoir marre des exploits de ses rats du désert, et dans les collèges de la vieille Angleterre, on rédige déjà des motions à l'intention de Monsieur Blair. Et puis le seul argument de la coalition est si mince qu'il n'est même pas évoqué : la résolution 1441 comporte une phrase qui légitimerait, selon Washington, la destruction immédiate du régime de Saddam. Même pas une phrase en fait, seulement quelques mots : " pourrait entraîner des mesures plus sérieuses " (si Saddam fait obstacle à l'inspection de l'ONU). Bush a donc utilisé ces quelques mots pour justifier les massacres qui ont lieu à l'heure qu'il est.
Mais en vérité on s'en fiche : l'ONU, c'est fini. Oh, déclare un Joshua hilare, elle rendra encore de grands services dans " ces affaires dites humanitaires " (sic), mais pour le reste nous avons ce qu'il faut. Et l'Iran, et la Corée, et la Chine ? Hé bien, même eux, s'il le faut, encore que Monsieur Muraychick n'hésite par à déclarer que le cas de l'Iran (dangereux nids de serpents terroristes) est différent car ce pays serait une " démocratie ". Et cette fois, sans rire, le plus sérieusement du monde. Le rire ne reprend qu'à l'évocation par Tim d'une coalition tripartite comprenant principalement la France, l'Allemagne et la Russie, trois puissances (ah ! ah ! ah !) dont nos GI's ne feraient qu'une bouchée. J'exagère, mais il faut faire court comme dit mon rédac-chef.
Alors voilà j'arrête. Ce n'est qu'une esquisse de ce qui tapisse le cortex de quelques représentants de décideurs. Mais voyez-vous, au total je suis assez satisfait. Un journaliste britannique qui veut sincèrement résoudre une équation parce que ce qui se passe commence à faire mal à son propre pays. Un représentant de l'establishment style Hercule Poirot qui nage douloureusement entre deux eaux. Un Français très style grand siècle, il ne lui manquait que la grande perruque de rigueur à Versailles, plus british in fine que les deux Anglais présents. Et alors Monsieur Muraychick, un poème qui éclaire d'une lumière sinistre les intentions réelles des Américains de Monsieur Bush. S'emparer du monde et imposer, pardonnez cette répétition conclusive, la Pax Americana Wall-Streetis. Rien de réjouissant me direz-vous ? Mais si, au contraire, tout ça c'est de la frime, de la frime assaisonnée d'une rare bêtise. Enfin par si rare en ces temps-ci du côté de la Maison Blanche. Et ce qui me plaît bien dans tout cela, c'est de voir les cartes s'abattre comme je l'avais prévu il y a déjà plusieurs années : l'Europe est en train de rompre politiquement avec les States, ce qui signifie une rupture bien plus profonde, une rupture culturelle qui dessine non pas le commencement de l'hégémonie américaine mais sa fin. Il me reste une case dans mes prévisions, une possibilité qui ferait de Bush-fils un accident transitoire comme ce fut le cas de Nixon. Mais ne rêvons pas trop. Le capitalisme américain est aux abois et c'est la seule raison pour laquelle la Maison Blanche risque bientôt de ressembler dans l'opinion mondiale à une certaine Chancellerie berlinoise. Sur la carte électronique du Pentagone, on verra bientôt s'éteindre les voyants rouges Coca-Cola, McDo et Hutt à travers le monde civilisé. Bah, ce n'est pas grave, il reste la grande Chine, nos bombardiers furtifs et nos chars Abrams. Bonne chance !
Mardi 8 avril 2003
Je suis à bout. Toute trace de colère a disparu en moi, je craque. Tant de guerres en une seule vie, à commencer par la Deuxième Mondiale, et ce massacre en direct, ce sang qui coule à chaque minute. Quel Français de mon âge, soixante-deux ans seulement, peut encore supporter l'histoire présente ? La plaie avait commencé à se refermer, tout doucement. Péniblement la violence se résorbait en surface à travers l'espace de la planète et les sources de haine se tarissaient les unes après les autres, même là où elles sont les plus archaïques, remontant parfois jusqu'au début du second millénaire de notre ère. Au Sri-Lanka on signait hier encore une paix incroyable qui a laissé tout le monde indifférent tant elle est marginale, comme si la naissance d'une paix ne mérite même pas une pissette en troisième page. La fin de la guerre froide avait ouvert une vanne de désir de vie plus jamais connue depuis Auguste. Et ça. Je n'arrive même plus à écrire, je ne sais plus comment parler de toute cette sanglante anarchie qui revient avec fracas, sans masque, en écrasant d'un pet arrogant tout ce que les hommes avaient avec acharnement construit pour empêcher tout cela.
J'avais commencé à écrire ces quelques phrases hier matin. Puis, m'installant au volant de ma voiture tout en continuant d'écouter le programme de France-Culture, j'entends une jeune femme, dont hélas le nom m'échappe, répéter presque mot pour mot ces quelques phrases qui ne sont ni des analyses ni des descriptions ni des considérations morales. Seulement une sorte de gémissement douloureux, un cri de révolte. Assez !
Ce matin, j'essaie de reprendre le dessus. Il faut admettre le pire, il faut admettre qu'il ne s'est rien passé depuis l'écrasement du nazisme, rien passé depuis la mort par asphyxie du stalinisme. Rien. Nous avons cru à ce moment magique charnière où les grandes causes de la violence semblaient avoir disparu. Nous avons cru naïvement que les sources de l'instinct hégémonique qui avait fait l'histoire des deux derniers siècles s'étaient pour ainsi dire taries. Nous voyons ressurgir le réel hideux de la volonté de puissance dans son mépris le plus répugnant de tout destin individuel. Désormais tout a recommencé, on peut mourir pour le rien des autres, pour la folie de peuples qui se cristallisent soudain dans une position paranoïaque, fermant les yeux sur toutes les obligations de légitimité qu'ils avaient eux-mêmes nourris de leur " humanité ". Il n'est plus nécessaire de chercher à comprendre, il faut désormais s'attendre à y passer, comme les peuples attendaient du temps de Darius, d'Hitler ou de l'Empereur Hiro-Hito.
Mais prenez garde, tout ça ne se déroule pas seulement là-bas, dans les sables de Mésopotamie, tout ça a déjà commencé chez nous, dans nos petites villes si tranquilles, sur le pas de nos portes : il faut s'attendre à y passer dans son entreprise, dans sa protection sociale, dans l'accès aux services les plus simples. La guerre n'est qu'un masque, elle n'est que le réel de la barbarie dans sa figure visible. Il n'y aura plus d'après-guerre. Monsieur Bush a donné le signal d'un règlement de compte général entre la tendresse de l'intelligence et la brutalité de l'animal humain. La porte du chemin qui conduit au non-être s'est rouverte, on avait cru trop vite que la bombe d'Hiroshima l'avait vitrifiée pour l'éternité.
Jeudi 10 avril 2003
Depuis le commencement de La guerre, j'avais pris l'habitude de participer aux forums de deux médias pour lesquels il m'est déjà arrivé d'avoir du respect. Le journal Libération fait parfois du bon boulot, et France Culture reste, malgré tous les défauts qui s'accumulent depuis une bonne demi-douzaine d'années, une radio audible, parfois héroïque. En ce qui concerne Libé, je ne pouvais pas me faire d'illusion car je connais Serge July depuis l'époque où en tant qu'apparatchik de l'UNEF il s'est honteusement opposé à la liquidation des Bapu, les Bureau d'Aide Psychologique Universitaire, ces anti-chambres des goulags chimiques de la nouvelle psychiatrie. Comme par hasard, le jour où nous l'avons rencontré dans un amphi parisien pour le persuader de se solidariser de la campagne que nous, les situs, avions lancé à Strasbourg, July était en compagnie de Marc Kravetz, fraîchement nommé chroniqueur sur France-Culture. Coïncidence ? Non. Profonde identité de faussaires des idées, ou plutôt de la relation qui doit unir l'idée et l'action.
Je peux le dire à présent car j'en ai la preuve. Au début je n'y croyais pas, mes textes, toujours rédigés dans le style que vous connaissez, c'est à dire plutôt du genre courtois intello même souvent chiant, passaient à la trappe de la censure. Libé comme France-Cul censurait mes textes, ils ne passaient même pas. Alors j'ai protesté, calmement, courtoisement chez l'un comme chez l'autre. Et vaille que vaille quelques-uns de mes messages parurent sur leur forums. Et puis, l'habitude fut prise de choisir. Tantôt je trouvai mon texte dès le lendemain, tantôt il s'était perdu dans la nature, c'est à dire pas tout à fait, car évidemment j'ai publiai une version sur ce site et vous avez donc pu lire tous ces messages et vous faire une idée de ce qui peut bien avoir justifié ce geste.
Je n'en dis pas plus. Pourquoi m'étonnerais-je d'un comportement que j'ai dû constater moi-même pendant plus de vingt ans dans les rédactions du service public, et contre lequel j'ai passé mon temps et brisé ma carrière à lutter. Seulement, je voulais que vous sachiez à quel niveau la liberté d'expression est tombée dans notre pays, et sans doute dans notre Europe. Il m'est arrivé fréquemment d'écrire au Financial Times, soit-disant le journal le plus objectif du monde ! Quelle farce, quelle féroce arrogance face à tout ce qui ne s'aligne pas sur leur Realéconomie de clercs au service des grandes puissances !
Bof, j'ai eu tort de croire un seul moment que j'avais quelque chose à faire dans ce domaine du jeu de l'échange d'opinions sur le réseau virtuel. Je vais retourner à mes chères études, ce qui ne m'empêchera pas de parler et de commenter comme je l'entends, les événements qui forment le décor de mon destin, un décor de plus en plus sinistre. Mais quoi, même le sinistre a sa beauté.
Vendredi 11 avril 2003
Machiavélisme à l'américaine. Le monde entier s'étonne de l'attitude de l'armée des coalisés qui laissent se développer l'anarchie la plus dévastatrice sans broncher. Seul argument ridicule : les combats ne sont pas terminés ! Ce qu'on oublie, comme ça en passant, c'est que cette indifférence est une nouveauté historique : excepté Attila, je ne connais pas beaucoup d'armées, depuis Alexandre, qui ont avancé dans leurs conquêtes sans entreprendre immédiatement la gestion de l'espace conquis. Ce crime, car c'est un crime qui porte le nom de non-assistance à personnes en danger, est parfaitement planifié, sa raison tactique et stratégique : les coalisés encouragent par leur passivité la purge dont ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Ils transforment ce qui devrait demain s'appeler la justice à l'esprit du règlement de compte à l'américaine, style mafia. On peut appeler les voyous qui ravagent aujourd'hui les grandes villes de l'Irak les septembriseurs de la révolution importée. Or cette vengeance qui s'attaque à une réalité aussi ancienne que les régimes au pouvoir depuis la chute de la monarchie, n'a pas de raison d'avoir de limites. Mais cette manière de laisser -faire le pire est en parfait accord avec l'esprit des " winners " du Far-West américain : le pouvoir à celui qui dégaine le premier. Nous avons de bonnes chances de voir bientôt régner à Bagdad un clone de celui au nom duquel on vient de massacrer quelques milliers d'êtres humains. Au nom du peuple irakien : merci Monsieur Bush.
Samedi 12 avril 2003
Il n'est jamais trop tôt pour instruire un dossier à charges pour un procès qu'il faudra de toute manière laisser à l'histoire. Cette science à ceci d'étrange qu'elle ne trouve son objectivité que longtemps après les faits, alors qu'il serait plus logique de considérer que la proximité des faits sont la garantie même de leur véracité. Bien sûr, la cause de ce paradoxe provient de l'impossibilité actuelle, dans le présent des faits, de bénéficier d'un regard d'ensemble, d'un panorama assez général pour comprendre des événements qui se passent dans la particularité de la géographie et du brouillard épais que répandent les passions contraires dans leurs compte-rendus.
Il en va ainsi de cette guerre si étrangement insolite qu'elle a déjà produit des ruptures qu'on n'aurait jamais imaginées, même si un mouvement général était déjà perceptible depuis longtemps à qui savait voir. Les " experts " les moins doués perçoivent depuis plusieurs années déjà le fossé qui se creuse entre l'Amérique et l'Europe. Les récents événements ne forment donc que les trois coups de la véritable pièce de théâtre dont le rideau va se lever dans les semaines qui viennent. Il y a néanmoins des éléments de ce déclencheur que l'on peut d'ores et déjà classer dans les premières pages du dossier que constituera pour les historiens ce moment d'une guerre qui aura servi à déchirer le voile qui recouvrait encore la réalité en marche.
Dossier Irak. Les historiens qui vont se pencher sur cet épisode des relations internationales des années 2000 commenceront logiquement par se poser la question du casus belli. Ils pourront constater en premier lieu que la rupture qui aura vraisemblablement détruit l'Alliance Atlantique a précisément pour cause la nature des causes de cette guerre menée unilatéralement par deux grandes puissances soutenues par une quarantaine de petits alliés de circonstance. A supposer que les historiens dont nous parlons vont se trouver dans une situation où ils jouissent d'une parfaite liberté d'investigation et d'expression, on peut dire qu'ils ne pourront que condamner la décision des " coalisés " au regard du principe de légitimité qu'offrait alors la structure et le fonctionnement de l'ONU. Ils chercheront cependant à comprendre le geste subversif des coalisés en fonction de données plus vastes que la tenue d'un Conseil de Sécurité, en analysant notamment l'enchaînement des faits et la teneur de vérité des arguments des uns et des autres. Au centre de cet examen figurera certainement la résolution 1441, c'est à dire le document qui justifie ou condamne l'action menée contre l'Irak en mars 2003. Le cœur de l'argumentaire de ce document est constitué par le danger que représenterait pour l'humanité la possession par l'Irak d'armes de destruction massive. En conséquence la résolution préconise l'envoi d'enquêteurs sur place afin de faire la preuve de l'existence de telles armes dans le pays en question.
On connaît la suite. Après avoir enregistré le fait que l'Irak fut attaquée et ruinée du Nord au Sud sans que la moindre arme de destruction massive n'ait été découverte, les historiens se tourneront alors vers l'argument qui est né pendant l'opération militaire et qui portait le nom de décapitation du régime tyrannique d'un certain Saddam Hussein. A cinquante et quelques années de distance ces historiens chercheront des preuves a posteriori de la férocité et du caractère résolument inhumain du régime que les coalisés vont abattre. Ils trouveront dans les documents du Pentagone et des services secrets de quelques autres puissances, des preuves en nombre suffisant pour effacer le moindre doute sur l'inhumanité de ce gouvernement. Pourtant, en étudiant de plus près les faits de guerre et d'après-guerre, ils vont être amenés à se poser quelques questions. En voici deux exemples :
- Comment se fait-il que la victoire des coalisés n'ait pas été suivie par une chasse féroce à tous les complices du régime. Quelques heures après la libération de Bagdad on aurait dû assister à des règlements de compte sanglant si tant est que ce régime tenait le pays à la manière nazi, c'est à dire immeuble par immeuble, comme se complaît à le décrire la presse du moment. Au lieu de cela, les historiens vont devoir constater que l'Irak se transforme à ce moment-là en un immense champ de pillage, totalement anarchique, sous le regard indifférent des soldats de la coalition qui ne sont pas venus, liront-ils dans cette même presse, pour maintenir l'ordre.
- Pourquoi Saddam Hussein, qui en avait certainement le pouvoir, ou alors il n'avait pas de pouvoir, mais alors quel genre de tyran était-ce ? pourquoi Saddam, se sachant condamné d'avance par cette armada invincible, n'a-t-il pas au moins détruit la richesse tant convoitée par l'envahisseur, pourquoi n'a-t-il pas fait sauter tous les puits de pétrole ? Avait-il, malgré tout, le sens de l'intérêt de son pays au-delà de sa haine personnelle et " mégalomaniaque " comme c'est écrit partout dans les journaux de l'époque ?
La question centrale restera cependant celle de savoir comment il a pu se faire que l'armada qui se répand sur l'ensemble du territoire ne trouve pas la moindre trace d'armes de destruction massive, l'unique casus belli inscrit dans la Résolution 1441 ?
Peut-être est-il aujourd'hui encore trop tôt pour répondre à ces questions que nous anticipons pour les futures recherches d'historiens impartiaux. Il n'est en tout cas pas trop tôt pour les méditer et suivre attentivement les événements qui viendraient corroborer ou contredire leur pertinence.
Dimanche 13 avril 2003
Lorsqu'il y a quelques jours je parlais des portes du non-être je n'osais pas penser à quel point cette expression venait à point. Non pas que je la considérais alors comme une simple figure de style, mais il manquait encore un élément plus essentiel qui justifie toute la terreur qu'une telle expression libère. La guerre, cette guerre-là, pouvait encore être classée parmi les remous post-coloniaux, les effets à long terme d'une violence qui vient masquer sous prétexte d'y mettre fin, une plus grande violence passée. Or on ne pouvait s'empêcher de subodorer dès le début, dès qu'il devint clair que les coalisés ne tiendraient aucun compte de la légalité universelle matérialisée par l'ONU, que leurs intentions étaient d'une odieuse hypocrisie. Aucun conflit au monde n'a soulevé un tel tollé de protestations dont les plus spectaculaires se produisirent dans les pays bellicistes eux-mêmes. Ce matin encore, j'apprends que Washington a décidé de ne pas présenter la résolution prévue contre Pékin pour atteintes aux Droits de l'Homme, au grand scandale des ONG. Pour le reste, mon réquisitoire d'hier suffit largement.
Si mon effroi a grandi entre-temps c'est à cause d'un détail. Toujours le détail qui trahit l'essence de l'action. Nous savons depuis deux jours environ que les musées de Bagdad ont été pillés, que ce qui restait des plus anciennes traces de notre propre civilisation avait été saccagé, profané, brisé avec la rage habituelle des barbares. Ce que nous ne savions pas, et que CNN nous a appris ce matin, c'est que l'armée du général Franks s'était engagée bien avant les opérations auprès de l'UNESCO à protéger en priorité ces trésors inestimables, des trésors que même ce barbare de Saddam Hussein a respecté au nom de l'Histoire. Un engagement pour rire, comme si le destin passé de l'humanité avait le moindre intérêt au regard de l'action de notre Attila moderne. Oui, le message de cette indifférence est clair : l'Histoire commence avec nous, avec cette offensive qui n'est que l'amorce du rouleau compresseur de notre civilisation made in USA. Rappelez-moi le nom de cet universitaire nippon-américain qui affirmait que l'Histoire était terminée, finie et que le marché avait définitivement pris le relais de l'action et des idéaux humains. Ah oui, Francis Fukuyama. Hé bien, mon cher Francis, en un sens vous n'aviez pas tort, sauf que vous sautez pour ainsi dire quelques épisodes et des épisodes qui vont encore coûter cher en vies humaines. Mais bravo pour l'efficacité de vos thèses, l'armée américaine a commencé à gommer le passé, cette saleté qui encombre les cerveaux qui prétendent encore penser. No past, no future, les beatniks avaient raison.
Lundi 14 avril 2003
Ce que fait le général Franks en Irak, sous les ordres de son président qui joue pendant ce temps au golf à Camp David, c'est ce qu'on appelle saloper le travail. Réédition de l'aventure afghane dont on ne souffle pratiquement plus un mot. La guerre en Irak ne fait qu'amplifier la mesure d'improvisation anarchique dont on a le triste souvenir vietnamien. En remontant plus loin, on peut aussi se demander ce que serait devenu l'Europe aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale sans les initiatives de personnages comme le Général De Gaulle, Churchill ou Adenauer, voire Staline. Les dessous de la campagne de Paton a fort bien révélé ce qu'on pourrait qualifier d'Heisenowerisme, cette guerre sans visage et sans stratégie globale qui n'avait comme seul objectif la destruction, que dis-je, l'anéantissement. On sait depuis longtemps pourquoi les Alliés ont infligé à Dresde ce que Bush inflige aujourd'hui à la capitale de notre civilisation : ils savaient déjà que cette ville irait au futur adversaire communiste. Il fallait donc détruire et détruire, Leipzig, Dresde, Berlin, bref, tout ce qui allait faire partie de la zone soviétique. Plus au sud, en revanche, on préservera Wiesbaden et aussi Baden Baden, deux villes agréables, bonnes à accueillir les états-majors d'occupation. Ce qui se passe aujourd'hui en Irak montre au moins une chose, c'est que les Américains n'ont pas l'intention de s'installer sur place. Ils n'auront pas besoin d'occuper le pays pour contrôler les flux de sa principale richesse, il n'y a donc aucune raison de préserver quoi que ce soit. L'Irak ne sera jamais qu'un vaste Dresde pour toute la communauté arabe et humaine, car contrairement aux Allemands, les Irakiens n'ont même pas eu le temps de mettre leurs trésors à l'abri dans les mines de sel de Saxe où l'on a pu retrouver l'essentiel des trésors muséaux des villes réduites en cendres. Le gouvernement de Saddam Hussein a même été pris dans une sorte de piège, car comme je l'ai signalé hier déjà, il existait un accord ou un engagement entre Washington et l'Unesco pour donner la priorité à la protection des musées mésopotamiens.
Or, ce salopage n'est que le reflet d'un bricolage politique et militaire beaucoup plus essentiel. Les " experts " et quelques analystes lucides avaient prévu de longue date que Bush ne s'arrêterait pas à l'Irak, mais on attendait qu'il y mette les formes et qu'il prenne un certain temps, qu'il suive au fond une sorte de rythme diplomatique de rigueur dans les décisions portant sur les grands conflits actuels. Or que se passe-t-il ? Bush-Pichrocole est déjà devant la carte de la Syrie, menaçant sans ambages ce pays qui tente péniblement de sortir de la glaciation imposée par Hafez El Assad à qui il est si facile d'identifier purement et simplement le fils. Incroyable insolence, à peine moins surréaliste que l'injonction de monsieur Wolfowitz à la France de payer les pots cassés. On croit rêver, mais on ne rêve pas. Le gouvernement actuel des Etats-Unis est bien décidé à faire le ménage à sa façon, en cassant, brisant, dévastant, désintégrant un maximum de ce que les Arabes ont construit pour abriter leur existence : tout cela ne représente que des futurs chantiers payés d'avance par le pétrole du sous-sol moyen-oriental.
Hier soir, j'ai lu attentivement un grand nombre de mails sur les forums de Libération et de France-Culture, c'est un choix comme un autre et j'y ai trouvé en face d'une majorité d'opinions hostiles à la guerre, quelques développements qui ne manquent pas de force même dans la caricature. Pour résumer leurs arguments, il suffit de dire que les Etats-Unis auraient décidé de passer au Moyen-Orient le même balais qu'ils auraient passé contre le nazisme. Point barre. Or, dans cette manière de voir on fait subir une torture invraisemblable à l'histoire, une déformation qui peut s'illustrer ainsi : quelques heures avant Pearl Harbor, ce ne seraient pas les Nippons qui auraient claqué la porte de la SDN , mais Washington. Voilà la contradiction de laquelle tous les supporters de Bush ne sortiront jamais. Il est inutile d'entrer dans les autres détails dont il en est, cependant, dont j'ai eu la joie d'avoir confirmation hier soir, à savoir que la conquête du Koweit par Saddam avait été encouragée par la Maison Blanche, piège classique qui démontre au moins une chose, c'est qu'il n'y aucune commune mesure entre un Hitler et un Saddam. C'est faire injure à tous les peuples de ce Moyen-Orient que nous semblons contempler avec tant d'arrogance que d'affirmer sans autre qu'ils vivent tous dans des oppressions comparables au nazisme ou au stalinisme. C'est ignorer, toujours la bêtise et le manque de culture la plus primaire, le rôle démocratique des structures tribales et claniques du Moyen-Orient. Si la religion semble prendre le dessus depuis quelques années, c'est un autre résultat de la stratégie prodigieusement imbécile des Etats-Unis. Le travail du Département d'Etat et du Pentagone ressemble à cette énorme erreur commise par les Britanniques au Bengladesh, à l'époque encore partie de l'Inde, lorsque ils ont détruit toute la structure fine du delta du Gange mise en place par des millénaires d'expérience pour construire de soi-disant barrages dont on connaît le résultat actuel, à savoir une catastrophe par an. Faire de l'Islam la donne majeure de la géopolitique orientale c'est exactement la répétition de cette idiotie technicienne, et les Américains en pâtiront les premiers. L'assassinat du premier mollah débarqué par les Américains à Kirkuk devrait servir de leçon, mais le fond de l'affaire est la paresse foncière de ces culottes de peau qui ne pensent qu'à manipuler leurs joysticks du haut des airs.
Ce qui nous amène à la suite, et elle n'est pas triste. Quitte à me répéter, je vais refaire grosso modo le scénario auquel le monde peut s'attendre. Je peux aussi jouer mon petit Alexandre Adler. Donc, la Syrie rayée de la carte pendant que Sharon joue les peace and love, histoire d'alléger (dans les illusions des Américains) le bloc originaire de haine anti-occidentale. Un modus vivendi, sinon une véritable paix, devra servir à calmer les masses (opprimées ?) d'Egypte, de Jordanie, du Liban, bref, de toute la zone qui entoure les cadavres qui bougent encore de l'Irak et de la Syrie. Après la Syrie, il reste le plus gros morceau de ce Moyen-Orient, à savoir l'Iran. Là il n'y a pas seulement du pétrole en abondance et des armes de destruction massives, il y d'abord une vengeance à prendre, une vendetta sans pitié pour l'une des plus terribles humiliations subies par la plus grande nation du monde. Que ce soit un démocrate qui ait piloté à ce moment là les opérations ne change rien. Le sang des otages, la honte des services spéciaux chargés de les récupérer, les attentats qui ont suivi à Beyrouth et ailleurs, tout cela crie vengeance et Dieu a désigné Georges W. Bush pour exécuter la sentence. Pendant ce temps, le fossé atlantique va se creuser de jour en jour davantage et nous assisterons sans doute à un renversement géopolitique qui ressemblera à un tremblement de terre : du fond de sa tombe, De Gaulle pourra admirer la réalisation de ses vœux les plus chers : l'Europe de Brest à Vladivostock.
Parce qu'entre-temps l'Amérique, s'il arrivait par malheur que son peuple ne renvoie pas son leader maximum aux poubelles de l'histoire, sera déjà sur la voie d'autres règlements de compte. Le porte-avion Taïwan attend déjà les bombardiers nucléaires, cette fois, destinés à mettre un terme à l'arrogance de ces Coréens qu'on empêchent littéralement de s'arranger entre-eux par tous les moyens, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Bush mettrait alors sans la moindre hésitation le feu à tout l'Extrême-Orient, quitte à provoquer des dizaines de Pearl Harbor, des centaines d'Hiroshima.
C'est fou tout ça, car la question qui surgit tout de suite est simple : où allons-nous nous situer, nous les Européens ? Car les arguments du Département d'Etat sont déjà prêts et pas simples à gérer : la guerre froide se sera simplement transformée en guerre chaude avec les mêmes ingrédients, le même argumentaire idéologique. Il faudra s'attendre à s'envoyer dire que l'humanité et les Droits de l'Homme sont, comme Dieu, du côté américain. Heureusement, l'être possède l'allié le plus sûr qui soit, à savoir le temps. Bush ne dispose pas du temps nécessaire pour mener cette conquête à la Darius. Comme Darius les tempêtes vont ici désintégrer ses armadas, là ce seront quelques Spartiates inébranlables qui stopperont des divisions blindées jusqu'aux dents. Tilt, Monsieur Bush, refaites vos calculs : vous allez vous accaparer très vite de nombreux marchés, certes. L'Irak, la Syrie, peut-être l'Iran. Mais par ailleurs vous allez perdre un temps précieux dans votre stratégie pour en finir avec le marché européen. La tendance des bourses montrent déjà que la confiance se tourne vers l'Europe, aucun marché n'aime le chahut. Et puis on ne rentabilise pas du jour au lendemain des nations missilisées et réduites à néant. Vous allez donc avoir à rendre des comptes à votre principal mandataire ; Wall-Street ne pardonne aucune faute professionnelle, même si elle en porte une part de responsabilité. Non, Sir, le temps joue contre vous, cependant que l'Europe coulera des jours peut-être rigoureux mais tranquilles et choisira honnêtement, le jour venu, celui qu'il faudra venir secourir ou châtier. Mais, du calme, tout cela ne se trouve encore que dans votre tête de Sudiste qui n'a pas encore digéré la victoire des terroristes de Lincoln, toujours et encore la vengeance ! Rien ne prouve que votre pays n'est pas capable de reprendre son sang froid et d'envoyer balader toute cette macabre comédie.
|

|
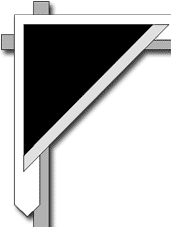




![]()