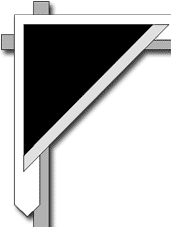
|


|
Mardi 10 juillet 2001
Lisez bien la date. Oh ! Elle n'a rien de spécial, comme ça, bien que chaque jour qui commence est un jour spécial (subjonctif ? Non, car ici le subjonctif enlèverait quelque chose à la force d'affirmation de la proposition), chaque jour est le dernier jour, le grand jour, le jour qu'on attend depuis toujours, et toutes ces sortes de chose. Tenez, il y a deux jours je me suis réveillé à la même heure, six heures, et dans ma boîte aux lettres il y avait un message m'annonçant le décès de ce qu'on appelle un vieil ami. Je connaissais Pierre depuis 1968, et si vous avez déjà lu quelques lignes de mon Journal, vous devinez dans quelles conditions nous nous sommes rencontrés. Pierre, de son nom Bernard, est mort en Mauritanie, dernier avatar de sa curieuse carrière de démographe. Comme ça, un infarctus, à soixante et un ans, dans un pays trop éloigné de Paris pour qu'il ait une chance de survivre. La première et la dernière maladie que je lui ai connue, c'était son dernier jour. En ce moment son corps attend la crémation au Père Lachaise, quelle connerie ! J'ai parlé à sa veuve, une amie très chère, ex-professeur de philosophie au Gabon et grande femme devant l'éternel pour laquelle j'ai beaucoup de peine. Pierre est mort de sa vie, il est mort d'avoir ignoré la première phrase de ce texte, vivant toujours dans un projet, toujours un peu à côté du présent, légèrement décalé dans une tension vers l'heure qui suivait, et pourtant toujours entièrement présent. A Nouakchott il était allé réformer l'Education Nationale mauritanienne qui tentait d'essuyer quelques décennies d'incurie arabisante en rétablissant le français comme langue principale. Son présent était un futur. Disciple d'Alfred Sauvy, Pierre fut une sorte d'inventeur génial et peu reconnu, le genre d'invention qui coûte au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer en angoisses intimes et en veilles interminables et ne rapportant strictement rien tant elle ne fait qu'agacer ceux qui auraient à s'en servir concrètement. Pierre était une sorte d'autodidacte universitaire, paradoxe vivant d'un intellectuel fourvoyé dans une discipline aride dont il ne voulait admettre ni la valeur symbolique, parce qu'il n'avait pas suffisamment le sens de la vérité symbolique, ni la valeur vénale et politique parce qu'il était trop honnête ou trop fier. Son invention est pleine d'enseignements. Il avait mis au point un calcul informatique de la déperdition scolaire, c'était sa première mission au Gabon, où il avait été recruté par l'Unesco comme conseiller technique. Ayant découvert rapidement le vide absolu qui s'était creusé dans le système éducatif de ce petit pays alors prospère grâce à son pétrole, Pierre s'est mis en tête d'aider vraiment les autorités de Libreville afin de donner un sens à leurs investissements dans l'Education. Ce vide était l'absence de finalités pratiques des études des jeunes Gabonais. Dans ces années soixante dix, il était devenu évident, comme dans tous les autres pays de l'ex-Afrique coloniale française, que le système éducatif parisien, importé tel quel d'Europe, était complètement décalé par rapport aux besoins de développement du Gabon. Ce résultat était devenu patent lorsque le dernier diplômé de ce pays eu rejoint le dernier poste d'enseignant disponible, d'enseignant ou de fonctionnaire de l'état. Mais comme toujours dans ce genre de pays essentiellement artificiel, la valeur de son diagnostic n'a rien changé, les résultats de ses recherches ont surtout gêné les autorités, et Pierre a fait comme tous les intellectuels français, il s'est réfugié dans l'enseignement de la démographie et Dieu sait si l'enseignement n'était pas sa tasse de thé. En France tout finit toujours par un cours magistral. Heureusement pour lui il avait quelques passions annexes, et je dois dire avec quelque admiration, qu'il savait soigner ses passions avec la même entièreté que son travail. Pierre était fou de coquillages et de chasse sous-marine, passant des heures dans les eaux troubles de l'Atlantique africaine en remplissant le soir venu son congélateur de capitaines et de barracudas appétissants et en étalant soigneusement ses nouvelles découvertes conchylicultrices dans son petit laboratoire où régnait une forte odeur de formol et de chlore. L'amateur était devenu un professionnel et je me souviens combien il avait peiné pour que sa collection prenne place dans un document devenu un must pour spécialiste. Il existe même un coquillage qui porte le nom de mon ami, une espèce qu'il avait découverte dans l'Océan Indien et qui n'avait pas encore été décrite. Cet amour qu'il a cultivé avec tant de fièvre patiente était sa philosophie profonde, sa méditation sur les formes et la beauté inutiles du monde. Un jour il m'a dit dans un sourire superbement ironique : - " j'ai mis trois jours à révéler les couleurs de cette porcelaine, à quoi pouvaient bien servir ces décorations là où j'ai trouvé ce coquillage, recouvert de boue ? " - Il parlait de lui, bien sûr, du sens de la beauté qui n'avait de comptes à rendre qu'à son moi, dans le genre : - "je sais bien qu'on ne voit pas combien je suis beau, mais ça m'est bien égal, le seul ennui c'est que personne ne fera ce que je fais pour aller y voir" - Erreur mon pote.
Son seul défaut, il faut en parler, était la peur de vieillir, une peur qui l'a mené un temps à se calfeutrer dans un poste de prof à la Fac de Lille, mais il n'a eu de cesse de se trouver une nouvelle aventure dans laquelle il pourrait rassembler ses soucis spirituels et son amour des corps. A l'heure où j'écris je pense que j'ignore encore largement dans quels nouveaux pétrins culturels et politiques Pierre s'était engagé là-bas en Mauritanie, mais je suis sûr qu'il y avait là matière à structurer le temps de quelques siècles, tant Pierre craignait l'ennui plus que tout au monde. Quand il me parlait de son père, il se décrivait lui-même, un homme qui usinait le temps avec l'application et le soin d'un horloger suisse, ne laissant rien ou presque au hasard et s'engageant tout entier, ne laissant que peu de place à l'improvisation si ce n'est dans sa vie intime où il perdait si rapidement pied qu'il cherchait alors à s'installer dans une distance difficilement franchissable par ceux qui l'aimaient. Et en vérité, Pierre a été un de ces amis qu'on aime malgré soi, non pas par curiosité comme cela arrive parfois, mais parce qu'il en imposait par son volume, je dirais, ontologique. Toute sa personne était toujours présente où qu'il soit et quoi qu'il fasse ou dise, avec cette autorité naturelle qui ne laisse guère de place à autrui et qui le rendait souvent imbuvable, c'était un homme libre.
En croyant terminer par cette belle chute cette première nécrologie de ma carrière littéraire, je me suis rendu compte que je n'avais pas soufflé un mot de la passion cachée de Pierre pour la Révolution sociale. Il faut bien dire que c'est une tâche bien au-dessus de mes moyens, tant cet éclairage est délicat à manier. Pierre se disait volontiers enfant de prolétaires, et de fait la situation de ses parents confirment totalement cette affirmation, à cela près que son père était petit fonctionnaire de la SNCF, si je me souviens bien. A cela près, mais encore à beaucoup d'autres choses que l'on pourrait trouver dans son roman familial. Le père de Pierre était un bâtard de l'aristocratie de sang bleu, et cette découverte avait un temps fortement troublé mon ami. Car Pierre ne s'était pas trouvé par hasard sur les barricades de Mai68 en ma compagnie, dans des conditions fort étranges tant elles reflètent le côté paradoxal de sa personnalité. Avant ce printemps historique, le fils de cheminot avait milité dans les rangs de l'extrême droite, oh ! Sans doute peu de temps, le temps de découvrir le néant spirituel de ce reliquat de l'histoire de France et de se retourner d'un bloc, comme toujours, dans l'autre camp de la Révolution. Ce thème a tenu une grande place dans notre relation, et je pense avoir toujours passé pour sa référence en ce domaine, m'y laissant une place qu'il n'avait pas l'habitude de concéder dans la plupart des autres. Et en fait, son idée de la Révolution et du progrès historique rejoignait très largement la mienne, nous avions tous les deux le même amour aristocratique pour l'émancipation de l'homme ou, pour le dire autrement dans la dialectique que nous affectionnions, l'émancipation de l'homme comme finalité aristocratique de la vie. Nous n'avions, lui et moi, que du mépris pour tous les grouillots de l'activisme politique, non pas pour les sans-grade ou les petits, mais pour les serviteurs zélés de la médiocrité socialisante. Antistaliniens nous l'étions spontanément, sans passer par les enquêtes véritatives sur les crimes du moustachu de Géorgie qui ne nous intéressaient en rien. Nous vomissions tous les partis qui se réclamaient de quelque léninisme ou trotskisme que ce soit, de quelque pédagogie ou autre conscientisation révolutionnaires. En bref, nous surfions avec le même enthousiasme sur la crête d'une vague aux flancs contradictoires et équivoques, le premier couvert d'analyses de classes et de rapports de production, l'autre de fantasmes flamboyants du sujet absolu de l'Arétè grecque. La Révolution, oui, mais dans le sens des vertus aristocratiques et le plus loin possible de la médiété consternante des clubs de la Gauche classique. Ce n'est pas un hasard si nous nous sommes retrouvés, tous les deux, sur des positions de type situationniste. Pierre a été l'une des rares personnes qui furent témoins de mes rapports avec la bande à Debord, rapports faits du refus de l'aristocratisme Debordien, sous-espèce d'un stalinisme affectif à la cardinal de Retz, et en même temps d'un excès de raffinement qui me renvoyait à mille lieux de toute relation politique exploitable ou seulement tenable. Comme moi, Pierre avait déserté le monde politique pour se promener dans la vie qui malgré tout se tenait là, demandant à être remplie et vécue. Sans abandonner ses convictions. Mon seul regret est qu'il parte maintenant, au moment où le monde va à nouveau trembler, me laissant quasi seul pour vivre cela dignement. Oh ! Allez, il me reste bien Idalina, sa précieuse compagne, belle et grande révolutionnaire elle aussi, de ce monde perdu des anciennes colonies portugaises. Non ?
Jeudi 12 juillet 2001
Qui suis-je, à l'heure qu'il est ? Un être étant ou bien un être écrivant ? Difficile à dire avec certitude. Mes journées se passent dans cette forme d'oisiveté qui m'est propre quand je vis en société, c'est à dire une agitation continue, perlée de périodes de retrait dans le sommeil ou de partage des passions du temps, le pain et les jeux. Le matin seulement le retrait prend une autre forme, une forme de miroir dans lequel je peux me voir assez distinctement. Bon, mes ennuis "administratifs" ne sont toujours pas terminés, sinon que tout est décidé et qu'il n'y a plus aucun suspens. Mais je suis toujours piégé par cette situation, ne pouvant rien entreprendre tant que la dernière signature n'aura pas été apposée au bas du dernier document. Attendre, et cette attente semble décanter au-delà du raisonnable mes sentiments quant au futur. En gros je me sens de plus en plus précisément engagé dans une alternative somme toute assez simple, et dont la simplicité ne manque pas d'intérêt. Ou bien je reste engagé dans un secteur de la praxis sociale et historique, ou bien je me retire totalement. Tout ou rien, en réalité il s'agit d'un dilemme et non pas d'une alternative. Une troisième voie clignote comme ça entre deux lignes, qui consiste à ne rien entreprendre du tout et à m'installer dans un vécu spontané mais aligné sur une imitation du consommateur : chercher un logement au calme et m'oublier dans un temps cyclique des saisons. A priori cette dernière solution me paraît sans issue, et pourtant elle prend parfois de la consistance dans mes méditations et cela me paraît digne d'étude.
En effet, cette dernière éventualité ne semble correspondre à rien de ce dont je me fais une représentation devant me convenir, c'est une dimension que je ne connais pas ou bien que j'ai oubliée, il y a bien longtemps. Vivre, quoi, sans me poser de questions, dans un retrait (la retraite) qui n'en est pas un, dans un vivre avec les autres juste ce qu'il faut, justement de cette façon faussement "sociale" que je n'arrête pas d'analyser et de critiquer. Reconnaître mon échec à magnifier ma vie en recherchant la fameuse médiété d'Aristote. En évoquant cette possibilité ma première réaction est le rejet, et puis une chose m'apparaît dans une lumière très crue, c'est que ce rejet est précisément ce qui me constitue depuis toujours, du moins depuis que j'ai entrepris de vivre seul. Que signifie, cependant, l'expression "me constitue" ? Ou plutôt, qu'en sais-je ? Est ce que je me connais assez bien pour affirmer cela avec tant de force, ou bien s'agit-il d'une fausse connaissance reposant sur la fossilisation d'une expérience particulière ? Autrement dit, suis-je allé assez loin dans la connaissance de moi-même pour gouverner mon comportement avec tant d'autorité ? Et si je me trompais ? Et si c'était cette même erreur qui m'entraîne depuis si longtemps dans la situation d' écorché vif que je suis pour moi et pour mon entourage (encore un préjugé ?) ? A vrai dire, cette question me taraude depuis longtemps, et depuis longtemps je me retrouve à chaque fois dans l'incapacité de répondre clairement. Il me semble qu'à chaque fois que cela se présente, ma réponse soit la même : de toute façon je n'ai pas le choix. Et il faut bien avouer que mon autonomie est faible par rapport à tout ça, c'est quelque chose de viscéral. A bien y réfléchir, c'est là tout le cadre stratégique et tactique d'une vie d'intellectuel, habitué à tout passer au peigne fin de sa conscience, comme le fameux mille-pattes qui doit marcher malgré sa conscience.
Oui, il est trop tard pour remettre en question la question globale du goût, et pourtant je ne suis pas sûr qu'il ne s'agisse pas de préjugés bien ancrés. D'autant plus qu'il y a une autre question qui se profile toujours en position corollaire : le présent n'est jamais un temps absolu, ni du point de vue social, ni du point de vue psychologique. Il est toujours historique, toujours à une certaine température d'événement, plus ou moins éloigné d'une transformation ou d'un bouleversement, toujours déjà engagé dans l'effectuation d'une volonté particulière. Or le degré même de mon dégoût pour l'étant présent est une indication de ce degré de décomposition historique et ce que je nomme plus haut "engagement" n'est peut-être, et même certainement rien d'autre que la patience d'attendre. En réalité, et cette conclusion prouve que nous avons un peu avancé, le dilemme sus mentionné fait référence à une autre question, celle de la position active que je pourrais ou non occuper dans les transformations qui s'annoncent. Ma préférence irait bien entendu pour une préparation intellectuelle de ce qui va faire trembler le présent, une sorte de mobilisation des esprits. Mais ne disions nous pas que la théorie se baigne dans les masses et non pas dans la cervelle de quelques diplômés ? Que faire? Inutile de s'appeler Lénine pour accepter la pertinence de cette question. Elle est nécessaire, hic et nunc. Nous y reviendrons.
Samedi 14 juillet 2001
Ecrire sur Chirac. Quelle idée ! Et pourtant cela appartient aux genres de mon métier, le portrait, la critique politique ou encore la nalyse comme disaient les Guignols. Mais écrire sur Chirac ? Mission impossible. Que peut-on dire de ce bouffon de l'histoire de France ? Attention, être un bouffon dans l'histoire de France n'est pas forcément négatif, Coluche aurait très bien pu devenir comme lui, locataire de l'Elysée. Possède-t-il une seule référence dans cette histoire ? Qui ? Le général Boulanger ? ou peut-être en forçant le trait Badinguet-Napoléon ? Nixon ? Guillaume II ? Difficile d'établir le moindre parallèle. Et c'est sans doute la seule raison pour laquelle un tel exercice me paraît aujourd'hui d'un certain intérêt. Ce personnage, j'hésite à dire Président de la République, est un personnage nouveau dans la série des personnages dits historiques. C'est déjà ça, et le montrer est déjà un bon programme.
Bon, que sait-on, ou que dit-on aujourd'hui de Jacques Chirac, dont je vous épargnerai évidemment la vraie biographie avec son papa cadre supérieur et sa dixième place à l'ENA? Ce que l'on sait peut se diviser en trois phases : primo, ce que j'ai toujours nommé sa "mise au point" ou son lancement. Pour qui connaît la vie politique française de l'intérieur, la réussite est toujours le produit d'un complot, ou bien à tout le moins d'un parrainage. Et ce fut bien le cas de Chirac que deux personnages de l'ombre ont porté sur les fonds baptismaux de la Droite française, une femme qui tenta tardivement et par dépit d'entrer en concurrence avec lui, Marie-France Garaud et un autre personnage de l'ombre, co-rédacteur du fameux appel de Cochin, Pierre Juillet, baron du gaullisme pompidolien. Une affaire pénible mais qui avait beaucoup de raisons de s'avérer payante à condition de réussir à le faire parvenir à ce fameux fauteuil de Président de la République inventé par le général après son retour à la vie politique en 1958. Il n'y a pas de doute que l'homme a séduit globalement ces décideurs souterrains qui préparaient l'après de Gaulle : Chirac possède de vraies ressemblances, idiosynchrasiques dirais-je, avec l'homme du discours du 18 juin. Et d'abord cette double personnalité ésotérique et exotérique qui font de Chirac à la fois un habile politique en sous-main, et à la fois un personnage entier et folklorique qui sait se faire passer pour l'esprit du temps tout en affirmant sa singularité sans peur et prendre des décisions à contre-courant, rappelons-nous la reprise des essais nucléaires, il fallait le faire. En bref, Chirac allie la faconde chaleureuse et toujours soigneusement calculée, comme les mots du général, à des pratiques politiques aussi florentines que celles de Mitterrand s'il ne lui manquait l'essentiel, savoir la finalité de ses décisions. Ses deux sponsors avaient de bonnes raisons de le pousser et ses brillantes prestations lors de mai 68 ont eu de quoi les rassurer sur leur choix. En effet, Jacques Chirac fut un des rouages les plus subtils et les plus efficaces de la défense du gaullisme menacé par la rue. Fort d'un quasi anonymat de haut fonctionnaire de cabinet, il a d'abord bien choisi son camp, celui de Pompidou, puis il a créé des ponts entre les adversaires, accéléré et influencé des négociations avec les syndicats, négociations qui furent, comme on le sait, la clé de la sortie de crise. Lorsqu'il est entré à l'Elysée sur les pas du Général, le président Pompidou pouvait dire : - bien travaillé Chirac ! -. Ces détails n'ont été publié que bien plus tard, ce qui montre la discrétion dont a su s'entourer notre homme au moment où il le fallait. J'avoue que lors de cette grande fête je n'ai guère entendu parler de Jacques Chirac, qui entamait alors son amitié de trente ans avec son futur adversaire, tout aussi inconnu alors et qui se distingua également dans les négociations brûlantes de Grenelles. Comme quoi mai 68 restera certainement le test central dans la distribution des cartes politiques de la Droite pour les quarante ans à venir.
Tout cela ne faisait encore de Chirac qu'un bon candidat pour la rampe de lancement des politiciens futurs, un homme d'envergure et de ressources. Son flirt avec le Parti Communiste dans sa jeunesse lui avait donné juste la mesure de lucidité qu'il fallait pour savoir qui trahir le moment venu à son profit. Il était prêt pour la gloire de la Droite. Malheureusement, Chirac était trop entier, son côté rabelaisien et la violence de ses impulsions pouvaient séduire au contact, mais le drame de ses parrains était qu'il ne passait pas l'épreuve de la publicité : Chirac faisait peur à la télévision, les sondages se sont multipliés en se ressemblant pendant vingt ans. C'était devenu un chapitre dans la formation des stagiaires du journalisme qui s'intéressaient à la nouvelle science des sondages, Chirac ne passait pas, c'était un mystère agaçant et cruel pour celui qui était devenu la mascotte de la droite française. C'était son image concrète, son visage avec ses lunettes d'ingénieur et ses tics semble-t-il irrépressibles qui dénonçaient quelque chose de terrifiant. Bref, le Téléfrançais n'arrivait pas à se laisser séduire par la personne, ce qui donna ses chances à un autre artisan des accords de Grenelles, son rival et adversaire de toujours, Giscard.
Echec et mat ? Non, car il va se produire l'un des phénomènes politiques les plus inattendus qu'on puisse imaginer : ce furent ses adversaires les plus mordants qui le mirent en selle ! Oui, pendant plusieurs années de suite, les Guignols de l'Info, partie essentielle alors de l'émission satirique et humaniste de Philippe Gildas, Nulle Part Ailleurs, ont tissé jour après jour un portrait tellement ridicule, tellement blessant pour la personne de l'alors Maire de Paris, qu'il finit par faire pitié. Les Guignols ont gommé en quelques mois l'aspect agressif de Chirac, cette image qui nuisait si puissamment à sa carrière. Rien de tel que la pitié pour faire oublier les lunettes et les tics, dont entre-temps Jacques était parvenu à se débarrasser tant bien que mal. Dans le même temps il exerçait à la Mairie de Paris des mandats on ne peut plus gaulliens pas leur mépris pour l'exactitude de l'intendance (encore qu'il s'agisse ici d'un mythe bêtement répandu par la Gauche elle-même, car De Gaulle était fort loin d'être le gribouille que l'on dit quand il s'agissait de gestion de sous). Des mandats dont il aura, comme on le voit aujourd'hui, beaucoup de mal à se remettre, sans doute plus que de sa mauvaise image. Il y a aujourd'hui une sorte de cumul destructeur entre l'idée folklorique que l'on se fait de Chirac, et la valse des millions qui l'a entraîné bien trop loin dans sa distraction régalienne de maître. Il oubliait alors qu'il était un maître de la République et non pas d'un pré-carré privatif. Mais il s'agit là du véritable instinct des hommes de droite, l'impuissance à se garder philosophiquement des petits et grands plaisirs de la vie par une sorte de sentiment de l'honneur fourvoyé : moi, Chirac, je ne mégote pas, jamais, même avec les deniers du Peuple. Ce problème de la corruption à ce niveau est très intéressant, car il est inhérent non pas à la République démocratique ou à la Démocratie elle-même, mais à tout exercice du pouvoir. Les exemples de la Gauche comme ceux de la Droite montrent que le pouvoir est en réalité VIDE de sens lorsqu'il n'est pas strictement limité aux impératifs de la guerre (raison pour laquelle les démocrates n'ont pas osé y toucher en Mai 68, se trouvant alors au plus près des analyses sérieuses du pouvoir). Le pouvoir, ne se concrétise vraiment que dans la corruption, il est essentiellement pouvoir de dépenser la richesse. Bien sûr, tout choix budgétaire peut d'office se voir décrit comme d'essence corruptive, et c'est pourquoi toute la science politique actuelle réside dans la médiatisation des motivations financières et non pas dans l'effectuation des politiques. Aussi faut-il préciser que la pratique politique elle-même ne se laisse pas définir simplement par la notion de pouvoir, il existe heureusement un esprit politique qui ne doit rien aux ambitions privées des individus.
Avec tout cela, il va falloir assumer la troisième phase, celle de la réussite à la Pyrrhus d'un Jacques Chirac hors d'haleine et politiquement ruiné. Car entre-temps son camp s'est littéralement désagrégé sous la double action d'un décrochage du politique de la sphère économique, par le truchement de l'internationalisation des entreprises (la disparition des Deux Cents Familles), et par cette personnalisation à outrance du pouvoir qu'est venue renforcer le nouvel appareil médiatique. En politique, la correction habituelle exige la prudence, pas question de voir des bouleversements là il n'y a que de minuscules évolutions. Des analyses de la Droite française comme celle de René Rémon, veulent montrer que ces évolutions sont imperceptibles et que les forces politiques d'un pays passent en général le cap du temps sans bouleversements majeurs. De Gaulle / bonapartisme, Giscard / légitimisme, Chirac / Boulangisme, bref, nihil novi sub sole. Ce n'est pas ce que je pense, et je crois pouvoir affirmer que l'analyse du personnage Chirac prouve le contraire, c'est à dire la proximité d'une catastrophe majeure pour la Droite française. Evidemment, le contexte européen a changé, déjà, beaucoup de choses, ainsi que la dépendance de plus en plus importante du marché mondial. Mais les mois qui viennent devraient aboutir à des révélations assez dures pour tout le monde, peut-être à une crise majeure que précisément le contexte européen aura le plus grand mal à maîtriser. Car il faut bien dire à propos de Chirac que son principal défaut est sa manière de faire partager par le monde sa propre incurie intellectuelle personnelle. En réalité, ce représentant du Peuple ne sait pas du tout où il va, ni où il veut aller. Son instinct d'homme de droite à la française ne lui conseille rien d'autre qu'un vague suivisme mondialiste des idées libérales de la droite mondiale ambiante. Mais cette droite n'existe pas : il n'existe de Droite stricto sensu que française et ce précisément parce que c'est le seul pays au monde où existe une opposition intellectuelle réelle, avec sa propre morale et ses propres stratégies, mais surtout avec ses institutions rigoureuses et qui ne pardonnent aucune incurie. L'exemple le plus drôle de cette sorte de j'menfoutisme de Chirac n'est pas sa dissolution, bien qu'à elle seule elle prouve que Chirac ne possède pas la moindre boussole politique et encore moins historique. Le bon exemple est la politique mise en chantier par son ombre Juppé, fidèle suiveur depuis toujours des tendances ultra-libérales initiées par Giscard. Quel surprise mortifiante ! Avoir cru pouvoir bouleverser en quelques tours de passe-passe pseudo démocratiques tout un acquis social séculaire ! Quelle naïveté, mais surtout quel manque de respect pour les électeurs qu'on a cru pouvoir motiver par des mots d'ordre aussi hypocrites que la fracture sociale pour s'empresser de les soulager de leurs maigres avantages de salariés les plus mal payés de tout le monde développé !
En fait, et pour conclure, Chirac est paumé. Ses relations avec les Grands de ce monde n'ont même pas la clarté que peut avoir le mandat d'un Madelin au service du groupe Rockfeller. Son pas de clerc en direction des écologistes montre deux choses. D'abord qu'il n'a plus rien à dire, que sa volonté idéologique est creuse et que la mode a entièrement envahi son sens de la stratégie politique, il botte en touche. Mais le plus clair dans ce choix, est sa névrose d'échec, le preuve qu'il en est arrivé aux tout petits calculs électoraux, les plus minables équilibres intellectuels où la neutralité affichée devrait venir sauver les errements indéchiffrables du passé. Qui est (aura été) Chirac ? Bien sûr le symptôme de la déroute de la Droite française, de la fatigue des Français pour le parti des maîtres qui ne savent plus être les maîtres. En un sens le piège de Mitterrand a magnifiquement fonctionné. Non pas sa machine infernale Le Pen, mais sa complicité avec le capital qui a brouillé les cartes de l'appartenance politique du patronat. La social démocratie à la Mitterrand a fait beaucoup de mal à l'antique caste des possédants qui avaient su si bien asseoir leur pouvoir, entreprise par entreprise, commune par commune, circonscription par circonscription. On voit bien ces derniers temps revenir en scène tous les représentants de ce temps béni des Familles Riches. Qui est Antoine Seillères ? Un héritier, non pas d'une fortune familiale, mais des énormes indemnités versées par la République aux faillis de la sidérurgie. Le roman des De Wendel reste à faire, de même que celui des héritiers du PLM, ces scandaleux rentiers des approximations de la République française. Mais l'apparition sur scène de ces gens-là correspond très exactement au temps politique d'un Jacques Chirac : d'un côté un homme prêt à trahir n'importe quel camp politique au nom d'un narcissisme de plus en plus affirmé, de l'autre les loups du capital, la harde de fauves qui se partagent des restes depuis déjà plusieurs générations et qui se contentent de spéculer au lieu de créer des biens et des gains. On dit de Chirac que c'est un brave homme. Peut-être qu'il l'est, et rien ne permet d'en douter. Mais une chose est sûre, il n'est pas un honnête homme au sens du Grand Siècle, non pas parce qu'il a mal dépensé quelques deniers publics, mais parce qu'il n'a pas assez cultivé son esprit. Homme pressé, trop pressé, il n'a jamais pris le temps de penser le monde dans lequel il brigue tant de responsabilités. Mais même cela ne serait pas encore trop grave si à l'instar d'autres Chefs d'Etat il était capable de bien s'entourer. Or la vérité est qu'il n'a pas le goût ni la passion de l'esprit, malgré ses mises en scène d'amateur de poésie, et cela seul le disqualifie à tout jamais.
En relisant ce texte à quelques heures de son écriture, je me rends compte qu'il aurait encore fallu dire bien des choses, notamment sur la pseudo affinité de Chirac pour les paysans de France. Mais pour ceci comme pour tout le reste, Chirac n'est qu'un fidèle suiveur de toutes les politiques des diverses droites. On n'oublie pas que la paysannerie, ou ce qu'il faut appeler aujourd'hui les rurbains, forment le dernier bastion électoral de la droite française. Mais là aussi Chirac devra refaire ses calculs, les calamités sanitaires et écologiques ont bien modifié l'impact des vrais exploitants agricoles sur leur environnement immédiat. Les paysans ne sont plus que quelques centaines de milliers dans notre pays, et ils sont désormais seuls. Si j'en ai le courage, je tenterai ces jours-ci un portrait psychologique subjectif du personnage.
Dimanche 15 juillet 2001
Allez ! Pas de raison que ça traîne, j'ai pu le voir hier soir sur le petit écran, plus à l'aise que jamais dans sa nouvelle peau de menteur psychanalysé. Quel talent de bateleur, un homme qui passe à travers les questions les plus brûlantes et les plus dangereuses avec autant de mépris que de sentiments si habilement contrefaits. Nous avons attendu longtemps pour avoir un tel bandit à la tête de l'état, mais à présent il est bien là, et il semble qu'il aie compris quel parti il lui restait à prendre s'il voulait conserver une chance pour l'an prochain : la mauvaise foi et le chantage à son propre camp politique : ou bien vous me soutenez sans états d'âme, ou bien vous êtes foutus, nous sommes tous embarqués dans le même esquif et mes fautes passées n'y changeront rien !
Mais restons dans le registre de la psychologie, et de la psychologie subjective. Je vais donc tenter de décrire comment s'est développé en moi l'image actuelle de Jacques Chirac, par quelles étapes elle est passée et en quoi cette image me concerne très intimement, en tant que contemporain de ce personnage.
Dans ses débuts d'homme politique, je crois être passé par les mêmes sentiments que la majorité des Français si j'en crois l'histoire des sondages dont j'ai parlé plus haut. Avec une petite différence, c'est que dans les années soixante finissantes et les années soixante dix, il ne me faisait pas peur, mais me paraissait hautement ridicule. Il personnifiait pour moi toute une classe de technocrates à têtes et lunettes carrées, ridiculement couvert de vêtements tellement conventionnels qu'ils démentaient toute prétention à incarner le moindre changement. Il y avait contradiction entre la fougue du Corrézien et la sémiotique qui se dégageait de son allure, et à ce jeu Giscard d'Estaing n'a pas eu de mal à le battre à plate couture : en fait Chirac faisait ringard, on pouvait sentir qu'il n'était pas bien dans sa peau, ou dans celle que ses mentors avaient fabriqué pour lui. Conséquence logique de cet état de fait, ses messages semblaient aussi creux que son allure, il ne disait rien, rien de vraiment de droite et rien d'autre, il se contentait de piaffer en briguant bruyamment le pouvoir, n'importe quel pouvoir.
Et c'est bien n'importe quel pouvoir qui lui échut, tant il manquait à cette époque de sens de la modernité. A sa décharge, et tous les Français ont fait cette analyse à l'époque, il faut bien reconnaître que l'ombre du Commandeur était écrasante. Le Général De Gaulle ne laissait aucune place idéologique claire et être gaulliste à cette époque relevait de l'exploit, au sens où d'une part il était impossible de faire une politique avec une simple allégeance, et de l'autre encore plus risqué d'installer le gaullisme dans une idéologie clairement définie pour s'en réclamer. Il fallait faire avec le flou artistique d'une politique de courtisans d'un homme certes exceptionnel, mais qui n'avait ni le goût ni la volonté de fabriquer une usine à gaz d'idées toutes faites. L'ennui avec De Gaulle est que tout en demeurant un pur représentant de l'oligarchie, il avait le don de fasciner une grande partie de la classe moyenne par son côté Robin des Bois. Mais que faire avec cette série d'actes politiques inclassables dont le principal paramètre a été la répugnance profonde du général pour tout ce qui venait d'outre-Atlantique. Après la Seconde Guerre mondiale, il était facile d'être de droite en Allemagne ou au Japon, il n'y avait qu'à suivre le regard de Washington, mais allez donc défendre le capitalisme de manière cohérente tout en critiquant le pays qui en était devenu la maison mère ! Redoutable ambiguïté dont le général jouait avec plaisir et talent, mais qui ne se laisserait pas aussi facilement gérer par les disciples. Seul Giscard avait fait les choix économiques clairs : tiersmondiser la France au nom de la logique des marchés.
Chirac, lui, était devenu Maire de Paris, une raison de plus pour que je m'en désintéresse totalement. Il était devenu pour moi un outsider de la vie politique, une sorte d'éternel candidat à un pouvoir qui ne cessait de se dérober, et qui n'avait aucune raison de lui offrir la moindre chance. Et puis son image ringarde ne progressait pas d'un poil, comme si son gaullisme énigmatique le tenait en retrait du mouvement réel, toujours ce vide idéologique qui n'était pas près ni prêt de se voir rempli. Si je fais un effort d'invention, je dirais qu'en tant que Maire de Paris Chirac a géré son acné d'adolescent capitaliste à l'aide des crottinettes, vous savez, ces machines ridicules pour déjection canine ! Comme on presse ses points noirs, beurk. Pourtant cet homme handicapé par son allégeance à l'image franchouillarde du général, a su faire ses classes de suiveur du peloton droitier, appliquant brillamment à Paris même les principes fondamentaux du capitalisme sauvage : éjection des classes moyennes et modestes du Paris intra muros, ouvertures toute grandes des portes de la spéculation immobilière internationale. Dans ce domaine, Chirac a même fort bien réussi, à Paris la crise de l'immobilier de bureaux a été l'une des plus sévères du monde entier, seuls les Japonais ont fait mieux, une manière comme une autre de se faire la main... Il faut que je reconnaisse ici que ses succès électoraux dans la capitale sont restés pour moi un mystère. Il y avait bien d'un côté cette clientèle typiquement plébéienne qu'incarnent si bien les bistrots parisiens et le petit entrepreneur - artisan, et de l'autre le bourrage des urnes dans lequel les Tibéri se sont fait un nom, mas cela ne suffisait pas à expliquer cette main - mise sur le cœur de notre République. Quand tous les souvenirs seront revenus, que l'on se sera représenté exhaustivement à quel point la bande à Chirac à mis cette cité à feu et à sang, on comprendra beaucoup de choses, dont la moindre n'est pas le développement de la violence partout dans le pays, dans un pays qui a toujours eu tous ses regards tournés vers sa capitale. Ce n'est pas un hasard si ce motif de l'insécurité va sans doute se trouver au centre de la campagne électorale à venir, Chirac joue ainsi son va-tout, son bluff ultime dont le jeu consiste à rejeter sur son adversaire la responsabilité de ses propres erreurs. Il suffira que ce gambit du Maire de Paris passe pour que tout le passé politique de Chirac se voit légitimé une nouvelle fois au grand dam de ce qui reste de gens vertueux en France. Le Chirac écologiste d'aujourd'hui joue le même jeu, avance la même figure de poker : qu'il réussisse à se faire passer pour le mécène de l'écologie ou pour le phénix des hôtes de cet environnement, et on oubliera aussi sec qu'il fut celui qui encouragea avec rage et entêtement l'invasion quotidienne de Paris par les hordes de cafards à essence ou diesel, véritable peste moderne. Mais ce que les braves gens ignorent en général , c'est que cette politique d'encrassement systématique des villes n'était pas la faute à personne, une fatalité du progrès, mais bel et bien une politique consciente et organisée à partir de bons bureaux climatisés ! Il suffit de rappeler le cri hebdomadaire de notre bon Pflimlin à Strasbourg : - Il faut encourager l'industrie automobile par tous les moyens ! -, et parmi ces moyens la liquidation massive des transports en commun.
La cohabitation ! Ah la cohabitation, quel cauchemar pour le journaliste que j'était devenu. Et quelle leçon de science politique pour l'éternel adolescent Chirac ! C'est un des paradoxes de la rivalité gauche - droite que de se dire que Chirac aura été à l'école du génie mitterrandien, et qu'il en tiré un énorme profit. D'après ce qui ressort des Verbatim d'Attali, le président et lui avaient de fort bonnes relations personnelles. Mitterrand avait une sorte de faible pour le grand dadais, son apparente sincérité et sa maladresse constante charmaient le vieil homme fatigué par la routine et prêt à se laisser avoir comme les Français le risquent en ce moment. Car sa force de séduction est vraiment grande, j'ai moi-même eu l'occasion de la "sentir" alors que je tentais d'organiser une interview avec le grand Jacques dans les années quatre-vingt. L'homme est d'une simplicité toute française, absolument sans les ronds de jambes ou les formules creuses qu'on pourrait lui prêter sur la foi de son image médiatique. Direct et franc, il déconcerte par son culot, se montrant ainsi pour ce qu'il est, un rude joueur de carte. Alors que Tibéri tentait en vain de me dissuader d'inviter son patron pour une interview à hauts risques, Chirac s'est emparé du combiné pour me dire franco de port et d'emballage qu'il me saurait gré de le laisser tranquille, à charge de revanche, c'était l'expression qu'il avait utilisée, une expression dont il semblait avoir une grande habitude. Par pudeur, je cacherai le thème de mon reportage qui faisait tellement peur au Maire de Paris, mais l'expédient vaut bien l'anecdote. Quant à moi j'étais bien loin d'avoir le pouvoir de forcer la décision du grand homme, chose qu'il eut l'excellent goût de ne pas me faire sentir. Habile, décidément.
Pendant les années de la première cohabitation Chirac a donc fait son miel en fait de savoir manipuler les socialistes. Et, de fait, je me suis souvent senti tout Jospin ces dernières années, imaginant très bien à quel type de comportement le Premier Ministre avait affaire. J'imagine sans difficulté aussi bien les fraternités de circonstances que les menaces cyniques dont est capable le personnage. Les deux hommes forment bien un couple, un couple monstrueux qui négocie en ce moment même son divorce. Tout tourne et aura depuis 1997 tourné autour du rythme et de la vitesse que prendrait ce processus de séparation radicale. A propos de sa toute première décision de Président de la République en 1995 qui a consisté à faire reprendre les essais nucléaires, je note que j'en fus presque admiratif. Ce "scandale" des bonnes âmes était le dernier hommage que Chirac aura rendu à la politique du général De Gaulle. Il n'était pas question que Washington profite ad vitam aeternam d'un avantage décisif pour les futures recherches guerrières, et Chirac a su affronter sans état d'âme la tempête que les Américains n'auront aucun mal à soulever à travers le monde. Je ne saurais jamais si ces ultimes essais ont eu toute l'importance scientifique qu'on leur prêtait à l'époque, et je me demande souvent ce qui aurait poussé Mitterrand à s'en passer s'ils avaient été si vitaux. Mais peu importe, même si Chirac a cru devoir jouer un cinéma gaullien à l'aube de son Septennat, il a bien joué cette partie, et c'est bien le premier acte d'homme d'état que je vois susceptible d'être mis à son compte. Bluff, toujours le bluff.
Un bluff qui arrive maintenant à son terme. Les cartes vont très bientôt être retournées sur la table de la République. Jusqu'à présent les Français ont toujours été protégé historiquement des véritables crises politiques, comme si le phénomène de la Collaboration avait instauré une sorte de neutralité formelle, qui permettait même de passer par perte et profit des coups d'état comme celui de 1958 sans que le sang ne coule dans les rues. Sans parler de Mai68. Dans les semaines qui viennent, il se révélera que les circonstances ont totalement changé : la Droite a été enfin acculée à son allégeance viscérale au capitalisme mondial, toute la droite y compris Chirac. Plus question, plus de possibilité de chercher une troisième voie, ridicule chiffon rose agité par la culotte de peau de l'Elysée pour endormir des syndicats tout-puissants et tout prêts à se la laisser compter tant la vie était bonne dans les bureaux parisiens de la CGT ou de la CFDT. Cette fois, libéralisme et social démocratie vont devoir s'affronter face à face, sans médiation, sans restes des allégeances politiques d'origine. Et pourtant cet affrontement aura d'abord lieu entre deux hommes, et c'est là la seule chance pour Chirac de tirer une nouvelle fois son épingle du jeu. Bluffant une nouvelle fois de toutes ses forces, il mettra sa personnalité en balance avec celle de Jospin, car il n'a rien d'autre à y mettre, absolument rien. Son quatorze Juillet d'hier montre clairement que c'est sur sa personne qu'il invite déjà les Français à porter leurs suffrages et non pas sur ses choix politiques. Son plaidoyer sur ses affaires consiste dans toute sa simplicité à donner au public le choix de le croire ou de ne pas le croire, manière de dire qu'il est à prendre ou à laisser tel qu'il est, c'est à dire un souverain plus libre que les hommes libres de son pays. C'est un langage que les hommes de droite entendent très bien, un langage qu'ils n'ont pas entendu depuis si longtemps qu'ils en sont comme soulagés. Enfin un homme politique qui ose s'affirmer en tant que star dégagé de tout devoir idéologique ou moral, un homme quoi, qui a des couilles et qui n'a pas peur de la meute de chiens qui tentent de le mordre au mollet de ses péchés passés. Il joue sur du velours, ce brave homme, car il est de fait que ces péchés, même s'ils ont été beaucoup plus graves et plus substantiels que ceux des socialistes, ne constituent pas un argument proprement politique, l'ad hominem risque de se retourner contre ceux qui en font état, et c'est bien la raison pour laquelle Jospin freine des quatre fers dans toute cette histoire. Pas question de passer pour un ringard qui court après des fantasmes de vertu dont il n'a cure, non pas qu'il soit malhonnête lui-même, mais parce qu'il sait que toutes ces histoires de corruption ne sont que des jeux de surfaces, les couleurs forcément irisées de toute démocratie, de tout pouvoir politique comme je l'ai mentionné plus haut.
La marge de manœuvre de Jospin est donc étroite, voire inexistante. Nous allons assister à une campagne électorale où dans le camp de Chirac tout sera fait pour alimenter le débat sur la personne, la sienne et celle de Jospin. Il faut forcer la carte du Sujet souverain, du monarque dont manque la France depuis si longtemps ! De l'autre côté Jospin sera contraint de louvoyer dans ce registre, incapable d'attaquer de front son adversaire sur la question de la moralité. Mais c'est l'occasion pour les vraies questions politiques de surgir et peut-être de trancher un débat truqué de bout en bout. Jospin jouera son jeu dans la pression idéologique, il tentera de forcer Chirac à se démasquer totalement en tant qu'homme de la Droite Internationale et non plus seulement comme le rejeton du Gaullisme. Oh, il ne faut pas s'attendre à ce que les deux hommes s'expliquent très clairement sur des sujets aussi brûlants que la protection sociale, la retraite ou la réduction du temps de travail. Mais les choses brûlent elles aussi de leur propre feu, Chirac est la dernière chance pour Wall Street de rentrer rapidement dans ses fonds (de pension), et la conjoncture fait que cette chance est fragile. Depuis dix ans le marché européen échappe à l'emprise des groupes financiers qui gèrent la manne sociale du salariat universel et chaque minute de retard représente des millions de dollars perdus, on ne peut plus attendre, on prendra n'importe qui, même Chirac. C'est clair, la Droite l'a déjà consacré comme son héraut et les quelques autres candidatures de droite ne serviront à rien d'autre qu'à replacer les uns ou les autres dans l'échelle qui descend de l'Elysée. L'avantage "humain" dont dispose Chirac (c'est un paradoxe mais c'est comme ça) va lui permettre d'être plus pointu sur la doctrine libérale, il va risquer la vérité, un peu comme ce qui a perdu Giscard. Dans le style : oui ce sera dur à cause de l'inflation, mais c'est important pour le futur. Nous allons voguer en pleine futurologie politique, mais cette fois les débats iront plus loin car les Français me paraissent vaccinés contre ces messes creuses. Jospin va devoir aussi se démasquer à sa manière et mettre franchement la marché en main à ses électeurs : voter pour le Marché américano-mondial ou pour une Europe un peu différente, un peu plus prudente. C'est cette prudence qui risque de le perdre, car dans le camp de Chirac flotte le drapeau noir de l'aventure capitaliste pure et dure, de quoi séduire les déclassés de l'histoire de France alors que Jospin risque de se croire, à tort, contraint de revêtir la tunique de Nessus de la frilosité traditionnelle d'une France résolument décalée. Mais la politique chiraquienne du panache n'est pas autant de mise qu'il y paraît car les cartes objectives sont trop évidentes dans les budgets sur-endettés des salariés. Beaucoup de signes indiquent que cette France-là est à bout de souffle et qu'elle exigera du futur gouvernement une réforme de fond qui ne pas va réellement dans le sens du vent d'Ouest.
Mardi 17 juillet 2001
Rave. Un petit mot qui gêne beaucoup de monde et qui est promis à un long et grand avenir. Dans les différents camps politiques on se creuse la cervelle pour savoir à quelle sauce accommoder cette rave qui n'a rien à voir avec la plante potagère dont on fait de la choucroute en Alsace. Pourtant elle se cultive également en plein champ, le plus loin possible de tout lieu habité et fleurit bruyamment la nuit dans le fumet des herbes étranges et de la sueur que font couler ces nouvelles ordalies. Qui sont les raveurs ? Tous jeunes ? Oui, c'est curieux, mais c'est comme si les moins jeunes n'osaient pas s'y présenter. Non pas qu'ils ne voudraient pas y participer, ils ont aussi de bon souvenirs de ce genre de fiesta sans limites, ils n'arrivent pas à oublier Woodstock. Mais, dans les Rave Parties, il y a des exigences qui ne se limitent pas au bon "move" ...
Mercredi 18 juillet 2001
Il faut savoir "bouger", c'est sûr, mais il y a autre chose, quelque chose comme un rite initiatique permanent qui promet rien moins qu'une éthique, voire une religion. Sous les dehors de jeunes fous de danse et de vertiges rimbaldiens, les raveurs préparent une nouvelle praxis, une nouvelle manière d'être en scandant de cette manière leur temps de vivants. Patrick van Eerstel décrit dans son livre intitulé "Le Cinquième Rêve" le cercle magique que finissent par tracer les rythmes africains au plus profond des pratiques sociales de l'ancienne Afrique. La Rave est une recherche de ce cercle-là. Mais d'abord elle est plus simple : elle condense une autre pratique, celle de la consommation. Ce qui frappe d'abord est le dépouillement certes ultra sophistiqué que revêtent ces cérémonies. Pas de décors, que de l'espace et des machines à sons. Pas d'organisation ni de lien apparent avec le monde normal, chacun vient vivre une aventure réglée d'avance, mais où tout peut arriver dans la forme la plus sobre. Plaisir de s'abandonner au rythme, aux vertiges de la drogue, du plaisir sexuel lui aussi dépouillé de tout falbala littéraire, d'un temps radicalement autre, loin de toute récupération marchande ou insertion dans les cycles complexes de l'évolution culturelle. On vient consommer un produit fini, stable, homogène et fiable à cent pour cent. On vient s'insérer dans un temps immédiatement consommable, sans protocoles et sans conséquences, sinon les dangers que représentent l'intempérance possible. Mais même dans ce domaine, les raveurs ont appris à prendre leurs précautions et on peut maintenant voir dressés au milieu des champs en friche des stands de secourisme très spéciaux, consacrés à l'hygiène des toxiques, si l'on peut dire... La société, elle, assiste paralysée au phénomène, tout simplement parce qu'elle n'a pas mieux à offrir et qu'elle sent bien que ses enfants qui sont là, réalisent précisément la quintessence de son être présent, savoir la consommation de masse.
Défiant toutes les structures fixes et toutes les infrastructures logistiques, c'est à dire que chaque rave-party s'invente et se réalise ex-nihilo ou presque, ces ordalies new-look indiquent de surcroît tout le mépris que professent les jeunes pour la culture "installée" : la rave est une pratique nomade. Elle se définit dès l'origine comme hors les murs, décalée par rapport à toute forme d'enceinte ou de situation géographique déterminée : tout espace, n'importe quel lieu sont par nature élus pour la Rave. Et totalement cosmopolite. Ici, nos enfants inventent une forme inattendue d'internationalisme, si on n'oublie pas que la culture a toujours été ce qu'il y avait de plus universel dans les actions humaines. Encore faudra-t-il accepter de classer la Rave dans la catégorie culture, sans la soumettre à la sous-catégorie méprisante de culture de masse, même si ici la masse est un paramètre indispensable de l'acte raveur. Le rap avait déjà de quoi nous mettre sur la voie d'un retour au mythe oral, à la scansion du poème épique, la rave invente la non spatialité de la célébration du rythme.
Lundi 23 juillet 2001
Hier soir j'ai encore vu un reportage sur l'une de ces rave-parties qui réunit en ce moment quelque 40 000 jeunes quelque part en Bretagne. Une chose frappe, c'est un côté presque sordide de dépouillement, on vit n'importe comment. On nage dans la boue, on mange des cochonneries innommables comme seuls peuvent en manger nos enfants coca cola ou Pizza Chutt (sic), bref aucun confort, seul compte le plaisir du mouvement et du vertige intérieur. On n'est pas loin du rite. Au fond, il est possible que nos enfants éprouvent tout simplement l'urgente nécessité de se socialiser à un niveau oublié, celui du plaisir. On pense généralement que c'est chose faite grâce à tous ces concerts en public et grâce à la télé, mais c'est faux à l'évidence. De plus cette socialisation est neuve dans son concept. Il n'est plus question de se fabriquer un environnement humain stable, comme dans toute société sédentaire, de gérer un équilibre écosocial. Non, ici il faut inventer de toutes nouvelles formes de socialité, des formes permanentes au-delà du mouvement, c'est à dire au-delà du voyage incessant et désordonné. Les jeunes s'inventent un nouveau langage international, la danse, comme les abeilles ou les fourmis. C'est à double sens, comme tout ce que nous faisons. L'avenir nomade de notre société ne se lit nul part mieux que dans le comportement de nos enfants, qui malheureusement n'en sont que rarement conscients. Leur amour du voyage est pris au piège des tours opérateurs et de cette effroyable société du tourisme, et c'est sans doute ce qui explique cette "astuce" historique pour s'inscrire dans un devenir nomade malgré la mauvaise tournure que prend le voyage comme tel dans le monde.
Dans les JT d'hier, Gênes et le sommet scandaleux du G8 avec de nouvelles victimes comme il y a quelques semaines en Suède. Des morts pour un sommet de chefs d'état ! Comme d'habitude TF1 présente les faits dans le médiocratisme de la droite française : oui c'est tragique d'en venir là, mais le Président Chirac l'a dit, il faut que les Chefs d'Etat se parlent pour qu'il soit possible de toucher les bénéfices de la mondialisation et pas seulement les inconvénients. Curieuse manière d'utiliser la dialectique des rédactions de troisième ! Un peu idiot, car le candidat de 2002 prend le risque de laisser entendre que la mondialisation est une vrai galère. On pourra prendre ces avertissement pour un tir de préparation de sa campagne électorale, car avec la liquidation des "acquis sociaux" Chirac sera bel et bien obligé de promettre des galères pour la France. Cela dit, il prend les Français une fois de plus pour des cons en croyant donner des leçons de ce genre. Comme si le fait de se réunir pour se goberger et se faire photographier en groupe allait changer quoi que ce soit ! Comme s'il existait quelque chose comme un dialogue des pouvoirs ! Kouchner a des couilles et du pif. Il me fait penser à un futur Kerensky quelques années avant la Révolution d'Octobre, car il a bougrement raison. Reportez vous à mon analyse de Mai68 et vous comprendrez ce que je veux dire. Encore qu'il faille faire très attention, car ce Mai - là risque de se passer beaucoup plus tragiquement, il suffira à nos despotes de choisir le lieu avec toutes les intentions qu'on peut imaginer dans les conjonctures qui vont se présenter. En gros, ce sera, en cas de crise économique profonde (style 1929) la mécanique américaine, c'est à dire ce qui se dessine déjà depuis Stockholm, tir à balles réelles et morts de plus en plus nombreux (mais "globalisés" et donc infinitésimaux en termes politiques immédiats), ou bien une crise véritablement à la française, et alors ????? L'autre modèle pourrait être le modèle social-démocrate, mais les pères de la social-démocratie n'ont pas hésité non plus à massacrer Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht quand il s'est avéré qu'ils risquaient de gagner politiquement la partie, bande de salauds sans âme.
Reste que ces manifestations symboliques n'ont guère de sens. Effectivement c'est un Mai 68 qui risque de se passer parce que les organisateurs de ces manif ne sont qu'une poignée d'intellos sans rapports ontologiques avec la conscience collective. Et le résultat sera le même, c'est à dire une récupération infiniment difficile à combattre : on pourrait soupçonner les pouvoirs en place de fomenter une telle crise qui serait à termes entièrement à leur bénéfice. Je développerai cela plus loin, mais globalement la chose est simple, les manifestations sont cela même qui donne désormais consistance à ces sommets pichrocolesques, les "opposants" donnent enfin à ces sommets l'importance qu'ils n'arrivaient pas à avoir autrement. Jusqu'à présent, il n'y avait que les média qui tentaient désespérément de faire vivre le sens de ces sommets alors que tout le monde s'en fout. Au demeurant, ces sommets sont, depuis le début, toujours les éléments d'une stratégie personnelle de l'un ou l'autre participant. La France a toujours été très friande des sommets depuis qu'elle a été viré de celui de Yalta, mais on ne fabrique pas des Yalta sur commande, et si un Mitterrand a su utiliser habilement les sommets de son temps, il n'en va pas de même avec l'actuel président de la République. Je pense que Chirac fait exactement le contraire de ce que faisait Mitterrand, à savoir défendre la République contre qui et où il peut, combattre Washington dans son leadership mondial et bien faire comprendre aux vrais patrons du monde que son pays ne s'alignera jamais. En son temps, le président socialiste se comportait en vrai général De Gaulle, affrontant ironiquement les Thatcher et les Reagan qui ne s'en rendaient même pas compte. Relisez ou lisez les Verbatim d'Attali, grands recueils de la science des sommets.
Samedi 28 juillet 2001
Chirac. Quel univers se profile derrière ce nom ? Car ne nous y trompons pas, les élections de l'an prochain auront un caractère de décision historique comme on n'a pas vu depuis longtemps. C'est à travers des détails tout à fait anodins et apparemment hors sujet que l'on peut deviner ce qui nous attendrait si l'actuel Président de la République était reconduit dans ses fonctions. Tenez, depuis quelques semaines sévit un jeu télévisé de toute première bourre (libérale). Cette émission s'appelle Le Maillon Faible, son principe : permettre à une douzaine de "candidats" de se manger entre eux (c'est à dire s'éliminer réciproquement) à la plus grande joie sadiquement mise en scène de la présentatrice formatée à cette fin. Et ce pour une véritable poignée de cacahouètes qui vient récompenser celui ou celle qui aura montré le plus de ruse et de cynisme. Remarquable modèle de relations humaines, ce jeu veut montrer : primo que nous sommes tous des salauds prêts à tout pour trois petits pois (merci nous le savions déjà), secundo que "dans la vraie vie" ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent mais les plus malins, et tertio et corollairement que la démocratie est une véritable escroquerie car elle sert d'instrument d'élimination (ce sont les joueurs eux-mêmes qui votent pour éliminer le "Maillon Faible"). Bref, un chef d'œuvre de cynisme libéral dont on peut observer de bons exemples dans les thrillers américains où le méchant n'est jamais assez méchant au goût du marché. Seul inconvénient pour les idéologues en chambre qui ont concocté cette salade pseudo ludique, ça fait jaser. Les "gens" ne paraissent pas aussi dupes qu'on pourrait le penser et les réactions des joueurs eux-mêmes témoignent de la prise de conscience qui s'opère. Autrement dit, c'est exactement comme les rodomontades de Chirac qui en bon Tartuffe se moque ouvertement des vertus républicaines, en se disant que ça plaît aux Français.
Jusqu'à un certain point. Et pas plus loin, ce qui fait tout le danger de la candidature Chirac pour la droite car après lui c'est le déluge. Autre exemple de brigandage moral : TF1 (qui a déjà commencé sa campagne pour Chirac) ouvre son journal fin juillet par deux sujets qui concernent le principal concurrent de la téléphonie Bouygues, à savoir France-Télécom. Cette société (certainement mal privatisée au goût de Bouygues) avait envoyé les enfants de ses salariés en vacances, et certains d'entre -eux n'ont pas pu être rapatriés dans les délais et avec la sécurité attendue en pareil cas. Toute une salade scandalisée concoctée par de soi-disant journalistes pour un épisode de ce que TF1 connaît pourtant bien elle- même. La première chaîne a aussi ses colos, et elle a les mêmes problèmes d'accompagnement des enfants, tâche ingrate car les enfants viennent de toute la France et selon un planning d'acheminement à des dates et des horaires extrêmement difficiles. Je connais tout cela par France-3 et il m'est arrivé d'être obligé d'accompagner moi-même mes enfants ou de les rechercher. Bref, c'était une occasion comme une autre pour TF1-Bouygues de s'en prendre en dessous de la ceinture à son principal et plus dangereux concurrent côté téléphonie. Il était si facile de faire craquer les ménagères de plus de cinquante ans sur le sort de ces enfants abandonnés dans les gares routières et ferroviaires ! Vilain France-Telecom ! Et cette comédie est d'autant plus réellement scandaleuse que le troisième sujet du journal télévisé portait, lui sur la véritable mort d'une jeune fille découverte assassinée quelque part en Bretagne ! D'abord les comptes personnels, les informations sérieuses après. C'est parfaitement gerbant, mais éclairant sur la moralité du plus grand média français et sur l'insigne nullité du CSA. Il est vrai que la droite a aussi pris les rênes de cette institution. Il y aura du ménage à faire pour Jospin, qui hésite bien trop depuis qu'il est à Matignon, tellement qu'on ne sait plus ce qui différencie vraiment son action de la politique des droites. L'insolence de Chirac vient de là, uniquement de là. Allez, assez pour aujourd'hui, mais vous allez encore m'entendre sur cette campagne, ça va saigner.
Un mot encore sur cette obscurité qui entoure l'action de l'actuel gouvernement. Il y a des choses qu'il faut savoir avec précision et que les média ne s'empressent pas de répandre car il y va des secrets de fabrication de la Cinquième République. La principale d'entre elles est le partage des tâches inventé par De Gaulle entre le Président de la République et le Gouvernement. Comme Mitterrand était resté du bon côté de la cohabitation, c'est à dire celui de l'Elysée, il n'a pas touché à ce partage tacite et difficilement lisible dans la Constitution parce que ça l'arrangeait. En effet, selon l'esprit de la Constitution gaullienne le Président donne les grandes orientations, c'est à dire fait les choix stratégiques à long terme pour le pays, alors que le Premier Ministre a, en principe, un rôle de gestion de cette stratégie. Ce système a bien fonctionné sous Mitterrand malgré quelques dérapages en politique intérieure. Il a surtout bien fonctionné parce que Mitterrand avait engagé toute son action sur le terrain de l'Europe et de façon plus générale de politique extérieure, une action à très long terme dont on est loin d'avoir atteint toutes les conséquences. La réforme intérieure n'était pas encore à l'ordre du jour, mais aujourd'hui la pression du marché est de plus en plus forte, et Wall-Street veut des réformes. Or ces réformes les Américains les obtiennent un peu partout assez facilement, sauf en France dont la position influence la majorité des pays de l'Europe.
L'enjeu des élections qui approchent est énorme, car on arrive au dernier round de ce qui est resté sous forme d'escarmouche depuis les tentatives de Juppé pour suborner Marianne par derrière, dirais-je... Washington a absolument besoin de Chirac (il ne serait pas étonnant qu'il soit prochainement invité aux States avec tout un cirque le glorifiant), car il est désormais seul sur la scène de la droite. Avec Berlusconi il ferait un bon tandem pour faire faire machine arrière aux Européens dans tous les dossiers économiques brûlants, fonds de pension, sécu, chômage etc... Car Berlusconi s'est empressé de montrer à Gênes qu'il était l'homme capable (enfin) de faire tirer sur des manifestants, excellent exemple pour l'Europe. Fidèle à son boulangisme napoléonien, Chirac a modéré ses réactions après Gênes, histoire de rester près du "Peuple", mais on peut être sûr qu'il ne fera pas moins que le Cavaliere le jour où il sera confronté à ce qu'il connaît bien depuis 1968, la rue. Bush y compte bien, ce guignol sanguinaire qui pense sauver son pays de la débâcle économique par une nouvelle politique de guerre. Bof !
Mercredi 29 août 2001
Retour de Sardaigne, saturés d'aventures en tout genre, et de cuisine italienne. Ustica est dans un état lamentable, suite à une malencontreuse erreur de ma part : il ne faut jamais prêter son bateau. Mais nous sommes en vie. Que signifie être en vie ?
Je ne sais plus. Ce que je sais c'est que je suis fatigué en permanence, sans doute comme des millions d'Européens. Et ce à la veille du traumatisme prévisible de l'introduction de l'Euro (le restaurateur qui me nourrit depuis deux ans a déjà lâchement profité de cette perspective pour augmenter tous ses prix au prétexte d'arrondir en Euro ! Ca promet !). Et puis les élections présidentielles : à considérer ce que chacune de ces élections a changé dans ma vie depuis que je suis né, je ne devrais pas m'alarmer, mais cette fois je sens que ça ne va pas se passer très bien. Restons sur le pont. La panne de mon pilote automatique me servira de leçon. Jospin m'a un peu rasséréné hier soir, il paraissait en bonne forme et n'a pas bafouillé ni lapsusé une seule fois, ce qui est assez rare pour qu'on le signale. Ce qu'il a dit confirme ce que j'écrivais plus haut, il se déclare déjà en faveur de la taxe Tobin (ce que je considère malgré tout comme une erreur) et il prend déjà ses distances vis à vis de la vache sacrée de la mondialisation américaine. Il a donné le ton social démocrate, tout en déclarant la bouche en cœur qu'il n'est pas partisan de laisser filer le déficit comme le souhaite Schröder. Incroyable ! Un Allemand qui parle de laisser filer le déficit ! La situation doit être terriblement mauvaise pour qu'on en arrive là, plus mauvaise qu'on ne le sait ou le croit. Le Japon est au bord de l'implosion. C'est le premier acte d'un processus de décomposition économique où aucune des thérapeutiques classiques ne servira plus à grand chose. C'est le sens de cette économie qui fait défaut. A Porto Conte j'ai vu arriver le Yacht du fils de Berlusconi (sic), spectacle pour le peuple, la politique du nouveau président du Conseil italien ! Dans le temps les grandes puissances faisaient marcher leurs bâtiments de guerre le long des côtes des pays récalcitrants, histoire de les intimider, aujourd'hui les gens du pouvoir font défiler les objets supposés du désir collectif, les objets premiers de la consommation, refuge de la raison de l'économie. Quelle tristesse !
Au pied du mur. A la veille d'élections présidentielles, devenues avec De Gaulle LE rendez-vous républicain, chaque citoyen devrait faire l'inventaire de ses désirs au lieu d'attendre passivement. C'est beaucoup demander ? Non, car l'homo démocraticus ne se prive pas de commenter, critiquer sauvagement ceux-là mêmes qu'il élit. Il ne se sent pas concerné par les caps que leur République peut prendre à court, moyen et long terme. Essayons de faire ce petit exercice, histoire de donner l'exemple, sans faire de démagogie ni surtout de s'évanouir dans les utopies eschatologiques. Nous le savons, l'histoire est d'une lenteur incroyable, mais gageons-le, sage.
Donc, que peut-on attendre du futur Président de la République Française, quel qu'il soit ? Tout de suite une idée se présente, qui va forcément donner une indication sur ce que l'on pourra attendre de l'un ou de l'autre des deux principaux futurs candidats : le maintien de la paix sociale et de la stabilité actuelle, malgré tout ce qu'elle comporte d'artificiel et de fragile. Qui de Chirac ou de Jospin aura naturellement intérêt à un tel état de choses ? A l'évidence c'est l'actuel Premier Ministre, engagé dans un vrai round politique. Imaginons un instant que Chirac gagne et qu'il puisse de surcroît s'appuyer sur une Chambre Bleue (disons plutôt Blanche), il ne fait guère de doute que le mouvement serait fort. Comme je l'ai suggéré plus haut, les réformes ultra libérales les plus urgentes seraient menées tambour battant, nous verrions la réitération sans doute beaucoup plus douloureuse, voire tragique, de l'hiver 1995. Par conséquent, un choix s'impose tout de suite : la pérennité du présent ou l'aventure sociale. On peut choisir la seconde solution, et je suis tenté de le faire, car la France a toujours avancé ainsi, dans le chaos passager. Pourtant je choisirai la paix sociale, encore cette fois, car notre pays est désormais solidement arrimé à l'Europe. Or il est trop tôt à mon avis pour placer nos voisins dans une situation de crise. Gênes a montré que certains ne plaisantent pas avec les manifestations de rue, il faut attendre une intégration politique plus avancée et plus solide. C'est toujours la raison qui m'a fait défendre Mitterrand envers et contre tout.Cela dit, et quoique ce seul élément possède déjà une grande force de contrainte électorale, que voulons-nous réellement de nouveau, qui puisse satisfaire nos projets personnels et ouvrir à une nouvelle ère historique ?
Il existe deux domaines qui me sont chers et qui demandent un soin tout particulier : la nourriture et les transports. L'actualité n'a pas manqué ces dernières années de rappeler les pouvoirs publics à ces deux secteurs, il est grand temps que l'empoisonnement sournois mais massif des populations cesse, autant dans les assiettes que dans les villes qui s'asphyxient lentement mais sûrement. Je ne place pas beaucoup d'espoir dans une politique volontariste de contrôle de l'agroalimentaire industriel. Pourtant, l'histoire des trente dernières années montre qu'un progrès a été possible, il suffit de se souvenir de ce que le Français modeste mangeait dans les années soixante. Il faut aller plus loin cependant, quitte à repeupler par incitation les déserts agricoles de la France Danone. La dégradation de notre alimentation est sans doute la conséquence la plus visible et la plus désagréable de la mondialisation. L'industrialisation de l'agriculture, entreprise par les Anglais dès le dix-septième siècle, n'a pas d'autre raison que le marché mondial. Or, cette industrialisation n'a jamais été menée à son terme pour ce qui concerne les paramètres financiers : les produits agricoles restent faiblement rémunérateurs par rapport aux produits industriels et ne peuvent pas, contrairement à l'industrie, encourager la création de PMI-PME. A la campagne il faut en moyenne posséder 300 hectares de terre pour vivre honorablement, c'est à dire dignement, c'est à dire sans dépendre des subventions étatiques. L'apparition du biologique et son développement est une bonne chose, mais elle reste marginale et demande un cadre légal et économique nouveau. En réalité la recherche agronomique devrait être orientée vers ces techniques culturales plutôt que vers des organismes végétaux qui doivent se battre avec les défauts de l'agriculture industrielle. Les pesticides et autres poisons sont, en effet, à replacer dans le cadre des impératifs de surface et de spécialisation : jadis, la variété du paysage empêchait concrètement tous les grands maux actuels. Même les sécheresses étaient compensées par la variété des végétaux cultivés, alors que les millions d'hectares de maïs ne tolèrent pas la moindre baisse hygrométrique. On sait aussi que la variété végétale est la meilleure arme contre les insectes et les champignons, il y a toute une science ou tout un savoir à prendre en compte voire à sauver là où ils se trouvent encore. Il faut imaginer un Plan Quinquennal de sauvetage des campagnes françaises, avec des objectifs clairs et chiffrés. Que signifie tout le bruit autour de la chasse, si le reste de la campagne se meurt dans l'indifférenciation variétale ? Quel sens a le fait de sauver quelques espèces d'oiseaux si ces mêmes oiseaux continuent de mourir faute de leur environnement propre ? L'histoire des cigognes en Alsace est très suggestive à cet égard. D'autant que la terre est mortelle. Aux Etats-Unis des millions d'hectares sont déjà devenus des déserts stériles, conséquence de l'épuisement définitif des nappes phréatiques. Et puis, dernier argument politique, les Français sont particulièrement pointilleux pour ce qui concerne leur nourriture. Ils devraient voir d'un bon œil un gouvernement qui ne se contente pas de jouer les pompiers lorsque tout va mal. Faut-il insister sur la question de l'élevage ? Inutile, je pense que tous les Européens connaissent la leçon. Mais là encore une dimension est généralement négligée, l'industrialisation a abouti à un isolement des espèces : aujourd'hui les poules, les cochons ou les bovidés naissent et meurent en compagnie de leur seuls congénères, déséquilibre dont les conséquences inapparentes ne sont pas moins graves que celles des farines animales. A la base de toute alimentation de qualité il y a l'amour, celui qui doit se manifester tout au long de la chaîne de production et de transformation des produits agricoles. Je n'ose pas dire la poésie, même si je le pense; mais je vous le demande : quel attribut peut-on donner à un vrai plaisir gastronomique sinon celui de poétique ?
Transport. Vous allez dire, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est son dada. Certes, mes thèses anthropologiques ne laissent guère de doutes à ce sujet, le nomadisme est en train de gagner brutalement la partie engagée depuis quelques millénaires par le désir historique de vivre de manière sédentaire. Cette sédentarité a échoué, et cet échec explique à lui tout seul toutes les formes actuelles de crises politiques, sociales ou économiques. C'est simple : il n'existe plus d'espace paysé par le désir, mais seulement des surfaces urbanisées ou ruralisées par les impératifs industriels. L'homme s'est chassé lui-même de son Eden si patiemment rêvé et si laborieusement cultivé. Le nomadisme à venir, il ne l'a pas choisi, sinon dans l'être spirituel du voyage : aujourd'hui on ne voyage plus seulement dans l'espace, mais aussi et de plus en plus dans le temps et dans les substances exotropes, c'est à dire qui conduisent l'esprit ailleurs sans faire bouger le corps. Cette transformation est éclatante, l'homme consacre le plus clair de ses ressources et de ses passions à ce qui fait voyager, bouger, parcourir l'espace, la plupart du temps en pure perte car appartenant encore à un apprentissage récent et qui ne connaît même pas son but ni ses véritables instruments. La France occupe une place originale dans cette phase de l'Histoire de l'humanité. Elle aura été l'une des plus belles réussites de la sédentarité, une stabilité humaine qui a produit les objets culturels les plus harmonieux et les plus cohérents dans un espace paysé de longue main depuis bien avant l'arrivée des faux paysans romains. En même temps elle a nourri en son sein, secrètement, les ingrédients d'un nouveau monde mouvant, détaché des soucis de la glèbe féodale. Les autres aussi l'on fait, mais la France a vu grand tout de suite, elle a tout de suite compris l'enjeu des réseaux et des voies, et aussi celui du changement de site. En lisant le Pascal d'Attali j'ai eu la surprise de constater qu'au temps de Louis, les agents de l'état étaient déjà soumis, comme aujourd'hui ils le sont encore, à la valse des mutations et des changements de lieux. La carrière dans l'état suit depuis très longtemps une logique mouvante où l'individu ne peut pas s'attacher trop profondément, trop "familialement" à une localité quelconque, nécessité de la garantie d'impartialité de l'état centralisé. La centralisation a favorisé le développement de la circulation des personnes et des biens, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et la Révolution Française n'a eu qu'un seul ennemi redoutable que l'on voit ressusciter de nos jours, l'attachement régionaliste identitaire, autre expression pour Girondisme. J'aime toujours à rappeler qu'au début de ma carrière à France-3, les règlements stipulaient la mobilité de tous les journalistes désireux de monter dans la hiérarchie. Pas question de laisser les journalistes s'incruster dans les castes locales au risque de devenir leur représentant exclusif : De Gaulle voulait précisément éviter cela pour faire contrepoids à la presse écrite locale qui lui était hostile dans la plupart des cas.
Le problème est qu'il faut encore que les Français, et surtout leur Etat, prennent conscience de l'importance de cette mutation et cherchent à en saisir le véritable sens. D'abord afin d'en maîtriser les conséquences désastreuses : la mortalité au volant n'a pas d'autre explication que la vacuité des parcours, c'est à dire l'absence de sens dans l'usage des véhicules. Cette absence, compensée au début par la beauté et la nouveauté des paysages traversés - maintenant effacées par le phénomène des artères massives de circulation - a retourné l'usage du voyage contre lui-même. Le véhicule a pris la place de la finalité réelle du se mouvoir, une perversité encouragée par la contrainte économique à l'usage des véhicules. En bref, il faut que les Français, et les Européens en général, s'efforcent de rationaliser l'usage qu'ils font de tout ce qui roule. Ils ont oublié, la plupart du temps, qu'il fut un temps où le train s'imposait de lui-même pour tous les grands déplacements, et qu'il est parfaitement stupide aujourd'hui de risquer sa vie pendant des dizaines d'heures au volant de sa voiture pour se rendre dans un lieu où une bicyclette suffira aux déplacements de proximité. D'ailleurs le plus drôle est bien de voir ces vélos ficelés sur les toits ou les coffres des voitures. Aussi, le gouvernement doit-il prendre très au sérieux la modernisation complète de son réseau de voies ferrées, longtemps négligée et réduite au plus simple c'est à dire au plus rentable. Il faudrait imaginer là une exception économique à la Loi d'autofinancement des services publics, qui date, rappelons le, de Pétain. La SNCF doit redevenir un service et non pas viser à devenir une entreprise concurrentielle avec les autres moyens de communication. Pourquoi pas un plan européen de transport à bas prix, seul moyen pour permettre aux populations d'apprendre à se mouvoir sur le continent sans des investissements trop importants, et sans que l'on aboutisse fatalement à un engorgement et à une pollution massive des zones traversées par la circulation ? Sans parler des dégâts sociologiques que l'on peut constater dans ces zones de passage où les habitants finissent toujours par vivre de véritables cauchemars au contact de ceux qui se "réalisent" au volant de leurs bolides. La privatisation est un véritable scandale dans ce domaine, car elle revient à faire du transport des personnes une roulette russe pour profits capitalistes. On a vu ce que cela donnait en Grande Bretagne, dix ans après les funestes décisions de Madame Thatcher. Encore un mot sur le transport routier : en finir vite ! Soixante pour cent des accidents mortels sont le fait des poids lourds, peu de journalistes prennent la peine de le rappeler. Pourtant, concrètement cela signifie que cinq mille personnes perdent annuellement la vie pour cause de transport routier de marchandises. C'est cher payé pour assurer le stock zéro des entreprises. A demain pour la suite de mon programme politique.
Jeudi 30 août 2001
Il faut prendre la balle au bond : Tobin or not Tobin, titre de l'article d'un certain William Abitbol dans le Monde à propos de la fameuse Taxe sur les Changes. Car le député européen le rappelle tout de suite, la taxe Tobin ne vise pas la circulation des capitaux mais la spéculation sur les changes. OK, la précision sert toujours à quelque chose et il n'y a pire ennemi de l'esprit que le désordre des concepts. Mais il me semble avoir toujours compris cette taxe ainsi, bien que je n'ai pas eu accès au livre de monsieur Tobin, et contrairement à Monsieur Abitbol, j'y demeure hostile. Son principal argument ne manque d'ailleurs pas de sel, l'économiste et politicien estime que cette taxe serait une régulation très "souverainiste". On le croît volontiers et même au-delà, remerciant l'auteur de l'article de toute cette eau qu'il apporte à notre moulin. Car si non seulement cette taxe ne fait que confirmer l'existence de la spéculation sur les changes en la légalisant pour ainsi dire a contrario, elle nous ferait faire en plus des décennies de chemin en arrière en direction des joyeusetés du nationalisme. Non mais ! Il est fou !
Cela dit son analyse anti-mondialisation ne manque pas de justesse, bien que le phénomène qu'il décrit doive plutôt se désigner comme l'américanisation du monde et non pas sa globalisation. Le crime de Nixon supprimant la convertibilité du dollar, celui de l'invention américaine des taux d'intérêt et les Reaganomics, tout cela est strictement américain. Identifier la mondialisation à ces trois éléments reviendrait alors à faire de la mondialisation un phénomène de pure domination impérialiste US. Dont acte, pourquoi pas, c'est tellement vrai. Mais alors il faut le dire ouvertement, et ne pas accuser les Allemands et les Français de s'être soumis à chacune de ces catastrophes venues de Washington puisqu'on fait la même chose en se voilant la face.
Mais, mais l'américanisation du monde, peste réelle et avérée, ne justifie pas pour autant le retour au nationalisme, cette fiction sédentariste fumeuse et génératrice de toutes les horreurs de l'Histoire humaine des Dix derniers siècles. Voir mon Atopie à ce sujet. A mon avis, il y a deux attitudes à défendre contre la gangrène impérialiste (rappelons que cette fausse mondialisation n'est rien d'autre que la première faute colonialiste des Américains, qui ont assez bien résisté à cette tentation malgré les dégâts causés par la doctrine Monroe en Amérique Latine) : la première consiste à encourager et à soutenir toutes les formes d'union monétaire hors de la zone dollar. L'Euro est le premier miracle politique de l'Europe et donne de bonnes raisons d'optimisme pour l'avenir, il n'y a pas de raison de ne pas y associer toutes les monnaies du monde qui le souhaiteraient afin de renforcer la seule monnaie qui puisse mettre un frein à ce qui est devenu une véritable agression économique. La deuxième est plus utopiste mais tout aussi inexorable comme nécessité historique : elle consiste à considérer les flux financiers eux-mêmes comme un mal absolu dépendant de la politique impérialiste américaine. Il faut le dire en toute simplicité : le capitalisme est resté jusqu'à présent le même que celui qu'a décrit Karl Marx. Ce qui a changé, et ce n'est finalement pas grand chose, c'est le remplacement de l'Angleterre par les Etats-Unis. Il est resté le même, c'est à dire un système politique de prédation aveugle, et ce Trieb prédateur n'a aujourd'hui plus de bornes parce que le fauve qui le fomente dans le monde est monstrueusement puissant. Or cette puissance est à 99 % politique. Regardons les relations entre Washington et Tokyo : les Américains tiennent les Japs par la barbichette politique depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Il faudrait d'ailleurs aller fouiller dans les stratégies sordides et dangereuses que le Département d'Etat déploie en Extrême-Orient. La Chine est le cœur d'un marché de dupe entre les Américains et les Nippons, et la première chose que Bush a faite en arrivant au pouvoir et de confirmer aux impérialistes nippons qu'ils sont toujours soutenus par les E-U, et qu'ils restent les seuls candidats à la domination de l'Empire extrême-oriental tout entier. Car les Japonais tiennent les Américains par la barbichette économique d'une dette en dollars fabuleuse, capable à elle seule de ratatiner Wall-Street en quelques minutes si, si les banquiers nippons s'avisaient d'en demander remboursement immédiat.
Ah oui, les Américains ne sont pas du tout le peuple vertueux que l'on s'imagine. Ils sont des bandits de grand chemin mondiaux, ayant retrouvé sur le tard, c'est à dire au bord de l'éclatement de la crise décisive, toute la sauvagerie et toute l'absence de scrupules moraux qu'illustre inauguralement l'acte de piraterie de Nixon. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la véritable nature du néo-libéralisme au lieu de s'attarder à rechercher du fascisme ici et là dans la barbarie sociale américaine. Les Américains ne sont pas fascistes, ni nazis, ils sont devenus par force - mais surtout parce qu'ils vivent depuis un siècle presque au crochet du monde, et que cela commence à compter en monnaie sonnante et trébuchante - des guerriers économiques, c'est à dire des prédateurs systématiques de toute réalité stable et de toute richesse matérielle, tant pis pour les atteintes à la morale humaine. Faudra-t-il un jour faire la guerre aux Etats-Unis ? Je ne le pense pas, mais nous en serons dispensés uniquement parce qu'autres s'en chargeront, tels les Chinois qui enragent de plus en plus ouvertement d'être pris pour les cocus du Soleil Levant. L'Histoire a des ironies intéressantes, car il n'est pas interdit de penser que nous volerons au secours des Américains, non pas pour défendre cette fois une cause humanitaire, mais pour mettre fin à leur hégémonie comme ils ont mis fin à celle de l'Europe. Là il n'y aura pas non plus de morale, et les pauvres Chinois risquent fort de payer le prix de cette manipulation. Mais alors les Américains seront pris à leur propre jeu : les parangons de l'anticolonialisme de l'après-guerre se verront à leur tour forcés de décoloniser la planète.
Encore une idée qui se rattache à tout cela : les Américains ne sont pas seulement responsables de la pauvreté du Tiers-Monde dont ils tirent cyniquement de quoi alimenter leur paresse et leur veulerie, ils sont aussi responsables de la destruction de la planète. Tout le mouvement d'industrialisation forcé qui couvre le monde d'insectes mécaniques et de béton a été conçu et orchestré de Washington. Les blattes à essence désormais sans plomb qui inondent l'Europe, et tout ce qui s'y rattache en fait de praxis sociales aberrantes et destructrice de culture et de paix, vient des ateliers de Ford et de General Motors. Si l'Europe a pour ainsi dire rattrapé les Etats-Unis dans la concurrence technologique, c'est qu'elle n'avait guère le choix du terrain : celui-ci était préparé par la guerre mondiale, et...pour la guerre mondiale.
Il m'arrive souvent de prendre la défense des Américains contre ceux qui ne se souviennent par assez des falaises normandes, et je reste respectueux de l'immense sacrifice de ces hommes. Je me demande pourtant parfois si le débarquement n'aura pas été le tout premier acte de la guerre totale de l'économie contre l'Homme. Pour comprendre cela il faudra reconsidérer la concept d'économie, en lui restituant pour commencer le qualificatif de "politique" et en rappelant qu'il n'existe aucune économie non politique, pour la bonne raison que la Nation de monsieur Abitbol ce n'est rien d'autre que le foyer autour duquel on partage la soupe. Donc je doute que l'héroïsme des jeunes GI puissent se définir comme un sacrifice, il faudrait plutôt chercher du côté de la roulette du casino ou de la traditionnelle morale de guerre. Dur.
Vendredi 31 août 2001
Ca tangue dur dans les bourses européennes, le passage à l'Euro ne se fait pas dans l'euphorie, et pour cause. J'imagine que les stratèges de Wells Stress sont tous à l'affût de la moindre erreur en calculant les effets de leurs manœuvres spéculatives. Nous arrivons dans la phase critique de l'introduction de la nouvelle monnaie, bien que l'essentiel se soit déjà produit et produit avec succès. Cet essentiel c'est le marché unique qui permettrait éventuellement aux Européens de se payer une période isolationniste s'il le fallait. J'ai toujours été convaincu que le protectionnisme avait encore un grand avenir. Ce serait, je pense, une bonne chose que de se décrocher pour quelques années du marché américain histoire de créer des produits alternatifs européens et surtout une éthique politico-économique différente. C'est simple : la social démocratie, pour parler vite, n'a aucune chance tant que des contrats léonins relieront l'Europe à son partenaire d'Outre-Atlantique. Bien sûr, en apparence, ce que je raconte est absurde. Il est inimaginable que le marché mondial se brise dans ses zones les plus solides. L'OMC est là qui veille au respect de la liberté du commerce. Mais ce n'est pas si simple, car l'OMC est une institution encore très fragile, pas encore intégrée dans la réalité des échanges, ou alors si mal que cette intégration ne profite toujours qu'aux mêmes puissances. Et puis l'histoire se fait seulement à coup de surprises. Entre les deux guerres on a pu constater comment la Société des Nations a été purement et simplement liquidée en tant qu'instance de pouvoir politique. Personne n'a pipé, il en ira de même avec l'OMC.
Il y a un symptôme qui annonce un décrochage ou une distanciation par rapport à l'Amérique, c'est le développement du secteur culturel européen. Sans bruit, la plupart des pays d'Europe fabriquent leurs séries, leurs émissions, leurs jeux, leurs films, alors qu'il y a encore dix ans c'était le désert partout. Les Américains sont en train de perdre à leur propre jeu. Ils ont envahi massivement les médias européens pour s'assurer le monopole, mais les Européens se sont réveillés et ils commencent à apprendre à produire eux-mêmes avec les techniques d'Hollywood mais sur des mélodies nouvelles. C'est encore fragile et ça bredouille encore le franglais, mais l'impulsion me paraît donnée à un mouvement plus important que tout le reste. La véritable indépendance reste celle de l'esprit, et c'est par elle que se conquerront toutes les autres, y compris l'économique. On n'a peut-être pas assez commenté le succès mondial d'une série comme Derrick. Or il s'agit d'une véritable contre-attaque culturelle, car avec tous ses défauts, cette série tranche nettement avec l'esprit de la série noire américaine. A un point incroyable, pensez seulement au rythme de cette émission où la lenteur sévit même dans la réalisation technique, zoom et panoramique à l'allemande, etc...
Mardi 4 septembre 2001
Esotérique, exotérique, ma religion est faite. Voici un exemple intéressant de ressassement millénaire absurde autour d'un mot et de son antonyme dont on n'est même pas sûr qu'il le soit. Il est vrai que l'enjeu de la signification de l'expression "ésotérique" est à ce point grand qu'il est naturel qu'on ai dû l'entourer d'un flou déroutant. Car pour les ésotéristes, c'est bien de dérouter qu'il s'agit, d'envoyer promener les profanes sur des voies dilatoires, sans qu'eux-mêmes ne sachent vraiment pourquoi. Après la lecture de la brique épuisante de Pierre A.Riffard intitulée "L'Esotérisme", j'en ai une petite idée. Elle est simple et paraît même simpliste, et pourtant je demeure persuadé que là aussi le vrai est dans le simple. En résumé,
est ésotérique ce qui doit être mis à l'abri des intempéries.
Revenons en arrière. Nous avons tous appris en Terminale que les grands hommes de l'Histoire, et notamment les philosophes, se caractérisent par une double face de leur personnalité et pour la plupart de leur œuvre. La Tradition académique a littéralement imposé l'idée que Pythagore, Platon et Aristote, mais aussi Newton et Goethe et bien d'autres géants de notre culture occidentale, ont tous mené une double vie et produit une double œuvre, l'une cachée, l'œuvre ésotérique, l'autre publique, l'œuvre exotérique. Ainsi, pour illustrer rapidement, il est communément admis que l'œuvre disponible de Platon appartient dans sa presque totalité au domaine exotérique, qu'elle était destinée à la publication. En revanche, on pense que l'œuvre disponible d'Aristote serait en réalité la partie ésotérique de son travail, en réalité des notes à partir desquelles le philosophe faisait ses cours de manière orale, la transmission orale semblant jouer un rôle important dans la définition du mot ésotérique. Pythagore, l'un des premiers penseurs ésotériques, aurait eu deux publics simultanément, ceux qui l'écoutaient en le voyant, et ceux qui l'écoutaient derrière un voile de lin qui le dissimulait à leurs yeux. Cette anecdote semble déjà dénaturer quelque peu l'acception que nous avions adoptée plus haut, mais l'idée ici est qu'il y a deux sortes de publics qui sont admis à l'enseignement, les profanes et les initiés. Ce mot nous met sur une voie de compréhension du phénomène. En effet, selon une idée courante, un initié est un individu qui accède à une tradition. L'initiation n'est pas un simple enseignement, elle agrège l'impétrant à un ensemble théorique et pratique pour en faire un être différent, voire considéré comme supérieur aux autres hommes. L'initié accède à un savoir restreint à ceux qui sont choisis pour certaines qualités. Le processus en question est exactement celui qui a cours aujourd'hui dans la Franc-Maçonnerie où l'on ne pénètre qu'après avoir montré patte blanche, ce qui ne signifie pas diplômes ou fortunes, mais pour la plupart des obédiences, sagesse et tolérance. Alors où est le problème ?
Le problème est que plus on simplifie ainsi le sens de l'ésotérique, plus on rejette l'ésotérique dans un domaine par définition difficilement accessible. Or cette attitude était sans doute admissible dans une société fortement hiérarchisée, où les castes dirigeantes se divisaient elles-mêmes en sociétés ésotériques et en sociétés exotériques. Mais dans nos démocraties scientifiques, cette dichotomie a vécu. Au temps de l'Eglise primitive, il n'était pas difficile aux prêtres de soumettre leur enseignement à la discipline de l'arcane, c'est à dire à un code théorique et pratique qui mettait l'essentiel de leur enseignement à l'abri du vulgaire. Pourquoi cela ? Pourquoi semble-t-il que de haute antiquité l'homme aie toujours dû cacher, voiler, retirer de la vue de la foule des éléments de culture et de science qui a priori ne pouvaient qu'être bénéfiques pour tous ? Ca, c'est une question typiquement moderne, moderne dans son sens moral, mais aussi moderne dans sa naïveté. Et dans son hypocrisie. Sa conséquence première est d'avoir discrédité presque totalement tout ce qui se relie de près ou de loin à l'ésotérisme au motif du rejet de l'irrationnel. Et pourtant les plus grandes découvertes de la science elle-même appartiennent originellement au domaine ésotérique, il suffit de penser au théorème de Pythagore qui a été longtemps l'objet d'une quasi guerre secrète dans tout le Bassin Méditerranéen. Combien de personnes ont perdu leur vie à cause de l'incommensurabilité de la diagonale du carré ? On ne le saura jamais, mais on sait en revanche parfaitement bien que Giordano Bruno a été brûlé vif en 1600 pour avoir maintenu envers et contre tous que la terre tournait autour du soleil et non l'inverse. La deuxième conséquence de cette idéologie rationaliste et positiviste est que le principe même de l'ésotérique a été mis en danger. Peut-être même l'ésotérisme est-il déjà mort là où aurait dû subsister et bien vivant là où il n'aurait jamais dû réussir à s'installer. Cette perversion historique est l'un des faits aux conséquences les plus graves et les plus dangereuses pour notre époque.
Est ésotérique ce qui doit être préservé des intempéries, avons-nous écrit un peu vite au début de ce texte. Explication. Nous partons de l'idée que la civilisation dans laquelle nous sommes est le produit d'un choix initial. Dans Atopie j'essaie de mettre en scène, bien maladroitement, ce moment où le chasseur-cueilleur, simple prédateur voisin des espèces animales, décide de devenir agriculteur et de se sédentariser. Contrairement à l'idée répandue par la civilisation elle-même, dans ses efforts ésotériques d'ailleurs, ce choix n'est pas à considérer purement et simplement comme un progrès de l'histoire humaine, mais comme une option ouverte dont l'incertitude du résultat était bien connue ainsi que les dangers. Les hommes du néolithique ne devant pas être considérés comme plus suicidaires que nous, il faut donc admettre qu'ils ont agi avec une certaine prudence, mis en place certains mécanismes et créé certaines institutions destinées à préserver l'essentiel de ce qu'ils possédaient alors. Encore une fois, il est parfaitement stupide d'avancer l'idée que tout cela aura été accidentel et que l'homme n'a fait que subir des conditions de subsistance qui l'auraient contraint à ceci plutôt qu'à cela. La réalité présente montre bien que tout est toujours possible dans le coin le plus inhospitalier du monde, pourvu que l'homme le veuille. Les candidats à la sédentarisation ont donc été confrontés à l'obligation de formuler leur choix - ce qu'ils ont fait abondamment dans tous les Ecrits que l'on s'obstine à qualifier de sacrés (ce qu'ils sont bien, mais pas pour les raisons de transcendance à chaque fois ou presque invoqués) - et de mettre à l'abri tout ce qui leur avait servi jusqu'alors de repères rationnels. Cela dit, il faut bien aussi envisager la dimension du traumatisme qui attendait ces hommes et il est certain que, dans leur sagesse certainement comparable à la nôtre en ce qui concerne la simple survie, ces hommes aient su, dès le départ que la société qu'ils mettaient en œuvre allait être un enfer dont ils étaient prêts à payer le prix. Mutatis mutandis, ils avaient décidé de conquérir l'Everest.
La société un enfer. Mélodie bien connue depuis les découvertes philosophiques de Rousseau. Et c'est dans cette perspective que nos ancêtres ont cru bon de créer cette dichotomie dans la transmission de leurs savoirs, de soumettre l'enseignement véritable à l'initiation, créant ainsi la double réalité ésotérique et exotérique de la Tradition. Mais attention, la cause n'en était pas l'ignorance et l'analphabétisme, mais bien le déchaînement prévisible, et qui a eu lieu, des passions sociales. Pour faire court : l'Eden originaire de Rousseau était condamné à se transformer et à devenir l'Enfer de Hobbes. Les créateurs de notre civilisation savaient que c'était le mal qui allait dominer aussi longtemps que leur projet exigerait la création et la subsistance d'Empires, de Nations et de foyers fixes. L'ésotérisme n'était alors rien d'autre qu'une ruse pour éviter que leur propre sagesse ne se dissolve dans la tourmente des sociétés sédentaires aux prises les unes avec les autres. Prenons un exemple aussi illustre que celui de Zénon d'Elée, qui a finit broyé dans un creuset pour s'être révolté contre son tyran. Voici une existence extraordinairement fertile et parfaitement glorieuse, au point que toute l'Hellade connaissait et révérait le disciple d'Héraclite exilé dans ce port italien. Et pourtant c'est le mal qui a eu raison de sa personne, et l'histoire n'a donné aucun privilège à ce grand homme, pas plus qu'elle n'a épargné Platon lorsqu'il s'était mêlé de politique avec son ami Denys le Tyran. Pourrait-on imaginer aujourd'hui un Einstein ou un Oppenheimer pourrissant dans un Camp de concentration ? Mais à cette époque, de telles choses n'étonnaient personne, ce parallélisme entre la lumière et l'obscurité, cette familiarité avec le mal, aucune hypocrisie sociale ne les dissimulait, aucune idéologie salvatrice et eschatologique n'en dissimulait les réalités : on savait. Et on faisait avec.
L'ésotérisme avait d'ailleurs pour principale finalité non pas d'épargner des personnes, mais de mettre à l'abri leurs enseignements. Pour deux raisons : la première étant que dans cet enseignement figurait toujours l'essentiel, sous une forme ou une autre. Or cet essentiel c'est le projet initial lui-même et toute la mémoire des Ages qui ont précédé, choses qu'il fallait préserver pour que la cohérence de la civilisation et de son projet soient maintenue à travers le temps. La violence des passions sociales ne connaît pas d'exception dans son instinct destructif, elle a au contraire de bonnes raisons de faire oublier ce que les hommes ont réellement cherché lorsqu'ils ont décidé de fonder des villes et des empires. La seconde raison est corollaire, si le mal réussissait à détruire jusqu'au fondement de la civilisation, alors tout le reste est menacé. La survie de l'espèce elle-même pourrait se voir mise en danger. Nous nous sommes considérablement rapprochés de ce danger-là, il ne faut pas, cette fois, se voiler la face. En bref, le secret du projet et celui de la survie sont le même : non pas que le projet de l'Homme soit purement et simplement de survivre en tant qu'espèce privilégiée, mais parce que sa survie est liée à son projet lui-même suprême objet des sciences ésotériques, la question de l'être. On associe toujours à l'ésotérique l'abscons et l'inintelligible. Et il est vrai que beaucoup de charlatans ont profité du voile pour monnayer leur pauvre apparence de savoir. Mais il est vrai également que l'initiation demande beaucoup à l'individu et que le travail du concept ne peut ni se contourner ni se remettre aux calendes romaines. Il est vrai aussi que la science - au sens de Hegel - n'est qu'un condensé technique de la science profonde qui gît en chacun de nous cachée et si difficile à atteindre. Mais c'est pourquoi aussi la première science est celle de soi-même, la plus ésotérique et la plus essentielle.
De nos jours, tout cela est engagé dans le plus complet désordre. Le seul ésotérique qui subsiste encore est celui que se transmettent les classes de décideurs, de plus en plus népotiquement liés les unes aux autres. Même la Loi est devenu objet ésotérique dont le maniement permet de honteuses exploitations économiques. La masse sait de plus en plus de choses et en même temps elle en ignore de plus en plus, et de celles que n'ignorait pas le dernier des serfs du Moyen-Âge. Quant au savoir fondamental, celui du sens de notre civilisation, il a presque totalement sombré.
Comment expliquer ce processus de délitement de la Tradition ésotérique, dont on peut au moins dire une chose avec certitude, c'est qu'elle véhiculait jadis la totalité du savoir et de la culture alors qu'aujourd'hui elle n'est plus qu'une peau de chagrin livrée aux astrologues de bazar et aux apprentis sorciers ? Les religions ont eu un certain génie ésotérique, elles ont modifié le message originel de telle sorte qu'il serve à la fois à signifier la finalité de la civilisation, mais aussi à stabiliser les foules qui commençaient de se former à travers le monde. Le "projet" est devenu le salut, l'eschaton des masses, et c'est pourquoi on a pu dire du Christianisme qu'il a pour ainsi dire confisqué aux hommes leur propre mort. Mais il a fait plus et plus grave. Tout en traduisant l'idée que l'homme était homme parce qu'il avait accès à la question de l'être en son contraire, c'est à dire que l'homme n'avait pas accès à l'être parce qu'il était fondamentalement mauvais, le Christianisme à détruit systématiquement tous les autres enseignements ésotériques. Cathares, Aryens, gnostiques sont tombés, hommes et œuvres, sous le sabre et dans le feu des mercenaires de Rome. De la sage diversité des savoirs à la quelle les Grecs n'ont pas osé toucher, Rome a fait un autodafé millénaire, chef d'oeuvre de censure historique. Aristote ne nous est connu que grâce aux Arabes. A tel point que l'on peut dire que les guerres de religion, parce qu'elles ont pu avoir lieu, ont en réalité sauvé ce qui pouvait encore être sauvé d'une telle débâcle. C'est de l'intérieur d'une Tradition exsangue et mutilée qu'est venu le seul geste qui pouvait mettre un terme à la mise sous tutelle absolue du projet de notre civilisation. C'est notre dette envers les Réformateurs, et aussi, il faut bien le dire, envers les Germains qui furent si longtemps les seuls à défier la toute-puissance romaine. Ne nous faisons pas d'illusion, la nouvelle Gnose américaine est en train de faire le même travail de sape universel et ce n'est pas un hasard puisquela société américaine n'a aucune autre racine culturelle que la Chrétienne. Qui osera réitérer le geste d'un Luther ou d'un Calvin ? D'où viendra la future guerre de religion qui réduira à néant le projet d'uniformisation culturelle et philosophique que nous percevons déjà si bien dans tous les médias du monde ? Et combien de vies coûtera une telle guerre ? On peut penser que le temps est arrivé où le sédentarisme doit disparaître en tant que Praxis dominante et décisive. Dès lors on peut aussi espérer que la violence nous sera épargnée. La fatalité des abîmes qui s'ouvrent déjà sous nos pieds ne nous permettrait même pas d'en user, tant il est primordial que les hommes trouvent à nouveau le courage et la modestie qu'il faut pour partager le même projet
Jeudi 6 septembre 2001
Connais-toi toi-même. Comment et pourquoi.
La plupart des systèmes de pensée se résument par l'impératif de Socrate, indépendamment de tous les autres aspects théoriques. Et pourtant, peu de philosophes ont concentré leurs efforts sur le fait lui-même de l'auto-connaissance ou de la connaissance de soi. L'égologie des Modernes ou les phénoménologies des Romantiques ne s'intéressent qu'à l'histoire de la conscience, établissent les cadres métaphysiques de son fonctionnement, s'appliquent à décrire cette fameuse relation sujet-objet. L'impression s'installe alors que la conscience est elle-même un phénomène passible de l'observation, de l'analyse scientifique et d'une systématisation objectale : la conscience est devenu un objet comme les autres. Rares sont les philosophes qui se sont intéressés à l'usage de la conscience et de l'auto-conscience, à son "mode d'emploi". De Husserl à Heidegger en passant par un penseur souvent oublié, Bergson, cette question a ressurgi avec le vingtième siècle, comme s'il s'agissait d'une question des temps tragiques, des époques de grands dangers. Et si on jette un regard en arrière, il faut remonter à Saint Augustin pour trouver une pensée toute entière tournée vers le souci du se-parler à soi-même, du se chercher en son fors intérieur, de se découvrir par delà ce fonctionnement automatique et transcendantalement programmé. Il est vrai que Saint Augustin parlait à son dieu, mais son génie et sa gloire philosophique reposent précisément sur l'identification naturelle qui s'établi entre ce dieu et le moi qu'il ne cesse en réalité d'interroger. On pourrait distinguer dans l'histoire de la philosophie deux courants de pensée. Le premier majoritaire aboutit au moi-parlé-par, qu'il s'agisse de Freud ou de Heidegger. L'autre, que l'on peut déceler chez un Nietzsche ou un Bergson, ne renonce jamais à identifier la parole et la volonté, la conscience et la responsabilité, thème central de la pensée d'un Lévinas. Faut-il choisir d'un point de vue moral entre ces deux positions, ou bien tenter de concilier les deux thèses ? Qui suis-je pour répondre à une telle question ?
Qui suis-je ? Premier pas sur le chemin du connais-toi toi-même, manière simple de poser le problème mais qui s'avère la plus délicate et la plus mystérieuse. Le mystère réside en effet tout entier dans cette autre question : qu'est ce qu'un "qui" ? Car elle semble partir d'une évidence qui serait que chacun de nous est "quelqu'un", est un "qui" dont seule l'identité reste à établir. Or, c'est quoi, un "qui" ? Où peut-on trouver un modèle de cet être abstrait qui se manifeste dans un pronom relatif ? Où se trouve la gamme de "qui(s)" dans laquelle on aurait une chance de se découvrir au détour de longs efforts d'introspection ? Voilà qui ne semble guère avoir de sens, de quoi nous rendre perplexe et de nous contraindre à nous rabattre sur le modèle universel divin et transcendant. La question serait alors : en quoi ressemblé-je à Dieu? Retour à Saint Augustin. Mais ce modèle divin demeure lui-même totalement obscur tant il est diversement parlé dans nos cultures, il y a autant de dieux que de moi(s), à tel point qu'il faudra bien admettre un jour la subjectivité totale des textes qui décrivent ou évoquent le divin. Le dieu de Moïse n'est ni celui de Saint Jean ni celui de Patanjali ou de Lao Tseu, comme si chacun de ces individus avait trouvé au fond de lui-même la Parole propre à identifier le sacré. Un pas de plus nous oblige alors à penser que ce sacré n'est autre que le moi lui-même. Qui suis-je ? Je suis le sacré. Dans mon fors intérieur gît quelque part ce que les théologiens reconnaissent comme la partie divine de l'être humain. Ce qu'ils ont baptisé l'âme, monade de divin, résidu de notre être-ange originaire, ange déchu et enfermé dans la matière.
Mais cette monade est vide. Elle ne contient aucun "qui", et toute recherche qui se contenterait de l'idée que notre moi recouvre en gros ce que les religions nomment l'âme, n'aurait pas avancé d'un pas. Elle aurait en fait renoncé au plus important, savoir de quelle âme il s'agit. Car même si on demeure fidèle à des représentations mystiques dans le genre chrétien ou même hermétique, les âmes ne sont pas toutes identiques même si elles sont toutes partie intégrante de Dieu, car l'Enfer lui-même est peuplé de créations divines. Dire que nous sommes les enfants de Dieu ne répond pas encore à celle de savoir si nous appartenons aux anges ou aux démons. La grande angoisse qui nous possède tous n'est-elle pas cette question toute simple : suis-je un type bien ou un salaud ? Question devenu bigrement urticante depuis qu'un certain Sigmund Freud nous a appris que la vertu est souvent le masque des pires vices. Mais n'anticipons pas sur le programme que nous nous sommes fixé. La première question est "comment se connaître soi-même ?". Nous reviendrons plus tard sur le pourquoi réel et il ne faudrait pas penser que la question de la vertu soit à elle seule la réponse.
Comment appréhender un mode d'emploi de l'introspection ? Cela paraît bien absurde, comme si l'examen de conscience n'était pas un phénomène qui aille de soi, comme s'il était nécessaire de prendre des précautions pour une activité qui n'a nul besoin de notre attention et de notre volonté. Les moteurs ne manquent pas pour nous y contraindre. Les sentiments, pensez par exemple au remord, ne laissent passer aucune occasion pour interpeller le sujet, lui enjoindre d'aller voir "qui " il est pour rendre compte de ses agissements. Or cette façon de décrire ce qu'on pourrait appeler une introspection naturelle, est précisément la manière perverse et pervertie de représenter le geste de s'interroger. Elle postule une passivité tout aussi naturelle du sujet, d'un sujet lui-même dominé par une force transcendante qui se manifesterait par le biais des sentiments, liens électifs entre l'homme et son dieu. De Böhme à Berkley en passant par Bérulles et Malebranche, il ne s'est rien dit d'autre. La force idéologique donnée à ces représentations en ont fait des évidences psychologiques : les sentiments nous sont donnés, ils échappent totalement à notre volonté et nous dominent de toute leur stature et nature divines. Et pourtant, c'est avec de telles évidences qu'il faut en finir, car les sentiments ne se laissent pas plus saisir dans un concept que le moi, et pour cause puisqu'ils le constituent en même temps qu'ils le défont sans cesse, génération et corruption dont le moi détient finalement le véritable secret. Pourquoi poser la question du moi si les sentiments étaient suffisants pour en décider et l'identifier ? Mais alors, si on ne peut pas se fier aux sentiments, ni aux autres affects comme l'émotion ou la passion, si le moi est premier, comment l'interroger ? Comment entreprendre l'action dont le but serait l'auto-connaissance de soi-même ?
La première réponse est une Lapalissade : se prendre pour objet. S'appliquer à soi-même les techniques et les logiques de la connaissance objectale. Se prendre pour un objet, mais pas n'importe lequel, se prendre pour L'objet, pour le seul véritable Objet. Au fond, partir du postulat que toute notre réalité, toute notre vérité, tout le secret de l'univers se trouvent là dans notre moi. Qu'il est la source inconditionnée non seulement du savoir, mais de toute réalité. En somme, qu'il est bien une parcelle de la divinité, mais une parcelle indépendante, une monade divine à l'oeuvre dans le réel. Leibnitz a été l'un des seuls génies à saisir de son regard d'aigle tout l'ampleur du sujet et tout le ridicule de la dichotomie du sujet et de l'objet. C'est pourquoi il était convaincu que c'était en lui-même, dans son esprit, qu'il trouverait la caractéristique de l'univers, le secret de la réalité, son équation mathématique. Et il est sans doute vrai que si la réalité pouvait se restreindre à l'expression mathématique, c'est bien de l'esprit d'un individu lambda qu'elle pourrait un jour surgir. Mais, à propos, ne tournons nous pas en rond à l'intérieur même de cette dichotomie du sujet et de l'objet ? Dire qu'il faut se prendre pour le seul Objet, n'est ce pas confirmer absurdement la légitimité de cette dualité ? C'est là que se trouve la difficulté, le punctum caecum, point aveugle de cette réflexion. Car si le moi devient l'objet, où se trouve le sujet ?
On sait qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a donc pas non plus de sujet. Voici la première réponse logique à cette difficulté. Mais il ne s'agit là que d'un échappatoire. En fait, la feinte, la fiction consiste toujours à représenter la relation, la relation entre moi et le monde, entre moi et le moi, alors qu'en vérité il n'y a pas de relation mais il y a un être-avec ou un être-dans. Et cet être est dans son connaître, il n'est que dans son connaître, autrement dit, l'impératif connais-toi toi-même ne fait rien d'autre qu'enjoindre à l'homme d'être. Mais cessons à nouveau d'anticiper. Restons dans le mode d'emploi le plus simple. Ai-je progressé dans ma démarche méthodologique ? Oui, parce qu'il y a encore quelques instants, je pensais être un sujet extérieur à mon propre moi, et dans cette position je ne vois pas comment je pourrais parvenir à identifier mieux cet objet qu'aucun autre objet de l'univers ou de ma pensée. Mais si j'admets que moi et moi font un, j'ai gagné une position à partir de laquelle s'ouvre un vraie possibilité d'associer l'acte de connaître à celui d'être. Il suffira d'ouvrir les yeux. Berkley, lui, a eu ce génie de tout résumer par l'idée du regard divin qui traverse l'homme et auquel l'homme participe par sa conscience. L'immatérialisme ou l'idéalisme du prélat anglais facilitent encore la compréhension de ce qu'il voulait dire, car ce regard n'est rien d'autre que la création continuée du monde. Dieu regarde, et dans ce geste il crée, dans ce regard naît et renaît sans cesse la réalité à laquelle je ne participe que pour autant que je la regarde du même regard que Dieu, le regard qui crée.
La conclusion mathématique est limpide : si mon regard crée, alors tout ce que je vois et tout ce que je sens forment le moi. Le moi n'est pas un fantôme tapi au fond de l'une de mes cellules nerveuses, il n'est pas un tableau que je pourrait peindre en faisant de grands efforts, il n'est pas une équation que je pourrais tirer de la computation de mes actes passés et présents, il est le tout de ce dont j'ai conscience. Autrement dit, la connaissance de soi-même est l'essence même de la connaissance, mais la moindre connaissance qui ne porterait pas le nom d'introspection n'en est pas moins introspection. Philosophies, sciences, savoirs les plus divers et les plus communs, simple mode d'emploi ou recette de cuisine, tout devient connaissance de soi dès lors qu'on y a jeté un regard. Alors, quel est donc l'intérêt particulier de cette connaissance particulière appelée introspection ? Encore que ce mot est tardif, issu du siècle qui a poussé à l'extrême l'objectivation du monde et laisse supposer qu'il est possible d'appliquer au moi tout l'appareil méthodologique et pratique de la science. Il vaut mieux le laisser tomber car il possède de surcroît un fort relent chrétien qui rappelle la confession, encore Saint Augustin. Reste l'essentiel : le moi est le seul objet dont la connaissance est garantie, ou plutôt comme le disait Descartes, heureusement il y a le moi, faute de quoi nous ne saurions rien connaître du tout. En me relisant jusque là, je vois bien que j'ai failli à ma tâche, ou du moins que je n'ai pas réalisé mon programme qui était de vous dire comment il fallait s'y prendre pour se connaître. Pourtant, je crois vous avoir donné quelques précieuses indications sur la véritable place du moi dans l'acte de connaître : la première. On pourrait dire cela de la manière suivante : c'est la question naturelle du moi qui entraîne automatiquement toutes les autres questions poursuivant une quête de savoir. C'est pourquoi le philosophe ou le savant, l'Homme tout court, chacun, doivent toujours revenir sur ce moi, reprendre le chemin de la connaissance vraie afin de ne jamais briser le lien entre cette connaissance-là et toutes les autres.
Est-il encore nécessaire de répondre à la seconde question du pourquoi ? Non, et oui. Non car nous y avons répondu déjà par deux fois, oui car cette réponse risque toujours de n'être pas comprise ou de l'être mal. L'auto-connaissance nous enjoint à être : dès que nous cessons de nous poser la question de notre moi, nous cessons pour ainsi dire d'être. Dès que nous cessons de prendre ce moi pour objet nous disparaissons. Oh bien entendu, lorsque fatigué notre intellect se détourne un instant de ce moi, il y a tout un registre psychique qui est prêt à prendre la relève, les sentiments, les émotions, les sensations ou encore les passions. Mais cette relève est toujours insuffisante car il y manque en général la volonté. Seuls les génies, mais nous sommes tous des génies, savent allier naturellement le sentiment et la volonté parce qu'ils savent transmuter les messages de leurs sentiments en expression rationnelle, c'est à dire visible et compréhensible. Mieux, ils s'y sentent comme contraints et leurs actions artistiques leur échappent autant que nous échappent la plupart du temps les significations de nos propres affects. Mais acceptons l'idée que nous sommes tous des génies et que tout ce que nous faisons se traduit par une réalité visible et compréhensible. Si elle n'apparaît pas à tous immédiatement, c'est parce que nous nous ressemblons encore beaucoup trop, à cause d'un phénomène historique qui nous a passés dans une tréfilerie humaine et modelés selon des canons standardisés pour cause de socialisation. Pour savoir qui vous êtes, regardez autour de vous et écoutez ce que vous entendez. Vous serez surpris de constater à quel degré de ressemblance vous pouvez arriver dans la comparaison entre cet univers et celui qui se cache en vous-mêmes. D'autres vous dirons : étendez-vous sur un divan, parlez et écoutez-vous parler. C'est la même chose élevée au degré de la parole, ce qui en fait l'efficacité mais qui en même temps déforme le message, car il en reste souvent l'idée qu'il n'y a plus que le moi, qu'il n'y a plus que sa petite personne à prendre en considération tant elle est singulière et sacrée. Le psychanalyste vous rendra un grand service, mais il y a ce danger de vous découvrir si seul et si sacré qu'il ne vous restera plus qu'à vous fuir définitivement dans la mort ou dans le divertissement pascalien, cette fois consciemment accepté.
Mercredi 12 septembre 2001
C'était donc ça Pearl Harbor ? J'allais dire "que ça", mais je sens bien que ce ne serait pas compris et il n'est pas de saison de minimiser d'une manière ou d'une autre l'horreur de ce qui s'est passé hier, 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Moi-même je n'ai pas eu de chance, par le plus grand des hasards j'ai pu suivre toute la tragédie minute par minute par télévision interposée et j'avoue que le choc est dur. Ce fut comme si la Terre parlait elle-même, comme si le lien intime et occulte que chacun de nous entretient avec la planète se mettait à tirailler dans tous les sens, faisant partager directement les souffrances des victimes à tous les témoins. Au bout d'une heure je me suis rendu compte que tous ces événements m'affectaient directement, m'angoissaient et m'épuisaient simultanément. C'était MA paix qui se trouvait soudain remise en cause, c'était le retour à mon premier vécu de la vie, celui d'avant 1945. Dans mon salon flottait une odeur de poudre, comme là-bas près de l'usine de la SACM et des canons qui tiraient en direction du Rhin et des troupes allemandes qui fuyaient. Bref, la mondialisation est déjà beaucoup plus avancée qu'on ne le pense, en même temps que l'individu naît un peu partout sur la Terre, le tissu organique de l'Humanité se refait et nous compatissons tous naturellement, sans même réfléchir. Impossible de ne pas se mettre dans la peau de ces passagers sacrifiés aveuglément ou de ces personnes saisies dans le cours de leur existence et contraint par la terreur à se jeter dans le vide de plus de cent étages ! Effrayant ! Quel Jérôme Bosch peindra cette horreur ? Quel Dante décrira ce qui s'est passé sous ces nuages de fumée apocalyptique. Seule la vitesse des événements aura peut-être manifesté quelque pitié pour les uns et les autres, je pense notamment aux passagers des avions sacrifiés qui n'ont certainement pas su où les conduisaient les monstres qui ont perpétré ce crime contre l'humanité.
Car ce sont des monstres, des monstres que je dénonce depuis des années dans ces lignes et dont personne hélas ne soupçonne assez le degré de monstruosité. Spirituelle. Il ne faut pas se cacher qu'il s'agit d'une nouvelle guerre de Religion, celle dont je parlais encore il y a quelques jours. Ironie du sort, c'est la Nation la plus religieuse du monde, la plus chrétienne et la plus dogmatique qui en est la première victime. Et c'est logique puisque c'est aux States que l'intolérance religieuse n'est pas conçue dans toute son horreur et avec toutes ses conséquences. Au point que les Américains ont baissé leur garde. Car ils ont dû baisser leur garde, dans les aéroports, à leurs frontières, dans leurs services secrets et dans leur cabinets politiques. Comment comprendre leur mansuétude à l'égard des Talibans depuis si longtemps, que dis-je mansuétude, complicité en vérité ! Washington a toujours fait spontanément confiance aux mouvements religieux, aveugle devant les ultimes conséquences du fanatisme, incapable d'évaluer correctement l'essence de la civilisation occidentale et de sa réalité absolument antinomique avec les logiques de la Foi. Certains ont indiqué hier dans leurs commentaires que les premières erreurs se situent déjà dans les années 70 lorsque les occidentaux ont fini par choisir Khomeyni contre le Shah d'Iran. Même moi j'ai fait cette erreur sur la foi des anciens liens qui avaient uni jadis le nouveau dictateur iranien avec Mossadegh, le héros de l'indépendance de la Perse. Et j'avoue que ce fut une erreur grave et impardonnable, qui montre bien que dans l'athéisme aussi il y a des degrés de maturité. On ne "bouffe" jamais assez de curé, jamais. Car en réalité il ne s'agit pas de bouffer du curé, mais de protéger la Raison et tout ce qui s'est péniblement construit autour de cette Raison contre l'obscurité des croyances
Que va-t-il se passer maintenant ? Il y a deux possibilités. Ou bien Washington et ses Alliés comprennent foncièrement ce qui s'est passé hier, comprennent les mobiles réels de ces kamikazes au bandeau vert, de ces assassins drogués par les doctrines. Il se pourrait alors que l'horreur d'hier puisse nous apporter quelques progrès et rendre utile le sacrifice de ces centaines d'Américains. Mais il se pourrait hélas que des hommes comme Bush, eux-mêmes aveuglés par la Religion, ou convaincus qu'on ne peut pas gouverner le monde sans l'utiliser, n'invoquent une fois de plus le Christianisme et ne nous placent une fois de plus dans une guerre de Religions à la dimension de la planète. Un Dieu contre un autre, la pire des perspectives à concevoir. Or c'est à cela que doivent aujourd'hui réfléchir tous les décideurs, tous les hommes responsables de ce qui va se passer maintenant. On risque de ne pas comprendre avec assez de clarté que l'inhumanité des terroristes n'a que cette seule source : le fanatisme doctrinaire. Qu'au nom d'une doctrine il devient possible de vouer aux gémonies TOUTES les valeurs de l'Humanité. Si tel était le cas, cela signifierait en clair que les Américains, au fond, approuvent silencieusement les monstres qui les ont agressés hier d'une manière aussi lâche et aussi félonne. Mais je n'ose pas le croire, le préfère penser que l'acte des terroristes aura aussi été leur suicide définitif, la preuve de leur incapacité à vivre et à accepter l'existence et la question de son sens. Au fond, ces terroristes ne sont que des impuissants qui ont avoué hier qu'ils vomissaient la vie au nom d'un au-delà fantasmatique. Dire que Washington était parvenu à la notion de Zéro-victime dans les conflits qui pouvaient surgir, preuve du haut degré de compréhension de la valeur de la vie ! Je ne peux qu'espérer que cette doctrine soit confirmée et qu'on ne se lance pas à nouveau dans un conflit sans fin et dans la surenchère au suicide collectif.
Je ne suis pas fier de ce que j'ai prédis il y a encore quelques jours, lorsque j'ai écris que ce serait l'Amérique qui serait visée par la prochaine guerre. Je pensais encore aux Chinois parce que Bush était en train de monter toute une diplomatie infernale en Extrême-Orient, mais le résultat est le même. Ce Président, dont on a pu mesurer hier combien il était désemparé, abattu par l'évidence et impuissant à maîtriser le sens des événements, n'est pas un cadeau pour la circonstance. Mais il vaut mieux penser que les circonstances font l'homme est qu'il est possible que même lui se réveille et se montre finalement à la hauteur. Je ne pense d'ailleurs pas que son peuple ne lui laisse la moindre nouvelle marge d'erreur, comme celle qu'il a commise au Moyen-Orient en délaissant le conflit qui alimente toute la nouvelle théologie de la violence. Oui, c'est bien de Jérusalem que provient tout le Mal, c'est bien ce conflit aberrant qui produit planétairement des conséquences qui n'ont rien à voir avec les dimensions géopolitiques réelles de la zone en question. Cela devrait montrer la force réelle des motivations religieuses et forcer les occidentaux à imposer une solution définitivement pacifique à Israël. L'Afghanistan est l'autre épicentre de ce tremblement de terre politique, et il est grand temps que l'Occident et l'Orient s'accordent pour mettre fin à cet état terroriste et liquider les vrais fauteurs permanents de crimes contre l'Humanité. Quant cessera-t-on de tolérer la barbarie dont les Talibans imposent le spectacle au reste du monde ? Comment à-t-on pu s'en prendre à Saddam Hussein pour sa petite conquête irrédentiste du Koweit avec autant de brutalité alors qu'on laisse des monstres barbus parader dans les couloirs du pouvoir mondial. Il faut enfin comprendre que ces soi-disant étudiants ne se sont pas proposés de vivre leur folie entre eux dans les limites de leur pays, mais qu'au contraire leur vocation est la conquête du monde et qu'il n'auront de cesse de mettre le monde entier à feu et à sang. C'est ça la logique des religions, de toutes les religions car il y va de leur sens, il y va de la seule démonstration dont elles sont capables, celle qui se termine dans la mort et l'obscurité.
La question qui taraude intimement tout le monde : comment peut-on aller ainsi gaiement à la mort ? Celle des autres, bien sûr, mais aussi la sienne ? Il faut imaginer une sorte de satiété qu'auraient inventé les commanditaires de ces monstruosités, une manière de combler en quelques semaines tous les désirs de ces futurs kamikazes, au point de les persuader que dans cette vie ils ne trouveront plus jamais de tels moments de, de quoi ? De bonheur ? Certainement pas, de délices ? Peut-être, des instants d'intense jouissance tels que seuls peuvent en offrir des drogues et beaucoup d'argent. Sans doute doit-on leur offrir pendant quelques mois cela même qu'ils escomptent, les crétins, dans le monde de l'au-delà, puis ciao. Ce n'est rien d'autre qu'une méthode de guerre comme une autre, une manière de former des combattants d'un certain calibre, certainement très difficiles à trouver et à persuader, et surtout très chers à entretenir. Bien sûr le Coran les aide beaucoup à se faire une idée de ce qu'ils désirent ici et là-bas : des délices gastronomiques, de la servilité autour d'eux et beaucoup de sexe sous toutes ses formes, tout cela se trouve dans nombre de ces sourates qui décrivent les récompenses divines. Quel connerie ! Mais je demeure persuadé que le marché est plus simple que cela : ou bien je (moi, Oussama Bin Laden) je te donne maintenant, tout de suite, de quoi te combler pendant disons un an, à condition que tu acceptes de te suicider à l'issu de cette période paradisiaque. Ou bien tu n'as rien du tout, et tu vas vivre médiocrement toute ta vie, tu n'auras rien eu du tout que de ramper dans les camps de réfugiés et dans des petits boulots que le hasard te permettra de trouver ici et là. Ces kamikazes sont de petits épiciers sans scrupules et certainement sans la moindre morale, et rien d'autre. Le tout c'est de savoir payer. Hier il faut reconnaître qu'ils l'ont fait sans barguigner. Il suffit de se reporter aux méthodes employées jadis par le Vieux de la Montagne, le célèbre chef des Haschischin, étymologie du mot assassin, cela suffit pour les décrire. Le vieux sorcier utilisait exactement la méthode que je viens de décrire pour recruter ses troupes et il les envoyait à la mort de la même façon. Rien de nouveau sous le soleil et il faudrait éviter de trop s'émerveiller à propos de ces faux héros de contrebande. En revanche, il serait instructif d'enquêter dans tous les lieux où se cultivent les délices de Capoue, car le suis convaincu que ces chérubins d'un genre spécial exigent de pouvoir jouir comme tout un chacun, c'est à dire dans les grands palaces et sur les plages de luxe de toute la planète. Allez donc voir à Acapulco ou à Ibiza, c'est là que vous trouverez ces apprentis tueurs kamikazes. Regardez bien. Une seule difficulté : il n'est même pas indispensable d'être d'origine musulmane pour être susceptible de faire partie de cette armée d'anges maudits. N'importe qui fait l'affaire et le monde ne manque hélas pas de ces gens-là
Samedi 15 septembre 2001
V.I.T.R.I.O.L. : visita interiora terrae rectificando invenis occultu lapidem. Certains initiés connaissent bien cette injonction alchimique à chercher la pierre philosophale dans les entrailles purifiées de la terre. Terre qui n'est autre que ce moi dont nous parlions il y a quelques jours. Le secret de la chrysopopée, de la transmutation du plomb en or, c'est la connaissance de soi-même. En cherchant à se connaître, l'individu se transforme, se bonifie. Cette idée repose sur une vision du monde dont nous ne sommes plus guère capables, car elle transcende la dualité de l'esprit et de la matière. Elle identifie l'être des choses avec l'image abstraite que nous nous en faisons, l'être comme sujet intérieur, comme moteur de l'intellect. La terre est conçue comme corps de l'être, au même titre que notre corps. Il n'y a pas seulement ici le jeu entre les concepts médiévaux de microcosme et de macrocosme, présents dans toutes les cultures du monde, il y a plus. Il y a un véritable sentiment d'identité entre les choses matérielles et les objets de l'esprit; en fait, le sage ne découvre rien, il remet les choses à leur place, il fait se superposer la vérité intellectuelle et le mystère de la parousie, de l'apparition perpétuellement recommencée du monde. Comment se rapprocher rationnellement de cette pensée si étrange ?
L'UN et la sphère. L'univers est la carrière dans laquelle les hommes puisent les signes avec lesquels ils construisent leurs temples théoriques. Comment, en effet, transformer en parole, en langage, l'intuition immédiate de l'être du tout. Tout ce que nous percevons, tout ce qui entre dans nos champs de saisie psychique et physique possède une qualité indéniable : il EST. Il possède l'être. On dit : il y a ceci, il y a cela, et on ne peut en aucun cas nier que tout ce que nous voyons et sentons soit. Or, si on cherche à figurer cette qualité d'être, il faut trouver dans tout ce que nous percevons avec les yeux, un objet qui possède cette qualité totalitaire et qui s'identifie visiblement avec l'unité du phénomène. Cet objet est la sphère, figure astronomique et géométrique qui a pris progressivement dans l'histoire de la Pensée la place de tous les autres objets cohérents qui pourraient suggérer la même totalité et universalité. Placez-vous face à une sphère, vous verrez toujours la même chose, quel que soit l'angle sous lequel vous percevez cette figure, elle conserve totalement son identité, exactement comme l'être qui est pour ainsi dire également répandu en toute chose. Prenez un cube, ce n'est pas pareil : si vous ne considérez qu'une des faces de ce cube, c'est bien une surface homogène et en tout point identique que vous verrez, mais vous ne pourrez pas ignorer les limites et les angles de cette face qui viennent interrompre l'extension de cette surface une. Si vous tournez le cube, vous verrez apparaître des angles et des droites de diverses dimensions, la perspective brise l'objet : c'est quoi ces angles, ces droites ? Ils sont autre chose que ce dont est faite la face que vous venez de contempler, ils viennent rompre l'unité, l'harmonie immédiate de la vision. La sphère, elle, n'offre aucun obstacle intérieur, elle est la parfaite représentation d'un objet qui possède une seule et unique qualité. De qualité unique, le monde n'en possède qu'une seule, l'être. L'être est l'attribut unaire du tout. C'est pourquoi l'être est traduit spontanément par cette figure de la sphère.
J'ai repensé à cette analogie dont j'avais déjà parlé dans mon petit texte d'ontologie intitulé Troisième Entretien Préliminaire. La figure de la sphère ouvre la voie à toute une logique déductive qui permet de s'approcher de cet attribut fondamental de l'univers qu'est l'être. Le mystère de l'étantité des choses trouve une porte d'accès qui s'ouvre sur un chemin qui se déroule tout naturellement pour labyrinthique qu'il puisse être. Le mot étantité n'est absolument pas abscons, il semble difficile à comprendre parce qu'il a été abandonné trop longtemps dans l'histoire de la Pensée, mais il ne dit rien d'autre que le fait pour un objet d'être : il est "étant", et on peut forger le substantif étantité à la place du verbe être, qui reste un verbe et à ce titre introduit une confusion dans son emploi. Ce chemin est forcément géométrique (more geometrico) et il prendra les formes des relations que l'on peut découvrir et dérouler à l'extérieur et à l'intérieur d'une sphère. Le centre de la sphère marquera le cœur de la vérité autour duquel elle tourne . Cœur, axe, rayons et diamètres, double impression de mouvement et d'immobilité que seule la sphère offre au regard, intuition de l'unité de la matière qui compose le volume, illustration éclatante de la différence entre l'intérieur invisible et secret et l'apparence contingente de la surface, relations qu'entretient la sphère avec les autres figures géométriques (par exemple le cube qui se transforme en sphère lorsqu'il entre en rotation rapide), tous ces éléments se retrouvent dans la théorie de l'être. La sphère est le secret du rôle qu'ont joué les mathématiques dans l'histoire de la philosophie, mais les mathématiques ne sont pas et ne seront jamais le secret de la philosophie elle-même. Encore une fois : une équation de l'univers ne pourra jamais inclure la place de celui qui la produira, sauf s'il était Dieu lui-même, et là se trouve tout le piège théologique dans lequel la philosophie s'est retrouvée pendant les derniers millénaires monothéistes.
Cette sphère est le monde, mais aussi le MOI, cet objet intérieur dont on cherche à percer le secret. Entre le centre du MOI et sa périphérie il existe des mouvements ascendants et descendants. Le regard intérieur descend vers le centre pour quérir pour ainsi dire des visions du centre, de l'axe, mesurer les rayons et les diamètres, évaluer le rapport entre la matière et son apparence de surface. Les produits de ces visions remontent vers la surface et sont traduits en paroles, en langage. Enfin, tous ces mouvements incessants finissent par s'installer entre les sphères des MOI elles-mêmes : l'altérité se joue d'abord sur cette scène de l'aller et venue du regard intérieur, de l'introspection, action native de la conscience. L'Autre devient le centre d'une autre sphère, extérieure, qui parle aussi sa relation avec son centre, qui accorde plus ou moins bien son langage avec le mien. Et c'est là que se joue l'Histoire des Hommes : le problème que chacun rencontre spontanément dans son monologue introspectif devient un problème collectif à travers les contingences du vivre-ensemble, de la création de sociétés humaines. Je dis contingence parce que je demeure convaincu que dans le monde nomade d'avant le néolithique cette quête du secret de l'être était nécessairement solitaire. Elle n'était pas pour autant de moins bonne qualité, au contraire, mais elle tournait en somme en rond, dans la sphère solitaire du MOI. Les descriptions que fait Attali du nomade dans ses "Chemins de Sagesse" montrent bien à la fois les qualités que doit posséder le nomade, mais aussi les avantages du nomadisme socialisé par l'Histoire. Ce qu'il ne dit peut-être pas assez en détail, parce qu'il n'est pas vraiment un spécialiste de l'ontologie, c'est la nouvelle dimension qu'a acquis V.I.T.R.I.O.L. après dix millénaires de souffrances liées à la sédentarité. Et mon hypothèse est précisément que le néolithique n'est que l'application d'un accord universel. Le passage à la vie sédentaire a été le choix de cette perlaboration socialisée de la question de l'être. Le labyrinthe, quant à lui, est effectivement le message global de ces nomades à notre monde, il donne la clé de la porte qui s'ouvre sur un chemin, et en même temps la figure du centre ontologique qu'il faut atteindre, et ainsi le transformer. Il faudra chercher dans cette volonté de transformation la reconnaissance d'une nécessité de changer de méthode, c'est à dire de créer un langage universel qui permette d'aller plus loin dans la connaissance et la transformation du MOI. C'est ce qu'on a pu appeler le progrès, ou encore la morale qui n'est à l'origine qu'une pure volonté de changer les mœurs en direction du Bien.
Dimanche 16 septembre 2001
L'intranquillité gagne le monde. Mais cela ne signifie pas qu'elle vient simplement de naître. Les images d'Amérique ne font qu'afficher dans le langage de l'œil une réalité permanente, celle de l'économie de la violence. Quelques philosophes, comme Heidegger, nous ont depuis longtemps avertis : le temps est venu de l'absence de guerre et de paix. Or, cette absence ne réduit ni le risque de la violence ni la chance d'un état pacifique. Le terrorisme n'est qu'une forme diffuse de la violence, aussi diffuse que celle qu'ont connue sans doute les nomades d'autrefois. Il s'agit de la disparition beaucoup plus rapide et surprenante que prévue des ensembles nationaux ou impériaux. Le nouveau terrain de la violence est le spirituel, et c'est là le nouveau grand danger, mais c'est aussi la phase indépassable et ultime du processus de l'Etre. Le fait que ce soit la Religion qui revienne à nouveau opposer des hommes à d'autres hommes reçoit deux explications.
La première est simple à comprendre : l'Islam est l'ultime refuge de l'idée d'une transcendance absolue et indiscutable, c'est à dire qui ne reçoit aucune médiation rationnelle et ne peut pas supporter l'existence d'un quelconque agnosticisme, encore moins de l'athéisme. Cette religion se conçoit elle-même comme une réponse ontologique absolue, même si à l'origine elle occupe la même fonction que les autres, à savoir de faciliter le tissage de la socialité des sociétés naissantes. Le fait, d'ailleurs, que cette religion soit le produit d'un peuple encore nomade au moment de sa fondation, peut éclairer le côté prosélyte de l'Islam, l'instinct de conquête des âmes, beaucoup moins puissant dans les religions sédentaires, excepté la judaïque, pour les mêmes raisons. Ceci explique cela : Juifs et Musulmans sont de même extraction sociologique (pour parler vite) et la lutte théologique qui les oppose est exacerbée par l'intransigeance des positions respectives. De plus, le Judaïsme, comme je l'ai noté ailleurs, peut se concevoir comme un athéisme, au sens où l'interdiction de nommer dieu peut correspondre à un déni psychanalytique. Refuser de donner un nom à un objet revient forcément à en nier l'existence, c'est le b a ba du lacanisme.
La deuxième raison est bien plus profonde : le retour du nomadisme confronte les hommes à leur véritable destin en supprimant d'un coup tout un champ de divertissements qu'ils s'étaient fabriqué dans le monde fixe des empires et des nations. En fait, le sédentarisme apparaît bien comme une domestication fondamentale de la violence : la défense de la terre donne un sens immédiat à la révolte ontologique de l'Homme. L'Islam, pour sa part, n'a jamais vraiment encaissé cette dérive spirituelle, et j'en veux pour preuve son impuissance congénitale à former des ensembles sédentaires stables et précis. La carte des pays musulmans et leur histoire montre à l'envi que les frontières n'ont jamais eu de sens pour les décideurs de cette religion. Ainsi, on évoque souvent la puissance de l'Empire Ottoman qui a dominé le pourtour méditerranéen pendant cinq siècles. Mais on oublie toujours de décrire avec précision comment était structurée cette domination, c'est à dire de montrer combien peu comptait le territoire lui-même. Les Turcs, en fait, avaient réseauté l'Europe méridionale sans pour autant s'attarder à posséder l'espace lui-même, ils parasitaient cet espace à partir de points d'appui militaires, sans s'immiscer dans les mécanismes de propriété terrienne. Cette attitude leur a d'ailleurs valu une popularité qui explique aussi la durée de leur domination. Comment expliquer l'impact culturel des Turcs sur la Grèce elle-même et sur les Balkans sinon parce que le joug ottoman était l'un des plus légers du monde. L'histoire récente de l'Irak montre bien qu'en plein vingtième siècle les peuples de la Mésopotamie n'ont toujours pas réglé à la manière occidentale la question des frontières. Pourquoi ? Parce que l'Islam entretient des relations équivoque et pratiquement impossibles avec la propriété privée. Un Empire musulman n'a pas le même sens qu'un Empire occidental parce qu'il est d'essence nomade.
Nous sommes dont confrontés au premier accident ontologique de l'histoire du retour du nomadisme. D'un côté l'Islam qui ne veut plus reprendre la quête du sens ou la question de l'être à son commencement mais seulement confirmer la réponse qu'elle a donnée il y a maintenant quatorze siècles, de l'autre l'Occident dont les réponses affaiblies par des guerres de religions extrêmement précoces ont perdu leur force de stabilisation spirituelle. Mais le temps n'est plus à la stabilisation de sociétés qui sont condamnées à disparaître. Le temps est venu pour l'Occident épuisé par l'aveuglement scientiste de remettre sur le métier la question de l'être à nouveau frais, en gérant du mieux qu'il pourra le décalage entre lui et l'Islam et en tenant compte des ensembles religieux qui continuent en son propre sein à s'enfermer dans des doctrines religieuses peu différentes en terme d'intolérance que celles qui ont mis, lundi dernier, le feu au cœur de Manhattan.
Lundi 17 septembre 2001
Dans la logique de ce qui précède. Le passage, ou le retour à la posture nomade, entraîne des conséquences nécessaires. La plus évidente est le retour à l'individu de sa liberté ontologique. Cette liberté, l'individu sédentaire l'aliène presque spontanément à la collectivité ambiante, parce qu'il perd alors le monopole de la création de langage. Il ne peut plus ajuster la pensée qui le traverse à ses propres métaphores du monde, la société impose la grammaire. Or la grammaire n'est pas seulement un mécanisme fonctionnel d'expression, ce n'est pas seulement une simplification universelle de cette expression. La grammaire, la syntaxe et la maîtrise sociale du vocabulaire imposent de l'intérieur les contenus de la Pensée. Il faut bien constater, par exemple, que la langue chinoise ignore le mot ETRE, même si Lao Tseu y fait une unique allusion dans son principal recueil d'aphorismes. Il s'agit là, sans doute, du résultat d'une censure tout à fait comparable à ce qu'est devenu le concept d'être dans la théologie chrétienne, un simple substantif désignant Dieu lui-même.
Que signifie liberté ontologique ? D'abord la solitude face à la question de l'existence. Quel arrogance nous permettrait de penser que l'existence est un concept moderne, voire contemporain. Pourquoi penserions-nous que l'homme de la préhistoire était une sorte d'animal partiellement inconscient, totalement détaché de la question du sens ? Rien. La théorie des Lumières n'implique pas du tout un tel mépris, l'idée d'histoire, celle de progrès ont des frontières précises, celles de l'existence sédentaire. C'est dans l'espace impérial ou national que la pensée s'est obscurcie de la manière que nous évoquions plus haut, par politisation du langage. Progresser c'est donc d'abord sortir de cet obscurantisme philosophique enfermé dans une fausse parole. Ce n'est pas pour rien que les Chrétiens ont affecté la parole des Prophètes ou de Jésus-Christ d'un P majuscule, il s'agit de l'installation d'un véritable monopole du langage. Et de rien d'autre. Rien. Mais ce hold-up intellectuel avait une contrepartie non négligeable car il facilitait la gestion logiquement inextricable des relations sociales naissantes. Exactement comme aujourd'hui un feu rouge règle la circulation, les valeurs religieuses servaient à régler la nouvelle existence des hommes contraints de partager le temps et l'espace. Imaginez la puissance des hommes qui ont inventé cette technologie métaphysique là ! Pourquoi moines et prêtres traversaient-ils l'Europe du Douzième siècle sans le moindre danger alors que plaines et montagnes étaient habituellement à feu et à sang ? Cette impunité n'a rien de magique et ne dit rien sur la piété des peuples, elle prouve seulement la puissance naturelle des clercs, propriétaires des seules réponses ontologiques qui permettaient d'envisager de survivre dans la réalité féodale. ILS savaient, et ce savoir avait une puissance immédiate, un efficace direct sur tout groupement humain : même les bandits dépendaient alors de cette parole magique. Toujours sur le mode de la promesse politique : demain nous raserons gratis, demain la Rédemption, demain le Salut. Demain.
Cette parole est maintenant vide de ce sens pratique. Au mieux elle nous apporte encore certaines valeurs déjà présentes dans la praxis nomade, ce sont les valeurs que l'on peut globalement résumer dans le mot hospitalité. Au pire elle nous asservit à un objet transcendant, en rien différent des idoles de l'Antiquité. Le drame de la situation présente est donc bien celui-ci : par quoi la remplacer, alors que les sociétés se trouvent encore bien engoncées dans une sédentarité de fait ? Comment régler cette circulation des êtres confrontés les uns aux autres par leurs singularités incontournables ? Cette question explique la persistance des religions dans nos sociétés intellectuellement avancées, avancées signifiant ici dégagées des ukases de Rome ou de la Mecque. On vit sur un malentendu permanent. Depuis plusieurs siècles, en gros depuis la Révolution Française, le monde occidental s'est remis à évoluer dans le sens d'un retour du nomadisme, de la position nomade de l'être humain, tout en consolidant par ailleurs idéologiquement et matériellement la réalité sédentaire, notamment en fabriquant de toute pièce la notion de Nation telle que nous l'entendons aujourd'hui. Il faut noter ici que ce concept est effectivement révolutionnaire dans son acception originelle, mais il signifiait alors non pas territoire nanti d'un drapeau, mais société nantie d'une Constitution. J'ai relevé quelque part la parenté du mot nation avec le mot natif, l'idée de naissance : la nation est l'idée révolutionnaire d'une société de nomade qui passent un contrat social sur la base d'une Constitution. La nation est la naissance de cette société à travers l'élaboration constante de cette Constitution, car les révolutionnaires étaient bien conscients des contingences de l'histoire des peuples sédentaires. Mais, ce contrat en constante élaboration est devenu, par lâcheté historique, une vague idée de territoire enfermée dans des frontières et dans une identité fantasmatique. C'est aussi pourquoi il ne faut pas se précipiter pour condamner l'impérialisme napoléonien : Napoléon Bonaparte n'a pas cherché à d'abord conquérir des espaces et à se les approprier, il a d'abord cherché à exporter cette idée de Constitution. Elle n'a pas tardé d'ailleurs à s'imposer à tous les peuples qu'il a combattu. Les dérives ultérieures de son action sont à mettre au compte de sa propre solitude ontologique et de ses conséquences psychiques désastreuses.
Oui, la solitude face au sens de l'existence est à nouveau à l'ordre du jour. Il ne suffira bientôt plus de jouer sur les significations du mot Foi pour s'assurer d'un sens bon marché disponible sur les marchés religieux. Car la culture socialisée de la question du sens a produit des effets intellectuels irréversibles, le langage a subi une sorte de péréquation des significations qui a neutralisé les liens des principaux concepts avec les théologies. Si le nomade de la préhistoire était pratiquement dans l'incapacité de partager ses visions du monde par absence d'outils sémantiques, ce n'est plus le cas pour le nomade d'aujourd'hui. Nous possédons désormais de solides outils qui nous permettent de partager les idées et même de les élaborer en commun, sans pour autant aliéner notre liberté de penser : c'est ça le Progrès, et seulement ça. Mais à quels risques se trouve confrontée une telle liberté dans un monde qui n'a pas encore compris la nature de son essence nomade ? Depuis le onze septembre nous en avons une idée tragiquement précise.
Mardi 18 septembre 2001
Stratégies de mort : guerre et/ou terrorisme. Il existe en gros deux stratégies discernables dans les actes horribles des terroristes à New-York. La première recouvre ce que le Président Bush a lui-même qualifié d'acte de guerre. Il s'agirait alors du premier acte d'une série calculée selon les réactions prévisibles des Américains. La seconde impliquerait quelque chose d'en soi bien plus redoutable, à savoir un acte unique, sans suite, random diraient les Américains, c'est à dire aléatoire et uniquement destiné à tuer et détruire. Les autorités US ont à faire un choix décisif entre ces deux stratégies, car toute l'efficacité de leur propre contre-offensive dépendra de la justesse de cette option.
La guerre. Jusqu'à nouvel ordre, c'est l'option choisie par le Pentagone et la Maison Blanche, mais il faut tenir compte des effets d'annonce et de la quasi obligation dans laquelle se trouvait Bush de brandir les grands mots et de rassurer son peuple sur l'envergure de sa propre action punitive. Cela ne prouve encore pas que les Etats-Unis soient décidés à se lancer dans une telle guerre, dont les conséquences sont incalculables. En effet, admettons que le suspect numéro 1, le dénommé Ben Laden, aie conçu un plan à long terme, dont les attentats de mardi ne seraient qu'une étape déterminée (n'oublions pas les attentats précédents), on doit se demander ce qui va suivre et à quelles réactions s'attend Ben Laden lui-même.
A partir d'une estimation de la dimension concrète et symbolique de ces attentats de mardi, on peut conclure que leur commanditaire a une vision claire de la suite des événements. En premier lieu, il est vraisemblable qu'il n'a pas déclenché cette apocalypse sans s'assurer de sa propre sécurité, et donc de ses relations avec ses protecteurs afghans. Les faits semblent d'ailleurs confirmer la fermeté du gouvernement de Kaboul dans sa défense de Ben Laden : il nie toute implication de ce dernier dans les attentats et refuse de le livrer à la justice des Américains. Ainsi naît un premier élément qui plaide en faveur de la déclaration de Bush : c'est bien d'une guerre qu'il s'agit, d'une guerre qui commencera sans aucun doute sur le territoire afghan dans les jours qui viennent. Le scénario est si évident que toute la presse mondiale s'attend d'un instant à l'autre à une attaque. La réaction des Afghans eux-mêmes ne trompe pas non plus, le nombre des réfugiés qui se pressent aux frontières prouve qu'on est conscient de la catastrophe qui menace. On sait que tout se joue là et non pas ailleurs. C'est donc bien d'une nouvelle guerre qu'il s'agit, dans le style de celle du Vietnam ou des derniers épisodes de la reconquête de l'Afghanistan lui-même à la suite de l'occupation soviétique. La question que soulève cette conclusion est simple : Bush a-t-il de nouvelles armes magiques pour éviter de s'embourber dans ce pays impossible, perdant les uns après les autres les appuis indispensables des pays voisins ? Dans une telle stratégie, Ben Laden s'attend à un tel développement, estimant sans doute avec raison que ni une stratégie de bombardement ni une attaque au sol pour massives qu'elles soient, ne parviendront à emporter la décision. A moyen terme, la conséquence la plus dangereuse pourrait être l'apparition d'une alliance extrême-orientale ayant la Chine pour centre, les relations entre Pékin et Washington s'étant déjà considérablement dégradées depuis l'arrivée de Bush à la Maison Blanche. La tenue des Jeux Olympiques et l'admission de Pékin à l'OMC ne suffiront peut-être pas à dissuader les Chinois de prendre leurs distances avec l'occident dont le principal représentant, l'Amérique, ne cache pas ses préférences pour Tokyo et Taïwan dans le Monopoly géopolitique de l'Extrême-Orient. Une telle stratégie aboutirait donc à ce que je prophétisais il y a quelques semaines, à une guerre entre l'Amérique et la Chine, une guerre à laquelle les autres pays de l'occident ont à choisir dès maintenant de participer ou non. L'Europe, qui est dans ce cas, restera en marge de ce conflit, même si dans un premier temps l'Alliance Atlantique risque d'entraîner la plupart de ses membres dans un soutien direct à l'offensive américaine. Quoiqu'il en soit, la décision d'une offensive de guerre sur le territoire de l'Afghanistan est une terrible gageure qui comporte le risque de conforter la stratégie de mondialisation de la violence de Ben Laden, nouveau Vieux de la Montagne des temps modernes. Autre risque, un recul décisif vers une culture mondiale de la guerre. Ben Laden en sera le perdant car la religion ne jouera plus aucun rôle dans une telle réalité, mais les peuples de la planète risquent aussi de connaître un recul historique sans précédant.
L'autre hypothèse semble à la fois plus conforme à la nouvelle réalité du monde et nous place devant l'inédit, ce qui en fait tout le danger tant les responsables actuels paraissent loin d'envisager une telle possibilité et décidés à raisonner de manière erronée et rétrograde. Elle signifie en fait qu'il n'y a aucune logique idéologique ou même théorique à cette manifestation de violence. Qu'en fait, les auteurs de ces attentats soient d'origines tout à fait aléatoires, tant du point de vue des motifs spirituels que des mobiles proprement psychologiques. Il ne faudrait pas négliger l'éventualité de la naissance d'une psychose sociale, d'une nouvelle maladie mentale à l'échelle des sociétés qui n'aurait rien d'étonnant ni s'impossible. La nouveauté résiderait dans l'apparition aléatoires et sociologiquement réduite à de petits groupes de ces maladies collectives dont nous avons en réalité déjà connu quelques exemples dévastateurs tels le nazisme ou la folie qui a provoqué les génocides au Cambodge ou encore au Ruanda. La différence en serait que la base n'aurait plus rien de national ni même d'idéologique, c'est à dire proprement religieux ou politique. Il se produirait en fait une convergence due au hasard entre des individus aux motifs totalement étrangers les uns aux autres. C'est pourquoi il n'est pas impossible qu'un individu comme Oussama Ben Laden, au nom des valeurs de son Islam à lui, ne manipule une fraction de ces ensembles malades, par exemple en les finançant à leur insu. Si la plupart des terroristes qui ont précipité des avions sur les bâtiments américains semblent avoir eu des vies sans histoire avant ce jour fatal, c'est qu'il s'agit bien de personnes ayant eu quelques privilèges destinaux, les moyens disons, de se payer des vies d'ingénieur ou de play-boy. Il y aurait donc une combinaison diabolique de plusieurs facteurs : la principale action du cerveau y consiste à regrouper et orienter les forces pathologiques dans le sens de leur effectuation ou de leur passage à l'acte. Attali parle dans son traité du labyrinthe des coalitions passagères entre nomades dans des actions uniques et hors de tout plan à terme, c'est de cela qu'il s'agit.
Comment agir contre une telle réalité ? Comment réagir ? Il n'y a guère de moyen stratégiques ou tactiques connus contre de tels phénomènes sociaux. On peut, cependant, discerner un impératif absolu : l'étude de telles possibilités et la formation de nouveau intervenants sur la scène sociale, qui ne seraient ni à proprement parler des policiers ou des soldats, ni des infirmiers, mais qui tiendraient en fait des deux à la fois. Il faut, de toute manière, songer à former des agents capables de sonder la société partout où elle émerge publiquement. Ces nouveaux agents secrets passeront leur temps dans les bars, les boîtes de nuit et les stades, à observer les gens et à tenter de discerner parmi eux ceux qui portent les traits sémiotiques de la maladie. Car il doit y en avoir, il y en a. Il faudra, bien entendu, d'abord établir une fiche signalétique psychologique et sémiotique de ces individus, travail qui se fait en ce moment même dans les services secrets américains. Un profil qui permettra aux nouveaux enquêteurs de distinguer ces malades au milieu des bien portants et le plus souvent sous les traits des mieux portants. Et cela partout. Il n'est peut-être pas étonnant que les attentats les plus spectaculaires se passent aux States, car il me paraît évident que la maladie dont il est ici question a progressé beaucoup plus vite là-bas que dans la vieille Europe. Il n'y a que l'Allemagne qui comporte des cas de criminalité qui ressemble à de telles actions, et ce n'est pas non plus un hasard. Mais il faut garder à l'esprit que ces malades mentaux n'ont aucun but idéologique précis : ils veulent tuer et causer le plus de dégâts possible, ici ou là, peu leur importe, personne ne sera plus jamais à l'abri. Une dernière remarque : le nomadisme qui revient régler les relations humaines ne doit pas seulement bénéficier aux assassins, il faut que les gouvernements et les décideurs commencent à réfléchir aux transformations qu'il faut apporter aux structures de la sécurité. Le Pentagone est un symbole assez clair à ce sujet, il n'est plus qu'un amoncellement de pierres, un immense bâtiment inutilement centralisé et en réalité obsolète dans la conception de sa mission. Les terroristes n'ont pas manqué leur cible, précisément parce qu'elle est devenue une erreur théorique. Les structures sécuritaires doivent s'approprier la souplesse du nomadisme et la légèreté des guérilleros. Elle ne doivent pas, pas plus d'ailleurs que toutes les autres structures de gestion des sociétés, se massifier encore davantage pour finalement s'imposer comme la cible par excellence du Mal. Aviss.
Jeudi 20 septembre 2001
Leçon de tolérance. Le temps est venu de remettre les choses essentielles dans leur ordre véritable en les sortant de la confusion qui les obscurcit. Quelles sont ces choses essentielles ? Bien entendu il s'agit de ce qui ne peut pas se toucher du bout des doigts ni même du bout du regard, sauf peut-être pour les grands initiés, ceux qui savent rendre au réel toute sa valeur étante, toute sa substance ontologique immédiate. Mais, il s'agit aussi de ce qui apparaît, dans le langage actuel, comme les motifs idéologiques des actes majeurs de notre temps; que se cache-t-il derrière le massacre de Manhattan, que se cache-t-il derrière les discours qui parlent des réactions qui se préparent ? Le motif de l'intolérance se situe à l'avant-scène de tous les discours, autant de ceux qui qualifient les actes terroristes que de ceux qui semblent vouloir les combattre. Le Président Bush a parlé de croisade, les Talibans répliquent par le mot Jihad. Et nous voici ainsi littéralement coincé dans une opposition qui prétend définir ou sous-tendre la définition de l'idée de tolérance : selon que l'on soit d'un côté ou de l'autre, on conçoit la tolérance comme ce qui manque à l'autre. En clair, chacun s'attribue la valeur de tolérance, précisant même que cette valeur est au centre de sa doctrine, qu'il s'agisse de l'Islam ou du Christianisme.
Or, la tolérance est tout sauf une valeur intra-religieuse. Elle est au contraire entièrement déterminée par la relation du religieux avec le non-religieux. Il n'existe qu'une seule tolérance, c'est celle qui règle bien ou mal selon sa présence ou son absence un homme nanti d'une foi avec un autre homme non-croyant. Et dans cette perspective, les Musulmans paraissent plus cohérents parce qu'ils ne reconnaissent pas à la foi chrétienne ou autre ce caractère de véritable Foi, ils désignent en général tous les non-Musulmans comme des incroyants. Là se trouve évidemment une sorte de sommet de l'intolérance malgré les vigoureux démentis de la grande majorité des notables musulmans, je dis notables puisqu'il n'existe pas de clergé musulman stricto sensu, pas plus que de clergé juif. Pour saisir pleinement cette vérité, il faudrait se reporter à toute notre histoire, qui depuis l'Antiquité n'est qu'une vaste histoire religieuse. Cela ne signifie pas que l'athéisme est d'apparition récente, mais qu'il n'a jamais influencé directement le cours de l'histoire, il est resté jusque dans le temps présent un état marginal réservé à quelques héros de la Pensée. La tolérance est né de l'existence de ces quelques hommes qui émaillent l'histoire connue de l'homo sapiens.
Mais qu'est réellement l'athéisme ? Disons l'agnosticisme, car je préfère ce mot. Je le préfère car il évite l'idée d'opposition à la Religion qui hante le concept d'athéisme. Etre athée implique toujours l'idée d'une négation de l'existence d'un dieu, alors qu'un agnostique n'a pas besoin de détruire une idée qui ne l'effleure même pas. En réalité, un agnostique ne conteste pas l'idée d'une transcendance nommée Dieu, il se tient en marge du théâtre social global, il ne participe pas, ni pratiquement ni spirituellement, à la culture générale. Il n'adhère pas aux structures de pensée qu'on a préparées pour lui et dont on attend de lui qu'il les partage et qu'il les transmette au futur. En apparence, l'agnostique se contente de ne pas croire à l'existence d'une puissance ultra mondaine dont il lui est aisé de démontrer qu'il n'existe aucune preuve d'une telle existence. En fait, en refusant de paraître croire à cette existence, il trahit son refus de se solidariser de tout le sens de la Praxis collective, de partager le conte de fée universellement admis, la plupart du temps en toute connaissance de cause. La plupart des philosophes grecs ont toujours mis leurs disciples en garde contre le fait d'afficher leur agnosticisme parce qu'ils étaient conscients des dangers politiques d'une telle attitude. Ils savaient qu'il y allait au fond d'une simple solidarité culturelle que l'on manifeste en participant aux croyances décrétées communes, mais qui n'ont de commun que la terreur qui les cimente.
Car la principale conséquence de la sédentarisation des hommes, a été la contrainte à l'adoption d'un "cinéma" collectif, d'un scénario explicatif du monde auquel on est prié de participer, le plus souvent par la terreur de la puissance politique. Ce qui a toujours entraîné une dérive de ce scénario vers des dogmes qui confortaient les formes politiques en vigueur, et par exemple le schéma paternaliste du Christianisme. Celui-ci permet à la puissance politique de se substituer symboliquement à la puissance divine, il suffit d'ajuster la doctrine à la réalité des relations sociales du moment. La tolérance n'est donc pas un problème de religion à religion, mais, je le répète, de religion à non religion. Celui qui tolère c'est d'abord la société qui a choisi un cadre idéologique de référence qu'elle cherche toujours plus ou moins à imposer à l'ensemble de ses membres. Celui qui est toléré est toujours celui qui ne veut pas ou ne peut pas partager le scénario culturel commun. L'avantage fondamental de la société nomade aura été la liberté individuelle de penser. Les problématiques de la tolérance ne concernent que le retour possible aujourd'hui d'une telle liberté. Il est évident que le fait de replacer le problème de la tolérance entre deux religions n'a pas d'autre but que de compromettre une fois de plus une telle liberté en contraignant par la violence tous les individus à choisir entre elles. Les Croisades ou les Jihad n'ont jamais eu d'autre but que de faire disparaître dans le sang des uns et des autres l'idée même qu'il pourrait y avoir autre chose que ces deux religions. Pire : qu'il n'y a de vrai que le religieux, c'est à dire ce quelque chose d'inexistant mais dont l'inexistence elle-même permet le lien social, le clin d'œil de Nietzsche que ce font les bourgeois entre eux pour se signifier les uns aux autres qu'ils sont conscients de la farce qu'ils jouent.
La vieille Europe est bien embarrassée aujourd'hui, trois jours après que Bush aie prononcé et répété ce mot de croisade. L'agnosticisme avait fini par trouver un refuge en Europe et ses habitants ne sont pas prêts à jouer la farce américaine, si celle-ci se précise comme croisade de religion à religion. L'isolationnisme de la nouvelle administration ne laisse guère de doute à ce sujet : l'Amérique ne tient pas à devoir partager les doutes théologiques des Européens, quitte à plonger le monde dans le feu et le sang tant désiré par d'autres ensembles religieux qui pensent s'y ressourcer pour quelques nouveaux millénaires à venir. Tant pis pour elle.
Vendredi 21 septembre 2001
Etrange. A deux mots de la première phrase je ne sais pas encore de quoi je vais parler aujourd'hui ! Pourtant, le thème est dans mon esprit depuis quelques jours, il y est en fait depuis très longtemps, apparaissant de temps en temps plus ou moins clairement. Tâchons donc d'être bon ce matin, c'est important.
Ce sujet ce n'est rien moins que ... le bonheur ! Oui, le bonheur, car tout ce qu'on peut lire dans ce Cinquième Journal depuis des semaines ne semble référer le lecteur qu'à une ontologie du mal-être, du malheur. On pourrait croire que mon discours tourne autour de cette paranoïa collective qui ne connaît rien d'autre que l'amère critique, la plainte gémissante, la prophétie lugubre ou, au mieux, les vagues espérances de nouveaux développements. Je suis en train d'écouter France-Info, cette radio qui a fait de la paranoïa son pain quotidien, comme beaucoup d'organes de presse en France, hélas ! Quel tristesse, mais aussi quel scandale ! Sémantique de mort, de destruction, de corruption et de décomposition : tout va mal et de plus en plus mal, la crise est enfin revenue dans tout son éclat, la "reprise économique" et l'optimisme qui l'accompagne, c'est fini. On croirait entendre OUF ! Oh, on sait que le bonheur social et historique ne nourrit pas la presse. Libé vient d'annoncer le triplement de ses tirages depuis la tragédie américaine ! Il s'agit là d'une véritable tyrannie de l'opinion, d'une doxa émotionnelle totalement irrationnelle, une sorte de fête foraine où les hommes supposés éclairés mettent tout leur talent au service du frisson morbide et de l'instinct de mort. Comprenez : l'attentat de Manhattan est devenu le caviar des média, leur jouissance hypocrite de la mort dont on assouvit ainsi le fantasme tout puissant. La mort simplifie tout, elle ordonne le souci ontologique vers un événement fatal, mais qui n'est pas le nôtre, il n'est pas celui des survivants. Tant que la mort demeure celle de l'autre elle n'est pas la mort, elle est le triomphe du vivant et c'est de ce triomphe là que parlent nos journaux ces derniers jours. Face à cette tréfilerie mortifère des âmes je vais tenter de réagir, car l'enjeu est immense. Les fanatiques de tout poil se frottent déjà les mains, les effets d'un demi siècle de paix sont sur le point d'être gommés et l'accumulation primitive de culture pacifique, chèrement acquise, détruite en quelques semaines. Le suspens des aubes et des crépuscules de guerre va reprendre sa routine. Parlons donc du bonheur. Il existe, je le vois. Et au fond pourquoi s'alarmer ainsi, il existe malgré tout le reste et il existera tant qu'ils n'auront pas tout anéanti.
Mais de quoi s'agit-il ? Je pense qu'on ne peut pas définir le bonheur. Comme l'existence elle-même, il est ou il n'est pas (ou ne semble pas être, ce qui est le plus fréquent). Le bonheur est un événement, il n'est pas un état descriptible à l'aide du classique forme et fond. Il n'est pas nanti de qualités ou d'attributs fixes qui permettraient de le déceler de près ou de loin. Ainsi, l'attribut richesse n'est pas forcément un attribut du bonheur, malgré toutes les contrepèteries que l'on peut faire à ce sujet. Non plus que la beauté, la puissance ou je ne sais quoi encore. Le bonheur, ainsi, n'est la plupart du temps pas visible : même un sourire, même le rire le plus tonitruant ne peuvent pas prouver sa présence. Au mieux pouvons-nous nous dire devant tel spectacle enviable que l'un ou l'autre des attributs que nous percevons pourraient être favorable au bonheur. Il y a une barrière infranchissable entre les objets du bonheur et leur vécu, entre les apparences du bonheur et la vérité de la situation de celui ou celle aux quels on le prête. C'est pourquoi règne le plus profond scepticisme à son sujet. C'est pourquoi la plus grande majorité des philosophes se sont réfugiés dans le stoïcisme face à la vie. Encore qu'il faille ne jamais oublier le tri culturel que l'on a opéré dans l'histoire au bénéfice de ce scepticisme. Cette couleur du discours et de l'ambiance à toujours profité à ceux qui l'on imposé autour d'eux. Comme aujourd'hui.
Et pourtant, si on recherche le bonheur en soi-même, c'est à dire si on évite de faire l'erreur de le prêter ou de le dénier abusivement à autrui, on a une chance de l'approcher et de pouvoir en parler. Quoique, quoique la difficulté est bien celle-là : parler du bonheur. Essayons. Ce que nous en avons dit dans le paragraphe qui précède nous donne quelques indications. Nous y apprenons en effet que le bonheur est totalement indépendant des objets qui pourtant le signifient au sens qu'ils apparaissent partout comme les objets du désir, du désir du plus grand nombre. Or cette indépendance nous indique malgré tout que dans le bonheur il y va de la relation à des objets. Le bonheur n'est donc pas un sentiment aléatoirement répandu dans les âmes selon des lois divines, il n'est pas une ressource miraculeuse de l'âme à laquelle une divinité quelconque aurait accordé une grâce particulière. Non, car s'il est vrai que l'humeur est de cette nature involontaire et que cette humeur peut prédisposer au bonheur, on sait qu'elle peut aussi imposer le contraire et qu'elle est toujours passagère. S'il y va donc d'une relation à des objets, il faut admettre qu'il s'agit maintenant de sa relation au tout du monde puisque nous avons exclu que certains objets pourraient expliquer par leur seule particularité le secret du bonheur. Le bonheur réside donc dans la relation que nous entretenons avec le monde en tant que monde.
Quelle est cette relation ? Le discours philosophique habituel nous dit qu'il y a, en fait, deux relations possibles avec le monde : la première physique, celle des sensations et des perceptions, et l'autre immatérielle, intellectuelle, spirituelle ou encore psychique, les mots ne manquent pas pour décrire ce qui est du domaine des idées. A propos du premier type de relation, la relation physique, nous rappellerons, conformément avec ce qui précède, que le bonheur ne tolère pas plusieurs relations mais une seule. Or les sensations ou les perceptions sont multiples, personne ne saurait contester cette évidence. Par ailleurs, je ne peux pas non plus en conclure que le bonheur dépend exclusivement de ma relation spirituelle avec la réalité, car cela introduirait également une multiplicité dans ma relation à l'étant, puisque je suis amené à opposer ma relation physique avec l'autre. Il faut donc que ma relation au monde soit une, ou du moins que, si je veux parler de relation heureuse, de bonheur, il est nécessaire que ma relation avec le monde soit une. Conclusion, le bonheur n'est possible qu'à partir d'une unification de ce qui apparaît spontanément comme une multiplicité de relations avec la réalité. La Tradition, encore elle, voudrait ici que le bonheur soit l'événement qui permette à l'individu de transcender la relation physique au bénéfice du monde idéal. Autrement dit, si l'on décode le message qui se cache derrière ces grands mots, le bonheur n'est jamais de ce monde mais seulement de l'autre. Il existe un bel exemple, celui de Boèce, ce chevalier romain torturé à longueur d'années dans un cul de basse fosse et qui a trouvé la force d'écrire, pendant son séjour dans les geôles, l'un des plus beaux poèmes de bonheur philosophique qui existe. En le lisant, on a du mal à admettre que son auteur l'ait écrit entre deux séances d'arrachage d'ongles. Et pourtant ce fut le cas. Dire à présent que Boèce aurait "transcendé" sa souffrance est évidemment une lapalissade qui ne nous avance guère. En vérité il avait atteint le bonheur malgré sa douleur, c'est à dire que la particularité de cette sensation n'était plus assez forte pour entamer l'unité de sa relation avec la réalité. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet exemple, c'est précisément que la souffrance physique n'est pas niée, elle est absorbée dans l'unité de la relation du chevalier avec son monde. On voit combien la nature des sensations ou de ses objets a peu d'importance, on peut souffrir comme Job et pourtant être heureux. Ce que Job lui-même semble avoir ignoré jusqu'au bout, quoiqu'il aie fait preuve d'une patience qui montre qu'il avait bien compris ce qu'était le bonheur.
Qu'en conclure sur le bonheur lui-même ? Nous avons omis beaucoup de caractéristiques de cet état de conscience appelé bonheur. Ainsi aurions-nous pu nous attarder sur le fait que le bonheur est un désir universel. Ce désir motive absolument tous les comportements quels qu'ils soient. Le Marquis de Sade n'avait qu'un seul critère pour justifier ses pratiques amorales et immorales, le bonheur. Lorsqu'il s'est avéré que Hitler ne ferait jamais le bonheur de son peuple, le dictateur n'eût plus qu'une solution alternative, la mort et la destruction totale de son pays, preuve de l'échec et aussi de la globalité de l'enjeu qui avait coûté tant de vies humaines. A cette universalité correspond celle que nous avons découverte quant au lieu nécessaire du bonheur, à savoir ce qui sépare globalement le moi du monde, ou plutôt ce qui l'y relie. Nous avons aussi appris que le bonheur ne se contente pas de quelques critères qui vont ordinairement avec les apparences du bonheur, comme la richesse, la beauté etc.. Il peut parfaitement avoir lieu dans les pires souffrances ou dans le manque absolu, du moins ce qui passe pour la majorité comme souffrances et comme manque. Ce qui implique que souffrance et manque appartiennent à notre lien au monde, exactement comme tout le reste. Comment cela ? Ces sentiments et affects négatifs ne manifeste-t-ils pas justement le contraire du bonheur ? Le manque n'est-il pas ce qui compromet la plénitude de la relation au monde, l'universalité du sentiment de jouir la réalité sans exceptions ?
Manque et souffrance appartiennent au monde, cela personne ne peut le contester. Comment alors ma relation à ce monde pourrait-elle être heureuse si je n'arrive pas à admettre ces dimensions négatives comme le constituant aussi ? Sauf à nier la possibilité même du bonheur, solution qu'on adoptée à peu près toutes les cultures du passé et du présent. Il y a pourtant une caractéristique qui unit tous les objets et tous les états de conscience que nous connaissons : leur mystère. La souffrance est aussi mystérieuse que la jouissance, même si la science s'efforce de dépecer la réalité pour en tirer des recettes assurées du bonheur, elle ne parvient qu'à des résultats partiels, limitant ici le manque et le creusant en même temps ailleurs. L'issue fatale du parcours individuel de la vie ne cesse d'affecter toute réussite ou tout échec dans ce domaine, à quoi bon trouver la meilleure manière de vivre s'il faudra de toute façon un jour la quitter ? La mort aussi est un objet du bonheur, et tant qu'elle n'est pas intégrée à l'ensemble des objets, ensemble que nous avons appelé relation au monde, il ne peut pas y avoir de bonheur. C'est pourquoi on doit admettre qu'il existe une manière heureuse de mourir, une manière qui n'est pas celle du pari religieux, qui ne peut pas l'être : se sacrifier pour une vie dans l'au-delà ne peut pas ressortir du bonheur car le sacrifice est aveugle, aussi aveugle que la main qui fait tourner la roulette du casino. Aucune conscience ne peut nier la dichotomie du vrai et du faux et doter ainsi sa foi ou ses croyances d'une absolue positivité. Le doute fait partie de la Foi, les théologiens sérieux ne l'ont jamais caché. Or le bonheur ne peut pas frayer avec le doute.
En revanche, le bonheur se nourrit du mystère, il se nourrit de l'opération qui consiste à chercher le sens de ce qui est. Rappelez-vous, l'être est comme la sphère, une figure universelle. Or, dans ma relation au monde, tout est étant, les joies et les peines, la jouissance et la souffrance. Tous les objets de cette relation sont, et à ce titre ils partagent la même question : pourquoi sont-elles ? Seuls les artistes savent quelle importance revêt cette question dans le traitement esthétique de ces objets. La peinture est un traitement ontologique de ce qui est peint, que ce soit une fleur ou un sentiment passager : elle traite la question de l'être de cet objet en le soumettant à une transformation calculée ou aléatoire, exactement comme un savant le fait avec les objets et les forces de la nature. Oui, la science en marche n'est rien d'autre qu'une forme de traitement de la question de l'être, elle mesure la conformité des objets de l'esprit avec ceux de la nature, c'est ce qu'on appelle les lois. Mais derrière ces lois c'est en dernier ressort La Loi de l'être des choses qui est recherchée. Le bonheur, donc, n'est rien d'autre que ce qui surgit un jour de cette question comme parenté du monde avec soi. Un jour, au beau milieu de la contemplation esthétique ou scientifique d'une chose ou d'un ensemble de choses, surgit la fraternité ontologique du monde avec soi. C'est ça le bonheur, la fin de la solitude existentielle, non pas la solitude parmi les humains, parmi ses semblables, mais par rapport au monde lui-même : on découvre l'intime identité de la réalité et de soi-même. C'est ainsi qu'on découvre aussi la beauté du monde et la sienne propre, ce qu'on appelle l'harmonie. Le bonheur est harmonie. Il est la perception d'un battement de cœur extérieur qui vient faire écho à son propre cœur, que ce cœur soit ému par le plaisir ou par la douleur, c'est sans importance. Etre heureux n'est rien d'autre qu'entendre battre le cœur de l'univers en même temps que le sien. C'est peu de chose et c'est tout.
Mardi 25 septembre 2001
Vétuste.
Le monde qui nous entoure affiche une contradiction flagrante. D'un côté on ne peut pas dire qu'il vieillit. Du moins se présente-t-il plutôt dans cette phase de lissage que je décrivais ailleurs, la fin des grands chantiers infra structurels laisse la place à des travaux de ravalement de réalité. Il faut maintenant construire une scène plaisante et confortable qui puisse suggérer une paix réelle, construite sur le durable. On veut un "développement durable". On récuse le vite fait, on veut de nouvelles bases solides, telles qu'on peut les fantasmer sur la base des formidables impressions recueillies dans les brillantes histoires de nos Empires. Quelles que soient les causes et les conséquences d'un tel désir, les hommes ne tolèrent plus un environnement sale, que ce soit les paysages naturels ou les villes : tout doit rester neuf, neuf en permanence, plus question de laisser la réalité se corrompre d'une manière ou d'une autre, par un bout ou l'autre.
D'un autre côté, tout sent le vétuste. Prenez une gare SNCF quelconque. Elle vient d'être rénovée et les matériaux nobles et coûteux comme l'aluminium ou le marbre donnent toutes les assurances du neuf qui dure, qui va durer. Et pourtant l'ambiance reste vétuste. La seule présence des immenses halls construits pour recevoir la fumée des anciennes locomotives nous fait oublier tout ce brillant peu tapageur mais lourd de sous-entendus. Bon, il y a toujours un décalage dans les grands projets, des chevauchements d'époques qui gâchent un plaisir que seul peut dispenser une réalisation entièrement neuve. Pourtant, il ne s'agit pas des matières qui nous entourent mais de l'ambiance. Quand je prends le train je plonge la plupart du temps quelques décennies en arrière, ne fût-ce que parce que les wagons arrivent à leur terme d'utilisation et qu'on attend vainement la nouvelle génération. Du moins là où n'arrive pas encore le TGV, comme à Strasbourg, capitale, dit-on ici, de l'Europe !... Mais cette impression est beaucoup plus générale. Dans mon wagon de seconde classe, je peux faire abstraction du mobilier et de ses revêtements, mais le roulis invraisemblable qui me secoue ne me permet pas d'oublier que le wagon que j'occupe n'a pas été construit pour faire du 200 km à l'heure, mais beaucoup moins.
A Toulouse, c'est la vétusté qui a fait tant de morts et de blessés. On a laissé une verrue obsolète s'incruster dans le destin de la ville. L'impression la plus pénible qui se dégage de cette catastrophe est celle d'une sorte de fatalité, de fatigue existentielle qui ont écrasé toute velléité de modernisation. On ne peut guère imaginer faute de gestion municipale plus énorme. Construire des tours d'habitation à un jet de pierre de ces vieilles bombes dont le sort est réglé par des chiffres comptables dans un logiciel parisien ! C'est un vrai scandale, mais gageons qu'on n'en parlera pas longtemps, car il y en a tellement à travers l'Europe. Hier le journal télévisé local a fait un reportage sur l'une de ces usines périmées, située le long du Rhin. Or, ce site en contient plusieurs, de ces usines, et l'une d'entre elles a aussi explosé faisant trois blessé en avril dernier : pas un mot à l'antenne. Ce jour-là il fallait lire Le Monde pour être informé sur ce qui se passe en proximité. Tant la peur s'impose, la peur, secret de la vétusté du monde. Peur économique, syndicale, politique, peur métaphysique, peur d'exister et d'être présent au monde. D'ailleurs, l'attentat de Manhattan est la conséquence de la vétusté des comportements : le terrorisme n'est pas chose nouvelle, loin de là, mais il est si fatigant de rester conscient !
Jeudi 27 septembre 2001
Que devient la vérité lorsqu'elle se dilue ? Que devient le savoir, disons, plutôt que la vérité, quand il se pulvérise dans les approximations pédagogiques ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut commencer par prendre le problème à l'envers et dire : que deviennent la vérité ou le savoir lorsqu'ils sont monopolisés par quelques esprits ? Car c'est là le vrai problème. Il a été un temps où la question de la vérité, et donc celle du savoir, n'étaient pas partageables ni imposables à des masses ignorantes, car ces masses n'existaient pas. Le nomade devait faire face tout seul à toutes les questions de l'existence, aussi bien les questions techniques que celles de son âme. Le chasseur - cueilleur était une encyclopédie ontologique. Un tel homme a forcément une idée réellement globale de l'existence, il connaît des relations entre les choses et entre les événements, et entre les choses et les événements, dont nous ne saurions avoir la moindre idée. De là, d'ailleurs, relèvent la plupart des savoirs que l'on appelle ésotériques ou occultes. Mais là n'est pas la question. Le nomade sait tout ce que l'on peut savoir. Maintenant si on fantasme une vérité transcendante, ce pauvre homme a nécessairement su les choses plus ou moins bien, il aura approché les savoirs et la vérité plus ou moins bien selon son destin. D'où l'idée de la sagesse comme apanage des vieux. Pour les nomades, survivre était la même chose qu'apprendre et s'assagir.
Or précisément, cette idée d'une vérité transcendante n'avait aucune raison d'avoir cours à l'époque des hommes isolés, car l'essentiel ne résidait en rien dans le compte-rendu des savoirs ou de la vérité aux autres hommes ou à la société, mais bien dans la réussite de l'existence entamée. Autrement dit, le savoir, la science ou la vérité étaient le secret de la survie elle-même. Donc, depuis que ces ingrédients cognitifs se rapportent exclusivement à une notion transcendantale, c'est à dire à une idée abstraite de l'adéquation d'une représentation avec le monde, ce rapport "utilitaire" s'est défait. Je mets des guillemets à utilitaire parce que ce concept s'est lui-même totalement décomposé au cours du processus de monopolisation de la vérité par une classe de clercs. L'utile se conçoit ici comme ce qui favorise l'existence en tant que telle, et non pas seulement l'un ou l'autre de ses aspects comme la bon fonctionnement physiologique de l'individu ou la stabilité sociale des civilisations. Est utile tout ce qui permet de bonifier la vie globalement, c'est à dire de la nourrir aussi bien matériellement que spirituellement. La sédentarisation des hommes est à l'origine de la privatisation des biens matériels sous la forme de la propriété privée, et il est certain que dans cette forme de civilisation, aucune stabilité et aucune paix ne sont concevables hors de ce principe. Ce qui ne va pas de soi et qui est pourtant bien réel, c'est que ce principe de propriété privée se soit transféré dans le domaine des savoirs et de la vérité. En même temps que les richesses se partageaient inégalement entre les hommes, il en allait de même avec le savoir et la vérité - entendons à partir de maintenant la vérité comme sens utile à l'existence, comme façon de concevoir les finalités de la vie avec bénéfice pour cette même vie.
Il faut donc concevoir ce phénomène comme une sorte d'évaporation du souci de la vérité et du savoir selon des pyramides plus ou moins pointues selon le type de la société à la quelle on a affaire. Mais une évaporation qui est le produit d'un rapt, d'un vol ou d'une spoliation. D'une aliénation dirait Marx : les propriétaires terriens se sont emparé des esprits en même temps que des corps, puisque la propriété privée a aussi pour conséquence l'exploitation de l'homme par l'homme. Est-il encore prudent d'écrire une telle phrase aujourd'hui ? Peu importe, nous ne sommes pas ici pour survivre mais pour vivre, et donc élaborer notre vérité et nos savoirs selon notre liberté. Mourir à cause de cela figure sans doute parmi les plus belles réussites ontologiques de l'Histoire. Or, le butin de ce crime historique n'est pas un butin comme les autres, il est la fibre ontologique de l'existence individuelle ou singulière. En l'enlevant à une personne on ne détruit pas seulement en partie la personne victime du vol, mais on détruit aussi le butin lui-même, on aliène son propre sens à sa propre existence, sans laquelle il n'est qu'une coquille vide, une abstraction qui s'évapore immédiatement vers les sphères de la transcendance, celles de la Religion. Désormais, on a sacrifié le savoir et la vérité de chaque homme, à une forme de savoir et de vérité qui n'a plus pour objet la réussite individuelle de l'existence mais seulement la soumission d'une partie des groupes humains à une autre partie.
Savoir et vérité ne se sont donc pas seulement déplacés de l'ensemble des humains vers une minorité, mais ils se sont dilués et transformés au cours de ce déplacement. La Réforme protestante a été une rébellion ouverte contre ce processus historique puisqu'elle tentait de rendre à l'individu la maîtrise de son esprit contre les églises et les clercs. Désormais le salut de chacun dépendrait de lui et de sa capacité à s'interroger sur lui-même et à se connaître en ses causes et en ses fins. Et pourtant, ce même protestantisme a confirmé immédiatement l'autre déchirure du destin singulier, celle de la vie matérielle. Les différentes sectes réformées se sont toutes retrouvées sur un principe sacré, la justification théologique des inégalités matérielles. Celle de la propriété privée de la richesse. En fait, ces religions qui se voulaient révolutionnaires ne pouvaient pas admettre que l'aliénation du corps était de même essence, était le même phénomène, que celle de l'esprit. C'est bien pourquoi elles n'influencèrent guère que les classes les plus riches de notre civilisation. Les peuples allemands et scandinaves ont été endoctrinés par l'épée et par le feu, comme ils l'avaient déjà été pour la religion catholique et romaine.
Pour conclure, je dirais que la civilisation sédentaire a pris un risque énorme, celui de détruire jusqu'à l'idée même de la vérité, destruction que les pragmatiques anglo-saxons ne cessent d'appeler de tous leurs vœux. C'est aussi pourquoi il n'y a pas, en réalité, de dilution de cette vérité ou de ces savoirs, il n'y a qu'un processus de décomposition global qui nous a conduit à un mépris qui risque désormais d'affecter tous les domaines de la vérité, les savoirs en tout genre n'étant que des figures de cette vérité. La dilution de la vérité et des savoirs est leur disparition pure et simple, le plus mauvais dénouement de l'expérience humaine.
Samedi 29 septembre 2001
Je vous propose aujourd'hui un petit résumé. Il faut toujours revenir en arrière et simplifier le plus possible ce qui se présente toujours de faon complexe et parcellaire. Donc, le trésor réel, le Graal des Hommes, c'est le sens de l'existence, et sa recherche constitue le fondement vrai de tout le comportement humain. Je dis bien humain, car tout ce qui n'est pas du ressort de la question du sens n'est pas à proprement parler humain. (Sale coup pour les religions dont le principe est précisément d'anesthésier toute problématique du sens au profit d'une recherche de croyance. En passant, je ne comprends pas l'attitude des gens nantis d'une Foi, car leur problème devrait être réglé une fois pour toute et ils ne devraient pas se sentir obligés de s'occuper des autres. La Religion éteint cela même qui fait l'humain.) Bien sûr, me direz-vous, pour bien comprendre ce qu'est ce Graal qui dirige en sous-main toute l'Histoire, il faut en avoir une idée préalable. Les uns se fascinent sur le concept d'origine. Ils pensent que le sens se trouve dans le secret de l'évolution du monde depuis une fantasmatique création ou depuis un accident cosmique. Les autres imaginent, quand ils pensent le mot sens, qu'il s'agit d'une direction ou d'un but : pourquoi suis-je ici, que dois-je faire dans l'existence etc.?.
Or ces deux interrogations connexes de la question du sens semblent faites pour éviter la véritable question elle-même parce qu'elles les placent d'emblée hors de portée de toute résolution, elles les renvoient dans une transcendance qui n'est rien d'autre que la fatalité de l'ignorance. Ni l'origine ni le but ne sont saisissables. Les prendre comme direction de recherche est donc se condamner à tourner en rond d'un mystère à l'autre en finissant par déléguer la puissance de réponse à une force transcendante, elle aussi hors de portée. Nicolas de Cues, l'un des plus perspicaces penseurs médiévaux du sens, avait fini par simplifier le problème en disant que le seul mystère était celui de la relation avec Dieu : comment peut-on s'approcher de l'Etre ? C'est pourquoi il avait besoin d'une doctrine de l'ignorance pour fonder une telle approche, et il inventa la théorie de la Docte Ignorance. Il n'est plus question ici de chercher un sens à la vie, mais seulement de tourner autour de son fantôme, Dieu. Pourtant, il y avait quelque chose de vrai dans sa démarche, quelque chose que nous prônons depuis les toutes premières lignes de nos écrits, à savoir que la question du sens (celle de Dieu) est le centre stratégique du destin de l'animal Homme. Mais aussi que cette question possède un statut particulier à cause de son caractère fondamentalement indécidable.
Retenons ici que les deux directions de recherche, origine et but, étendent une sorte de monopole sur la pensée du sens. Elles dissimulent ce faisant la véritable essence du sens qui se trouve dans le présent. On pourrait même dire tout simplement que le sens est le présent. Pour bien comprendre cette phrase curieuse, il suffit peut-être, pour les plus doués, de donner au petit mot "est" le sens de "ester". Cette curieuse forme transitive du verbe être, verbe qui ne saurait avoir le moindre complément d'objet direct ou indirect, est utilisé notamment avec la signification de aller en justice, régler un différent par le recours au Tribunal. Cela donnerait alors : le sens este le présent. En faisant un tout petit jeu de mot, on peut aussi donner l'image du lest, en disant que le sens leste le présent, lui donne du lest. Ce qui nous renvoie immédiatement à deux autres idées, celle de donner du poids, de la substance, et celle de donner de l'équilibre, autrement dit de rendre possible, viable. Le sens du présent n'est donc rien d'autre que ce qui le rend possible, il est donc lui aussi présent et non pas à chercher quelque part dans le passé ou dans le futur. Le sens est ce qui cimente ce que nous percevons en tant que réalité. Mieux, il est ce qui nous rend accessible la notion même de réalité ou de présent.
Le sens est donc antérieur à toute réflexion. Il n'est pas ce qui est a priori à chercher, mais ce qui ouvre la recherche elle-même. On peut donc se demander à quoi sert cette recherche qui nous est en quelque sorte imposée par le sens sans que nous sachions de quoi il retourne. Nous savons cependant qu'elle nous est imposée, que nous ne la choisissons pas parmi d'autres, qu'elle surgit par et dans le présent et justement en tant que présent. La réponse la plus simple que nous pouvons alors esquisser serait de dire que l'exercice de la question, le fait que nous y soyons soumis constamment sans que nous ne trouvions la moindre réponse, modifie le sens même du sens. Pourquoi disons-nous cela ? Parce que nous sommes bien obligé de constater que le présent ne reste jamais présent. Il s'enfuit à peine arrivé pour laisser la place à un futur qui se bouscule à la porte de nos perceptions. Or, pendant ce processus le présent change dans ses aspects. Attention, ce n'est pas seulement la couleur du jour qui change, ou celle du mois, la couleur de nos sentiments, de notre être intérieur change également. Ces changements représentent l'effectuation du présent sous la forme du temps. Les modifications qui s'introduisent ainsi dans la question du sens la nourrissent de diverses manières, offrant une sorte de kaléidoscope à travers lequel on distingue le présent.
Dans nos existences présentes (celles de notre Epoque, de notre Temps), le vécu de la question du sens suit une curieuse évolution. Très présente dans l'enfance, la question se dilue dans l'âge adulte pour ressurgir tardivement, lorsque la mort se rapproche. Il est vrai que dans nos sociétés les systèmes éducatifs s'empressent tous de régler cette affaire sans faire de bruit et par des moyens expéditifs comme les religions, ou plus sophistiqués comme la science. La persistance de l'enseignement de la philosophie en France est l'objet de la risée générale, et plus particulièrement des pays qui campent depuis si longtemps dans les espaces arides du pragmatisme. Pourtant, même là, dans nos terminales philo, le traitement du sens est lui-même devenu objet de risée. Au mieux on se remet à cultiver la logique, au pire on enseigne des résumés caricaturaux des diverses sciences humaines. Là aussi on a oublié que tout se joue dans l'exercice de la question du sens, cette discipline qui rassemble à chaque étape de la vie l'expérience du temps pour assumer le présent. A l'échelle de la vie, le présent n'est plus alors seulement l'expérience immédiate de la réalité, il prend sa valeur définitive avec le passage dans la mort : la mort devient un moment de la présence, comme un autre, comme tous les
Or, aussi loin que l'on puisse remonter dans les textes et les documents de nos cultures, et surtout dans l'aperception actuelle de la mort, la mort est conçue comme ultime perte du sens. Elle marque l'échec du passé et l'anéantissement de tout futur mais cela s'explique parce que le sens est resté coincé dans cette logique temporelle qui l'a expulsé du présent. On a oublié que le présent est présent de l'être, et non pas présent d'un individu : la question du sens ne porte pas principalement sur le destin individuel et toujours singulier. L'individuation et la singularité sont des ruses inventées par l'être pour protéger le questionnement lui-même. C'est pourquoi notre civilisation sédentaire représente le plus grand danger pour le sens : la coagulation des hommes en société offre le risque majeur d'une réponse hâtive, totalement fausse et totalitairement exploitée. Le totalitarisme n'est rien d'autre que la tentative d'en finir socialement avec la question du sens, elle est de même nature que les sentiments d'impuissance face au mystère du sens qui conduisent certains individus au suicide. Le jour qui a précédé l'attentat de Manhattan, le chef du groupe de terroristes écrit en substance à ses complices : - n'oubliez pas la vie bienheureuse qui vous attend au-delà de la mort, faites confiance à Allah -. Quelle tristesse ! Tant de bruit, tant de morts et de larmes comme prix du renoncement à la question du sens d'une poignée de débiles mentaux. Ici la débilité garde son sens premier : la faiblesse et la lâcheté.
Mardi 2 octobre 2001
Temps et individuation. Sartre disait : - Je nais plusieurs et je meurs seul -. Lorsqu'on fait un effort de mémoire, on découvre avec surprise combien cette remarque est pertinente : nous sommes longtemps vécus avant de vivre notre vie, et cela provient du fait que plus nous sommes jeunes, plus nous faisons les choses avec d'autres, en même temps qu'eux, dans le même but et sans nous poser la question de savoir si notre propre volonté est concernée. Et puis vient le temps où les décisions paraissent de plus en plus ne dépendre que de nous. Il faut utiliser le mot paraître car les illusions sur notre liberté de choix sont grandes. Pourtant, ce qui est vrai, c'est que nous glissons sans nous en apercevoir dans un état où il nous semble évident que tout ce qui nous arrive dépend de nous, même si cela est faux. Les autres s'éloignent, chacun s'isole dans un destin personnel et plus nous avons d'emprise (plus nous croyons en avoir) sur le monde qui nous environne, moins nous avons de véritables liens avec lui. On appelle cela l'individuation.
Ne compliquons pas les choses. L'idée que nous sommes vécus est liée à la plus ou moins grande impression que nous avons d'être manipulés, de ne pas participer lucidement à tout ce qui nous arrive. Enfant, adolescent et plus tard adulte, nous constatons bien qu'il se produit un changement dans le rapport de notre volonté avec le monde : soit elle s'exerce de plus en plus consciemment sur lui, soit elle s'y heurte de plus en plus durement. Mais le résultat final est toujours le même, à chaque pas je me sens un peu plus seul. Dans sa remarque, Sartre avait en vue le problème du hasard et des possibilités qui s'appauvrissent au cours du déroulement de l'existence. Au début tout est possible, dans un lit de mort tout est dit. Il voulait ainsi camper la position de la conscience du sujet à l'intérieur de sa propre histoire et souligner l'importance tragique des choix que nous faisons et qui ne nous laissent que rarement l'occasion de revenir sur eux. Hannah Arendt a repris cette réflexion au plan de l'Histoire, en décrivant la dynamique de l'action qui lance dans le temps des séries incontrôlables de conséquences, série qui peut tout aussi bien se retrouver dans le destin de l'individu : pour avoir choisi tel métier plutôt que tel autre, on peut rater sa vie définitivement.
Tout cela procède de considérations anthropologiques certes intéressantes, mais que nous laisserons de côté car elles sont douteuses. Il n'est pas évident, en effet, que le phénomène de l'isolement progressif du sujet soit cause ou conséquence des options qu'il prétend imposer ou s'imposer. Autrement dit, est-ce que ce sont mes choix qui m'isolent au fur et à mesure que je les fais, ou bien suis-je moi-même contraint de manifester ma volonté de plus en plus fermement parce que je vieillis et que ce vieillissement entraîne automatiquement l'individuation ? Ou encore : la vie est-elle, quoi qu'il arrive, un parcours vers la solitude absolue du moi indépendamment de toutes les options que je prenne ? Au point que le choix n'est même pas un choix, il est une obligation pour ainsi dire fonctionnelle d'un sujet que le temps définit lui-même de manière de plus en plus précise. Peut-on neutraliser les contenus de nos choix pour n'y voir plus qu'une manière de traduire l'apparition de notre moi dans le temps ? Un moi dont la souveraineté serait d'autant plus réelle sur le monde qu'il serait plus pur, c'est à dire plus individué, plus singulier que les autres ?
C'est là que Freud et Lacan sont d'un grand secours. En effet, dans le regard qu'ils portent sur le sujet, il apparaît bien plutôt le contraire de ce que dit Sartre, et pour paraphraser le philosophe de l'existentialisme, on pourrait dire à leur place la phrase suivante : l'homme naît singulier et meurt singulier, quels que soient les accidents qui entre les deux événements l'entraînent dans la généralité, dans le commun de la communauté. On peut ainsi entrevoir un modèle du destin humain. L'homme naît dans la pureté de sa singularité et entre dans les tribulations sociales de la vie où il perd chaque jour un peu plus de sa singularité pour survivre. Mais sa singularité est toujours plus forte que cette tendance à s'identifier aux autres, et, soit il lutte pour reconquérir ce qu'il perd dans le dressage social, soit il souffre de s'y abandonner en se perdant dans la névrose ou dans les autres expédients toxicologiques. La psychanalyse n'a pas d'autre objectif que de permettre au sujet de reprendre contact avec le moi que son histoire lui a fait oublier. Oublier ou ne jamais connaître, car ce moi singulier gît dans l'inconscient, dans cet espace psychique où il se réfugie avant même que le sujet se soit doté des notions qui lui permettraient de penser à se chercher lui-même.
Mais de quoi parlons-nous en réalité ? Tout cela paraît bien creux. On nous parle d'individuation dans le temps, de moi à découvrir sous le masque social, mais on ne nous dit pas ce que sont ces singularités et ces moi en veux-tu en voilà ! C'est quoi le moi ? A quoi ça sert d'être ou ne pas être celui qu'on est ? Est-ce que cela change quelque chose dans le destin de l'humanité et dans le mien propre ? Etre ou ne pas être ce qu'on est. Un petit morceau de phrase manquait au monologue d'Hamlet : ce qu'on est. Alors je vous pose une autre question, qui pourrait nous mettre sur la voie du sens de toutes ces questions : et si on était obligé de demander à une banane de bien vouloir être une banane afin que nous puissions la déguster ? Imaginez que tous les êtres de l'univers possèdent le pouvoir d'être ou de n'être pas, selon leur bonne volonté ! Inimaginable, fou, impossible, les choses sont ce qu'elles sont et il est parfaitement idiot d'aller penser qu'à un moment ou à un autre elles soient autre chose que ce qu'elles sont ! Mais enfin !!!!
Certes, mais pourquoi en irait-il autrement pour l'Homme ? Pourquoi la chose "homme", l'être "homme", disposerait-il du privilège de pouvoir décider d'être ou de ne pas être ce qu'il est ? C'est grave. C'est grave parce que dans l'histoire de l'humanité, il apparaît bien qu'on n'a pas cessé de vouloir faire de l'homme, des hommes, la plupart du temps autre chose que ce qu'ils ont été, qu'ils sont et qu'ils seront. Mais ce n'est pas le plus grave, encore une fois, ce qui est grave, c'est qu'on pourrait penser une telle chose, penser que l'être singulier qui naît ici et maintenant puisse n'être qu'une réplique de ce qui est né là-bas en d'autres temps ou de ce qui va naître ailleurs et dans le futur. D'ailleurs l'industrialisation du monde est un tel penser de la possibilité de l'identité des êtres et des choses. Voyez, Heidegger l'avait bien vu, comme l'élevage industriel procède : il ne s'intéresse qu'à la multiplication à l'identique d'un modèle initial, le plus rentable à tel ou tel point de vue. Mais de tels êtres ne peuvent pas exister en réalité ! Ils ne peuvent exister que sur le mode du mensonge, et lorsqu'on mange aujourd'hui du porc, on sait bien qu'on ne mange pas du "vrai" cochon, mais seulement un Ersatz. L'homme identique est un Ersatz d'homme, l'homme fantasmé par les pédagogues de notre civilisation est un Ersatz, une contrefaçon dont tout le tragique réside dans le fait qu'il en est lui-même conscient.
Bigre. Tout cela me paraît de plus en plus compliqué et de plus en plus effrayant. Au fait, la civilisation du choix, de la liberté des options, c'est bien la nôtre, non ? L'homme d'aujourd'hui a-t-il un autre mot à la bouche que celui de liberté ? Le progrès dans l'histoire ne doit-il pas procéder de la liberté de choisir qui est échue aux hommes, et ce malgré certaines idées de Toute-Puissance transcendante et divine ? Même Dieu laisse les hommes libres, mais les laisse-t-ils libres d'être ou de ne pas être ce qu'ils sont ? Absurde. Je frôle un abîme insondable, et pourtant c'est bien de cela qu'il s'agit : être ou ne pas être ce qu'on est. Alors j'en connais qui vont me dire tout de suite que le destin humain n'est pas génétique, qu'il n'est pas enfermé dans un chromosome. Bien sûr qu'il n'est pas tel. Bien sûr que la vie de chacun se construit dans le chaos environnant et qu'elle se transforme selon des nécessités et des contingences parfaitement extérieures au moi. Mais cela empêche-t-il le moi d'être Moi ? Il me paraît évident que pour cesser d'être moi, il faut carrément procéder à un abandon conscient et organisé. Et il me paraît tout aussi évident que celui qui ne veut pas renoncer à son moi ne cessera jamais de lutter pour lui permettre d'être et de subsister jusqu'à la mort.
jeudi 4 octobre 2001
(suite)
Après avoir relu ce qui précède, on peut dessiner un tableau : d'un côté la réalité extérieure, avec ses êtres et ses choses (ses étants) inamovibles dans leur singularité. Telle banane sera jusqu'au bout de son parcours de banane cette banane là, grosse, verte et pâteuse. Personne ne peut songer qu'elle veuille se transformer, pas plus que ce caillou ou cet astre. De l'autre l'homme, pour qui il semble y avoir un problème d'être authentique et d'être inauthentique. Nous ne savons pas si sur son bananier, notre banane est l'objet d'un dressage collectif, mais nous en doutons. En revanche, dans la société des hommes, et aussi de certains insectes faut-il ajouter, il existe des rites et des exercices collectifs qui prétendent donner une identité elle-même collective aux individus. L'homme semble acquérir une seconde identité qui diffère de son être véritable. Il doit alors consacrer une grande partie de son activité d'homme à se définir par rapport à cette dualité qui lui est imposée. Et de fait, l'honnête homme est cet homme de la médiété, de la moyenne, qui réalise un modèle commun alors même qu'il naît dans une parfaite singularité. Le problème des clones soulève la question de savoir si on doit créer des êtres humains parfaitement identiques.
Or même en clonant un homme, on obtient seulement un homme identique à lui-même, autrement dit une singularité multipliée par deux. Sa singularité n'est pas pour autant évacuée même si à force de multiplication elle risque progressivement de prendre une place de plus en plus grande. Si je multiplie Socrate par dix mille, je n'obtiens pas un nouveau Socrate, mais seulement dix mille Socrates qui vont tous se poser la question de leur moi, la question de chercher à se connaître eux-mêmes. Le clonage ne devient effrayant que dans la seule perspective de mettre en projet la fabrication d'un modèle unique d'homme, si une telle chose est imaginable, ce dont je doute. Les totalitarismes se sont tous proposé des finalités de ce genre et on a bien vu que cela ne marche pas. La technique n'y changerait rien, précisément parce qu'elle ne saurait, en aucun cas, atteindre et maîtriser l'être authentique du sujet choisi pour modèle : il restera toujours un doute sur l'ultime identité de celui qui pourtant correspondrait le mieux aux besoins et aux désirs sociaux. Et ce doute commence chez le sujet cloné lui-même. Il n'y a aucune raison de penser qu'il puisse avoir un savoir inné de lui-même ou des outils d'auto-connaissance plus efficaces que les autres.
Quel est, à ce stade, l'intérêt d'une telle méditation ? D'abord, elle nous rappelle les enjeux réels de notre situation d'homme individuel, ce n'est déjà pas mal. D'un autre côté elle nous permet de nous resituer dans le contexte du monde et dans le rapport de notre être avec les autres êtres, de l'étant que nous sommes avec les autres étants. Nous pourrions estimer avoir avancé un tout petit peu parce que nous nous sommes rendu compte en passant que notre singularité est inamovible, qu'elle appartient à la constitution globale du monde, qui que nous soyons et quelles que soient les transformations que l'on nous fait subir ou que nous nous imposons à nous-mêmes. On peut alors aussi émettre une hypothèse : et si l'auto-connaissance, la recherche du moi vrai était la voie royale, la seule qui conduise à l'être en tant qu'être ? Quoi ? Vous ne comprenez pas ? Bon, d'accord ce n'est pas évident. Disons le autrement : si d'un côté nous reconnaissons que les autres étants de la nature sont d'office comme ils sont et qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute leur être réel, et que d'un autre côté nous, les hommes, nous doutons de notre être réel pour toutes sortes de raisons, alors le sens de notre vie à nous les hommes pourrait bien se résumer dans le connais-toi toi-même de Socrate. Finir par se connaître en reviendrait pour ainsi dire alors à prendre sa véritable place dans l'être général des choses qui nous entourent, à guérir la blessure que nous lui avons infligé en nous en arrachant. L'idée que le néant de la mort contient la réponse de l'auto-connaissance aura été la cause première de cette faute, car l'être vit dans la lumière.
Vendredi 5 octobre 2001
Un monde sans information. Je pense que je me mets tout doucement à comprendre l'expression de Marcuse : le monde unidimensionnel. Le réseau qui prétend servir à véhiculer l'information à travers la planète, réalise en réalité un tout autre fonction, il accomplit le rêve de Descartes, à savoir fabriquer un monde purement intelligible, un système pensé qui agrandit sans cesse son emprise sur le monde tout en l'ajustant sur les normes de la raison. Attention, ne pas lire de travers : ce n'est pas l'esprit des hommes qui s'ajuste sur la raison, mais les lunettes à travers lesquelles les hommes s'efforcent ainsi de vivre le monde, de l'exister. C'est un peu comme si, par exemple aujourd'hui, tout le destin du monde se résumait dans le grand jeu guerrier que Bush Jr est en train de mettre sur pied.
Hier on voyait le monde à travers les jumelles déformantes de la guerre froide. La guerre froide était le modèle de compréhension, la structure rationnelle qu'il fallait adopter pour penser son monde et sa vie, à toutes les échelles et à tous les termes prévisibles. Depuis l'effondrement de cette vision du monde, que l'on a évidemment interprété comme une victoire de l'un des deux camps (ce que n'avère en rien la réalité politique présente), il y a eu comme un malaise, un trou d'air. On a souffert pendant presque une décennie d'un déficit de rationalité, on ne savait plus comment interpréter le cours des choses et les événements qui ne cessaient pas pour autant de marquer le temps.
L'esprit cartésien ne se contente pas d'explications circonstancielles et ne tolère pas de régionalisme dans la pensée. Il exige seulement de toujours agrandir sa base structurelle et d'englober toujours davantage de réalité. Ainsi, ai-je moi-même cherché et, semble-t-il trouvé, un modèle explicatif des mouvements humains perceptibles dans l'histoire. La dualité nomade/sédentaire avait cette ambition de clarifier le développement de la civilisation dans ses contradictions et dans ses réussites, mais surtout sur la base de la constatation du retour sur scène du comportement nomade. Mais cette découverte, que d'autres ont fait avant moi sans doute, atteint-elle son but ?
Pour ma part, je savais bien qu'il ne suffisait pas de poser le doublet nomade / sédentaire pour tout expliquer, mais qu'il fallait encore découvrir la clé de cette dichotomie. Il fallait encore montrer pourquoi l'homme nomade a décidé un jour de se sédentariser. A cet endroit du problème, j'ai appelé à mon secours une autre de mes pensées cartésiennes, car c'est bien de cela qu'il s'agit, l'idée que l'essence de l'humain se trouvait exclusivement dans l'angoisse existentielle de l'être humain, c'est à dire dans l'élaboration de la question de l'être. De l'être du monde, du pourquoi de la réalité, du pourquoi le monde est-il plutôt que de n'être pas ? Bon, le raccord était facile par le biais de la problématique du temps et de l'espace, paramètres fondamentaux de toute analyse du nomadisme ou du sédentarisme. Le logiciel Word me souligne à chaque fois ce mot sédentarisme, comme s'il n'existait pas. Etrange.
Bref, je suis en train de faire la critique de tout ce que j'ai cru produire de mieux ces dernières années. Si j'ai commencé en parlant d'un monde sans information, c'est qu'il y a un lien logique ireffragable entre l'information telle qu'elle se pratique aujourd'hui et mes tentatives de dessiner des panoramas transhistoriques. Nous sommes dans l'ère de la construction rationnelle de la vérité des événements. Or, il n'y pas de construction possible des événements, sans quoi ils n'en seraient pas. Ainsi en va-t-il de l'horrible attentat qui a détruit ces deux tours dans la mégapole américaine. Il y a certes un besoin politique et social urgent à lui trouver une place logique dans une trame compréhensible, mais cela ne prouve pas encore qu'une telle trame existe. Je suis même convaincu, comme je l'ai déjà laissé entendre dans l'un de mes commentaires, qu'on a affaire à la naissance de comportements sociaux totalement irrationnels. Irrationnel signifie ici que ces comportements ne ressortissent plus du tout de la géopolitique classique. On peut souligner ici l'ironie de la situation dans laquelle se trouve l'administration Bush qui a tout fait pour ressusciter la guerre froide version péril jaune et qui se voit soudain propulsé dans ce qu'elle décrit elle-même comme une guerre totalement différente.
Ce n'est pas tout à fait exact, car il y a bien, dans l'explication qui commence entre les ultras islamistes et le reste du monde, une question d'hégémonie, nerf traditionnel de toute géopolitique. Mais cette hégémonie ne se décline plus du tout dans les termes habituels de la puissance, elle parle de tout à fait autre chose, de choses que les oreilles occidentales ne sont pas prêtes à entendre. Si peu que même ceux qui comprennent préfère se taire par peur des conséquences. Quelles sont ces choses ? Elles sont de nature à remettre en question le tout du comportement occidental et en particulier le fonctionnement apparemment inattaquable de la production et de la consommation. Ces pouilleux d'islamistes se rebellent contre le monde profane du matérialisme marchand en hypostasiant les fins dernières de l'existence, le sens de la mort. Bien sûr cette rébellion pourrait se confondre avec une revendication de classe parce que le monde islamique se trouve être dans sa grande majorité le monde le plus pauvre. Encore de l'ironie : rappelez-vous hier comment on décrivait la puissance militaire irakienne avant de constater qu'il n'y avait guère plus qu'une armée de va-nu-pieds, et constatez aujourd'hui quelles richesses financières fabuleuses on attribue à ce Ben Laden. Il ne faut pas être économiste pour savoir, au vu des chiffres qui transpirent ici et là, que les sommes dont disposerait ce bandit sont en vérité ridiculement faibles. Elles ne suffiraient même pas à assurer le budget annuel de nos Anciens Combattants
Non, non. Il est impossible de faire de ce Ben Laden un adversaire comme les autres. Il est un ennemi irrationnel, quelque chose comme un farceur de l'histoire qui tire la barbichette de la plus grande puissance mondiale. Mais ce qui inquiète le plus nos gouvernants, ce n'est pas la puissance de feu ou d'argent de ce monsieur en particulier, mais c'est la nature même du message qu'il délivre à grand frais : hommes de l'occident, votre projet a échoué, vous vous êtes ensablés dans le matérialisme hédoniste et dans l'oubli de votre humanité, dans l'oubli de ce qui a fondé votre humanité. La position à partir de laquelle il nous fait ce procès n'est elle-même pas tenable, il ne fait que profiter des inégalités conjoncturelles pour donner un air de légitimité à son Jihad vieux comme le monde. Sa guerre de religion à toutes les autres pareille. Mais ça fonctionne, et je suis persuadé que les intégristes catholiques ou autres ont en ce moment bien du mal à cacher leur admiration pour ces guerriers de la Transcendance, ces nouveaux Croisés de Mahomet.
Mais voyez comme je suis invinciblement attiré vers les grandes explications, les grandes mises en évidence de la vérité de la réalité. Et comme je me trompe ! Certainement ! Bon, admettons qu'en réduisant tout cela au monde de l'information, ce que j'avance ici n'est pas dénué de bon sens. Mais le monde ne s'arrêtera pas de tourner à cause d'Oussama Ben Laden ! Les avanies des hommes aux prises avec la question de l'être n'ont pas grande importance pour cette question elle-même, sauf qu'elle n'a que l'homme pour la porter et pour la garder. La guerre froide a eu comme immense avantage de faire comprendre à l'être humain qu'il pouvait y aller de sa disparition, en cas de trop grandes conneries. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce qu'il y a un risque certain que nous allons connaître une situation style Brazil, c'est à dire une époque du terrorisme absurde, qu'il faille craindre pour l'espèce. Il me paraît assez insensé de donner à tout cela la dimension d'une tragédie historique, cela ne pourrait que nous faire perdre, je le répète, tout l'avantage du respect pour l'Homme que nous a finalement inspiré la terreur d'une guerre nucléaire
Je me suis un peu perdu en route. Mon dessein était plus simple, il était dans la lignée des petites méditations de ces derniers temps sur le moi et l'auto-connaissance, le connais-toi toi-même de Socrate. Il cherchait à imaginer le monde qui existe en dessous du monde de l'information, monde dans lequel chacun finit par se perdre comme un simple élément, une partie ou une pièce du lot. Chacun de nous, et c'est cela qui nous différencie radicalement du monde de l'information, est un monde à lui tout seul. Quel agence de presse pourrait couvrir les événements de votre moi ? Quelle télévision ou quelle radio représenter le cours de l'histoire de votre personne ? Chacun de nous est cette monade de réalité qui porte en elle la vérité entière du monde, et il n'y a nul besoin de conquérir le monde, les autres, les autres peuples ou les autres religions pour s'en assurer. Mais là aussi le chemin est douloureusement difficile, voyez ce texte comme il est chaotique, il n'est pas facile d'abandonner pour soi-même ce qui marche si bien pour le reste du monde. Comment trouver en soi ce que l'on n'y cherche même plus tant on est appauvri par la rationalité de l'information ? Comment sentir à nouveau le monde comme dans notre enfance, avant qu'il ne se dissolve progressivement dans les philosophèmes simplistes de la Raison ? Bouh !
Samedi 6 octobre 2001
Il y a une phrase qui prête à confusion dans le premier paragraphe de ce que j'ai écrit hier. Confusion dans mon propre esprit, bien évidemment. Il s'agit des "lunettes de la raison", là où je veux signifier que ce n'est pas l'esprit de l'homme qui devient raisonnable, mais que l'homme se fabrique un instrument rationnel, la Raison, qui lui permet de comprendre immédiatement le moindre événement. Mais cette Raison n'a rien de rationnel, elle prend seulement les allures logiques des choses que l'on peut alors comprendre : on se construit un système de causes et de conséquences qui marche à tous les coups, ou presque. Je ne devrais pas appeler cela Raison et je m'en excuse platement, mais il faut bien reconnaître aussi que nos outils de compréhension des phénomènes sont grossiers, toujours caricaturaux par rapport à ce qu'ils sont chargés de traiter, comme on dit aujourd'hui. Imaginez le fossé qui existe entre la manière d'expliquer les phénomènes il y a deux ou trois siècles et la nôtre ! Dans le problème Ben Laden, c'est exactement de cette différence qu'il s'agit. Les Musulmans, dans leur ensemble, demeurent absolument hostiles à toute explication rationnelle au sens de notre science logique occidentale. Ils "raisonnent" encore comme jadis, sans aucune hésitation, quitte à risquer le fanatisme et ses conséquences. Idem pour les autres intégristes de tout poil.
Ce qui nous indique un danger, celui de voir se reconstruire tout le dispositif théologique que l'on peut trouver par exemple dans la Bible lorsqu'elle s'en prend à l'idolâtrie et aux idolâtres. On peut très légitimement comparer notre drame actuel à celui qui est décrit dans la Bible. Les Juifs y étaient en gros divisés en deux catégories morales, l'une qui sacrifiait aux idoles et l'autre qui combattaient ces pratiques. Or, le Talmud nous décrit l'idolâtrie exactement comme ce que nous entendons aujourd'hui par hédonisme, consumérisme et amoralité. Ceux qui sacrifiaient au veau d'or, allaient en fait au bordel. Ils constituaient en réalité la pègre de la société judaïque. Pour les intégristes musulmans (et les autres), l'occident est devenu la pègre planétaire, accusation facile à défendre si l'on observe les inégalités en tout genre qui frappent les peuples.
Lorsque je plonge dans mon passé lointain, et même plus proche, je me rends compte parfois que j'ai moi-même vécu dans le culte de la "pureté" religieuse. Vivre ici signifie jouir. A treize ans j'étais un catholique heureux et transporté par les idées de pureté et de salut. De même plus tard autour de mes vingt ans, alors que j'étais parvenu à un pacifisme militant, j'ai eu la surprise de constater que la vie militaire que je découvrais dans la caserne de Toul correspondait parfaitement à mes goûts. Elle s'opposait absolument au chaos social et à toutes les vilenies esthétiques et morales du monde civil. J'ai été littéralement séduit par l'esprit militaire et par le style de vie qui y correspondait. Bref, il y a matière à comprendre autrement la colère de ces barbus apparemment si stupides et si barbares, mais comment négocier une telle compréhension ? La réponse est plutôt optimiste car il n'y a guère le choix : ou bien l'occident se moralise réellement, et c'est ce qu'il faut voir et comprendre dans toutes les mesures prises actuellement contre tous les genres de trafics financiers et autres, ou bien la situation ne peut que se tendre davantage et tourner au bain de sang permanent. Cette fois, l'ONU doit véritablement prendre en mains les destinées du monde, car aucun peuple au monde ne laissera une nation, quelle qu'elle soit, profiter de la situation pour asseoir un peu mieux encore son hégémonie. Cette fois nous avons clairement le choix. Nous verrons bien.
Avoir cru et ne plus croire. Pourquoi et comment cela s'est-il passé autour de mes quatorze ans ? Cela s'est passé dans mon collège de Jésuites, et lorsque j'évoque cela, tout le monde hoche la tête d'un air entendu, comme si une telle évolution était normale, alors que la plupart de mes condisciples de l'époque sont restés croyants, ou du moins solidaires du système de la croyance. Non, les Jésuites n'y sont pas pour plus que mon curé de paroisse qui s'énervait de mes questions rationnelles sur la Révélation et sur l'identité de celui ou de ceux qui ont écrit les grands Textes de notre religion. Vers quatorze ans il s'est simplement passé que je ne pouvais plus admettre de mettre au second plan ma compréhension rationnelle du monde. Ma foi est donc morte d'un coup, sans changer grand chose dans mon comportement sinon que je cessai toute pratique de manière si scandaleuse que les bons pères se séparèrent de moi. Et ils le firent de manière si hypocrite et si mensongère qu'ils ont comme légitimé moralement mon départ du catholicisme. Au fond je me retrouvais dans la position de l'opprimé qui constate que ses supérieurs ne respectent pas les termes de leur contrat, car la liberté figure en toute lettre dans toutes les religions. Il suffit de ne pas la revendiquer pratiquement et de se contenter de la liberté mentale !
Je voulais dire un peu plus haut que je me suis retrouvé en tant qu'athée dans la position des Talibans !!!! Et la suite des événements de ma vie n'ont pas prouvé le contraire, je suis bien devenu une sorte de taliban pour l'occident chrétien, refusant de reconnaître ses valeurs culturelles et sociales. Comme pour des milliers d'autres Français de cette époque, tout cela a abouti à la révolte contre les guerres coloniales puis à Mai 68 et enfin à une difficulté d'exister socialement si forte que j'en souffre encore aujourd'hui.
Hier j'ai cru me faire plaisir en partant me promener dans le piémont alsacien pour chercher des champignons, une occupation qui m'a toujours rempli de satisfaction. Las ! La forêt n'est plus ce qu'elle était, non pas que la pollution l'aurait irrémédiablement blessée, mais parce qu'elle est devenu un parc d'attraction pour tous les oisifs nostalgiques, comme moi. Insupportable de voir ces dizaines d'automobiles stationnant dans les chemins signifiant chacune un promeneur, un retraité ou un spécialiste de la mycologie gastronomique. Beurk, tout est devenu industriel, même les comportements et surtout les comportements de loisir. Que vais-je encore pouvoir faire ? Comment retrouver la vie là où ont poussé les chaînes de production du loisir ? Les paysages, les villages, les villes, tout est fléché dans le sens de la production / consommation. Toute poésie se trouve progressivement chassée du moindre recoin et je vais bientôt me retrouver dans cette situation qui m'angoisse, celle du monde de la publicité. Dans l'une de mes premières méditations je note que la publicité a moins pour objet de faire vendre des produits que de dessiner le monde futur, le monde qui figure une sorte d'idéal pour le commerce. Le monde tel qu'on peut le percevoir dans une publicité pour Coca Cola est ce monde lisse et brillant dépourvu de tout destin et de tout événement : il explique la pureté de la consommation, il pose la consommation comme alpha et oméga de toute existence. Notre civilisation semble alors bel et bien devenu une vaste machine à digérer les choses de la manière la plus agréable possible, un appareil de réglage du métabolisme, rien d'autre. Le métabolisme de qui ? Des dieux ? Bof.
-----------------------------------
DES LIEUX ET DES EPOQUES
Il y a quelques années mon ami Jean-Luc Nancy (peut-on écrire "mon ami" sans pudeur et sans crainte de se tromper ou de choquer ? ce n'est pas une question que je lui pose à lui bien entendu, mais plutôt à moi-même et en général, ce qui me gêne le plus dans cette expression est le possessif qui annexe plutôt qu'il ne magnifie) publiait un texte sous le titre "Des lieux divins". Je n'ai fichtre pas le moindre souvenir du propos, sinon qu'il m'avait agacé à cause de la référence théologique qui me rappelait toujours que Jean-Luc est pratiquement un défroqué. Pardon si je me trompe, mais je crois me souvenir de certaines conversations à Colmar dans les années soixante. Pourtant le thème du lieu me hante désormais à chaque moment, comme si chacun d'entre eux possédait une véritable identité, comme si c'était quelqu'un.
Ainsi le lieu de mon enfance avait été un immeuble quelconque, construit autour des années 1900 dans le Mulhouse intra muros, assemblage hétéroclite de taudis à peine descriptibles et d'hôtels particuliers dignes de Neuilly. Ce lieu a disparu, l'immeuble rasé et remplacé par je ne sais quoi, un parking ou un square, on ne voit pas très bien le projet initial. Bref, le lieu est mort, comme mon père, comme ma mère, et je crois que je n'ai jamais ressenti aussi fortement l'impression d'être brutalement devenu orphelin que le jour où j'ai découvert ce massacre de mon enfance. Quitte à me répéter, car j'en ai déjà parlé dans ce journal, j'ai découvert ce jour là que plus jamais je ne pourrai me retrouver dans la disposition spatiale que m'offrait cette maison. Jamais plus je ne pourrai goûter les rayons du soleil, ou l'ombre de l'été dans cette position allongée, la tête sur l'oreiller moelleux de mon père et les oreilles pleines des bruissements de ce quartier si coloré. Dans la cour le parfum du café fraîchement torréfié me parvenait en même temps que le chant de milliers d'oiseaux qui étaient devenus mes familiers. Oui, oui, pardon pardon, je ne suis pas en train de faire du Proust pirate, pas de crainte. Je veux m'interroger autrement que l'écrivain du Temps Perdu, car je ne pense pas que ce temps soit perdu, je pense qu'il n'est que blessé.
Et puis je n'éprouve pas du tout le besoin ou le désir de le retrouver, car il m'est apparu il y a quelques temps déjà que la mémoire suffit à elle-même, elle procure exactement le même plaisir que ce dont elle produit l'anamnèse. Anamnèse est le mot, car toute le différence entre se souvenir et se remémorer est là, dans la jouissance renouvelée de ce qui semble perdue. Oui, j'ai appris à tirer du plaisir d'un passé révolu, parfois depuis longtemps. Il arrive même que certaines expériences gastronomiques se présentent à ma mémoire, à mon grand plaisir et sans le moindre regret ou la moindre nostalgie. Comme si le fait se reproduisait réellement, comme s'il était classé dans un tiroir dont il suffit d'avoir la clé pour pouvoir en profiter à nouveau. La nostalgie, puisque nous en parlons, me paraît gâter beaucoup de choses autour de moi. Le monde de la consommation s'est lancé depuis longtemps dans une imitation minable des choses d'antan et il n'y a rien de plus navrant que le spectacle des victimes de telles manipulations. Donc pas de culture de la nostalgie, vieille recette religieuse de la bonne conscience froissée par sa propre lâcheté, sa terreur de la liberté; c'est toute une littérature dont il est question ici mais seulement en passant.
Le temps peut donc souffrir, comme l'espace. Ces deux éléments de notre danse dans la vie sont reliés en permanence à notre présent, et cela dans leur identité propre. Lorsque j'évoque pour moi un souvenir africain, je me retrouve sans peine là-bas, au Gabon, dans ma brousse et dans la chaleur hospitalière de cette région équatoriale. Dans l'exemple que je citais plus haut, le problème n'est pas que je ne puisse pas me retrouver dans cet espace chéri de mon enfance, mais qu'il me demeure interdit de répéter l'expérience, ce qui est une atteinte à ma liberté. Car un espace n'est jamais fini dans l'existence. Il vit et change. La liberté c'est la faculté de laisser être les choses dans leurs destin propre et donc dans leur changement en même temps que soi-même. On ne peut pas dire que la destruction totale soit un simple changement, cela explique ma peine. Mais le lieu est toujours là, ses coordonnées astrales demeurent les mêmes et je trouve d'ailleurs assez symbolique de mon destin qu'il me faille affronter un lieu devenu vide et quasi imperceptible, comme si une force hostile avait voulu me priver et m'éloigner définitivement du lieu de ma naissance. Dans ce lieu de Mulhouse je sais bien qu'il subsiste quelques haines assez féroces à mon égard, et il ne sera pas facile d'y demeurer comme je le souhaiterais. Mais je l'affronte et je vois bien qu'il n'est pas vide, qu'il est plein de ma tristesse, aussi triste que moi. Nous avons encore bien du temps devant nous pour changer à nouveau toute cette réalité.
Comme les pièces d'un puzzle. Tout se reconstitue, à chaque pas que je fais dans l'espace des première années de ma vie. Depuis que je suis de retour dans ce lieu, je me sens comme dans une curieuse transe. Le cadre général de la ville a totalement changé. Ai-je assez reproché à ses édiles d'avoir détruit Mulhouse dans son âme et dans son esprit ? De trop, car on ne peut pas détruire une ville ainsi et je découvre en ce moment combien je me suis trompé. Mais il y faut vraiment beaucoup de bonne volonté et de compassion car personne ne peut imaginer la puissance de la fermentation urbaine ici, ces trente dernières années, la rage avec laquelle les impératifs les plus sordides se sont emparé de l'ancienne république suisse pour la réduire à un parking pour salariés. Combien de temps me faudra-t-il pour tout retrouver ? Y parviendrai-je avant ma mort ? Ce n'est pas sûr, et puis il faudrait que je décide de m'y consacrer, ce qui n'est pas encore fait, malgré la pente fatale qui m'y conduit. Oui une transe, une sorte de petit bonheur qui chante sous ma veste quand je débarque au centre-ville, un sentiment que je n'ai pas fini d'interroger ici devant mon PC. Désolé si cela vous ennuie, ce sera au moins une bonne raison pour abandonner la lecture, non ?
Dimanche 6 octobre 2001
Transe ou jubilation. Oui je pense que le mot jubilation est plus approprié. Il s'agit d'un état d'énervement délicieux où le décor que je traverse suffit à mon bonheur. Etrange et difficile à comprendre en termes ordinaires, il y faut de la poésie, mais il paraît que ce n'est pas mon fort. Alors comment faire ? Travail de mémoire. Disons que le décor semble éveiller une curiosité permanente, comme s'il recelait partout un trésor. Bien sûr il y a un trésor derrière chaque vision, et ce trésor n'est autre que l'image d'origine, ce qu'il y avait avant. Il se fait alors une sorte de travail d'ajustement entre l'original qui se trouve dans ma mémoire et la forme présente. Je retrouve la vérité du lieu, et ce faisant j'abolis d'une part les effets déformants des transformations infligées à l'espace et de l'autre je sors moi-même du temps normal : la présence que j'expérimente n'est plus celle du présent de la conjugaison, mais un autre présent, plus complet et qui comprend d'un tenant les trois temps du temps, passé, présent et futur. Le vrai trésor n'est plus alors la forme d'origine, celle que j'ai connue dans le passé, mais la forme du réel en tant que telle, une forme inamovible, éternelle. Oui, en fait, c'est l'éternité que je découvre dans ces pérégrinations aux quelles je me livre assez prudemment.
Question : dois-je m'attendre à une évolution dans ces promenades extraordinaires ? Un résultat inattendu qui viendra me surprendre le jour où se produirait en quelque sorte un épuisement du gisement ? Ou bien tout cela est-il condamné à justement s'épuiser dans l'habitude des formes présentes au sens banal du terme ? Mais il y a une autre hypothèse, la subjective. Il ne s'agirait pas d'un événement conjoncturel, lié à mon expérience du lieu précis de mon enfance, mais de ce que l'on appelle la contemplation. La contemplation n'est pas simplement vision, lien passager entre un œil et un objet. Elle accomplit autre chose que le déroulement des formes de l'objet et ne se contente pas de les saisir pour les replacer dans le continuum de l'espace général. Difficile à dire, mais on pourrait suggérer que la contemplation manduque le réel. Cela signifie que celui qui contemple et les choses contemplées subissent ensemble un processus de "digestion", un processus commun d'intégration au corps de la réalité. On dirait que dans la contemplation s'effectue l'apparition même du réel, de la réalité. De la réalité en tant que réalité et non plus en tant qu'objet provisoire de la perception, d'expérience liée à l'une ou l'autre déclinaison du temps. Comme le fait de manger ou de satisfaire un besoin ou un désir, la contemplation offre du plaisir, je préférerais dire du bonheur, au sens initial de la bonne heure, du présent bon.
Essayons de mieux comprendre ce qui se passe ici, car il y a peut-être beaucoup de frime dans tout ça. Imaginez ce qu'on peut penser en lisant cela : ah il a trouvé le filon du bonheur ! Ah le voilà à l'abri des passions habituelles puisqu'il lui suffit de se promener dans une ville pour être heureux ! Il n'est pas faux de dire que je me sens détaché des passions courantes, argent, ambitions, gloire et plaisirs triviaux, mais cette faculté de contemplation ne représente de loin pas le milieu permanent dans lequel j'existe. Le temps normal, celui qui fait naître et qui tue me rattrape comme il rattrape tout le monde. Il s'installe même parfois de façon pesante et angoissante, comme dans mon enfance, sans tenir compte des privilèges que me confèrent mes renoncements au monde. En réalité, si je me souviens bien, je retrouve ici les sentiments natifs de ma jeunesse, sentiments dont l'ennui est le plus prégnant et le plus mystérieux. Il suffit que l'enchantement de la contemplation cesse, parce que la vie courante reprend ses droits sur l'usage du temps, pour que l'exister se mette à ralentir, à s'embourber comme dans le rêve classique où le corps est comme empêché de se mouvoir selon les ordres de la volonté. Pourtant, je croyais depuis longtemps en avoir fini avec l'ennui, l'aventure du monde et de la vie avait imprimé à la vie de tous les jours une sorte de rythme, un swing à peine traversé par quelques crises plus ou moins violentes, sans doute liées précisément à un certain degré d'inconscience de la situation véritable.
Retour à ces simplifications quasi religieuses de la compréhension du monde. Pour ne pas s'ennuyer, il faut et il suffit d'adopter un cadre de compréhension suffisamment global de la réalité pour pouvoir avancer sans hiatus. C'est le privilège incontestable qu'offrent toutes les religions, à condition de s'y perdre. Nous avons appris récemment ce que signifie se perdre dans la religion. Je me souviens de ces naïvetés de journaliste lorsque j'osais dire sans rire que dans mon bureau j'auscultais le monde, prenait son pouls en recherchant le lieu du jour où battait son cœur. Non mais ! Oh bien sûr il s'agit toujours d'une métaphore pour exprimer et décrire le travail qui consiste à établir une échelle d'importance entre les événements qui tombaient sur mon téléscripteur. Mais quand même quelle prétention, quelle naïveté je le répète. Naïveté qui avait cette contrepartie intéressante qu'elle me permettait de frissonner avec ce monde, de ne jamais tomber dans ces interstices creux où se forme l'ennui et le désœuvrement. Dire que chacun d'entre nous se voit d'une manière ou d'une autre contraint de trouver de tels expédients pour passer le temps ! C'est sans doute l'un des aspects les plus durs à vivre que cette comédie positivante qu'individus et corporations s'inventent pour arriver à s'inscrire dans un tel rythme. Je n'ai pas connu beaucoup de personnes qui se soient cantonnés dans le refus de cette hypocrisie, et ceux qui s'y sont risqué l'ont tous payé très cher. Quoique, au fond je ne sais pas tout ce qui a bien pu leur arriver par la suite.
L'ennui est de retour ? Pour l'instant je n'y vois qu'un signe de jeunesse, d'un rajeunissement de mon esprit. Il revient à la puissance initiale de refus. Car dans l'ennui il n'y va pas d'abord d'un manque de sens ou d'un manque à jouir, mais d'un refus d'adhérer aux valeurs moyennes du bonheur. Fatigué.
Samedi 10 novembre 2001
Je sais assez de tout pour tout savoir.
Bon, c'est un retour, après bien des tribulations douloureuses entre les mains des médecins et des chirurgiens. Seulement une remarque en passant, la médecine progresse certainement mais avec brutalité : les nouvelles techniques comme la cœlioscopie sont à l'abri de toute critique, sauf que les soins d'accompagnement et la convalescence se font au pas de charge. Et puis on ne prend plus aucun risque, quitte à faire souffrir un peu plus la bête, il vaut mieux poser une sonde urinaire quitte à abîmer un peu la zone génitale. Au total j'affirme qu'au lieu qu'elle soit jugulée par les discours ministériels, la douleur progresse dans les hôpitaux. Mais là aussi il s'agit bien souvent d'une facilité thérapeutique : la douleur est le meilleur des baromètres, un malade qui souffre est un malade déchiffrable et au demeurant vivant... Mais attention ! la douleur est génératrice de dépression, surtout lorsqu'elle s'établit sur la distance. Bof, il vaut mieux (pouvoir) rester à l'écart du monde médical. Hélas, non possumus !
J'ai souvent été traversé par cette idée que je figure parmi les rescapés du progrès. Sans la médecine moderne je n'aurais peut-être pas survécu. Faut-il le regretter ou s'en féliciter ? Je pense que la question est idiote parce que la vie, et donc l'existence, ne posent par elles-mêmes aucune question de valeur, elles ne concernent que ce qui survit, de toute manière, quel que soit le degré ou l'intensité ou tout ce qu'on veut de force et de santé. Les grands hommes ont souvent été, c'est une banalité de le répéter, de grands malades. C'est une indication intéressante en ces temps de réveil de l'intolérance, car au fond il n'y a guère de différence entre naître diabétique ou naître "infidèle". Monsieur Ben Laden, qui est paraît-il lui-même un grand malade, ne cherche au fond qu'à faire supprimer les trois-quarts de l'humanité au nom d'un eugénisme religieux. On pourrait lui demander de quoi il se mêle puisque la justice à laquelle il se réfère est d'ordre transcendant. Il est d'autant plus navrant de constater combien un tel crétin peut faire trembler le monde !
Lundi 12 novembre 2001
Changement de sujet. La Madeleine de Proust existerait-elle sans Proust ? Autrement dit, pourrait-on ressentir et identifier comme on le fait aujourd'hui, ce phénomène de l'anamnèse sensorielle si un certain Proust, écrivain, n'avait pas conceptualisé le processus ? En lisant Proust, nous avons certes chacun l'impression d'avoir vécu des centaines de telles réminiscences, mais n'aura-t-il pas fallu d'abord prendre conscience des idées écrites par l'écrivain français pour vivre réellement ces moments de mémoire ? Je me pose cette question depuis que je me retrouve dans mon milieu d'enfance, Mulhouse, exposé à une multiplication de ces phénomènes mnésiques. Il y va de beaucoup dans la réponse à cette question, il y va d'abord du statut du concept, et ensuite de celui de l'écriture. Si après m'être identifié comme écrivain on me demandait -"qu'est-ce-que vous écrivez", je répondrais qu'il s'agit d'une question idiote, parce qu'écrire c'est écrire, qu'à partir du moment où l'on écrit vraiment, c'est à dire où l'on fait autre chose que parler, il n'est plus utile de se renseigner sur les contenus de l'écriture, l'écriture est à elle-même son propre contenu. Elle est une action directe d'expression et ne demande aucun compte générique pour s'identifier en tant que telle. Donc la madeleine de Proust semble vraiment, disons, une condition sine qua non du processus mnésique lui-même. Formidablement intéressant, non ? Ah bien sûr, il est probable que d'autres écrivains ou poètes aient déjà fait allusion avant Proust à ce phénomène, mais cela ne change rien à l'affaire, car Proust lui-même était extrêmement imbibé de toute l'écriture déjà présente à sa naissance.
Reprenons. Une perception ne serait possible qu'en tant que sensation affectée d'un concept. C'est ce qui figure déjà en toute lettre dans la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel, mais à un niveau tellement conceptuel précisément, que l'expérience sensuelle elle-même est pratiquement occultée. Mais que signifie affectée d'un concept ? C'est là le problème, car un concept est-il concept seulement après être passé au feu de l'écriture, ou bien possédons nous des idées et des concepts indépendamment de leur gravure dans la pierre ou sur le papier ? S'il me lisait, Derrida devrait bien se marrer car il semble que j'entre enfin dans ses eaux théoriques. Mais pourquoi pas ? Evidemment cela représente pour moi un immense travail que de recoller les morceaux de mes propres ensembles théoriques afin d'y intégrer cette hypothèse, relativement neuve pour moi. Il faut d'abord que j'abandonne tout un platonisme implicite et spontanéiste qui condamne a priori l'écriture comme mensonge, comme vérité différée et en tant que telle déformée et surtout déformable. Il faudra aussi que j'abandonne ou que je reclasse tout le département "tradition orale", il faudra en somme que j'accepte de ne nommer tradition que ce qui prend son départ déjà avec une écriture, quelle qu'en soit la forme. Il y aurait des écritures, comme on dit qu'il y a des langages. Dans mon premier "écrit" intitulé "Deuxième Entretien Préliminaire", j'avais analysé le langage comme œuvre d'art, c'est à dire comme infraction ou mutilation productive de l'étant. Je m'explique. L'art part toujours d'une imitation de l'étant (qu'on peut aussi appeler nature ou tout ce qu'on voudra). Or cette imitation est toujours infraction au sens où elle doit rompre avec le temps réel et l'espace réel : reproduire un paysage c'est d'abord le sortir de son espace propre, et c'est ensuite le saisir dans un temps t tout à fait aléatoire, c'est à dire impossible à isoler. Les flux de sensations doivent être bloqués par l'artiste qui doit choisir d'arrêter lui-même les flux issus de l'étant. L'art est, à ce titre, une falsification absolue, sans appel. De la même manière, l'écriture procède, comme la parole sans doute - et c'est là que s'articule la problématique du passage de l'oral à l'écrit - d'une invention artificielle, de l'immobilisation du sens dans une posture aléatoire. Cette posture est certes appelée à évoluer, et on peut penser que l'écriture est une phase de l'évolution de l'expression humaine. Cette expression ne vise sans doute pas autre chose que la proclamation de son appartenance à l'étant, manière élégante et honorable de nier la mort.
Il faudrait donc, en toute honnêteté, replacer l'écriture, et donc la madeleine de Proust, dans une évolution du cri de la bête blessée, dans son épurement. Mais, ce n'est pas tout. Car il y a, nous l'avons dit plus haut, détermination de la perception par l'écriture : il n'y a pas de perception sans gravure préliminaire, sans dessin (ou dessein ?) de la sensation. La sensation doit être représentée graphiquement pour qu'elle prenne sens pour devenir perception. Pourquoi devenir perception ? Parce qu'en tant que perception elle change de registre et passe du passif à l'actif : l'anamnèse en tant que telle est une action, ce n'est pas un accident des sens. L'exercice de l'écriture conduit à autre chose qu'à un vécu ordinaire : il fait passer dans l'intemporel et dans le non spatial. J'y ai déjà fait allusion, il s'agit d'un véritable voyage dans les deux éléments fondamentaux de notre perception du monde, d'une abolition de la dépendance du présent, ou de l'extension du présent dans les trois dimensions classiques du temps. Autre chose est de savoir si Proust avait lui-même la moindre idée de la dimension de sa réussite.
Mardi 13 novembre 2001
Ecrire : choisir des mots pour habiller le flux des pensées, interrompre ce flux, lui-même composé de mots qu'il faut trier, dont il faut liquider la plupart pour n'en retenir que quelques uns. Il s'agit d'un geste dans le geste. Vous assistez à la théorie des mots qui se succèdent dans votre esprit, organisée à priori dans une posture dormante ou mécanique, et puis tout d'un coup vous tranchez, coupez, désossez la structure mouvante du pensé pour en extraire un mot, rarement un mot nouveau, mais un mot qui acquiert sa nouveauté par la nouvelle place qu'il occupe dans un flux cette fois contrôlé. Enfin, contrôlé de manière assez empirique et bancale, dont on ne peut jamais rien dire qu'au résultat final, résultat qu'on a bien du mal à découvrir. Ainsi dans ce que j'écris en ce moment même on peut distinguer ce que je pensais AVANT de me mettre devant ma machine ce matin, cela qui s'était mis à dormir en moi, classé dans les archives du pensé passé et qui avait pris sa place dans ma théorie générale des choses pensées. Et puis en y regardant de plus près on peut voir de petites inflexions, par exemple dans le mode de présentation de l'idée. Ainsi, jusqu'à présent il ne me serait pas venu à l'esprit de décrire, comme je le fais en ce moment, l'opération d'écrire par le menu de ce qui se déroule à partir de mon clavier. Cette nouveauté infléchit le sens qui sort du "magasin", du stock pensé et ficelé depuis hier ou avant-hier ou encore depuis des années.
Oui, la pensée elle-même se renouvelle par crises, la plupart du temps elle ne fait que s'entretenir, rester à peu près debout après d'elle-même, et il faut des ruptures formelles ou de fond pour lui imprimer un mouvement nouveau. Mais elle ne se renouvelle réellement qu'à partir du moment où ce flux routinier trouve un barrage sur son chemin, à partir du moment où intervient la décision de construire un tel barrage, de bloquer le train-train devenu aveugle du pensé immobilisé dans le non conscient. Et ce barrage, cette décision, c'est l'écriture, exactement comme le choix d'une couleur donnera soudain un caractère définitif et irréversible à un tableau. L'écrivain en arrive d'ailleurs à des situations fort étranges, où il lui suffit de prendre en main les instruments de son écriture, clavier, plume ou stylo, pour déclencher la crise : l'écriture est une crise permanente dont tout écrivain sort lessivé, détruit, vidé, mort d'angoisse pour avoir passé des heures souvent à enfreindre son propre pensé, à détruire tout ce qui s'est construit en lui pour plâtrer le questionnement incessant, absorber le ressac permanent des mots qui se bousculent. Car cette crise est dangereuse, elle porte l'âme de l'écrivain au bord de lui-même, entre l'édifice qui supporte ce qu'il est depuis si longtemps, les quelques certitudes qui donnent un lien apparemment si solide à ces mots épars, et puis les mots qui surgissent d'un coup pour renvoyer tout le reste dans l'incertitude, dans le décomposé. L'écriture compose en décomposant, le discours nouveau se nourrit des restes du discours ancien, et l'angoisse primitive surgit de ne plus se comprendre soi-même. Alors il faut travailler à la recomposition du tout, chercher les morceaux des articulations brisées et les recoller dans l'écriture nouvelle.
Mais attention, la terreur qui se dégage de cette opération d'écriture n'est pas seulement causée par le danger de voir se désagréger le pensé, la belle mécanique théorique sur laquelle on repose souvent pendant des années, mais justement par celui de remettre en question la vie elle-même : retour au problème de l'antécédence du conçu sur le perçu. Admettez un instant que ce soit bien Proust qui ait inventé la si célèbre anamnèse, qui lui ait conféré ce côté expérimental et ludique à la portée de tout le monde. Alors il faudra aussi bien admettre que c'est l'écriture qui règle tout, que c'est le concept qui renferme de manière absolue tout ce que nous classons dans l'humain et ses privilèges. Contrairement à ce que pensent les empiristes ce ne sont donc pas les sensations qui forment la substance du pensé, ce n'est pas l'être humain qui s'adapte à la réalité selon une arithmétique de l'afférence ou de l'efference mais c'est bien la réalité qui pourrait se plier à la décision du concept. J'affirme qu'il est possible de réchauffer le monde avec des mots.
Samedi 17 novembre 2001
Vive les accords de Matignon ! C'est presque un mea culpa que je vais faire ici, en prenant résolument, cette fois, la défense de la Corse et des Corses. Presque, car je n'ai jamais donné dans l'anti-nationalisme primaire, j'ai toujours pensé que derrière la violence en Corse, il y avait une affaire d'honneur. Et ceux qui m'ont lu savent quelle place tient l'honneur dans ma métaphysique. Or je viens de voir ce magnifique documentaire intitulé Une île sur le Feu, diffusé par l'excellente chaîne de télévision Planète. Quelle douche ! Roborative et descillante pour les yeux et la conscience politique et historique. Il ressort principalement de ce remarquable document que la Corse est un département cocu de notre belle France, cocufié par la Métropole, évidemment.
Le plus bel adultère, dans la longue liste d'injustices dont la Corse a été l'objet, me choque particulièrement car il fait partie de mes rancunes historiques les plus solides : pendant la Grande Guerre, celle que je préfère (sic), les Corses ont subi le même traitement que les tirailleurs sénégalais : en première ligne, allez, et pas de rouspétances. Bon, il faut bien qu'il y en aie, en première ligne, mais il y a mieux. Le Ministre de la Guerre de l'époque, paix à son âme, avait tout simplement décidé que les Corses n'iraient en permission qu'une fois tous les six mois, alors que leurs compatriotes (?) du continent avaient le droit de rentrer dans leurs foyers une fois tous les trois mois. Comme on le souligne dans le film, cela fait autant d'occasion de mourir en plus. Cela me suffirait déjà pour condamner la marâtre continentale, le crime me paraît assez grand pour qu'il mérite la révolte, sous toutes ses formes. Mais, comme c'est curieux, je n'ai pas appris ces faits dans mon école, il aura fallu attendre que j'ai soixante ans pour en prendre connaissance quasi par hasard ! Merde.
Mais ce n'est pas tout, et de loin pas tout. Spoliations économiques en tout genre, attitude coloniale des gouvernements successifs, erreurs monumentales de gestion, et partout la mauvaise foi, comme dans ce que raconte Rocard dans le documentaire à propos de la SOMIVAC, société de mise en valeur de la Corse. Mise en place par un des gouvernements socialistes des années 57 - 58, cet organisme avait acheté un grand nombre de terre pour les mettre en valeur, les remembrer puis les revendre aux Corses. Bel élan de générosité. Or lorsque les premiers 400 lots de terre ont été sur le point d'être revendu aux Corses, le gouvernement français (c'était De Gaulle...) intime l'ordre à la SOMIVAC d'en céder 90 % aux Pieds-Noirs qui venaient de quitter l'Algérie en catastrophe. Bon, on peut admettre qu'il y a aussi une proportion de Corses et de descendants de Corses parmi ces Pieds-Noirs, il reste qu'une telle décision ressortit du mépris le plus affligeant des populations de l'île et de la provocation la plus ouverte. Imaginez un tel épisode quelque part en Champagne ou en Vendée ! Incroyable.
Au demeurant, ce que j'écrivais dans mon Journal (hélas je ne sais plus lequel), reste pertinent, et parfois pour des raisons tout à fait artificielles. Ainsi, la métropole avait exporté en Corse le principe de l'indivision, or pour contrer cette loi il n'y avait qu'un seul moyen : inventer une propriété orale, non attestée par la paperasse. Les héritiers se réunissaient autour du corps du décédé et se distribuaient ses terres oralement.. A partir de là tout devient affaire d'honneur, de parole donnée et tenue ou trahie, et puis de paix ou de violence selon les aléas des personnes et des caractères. De là la constitution aussi d'une communauté clanique, car une telle société a besoin d'arbitres indiscutables et respectés. Il n'y avait qu'un pas avec des chefs de clan qui sont devenus avec le temps les représentants élus et les nouveaux caïds de Corse. De même, les jeunes n'ont plus qu'un moyen REEL pour se placer dans un tel contexte social : le courage ou l'héroïsme d'un homme d'honneur. C'est dans la Mafia qu'il y a le plus d'hommes d'honneur.
Enfin, c'est toute ma théorie du nomadisme persistant qui se trouve confirmée par ce petit tour en Corse. En effet, dès le 19ème Siècle, les gouvernements se sont attachés à encourager et parfois forcer les Corses à s'expatrier dans les nouvelles colonies d'Afrique et d'ailleurs, d'où la présence nombreuse de Corses dans les administrations coloniales. Car ils ont joué le jeu avec plaisir, retirant tous les avantages de la situation, et se trouvant tout d'un coup fort dépourvus lorsque l'aventure coloniale s'est terminé un peu partout dans le désordre qu'on sait. Incroyable incurie des gouvernements de ces deux derniers siècles, qui ont encouragé ce nomadisme voilé pour ensuite, lorsque tout était perdu, prétendre recoloniser la Corse elle-même ! Dans les années 70 on a voulu très sérieusement faire doubler la population de l'île et lancer un développement touristique qui, s'il avait eu lieu, aurait transformé la Corse en une super Côte d'Azur, béton et grand banditisme garanti. Heureusement il y a eu Aléria et le nationalisme Corse, cette farce dont on n'a pas fini de rire, mais qui a bien protégé, finalement, les intérêt du peuple Corse. Je vais me cherche un anneau quelque part dans un petit port de cette île, j'y finirais bien ma vie.
Dimanche 25 novembre 2001
Ca y est ! Je viens de constater qu'il n'existe plus aucune chaîne de Télévision indemne de publicité. Requiescat in Pace. Jusqu'à ces derniers mois, il y avait encore quelques enseignes "propres", comme Planète ou la 5 où il faisait bon s'attarder parfois pour cette seule raison. Mais tout passe, et le marché s'empare de tout. Le pire dans ce constat funèbre est qu'il faut tirer une conclusion impitoyable : aucun média ne peut plus vivre sans se vendre à une puissance privée. Encore pire : aucun media public ne peut survivre sans pactiser avec le diable du commerce. C'en est fini de toute liberté éditoriale, car personne ne peut croire qu'une puissance d'argent laisse à son commensal la bride sur le cou. J'ai encore un exemple récent qui prouve à quel point cette loi est d'airain, c'est le cas Afflelou qui vient de retirer pour des millions de marché à une antenne qui s'est permise de faire un reportage irrévérencieux sur le grand opticien bordelais. Bref, tout est foutu de ce côté là, mais y en a-t-il en autre ? Existe-t-il encore un seul moyen pour le public de recevoir des messages propres, des informations véraces et totalement libres de toute influence ?
La réponse est non. J'ai vécu les étapes de cette dégradation à mon corps et à ma carrière défendant. Dans les années 80 ce fut au tour de la Troisième Chaîne française, la chaîne régionale (sacro-sainte création du général De Gaulle !) à tomber dans l'escarcelle publicitaire après que les deux autres eussent déjà largement laissé leurs budgets dépendre de cette manne. A ce moment là j'étais dans la place, comme journaliste, bien indigné et bien marri de ce qui arrivait. J'ai dû moi-même écorner ma carrière par un refus d'obéissance (hé oui, aujourd'hui dans la Presse Française on peut tomber, en tant que journaliste, pour cette accusation ! ). On voulait me faire lire la météorologie, moi journaliste, une météo sponsorisée par une assurance privée. Mon refus avait laissé mon Rédacteur en Chef incrédule, il ne pouvait pas comprendre le pourquoi de mon geste. Mais quelques jours plus tard, lorsque le bras de fer entre la Direction et moi s'est tendu à mort, j'ai sorti mon atout maître en précisant que l'assurance en question avait fricoté publiquement avec Le Pen. Cet argument était évidemment un compromis qui permettait au Rédac-Chef de ne pas perdre la face, mais il me servait surtout à faire comprendre à la hiérarchie le fonctionnement réel de la publicité. Pourtant je me souviens que ma menace n'avait pas été prise au sérieux, on ne pouvait pas admettre que Paul Kobisch refuserait, le moment venu, de lire la météo, risquant ainsi de se voir accusé du fameux "refus d'obéissance". Là aussi mes chefs rêvaient, car l'obéissance n'avait jamais fait partie des articles de la Charte des Journalistes. Tout le monde faisait semblant d'avoir oublié les principes fondamentaux du journalisme dont la liberté était le plus essentiel.
Le jour venu, le Chef était dans le studio, et il a bien été obligé de prendre l'antenne à ma place, car je quittais la cabine au moment précis du générique de la météo. Furax, il avait dû prendre ma place. Le lendemain il fut question de mon licenciement, nouvelle que je reçus avec toute la sérénité dont je sais faire preuve, en précisant à mon Rédacteur en Chef qu'il prenait de sérieux risques ainsi que le Directeur Régional. Le résultat fut qu'ils ont été contraints de dissocier la Météo elle-même du Journal Télévisé, et de payer des pigistes pour la lire. J'avais gagné sur toute la ligne mais je savais que ma victoire n'était qu'apparente car je paierai plus tard en terme de carrière, carrière gelée jusqu'à ce que je démissionne pour aller travailler là où j'avais la certitude qu'il n'y aurait jamais de publicité. Arte, en effet, s'était donné comme principe original à l'époque, de refuser toute publicité. Ca faisait bien dans le décor culturel européen. Et puis la vérole est venue comme partout ailleurs, produisant les mêmes effets sur le produit lui-même, et sur ma carrière. Enfin, vous apprendrez aujourd'hui que toute cette évolution ne s'est pas faire toute seule dans les média, et qu'il y a eu pas mal de résistance un peu partout. Les cimetières médiatiques sont pleins de Paul Kobisch, qui a finalement été licencié pour "refus d'obéissance" à ....Arte ! Il faut le faire. Mais le pire du pire n'est-il pas que tout le monde s'en fout ? Parce que tout le monde le sait et que personne ne songe à résister là où il le faudrait, c'est à dire à boycotter les émissions payées par le secteur économique privé.
On ne croit plus en la liberté. Voilà le problème. On a peur. Vous avez peur, vous ? Et pourquoi ?
Dimanche 2 décembre 2001
Les grandes dichotomies sont toutes stupides. A priori. Ainsi, dans une communication récente, j'ai travaillé sur fond du doublet célèbre superstructure / infrastructure. Méthodologiquement l'affaire s'est plutôt bien passé, il s'agissait d'étudier les phénomènes (supposés) de l'uniformisation et de l'homogénéisation des pratiques culturelles dans le cadre de la mondialisation. Or, après m'être soigneusement distancié par rapport à cette dichotomie abstraite, je me suis retrouvé à spéculer dans une autre dichotomie tout aussi abstraite, sans m'en rendre compte. J'avais subrepticement remplacé le doublet que l'on doit à Marx par un doublet de mon cru, à savoir fonctionnement / événement. En y réfléchissant bien, je me suis retrouvé devant les mêmes difficultés en me rendant d'ailleurs compte que les deux dichotomies se recoupaient tout à fait. Heidegger répétant Marx, ça je ne l'aurais jamais deviné ! Heidegger parce que le concept de fonctionnement joue un rôle central dans sa pensée, disons dans sa critique de notre civilisation. Dans les événements de notre "progrès technique", le philosophe de la Forêt-Noire ne voit qu'une accumulation de fonctionnements qui génèrent de nouveaux fonctionnements.
Mais qu'est-ce qu'un fonctionnement ? Par opposition à un événement ? Là est toute la question. La philosophie des existentialistes, que ce soit Sartre ou Heidegger, ou encore sous certains aspects Kierkegaard, repose sur une hypostasie de l'événement. Or le fait d'exhiber un concept comme celui de fonctionnement paraît alors contradictoire dans une ontologie où il n'existe pas d'idées directrices ni de processus temporel rationnel. Pas d'Histoire quoi. Si notre vécu est tout entier événementiel, c'est à dire si chaque instant de notre existence est événement et non pas passage ou processus, alors il n'existe rien qui puisse signifier quelque chose comme fonctionnement ( ou infrastructure pour la version Marxienne ). Dans l'aperception existentialiste il faut admettre que chaque étape de ce que nous appelons fonctionnement, chaque degré de ce que nous concevons comme développement ou évolution, chaque moment d'un processus quelconque sont des événements. Pour bien comprendre, il faut se représenter les moments de fonctionnement d'un moteur à explosion comme des événements.
Mais que signifie événement ? Un événement est quelque chose qui arrive de manière aléatoire, indépendamment de la volonté humaine, indépendamment d'une série et d'une prévision. Un fonctionnement, au contraire, décrit ce qui arrive régulièrement et de manière parfaitement répétitive et contrôlée. Par l'homme. Penser l'existence comme Evénement, ou bien comme suite d'événements ne tolère donc rien de tel, sauf à redéfinir le fonctionnement comme ce qu'il n'est pas a priori, c'est à dire un accident comme n'importe quel accident. Comment un fonctionnement peut-il se retrouver dans la catégorie des accidents ? Ce n'est pas si difficile à concevoir, si on se distancie par rapport aux phénomènes dont le caractère répétitif amène un fonctionnement. Ainsi la religion : le Christianisme a "fonctionné" pendant deux millénaires en donnant toutes les garanties d'un fonctionnement parfait, en donnant l'illusion d'être aussi naturel que la pluie ou les vagues de l'océan. Or, le Christianisme a vécu, il ne "fonctionne" plus. On constate à son propos que non seulement il ne fonctionne plus, mais qu'en réalité il n'a jamais fonctionné qu'avec l'aide de milliers de pharmakon, d'artifices de toutes sortes. Exit le fonctionnement. Cette comparaison nous met sur la voie d'une définition plus simple du fonctionnement : les processus naturels.
La Nature fonctionne : elle tourne selon des ou un rythme précis, celui des saison, ceux des révolutions astrales. Génération et mort sont les événements de ce fonctionnement. Soit, mais on sent bien que notre sens du fonctionnement n'est pas satisfait par cette comparaison. On sait que les rythmes naturels mais surtout les événements qui marquent ces processus ne possèdent de loin pas la perfection de ce que notre technique a, depuis des siècles maintenant, mis à notre disposition. L'Allemand qu'était Heidegger devait avoir un sens impitoyable de ce qu'est un fonctionnement. La précision de la technique moderne ( et allemande de surcroît ) ne laisse aucune place aux aléas, nulle bavure dans l'alésage d'une tuyère d'avion à réaction ou dans le fraisage d'un bloc moteur. La Nature est tout le contraire, on ne peut s'y fier qu'en prenant d'extrêmes précautions, elle est le lieu par excellence de l'événementiel. Toutes les spéculations triviales ou scientifiques sur la météorologie ( le Temps ! ) sont là pour rappeler l'imperfection native de la nature par opposition à notre sens du calcul et à nos pouvoirs de contrôle des processus fonctionnels.
J'ai l'impression de réécrire l'histoire. L'instinct technique repose évidemment sur l'observation des phénomènes répétitifs de la nature, sur l'étude du "fonctionnement" de la réalité qui nous entoure, à commencer par le mouvement des astres. Le cœur de toute science, la mesure, dépend étroitement de ce mouvement. Mais ici il en va pour le temps comme pour l'énergie. Heidegger avait défini le passage dans la civilisation technique comme le point à partir duquel l'homme a produit, créé de l'énergie non-naturelle, c'est à dire la forme d'énergie qui n'existait pas dans la nature immédiate, dans le monde terrestre. L'énergie nucléaire, souligne-t-il, n'existe que dans le firmament. L'homme a dompté des forces qui dépassent le cadre dans lequel il existe. Aujourd'hui, le temps est devenu presque aussi artificiel que cette énergie, puisqu'il ne se calcule plus à partir des révolutions astrales, mais à partir de celles des satellites artificiels, garantie de l'exactitude mathématique et du contrôle humain. La science nettoie les saletés de la nature brute, créé des paramètres indubitables, bref, elle produit le véritable fonctionnement. Restant entendu que l'univers tout entier reste une grande inconnue, tellement inconnue que tout projet de fonctionnement universel reste condamné à passer pour un bricolage naïf.
L'idée de fonctionnement restera donc éternellement une approximation, ce qui logiquement la classe dans le contraire de sa propre idée. Il n'y a aucune possibilité que quoique ce soit fonctionne réellement parce que tout reste évidemment soumis à des processus et à des événements absolument insoupçonnables. La terre peut sauter à tout moment, percutée par un astéroïde quelconque. Nous aurons belle mine avec nos calculs. Le problème est là, dans le côté illusoire du fonctionnement qui provoque le scandale des consciences dès que la nature se remet à parler son propre langage et à produire de l'imprévu. Que ce soit des catastrophes naturelles ou des événements liés à la nature humaine elle-même comme le crime inqualifiable du 11 Novembre, ils montrent les limites de toute prévision, de tout fonctionnement. L'oubli de ces limites a produit un monde lui-même dangereux, l'homme ne monte plus aucune garde tant il est convaincu de sa suprématie. L'anthropocrate ne se soucie plus de se préparer en permanence à l'événement, il n'attend plus rien. Terrible.
Jeudi 28 février 2002
Ceci est une réaction à l'émission d'Assouline de ce matin sur France-Culture. Invité le sempiternel Pascal Brückner, thème : la critique de l'anti-américanisme primaire.
Pascal Brückner figure comme l'un des penseurs, politologue et intellectuel engagé du moment. Il s'agace de l'anti-américanisme trop primaire à son goût d'une large partie de la vraie gauche française. Comme d'habitude c'est la gauche elle-même qui se flagelle car les vrais intellectuels de droite ne prennent pas le risque ni ne perdent leur temps à faire une contre-pub américanophile. Peu importe donc la droitité à peine cachée de votre invité de ce matin, le fait important de votre émission est que ce cénacle d'esprits fins et cultivés n'a à peu près rien dit d'intéressant, ni pour attaquer l'oncle Sam ni pour le défendre. Les personnes réunies autour des micros n'ont fait que nous aligner quelques banalités sur l'Amérique de Bush et l'économie. Il vaudrait mieux qu'elles se cultivent un tant soit peu, en s'astreignant, par exemple, à regarder les séries américaines que déclinent comme autant de robots sans âmes nos antennes publiques et privées. De Dallas à Melrose Place, en passant par Dynastie et Beverly Hills, ce n'est pas seulement le marché des produits télévisuels que les USA ont progressivement monopolisé. Plus largement il est tout aussi inintéressant d'aller répétant que nous sommes des cocus culturels, cette vérité n'ayant une chance d'acquérir un sens que le jour où on nous dira pourquoi.
Hé bien je vais vous le dire en peu de mots : parce que l'argent (ou la puissance financière) se comporte effectivement comme le principe nazi, n'en déplaise à ceux dont les oreilles sensibles en ont assez d'entendre parler du plus grand crime connu de l'humanité. Ce principe est simple, il est celui de la propagande, c'est à dire du discours imposé et menaçant dont le seul effet recherché est la peur. Allez donc analyser en profondeur ces séries dont on pense qu'il suffit de se moquer en bon Français qui a fait sa philo, allez-y et vous discernerez peut-être le paradigme de la terreur qu'elles renferment toutes, le modèle que distribuent parallèlement les entreprises dans la vie quotidienne, et déjà les professeurs dans nos écoles.
Allez voir quelles curieuses coïncidences superposent miraculeusement les discours de morale économique qui traînent dans chaque épisode de ces " crétineries " avec ceux-là mêmes de nos patrons, privés et malheureusement de plus en plus fréquemment publics. Croyez-vous que le téléphage moyen a les moyens intellectuels et moraux suffisants pour ne pas finir par ressentir comme une fatalité à valeur de véracité inéluctable ces aventurettes qui ressemblent tellement aux siennes. Lorsque Amanda, l'héroïne impitoyable du capitalisme pur et dur, écrase la pauvre Allyson qui n'en peut mais, je ne revis pas autre chose que mon dernier conflit avec mon chef de service.
Alors vous me direz superbement que c'est donc qu'il y a valeur de vérité dans ces séries injustement vilipendées et qu'elles ont donc a fortiori valeur de culture ! Soit, mais cela revient à peu près au même que de dire que les slogans de Goebbels étaient vrais parce que la réalité allemande ne laissait aucune chance à quelque autre vérité que ce soit. Il y a quelque chose de tragique et de dérisoire à ces fantasmes d' " exception culturelle " ou autre complainte identitaire, mais ceux-ci ne font que dissimuler la véritable souffrance de ceux auxquels on refuse tout autre horizon que celui de la propagande, celui de la domination de l'homme par l'homme enfin parvenue à son terme ultime : le viol de la conscience. Cela vous rappelle, comme à moi, un livre très classique sur cette affaire. Allez donc aussi le relire. Merci.
Mercredi 26 mars 2002
Ca suffit ! Monsieur Max Gallo a tout faux, une fois de plus. Il fait partie de ses pleureuses de la République et de la politique qui se trompent de bout en bout sur tout avec de grands airs de diva de la pensée historique. Quel bel exemple de pseudo-historien de l'anecdote accumulée en roman. Bref, cet histrion, permettez-moi ce mot d'humeur, prétend que l'économie a pris le pas sur le politique ! Quelle erreur en un temps où le politique reprend tous ses droits, mais, Monsieur Max, pas là où vous l'attendez, dans votre fausse démocratie de représentation et son théâtre de marionnettes pseudo républicaines. Le politique est désormais, au contraire, partout où vous ne le cherchez pas, dans toutes les relations qui se tissent autour du citoyen dans les domaines qu'il ne choisit pas, qu'il n'a pas le loisir ni la liberté de choisir, celui du travail pour commencer et tous les autres, les sociaux, depuis la famille jusqu'aux relations de bistrot. D'où il ressurgira le moment venu, ne crains rien mais gare tes fesses.
Crétin, je me fâche, quelle idée méprisante faut-il avoir du citoyen pour penser de lui qu'il vit dans l'économie, cette abstraction purement idéologique et religieuse, dégoulinante de fausse science ! Ne crois-tu pas que n'importe lequel d'entre nous se sait dans une relation politique avec ses chefs, sa femme, ses enfants et ses amis et ennemis ? Qu'est-ce-qui te permet d'exclure du politique tous ces champs réels de la vie ? Qu'est-ce-qui te permet d'hypostasier les appareils de cette démocratie moisie et de dire, par exemple, que l'abstention est un geste apolitique ? Ils te rient au nez, et je suis poli, ceux qui s'abstiennent et te renvoient à tes joujoux de bourgeois impénitent. Tu es raide, rigide comme un balais, englué dans ton romantisme de distribution des prix et des Mariannes en Brigitte Bardot de plâtre !
Patate ! Il est temps d'ouvrir les yeux, c'est à dire d'exprimer par des mots les termes de la nouvelle donne qui s'annonce toute proche : tes discours de magister vont cesser d'avoir cours et tomber bientôt dans le vide sidéral de la moralité à la petite semaine des socialo-gaullistes en chambre, de toute cette sociologie de petits profiteurs même pas consciente de ses péchés, véniels il est vrai, tant ils sont médiocres. Pourquoi tu crois que les quelques grands républicains qui restent, les Joxe, les Badinter et quelques autres se cachent et refusent de prendre ce pouvoir qu'on leur donnerait les yeux fermés ? Parce qu'ils ne veulent pas se compromettre moralement avec cet appareil même plus politique tellement il est devenu une simple balayette de femme de ménage pour transnationales. Quand les petits camarades se mouillent à Barcelone, tu le remarques, tu mets le doigt sur leur trahison, tu le dis qu'ils ont signé contre les intérêts des salariés français et au profit du détesté libéralisme anglo-saxon.
Mais ce que tu ne dis pas, c'est qu'en réalité ce sont tous les défauts de notre sainte démocratie française qui se sont accumulés à Bruxelles : quelles différences y-a-t-il entre le despotisme de la Commission et celui des Ministères de la rue de Varenne ou de la Place Beauvau ? Quelle différence entre la paralysie de l'assemblée de Strasbourg et celle du Palais Bourbon soumis à la discipline, hé oui ne rigole pas, " républicaine " ? Quelle tristesse que des gens comme toi, qui vendent à milliers leurs brochures pour midinettes, se révèlent dupes de cette République qui s'affirme aujourd'hui plus censitaire que jamais ! Non, mon cher, l'économie ça n'existe pas, pas plus que Dieu, et je dirais comme l'autre - " l'économie est morte ", morte-née car tu devrais savoir au moins comme moi qu'elle vient à peine de naître cette économie, qui s'appelait encore économie politique il n'y a pas vingt ans.
Bref, tes gémissements ont fait Tilt. Refais tes calculs, comme disait quelqu'un qu'en son temps tu n'aimais pas beaucoup, et pour cause, Debord avait déjà démystifié tout cela avant Mai 68, une date que tu dois avoir renié depuis longtemps aussi, digestion faite de tous tes renoncements au vrai changement, et toutes couleuvres avalées des complicités passagères et si pusillanimes de contenus. Car on n'a pas oublié que certain grand socialiste, Mitterrand avait de la gueule, lui, t'on fait confiance, et qu'en as-tu fait, de cette confiance ? Alors camembert, Max. Quand tu te réveilleras de ta rêverie économiste, sache qu'il sera trop tard et qu'à ce moment-là on n'aura plus besoin de prêtres de la croissance et du CAC 40. Tu n'es pas ça ? Oh non, sans doute, mais ce que tu sembles ignorer, c'est que tes propos ouvrent des autoroutes à tous les nouveaux corbeaux de la nouvelle transcendance marchande. Il est vrai, et je m'arrête là, que tes livres se vendent si bien ! En toute fraternité.
|

|
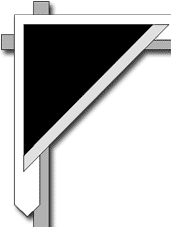




![]()