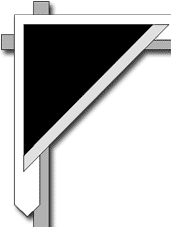
|


Lundi 11 décembre 2000 Toute une année sans rendre compte de mes journées. Non pas que je n’ai pas écrit, j’ai, au contraire,
encore sévi avec un de ces manuscrits dont le destin est le néant, mais qui me plaît beaucoup. Une méditation assez élaborée du binôme Sédentaire/Nomade, une
question qui traîne dans ma tête depuis des lustres et qui prend forme. J’ai envoyé tout cela à trois éditeurs, on verra bien. Mon but était double,
introduire la dimension de vérité dans la poésie, la vérité dans toute sa détresse, et déverrouiller la Parole : l’époque présente est comme saisie
dans un bloc de mensonge, chacun veut dire A et sur ses lèvres se forme B, c’est irrépressible et c’est la peur. Si l’un des éditeurs craque, c’est la
révolution. Je suis littéralement heureux de revenir sur cette scène de ma vie.
Youppie !
Mardi le 12 décembre 2000
Pas si facile en ce moment de me concentrer sur cette écriture, il se passe trop de choses décisives par
rapport à mon existence, divorces avec ma femme et avec mon entreprise, perspectives de libertés nouvelles, peut-être départ en bateau pour
l’aventure ? Et puis la douleur physique ne me lâche pas d’une semelle, et en ces semaines de fin deux-mille, je déguste au point de me poser quelques
questions. Ma colonne vertébrale s’entartre trop vite, suffira-t-il de quelques semaines de voilier pour tout remettre en ordre ? Je l’espère car je ne
saurais continuer ainsi.
Bref, le temps passe aussi, délavant toute chose comme le soleil. On finit par se demander de quoi il s’agit ? C’est curieux comme
les lignes de définition du réel s’estompent sans cesse, il y a comme un brouillage permanent destiné à fomenter une sorte d’oubli de ce qui est, oubli
des principes et des fondements, oubli même du malaise dans lequel on végète en faisant semblant de temps en temps de se réveiller pour " faire "
quelque chose. Tout s’évanouit dans la confusion, les analyses, les croyances, les opinions les mieux ancrées, pression d’un temps râpeux comme une pierre
ponce. Pourtant, en ce qui me concerne, les contours de ma pensée s’affirment curieusement, je m’éloigne d’une attitude d’analyse permanente de ce qui se
passe et me rapproche d’une idée plus large et beaucoup plus précise à la fois du " comment ça marche parmi les hommes depuis toujours ". Mon essai
sur Nomade/Sédentaire m’a fixé les idées, des idées que je tourne depuis très longtemps dans ma tête, mais cette fois d’une manière systématisée, ce qui
pourrait m’effrayer tant je récuse désormais toute théorie, mais, mais ici la théorie se veut parfaitement laïque, au sens où rien ne procède d’aucune
transcendance, autre que le transcendantal lui-même. En gros je poursuis dans la thématique de l’éternité intrinsèque de l’homme avec cette question certes
angoissante : comment défendre l’homme du passé sans renier le progrès, mais d’abord qu’est ce que le progrès ?
Pas ce qu’on pense en tout cas, il faudra sans doute s’orienter vers une idée du progrès comme jeu réussi ou mieux réussi que les précédents
mais en aucun cas d’une amélioration linéaire du destin humain. Autrement dit, le présent peut tout aussi bien échouer ! c’est ce qui est arrivé au cours
du vingtième siècle, en raison d’erreurs bien antiques. Voir la théorie de l’action de Hanah Arendt, quand elle dit qu’une action est par essence ce dont
on ne peut pas maîtriser les conséquences à long terme, c’est à dire ce qui engage terriblement la responsabilité humaine, celle du héros ! C’est bien
la maladie du présent, cette légèreté avec laquelle on se permet les erreurs, en se disant qu’il reste toujours possible de corriger !!!! L’histoire de
Tchernobyl, celle des farines animales ou des tankers fous qui empoisonnent les mers, est une histoire dont nos descendants paieront les factures très cher, et
c’est bien de notre insouciance et de notre paresse qu’il s’agit, de notre nullité à être homme. Encore une fois, je ne pardonnerai jamais à mes ancêtres
les deux guerres qui ont anéanti mille ans d’histoire, pourquoi mes enfants me pardonneraient-ils les mêmes conneries ?
Jeudi le 21 décembre 2000
Il se passe en soi des révolutions aussi étranges et aussi tragiques que la plus terrifiante des
Terreurs. " Sans doute " aussi tragiques car l’on n’a accès, en général, qu’à son caractère étrange, et surtout à cette affreuse certitude que
l’on y est pour rien. Parfois les choses se précipitent comme en ce moment avec ma nouvelle " compagne " Mara, alias Martine, alias encore un tas de
pseudonymes. Je ne sais absolument pas si " je l’aime " (curieuse expression, il est vrai..) ou non, ou encore un peu ? Je n’en sais rien du
tout, tout ce que je constate, c’est que cette femme devient ma compagne. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus profondément, chaque jour dans un
" cela va de soi " plus évident et plus certain. Je ne sais pas, mais il y a bien des choses qui me séduisent chez elle, notamment le bonheur qu’elle
irradie. Le spectacle du bonheur a quelque chose d’extrêmement jouissif, c’est sans doute la jouissance la plus égoïste qui existe, et c’est pour cela que je
m’en méfie.
Mais il n’y a pas que Mara et cette fermentation sexuelle et sentimentale, il y a tout un faisceau de comportements qui changent… tout
seuls !!!
Tenez, j’avale de la codéine depuis bientôt quatre ans, en dose de plus en plus forte, tant me font souffrir mes maux de dos, mais tant
j’apprécie aussi la douce euphorie liée à sa prise et le fait que cet alcaloïde de l’opium me donne curieusement de l’énergie pour agir au lieu de m’endormir.
Je ne pensais jamais cesser de consommer ce succédané de la morphine, tant je m’habituais à un corps douloureux. Et puis récemment le médicament miracle nous
est arrivé d’outre-Atlantique, un antalgique anti-inflammatoire qui n’attaque pas le système digestif ! Du coup les douleurs, un peu toutes celles qui sont liées à une inflammation (origine certaine des cancers), disparaissent.
J’ai donc arrêté la codéine, sans problème, avec de nouveau ce sentiment que j’avais éprouvé le jour où je m’étais arrêté de fumer, c’est à dire de toute
puissance volitive qui m’effraie toujours. Ce fut mon prétexte pour reprendre la consommation de nicotine, on va voir s’il en ira de même avec cette drogue,
après tout ça me tranquilliserait. Je ne m’aime pas en héros de la volonté. Mais d’un autre côté je préfère aussi économiser mes extases d’origine toxiques pour
plus tard !
Curieuse peinture de la volonté ! J’ai déjà remarqué combien nos volitions suivent une sorte d’impératif collectif, ou commun, ou
encore sociétal ( ?). C’est à dire que notre volonté personnelle se modèle plus facilement sur un comportement normal, normé par le comportement général,
elle y trouve comme une sorte de paix dans son désarroi de la liberté. Car la liberté est d’abord un désarroi, secret de la position nomade et de la fatigue
ontologique de la race humaine ! Faire comme tout le monde rassure, banalité qui explique hélas beaucoup de choses insensées comme les religions ou
encore les modes.
Mercredi, le 31 janvier 2001
Je découvre un peu mieux le Paul Valéry dans ses Cahiers. Etrange homme, homme éminemment français, il
condense assez parfaitement ce qu’on a coutume de nommer hâtivement le cartésianisme. Une même rigueur glaciale dans les inférences logiques, une même
perplexité devant la fuite des fondements. Très proche de Nietzche aussi, trop peut-être, car cela l’empêche finalement de dire des choses intéressantes sur
les hommes et sur l’histoire qu’il se contente naïvement de haïr. Nietzsche – Valéry, voilà un rapprochement franco-allemand intéressant, d’autant que Valéry
s’est " impliqué " dans la problématique politique du franco-allemand. Lointaines accointances entre Francs et Gaulois ? Il est remarquable
combien il déteste Louis, celui qui a coupé les têtes de la Noblesse (d’origine franque !..). C’est d’autant plus curieux que Valéry provient d’un pays de
langue d’Oc où le Visigoth n’appréciait guère le barbare franc. En fait Valéry est un aristocrate de Gaule ancienne, celle qui avait quelques longueurs
d’avance sur le système sédentaire romain. D’où cette contradiction curieuse, d’un côté il condamne celui qui réinvente massivement la sédentarité contre les
nomades francs, Louis, alors que son sens de l’aristocratisme devrait le préserver de cette barbarie. Il y a peut-être là-dedans une des composantes
contradictoires de la France : les Français adorent leur lopin de terre, mais n’ont de cesse de trouver un prétexte pour filer à l’autre bout du monde.
Vendredi, le 2 février 2001
Ah oui ! la crevaison ! Figurez-vous que l’idée cocasse d’une crevaison de l’être m’est
passée par la tête ! Pouvez-vous imaginer cela ? L’histoire de l’homme ne serait rien d’autre que : soit les effets de l’air qui sort de l’être
qui se dégonfle, soit les efforts frénétiques de l’être pour coller une rustine avec l’aide (ou contre l’hostilité) de l’Homme ! L’homme étant une part de
l’essence de l’être qui se serait échappé par la crevaison …. C’est rigolo tout plein ! cela expliquerai tellement bien les tourbillons entre Etre et
Non-Etre et tout le reste, jusque et y compris les théories astrophysiques sur la dilatation ou la rétractation de l’univers ! Hihihi
C’est pas sérieux, mais c’est tellement marrant !
mercredi 28 février 2001
Le cœur n’y serait-il plus ? Ecrire serait-il devenu si difficile ? Pas vraiment, mais ma
mésaventure avec mon dernier manuscrit Atopie me décourage presque définitivement de m’exprimer par l’écriture. ILS ne comprennent pas, rien.
samedi 17 mars 2001
Entropie. Je me sens entraîné dans un mouvement incontrôlable de désagrégation des choses, au sens de Heidegger.
Mon corps d’abord, dont je perçois de plus en plus mal le sens, autre que de me fournir de la douleur. L’esprit, dont je ne puis rien dire en dehors de sa
manifestation dans mon écriture, une manifestation qui se raréfie, dont le désir tarit ? Pourtant je lis beaucoup, honnêtement. Valéry d’abord dont je
redécouvre la prodigieuse intelligence, malaise et enthousiasme. Je me suis toujours demandé quelle relation il peut y avoir encore ce Français classique et
le penseur de la Forêt-Noire, Heidegger. Et l’autre jour je trouve cette citation : (Pléiades, Cahiers, II) sous le titre de " Conscience " : " Comme si, par une segmentation
automatique, l’être devait, à chaque instant, couper ce qui fut, définir son reste, revenir à l’état de capable d’inconnu, éliminer ce qui risque de faire
mod(ification) permanente, reconstituer sa sensibilité potentielle - - - c’est à dire refaire du présent. " (italiques dans le texte).
L’être qui " refait du présent " ! Pas mal comme expression de la réalité.
dimanche 18 mars 2001
Insondable cette phrase !
Lundi 19 mars 01
J’y reviendrai. Ce matin j’ai envie de régler un compte, avec ATTAC. Vous savez, ces gentils organisateurs de la
Révolution Tobin ! Je suis un peu méchant, mais de temps en temps on n’a pas le choix. Voici de gentils intellectuels qui s’occupent activement de toutes
les misères du monde : travail des enfants au Bengladesh, Sida en Afrique, escadrons de la mort au Brésil, Chiapas, Généraux birmans et coetera… Leur arme
principale c’est la revendication de la fameuse Taxe Tobin, du nom d’un quidam US qui a lancé l’idée de taxer la spéculation monétaire, quelque chose comme O,
OO1 et quelque % pour chaque dollar échangé contre une autre monnaie, dans le monde ENTIER ! On voit déjà l’irréalisme de la chose lorsqu’on constate
qu’il n’existe aucun pouvoir mondial capable de planifier et de faire appliquer une telle taxe. Mais la véritable raison qui dévoile toute l’inanité de cette
chose, c’est qu’elle ne vise rien moins qu’à conforter cette spéculation sous prétexte de la " moraliser ", voire d’en compromettre l’efficacité
financière. On ne rit pas ! Bref, il est inutile d’en rajouter sur la critique de ces belles âmes qui me font penser aux Dames des Bonnes Œuvres.
ALORS qu’à leur porte, à deux pas de chez eux, ces penseurs de la révolution n’ont qu’à observer la mine grise de leurs concitoyens, écouter
les conversations de bar et contempler les foules blafardes qui coulent dans les couloirs de la mort lente du quotidien. Jamais, au grand jamais l’humanité ne s’est trouvé dans un tel état, un tel degré de déchéance, le seul exemple ne
concernait que les Juifs sous la botte nazie. Combien de femmes et d’hommes se lèvent le matin, se considèrent dans leur miroir avec un lamentable sourire de
pitié, une complicité à peine manifestée qu’elle est déjà vieille et usée, vide : on ne se fait plus confiance, on est un CON. Tout ce qu’on fait à
partir du moment où la machine à réveiller les cons a fait son œuvre, tout ça fait dégueuler. Se regarder dans le miroir, se savonner la tronche pour y passer
le rasoir, se refaire le pli dans les cheveux qui se sont crus libres pendant quelques heures, retirer délicatement son futal du cintre, vite le remonter sur
son slip troué en priant qu’il ne vous arrive rien dans la journée (pour qu’on ne soit pas obligé de vous le retirer), s’asseoir en soufflant pour la première
fois de cette journée à peine commencée en vidant votre tasse de café. Elle vous consolera pendant les minutes qu’il faut pour vous arracher à votre domicile et
rejoindre les locaux de votre peine perpétuelle. Et tout le reste est à l’avenant. Allez, assez d’hypocrisie et de jésuiterie ! La misère est ici,
dans notre vie, dans notre existence, si on peut encore appeler cela ainsi, tant le mot a été anobli au cours de ce dernier siècle, sans aucune raison
d’ailleurs, sinon l’intuition que s’en était fini d’ " exister ".
mercredi 21 mars 2001
Faut-il développer,
encore ? C’est sûr. On pourrait faire deux cartes : la première serait la photographie fidèle des positions des individus dans la structure sociale, la
deuxième serait celle de leurs désirs par rapport à ces positions. Superposées, ces deux cartes devraient, dans le meilleur des cas, se recouvrir et donc former
une sorte de passoire, et dans le pire des cas former une surface compacte, les désirs demeurant résolument à côté de leurs buts. Qu’en est-il en réalité ?
En réalité les économistes raisonnent différemment. Ils utilisent un concept-clé pour légitimer le fait que la superposition ne se fait pratiquement pas :
celui du besoin. En ajoutant le besoin au désir, on arrive peu ou prou au " tissu " dont on se vante tant, le tissu social. Mais toute la
question est de savoir ce que vaut la catégorie du besoin par rapport à celle du désir. Quoi qu’il en soit, une conséquence émerge de cette réflexion, c’est que,
selon les analyses des économistes, et donc aussi des politiques, une grande partie des individus agissent quotidiennement en fonction du besoin et ainsi
sont contraints de faire l’impasse plus ou moins radicalement sur leurs désirs. Demandez à 100 salariés qui se lèvent le matin pour aller à leur travail s’ils
sont contents de le faire, vous obtiendrez, dans des conditions idéales de sincérité, une réponse négative dans la grande majorité des cas. Le désir de la
majorité sera de ne pas se lever de son lit, de ne pas procéder au rituel de préparation des apparences vestimentaires, de ne pas prendre les transports en
commun ou l’automobile pour se rendre au travail, de ne pas arriver dans les bureaux ou les ateliers où ils sont attendus par un encadrement, etc… etc… Le
phénomène le plus intéressant est que même ceux pour qui le métier peut passer pour une sorte de passion rechignent à y courir dès l’aube. Non pas par ce que
l’idéologie passéiste héritée du Christianisme nomme la paresse naturelle de l’homme, mais bien parce quelque chose cloche.
Quelle est cette chose qui cloche ? Pour en prendre
conscience, il suffit d’interroger les exceptions à cette règle, car il en
existe. De plusieurs sortes. Les plus courants sont ceux qui exercent un pouvoir
ou une responsabilité réelle et non déléguée, les décideurs : les décideurs
sont en vérité des joueurs. Leur enthousiasme pour leur " métier "
n’est pas un mystère, leur bureau ou leur atelier ressemble à une sorte de
casino où le temps passe dans la frénésie des gains et des pertes. Pas étonnant
qu’ils y courent comme les boursiers courent Place de la Madeleine. Tous les
autres, si l’on néglige les délinquants qui passent leur temps à faire de la
perruque, c’est à dire à voler leur entreprise, sont des sortes de névrosés qui
ont fini par identifier besoin et désir, une opération qui produit autour d’eux
l’essentiel du malaise social. Montrer qu’on aime son travail sans raison
patente provoque rien moins que la haine des autres car on ne peut y voir que la
preuve d’une hypocrisie ambitieuse et égoïste. Mais, comme chacun sait,
l’égoïsme est une catégorie économique de base. Sans lui, pas de marché magique,
pas de main divine qui régit la paix des relations. L’égoïsme est un postulat
fondamental de cette " science " qui portait hier encore son vrai
nom : économie politique, et dont l’appellation a été
" blanchie " comme l’argent de la Mafia en " économie " tout
court.
Mon expérience va beaucoup plus loin, elle ne s’arrête pas à la
constatation que la reprise du travail le matin est une corvée pour tous. Dans
l’action elle-même, c’est la même chose. Je prends l’exemple le plus séduisant
possible, celui d’une rédaction d’un média quelconque. J’ai observé, en tant que
cadre dirigeant, que lors de la répartition du travail, le jeu consiste avant
tout à l’évitement du travail, ou au moins à sa minorisation maximum. Chacun se
défile, quel que soit son " aura " de travailleur zélé ou talentueux.
Les plus intelligents préparent d’avance leur travail, quand ils le peuvent,
afin d’en diminuer les désagréments et les mauvaises surprises. Paresse ?
Encore une fois NON. REFUS. Refus d’obéir à une nécessité transcendante et
pressante, refus de se soumettre à une structure étrangère à son désir et à sa
volonté, malgré toute la dose de résignation engrangée déjà lors de l’enfance et
de la formation. L’homme aliéné c’est cela. C’est simple. Il ne lui reste plus
qu’à trouver toutes les formules existantes pour échapper à ce destin, le
syndicalisme, la maladie ou la fuite en avant dans l’exploit, espérant ainsi
passer dans la catégorie des décideurs, c’est à dire devenir enfin HOMME.
Vendredi 23 mars 2001
Cruel, fou. Voilà l’image que je
donne, je le soupçonnais depuis quelques temps, j’en ai reçu la preuve hier par
Martine. Elle ajoute cette belle considération actuelle et métaphysique, nous
sommes un couple de cinglés dans un vaste asile d’aliénés. Le temps passe et je
me rapproche des temps du choix. Maintenant que ma " carrière "
séculière est passée, je sors du monde, mais pas à la manière de Pascal ou de sa
sœur, moi, je retourne dans les paradis que j’ai connu réellement, les océans.
Dilemme : seul ou avec Mara ? Dilemme à double entrée car il se pose
pour moi ET Mara. Je lui ai expliqué hier qu’il ne me restait guère d’autre
choix que de partir, exercer enfin la seule liberté qu’il m’aura été donnée de
palper au cours de ma vie. A nouveau, d’ailleurs, je considère ce projet comme
une épreuve, un coup de pied au cul éthique comme ceux que je m’adressais dans
ma jeunesse lorsque je me trouvais dans une impasse existentielle. C’est quoi,
une impasse existentielle ? Il y a une manière simple de décrire une telle
situation, c’est lorsque ma situation générale s’est " régularisé ",
lorsque je suis pour ainsi dire devenu un moine dans cette société à mon corps
et âme défendant. Expliquons, cela pourrait éclairer aussi mon propos
d’hier.
A dix-sept ans déjà, lorsque je fréquentais encore la terminale
A du Lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, j’ai eu tout d’un coup le
sentiment, aux environs de Pâques, que ma vie s’était embourbé dans un rituel
factice et sans perspective, assez dure à vivre malgré l’anarchie des jours,
mais surtout sans objet. Il fallait que je lui donne un objet, que je ME sorte
de moi pour m’exposer à l’Autre, à l’altérité. Je suis donc parti à l’aventure
en entraînant un de mes camarades, ce qui fut l’erreur parce que les motivations
étaient loin de se recouper. Nous errâmes dans l’Allemagne en pleine
reconstruction, nous étions en 1959, et ce fut une expérience riche mais sans
lendemain. Mais j’avais compris la méthode, une sorte de auto-déguerpissement,
je sortait brutalement de moi-même et de tout ce qui me constituait. C’est dire
que j’ai fini pas sentir à quel point on se perd dans une structure
existentielle donnée, à quel point on aliène son soi dans des actions
répétitives et quotidiennes dont la plupart sont forcées, c’est à dire sans
alternative : se donner à une telle structure c’est se perdre, et cette
perte se ressent pleinement lorsque s’estompe les illusions de la mise du jeu.
Au fond, on se retrouve décavé dans une réalité étrangère, il ne reste plus qu’à
en changer. L’erreur que commettent la plupart des personnes confrontées à ce
cas, c’est de calculer leur changement avec les mêmes paramètres qu’ils avaient
déjà utilisés pour en arriver là où elles sont, ce qui ne change rien. Non, il
faut se donner librement, aveuglément à l’immensité des possibilités destinales.
Il faut laisser le destin vous prendre en charge, si vous voulez découvrir
l’Autre, je dirais découvrir DE l’autre. Cette pratique a fini par me convaincre
de l’impossibilité structurelle de la position sédentaire et explique la
théorisation que j’en ai faite dans Atopie. Je précise en passant que cette
théorisation n’est qu’une ébauche, une sorte d’éditorial qui demande une
élaboration (un perlaboration puisque je compte bien unir l’action à la
réflexion) dans le détail. Je rappelle seulement rapidement l’essentiel des
principes qui guident ma pensée : l’Autre ne se rencontre qu’à travers la
liberté, sans liberté, point d’altérité, et c’est ce qui me paraît constituer le
principal point d’achoppement de la pensée de Lévinas. Cet adversaire
d’Heidegger plante un décor qui pour être réel n’en est pas moins impuissant à
rendre compte de ce qu’il veut lui-même démontrer. La rencontre d’Autrui dans la
dépendance réciproque et dans l’inégalité ontologique rend cette rencontre
impossible, ou, empêche simplement la relation. L’enjeu de la rencontre d’autrui
c’est la nature du terrain, comme à la guerre. Si le terrain est libre, les
consciences peuvent se rencontrer, sinon elle restent cantonnées ou murées dans
leur ipséité. C’est pourquoi la seule finalité théorique et pratique s’appelle
liberté. Mon destin m’apprend justement qu’à défaut de cette liberté, il me
devient difficile et douloureux de " piloter " mes relations à Autrui,
il ne me reste donc qu’à faire le vide autour de moi en attendant des jours
meilleurs, le destin classique des anachorètes.
Retour à Lévinas. En fait, il raisonne à partir d’une
eschatologie judéo-chrétienne. Il " éternise ", ce faisant, les
données présentes à toute rencontre. Autrement dit les rapports à Autrui ne
peuvent jamais changer, c’est à dire le cadre de cette rencontre reste fixe dans
le temps (l’équivalent de la Loi divine). Aucun gain de liberté ne peut donc se
concevoir, aucune dynamique évolutive (ou révolutive) ne peut venir modifier
l’inégalité constitutive de la relation. L’Homme est ainsi figé devant l’abîme
qui le sépare de l’Autre, sans espoir de partage. Par suite, chacun est
contraint de se placer dans une position infiniment petite par rapport à
l’Autre, s’il veut imaginer une chance de laisser un espace à l’événement
(avènement) de la relation. Or l’autre se trouve confronté au même dilemme, les
deux restent condamnés par les deux mêmes " moins infinis " de l’être,
et donc au silence.
C’est un malentendu très ancien et qui bloque depuis toujours
aussi bien la conception de la société que celle du contenu des relations
humaines. Pour mieux comprendre ce qui paraît un peu alambiqué, il suffit
d’imaginer l’impératif suivant : la liberté est le seul milieu qui laisse
passer la relation, et par ailleurs toute relation n’est relation que si elle
porte sur la question de l’être. Ces sortes d’axiomes ont pour corollaire
notamment le fait que les religions interdisent toute relation humaine
puisqu’elles court-circuitent radicalement la question de l’être en s’emparant
de sa notion. C’est la raison pour laquelle les religions ne peuvent dépasser la
catégorie de la charité (et là aussi on peut aller voir chez Lévinas, qui sous
cet aspect des choses se trouve en contradiction flagrante avec le Judaïsme) et
sont impuissantes et allergiques à la notion de solidarité. La République n’est
rien d’autre que la construction des relations humaines, rendues possibles par
la laïcité. Lacan disait qu’il n’existait pas de relation sexuelles, il avait
parfaitement raison, la sexualité n’est pas une relation, c’est une emprise
réciproque ou non. Elle peut faire l’impasse sur les inégalités et sur l’absence
de liberté parce que la question qui préoccupe les impétrants leur échappe, la
procréation, la descendance. C’est pourquoi les enfants illégitimes ont toujours
eu une chance de pouvoir se faire reconnaître dans les pires conditions. La
sexualité est le royaume du caprice.
Dimanche 25 mars 2001
Phylogénèse = ontogénèse. C'est
une banalité qu'on n'a pourtant pas assez étudiée. Mon idée est la suivante :
dans la vie de chacun se déroule toute l'histoire humaine elle-même. D'intuition
la chose paraît absurde, mais considérée comme se déroulant sur plusieurs
paliers ontologiques, la chose est possible. L'éternel retour pourrait ainsi
trouver une nouvelle interprétation assez simple. L'homme joue et rejoue
éternellement la même histoire, non pas dans un temps linéaire progressif et
cumulatif, mais son destin représente le cercle entier de l'histoire dite
"passée". Dans mon esprit, l'idée se systématise d'une logique ludique du temps.
Pour faire court, les règles générales sont perpétuellement données dans une
rationalité matérielle dont les formes se meuvent selon la justesse du rythme
des allers et venus au centre du cercle (épistémologique).
Plus simple : la vie de chacun est phasée, néologisme d'énarque
mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Les phases sont à la fois
prédéterminées et à la fois aléatoires (problème de dieu et de la liberté), mais
elles se déroulent quoi qu'il arrive.
mardi 27 mars 2001
Entièrement responsable. Avez-vous
déjà eu cette illumination sur vous-mêmes ? Nous sommes entièrement
responsables de tout ce qui nous arrive, du bien, du mal, des plaisirs comme des
souffrances. Il n’y a pas de raison pour cela de " se haïr " comme le
pensait Pascal, mais seulement de reconsidérer tous ces raisonnements causaux
( ?) ou à caractère transcendant. Cessons d’accuser les autres, la société,
l’histoire, le hasard, dieu ou nos faiblesses, cessons de nous gargariser avec
nos chances, nos talents et notre " volonté ". Volonté, hi hi
hi ! Pourquoi pas, la volonté, mais alors d’une manière toute nouvelle,
celle qui consiste à assumer ce qui sort de soi, ce qui semble se décider de
soi. Le jeu ne se déroule donc pas seulement entre moi et le monde, mais d’abord
entre moi et moi. Cette considération pourrait d’ailleurs faire suite à ce que
j’écrivais hier sur l’assomption individuelle de toute l’histoire par une sorte
de répétition : nous répétons l’histoire selon la science que nous en
avons, science qui comprend évidemment l’instinct et tout ce qui échappe à la
raison classificatrice et causale.
Historiquement le discours général indique que le temps de la
conscience de cette responsabilité personnelle est venu. Toutes les formes de
libéralisme ne disent rien d’autre que cela : prend conscience de ton être
de marionnette afin de devenir au minimum ta propre marionnette.
Etre responsable, c’est d’abord accepter ou refuser. C’est
d’abord considérer que tout, TOUT, se choisit, que la conscience a toujours une
longueur d’avance (voir Valéry) sur tout ce qui vous arrive, tout ce qui vient à
votre rencontre. Si on est obligé d’invoquer le rôle de l’inconscient, c’est que
cette évidence n’est pas assumée historiquement, car l’avantage de la conscience
sur l’inconscient c’est précisément ce recul qu’elle possède toujours, quoi
qu’il arrive, sur le fait ; ce recul ou cette avance, comme on veut.
Autrement dit, l’importance ne doit pas porter sur l’actualisation d’un acte
(manqué ou pas), mais sur le commentaire qui en est fait avant ou après. Autre
avantage de la conscience, c’est le pouvoir de juger de la conformité avec
l’histoire, avec le connu : la culture, la vraie, c’est cela, se connaître
dans le flux du temps, dans le flux cyclique ou pas, peu importe, il marque une
continuité de la volonté générale, c’est à dire de la péréquation des volontés
individuelles dans laquelle on est contraint de jouer. Il faut s’y connaître ou
périr. C’est l’honneur qui en dépend. L’honneur. La valeur la plus précieuse et
la moins présente dans le discours présent, pourquoi ? On peut dire que la
technique a tué l’honneur, on peut. Quel disposition de conscience peut tenir
devant un tir groupé de canons de 150 ? D’une bombe atomique tombée du
ciel ? Le seul a répondre que l’honneur peut survivre dans le pire des
enfers, c’est Ernst Jünger, le fou sorti miraculé des enfers de 14-18. Son idée
est symbolique de la conscience d’une tragédie de l’honneur. Et son raisonnement
se tient : derrière la technique il y a une volonté qu’il faut assumer,
quelle que soient les structures causales matérielles (politiques, économiques,
scientifiques). Cette conscience a conduit l’écrivain allemand à inventer,
malheureusement, une " figure " hélas, à caractère transcendant(ale),
la fameuse figure du Travailleur. Mais bon, cette figure, pourquoi pas ? Si
Jünger commente ses actes (et ceux de ses contemporains) de cette manière,
pourquoi pas, cela le regarde, de même que celui qui dira qu’Hiroshima a été la
volonté divine… A condition, toujours, d’être capable d’impliquer sa propre
responsabilité dans le jeu qui se déroule dans son présent. Bien sûr, le
problème pour un croyant, et c’est la raison pour laquelle nous avons écrit
" malheureusement ", c’est qu’il semble que sa conscience manque une
marche. Elle bute sur une préséance de la Foi, la même qui fonde la fausse
préséance du cœur sur l’esprit, selon les classiques. Pourquoi fausse ?
Fausse parce qu’elle impliquerait une absence du cœur dans la conscience, une
autonomie du cœur qui n’a aucun sens : le cœur devient lui-même une
transcendance intérieure à l’homme. Le cœur n’est pas l’apanage d’un
raisonnement théologique ou humaniste, il est, si on tient à se servir de ce
mot, la dynamique de la conscience. Avoir du cœur, signifie d’abord avoir du
sang-froid, être en mesure d’affronter toute réalité, autrement dit avoir une
conscience forte et, pardonnez le terme, opérationnelle. La phrase de Valéry
commentée plus haut me paraît tout à fait coller avec tout ce que nous venons de
dire. On ne peut créer du présent qu’en assumant ses coordonnées, ce qui revient
à une prise de conscience permanente des données du jeu courant.
Il faut noter encore que cette sorte d’existentialisme, car
il s’agit bien de cela (Sartre l’a très bien vu), est lui-même une figure du jeu
historique, une martingale provisoire initiée par la métaphysique grecque et par
l’histoire de l’homme sédentaire. Le rôle de la conscience a été écrit par les
choix initiaux et par leur assomption à travers les trois derniers
millénaires : cette production de la conscience va de pair avec la
naissance de l’individu, et il faut en réalité considérer l’histoire à
l’envers : les Grands Hommes, les individualités fortes qui émergent dans
notre histoire, ne sont pas les créateurs de cette histoire mais les produits,
et c’est cela qui agace les tenants d’une histoire qui s’attache d’abord à
décrire la vie quotidienne des peuples. Donc, la conscience est le premier objet
dont la conscience a à se préoccuper, car elle articule les choix qui produisent
de l’histoire. Ira-t-elle aussi au rebut comme la Foi ? qui sait, cela n’a
pas d’importance et nous n’avons pas le choix d’en décider avant d’en avoir fini
avec ce qu’elle peut encore produire et accomplir en tant que présent. Le
présent est lui-même une figure phusique de la réalité, et il est sans doute
déjà condamné en tant que tel, il deviendra obsolescent par la force des choses,
mais il nous est totalement impossible de parler d’une telle mutation. Notre
humilité consiste principalement à le reconnaître au lieu de se permettre de
brader la conscience au profit de l’instinct ou de la Foi, ce qui n’indique
qu’une volonté de reculer ou de faire du sur-place dans le temps.
mercredi 28 mars 2001
Difficile idée que celle d’un
présent périssable ! Le présent semble être la, la quoi ?, l’idée, le
concept ? l’état ? le sentiment ? la sensation ? l’être au
plus proche ?
Ce qu’on peut dire, peut-être, c’est que le présent est notre
mode d’être au réel, et encore, il faudrait vérifier si ce mode est vraiment
universel ? Les Inuït sont-ils au monde exactement comme nous le sommes, la
présentification se fait-elle pour eux exactement comme pour nous ?
Question absurde en apparence, mais en apparence seulement. Alors comment
pourrait-on imaginer des inflexions ou des modifications de cette
présence ? A cela on peut déjà au moins répondre par la possibilité d’une
différence d’intensité du présent, c’est à dire d’intégration dans le réel.
Etant entendu, et c’est là toute la difficulté, que le présent pensé est aussi
du présent et qu’il faudra donc affecter un coefficient aux objets du présent.
Explication : si le pêcheur du Grand Nord jouit d’une relation plus
symbiotique avec les objets de sa nature, mer, glace, poissons et autres
animaux, ciel, froid etc…, cette symbiose peut s’imaginer comme assumée à un
niveau supérieur par la pensée, et donc combler la carence pratique du sens. En
fait il faut penser le présent comme une toile non homogène, comme un patchwork
fait de liens d’espèces différentes.
Il y aurait donc une histoire du présent ou de la présence,
histoire dont des formes passées (c’est à dire condamnées à disparaître de
manière rédhibitoire) subsistent à côté de la forme présente du présent. Cette
forme présente n’est, évidemment qu’une forme moyenne d’un présent qui prend
progressivement la place des autres formes, quelle que soit la légitimité de
cette mutation. Elle se produit, c’est tout. Aujourd’hui le monde entier reçoit
la météorologie par le texte, par l’écrit ou le message. Hier, la prévision du
temps était charnelle, elle appartenait aux objets immédiat du présent, comme
l’humidité aujourd’hui encore, indique aux rhumatisants que la douleur va
augmenter.
Mais tout cela n’est pas très satisfaisant, car la notion
d’intensité ne me paraît pas suffisante pour désigner une qualité décisive du
présent, elle rejoint toute la réflexion traditionnelle sur le conscient et
l’inconscient ou les degrés de la conscience, depuis Leibniz jusqu’à Lacan. Et
au fond, cette intensité variable semble plutôt consubstantielle à la
conscience, même si la différence elle-même ne s’explique pas immédiatement. Si
on écoute Roger Chambon, l’intensité maximum du présent se trouve dans la
science : l’homme n’étant que le vecteur de la perception, et la perception
étant affinée par la science, c’est dans le domaine scientifique que la présence
se joue à son maximum d’intensité. Les génies mathématiques semblent vivre de
plain pied avec le réel, dans l’intensité maximum de l’être. L’histoire du
présent serait donc celle de la science. Mais je pense qu’il faut ici souligner
que le milieu de la science c’est d’abord l’hypothèse, et en tant que telle,
l’hypothèse tend plutôt à creuser un écart entre le sujet et le présent, et même
plusieurs écarts parfois, elle place l’homme dans une position de pivot autour
duquel tournent une multiplicité de présents possibles. C’est toute l’opposition
entre la simplicité de la relation immédiate avec la nature, l’écologie
spontanée, et la complexité d’une relation médiatisée par le savoir.
jeudi 29 mars 2001
La famille socialiste de Strasbourg s’est
déchirée sous les coups des ambitions des uns et des autres. Quelles que
puissent être les raisons invoquées par JCPD, il demeure un traître. Pas
seulement à tous les membres de son parti, mais aux Strasbourgeois naïfs qui
l’ont pris pour un homme de gauche. Mon cher JCPD, un homme de Gauche ne sert
pas de passerelle à la Droite, jamais et en aucune circonstance. A l’extrême
rigueur il jette son manteau de Nessus rose aux orties, et il se proclame de
droite avant de trahir. Mais assassiner un camarade dans le plus pur style de
Tartuffe, non.
Or, cet accident électoral comporte une leçon, et une leçon
sévère : la trahison est entrée dans les mœurs politiques par la grande
porte. Car ce qui compte dans cette affaire, n’est pas que la manœuvre de
Ganelon ait réussi, c’est qu’elle l’ai fait dans l’indifférence et l’hypocrisie
générale. On a fait comme si c’était normal, et je retrouve de très bons amis
dupés par ce malin génie, et assumant la trahison sans le moindre remords. Bref,
le ciel politique est en train de changer de couleur en France, car ce genre de
coup bas n’a jamais été de mise dans notre pays, je mets au défi qui que ce soit
de m’en citer un exemple comparable hors de la parenthèse pétainiste. Non, il
s’agit bien d’un assassinat politique, un assassinat qui, je le pense très
sérieusement, s’est tramé bien ailleurs, dans quelques salon parisien, et bien
avant que JCPD ne se lance dans son aventure honteuse. Pour ceux qui ont suivi
les débuts de Catherine et ses déboires avec les concurrents du Tram, ils savent
parfaitement que l’adage selon lequel la vengeance est un plat qui se mange
froid conserve toute sa fraîcheur. Car ce lynchage est sans nulle doute un coup
de boule à trois bandes : le Tram, le Ministère de la Culture et la Mairie
de Strasbourg : le paysage médiatico – financier a bien changé depuis 1989.
Mais là n’est pas l’important. Au fond le sort de Catherine nous indiffère
quelque peu, et ses propres erreurs et errements sont aussi critiquables. Ce qui
importe en revanche, c’est le changement de régime perceptible après cette
trahison, non pas de régime politique, hi hi, mais de mœurs politiques. J’ai dit
un peu vite plus haut que de telles trahisons n’existent pas, mais bien
évidemment je ne parle pas des manœuvres hautement cyniques de certaines
personnes précisément de droite. C’est la Gauche que je voyais indemne de cette
sorte de fièvre aphteuse, dans ses pires moments, et c’est un Mulhousien qui
écrit cela, c’est à dire un citoyen qui a vu son Maire socialiste passer à
droite, un Emile Muller qui a cru devoir aussi trahir à sa manière la Gauche
d’alors. Mais l’Emile y a mis des gants, d’abord, et ensuite il a changé de
parti, mais je suis de plus convaincu qu’il l’a fait en bon tragédien conscient
qu’il fallait sauver sa ville de la ruine totale, sorte de prix à payer pour que
Peugeot accepte de venir détruire la forêt de la Hardt au bénéfice des citadins.
Bref, c’était un cas de conscience dont JCPD aura bien du mal à se revendiquer
devant le tribunal de sa propre conscience.
En général, il est bon de mépriser le traître, même si au fond
l’important n’est pas le personnage, mais le consensus civique qui s’est opéré
autour de lui et de sa trahison : les gens de bonne foi n’ont pas VU la
trahison, ils ont cru, les cons, " faire " de la politique, comme les
grands. Cette fois-ci il convient d’aller plus loin, car le geste de JCPD
n’indique pas seulement la naissance des crapules dans les rangs progressistes,
car il y a longtemps qu’on les voit venir, mais il montre la face inquiétante
des temps nouveaux, ceux qui ont fait les Catilina, Monsieur JCPD. Derrière cet
épisode presque Clochemerlesque (et celui-là ne figure pas chez Rimbaud,
croyez-moi), se cache la lessive des Empires. D’abord en Alsace même où la
tolérance des notables cléricaux avait atteint son étiage millénaire, mais
surtout au plan national où Strasbourg figurait pour la Droite parmi les
danseuses électorales intouchables comme les DOM-TOM, sans parler de cette
insolence quasi situationniste qui a vu ce patelin opérer des choix stratégiques
aux implications plusieurs fois milliardaires ! Vous pensez ! se
permettre de choisir des investissements de cette taille, alors que toute
l’économie alsacienne a depuis longtemps remisé ses ambitions dans les
vestiaires des multinationales nationales et internationales, hi hi. Oui, chers
concitoyens, on règle des comptes, on apure des factures d’une politique
néo-soixante-huitarde, et on se souvient d’une certaine tendance de la capitale
alsacienne à réagir de manière indépendante, lointaine conséquence d’un
sentiment d’ancienne capitale dont les Palais sont détruits mais les classes
sociales encore présentes, paradoxalement confites en religion, surtout la
protestante…..
Bref, tout cela n’est pas gai, car il s’agit d’une explication
de fond, dans le style – circulez, y a rien à voir -. L’Alsace de Monsieur
Pflimlin, sourire bon enfant pour une politique de fer, mais aussi la France où
les traîtres du style JCPD m’ont paru soudain proliférer. En fait, la seule
conclusion qui s’impose, c’est que la peur s’est installée dans les rangs des
politiciens de gauche. Une peur au fond naturelle puisque la Gauche reste la
Gauche, et Catherine l’a bien montré quoi qu’on en ait. Or face à la
contre-offensive de l’Empire, cette Gauche se trouve à présent devant des choix
douloureux, hic Rhodus, hic salta, ici est la Rose, ici il faut sauter. Et
Strasbourg se montre bien comme une Bérézina politique sans précédant pour le
PS, car rien ne justifiait pratiquement, le désamour des citadins du bord du
Rhin, la trahison était le seul moyen de se débarrasser de cette encombrante
Catherine. Dont acte.
La Bérézina est encore relativement loin de Waterloo, et
beaucoup d’analystes ont raison de voir dans l’incompétence flagrante des
nouveaux édiles, une garantie pour un retour rapide des socialistes place de
l’Etoile. Or, cela pourrait être faux, car entre-temps la réalité se sera joué
au plan national et européen, et Strasbourg pourrait retomber dans son statut
antérieur de ville franche, livrée pieds et poings liés aux classes désormais
complices de l’Empire. Si Lionel Jospin avait assez de feeling par rapport à
cette menace, il se hâterait de remettre notre chère Catherine en selle
politique, montrant ainsi qu’il ne s’y laissera pas prendre deux fois. Ses choix
futurs seront aussi les symptômes de sa volonté profonde, Catherine vient de
passer au rang de baromètre de la Gauche française.
Vendredi 30 mars 2001
Pris contact avec la jeune
génération philosophique allemande, Peter Sloterdijk, homme à scandale il y a
encore quelques années, paraissant ne pas répudier assez durement l’héritage de
son peuple. Première impression, on est dans le systématique et dans l’usage
abusif du " nous ", qui
n’est en rien le nous philosophique, mais est censé désigner le " on "
en général, avec cette nuance active d’un sujet indicatif et non passif. La
matrice du système n’est rien d’autre que Dynamis/Energeïa, modernisé ou plutôt
peint dans le présent. Trop tôt pour juger, mais je déteste déjà le
" nous " et surtout une expression qui attend la trentième page pour
annoncer le père : Ernst Jünger. Sloterdijk n’est peut-être que le premier
intellectuel allemand qui ai le courage d’y faire allusion et peut-être plus. En
tout cas c’est assez pénible à lire et me rappelle avec un certain malaise
l’allégresse des Situationnistes : le monde s’écroule, allons-y. Mais le
pire dans la " philosophie " qui s’annonce, c’est l’extrême naïveté du
ton apocalyptique une fois de plus. Encore un qui n’a pas compris que la crise
était l’élément de la conscience et pas un objet. On se fiche éperdument des
bouchons autoroutiers, mais alors…
Mardi 3 avril 2001
Une ruse manichéiste : Tchernobyl.
Sloterdijk esquisse une pédagogie de la catastrophe : l’homme ne peut plus
rien apprendre par lui-même et ses
disciplines scientifiques ou morales, il doit tirer son futur de ce que peut lui
enseigner la catastrophe. L’exemple - type se trouve dans le nucléaire, car lui
seul possède les dimensions suffisantes pour suggérer l’Apocalypse. Le problème
c’est que notre philosophe ne possède qu’un seul exemple pertinent, Tchernobyl.
Problème, parce que cette centrale se situe en URSS dont les tares, en 1986,
sont bien connues en Occident : bureaucratie, impérities en tout genre,
incompétence et surtout déclin des moyens de maintenance d’un tel appareil. Par
ailleurs, on sait aussi que les centrales de conceptions soviétiques sont
techniquement dépassées, elles ont été construites a minima, besoins
énergétiques obligent. Bref, Tchernobyl risque d’être un mauvais exemple pour
illustrer une thèse universelle de la nouvelle pédagogie. Mais le tropisme
écologiste allemand est plus fort, pas question d’attribuer un statut spécial à
la centrale ukrainienne, elle peut fort bien représenter l’ensemble du parc
nucléaire mondial, ce qui est simplement faux. Cette remarque apparaît a priori
sans importance par rapport à l’enjeu, mais en exténuant cet exemple, Sloterdijk
prend le risque de confondre le fantasme humain de l’irresponsabilité politique
– ce qui a été le cas de Tchernobyl – et celui de l’irresponsabilité technique
en tant que telle et ses fautes. Jusqu’à présent, je suis obligé de constater,
au contraire, que les erreurs techniques ont été relativement rares par rapport
à la quantité et à la qualité des découvertes opérées et leur exploitation
économique. Même Hiroshima, il faut avoir le courage de le dire, a été une
expérience contrôlée de bout en bout, même si les paramètres d’une telle
décision politique et humaine sont absolument inacceptables du point de vue de
la morale. Du moins d’une morale qui prévaut aujourd’hui, mais qui en 1945
reposait sur bien d’autres critères.
Prenons le prion et la maladie de la vache folle. Voici encore
un exemple qui n’est pas imputable à la science, car personne ne pourra
démontrer que la science a donné sa garantie à l’opération qui a consisté à
introduire le cannibalisme dans la race bovine. Il s’agit ici d’une bévue du
mercantilisme le plus lamentable qui rappelle exactement l’accident dans les
années cinquante de la thalidomide, ce tranquillisant qui provoquait la
naissance de monstres.
Mais ces raisonnements un peu rapides du point de vue de la
valeur des arguments matériels ont un fond lui-même fort critiquable de mon
point de vue : cette pédagogie de la catastrophe n’est pas neuve, elle
expliquerait rien moins que les révolutions coperniciennes des civilisations, je
cite : " Des civilisations alternatives naissent quand les hommes ont
un différent insurmontable avec le monde ". Cela implique des faits
d’importance capitale dont l’invention elle-même de la métaphysique !!! La
philosophie serait née d’un " différent " entre l’homme et l’étant,
l’homme et son monde ! En-dehors du caractère de lapalissade de cette
affirmation, je retiens l’idée qui se cache en contrepoint et qui voudrait que
l’homme puisse vivre en harmonie avec son monde et cependant rester conscient de
ce même monde, idée proprement idiote. Sloterdijk voudrait-il suggérer que
l’humanité a besoin de catastrophes (comme la Seconde Guerre mondiale par
exemple) pour progresser ? A
bon entendeur salut.
A vrai dire j’espérais plus d’esprit de quelqu’un qui ose
s’attaquer aux papes de la scène idéologique allemande comme Habermas. Mais
soyons patient, il faudra lire la suite avec beaucoup d’attention, car j’ai la
sinistre impression que cette " pensée " inaugure une nouvelle ère
idéologique allemande pas piquée des hannetons, comme on disait de mon
temps…
mercredi 4 avril 2001
L'horizon de mes pensées se trouve complètement
bouché ce matin. Pourtant, il est cinq heures, j'entends à côté de moi le bruit
de fond de France-Culture - il est question de la bibliothèque d'Alexandrie ? Je
croyais qu'elle avait brûlé !! Erostrate était donc aussi un mythe ? En fait je
suis très ému. Un grand personnage de ce monde m'offre son amitié. C'est
bouleversant. Sur la foi de ce texte-ci, de ce Journal qui traîne maintenant
depuis quatre ans sur Internet. Il faut dire que la version qui se trouve sur
Multimania n'a plus d'adresse E-Mail correcte depuis mon déménagement, et je ne
reçois plus de courrier depuis longtemps. J'ai bien fait de refaire un nouveau
site, merci Mara ! Le plus émouvant c'est que je parle de cet homme, qui écrit
énormément et dont j'ai lu beaucoup de choses. A vrai dire, plus d'une chose
nous relie, notamment la lecture de Jünger. Au fond cette rencontre est un
résultat logique, nous avons quelque chose en commun dans nos manières de hanter
ce monde, de lui poser des questions, de l'admirer et de nous moquer de lui. Que
disait l'autre ? " Un livre est bon lorsque le lecteur a l'impression de l'avoir
écrit lui-même ". C'est tout simplement vrai, il y a dans la lecture un mystère
de l'amitié ou de la fraternité qui se joue. Le moment n'est pas venu de dire de
qui il s'agit, tout ce que je peux dire c'est qu'il m'est déjà arrivé plusieurs
fois d'en parler, je pense qu'il ne le sait pas encore lui-même parce que mon
journal commence à peser quelque peu lourd. Il faut que j'ajoute qu'une telle
rencontre me comble de joie car elle déchire d'un coup le voile de ma solitude :
il ne se partage entre les hommes qu'une seule chose, la pensée, et quand cela
se produit, c'est le sens lui-même qui se manifeste. Quelle histoire pour une
simple reconnaissance ! Ben oui, je suis comme ça. Merci, vous.
jeudi 5 avril 2001 Sloterdijk,
encore lui et sa gynécologie-obstétrique ontologique ! Mais comment un
philosophe peut-il articuler des choses dans le genre, écoutez : « -
….naître c’est pour l’enfant humain la fin de sa vie intra-utérine ( jusque là
tout va bien) qui est probablement le seul stade de la réception dans le
monde qui a le caractère du chez-soi, c’est à dire du pays natal, à
supposer..etc… » - Non mais ? ça va pas la tête ? (sous réserve
d’une mauvaise traduction, car je lis dans la version française.. La
Mobilisation Infinie, Bourgois). QUI est reçu dans le monde à partir
d’un « pays natal », d’un « chez-soi » ?
Quel soi de quel chez-soi ?
Non mais on plaisante ici, non ? Quel pays pourrait exister pour qui n’a
même pas encore commencé d’habiter autre chose que son double. A moins d’aller
nicher quelque conscience extraterrestre dans le fœtus, je ne vois pas comment
le nouveau-né pourrait
juger des circonstances de son arrivée dans le monde. Mais
surtout s’appuyer sur un quelconque Soi ? Je suis tout à fait d’accord avec
le jeune penseur d’Outre-Rhin lorsqu’il décrit la trahison des promesses que le
monde articule à l’intention de l’enfant à peine né, et de l’enchaînement des
mensonges, mais, ce fameux soi n’est pas un objet des autres, il en est, comme
disait mon maître. Bien sûr on peut la lui faire un bon nombre d’années, mais
pas indéfiniment, non, non, non et non. Il arrive un moment où il peut basculer
dans le camp des menteurs ou bien refuser. Il n’y a pas d’excuses, Peter
Sloterdijk, et c’est là que le bât blesse, car je comprends bien qu’enfant d’un
peuple qui a poussé la logique du mensonge si loin, tu ne puisses pas facilement
admettre cette responsabilité immanente. NON, nous ne venons pas au monde comme
des visiteur d’ailleurs, nous NAISSONS avec le monde et le monde renaît
effectivement chaque fois avec nous. Notre soi contient ce monde et est contenu
par lui.
Bon, après, c’est la déréliction.
Certes, mais quelle déréliction ? Celle d’un jeune animal abandonné dans
les fourrés sans protection et sans nourriture ? Meuh non, celle d’un
homme trompé, mais trompé par des mots, par les mots du langage qu’on a été
obligé de lui apprendre pour qu’il soit à même de recevoir les mensonges,
mensonges qu’on a toujours le bon goût de faire passer pour la vérité. Et
alors ? Et alors cela signifie qu’il est devenu un soi à ce moment-là, pas
avant, et que c’est lui qui se déterminera par rapport au jeu qu’on lui offre.
lundi 9 avril 2001 Finalement la pensée de Sloterdijk peut se
résumer ainsi : l'homme s'est servi de la nature comme d'un décor pour ses
délires historiques et eschatologiques, et à force de ne voir que ses projets
(ses actions dirait Arendt), il a oublié une " fragilité
constitutive " du monde qui annonce le contraire d'un salut messianique.
Pensée écologiste et pour tout dire truisme qui court les rues. Maintenant, je
ne peux pas enfermer la pensée du jeune homme dans ce seul livre, il faudra voir
plus loin car il a de belles formulations et de brillantes intuitions. Seulement
il y a une chose qui me gênent considérablement. D'un côté il relève le
panthéisme qui s'installe dans cette période dite " postmoderne " (le
postmodernisme devant figurer surtout la fin de toute histoire, de toute mise en
scène eschatologique et la fin donc aussi de la métaphysique comme livret
dramatique autour du thème de la vérité), mais ce panthéisme semble
paradoxalement n'être qu'une posture de plus, un mouvement scénique et non la
découverte d'une profonde appartenance à la réalité, réalité toujours encore
conçue comme la réalité de Freud, c'est à dire l'Anankè, la misère et la
déréliction de l'être jeté dans le monde. Au fond tout tourne chez S autour du
motif de la naissance-chute de l'être faux et devant se tromper parce que faux
qu'est l'homme, animal inachevé etc… Au fond, il répète à sa manière ce qui se
dit de tout temps (excepté Spinoza et Heidegger), il entre totalement dans le
schéma historique, il croit à l'histoire au moins comme trame destinale qui a
conduit l'humanité au bord du gouffre, Hegel moins la bombe atomique. C'est
comme si une humanité non-historique n'était pas concevable uniquement parce
qu'il semble qu'elle ait mis la terre en danger. Encore que l'on ne qualifie pas
ce danger, on n'en soupçonne pas un sens, même pas le fait qu'il s'agit d'un
sentiment humain : et c'est là que tout pèche à mon avis, prendre le danger
comme absolu n'est rien d'autre que reprendre l'Apocalypse de St Jean et
respecter la tradition qui charge l'Homme de toute la faute de(s) (l')
histoire(s).
Que dire de tout cela ? Que dire d'un projet d'Alliance
avec la Terre (qui remplace celui d'une Alliance avec Dieu) ? Je ne sais
pas, je ne comprends même pas comment une telle chose pourrait se concevoir.
L'homme est-il seul à être seul dans le monde ? Peut-il tirer de son
sentiment des idées aussi étranges que celle qui en fait le maître du monde ou
celle qui en fait une maladie de peau de la terre ? La profonde identité de
l'homme et de sa " réalité ", son appartenance à l'être laisse-t-elle
une place à la possibilité d'un tel statut ? Et pourquoi la civilisation
est-elle encore une fois conçue comme sortie de la symbiose (de l'âge d'or).
Cette sortie n'est-elle pas qu'un simple fantasme ? Pour ma part j'ai déjà
répondu à cette question, ce n'est pas la relation de l'homme avec la nature qui
fait histoire, ni même celle de l'homme avec l'homme (ce qui revient au même),
c'est la question de l'être qui fait histoire et seulement elle. Qu'il faille
encaisser d'avance l'absence éternelle de réponse n'enlève rien à la position
absolue de la question. Cette absoluité n'est plus ressentie que par les poètes
qui reçoivent des " répons " comme le dit si bien Heidegger et les
rendent par la parole. Cela ne signifie pas qu'il faille, entre autre, nier que
les religions contiennent aussi de la poésie, et sans doute à un degré éminent,
mais cette poésie semble dériver dans tous les cas d'un affaiblissement du
questionnement de l'être, d'un émoussement de la lame véritative propice à la
socialisation et à une constante péréquation du savoir. C'est une poésie de la
compassion qui veut épargner aux masses les dangers des avant-postes, mais la
compassion est toujours louche car elle postule l'injustice.
En tout cas, cette lecture me confirme dans le sentiment que
j'ai qu'il est urgent de continuer à se détacher de tout contenu final ou
eschatologique de notre temps (je ne dis plus histoire, car plus personne ne
sait ce qu'il met sous ce mot). Tant pis pour le progrès, mais au fait, c'est
quoi le progrès ? Ne pourrait-il pas figurer comme retour
vers une posture plus homéostatique que la nôtre ? Comme libre changement
de jeu. Après tout, l'histoire passée a donné des résultats essentiels, elle a
formé les contours de l'humanité, forgé les concepts moraux qui y correspondent,
on a les moyens de passer à autre chose de plus fort et de plus audacieux que le
fonctionnement des tapis roulants !! Je veux dire par retour, non pas
l'aller vers les formes du passé, mais le cesser de se croire obligé d'aller de
l'avant, de croître chaque jour vers un ciel adulte et riche, au fond de retour
du sang-froid. Même dans les chemins qui ne mènent nulle part, il faut savoir
s'arrêter pour prendre du repos.
mardi 10 avril 2001
Olympio, éditeur en
ligne, rouvre son site aujourd'hui. J'y ai envoyé mon Atopie, mais je crois
qu'il y a malentendu. Les éditeurs aimeraient bien diversifier les genres, mais
d'après leur forum, il s'agit exclusivement de romanciers ou de nouvellistes, je
dois faire l'effet d'un importun. De la théorie, non mais ! D'ailleurs au
fond de moi-même je ressens la même chose, la théorie est sale, disons
poisseuse. Pourquoi finit-elle toujours par se former ? C'est finalement ce
que j'ai vécu : je n'ai rien recherché, la théorie du nomade s'est
progressivement imposée à moi, comme sempiternel dénominateur commun. Théoriser
c'est au fond voir passer à longueur d'événements ou de savoirs ce genre de
constante. Bien sûr la constance est en moi, au sens où c'est mon caléidoscope
qui déchiffre, c'est mon nomadisme qui défile dans les choses et les histoires.
Je porte cette théorie comme ultima ratio de mon être, d'où la tentation de
rationaliser dans l'absolu, fonder une vraie théorie de l'état nomade. Donc la
théorie est poisseuse parce qu'elle traîne toujours avec elle l'ipse d'un regard
ou d'une expérience. C'est un piège redoutable, c'est comme si j'étais un Gitan
sans le savoir, de par mon destin et celui de mes ancêtres les plus proches,
baladins de l'industrie de l'image et du commerce montant en universalité. En ce
sens je ne suis pas seul, je suis même loin d'être seul dans un monde qui bat
cette cinétique en mayonnaise depuis le siècle passé. Parfois, lorsque je songe
au destin de mon grand-père d'origine allemande, venant à Paris pour y
travailler sur la photographie (à l'époque c'était l'équivalent de
l'informatique aujourd'hui), je m'y vois tout simplement, je revis la même chose
avec sans doute une certaine naïveté pratique. Ce pauvre Gustave-Adolphe avait
encore la foi dans la République française, c'est comme si moi je pouvais
m'imaginer un lieu où ma passion aurait de la place. D'où la surprise lorsque la
guerre et la politique l'on rattrapé, viré de sa France si belle et si
supérieure à sa Germanie de ploucs. Il y avait aussi des ploucs à Paris, mon
aïeul est donc parti mourir en Suisse, le pays des apatrides où, curieuse
coïncidence, résidait déjà son frère. Il a donc refait un nouvelle fois sa vie,
dans une banlieue de Berne, mais le cœur n'y était plus. Son seul tort aura été
de cultiver une passion technique, maladie bien allemande car il était un esprit
pondéré et cultivé, il aurait pu être une source pour moi, mais il ne l'a jamais
été que comme absence. Au fond comme mon propre père, quittant la vie
volontairement alors que j'atteignais à peine l'âge de raison. Que de tapis
brutalement retirés sous mes pieds, comment trouver un équilibre à partir d'une
telle accumulation de négatif ? Au fond le siècle se retire sous mes petits
pieds d'Alsacien d'emprunt, le siècle qui vient de se clore et celui qui a
encore cours. Au fond, je ne sais rien du sédentaire, et je le sais. Je sais
aussi pourquoi j'ai toujours été attiré par les êtres qui me ressemblaient de ce
point de vue là, les réfugiés de tout acabit, dont les pieds-noirs, sous-peuple
broyé par le n'importe quoi français. Combien de Gustave-Adolphe parmi ces
millions de rescapés de la faute impérialiste. Combien de moi dans les
générations parallèles d'apatrides par destin. Il y a bel et bien deux France
face à face, celle qui s'est réfugiée au bon endroit il y a quelques siècles,
les coteaux de Bourgogne ou de Gironde, la glèbe caillouteuse du Limousin ou les
marais poitevins, et puis la France romanichelle qui en est toujours au début de
son installation, qui ne peut penser ni paix ni repos, qui prend l'avantage
grâce à sa familiarité avec la vitesse, son habileté à se recomposer vite et
efficacement.
D'autant plus violent sont les effets des rares incursions dans
les moments de paix réelles. Ainsi ma petite enfance, en pleine guerre, à
l'écart de la non-réalité de la guerre, là-bas dans le vignoble des Alsaciens.
Souvent je me dis que c'est là que c'est enraciné toute ma capacité à vivre,
plutôt accumulé en moi l'énergie qui m'a permis de rebondir. Qu'en penser ?
Tout ce que j'essaie de penser justement, toute la mathématique des postures
humaines, même s'il est difficile de rester honnête. Pourquoi postuler une
essence nomade plutôt que son contraire ? Je pourrais m'en tirer par une
pirouette en disant que mouvement et repos sont le même, mais alors pourquoi
hypostasier le mouvement ? Et le dénuement qui va de pair, mépris pour
l'acquis, le propre, la propriété, l'attribut mobile, même dans l'esprit… J'y ai
souvent senti, comme pour les Pieds-Noirs, une sorte de barbarie, celle que
revendique Camus dans l'homme révolté, pas par hasard. Réponse dans
Michaux , le voyageur immobile ? Même dans Jules Verne, l'homme qui a
contenu l'âme des Français dans les limites du rêve. Mais pour quel
résultat ? La guerre ? Ils sont partis au centre du monde, ils ont
atterris dans les tranchées.
Je dis violent : l'immobilité violente de mon enfance,
cela qui me bouleverse encore aujourd'hui, met mon âme en état de fibrillation,
la nanti d'un nez, d'une peau, de papilles et de ces couleurs que j'aperçois
parfois lorsque mon regard s'évade, distrait, vers le rien. Oui, il y avait un
projet fantastique dans le sédentaire, une source d'immenses richesses, mais
c'est dans les grottes du Kilimandjaro que les hommes sont finalement partis
chercher le trésor de Salomon. L'or du ciel ne leur a jamais suffi.
jeudi 12 avril 2001
Milieu de la nuit, je suis réveillé par le bruit des jeux vidéo
de mon fils. Bouh. Or en me réveillant j'ai fait un songe très court, une sorte
d'épisode à moitié onirique qui me lâche une de ces grosses vérités sur
moi-même. Là d'abord je rougis de honte. Elle s'appelle X et a été une sorte
d'élève pour moi, partie de presque rien, elle est devenue quelque chose comme
Grand Reporter, ce qui n'est pas mal pour son âge et j'avoue qu'elle a fait les
efforts qu'il fallait pour y arriver, les études, le travail sur le terrain et
tout. Je l'ai soutenue de bout en bout par simple justice et non pas du tout
pour ce qu'on pourrait penser. Elle représentait pour moi une partie essentielle
de mon travail de journaliste, qui était de transmettre aux jeunes ma culture
dans tous les domaines. En réalité, je l'ai formée à des niveaux très profonds,
tant du point de vue politique que philosophique et historique. Ce que je n'ai
pas vu tout de suite, c'est qu'elle avait fini par se moquer de moi et sans
doute aussi me trahir. Une rédaction de télévision c'est un vrai Kriegspiel. La
honte provient donc de l'effet direct de la découverte de l'étendue du désastre
humain que représente pour moi un tel comportement. J'ai été complètement
aveuglé par l'hypocrisie de cette femme. Oh je m'étais rendu compte de quelque
chose l'une ou l'autre fois, lorsque ses blagues sur ma vieillesse étaient
devenues un peu trop voyantes, car nous avions des relations très drôles et très
libres, sans qu'il n'y eût jamais la moindre relation sexuelle. Sans doute une
erreur de ma part, mais je n'ai jamais pu m'y faire, c'est à dire exploiter
sexuellement ma position hiérarchique. Je dois dire que je n'en avais guère
envie et le regrette un peu, car lorsqu'on demeure résolument en-dehors des
intrigues sexuelles et sentimentales, on s'isole radicalement d'un groupe : on
n'a guère le choix dans les sociétés, il faut se " mouiller " hi hi. Résultat,
la trahison. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, et je le savais depuis
assez longtemps, ce qui m'arrive cette nuit, c'est donc une sorte de vertige
devant l'ampleur de cette espèce de tromperie, et l'ampleur aussi de ma naïveté.
Pan sur mon bec de mec futé. Il faut arriver à penser l'autre salaud, cher
Lévinas, pas seulement le contraire. Oh ce n'est pas une nouveauté pour moi,
je suis un vrai con dans la vie, mais cette connerie m'a souvent sauvé la vie,
désorienté l'adversaire à tel point que cela me laissait le temps de me
soustraire à son emprise. Par simple intuition, par instinct ? Tout est dans la
nature… Je vais donc aller me recoucher sur ces considérations autocritiques. Le
pire, c'est que X me fait pitié. Apparaître ainsi dans ma conscience c'est
moche, ne plus m'avoir à ses côtés, c'est encore plus moche. C'est un châtiment
suffisant. Quel culot quand-même ! Serait-ce une petite vengeance ? Non.
Vendredi 13 avril 2001 Seuls
quelques vieux politologues de la vieille école savent que les pays, les régions
du monde et chaque continent ont chacun leur maladie, leur particularité
pathologique ou irrationnelle. Dans le temps on avait mémoire des époques de
crise provoquées de manière récurrente par le mal. Ainsi chez les Chinois, le
mal pourrait s'appeler la mélancolie solitaire, ou, en termes modernes,
isolationnisme chronique. En fait, ils n'ont jamais compris qu'il pouvait
exister quelqu'un d'autre dans la réalité de l'univers. Ou plutôt, car il faut
parler avec précision, ils n'ont jamais pensé que CE qui existait en-dehors des
limites de l'Empire puisse compter, nous dirions appartenir à l'être. Et de fait
les anciens empereurs se battaient contre les barbares des frontières comme on
chasse les mouches, avec une détermination toute relative car ces
extraterrestres ne pouvaient pas réellement nuire à l'Empire, pensait-on. De
temps en temps il fallait bien constater qu'ils savaient exister, surtout
lorsqu'ils s'emparaient du Palais et de l' Empereur lui-même. L'incident de
l'avion espion américain me fait penser à ces situations, où la Chine montre
tout à coup les dents, prend des décisions xénophobes parfois incroyables,
allant jusqu'à supprimer d'un coup d'un seul toutes les relations économiques
avec l'étranger. C'est un avertissement assez stupide en soi ( c'est comme pour
les mouches ) car l'heure n'est pas venue des grandes décisions, mais le
gouvernement de Pékin a-t-il vraiment le choix ou est-il victime du symptôme
classique de rejet ? Entendons-nous bien, je ne prétends pas connaître la vérité
sur l'incident lui-même, certains diront que c'est Bush qui est allé tirer la
barbichette de Yang. Mais cela n'a pas d'importance, car c'est la réaction des
Chinois qui compte. Finalement ils ont marqué le coup durement alors que,
sachant que l'heure n'était pas venu de s'en prendre à Washington, ils auraient
pu écraser le coup, comme on dit. C'est que la maladie des nations est toujours
plus fortes que les calculs à courts termes. Ainsi que peut-il advenir des
relations économiques du monde avec l'Empire du Milieu ? Depuis des décennies le
monde entier se penche sur ce vaste marché aux miracles, et aucun miracle ne se
produit. Le pays lui-même ne s'est jamais ouvert aux économies étrangères
autrement qu'en créant des "zones à l'instar de l'étranger", des zones franches
qu'on peut supprimer d'un trait de plume à la moindre alerte. En tout cas, cette
affaire plus celle de Taïwan devrait cette fois indiquer clairement les
intentions "éternelles" de la Chine, donner le diagnostic final sur cet immense
marché aux illusions. J'ai toujours pensé que ce marché restera un miroir aux
alouettes, juste bon à nourrir des spéculations fructueuses pour quelques uns et
néfastes pour tout le monde. La logique linéaire du développement indéfini va
connaître quelques mécomptes.
On peut analyser encore plus finement mais on arrivera toujours
à cette conclusion, que la Chine est impuissante à s'ouvrir délibérément au
monde. En revanche sa bonne santé sociologique réside toute entière dans sa
répugnance à conquérir, à sortir de ses frontières lumineuses, et cela qu'on
soit communiste ou pas (rappelons que les Chinois sont les seuls êtres humains à
avoir expérimenté le vrai communisme il y a environ deux mille ans, avec un
succès comparable à celui des Russes, justement à cause de leur maladie
génétique, comme quoi le communisme va bien avec l'universalité, Staline refais
tes calculs, ta NEP c'était nul).
La conquête du Tibet au dix-septième siècle (je crois) n'est
que le résultat d'une impatience finale à l'égard des barbares qui descendaient
les pentes de l'Himalaya pour piller la Chine.
Les maladies nationales n'ont cure des régimes, on peut le voir
dans la Grèce antique qui souffrait et en est morte, de la maladie inverse,
l'intranquillité du centre. Les Grecs ne sont jamais parvenus à se mettre
d'accord sur un fond unique de leur espace politique et donc sur un centre et
une capitale. En fait sur les fondements d'un espace stable où pouvait
s'inscrire leur désir de sédentarité : éternelle ambivalence des peuples
commerçants. L'échec grec montre d'ailleurs l'hétérogénéité des caractères liés
aux territoires. Le Péloponnèse est une Chine en réduction, alors qu'Athènes
aurait plutôt souffert d'une trop grande volonté d'expansion.
Vous allez me demander, quelle est la maladie de la France ? On
aurait déjà pu poser la question lors de la conquête romaine, car les choses
n'ont guère changé : la France est la nation la plus saine du monde, elle
souffre d'absence de maladies et jouit du meilleur équilibre physiologique qui
puisse exister, hormis la Suisse qui puise son éternité dans l'assomption de ses
diversités, modèle pour l'avenir de toutes les autres nations. Si Vercingétorix
a été vaincu, je pense que c'est plutôt parce que le modèle qui arrivait de Rome
ne faisait au fond que conforter les voeux les plus profonds des Gaulois,
organiser leur immobilité ancestrale, bien plus ancienne que celle de l'Italie.
Cette profonde bonne santé ne laisse personne indifférent, surtout pas les
nations remuantes et qui n'ont pas encore trouvé leur propre équilibre,
l'Amérique en est le meilleur exemple, qui tente d'exporter son trouble
permanent, son millénarisme débile qui provoque partout la panique. Mais j'ai
bien dit, la France souffre d'absence de maladie, elle ne peut nulle
part, de part son culte de la Raison, se laisser aller à des symptômes
irrationnels sans que l'Esprit français ne prenne le dessus. Pas de défoulement
possible, une trop grande discipline dissimulée sous un masque rigolard, voilà
ce qu'on pourrait finalement diagnostiquer comme névrose de l'Hexagone, et ce
n'est pas forcément drôle pour les Français. samedi 14 avril 2001 Pour mémoire : il semble y
avoir une grande disproportion entre l'incident de l'avion US et ma remarque sur
les nations. Pourtant l'important n'est pas dans la grandeur de l'événement,
mais dans ce qu'il révèle de l'état des relations réelles entre Occident et
E-Orient. Lorsqu'on constate ce qui se passe dans une telle situation, on est
certain que rien n'a changé et que l'on se trouve toujours dans l'ancienne
politique, l'antique Realpolitik, celle de la guerre. Dans ce cas il est
remarquable que cela provienne d'un côté des Chinois, dont on croit qu'ils
rêvent d'en découdre à propos de Taïwan, mais aussi de beaucoup plus, et de
l'autre côté du seul adversaire auquel conviendrait finalement un tel projet,
Monsieur Bush Junior, qui rêve sans doute d'imiter son père et qui devra cette
fois se contenter d'avoir donné l'impression de fermeté. L'incident lui-même
révèle que les deux nations marchent et volent sur un pied de guerre, si je puis
dire, leur réactions disent que c'est vrai et qu'il s'agit bien de guerre et
d'intentions de guerre. On me dira, oui mais dans chaque camp il y a ceux qui
cherchent à envenimer les relations et les autres. Justement : ce sont les
premiers qui font, à chaque fois parler d'eux (c'était le cas lors de l'incendie
de l'Ambassade chinoise à Belgrade, qui n'a pas empêché, mais pour d'autres
raisons, le Congrès de prolonger pour un an la clause de la Nation la plus
favorisée en faveur de Pékin). Les autres, on ne les entend jamais, ce qui
signifie au moins une chose, c'est que l'opinion publique chinoise ne doit
entendre que la version dure des événements, de même que les citoyens US.
Mais ce matin je ne voulais pas écrire à nouveau là-dessus. Un
autre sujet me captive depuis mon oreiller magique, le chant des oiseaux. Les
mêmes. Ceux de mon enfance. Mulhouse en 1947. Pinsons d'une folle gaieté,
quelques pies de toujours, un rossignol déjà ? Et me vient cette impression de
perfection, de sublime sans phrase et sans appel. ILS sont de nature divine, les
oiseaux. Et nous, pas. C'est vrai que beaucoup de peuples antiques le pensaient
spontanément et ils avaient raison, ce qui est étrange, c'est que nous ayons pu
oublier cette impression, nous cacher à nous-mêmes ce miracle quotidien du chant
des oiseaux. Il faudrait encore parler de tout le reste, leur vol, leurs
couleurs et tout, mais le chant c'est, comme disait l'autre, une réalité en soi,
un autre monde parallèle à celui que nous connaissons, ou que nous croyons
connaître. Bien sûr dans cette suavité qui me parvient à travers les notes qui
perlent au milieu de ces HLM, il y a ma madeleine de Proust. Mais est-ce
tellement important ? Je ne crois pas, ou du moins ce n'est important que parce
que ce souvenir fait partie de la "fabrique du présent", c'est sans doute avec
mon bonheur d'enfant que je décore mon aujourd'hui, et seuls les enfants
entendent les oiseaux. Demain c'est Pâques, vieille phrase que je ne pensais pas
que je dusse un jour à nouveau la prononcer ou l'écrire. Mais pourquoi pas ? Il
ne faut pas se priver d'une qualité du temps sous prétexte que l'Eglise
catholique et romaine la monopolise depuis la nuit des temps. En fait, Pâques
c'est une date et rien de plus. Ce qui m'amène à cette autre intuition que j'ai
eu hier, que l'un des enjeux de l'histoire humaine était la maîtrise du temps :
faire que chaque année se ressemble, que chaque époque se rejoue le plus
pareillement possible, que les sentiments soient en quelque sorte orchestrés
subtilement selon les saisons, l'évolution des humeurs (toute une science
biologique..) et la mythologie sous-jacente. Et il ne faut pas penser que c'est
facile, car les changements qui peuvent se présenter d'une année à l'autre sont
immenses, il suffit de penser aux prisonniers de la dernière guerre qui
parvenaient toujours d'une manière ou d'une autre à célébrer leur Noël ou leurs
Pâques. Je me souviens de la mêmeté des fêtes de mon enfance. Les Chrétiens
étaient passé maîtres dans la mise en scène et ses répétitions, année après
année, siècle après siècle : voilà qui fait la force du mythe. Je me souviens
encore de mon curé qui disait -"pendant le mois de Mai, la Vierge Marie
s'arrange pour qu'il fasse beau tous les samedis"-. Et nous y croyions de tout
notre coeur, si bien que dans notre mémoire cela reste une vérité.
Les oiseaux, encore : nous avons vraiment l'air plouc à côté,
non ? Oiseaux et fêtes, oiseaux et Pâques, il y a du divin dans l'air !!! Bigre,
je dérape dans le mystique maintenant ? On ne se défait pas si facilement des
habitudes ancestrales, des empreintes profondes qui se gravent dans la chair
tendre de nos enfances. Pédophilie des âmes.
Cette idée de la maîtrise du temps me travaille l'esprit. Que
font les prêtres (toujours eux) ? Ils installent les rythmes. C'est sans doute
ce qui structure l'écriture Sainte elle-même, l'ancien et le nouveau Testament :
il faut des événements répartis dans l'année lunaire pour pouvoir répartir la
pratique festive selon un rythme correspondant à des éléments extérieurs comme
le climat et la longueur des journées. Les africains du Gabon n'aurait jamais
écrit un scénario du genre Golgotha, parce qu'il n'y a que deux saisons en
Afrique Centrale, et encore par rapport au vécu, on ne peut en distinguer qu'une
seule. C'est aussi pourquoi leurs rythmes musicaux sont bien plus simples et
plus efficaces que les nôtres. Mais que sont les rythmes, voilà qui est plus
compliqué. Dans le rythme, et donc dans les rites, il y a de la justesse, une
correspondance à une vérité, un synchronisme avec autre chose. Le calendrier
n'est donc rien d'autre que la partition du temps, ce n'est pas rien et cela
pose la question de savoir si on peut se passer d'une telle rythmique à partir
du temps linéaire que nous avons fabriqué. Le secret de l'adoption du rythme
ternaire des Africains dans toute la musique dominante du monde est peut-être
dans ce fait que le temps linéaire se substitue au climat linéaire du continent
africain, et de ce fait supprime la nécessité des rites occidentaux. Pourtant,
ces rites sont loin de disparaître en Amérique par exemple qui est déjà
totalement installée dans le temps linéaire. On peut aussi remarquer à ce propos
qu'entre les musiques occidentales et extra - occidentale, il y a plus que des
différences, il y a certaines hostilités sociologiques. La musique de "nègre"
offusquera toujours les oreilles conservatrices des deux côtés de l'Atlantique.
En fait, tout cela pue le structuralisme, encore que je ne
sache pas que les structuralistes se soient donné la peine de chercher un décor
métaphysique ou même seulement physique à leur structures. Leur déterminisme
reste culturel, mais la culture dont il est question ne reçoit pas davantage
d'explications. Ce qu'il faudrait trouver c'est une structuralisme fluide,
alimenté par tous les canaux par lesquels se manifeste la question de l'être. La
Religion est sans conteste un de ces canaux, mais dont les flux ont tenté
d'inonder la totalité du champs ontologique en s'emparant de tous les vecteurs
questionnant et posant un terme idéologique dogmatique pas plus ragoûtant que
ceux que l'on vomit aujourd'hui dans les domaines de la politique ou de
l'économie. Les Indiens de la tribu d'Ischi avaient trouvé le secret d'une telle
fluidité qui reliait la force des rivières à celles des poissons, et le temps
des saisons à celui de la vie de chacun. Cette fluidité solide, dont le rite
n'est pas exclu, n'est rien d'autre que la liberté. Rien d'étonnant à ce que ce
soient nos Chrétiens barbus qui aient mis un terme à cette réalisation du
paradis sur terre.
dimanche 15 avril
2001
Voilà les choses remises en ordre, un d minuscule pour ce
dimanche si spécial. En fait mon curé s'est planté aussi pour Pâques, sale
temps, froid, venteux et pluvieux, un vrai Pluviose, rien à voir avec la
résurrection. Dans l'HLM de Mara ils viennent d'installer un tout nouvel
ascenseur. Merveille des merveilles, on se croirait dans un immeuble quatre
étoiles de la rue Raphaël. C'est le lissage qui se met en place, l'ultime
tentative de banalisation de la misère, la misère oui, mais avec un
environnement normal. Ainsi s'apaisent momentanément les âmes perplexes, le lift
s'appelle Schindler, ce n'est pas un hasard, nous sommes tous sur sa liste.
Demain Porto Conte, beau titre ! Mercredi
2 mai 2001 La civilisation est un fait minoritaire. Ca fait deux
semaines que je rumine cette hypothèse faute de pouvoir la développer ici. Or il
est curieux de voir à quel point un tel énoncé se vérifie intuitivement à chaque
pas, une fois qu'il s'est conceptualisé. Mais que signifie " fait
minoritaire " ? On pourrait penser que la minorité du phénomène se
laisse appréhender dans le constat que la plupart des actions que l'on peut
analyser ne contiennent en dernier ressort qu'une apparence de rapport avec un
ordre civilisé. Cela peut aller de l'expérience d'un simple trajet en bus
jusqu'à l'analyse de contenu des longues heures d'ennui distillées par les
média. Globalement, comme on dit, la civilisation est absente du cœur des
actions, dans lesquelles on ne distingue plus qu'une arithmétique du besoin, du
profit, de la recherche de la satisfaction personnelle et égoïste. Mais ce n'est
pas tout à fait cela, car la civilité en tant que telle continue d'encadrer les
faits : cette arithmétique égocentrique a lieu sous les dehors du civilisé
qui en est comme le vêtement ou l'apparence extérieure. La question qui alors se
pose est de savoir quelle fonction occupe ce " dehors ", si celui-ci
n'est qu'un décor et un alibi, ou bien s'il constitue cela qui autorise en
quelque sorte le déroulement de l'action.
Bien sûr, il faudrait commencer par faire le tri entre ce qui
est action et ce qui ne l'est que par dégénérescence du concept. Aujourd'hui
action signifie pratiquement mouvement, l'action s'est identifiée à la réalité
cinétique, cause - mouvement - conséquence, dans une parfaite neutralité de
contenu. Ceci est absurde, bien entendu, l'action appartenant par essence au
geste civilisateur au même titre que la Parole. Agir n'est donc pas agiter ou
s'agiter, c'est œuvrer dans le cadre d'un projet ou d'un plan. Que cette action
soit hostile à la civilisation confirme encore le fait qu'elle dépend
essentiellement de la civilisation, qu'elle appartient à sa dialectique. Si donc
je reviens au constat de ce que j'ai appelé la minorité de la Civilisation, il
faudrait plutôt dire alors que l'action elle-même est rare, voire absente, même
celle qui tient la civilisation pour une erreur.
Mais, j'ai maintenant l'impression de digresser par rapport à
l'intuition première. Pourtant, s'il est vrai que le civilisé accompagne en
quelque sorte toutes les formes d'actions, même les plus éloignées de tout agir,
cela signifie qu'il se solidarise formellement de ce mensonge. Il en va du
civilisé comme de la politesse creuse qui encadre les relations humaines,
l'hypocrisie générale. Je pense que nous abordons là le problème du rite, et
celui de l'opposition entre forme rituelle et fond doctrinal, et cela permet
alors de comprendre l'idéologie rituélique d'un Confucius, pour qui le rite
était le fondement indépendant de toute civilisation (prise comme stabilité des
institutions). Le rite assure la stabilité, indépendamment des considération
idéologiques, il est la Civilisation. C'est justement pour éviter que l'on
confonde action et mouvement que la stabilité est prise comme critère
absolu de la civilisation : la barbares sont ceux qui ne cessent de bouger
autour de l'Empire, et ils bougent parce qu'il n'ont pas d'Empire, au sens
d'empire sur eux-mêmes. Le barbare n'a pas trouvé sa réalité, il ne possède pas
les repères de civilisation qui lui permettraient de s'arrêter pour exister sa
réalité.
Le constat que nous avons fait est donc bien de cette
sorte : dans notre temps, le mouvement prend le pouvoir. En ce sens il faut
donner raison à l'analyse de Sloterdijk, une analyse déjà largement entamée par
Jünger. Nous y reviendrons. Jeudi 3 mai
2001 La civilisation est un fait minoritaire, mais il s'impose au
majoritaire. Voilà ce qui m'a frappé et non pas toute cette méditation sur le
rite. La civilisation est tout ce qui reste toujours pour identifier l'humain.
Ce matin l'actualité c'est le livre d'un général qui confirme une fois de plus
l'utilisation de la torture pendant la guerre d'Algérie : tout le monde
était au courant. J'aurais tendance à prendre avec des pincettes les motivations
de ce général, j'ai du mal à croire à quelque forme de repentance que ce soit,
d'autant que si j'ai bien compris, il s'agit une fois de plus d'incriminer les
décideurs, les autorités, François Mitterrand (une fois de plus), sans aller
plus loin, sans se demander si la responsabilité n'est pas beaucoup plus large,
beaucoup plus étendue dans la population de la France des années cinquante. Moi,
je savais, et pourtant je n'étais pas, dans ces années là, politiquement engagé
d'une manière ou d'une autre. Je savais qu'on torturait en Algérie parce que ça
se savait partout, dans les cours de lycée, dans les familles où on se passait
des photographies parfaitement horribles en écoutant les anecdotes des appelés
en permission, on s'en gargarisait sans trop de pudeur. Et c'est à ça qu'il
fallait résister. Le jour où j'ai déserté, j'ai réuni mon peloton d'élèves
gradés et je leur ai annoncé ma décision en précisant les raisons de mon geste.
Aucun d'entre eux n'a eu même l'idée de contester mes déclarations sur les DOP,
les unités chargées du sale boulot, ce qu'ils n'arrivaient pas à concevoir,
c'est qu'on puisse aller jusqu'à la désertion pour un tel motif, et d'ailleurs
ils n'y ont cru que quelques jours plus tard, lorsque ma désertion fut annoncée
officiellement.
Mais encore, ce pétainisme résiduel, comme on l'a dit ce matin
sur France-Culture, ce n'était de loin pas seulement les mœurs dépravés des
militaires professionnels ou appelés (dont il faut rappeler que le viol des
civils algériens restait une gâterie dont certains parvenaient même à se
vanter), c'était tout simplement la France des années cinquante et soixante.
Pourquoi Mai 68 sinon que la coupe était pleine ? Etrange, aujourd'hui ce
sont les étudiants d' Alger qui descendent dans la rue, exactement comme en
ce temps-là. Pourquoi ? parce qu'il n'y a plus personne d'autre de
vivant : seul l'esprit vit encore dans quelques recoins des universités
(situation que l'Amérique latine ou l'Asie connaissent fort bien), le civilisé
est refoulé dans l'extrême minorité d'où il rebondit toujours, quoi qu'il
arrive. Depuis quarante ans j'attends d'être réhabilité de ce qui passe
quand-même et toujours pour une trahison : en réalité l'histoire exige de
l'individu qu'il se solidarise avec tout, même et surtout avec les crimes de ses
concitoyens. Qui peut dire " non pecavi " ? Moi et quelques
centaines de Français, mais ce n'est pas une situation enviable de faire partie
de cette minorité, la culpabilité des autres vous enferme dans une marge dont il
est impossible de sortir, et ce ne sera pas cet ultime épisode des règlements de
compte au sommet qui changera quoi que ce soit. Que François Mitterrand soit
responsable, personne ne l'ignorait à l'époque, personne n'ignorait qu'il
représentait la politique de l'exécutif de la République, et donc, qu'on le
veuille ou non, d'un certain consensus social autour de la sale guerre. En 1980
il m'est arrivé d'entendre deux journalistes connus dans le pays d'ici (hi hi)
défendre l'usage de la torture en cas de guerre (et donc pendant la guerre
l'Algérie), et savez-vous devant quel auditoire ? devant des étudiants
juifs, venus écouter sans broncher leur plaidoyer poussif et scandaleux. Si je
n'étais pas intervenu, le message serait passé sans autre forme de procès tant
il allait de soi que la guerre juste justifie toujours tout (voir St Thomas
d'Aquin). Il est vrai que la même problématique rongeait déjà les rangs de
Tsahal face aux Palestiniens.
Oui, la civilisation est un fait minoritaire : de 1954 à
1962 ils ont été à peine quatre cents jeunes Français à dire non à ce crime, et
la plupart d'entre eux ne l'ont pas fait pas calcul politique, mais par un
reflex moral immédiat. Pas de discussion, la torture n'appartient pas à
l'identité humaine, elle ne se justifie d'aucune manière, elle n'est que la
conséquence de la naissance de la barbarie au beau milieu de ce vingtième
siècle, là-bas, de l'autre côté du Rhin. Car il faut dissiper cette idée que la
torture appartient à la pratique guerrière. Même à l'époque des Goths, lorsqu'un
Boèce était torturé à longueur de journées au fond d'un cul de basse-fosse, le
motif n'avait rien de guerrier, le motif était la vengeance personnelle du
souverain, la haine pure et non pas le calcul portant sur le nombre de vies que
l'on pourrait sauver en en sacrifiant une seule. Si nos pioupious se sont
précipité dans les trains du front en 1914, c'est qu'ils avaient de la guerre un
tout autre goût que celui qui nous reste dans la bouche depuis 1945. La guerre
totale a tué la guerre, comme elle a tué la paix, et la faute des élites
françaises des années noires des guerres coloniales (mais aussi des élites
américaines et de toutes les élites militaires du monde, voir au Chili ou en
Argentine) est de n'avoir pas su se distancer par rapport aux méthodes nazis en
optant pour leur efficacité technique. La civilisation cinétique commence avec
la vitesse d'exécution, capitale. Rien d'étonnant à ce que le locataire de la
Maison Blanche s'appelle Bush.
AH NON ! ah non ! j'ai tout faux, ou presque…presque.
Oui ce matin je n'avais pas mentionné le nom de ce général faute d'en connaître
l'orthographe, et ce soir j'ai acheté Le Monde que je ne lis plus que de temps
en temps. Quelle surprise !! Nulle repentance chez cette culotte de peau
(en l'occurrence on peut même dire de peau humaine…ça rappelle aussi des
souvenirs lumineux ..), un froid cynisme sur fond de bonne conscience.
Juste une petite contradiction, il passe bien vite d'une admiration pour le
général de la Bollardière (bien connu par les résistants à la guerre
d' Algérie) à la liquidation industrielle des terroristes algériens. Sans
états d'âme.
Alors distinguons : il y a deux événements dans cette
histoire. Le premier c'est l'aveu. L'aveu sans fards et sans phrases : j'ai
torturé, j'ai tué pour achever les victimes et pour cacher mon crime et celui de
ceux pour qui je les commettais. Voilà qui remet à leur place les Le Pen et
autres Bigeard auxquels le cœur a manqué pour aller jusque là, le bon général
Aussaresses, lui, ne regrette rien, il a fait son " boulot ". Ce qui
est vrai sans aucun doute, l'assassinat étant devenu un boulot comme les autres
dans les camps de " fabrication industrielle de cadavres ".
Et puis l'autre événement c'est le culot de cet homme. Mais
est-ce seulement du culot, ou bien les temps seraient-ils venus où de pareilles
vérités, de pareilles confessions sont possibles sans plus ? Si encore il
avait craqué, au crépuscule de son existence, pour réellement confesser des
crimes ! Mais non, son opération est une véritable provocation : il
veut se justifier, il veut que le débat national s'empare de son point de vue
pour le défendre et non pas pour lui faire subir le sort des actes d'un Papon ou
d'un Bousquet. C'est qu'il pense, quelque part comme on dit, que c'est possible,
qu'il y a une " fenêtre " dans l'ambiance générale. Maintenant que le
FN est mort ou agonisant, il ne court pas le risque de s'identifier à ces
nostalgiques de l'Algérie française, il ne veut qu'une chose : faire
admettre la légitimité de ses actes. Le sort que Le Monde a réservé à cette
lugubre forfanterie montre d'ailleurs qu'il n'a pas tellement tort, ON prend, on
vend, on s'apprête à discuter, on ouvre une tribune aux assassins et on
interview le monsieur comme un honorable père de famille. Bof, bientôt le tour
aux anciens de l'OAS qui ne vont pas manquer de saisir l'occasion.
Pour le reste tout ce que j'avais écrit est tristement vrai. Il
manquait encore une petite chose, que je n'aurais pu trouver sans lire les
extraits du livre (LIVRE !) de ce militaire, c'est un jugement sur la
qualité d'un général français, ou sur les qualités humaines d'un gradé de ce
niveau. J'ose espérer que cet Aussaresses est devenu général au bénéfice de la
retraite, car j'aurais mal à la France d'imaginer qu'un tel individu ait obtenu
ses étoiles en activité.
Encore une remarque. Cette insolence, car c'est de l'insolence,
me rappelle exactement celle des quelques soldatesques que j'ai rencontrées par
hasard dans les années cinquante et qui se pavanaient en détaillant le récit des
traitements qu'ils avaient fait subir à des " fells " ou à des
" niakoués ". Ce qui signifie que les temps sont revenus où toute
honte bue, les masques tombent : cette histoire me fait le même effet que
le retour sur scène de Le Pen au début des années 80, où je me réjouissais en
disant qu'on allait enfin voir tomber le masque de tous ces cousins du Maréchal,
et tant mieux pour le combat politique enfin à découvert. C'est le
progrès … vendredi 4 mai 2001
Je suis encore sous le choc de ce passage à l'acte de ce
Bérrurier d'opérette ! Pas question de faire passer à l'as toutes ces
années où on s'est comporté comme un cochon, non, c'est ma vie ça Monsieur, ma
vie pour la Patrie, Monsieur. J'en ai le cœur qui se soulève grave. Mais au
fait, il y a quelque chose qui me turlupine encore plus grave : ce monsieur
prétend avoir fait Khâgne et je ne sais quoi comme diplômes dans les
humanités ? En compagnie d'Escarpit et de Mandouze ! Voilà de quoi
mettre mon drapeau humaniste en berne pour longtemps, moi qui croyait que les
Catilinaires suffisaient à forger une âme d'homme. C'est donc faux, archi-faux.
L'assassinat de Ben M'hidi (dire que j'ai assisté à l'inauguration de la rue du
même nom en me demandant comment ce héros était mort) a, il est vrai, quelque
chose de semblable à celui de Cicéron, petit meurtre implacable mais discret,
loin de Rome à la campagne, mais d'une cruauté absolue. ILS n'ont même pas osé
le tuer à Alger même, à la Villa. J'ai cru lire quelques dithyrambes de l'un ou
l'autre de ces tortionnaires à propos de Ali La Pointe, le pote à M'hidi. Ah
quel homme, un véritable adversaire, un ennemi à notre mesure etc et des
meilleures. Tout ça pour apprendre qu'on a liquidé Ben M'hidi comme un
chien ! Bravo Messieurs, on ne fera jamais votre procès mais ces pages
glorieuses iront orner désormais notre bonne Histoire de France : à Saïgon
on s'est fait mettre (pardon pour la grossièreté), mais pas à Alger, ah non, pas
à Alger. Allez donc lire la version clean de la Bataille d'Alger, celle qui se
passe sous les ordres de Massu et de Bigeard, et pas celle des égouts de
l'armée, on dirait Austerlitz.
A propos, il serait temps d'ajouter quelques considérations
historiques sur tout ce vomi de l'histoire, de notre histoire. Bon
allons-y : Indochine, Algérie, Afrique Française au Sud du Sahara. Quel
merdier ! La question est simple en regard des déclarations du général
Ausseresses : en quoi le patriotisme était-il concerné par ces trois champs
de bataille ? Réponse : en rien. Comment un officier de l'armée
française pouvait-il torturer à Alger au nom de la Patrie ? Quelle
Patrie ? l'Algérie était-elle la Patrie ? ou l'Indochine ou la Côte
D'Ivoire ? Non, tout simplement non, même pas juridiquement, ces
territoires étaient des colonies, c'est à dire des zones d'exercice aléatoire de
notre souveraineté. La guerre était au menu depuis le départ, depuis les
conquêtes militaires de ces espaces, elle n'a d'ailleurs jamais arrêté, dans
aucune de ces enclaves à esclaves.
Mais là encore il y a plusieurs aspects de la question. La
première est le contrôle de l'évolution des choses. Dès 1945, il était clair
pour tout le monde que la décolonisation était à l'ordre du jour, j'allais dire
du monde. Les Américains avaient tout pouvoir pour en finir avec ce qui leur
faisait de l'ombre aux quatre coins de la planète, et certains comme le général
Leclerc et Mendès France l'avaient compris et s'apprêtaient à appliquer une
politique qui pouvait délier la sujétion coloniale et préserver en même temps
des relations constructives avec ces pays. On sait ce qui a suivi, le succès des
intrigues (aujourd'hui on dirait du lobbying) des milieux pinardiers,
caoutchouteux, bois tropical et huile Lesieur, passez muscade. Les pires membres
de la famille des 200 familles prennent le pouvoir et décident de jouer les
Rambo partout où ça moufte. Les cocoricades gaullistes, j'allais dire
Céaucescudistes, n'ont fait que retarder l'évolution fatale de ces
conflits avec des résultats plus catastrophiques les uns que les autres. De
Gaulle, c'est l'acier et le sucre, les Grandes Familles du Nord, plus impatients
de faire circuler leur came en Europe que de vendre quelques sous-produits sur
un marché où les Américains ont déjà décroché la timbale. Mais les généraux
(félons) sont ses amis, pire, ils forment sa famille d'origine, les soldats de
la Résistance. Dès 1958, dès le coup d'état, le grand Charles aurait pu
reprendre sans problème la politique entamée par Mendès et Leclerc, mais il
fallait, n'est-ce-pas, ménager les Salan, les Jouhaud et les Trinquier (et les
Aussaresses), les humiliés de Saïgon, mais aussi les Compagnons de la
reconquête, Tchad, Monte Cassino et compagnie. D'où ces atermoiements, ces
lenteurs et tout ce gâchis humain en Algérie : rien ne justifiera jamais
les trois années de guerre qui ont suivi l'accession du général De Gaulle au
pouvoir, aux pleins pouvoirs. Il faut bien reconnaître qu'il a su s'éloigner
radicalement de ces amis les plus proches et jusqu'à un certain point les
trahir, et il est remarquable de constater que c'est Mitterrand qui a passé
l'éponge pour les généraux qui moisissaient dans les geôles de la République.
Mais c'est que le général n'avait pas le choix, politique à minima, pataugeage
dans la semoule de la conjoncture internationale. Qui sait ce qu'il aurait fait
si Washington avait baissé la garde, diminué la pression sur le chapitre de la
décolonisation ? Il suffisait d'un bon président isolationniste pour que
les USA se désintéressent de la question pour quelques années au moins, même si
les multinationales veillaient déjà au grain, le continent africain étant avant
tout un réservoir de richesses qu'il fallait stériliser pour ne pas menacer la
structure existante. En Algérie même la situation était propice à un
durcissement de la colonisation, la guerre était " gagnée " pour
l'armée et le pays aurait pu devenir un compound sud-africain défendu par des
miradors à l'Est et à l'Ouest.
L'autre aspect c'est le terrorisme et les victimes civiles. Le
patriotisme pouvait-il se nourrir ou se revendiquer de la mission de sauver des
vies humaines, et pour cela de torturer pour aller plus vite ? Ceux qui
connaissent la guerre de l'ombre savent deux choses par cœur : premièrement
que les suspects n'en savent jamais assez pour que leurs déclarations empêchent
les grands attentats. Dans la bataille d'Alger, d'ailleurs, je crois me souvenir
que le succès de l'offensive a été dû en grande partie au quadrillage militaire
de la Casbah : Massu voulait que toutes les rues du quartier soient en
permanence sous le regard d'un parachutiste. En quelque semaines la circulation
a été totalement asphyxiée, il était devenu impossible de sortir d'une maison
sans être immédiatement repéré par un soldat français. Comment voulez-vous
résister de cette manière ? Deuxièmement, le terrorisme se nourrit de ses
échecs : en assassinant Larbi Ben M'hidi comme ils l'ont fait, les
militaires français n'ont fait que mobiliser davantage de haine, faire monter
ceux qui viennent après. On connaît la logique de la répression. Et puis soyons
concret : Alger est une petite ville, le quartier concerné minuscule, la
victoire de la Bataille d'Alger c'est de la frime, ce fut le premier bulletin de
victoire depuis Dien Bien Phu, ça valait bien la peine d'y mettre le paquet. Je
préférerais, pour tout dire, que ce général tortionnaire me dise qu'il a fait
tout ça pour venger les victimes des attentats. Au moins cela deviendrait
admissible sur le plan de la passion, exactement comme ce qu'il avait fait à
Philippeville. Après tout, lorsque la guerre en vient au terrorisme civil, c'est
une sorte de suicide collectif qui commence et tout le monde le sait, la morale
n'a plus grand chose à voir et la seule chose qui compte est de faire du mal à
l'adversaire, de quelque manière que ce soit. Pas besoin de ratiociner mon
général, mais admettez au moins ceci : moralement vous avez montré que vous
étiez exactement au niveau de vos adversaires, et même légèrement en-dessous en
raison de votre avantage matériel. Et c'est cela votre faute, et une faute qui
porte autant atteinte aux intérêts de ceux que vous défendiez, à savoir les
pieds-noirs qu'à vos adversaires. Une force qui prétend combattre le mal ne peut
pas se confondre avec ce mal et avec ses méthodes, le résultat final de tout ce
gâchis montre bien que tout cela était BIDON. Et vous le saviez, vous le
sentiez, vous n'avez jamais pensé à cette époque que quelque chose comme une
paix civile pourrait surgir de votre action, ou bien ?
Samedi 5 mai 2001
Je ne suis pas si fier que
cela de m'être précipité dans ce commentaire rageur du sempiternel !! Marre de
ces fantômes de la non-vie, de la non-réalité - ce que personne ne comprend,
c'est que l'homme a inventé un peu avant 1914, l'abolition de la réalité et que
ce que j'avais vécu en tant que petit enfant entre 41 et 45 s'est prolongé
scandaleusement au-delà de cette limite, grignotant notre vie, année par année.
Ces incultes culottes de peau ne pourraient même pas comprendre ce que je dis,
distinguer les responsabilités réelles de leurs sinistres calculs. Ils
s'amusent, en fait, remplissant comme ils peuvent des existences condamnées au
vide sédentaire. Crétins.
Et nous sommes toujours dans cet après-vide où
règne l'oubli de la vie. On est obligé de se réfugier dans son intellectualité
exacerbé, dans cet ego cartésien où se préservent quelques molécules d'honneur.
Valéry est intéressant car il pressent tout cela avant la catastrophe et
s'adapte parfaitement aux événements, au point d'en devenir parfois
insupportable de morgue spirituelle et d'intelligence " sans emploi ", comme
disait Debord. Il va jusqu'à revendiquer la vacuité de l'intelligence, la "
philosophie est un art de penser indépendant de ses objets ", ou quelque chose
comme ça. Gymnaste de la pensée, exercice, exercice : un jour j'ai découvert
qu'en Espagnol, le mot exercice signifie Armée ! Hi hi hi ! Car la guerre
commerciale, comme ils disent, c'est le même phénomène, pas de place pour autre
chose, l'économie chasse toute autre réalité, elle hante tout l'espace de la
conscience sociale, écrase toute tentative pour vivre autre chose. Fin 68 on
parlait d'anti-économie, n'est-ce-pas ? Qu'en est-il surgi ? Le Club
Méditerranée. Réalité du Vingtième Siècle = Club Méditerranée, merci Monsieur
Trigano, heureusement que votre famille a franchi cette même Mède dans les
années 62, vous aviez de l'humour ! Mais qu'est - ce - que vous voulez Kobisch ?
J'entends encore ce cri de mon prof de philo, rageur et amer, déçu devant
l'accumulation des fins de non-recevoir de cet élève rétif mais si rusé et si
culotté. Le pauvre avait de la vie la grande expérience de l'Exode alsacienne de
39, cet entrechat historique d'un peuple qui avait perdu depuis des lustres le
sens de toute réalité et qui avait décidé depuis longtemps de la confondre
définitivement avec le Gewürtztraminer et les flonflons. J'y repense à présent,
vivre dans l'immobilité d'un paysage est impossible, tout simplement, sous peine
de pathologies psychiques de la dimension d'Auschwitz. La première grande faute
sémantique aura été de distinguer le Temps et l'Espace, de déchirer l'hymen qui
relie l'un à l'autre, de laisser ainsi s'installer l'idée qu'on pouvait traiter
l'espace séparément du temps, qu'on avait le droit de figer l'espace autour de
soi, d'en faire un absolu. Ce que je veux ? Mais cher Lucien Braun comment le
saurais-je ? Et encore, je crois m'en être bien sorti, lorsqu'à peine fermées
les portes de votre Lycée je me suis enfui vers la Grèce pour une aventure sans
lendemain, sans temps et sans espace, tellement absolue qu'elle ne s'est même
pas inscrite correctement dans ma mémoire. Comme quoi il faut se méfier de ce
qui colonise la mémoire facilement. Par exemple, il m'arrive d'irriter mes
auditoires en évoquant implacablement les dates des événements : colonisé par le
temps réifié, par ce rythme plouc de calendrier ringard. Comment le saurais-je ?
La volonté a besoin de repères dans la réalité, où sont-ils ces repères ? où
étaient-ils dans les années cinquante et soixante ? Et ne vous plaignez pas,
nous vous avons inventé Mai 68, une fête comme vous n'en aviez pas vue depuis la
Libération, depuis ce jour où tout le monde a cru que la réalité était de
retour. Et vous n'étiez pas le dernier à danser de joie, j'en atteste, vous
aviez quelque chose d'attendrissant à gambader comme un jeune homme dans les
couloirs de la Faculté de Philosophie alors que vous en étiez le patron ! Pas
mal, mais manque de persévérance. En ce moment, voyez-vous, je me retrouve un
peu comme en 1960, que faire ? La Grèce est loin, elle a disparu en fait dans le
travail touristique, dans l'économie de la jouissance triviale ou dans la
jouissance triviale de l'économie. Les renversements dialectiques chers à Marx
restent toujours fructueux. Pour l'instant je me vois condamné à la solitude
totale, ça c'est le premier constat. Dans les années de jeunesse nous étions
encore quelques-uns, un groupe de révoltés déterminés à ne pas se laisser faire,
et cette forme d'association était un élément de ce que nous voulions. Que
signifierait donc pour moi de dire que je veux ceci ou cela ? Ceci ou cela tout
seul ? Anachorète du Temps et de l'Espace, merci, non, j'ai donné dans ma vie
professionnelle, largement suffisant.
Le matin, je m'efforce d'écouter
chanter les oiseaux, c'est un reste non négligeable de ce qui ne s'est pas
anéanti dans la fissure spatio-temporelle. Mais mes amis à plumes paraissent
eux-mêmes fatigués, et leurs concerts ne durent jamais très longtemps. J'écoute
aussi la mer, couché dans mon voilier, c'est déjà mieux, le vieil Océan ne s'en
laisse pas compter et il a des ressources infinies semble-t-il. Mais tout ça est
triste, lugubre même, me rappelle les gémissements des romantiques : la vie est
une occasion manquée, elle est là, présente, et personne n'en fait rien. On fait
mine d'avoir décidé que la vie était en fait ce qui précède la vie, ce qui la
rend possible : bouffer, travailler, se protéger, savoir comment poser son cul
et comment boire des boissons fraîches. Quand tout cela est assuré, il n'y a
plus rien. Le spectacle, si, le spectacle de tous ces préparatifs stériles. Le
spectacle, le monde du spectacle, quelle tristesse ! Autour de moi je vois la
réalité devenir mime de mime, la télévision tourne en rond dans les flaques
d'images du quotidien le plus sordide. On me sert la non-réalité en conclusion
esthétique, à charge pour moi d'y investir mon hybris personnelle. Non mais,
pour qui nous prend-on ? Nous, en tout cas, nous nous prenons pour des Rimbaud
qui traînons chacun à une extrémité du drame. Son cœur bavait déjà à la poupe,
et le nôtre donc, dire que nous avons encore des cœurs après tout cela ! Parfois
je comprends Maldoror, parfois pas. En ce moment nous sommes très intimes tous
les deux ; lui ne rigole jamais, moi trop, rire pulvérisant l'invraisemblable
qui se tient là, à mes côtés, tous les jours, partout. Mais quelle fatigue !
hypoglycémie permanente de l'âme devant la fatalité du non-réel, de ce qui fait
semblant d'être, là, partout, en parlant, évoluant avec ou sans élégance, se
manifestant par des dehors qui veulent se signaler ; les hommes ont appris à se
signaler dans des looks de tout genre, répétition de leurs fantasmes de BD, de
la glue mnésique qui prend ici et là dans les salles obscures ou sur les petits
écrans. Chaque jour, je vois à côté de chez moi se répéter la comédie si drôle
de Mon Oncle, sans scrupules, sans pudeur on se livre à des ballets de
trisomiques pour trisomiques, l'hôtel cinq étoiles qui reçoit les légumes qui se
prennent pour des légumes dans leurs limousines du jour. Les rues s'encombrent
de gens encombrés de marchandises, sans pudeur, on mange l'interstice de l'ennui
en sandwich en courant vers la passerelle du temps qui attend, prépare toujours
le lendemain, la nuit, les draps, les choses qui ne s'attendent même plus, qui
viennent au gré des courants de la publicité et des voyants rouges et verts.
Hop, on saute dans l'Agence et puis dans l'avion, on s'aventure dans les listes
dégriffées. Allez, moi aussi je dois y aller, j'y vais, j'y suis. Ah dormir
!…………
lundi 7 mai 2001
Le texte qui suit est destiné à former un chapitre du manuscrit original qui s'intitule Atopie. Mais j'ai pensé en donner une version immédiatement dans ce journal, puisque aussi bien je l'ai écrit aujourd'hui, mais surtout à l'intention de ceux qui auraient déjà parcouru Atopie et qui n'ont aucune raison d'attendre de voir le texte réorganisé sur Internet, ce qui n'est pas simple et qui demande beaucoup de travail à ma chère Mara. Il ne sera sans doute pas terminé car à chaque journée suffit sa peine, mais la suite est déjà dans ma tête.
RIMBAUD : LA CASSURE
Dans le contexte d'une telle théorisation qui se réclame du poétique, il est intéressant de s'arrêter un peu sur un exemple tiré du siècle dont nous venons de parler, et qui, pour des raisons évidentes, confirme radicalement la thèse d'un échec du sédentarisme. Nous y trouverons tous les paradoxes rassemblés, si magnifiquement rassemblés qu'il ne serait pas impossible d'affirmer que toute notre thèse pourrait se contenter de l'exemple de la biographie de Rimbaud pour se soutenir, sans autre référence. Oui, Rimbaud à lui tout seul a fait l'expérience consciente de ce qu'on pourrait appeler la ruine ou la pourriture des siècles immobiles. Nous n'allons pas refaire une biographie de ce prince des poètes, qui, comme on s'empresse de le dire à chaque fois qu'on l'évoque, tient encore aujourd'hui la corde de la célébrité, du succès sans phrase, et, on pourrait dire pour résumer qu'il monopolise d'une certaine manière et d'une manière originale, la notion de génie. Beethoven est un génie comme Léonard ou Descartes, mais Rimbaud est le génie absolu, le frêle adolescent dont a jailli un flot de beauté vraie sans qu'il y paraisse lui-même beaucoup, on dirait qu'il est la main même des Muses, le porte-parole d'un Dire de l'être.
Nous nous attarderons en revanche sur certains moments de sa vie sur lesquels justement peu de biographes se penchent sérieusement. Son engagement comme Légionnaire Batave en Indonésie suivi d'une désertion (on pense tout de suite à Ernst Jünger qui réitère le geste peu avant la Première Guerre Mondiale, sans que l'on sache d'ailleurs avec exactitude s'il existe une relation entre l'exemple de Rimbaud et l'aventure de l'écrivain - guerrier allemand). Et puis, bien sûr, ce revirement destinal que constitua son aventure dans la zone passionnante de la Mer Rouge, mais aussi son comportement ambigu lors de la Commune de Paris, quand son " cœur bavait à la poupe "au milieu des événements " abracadabrantesques ".
Non pas pour donner encore plus de détails sur tout cela, car on n'en possède pas, mais pour analyser et éclairer des décisions qui n'ont pas cessé de surprendre le monde littéraire et l'autre. Bien sûr on n'évitera pas une lecture de Rimbaud, mais une lecture qui figure surtout déjà dans la thèse générale de cet ouvrage auquel on aurait aimé pouvoir donner le beau titre de " Bateau Ivre ". Ce poème est le résumé dernier d'Atopie, faut-il le souligner ?
Ce qui fait scandale dans l'existence du jeune Rimbaud surgit d'abord de son parallélisme avec celle de Verlaine. Verlaine est le type-même du provincial parisianisé. Lorrain comme lui, Rimbaud ne voudra jamais réellement jeter son ancre près du Léviathan de la Culture, vivre au cœur du mouvement littéraire qui porte, entre-autre, le nom si évident de Parnasse. Rimbaud n'est pas mondain, Rimbaud n'est pas un arriviste de ces nouveaux métiers qui ont surgi de l'écriture, il ne cherche en aucun cas la Gloire littéraire. La pureté de son écriture est toute entière dans cette vérité, que le jeune Ardennais écrit pour hurler son être et pour rien d'autre, aucune finalité secondaire, même s'il se reconnaît comme poète, premier paradoxe qui l'amènera a fréquenter celui qui est " monté " à Paris pour la conquérir. Rimbaud rencontre Verlaine au cours d'une errance métaphysique qui commence, d'ailleurs tardivement par rapport à son œuvre, et cette rencontre est toute entière une rencontre humaine, et non pas littéraire. N'étant agrégé de rien, je ne suis pas en mesure de juger des ressemblances et des dissemblances entre les œuvres poétiques des deux hommes, je ne peux qu'affirmer que je ne vois qu'un seul trait qui unit les deux textes, celui du genre. Entre la poésie de Verlaine et celle de Rimbaud, rien, aucune comparaison possible, aucune possibilité de les mettre sous un même chapeau, sous une même rubrique stylistique ou autre, j'ai toujours trouvé assez con (pour tout dire le plus platement possible) l'invention des écoles et des courants, occupation assez vaine et surtout appréciée des cuistres, comme on peut le constater dans les commentaires Anglo-Saxons, friands de science littéraire. Non, la singularité de ces deux hommes se prouve, je dirais, par le mouvement, c'est leur écriture qui les distingue d'abord. Un exemple ? L'absence totale d'émotion chez Arthur. Comment pourrait-on comparer deux hommes dont l'un passe son temps à pleurnicher ou à boire sa vie, et l'autre à la fouetter d'héroïsme et de mépris pour les vices et la promiscuité ? Gageons que l'aventure homosexuelle que l'on prête aux deux hommes avait comme moteur aussi cet héroïsme dans le plaisir et la douleur qui caractérisa Rimbaud tout au cours de son existence, pas si brève qu'on veut bien le dire, interminable si on l'étale dans toute la richesse de ses expériences. Là où Verlaine est un simple cosmopolite à la mode, Rimbaud est déjà un citoyen universel, là où Verlaine se montre comme un simple consommateur malheureux du temps, Rimbaud chevauche tous les défis de son siècle, dont celui qui consiste à renoncer à la beauté contemplative, à la chaude position couchée dans le sillon de son talent.
Héros, Rimbaud avait pris très au sérieux le texte humaniste gréco-latin. Mais non pas pour se proposer de le prolonger ad libitum à l'abri des belles Lettrines dorées, mais pour le faire revivre dans la dimension du réel. Ce réel, il le rencontre enfant dans une conjoncture diabolique, celle de l'orphelin du Héros, fils de soldat, descendant d'un homme qui n'avait rien de la Noblesse nominale et tout de son privilège encore presque intouché de la guerre. Ajoutez à cela la solitude d'une mère toute entière dévorée par cette noblesse blessée (allitération fort intéressante au demeurant, il faudra y revenir) au milieu d'un désert, nous dirions culturel, où tout l'être de la Civilisation qui porte tout cela, le théâtre des opérations, se résume dans l'Ecole et son cher Maître et ami. La passion de Rimbaud, la première et fondamentale passion n'était pas la poésie, mais les Belles Lettres. Toute son excellence se manifestait alors dans ses magistrales versions latines et dans ses thèmes parfaits, il travaillait la langue morte comme s'il vivait dans les siècles antiques, preuve évidente de son amour pour les contenus, son admiration pour la passion elle-même qui vit encore dans les grands écrits de nos lointains Ancêtres. La poésie, a, semble-t-il, un autre statut. A supposer que le jeune lycéen se soit épris de la poésie par le biais des exemples littéraires antiques, c'est à dire qu'il se soit lancé dans une pure imitation du métier de poète tel que le décrivent les œuvres historiques, Rimbaud aurait écrit autre chose. Sans doute aurait-il cédé au désir naturel de refaire sa version de l'Enéide, comme l'ont fait les poètes classiques comme Dante, il en avait l'envergure, peut-être aurait-il réécrit entièrement l'Iliade, ce qui correspondait bien à sa donne existentielle de fils de héros.
Mais il ne l'a pas fait, que dans un court sonnet où le soldat dort déjà, deux trous rouges au côté droit. Première Illumination, Rimbaud prend conscience de la mort de la guerre : le fusil a tué la guerre, le Lebel n'est pas loin, s'il n'est pas déjà dans les cartons de l'inventeur (à vérifier). La poésie classique ne peut donc pas survivre, elle ne peut plus accompagner la réalité, la sous-tendre et la motiver, la poésie classique est obsolète, elle n'est même plus le son de l'olifant de Roncevaux, elle est morte comme la langue qui la profère. Le jeune homme tourne donc son regard vers un autre monde, tout bonnement le sien, celui des Siens, celui de sa Pénélope de mère, celui des Femmes à Genoux, et aussi, déjà, celui de Jules Verne et des imaginaires d'adolescents. D'adolescents certes, mais surtout d'adolescents de la Civilisation. Le Bateau Ivre condensera sans appel le voyage initiatique de cette Civilisation dont les auteurs quittent le ciel à reculons attirés par l'abîme marin. Alors, pourquoi continuer à faire semblant ? Après Bateau Ivre, que reste-t-il comme perspective d'existence ? Les voies royales de l'héroïsme des Hellènes et des Romains ont disparu depuis longtemps, forme et fond, coulées par l'aboiement des canons, ensablés par la médiocrité des consommateurs de temps, ces humanoïdes Chrétiens qui ont pris la relève des héros de Salamine. Il faut comprendre le sens exact d'Illumination. Il ne s'agit pas d'une inspiration subite ou d'un événement mystique, pas du tout, il s'agit d'une prise de conscience brutale de sa propre histoire, de la position qu'il occupe en tant que héros, dans un monde moisi par son immobilité, dans un monde qui s'est défait silencieusement, noyé dans son propre projet de soldat-laboureur. Rimbaud comprend qu'il est cuit, que son rêve est un enfantillage dépassé et qu'il ne lui reste aucune chance de s'accomplir dans son rêve antique et pioupiesque. Et pourtant, il reste une chance, là-bas sur les frontières coloniales, de jeunes Européens paraît-il, se battent pour conquérir, auraient reculé les limites de l'Empire cerné par les Indiens, exercent aujourd'hui même le beau métier de soldat au milieu des miasmes tropicaux. Alors pourquoi ne pas tenter le coup ?
Ici le commentaire prend le pas sur la réalité historique. Rimbaud s'engage dans la Légion Batave qui bataille, paraît-il, dans les eaux de l'Océan Indien autour des sept mille îles et îlots de l'Indonésie. Nous ne savons pas grand chose de ce qui lui arrive, mais nous savons ce que fut cette conquête de l'Indonésie par les Hollandais, la pire abomination dont l'Occident se soit rendu coupable au cours de ses conquêtes dites coloniales. Les récits et les documents sont fort rares, mais tous les historiens s'accordent sur la brutalité singulière de la colonisation néerlandaise. Lors des massacres des communistes, au moment où Suharto renverse son commensal Suekarno, le nombre de morts (près d'un demi-million en quelques jours) effraye le monde entier. Les commentateurs iront chercher les exemples dans l'histoire de ce pays et ne trouveront que celui de la colonisation, massacre permanent et gratuit qui n'aura fait qu'inoculer la barbarie génocidaire des Européens à l'un des peuples les plus charmants et les plus civilisé du monde, l'Indonésie était une grande puissance avant le néolithique… Rimbaud s'enfuit écœuré et regagne miraculeusement la France, un retour aventureux qui n'a rien à voir avec la fin idyllique et paternelle de la désertion de Jünger en Algérie. Rimbaud s'engage mais paye cash en danger et souffrances diverses, il apprend son futur métier d'aventurier, il sait déjà que son salut n'est pas et ne sera jamais plus dans la poésie. Illuminations. Un voile sanglant s'est déchiré sur le monde, sur son monde. Rimbaud a perdu son pucelage ontologique. Désormais, tous les autres peuvent suivre. Il tente un moment les vices de l'époque, protégé par le libéralisme belge et britannique il s'essaie à la sodomie, la drogue et la boisson, sans conviction. Non, il n'est pas un Verlaine ventru et veule, il ne peut pas se résoudre à noyer son chagrin métaphysique dans les pintes de bière tiède de l'East End. Son Orient à lui est mort, ou peut-être seulement à venir, en cherchant bien, on trouvera une Indonésie plus vraie que la vraie, un espace de rodéo qui aurait quelque chose à voir de près ou de loin avec le mythe grec, avec les campagnes des Légions romaines.
La poésie ? Elle est loin dans l'esprit d'Arthur. Elle a tout perdu, elle n'est plus rien. On peut même se demander comment la France littéraire a pu conserver cette œuvre, une œuvre a ce point déchue dans l'esprit de son auteur. Non pas reniée, Rimbaud ne perd pas son temps avec les regrets ou les remords, mais simplement délaissée là où elle s'est arrêté, faute de sens, de sens dans la vie du poète. D'un poète qui ne cessera pas d'être un poète parce qu'il cesse d'écrire, mais qui ne peut pas réduire son existence à la copie, à celle d'un copiste médiéval, enfilant les figures de style et les martingales rhétoriques. Il a déjà donné les plus géniales, celles qui écrivent le réel dans sa vérité la plus crue et la plus limpide, il n'a plus envie de se cacher derrière le buisson du beau pour donner à son existence un alibi assez solide pour continuer à vivre. Il aurait pu se suicider, à ce moment-là, en finir avec le non-sens de ce qui vient de se fermer dans son désir, mais le suicide était déjà au programme de son aventure indonésienne, or Rimbaud n'a rien d'un suicidé, il n'a aucune prétention à se " donner " la mort lui-même, il va faire ce qui lui reste à faire, partir et errer, errer dans la partie du monde la moins recherchée, entre des actions hasardeuses qui finiront par faire une petite boule de neige, un petit bas de laine qu'il n'aura même pas le temps de consommer.
O que ma quille éclate, o que j'aille à la mer ! Et sa quille - c'est l'interprétation d'un ami psychanalyste- c'était son genou, le membre qui va provoquer sa mort quelques années plus tard. Bien vu Jean Guir, la quille c'est bien le genou dans l'ancien vocabulaire des marins.
Le genou de la Civilisation, c'était son aspiration à la position sédentaire. Vraie ou fausse, peu importe. Je veux dire que l'idéal sédentaire, sédentaire-Chrétien faudrait-il dire, n'aura jamais été qu'une apparence, que les dehors d'un prétexte à Loi morale, au fond l'alibi permanent destiné à légitimer l'instinct despotique de nos aristocrates. Et l'exemple de Rome et de la Gaule est frappant : César vient " pacifier " ce qui est déjà depuis bien longtemps en paix, ce qui a trouvé les voies du sédentaire bien avant Rome, exactement comme l'avaient trouvé les Etrusques, floués par la tchatche romaine. Le sédentarisateur Rome, est un imposteur, un nomade qui a pris cette sédentarisation comme fond de commerce, un fond riche de profits juteux, de plus-values infinies de magnificence urbaine en retraites militaires confortables. Au fond les Romains, et puis ensuite les Francs, se sont bien moqué du monde avec leur Cité : Rome n'aura jamais eu plus de valeur que la yourte de Gengis Khan ou le Samarkande de Tamerlan, simples lieux de stockage du produit de leurs rapines. Et ce genou a éclaté en même temps que celui du poète. C'est pourquoi nous avons intitulé ce chapitre LA CASSURE.
La force et le génie de Rimbaud sont tout entiers dans cet être-prophétique de l'échec du Titanique Civilisation. Homme figé, gelé dans les contreforts des Ardennes où aucune chance jamais ne lui était ouverte de vivre ses passions d'enfants, que ce soit la mémoire fêlée d'un père absent ou la mémoire forte du texte des Humanités, Rimbaud s'est révolté contre cette condamnation de son destin d'homme nourri des valeurs de l'Univers à la consommation des valeurs de son territoire. Arthur a été séduit par le projet de la Commune de Paris, il semble même qu'il s'y soit engagé assez loin mais que son expérience batave (une expérience aussi politique que simplement militaire) l'ai mis en garde contre la grandiloquence et son autre la misère morale. Il a eu l'occasion de mesurer le gouffre qui sépare la beauté des idéaux et l'horreur des réalités, et son poème prouve qu'en pénétrant dans le Paris insurrectionnel, il pressentait déjà l'échec et l'issue fatale, une issue à l'indonésienne…mot pour mot. L'échec là est total, métaphysique : le bateau s'échoue sur le sable des fonds marins parce que la seule chance de jamais accéder au combat des valeurs antiques s'est évanouie, Monsieur Thiers a remis de l'ordre dans la consommation des Biens de ce monde, empêché les pires transformations, mutilé définitivement la créativité révolutionnaire des Français. C'est vrai, j'ai souvent insisté sur la mutilation du peuple germanique lors des massacres religieux conduits par Charlemagne et des révoltes successives écrasées dans le sang, mais je m'aperçois que cette manière d'analyser l'histoire humaine peut aussi parfaitement s'appliquer à notre pays, et notamment à propos des échecs successifs et décisifs aussi de la Montagne et de la Commune de Paris. J'aimerais encore y ajouter Mai 68, mais soyons sobres, et gardons quelques amis…
Suit alors l'aventure orientale d'Arthur, ce Tintin avant la lettre mais auquel Hergé a dû souvent penser, tant son œil est aiguisé dans la description de cet Orient si mystérieusement évident. En effet, la Mer Rouge c'est le lieu de la Guerre par excellence, on pourrait dire le centre géodésique de ce qui reste alors (et aujourd'hui encore, eh oui, comment expliquerait-on que le monde entier garde son regard braqué sur les épisodes des querelles israélo-palestiniennes ?) comme espace pour guerriers antiques, pour héros pas de BD, pour nostalgiques de l'aventure nomade, des razzias ludiques et tragiques et des abandons hédoniques sur les gazons des oasis. Arthur vise juste. Que se passe-t-il dans son esprit ? Quel est son projet ? Sait-il qu'il va finir comme négociant en tout et en n'importe quoi, qu'il va fonder une sorte de comptoir où le commerce se nourrit des complots et des vendettas incessantes entre patriarches pas encore convaincus que le commerce en tant que tel est leur vrai destin ? Nul ne le sait, on ne peut que conjecturer son dégoût pour le monde qui l'entoure, mais comme nous l'avons déjà souligné, Arthur n'est pas un émotif ni un sentimental, il analyse froidement les situations et ne décide rien en fonction de l'esthétique. Il vise juste en choisissant la Mer Rouge précisément parce qu'il analyse froidement la situation géopolitique de son monde : la Mer Rouge est et restera longtemps un espace de liberté totale. La convoitise pétrolière est encore loin et le conflit des Juifs et des Arabes seulement un vieux souvenir, certes prêt à se rallumer à la moindre alerte, mais pas opportun dans cette zone du commerce de la guerre par culture, de la guerre comme éthique de consommation (quel culot quand-même). Rimbaud se fera lui-même Juif, le Juif d'Aden, serviteur zélé des passions tintinesques des cheikhs et des chefs de clans. Il ne peut pas entrer dans les querelles, celles-ci ne sont pas les siennes et il aurait l'air ridicule de s'en mêler. Non le grand Art pour lui est de mimer des Alliances avec les uns et les autres, de prendre parti tout en vendant ses fusils aux uns et aux autres. Enfin, on ne sait trop rien de ce qu'il fabriquait dans son oasis philosophique, il n'en reste pas moins qu'il fait sa pelote, et qu'en bon paysan ardennais, il prépare sa retraite sur le continent : " retour des colonies, prêt pour la politique ".
Au fond, Arthur est un jeune Français parti pour les Colonies. Il n'a pas choisi l'Afrique Noire parce qu'il se méfie à juste titre d'une conquête qui ressemblerait par trop à ce qu'il a pu voir en Extrême-Orient. Il préfère un monde encore dégagé de l'emprise des grandes puissances du moment, et dans lequel il ne jouera qu'un rôle d'étranger techniquement efficace, il inaugure au fond la position de conseiller d'une Coopération Technique privée et d'autant moins suspecte aux yeux des autochtones. Mais son objectif est tout ce qu'il y a de plus plouc : faire des économies, qui lui permettront entre-autre d'entretenir les femmes de sa vie, c'est à dire d'abord sa mère, et rentrer en France couler les jours heureux d'un Ulysse qui a donné, risqué sa vie et conquis sa Rome à lui, le droit de s'étendre dans les frais valons de son Ardennes natale, sans trou rouge au côté droit. Que voilà un mythe crevé, semble-t-il, un Dieu insulté ? Une légende meurtrie et trivialisée ? Pas du tout, Rimbaud demeure Rimbaud parce qu'il est tout simplement un homme comme les autres, un homme qui n'a pas pu accepter de construire sa vie sur un mensonge ou sur un libertinage culturel profitable, par instinct aristocratique. Arthur est resté honnête de bout en bout parce qu'il entendait rester maître de son destin, de rester un Homme Libre, celui qu'il avait découvert dans ses versions grecques et latines. Mais plus simplement, Arthur n'a jamais écrit pour faire de la littérature, Arthur a usé de son génie de la langue pour faire sortir les cris de son âme angoissée. Et ces cris étaient tellement déchirants qu'ils ont crevé la toile de la Culture du siècle sans jamais y appartenir vraiment, sans s'inscrire réellement dans la Tradition Poétique telle qu'en elle-même l'Anthologie de Monsieur Pompidou l'anéantit pour de bon.
Rimbaud est ainsi le symptôme le plus vivant et le plus complet de la crise qui secoue le siècle qui s'ouvre sur l'aventure nomade de Bonaparte et s'achève sur les préparatifs du Grand Massacre de Verdun. Les voltes délicates de son âme se lisent dans les voltes face de son existence, et il est vraisemblable que ce destin est comme le paradigme de la grande Cassure qui va déverser ses contenus empoisonnés dans le Vingtième Siècle. Il est comme la préfiguration de l'appel au nomade, ou du rappel du nomade dans ce fourvoiement des idéaux territoriaux, nationalistes et finalement fascistes : les soldats romains en campagne dormaient à côté des faisceaux, comme les soldats de 14.
Mardi 8 mai 2001
J'ai quand - même terminé mon Rimbaud hier encore. Bien sûr tout cela aurait pu se présenter d'une manière plus nuancée, et je vais encore essuyer les critiques classiques de grossièreté et de brutalité, le meilleur et le pire. Mais je sais aussi qu'un qui ne plaît pas devient tout de suite le pire, alors.. Le bon lecteur aura senti tout l'hommage presque dévot que je rends à Arthur, à propos duquel je dois signaler une particularité personnelle : Rimbaud a longtemps été le seul poète français auquel j'étais sensible en tant qu'Alsacien ayant tété le Germanique au sein maternel. Un vers de Goethe (ou d'un quelconque rimailleur alsacien) et mes larmes coulent en abondance, dix pages de Baudelaire voire de Hugo me laissent de marbre. Les vers de Rimbaud m'ont toujours paru dépasser toutes les catégories de la sensibilité et du sentiment pour atteindre celles de la vérité. Ils ressemblent, dans mon esprit, aux coups de pinceaux de Vincent Van Gogh, coup de pinceaux qui ne font que
révéler
l'être de la chose peinte, l'être du présent du peintre. Pourrais-je intégrer Van Gogh dans ma méditation d'une manière ou d'une autre ? Certainement, et ce serait une expérience d'autant plus intéressante que son oeuvre représente, selon moi, à peu près l'essentiel de ce que la civilisation sédentaire a permis de créer, le meilleur. Van Gogh fait a posteriori ce que les hommes font en général avant, il donne une image du monde tel qu'il se présentera après l'effort humain pour le payser, pour l'humaniser. Je m'exprime mal ce matin, je veux dire que Vincent Van Gogh trace les plans d'un monde déjà fait et pourtant pas tout à fait présent, il propose une autre présence, une autre version du paysage, montrant en même temps que les hommes se sont trompés, disons auraient pu faire mieux : le sédentarisme est bâclé, et sans l'intervention de Vincent, ce serait encore pire. L'immobilité sédentaire aurait pu être un succès éclatant si elle avait trouvé un metteur en scène de la dimension de Van Gogh. En fait, Van Gogh est tout simplement l'une des réussites de la ré-interprétation sédentaire du monde, il est l'un de ceux qui a su faire alliance avec l'espace et le temps, quitte à se sentir obligé de mutiler le seul être qui ne colle pas tout à fait avec le paysage, l'homme lui-même. Si l'on faisait un bilan de l'histoire de l'installation de l'homme sur un territoire, alors il faudrait conclure, avec Vincent, que l'homme a bien travaillé ce monde, le rendant presque parfait, mais qu'il existe un être qui est loin de cette perfection, l'homme lui-même. Il est inutile de s'attarder sur le fait que toute la vie de Vincent est une errance sans fin et qu'il était un homme aussi simple que Rimbaud, fidèle à ses proches, et...originaire de cette Hollande fixiste et hypocritement campée dans la pose du Civilisateur.
Ce matin je ne voulais pas revenir sur ce sujet, car mon ouvrage va déborder de partout et finir par former une constellation de textes qu'il faudra aller pêcher ici et là. Non je voulais parler pour une fois d'un sujet d'actualité, je veux dire ce que j'appelle moi Luft Geschichte , traduction de la formule anglaise Loft Story ! Comme je n'ai plus de poste de TV depuis longtemps, je ne connais cette émission que par ouï-dire, mais c'est bien suffisant, voici bien trente ans que nous avions prévu qu'il ne resterait bientôt plus rien d'autre à montrer dans la petite lucarne, qu'il ne resterait plus qu'à passer la vie quotidienne en boucle sur un miroir sans tain derrière lequel chacun pourra se chercher dans une démente auto-identification qui deviendrait rapidement cultuelle. Je me souviens d'un ami belge qui avait proposé dans les années soixante de monter un Musée de grands hommes vivants, que les visiteurs pourraient aller interviewer dans des cabines en verre. Ah je vois bien le général Bigeard répondant aux questions des curieux aux côtés de Régis Debray ! Quelle rigolade. Mais Loft Story n'est certes pas une rigolade, plutôt une sinistre farce qui a toutes les chances de mal finir. Déjà le succès de son principe indique qu'il faut s'attendre à bien pire de la part de la concurrence : l'homme était un animal politique, il est en train de devenir un animal de Zoo, on peut dire qu'il est en train de remonter sur son arbre ?
Jeudi 10 mai 2001
J'ai mis presque une heure pour m'apercevoir que mon sujet de ce matin était écrit en toutes lettres dans la date : Diss Mai, comme disait Tonton, vingt ans ! Moi qui cultive une sorte de haine pour les anniversaires, je craque pour celui-là. Il est bon, de temps en temps de remettre des pendules à l'heure et de faire son examen de conscience. Car il s'agit bien de cela. Le citoyen n'est pas dispensé de s'arrêter de temps en temps pour examiner la valeur de ses choix, la pertinence de ses suffrages. Le citoyen n'est pas une personne abstraite, c'est vous, c'est moi, c'est lui, ce sont eux qui ont élu François Mitterrand un beau jour de Mai 1981. Lourde responsabilité qu'il ne faudrait pas entièrement basculer sur les épaules d'un seul homme sous prétexte qu'il détenait tout le pouvoir, ce qui est bien illusoire, même si on se sert souvent de cet argument pour se dérober à ses propres responsabilités.
J'ai souvent comparé l'élection de FM à la Libération et à Mai 68 à cause de l'immense jubilation qui s'est emparé des Français ce jour-là, de la joie un peu délirante qui s'est emparé des rues de notre pays. Cette réaction a été, au fond, la première cause du tour qu'allait prendre la façon de gouverner du nouveau Président, car ce fut une réaction idolâtre, qui a subitement transformé la nature même de la fonction présidentielle. FM n'a pas eu besoin de créer lui-même le culte de la personnalité, il était devenu en quelques minutes ce qu'on lui a reproché lourdement par la suite, Dieu en personne. Pour qui connaît bien le destin global de François Mitterrand, un tel enthousiasme n'était pas de mise, je veux dire qu'il ne correspondait pas à ce à quoi l'homme pouvait prétendre ou s'attendre dans le cours de sa vie. FM est un homme de second rang, au sens où sa carrière fut laborieuse, modèle parfait de la carrière politique d'un Français moyen, gravissant lourdement les échelons de la vie politique de mandat locaux en mandats nationaux, de fonctions secrétariales en portefeuilles ministériels. Le mandat présidentiel qui lui échoit ce jour-là est une immense surprise, et pour les initiés, cette surprise, qui n'en est pas une, ne confirme pas seulement des attentes précises, ne conforte pas seulement un programme révolutionnaire devenu soudain acceptable pour la majorité des citoyens, cette surprise manifeste au grand jour la trahison des idéaux nationaux dont la droite avait fini par se rendre coupable. La faction giscardienne avait bien fini par mettre la France à l'encan sur le marché mondial, accélérant vertigineusement ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement, c'est à dire l'insertion de notre pays dans la mondialisation américaine. Face, FM se présente comme un nouvel avenir de fraternité, de liberté et d'égalité, Pile il est le sauveur des meubles. Et ces meubles ont de beaux restes, malgré les grandes erreurs roumaines du général De Gaulle, Concorde, Plan Calcul, Sidérurgie etc. et grâce à des choix qui ne furent pas des erreurs, le nucléaire entre-autres.
Bien sûr, chaque Français à ressenti ce jour-là un immense soulagement, sans savoir pourquoi la plupart du temps. Pour ma part, les choses étaient simples : j'étais en train de préparer ma licence de journalisme, dont les résultats flatteurs pour moi me sont parvenus quelques jours avant l'élection de la Chambre Rose qui fut une grande souffrance, je me souviens gaiement, pour le rédacteur en chef de mon BRI de Reims où je faisais déjà un stage de reporteur télé. Car les irréductibles attendaient encore un démenti législatif à la catastrophe présidentielle, et se frottaient déjà les mains d'une cohabitation douloureuse pour le nouveau Chef de l'Etat. Mon soulagement provenait d'un fait simple, c'est que cette élection m'ouvrait les portes du service public, non pas parce que j'étais un militant socialiste qui avait activement œuvré à cette élection historique, mais parce que mon passé de militant anti-colonialiste cessait d'obérer (du moins j'en étais convaincu) toute chance de faire carrière dans le service public. Dont acte dans les ..années qui ont suivi, car j'ai attendu mon contrat presque deux ans, le méritant par un surtravail constant et en déjouant, jour après jour, les pièges de mes nouveaux collègues, tous ou presque dévoués à l'ancien pouvoir, aux anciens pouvoirs… Ma première déception politique est d'ailleurs due aux atermoiements démagogiques des nouveaux maîtres du service public de la télévision. Leur idée était simple mais terriblement dangereuse : faire taire cette majorité de droite des rédactions en multipliant les promotions-sanctions. La fameuse chasse aux sorcières dont on a fait les choux gras dans les média, c'est résumée à FR3 par une valse de Rédacteurs en Chef d'origine RPR et UDF d'un bout à l'autre de la France. L'idée était simple : le dispositif conçu par la droite était tellement encadré, tellement contrôlé par Paris, qu'il valait mieux donner à ces adversaires un pouvoir fictif afin de les amener à se décrédibiliser le plus vite possible. Et cette tactique a partiellement réussi, mais elle a entraîné des querelles et des déchirures telles à l'intérieur des rédactions composées de jeunes gens pas forcément hostiles au pouvoir socialiste, que l'administration a réussi en quelques mois à détruire dans tous les BRI jusqu'au minimum de stabilité nécessaire pour produire des programmes de qualité. En même temps, cette même administration dont l'exécutif n'avait changé que les grandes têtes, s'est bien vengé en mettant en place le plus vite possible toutes les nouvelles réformes liées aux nouvelles technologies, et qui faisaient partie de ce 'mouvement' de destruction masqué du rôle de l'Etat dans le service public : le passage à la vidéo dans les années 82-83 reste une victoire décisive pour les adversaires de la République, car elle a entraîné une disqualification radicale du métier de journaliste investigateur, au profit d'un journaliste communicateur, rêve de tous les despotes. Et cela dans une France socialiste !
Mais, je pense que la forme qu'a pris mon soulagement en 1981 ne devait pas être très différent de celui de la majorité qui avait élu FM. Je pense à tous ces cheminots ou à tous ces agents EDF ou France-Telecom, qui savaient depuis longtemps leur condamnation à la privatisation. Mais aussi à toute cette France moyenne joyeusement sabrée par l'éclosion du gigantisme industriel américain, synonyme, la plupart du temps, de chômage. L'Europe aussi, avec ses redistributions économétriques, à moi l'agriculture, à toi la sidérurgie (il faudra un jour analyser ces choix : pourquoi l'agriculture à la France ? réponse : parce que l'électorat paysan (et rural) est de droite. Pourquoi la sidérurgie à l'Allemagne et au Benelux ? réponse : parce que le monde ouvrier de ces pays représente encore la majorité sociale) remettait durement en question la justice sociale la plus élémentaire. Comment les salariés lorrains pouvaient-il admettre et comprendre la liquidation massive de leur outil de travail au profit de leurs concurrents belges et allemands. Parfois je me suis dit, dans ces moments lugubres, que l'élection de FM c'était seulement cela : faire faire par un socialiste le sale boulot qu'exigeait, soit-disant, la construction européenne, celle du Traité de Rome, la libérale. Après, on s'en débarrasserait sans problème, le pouvoir est par essence de droite, triste vérité. Et le scénario a bien failli se dérouler ainsi, ressemblant à s'y méprendre à celui de la Révolution des œillets au Portugal, révolution qu'on dit parachutée par le groupe de Bilderberg, la fameuse Trilatérale dont on ne parle plus depuis le succès médiatique des Conventions de Davos.
C'est pourtant l'Europe et sa problématique qui ont cimenté ma fidélité à FM, homme que je n'aimais guère car trop mêlé à la politique florentine qui marquait les premières années de la guerre d'Algérie. Il me répugnait par ailleurs physiquement, son masque ne parvenant pas à dissimuler une ambition dévorante, je me souviens avoir salué son mentor publicitaire qui, paraît-il, avait eu l'idée de lui faire limer ses canines. Le plus drôle c'est qu'il est arrivé la même chose à Chirac, le mal-aimé des sondages confidentiels et qui faisait peur aux Français. Il aura fallu attendre les Guignols pour lisser son image, le ridiculiser assez pour effacer cette image de l'ambition despotique et pathologique. Le Rire n'est pas le propre de l'homme, il est celui des Français. Bon, l'enjeu était devenu l'Europe pour moi, uniquement parce qu'il était devenu évident qu'elle se ferait, mais qu'il fallait encore décider quelle Europe on allait faire et comment. FM était la garantie d'une Europe démocratique et républicaine, c'est à dire que la réussite de la présidence socialiste devait servir de modèle, devait pour ainsi dire peser de manière décisive sur l'avenir du continent.
Inutile de souligner combien de reniements et de sacrifices intérieurs il aura fallu admettre pour rester fidèle à cette ligne. Dans mon service public la situation s'aggravait d'heure en heure, et certains proches de FM perdaient la raison dans l'exercice de leurs fonctions. Moi, je vivais l'Europe de demain, manière bien singulière de reporter la jouissance dans l'au-delà. Mais, en 2001, je dois dire que je ne suis pas si déçu par le résultat, je tire quelque bénéfice de ma patience des années 80 et 90, car l'Europe me paraît effectivement mieux engagée qu'on ne le pensait possible dans les années de plomb de la fameuse crise économique. Et cela est grandement dû au président François Mitterrand, qu'on le veuille ou non. Son travail symbolique a été considérable et son poids politique international étonnamment grand dans une conjoncture où la réalité se jouait de Reagan en Bush, et de Thatcher en Kohl. Tonton était un grand républicain, et personne ne pourra lui contester cette dimension, même si les débuts de sa carrière en font un nostalgique du légitimisme. Mais ces deux aspects ne sont contradictoires qu'en apparence, car la légitimité reste une valeur essentielle du sentiment républicain, comparable à celui de la fidélité au Sang royal. C'est son sens de l'honneur et son orgueil cornélien qui lui vaudront la plupart de ses démêlés avec l'histoire : de ses fréquentations de Bousquet à la gerbe de la tombe de Pétain, Mitterrand a refusé de renier ses choix humains mais aussi les devoirs de la Nation.
Il y a vingt ans, et aujourd'hui ? Oui, il faudrait encore ajouter combien FM a œuvré ou manœuvré pour en arriver à moderniser la France comme il l'a fait. Car il fallait encore réussir à sortir le pays à la fois de sa léthargie technologique et à la fois de sa léthargie sociale et fonctionnariste. Dont acte, quel que fut le prix de cette modernisation, elle a permis de tenir face à la mondialisation, car la réalité ne se laisse pas maîtriser seulement par des mots. La France d'aujourd'hui est encore largement celle de François Mitterrand par la force qu'elle a acquis durement et douloureusement. Et puis cet événement unique, qui a lui seul prouve le caractère historique du passage de cet homme à l'Elysée, le passage du budget de l'Ecole devant celui de l' Armée. Cherchez un geste civilisateur, le voici. Il suffit, paix aux cendres de François Mitterrand, il a bien mérité de la République.
Vendredi 11 mai 2001
A me relire (mentalement), je suis surpris par la tontolâtrie fieffée de mon souvenir du grand homme. Et pourtant, que dire des détestations que ce Maître m'a inspiré au cours de ces deux mandats, record extraordinaire dont on n'a pas encore faire le commentaire. Ce paradoxe me semble correspondre parfaitement au sentiment national, je suis bien un Français moyen, soumis pendant quatorze années à une douche écossaise assez pâteuse où il aura bien fallu s'inventer une sorte de stoïcisme politique constant afin de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, car le socialisme de pouvoir c'était bien un bébé et hélas le reste encore aujourd'hui, avec Jospin qui ne porte pas pour rien le sobriquet charmant de Yoyo. Je peux dire que j'ai été père, j'ai élevé mes deux enfants en même temps que FM tentait de faire pousser la plante socialisme dans ce pays d'anarchistes de droite. Je dois encore posséder quelque part dans un tiroir un objet frappé du fameux " génération Mitterrand ", et je pense que cette louisade du vingtième siècle est d'une vérité criante. Louisade = fait se référant à Louis XIV, hi hi ! FM réinventait le sujet socialiste sans socialisme, très fort et avec un succès dont on ne fera que mesurer à l'avenir la profondeur républicaine. Car si la République souffre par tous les bouts, pourrait-on dire, les Français n'ont jamais été aussi républicains qu'aujourd'hui, évolution tout à fait normale et qui explique que la France tient face aux puissances d'argent du monde entier, les mènent par la barbichette " sûre d'elle et dominatrice " hi hi hi !!! C'est sans doute ce dont l'histoire se souviendra dans quelques siècles à propos de FM, cette manière presque gaie de scier la branche sur laquelle il était assis, afin de faire prendre conscience aux Français que l'époque des institutions anciennes et stables étaient révolue, et que la pouvoir politique est bel et bien passé dans le citoyen lui-même, sans même qu'il le sache. Car aucun Président de la République, mais il faudrait dire aucun Chef de l'Etat, ne s'est discrédité à ce point systématiquement, comme si cela faisait partie de son plan. Une Louisade à l'envers, FM a défait le mythe monarchique, il a montré combien l'homme-sujet du politique, l'élu du peuple, le sujet de l'histoire n'était qu'un pantin comme les autres. La conséquence est une critique en acte du politique contemporain, de cette démocratie de représentation dont ce président fut, en apparence, le plus ardent défenseur.
Mais oui nous l'avons haï, fortement, sainement. Moi, ancien combattant des libertés socialistes (hi hi hi), je suis resté cocu, rien, rien à attendre de ce vieillard nationaliste qui a choisi d'emblée la France rurale, les ploucs, contre tout ce qui paraissait moderne ou avant-gardiste. En même temps qu'il libérait les chiens cultureux qui allaient aboyer la bonne nouvelle aux quatre coins du pays. Quel renard ! Quelle ruse historique quotidiennement palpable, oui florentin est le mot, c'est une des seules choses exactes qu'on ai pu dire sur cet homme du terroir. Mais je n'ai jamais voté contre lui, dans aucune élection même la plus éloignée de sa personne. Autodiscipline incroyable dans laquelle mes rapports avec les autres citoyens jouaient un rôle important, j'avais le sentiment de défendre exactement ce qu'il fallait défendre à ce moment-là, au-delà de l'homme détestable par bien des aspects. Bien sûr, la crainte de " les voir revenir " n' était pas sans importance, mais au fond j'ai aussi appris, au cours de cette époque, à estimer tactiquement le fait de prendre conscience de l'opposition. Autre acquis du mitterrandisme, sans doute : les Français auront appris à juger les droites, et cela envers et contre leur préférence viscérale pour ces mêmes droites. Le Gaulois a dû se démasquer, il doit aujourd'hui le faire, montrer qu'il a une préférence esthétique lourde pour les ors de la richesse matérielle et que le petit commerce de Stéphane Bern (vous connaissez cet histrion cathodique qui vient, paraît-il de se trouver des affinités avec l'actuel Président de la République ?) a encore de beaux jours devant lui. Mais cette vaste psychanalyse est tout à fait positive, car les sentiments sont une chose, et la réalité une autre. Admirer avec humilité nos têtes régnantes, ça va tant que le pain blanc est assuré et aucun Français ne se laissera jamais plus envoyer manger de la brioche en cas de pénurie. Le peuple français est l'un des moins sentimentaux du monde, peut-être aussi peu émotif que les Chinois, Tonton l'avait fort bien compris et avait cultivé adroitement cette disposition psychologique.
Décidément, je n'arrive pas à lui faire mal, à ce traître de Mai68, à ce dégonflé de la révolution, à cet homme profondément conservateur. Ca doit être ce qu'on appelle la transcendance, FM est hors d'atteinte, grand joueur ayant réponse à tout, renvoyant toutes les balles de l'autre côté du filet sans se préoccuper des conséquences. Il a sorti les généraux de leur opprobre d'anciens terroristes, et nous ? Il ne nous aimait pas, sans doute, il n'aimait pas ce qui dépassait de l'ordre républicain stricto sensu. Lorsqu'en 1943 il a opéré sa révolution culturelle et s'est engagé dans la Résistance, il a dû le faire à contre-cœur, mais en sachant que son choix était déjà majoritaire, il a haussé les épaules en se disant -" puisqu'il le faut, allons-y " - Mais pour la guerre d'Algérie, il a bien observé que la majorité des Français s'en fichaient royalement, et que les trublions qui résistaient n'étaient que des marginaux sans importance politique. A noter tout de même qu'il en a mis dans son entourage, de ces hommes-là, faisant une sorte de charité politique inspirée en grande partie par la générosité de son épouse. Mais le cœur n'y était pas, exactement comme pour le Général De Gaulle, qui laissait faire Malraux dans ce délicat problème de résistance non gaullienne.
Aussi, vais-je lui rendre le repos de la tombe. Après son élection en 1981, il nous a montré son souhait le plus profond, entrer un jour au Panthéon. Cela aura-t-il lieu ? Certainement, mais il faudra attendre que l'Europe existe enfin, car les Français sont aussi les gens les plus ingrats de la terre.
Samedi 12 mai 2001
Commerce équitable au menu de France-Culture. Ca tombe bien, je comptais parler économie ce matin et le nommé Guy Ascoett (orthographe ?), ponte du parti Vert, défend la notion, une notion dont la réalité s'impose certes, mais pas selon la volonté politique des écolos. Le développement du commerce équitable fait partie de ce que j'appelais le retour du Marché et de la marchandise, c'est à dire le déclin de la souveraineté de l'argent, des monnaies nationales. Dans cette économie, le problème n'est pas l'équité, mais le rapport des marchandises avec le désir. Car les écolos raisonnent toujours en dégradé de l'économie libérale où seule compte une certaine adéquation,
celle de l'objet et du prix.
Or, dans une telle acception théorique des échanges, on ne prend pas en compte le désir des agents économiques, ni celui des producteurs et encore moins celui des consomma(c)teurs, comme on les appelle. Il est évident qu'un consommateur occidental ne cherche pas seulement à faire la charité lorsqu'il choisit d'acheter plus cher un café américain ou un légume biologique. Il cherche aussi à se faire livrer autre chose que ce que lui propose les flux actuels de marchandises : ce sont les relations humaines dans leurs objets et leurs exigencesqui se transforment dans l'échange et non pas le contraire. Les écolos commettent la même erreur que les théoriciens de la communication qui estiment que le simple accroissement du nombre d'émetteurs et de récepteurs, ainsi que le progrès des technologies, va transformer la communication elle-même. Ceux-là oublient que derrière ces phénomènes d'accroissement et de mutation il y a le désir d'une AUTRE communication. Les deux ordres de phénomènes se rejoignent dans les faits, car ce qui est crucial dans l'économie, c'est bel et bien l'information des agents, à quelque niveau qu'ils se situent. Un marché ne peut exister dans le sens de Adam Smith que si l'information est parfaite : il faut la supposer parfaite pour imaginer un véritable marché régulateur qui produise tous ses effets naturels. C'est bien là que l'aristocrate britannique, qui pouvait bien s'imaginer qu'il était informé au mieux des conditions de l'époque parce que l'Angleterre était le véritable sujet de l'économie, s'est trompé sur l'état réel du flux des marchandises à son époque et de sa signification par rapport au politique et à la monnaie. L'information économique, elle-même, ne peut pas se contenter de porter sur les adéquations et la concurrence des prix, elle doit s'intéresser au premier chef à la valeur marginale, c'est à dire aux limites, aux franges du désir en tant que tel des objets du marché. Et ce théorème vaut autant pour le producteur qui doit se situer par rapport à une ambition personnelle que pour le consommateur qui cherche des objets qui correspondent à son désir et non pas des objets qui correspondent exclusivement à des modèles sociétaux de consommation.
Modèles sociétaux et politiques : si l'on examine le phénomène du développement de l'automobile, on constate que son rythme est contrefait, ou disons largement artificiel et lié à des stratégies politiques, d'économie politique. Certaines nations y ont vu une poule aux oeufs d'or, et se sont empressé de mettre en chantier une politique systématique de développement, qui comprenait entre - autres l'externalisation des usines, la décentralisation de la production et l'éloignement systématique des lieux de travail des lieux de vie. L'usage hédoniste de la voiture n'est qu'un aspect marginal de sa valeur d'usage, et on peut affirmer sans se tromper qu'elle est entrée dans la catégorie des marchandises destinées à permettre la production, à recomposer la force de travail. National 7 c'est du passé, car même cet usage vacancier de l'auto s'est transformé en travail de reconstitution de la force psycho - sociologique des salariés. Travail ! Tripalium !
Maintenant l'économique en tant que tel. Existe-t-il quelque chose comme une économie indépendante, réalité autonome (marché) qui constituerait cette main invisible qui règle les échanges humains ? Impossible car il signifierait l'existence d'un monde parallèle au mien et à celui de tous les hommes, une transcendance en fait qui ne veut pas porter son nom. Ce serait beau, aussi beau que les Lois de la Nature dont on a depuis longtemps compris qu'elles n'étaient que ce que nous en faisions. On me répondra que je raisonne ainsi parce que je reste prisonnier de mon monde à moi. Certes, comme tout le monde ! Non il n'y a pas de réalité indépendante de l'esprit humain : il y a quelqu'un derrière tout ce qui se passe, il y a un sujet à tout. Le fait que l'ensemble donne l'impression du chaos révèle seulement que le chaos est la règle du désir parce qu'il est pluriel par essence, mais à chaque instant il y a un auteur de la réalité, un homme qui décide. Le politique est inventé par les Grecs à cause de cette évidence, comme ordre dans le chaos et non pas comme réalité séparée des autres soucis. La fameuse dichotomie d'Annah Arendt entre Polis et Oikos, la Cité et la Famille (c'est à dire l'économie) pourrait s'avérer entièrement fausse, et son aristocratisme personnel n'est sans doute pas étranger à une telle conception de la réalité et de la combinaison (refoulée) de l'économie et du politique. Qu'ils mangent donc de la brioche ! Le marché est donc victime d'une barbarie naturelle, la pluralité du désir, et seul le politique peut fonder des valeurs de reconnaissance d'un désir à l'autre, opération de communication essentielle si l'on a en vue une idée de "marché" ou d'ordre commercial. Le politique dégage l'espace pour le désir : il n'existe aucun désir collectif, autre approximation des gens de gauche qui leur a coûté cher ces dernières années. Le politique ne peut pas faire l'économie de la singularité du désir, il ne peut le faire que dans la forme despotique ou totalitaire. Le succès du roman Cent Ans de Solitude de Gabriel Garcia Marquez repose peut-être entièrement sur le fait qu'on peut aussi aimer et désirer manger de la terre !
Mardi le 15 mai 2001
On pourrait dire, et je suis sûr qu'on l'a dit, que Valéry (Paul) était malade de lui-même. Et c'était vrai, contrairement à son ami Bergson. Mais que signifie cette égopathologie du poète mathématicien, est-ce vraiment une maladie ? C'est énervant, il faut reconnaître, écoutez : - "
Dégoûté, écoeuré - de moi, je me prends et me jette par terre à plat ventre, bras étendus. Mon cerveau / organe de l'esprit / s'envoie avec tout le reste au sol, aux choses jetées, aux poussières, à l'humilité littérale, à la vie la plus minime - avec l'espoir / force / de ne plus penser, et que ses regards soient deux cailloux.
- (Cahiers Ego). Ce féroce athée se comporte comme un anachorète chrétien parce qu'il se hait, on dirait du Pascal, avec cette nuance fondamentale, Valéry se hait parce qu'il ne se reconnaît pas. Pascal se connaît trop bien. Il sait qu'il est l'enveloppe ou le véhicule du mal, quelles que soient ses vertus et ses intentions, quelle que soit la pureté concrète de ses actions. Valéry n'arrive pas à être lui-même : son esprit est infirme, amputé de lui-même par le despotisme, il faudrait dire totalitarisme, des universaux. Paul n'arrive pas à assumer sa singularité sans trahir ses principes d'enfant de coeur. -"
Si "ma conscience" ou l'Impératif catégorique se lève et dit à mon désir : Ne veuille pas ceci, ne fais pas cela -, il y a un autre Impératif non moins catégorique qui demande : pourquoi ?
"- (ibid) . La victime ne fait pas que réfuter ici une thèse philosophique, il vit réellement un drame intellectuel dont l'origine est dans la reconnaissance d'un autre désir que celui des Principes. Les principes s'en prennent à la spécificité du désir de Valéry. La singularité de ce désir lui est dérobée, or cette singularité a valeur d'universel, et Valéry le sait, il s'agit d'une contradiction logique intolérable, il s'agit du tragique lui-même. En quelques lignes, que Paul avait l'habitude d'écrire le matin entre cinq et sept heures, il trace le destin humain, sur cette base si fragile de la subjectivité, la cartésienne poussée à ses limites, au-delà de Fichte et de Stirner. Seul Nietzsche l'accompagne dans ce drame égologique, et peut-être Lacan, Lacan qui ne parle que rarement de Paul et ne lui paye pas toutes ses dettes théoriques (mais il se peut que je me trompe ?.. dans ce cas je demande pardon).
De quoi retourne-t-il ? De l'essentiel. Il y a un Bien, et il y a un Mal. Mais au-dessus de ces deux (quoi ?, valeurs ? idées ? concepts ? emmerdements ?) il y a le Moi. Et ce moi ne fait le bien que dans son intérêt et, le plus souvent, commet le mal pour le plus grand bien, bref, ego n'a rien à voir avec la morale universelle, avec la morale qui se dit dans le langage, qui se définit dans la logique spatio-temporelle des catégories a priori. Il y a un conflit absolu entre les catégories et le Moi. Absolu veut dire sans issue, sans résolution dialectique, Valéry est condamné à assumer ce gouffre ouvert en permanence entre lui et lui, entre ce qu'on a fait de lui et ce qu'il est, entre ce qu'on veut de lui et ce qu'il veut de l'existence, entre ce qu'il peut faire et ce que l'existence demande de lui, exige de son esprit unique. Il n'est pas l'UN (et sa propriété), car l'UN c'est l'UN universel, celui qui comprend tout, et donc la Loi morale quasi automatique du langage, le sentiment inné de l'universel Bien. Il est Paul, avec seulement la pureté de son être singulier, la pureté de la singularité. Il faut comprendre :
la singularité est toujours pure.
Elle n'a besoin d'aucun rapport pour faire état de ses vertus, elle est vertueuse par elle-même. Et c'est le secret de l'aristocratisme que dévoile ainsi cet aristocrate du peuple : le Roi dispose de la vertu absolu parce qu'on a cultivé sa singularité, parce qu'on n'a jamais osé s'en prendre à ses désirs les plus insignifiants ou les plus universellement répréhensibles. L'éducation des nobles, que Rousseau tentera de rendre à Emile, c'est cela, la culture de la singularité sacré du corps royal, de l'égo de tous. Comprenez, c'est ainsi que je le comprends : l'harmonie originaire, édenique, c'est l'harmonie naturelle des singularités : l'être est bien le mur de monades entrevu par Leibniz, mais de monades intouchées, non aliénées par les stratégies linguistiques des égos confrontés entre eux. Projet historique : rendre à chacun sa singularité, voilà une lumière dans la confusion des théories de la communication.
Mercredi le 16 mai 2001
C'est pourquoi il est vrai que je projet de Lacan est central, essentiel. La psychanalyse parle d'une guérison ontologique et non pas d'une simple disparition des symptômes pathologiques de l'être en société : elle retaille le langage du sujet (barré) qui se réaproprie sa propre parole. Que signifie se réaproprier sa parole ? C'est d'abord la comprendre dans ses formes aliénées, c'est apprendre à comprendre ce sur quoi on se trompe depuis toujours dans les formes mutilées de la parole. Mais d'abord qu'est-ce-que la parole elle-même ?
Rude question, et pourtant d'une grande limpidité. La parole est le don du moi, c'est la partie du moi que le moi offre à autrui, opération que certains grands philosophes nomment de préférence le Dire plutôt que le communiquer ou le signifier. Voir Heidegger ou Lévinas. Le Dire dit l'être du moi, la place de la brique ontologique dans le mur des monades, mais la place exacte de cette monade singulière qu'est le sujet unique. Si on précise qu'il s'agit d'un Dire, c'est qu'il n'y a pas lieu d'en changer quoi que ce soit, d'en corriger tel ou tel aspect : le sujet se dit dans sa pureté singulière, depuis sa place dans le mur et dans le respect des aspérités de la pierre qu'il constitue naturellement et qui le lient naturellement aux autres éléments du mur. La Nature n'est rien d'autre que cette état brut de la partie d'être que constituent les étants dans leur singularité. D'où toute une méditation intéressante sur la pierre taillée et la pierre brute, sur les dangers de la taille et son sens, sur le retour d'un absolu ou d'une vérité de la pierre brute et de l'histoire de ce geste lié à la sédentarisation, la taille.
Car le langage tel que nous le connaissons est un langage taillé dans les stratégies singulières aux prises les unes avec les autres : la souveraineté n'est rien d'autre que le monopole des significations sur le langage collectif. Oh que c'est mal dit ! Voyons : le Roi donne le sens aux mots et ces mots fonctionnent collectivement selon ce sens, c'est pourquoi la culture a mauvais genre, elle est le travail des clercs au service du souverain. Tout cela est un peu caricatural, mais il faut penser dans une perspective dynastique et surtout symbolique, réellement culurelle au sens du religere, de cela qui relie les hommes entre eux. Le langage. Pensez, par exemple, au destin d'un mot comme l'Etre ! Comment a-t-on pu s'aveugler pendant plusieurs millénaires au point de faire passer un verbe pour un substantif ? Comment un dieu pourrait-il être un Etre ? En fait, nous savons tous qu'il s'agit d'un raccourci sémantique. En disant l'Etre divin, on signifie ce par quoi l'étant est, ce qui transit l'étant dans son être, et cela devient l'arkè ou l'origine ou encore la Création. Bref, le vocabulaire se popularise selon la compétence du souverain ou les intérêts des clercs, de ceux qui ont participé à la formation du Souverain tel que nous l'entendons, le souverain Absolu de l'époque moderne. Bien sûr, dans l'Histoire, les souverainetés et leurs formes particulières s'imbriquent les unes dans les autres et se masquent parfois, mettant souvent les concepts eux-mêmes en difficulté. Exemple : les Anglais ont réussi à faire admettre au monde entier l'expression "monarchie constitutionnelle", expression qui est une contradiction dans les termes. La signification s'est imposée grâce au poids historique de l'ensemble anglo-saxon, mais si elle avait une quelconque légitimité ontologique, alors on ne pourrait pas comprendre pourquoi les Anglais d'Amérique se soient débarrassés de cette forme politique. On peut en revanche mieux saisir les raison pour lesquelles la Constitution américaine repose tant sur une légitimité biblique. Le roi d'Amérique n'est autre que le Dieu judéo-chrétien. Je ne veux pas entrer dans une discussion philosophique à propos de cet exemple, mais il me semble bien illustrer ce qu'une stratégie particulière (singulière) peut, dans le langage, imposer une signification aléatoire aux mots.
Il faut alors se représenter le dictionnaire de chacun, c'est à dire sa taxinomie particulière, comme un degré de sa servitude. Servitude dans la structure de pouvoir présente, mais aussi comme résultat de la sédimentation des significations successives et de leur interaction les unes sur les autres. Je pense qu'il ne serait pas difficile de trouver des exemples de "redressement" sémantique culturel qui rendent à certains mots des significations qu'ils ont acquis dans le Haut Moyen-Âge, envers et contre toute logique historique, seulement parce que le clerc qui opère choisit cette signification-là. L'herméneutique est d'ailleurs la science du rapport entre l'homme et son langage, mais seuls les Juifs la maîtrisent parce qu'ils refusent d'annuler les significations antérieures au profit d'un bénéfice immédiat : les différentes significations renvoient aux changements du temps mais ne s'annulent jamais les unes les autres. Il n'y a qu'un seul Dire, la Thora.
Jeudi le 17 mai 2001
Non. La Thora n'est qu'un Dire-modèle. Elle est l'idée-même de Dire au sens où la Parole de Dieu est l'expression absolue de la singularité parfaite : la parole prophétique est l'écho de la voix de Dieu. Dieu est le singulier en tant que tel, l'universelle singularité. Symbolique tout cela, mais vrai. Toutes ces vérités ont été mises en conserve, cachées aux yeux du vulgaire, substantifiées sous des formes les plus ridicules les unes que les autres, Enfer, Paradis, Anges et Démons. Cette manoeuvre fait elle-même partie des stratégies linguistiques de domination effectivement facilitées par l'écriture.
L'écriture est la jurisprudence des significations.
Or, la jurisprudence n'est pas une sorte de Talmud qui se nourrit de l'étude quotidienne ne varietur , elle est adaptation politique des régimes sémantiques qui se suivent selon les transmissions ou les prises de pouvoir. Pourquoi ne pas dire les choses plus simplement ?
En effet, étant donné que le plus simple est toujours le plus dur à comprendre puisque la compréhension est d'abord un comportement d'acceptation, de soumission : en saisissant une signification qui vous est faite, vous manifestez d'abord votre reconnaissance du pouvoir de Dire de celui qui parle. C'est pourquoi il vous demande - " Vous saisissez ?"- Sous-entendu : -"c'est moi le patron dans ce dialogue, et c'est moi qui fixe les règles du parler"-. L'écriture, elle, atteste de l'existence permanente d'une signification, d'où la création des Dictionnaires et le fait que ce sont les Etats qui garantissent, par le biais d'institutions comme l'Académie, la validité des significations. Je me suis récemment adressé au Comité Nobel pour savoir comment étaient choisis les candidats à un Prix de Littérature. Réponse immédiate : c'est par un faisceau de "voix autorisées" provenant de diverses institutions "autorisées" que parviennent les suggestions de remettre le Prix à tel ou tel écrivain. J'ai donc demandé à quoi renvoyait l'"autorisation" en question, pas de réponse. Et il ne peut évidemment pas m'être répondu à une telle question puisqu'elle est platement politique, en contradiction absolue avec l'idéal du Prix. Là-dessus on pourrait encore discuter, et admettre que les initiateurs du Nobel, les inventeurs de la dynamite, ont voulu cyniquement ne pas sortir du cadre des significations régnantes, ce qui peut nous faire penser qu'Hitler aurait pu recevoir le Nobel de Littérature voire de Paix, si son pouvoir politique s'était consolidé au lieu de se dissoudre.
D'où aussi le pouvoir exorbitant des éditeurs, le pouvoir sans doute le plus totalitaire qui soit, ils sont les véritables gardiens des significations et du jeu possible entre-elles, ils décident de la liberté d'écrire, mais aussi de penser. D'où le succès des romans à l'eau de rose auprès des masses : ces écrits ne mettent rien en jeu, n'offrent qu'un commentaire anecdotique du réel et ne se permettent pas d'interpréter ou d'entreprendre quelque opération véritative que ce soit. Monsieur Guy Des Gares, comme on l'appelait, raconte ce que le peuple voit et entend toute la journée, il offre une interprétation factuelle du réel, mais jamais un sens ou une signification exacte autrement que par suggestion logique, inférence dont il s'abstient concrètement mais qui se lit toujours en filigrane selon les canons officiels des significations. Si son sujet rapporte l'histoire tragique d'une fécondation in vitro, il restera ambigu dans ses conclusions, le pouvoir n'a pas dit son dernier mot sur cette pratique et il ne convient ni de la condamner ni de la glorifier, mais si la suppression des "naissances sous X" est à l'ordre du jour, on peut être certain que l'auteur nous tricotera un scénario bien baveux sur le tragique destin des orphelins de conscience.
Tout cela peut passer sous la rubrique idéologie. Bon, mais encore faut-il préciser que l'idéologie commence à l'échelon le plus simple de la pratique du langage, de la parole et de l'écriture, c'est à dire dans la définition des éléments du discours. D'ailleurs il fut un temps ou l'orthographe jouait le rôle de censeur, car l'orthographe témoignait du degré d'intégration (d'agrégation) de l'auteur. Elle était (et le reste très largement) la patente d'écrivain public, autorisé, et cela se comprend aisément au sens où la grammaire commande bel et bien la logique des significations et le vocabulaire leur effectuation : écrire lettre avec deux t signifie non seulement que l'on accepte une convention formelle, mais que l'on accepte la parole qui a posé originairement la signification liée à cette forme. L'orthographe est une attestation de complicité !
J'arrive à la septième cigarette du matin et il faut donc que je conclue, provisoirement, car cette discussion est la plus essentielle qui soit. Ma conclusion portera sur le constat d'une dégradation générale du Dire : l'Histoire de la socialisation des êtres humains est celle des outils de cette socialisation, la Parole et l'écriture. On peut être certain que l'homme nomade d'avant le néolithique était un homme silencieux, un peu comme le sont encore les Touaregs, silence qui marque la crainte et le respect de la liberté de l'Autre, la conscience du danger immense qu'offre toute Parole à cause de son ipséïté naturelle, c'est à dire la condamnation de chacun à la singularité de son intelligence du monde. Ce que parler veut dire c'est la place que j'occupe dans le maniement des unités formelles du langage, c'est ma souveraineté sur le sens. Dégradation signifie dans mon esprit que les langages se sont de plus en plus détachés de leur sens initial de gérant de l'altérité pour devenir des outils de pouvoir et de régulation collective de ces pouvoirs. Banalité. Or, notre temps est aussi celui de l'inflation des langages. Chaque jour un nouveau langage naît dans les technologies qui jouent avec les significations : nous vivons un crépuscule des taxinomies officielles, une atomisation du langage qui recoupe l'atomisation de la société. L'Homme récupère ainsi sa liberté de penser à cause de l'impossibilité technique de contrôler la circulation des messages. Si un chanteur de rap en dit aussi long sur telle aspect du destin humain qu'un long pamphlet philosophique, alors le courage éditorial revient à chacun, chacun se dit qu'après tout il n'est pas obligé de se plier au diktat des significations officielles, ni à l'imprimatur qui va avec. Internet est aussi devenu un lieu anonyme, un désert ou une vaste étendue pour nomades, où se font de nouvelles rencontres du premier type, où l'on réapprend à se parler en-dehors des canons politico-religieux de la Parole autorisée. Bonne journée !
Vendredi le 18 mai 2001
J'avais entamé un commentaire du problème des irrédentismes (Corse, Pays-Basque etc..) à la lumière de mes considérations linguistiques qui précèdent. Il me paraissait particulièrement évident que l'on se trouve là au coeur de ce que soulève la relation de souveraineté ou de domination à travers le langage. La revendication des langues régionales est évidemment une revendication qui entend rompre avec la logique du langage dominant, en l'occurence le Français. La spécificité de cette problématique en fait, cependant, une illustration de ce que Lénine appelait le développement inégal. Le Corse ou le Basque sont bien des langues singulières, mais elles le sont dans un contexte tribal, c'est à dire que l'on se trouve dans un segment d'histoire passé et pas du tout dans le défi du langage singulier individuel. La revendication de la langue régionale ne peut aboutir à mieux qu'au rétablissement d'une autorité fantôme, volonté qui ne manifeste qu'une seule chose à savoir se soustraire au règne de la langue métropolitaine, car les langues résiduelles n'ont plus de colonne vertébrale sociale. La langue Corse n'a plus de maître, et tout ce à quoi elle pourrait aboutir à être à nouveau répandue systématiquement, c'est une sorte de complicité clanique sans objet, purement sentimentale. Or cette nouvelle situation communautaire ne change rien à la dynamique universelle de l'individuation linguistique. C'est pourquoi Jean-Pierre Chevènement a tort de s'arquebouter sur les principes : il me paraît difficile de reconstruire une plastique linguistique efficace à partir des résidus globalement décrochés des réalités essentielles, et d'abord parce qu'il n'y a pas de volonté clairement consciente d'elle-même capable de mettre en place une véritable stratégie de conquête linguistique, les maîtres compétents font défaut.
Bien sûr, tout cela fait désordre, mais l'expérience montre dans certains pays dont on ne parle pas souvent (l'Allemagne possède aussi ses régions linguistiquement limitrophes, comme le Nord frontalier avec le Danemark) que l'enseignement des langues régionales, des patois, ne dérange en rien l'ordre dominant. Le patois rétablit une sorte de convivialité festive qui ne fait pas d'ombre au fonctionnement général de ces micro-sociétés qui n'en sont pas réellement. On aboutit à une sorte de double praxis linguistique telle qu'elle existe très fort en Alsace, sans qu'elle remette en question la conscience d'une nécessité absolu de préparer son destin dans la langue dominante. Il est curieux, voire assez drôle, de constater que les speakers de l'une des principales radios bilingues en Alsace, se piquent de parler un Français parfait, tellement travaillé qu'il en paraît comiquement snob. C'est dire si la férule idéologique du Français fonctionne parfaitement et qu'il n'est pas question de s'en prendre à la langue de la République.
D'ailleurs ma thèse sur le langage ne laisse pas beaucoup d'espace à la langue en tant que phénomène indépendant. Laissons donc les Corses parler le jargon qui leur plaît, cela ne changera rien. Cela risque même de changer si peu de choses que cette nième réforme décevra autant que les précédantes, car le problème de la violence en Corse est ailleurs, je l'ai, je crois, déjà amplement décrit. En bref, la violence a une place réelle dans les relations tribales en tant que ce que l'on pourrait appeler de la tauromachie sociale : la violence est initiatique, et je ne vois pas quelle pratique linguistique pourrait changer quoi que ce soit dans cette pratique non-contingente et structurelle. En fait, la tactique des gouvernements successifs est de plâtrer au fur et à mesure en attendant que la structure change en se dissolvant, ce qui a effectivement des chances d'arriver si le développement de la Corse finit un jour par prendre son vrai départ. L'insularité est un problème universel, voyez l'Angleterre et le Japon ! Mais les Corses sont malins, ils ne tiennent pas tellement à ce que leur beau pays soit laminé par le tourisme plus qu'il ne l'est déjà, et là des sentiments très divers se mélangent, les uns plus légitimes que les autres : bientôt ce seront les nationalistes qui plastiqueront les cabanons de plage au non de l'écologie ! Bof. Comedia humana ! Un mot encore sur le cas Basque, qui me paraît beaucoup plus inquiétant. Là les choses sont différentes au sens où l'on ne peut pas parler de tribu, mais il faut bien admettre qu'il y a un peuple qui n'a aucun problème linguistique ou économique. Les Basques étaient déjà redoutés des Romains pour la violence de leur rejet de l'Empire. Il est facile d'imaginer combien la permanence culturelle de ce peuple et celle de son opposition à la civilisation marchande libérale conforte naturellement son désir d'indépendance. On vient de voter et les commentaires s'empressent de démontrer que les nationalistes ont perdu, en réalité rien n'a changé dans la structure politique et le nationalisme dit modéré a fait son plein habituel, le masque reste en place.
Samedi le 19 mai 2001
Nomadisme et singularité. Ce matin une question de méthode s'est présentée à moi : comment s'imbriquent dans mon esprit ces deux, ces deux quoi ? ces deux idées de l'Homme ? Ces deux requisit de toute pensée de l'histoire humaine ? Mais plutôt que de parler d'imbrication, je préfèrerai rechercher la généalogie de cette pensée dans ma vie, c'est sans doute plus intéressant qu'une spéculation métaphysique abstraite, même si on n'y coupe sans doute pas. L'eau de mon baptême est la catholique. Je ne sais pas comment mes parents, surtout ma mère, s'y sont pris pour former chez moi cette représentation si parfaite dans mon enfance de mon âme. J'ai parlé longuement de cela dans mon premier ouvrage qui porte le nom de Deuxième Entretien Préliminaire et qui retrace mon ontogénèse spirituelle ; mais, ce texte reste encore beaucoup trop spéculatif, malgré les anecdotes personnelles qui, en réalité, forment plutôt des descriptions de situations très générales. Le résultat es très classique, au point que le thème nomade en est absent, et que celui de la singularité ne surgit qu'à la proximité de ma tombe, et encore... J'ai l'impression que je n'avais encore rien compris à rien. Pourtant, le fond de mon propos était prometteur, il mettait en scène, pour commencer, le mensonge social et religieux. Gouffre entre les attentes suscitées chez moi par l'ambiance de ma petite enfance et les résultats qui se présentaient au fur et à mesure dans ma vie, j'allais dire ma recherche. En gros, les choses se sont passé ainsi : mon âme était censée former une quantité abstraite de substance divine dont le remplissement cognitif était à la charge des autres, était garanti par mon environnement humain. C'est avec un énorme plaisir que j'ai entamé mon Ecole, non pas la Maternelle qui me paraissait précoce en regard de mon besoin de proximité avec ma mère, mais la grande école, celle où m'allaient être délivrés les grands secrets de la vie. Car mon enfance est traversée par une tension très vive, un étonnement très laïque qui se jouait en solo, pour ainsi dire, à côté des dogmes que j'enfilais dans mon esprit comme des perles décoratives. L'âme, oui c'était bien, c'était beau et surtout assez effrayant pour séduire mon besoin d'émotion, mais il y avaient mes yeux et mes oreilles, et ma peau qui exigeaient leur part de savoir. Très banalement c'était le ciel qui m'ouvrait, la nuit venue, à cette dimension mystérieuse de ce qui m'arrivait. Déjà mes voyages spatiaux laissait mon âme à la maison, et je sentais bien qu'il y avait là bien autre chose que les épisodes de la Bible que par ailleurs je suivais avec passion dans mon catéchisme. (en passant : c'est une grande erreur du catholicisme d'avoir abandonné au fil des siècles le commentaire de l'Ancien Testament dans sa pédagogie au profit des récits christiques aux rebondissements ahurissants d'irréalité) Bref, une coupure se faisait entre deux modes de relations avec le monde qui se construisait autour de moi. Il y en avait deux, en fait, de mondes et je constatais très jeune qu'aucun des deux ne voulait entendre parler de l'autre. Je me retrouvais donc dans une réalité schizophrénique très tôt et il fallait bien qu'à un moment ou à un autre ça bascule.
Toute une Histoire se répétait en moi. Celle du mensonge chrétien, sa féroce liquidation des sources grecques et latines, sa censure absolue de tout élément oriental ou extrême-oriental, Iran et Chine. La question du ciel était éludée en permanence et je me retrouvais dans l'univers fixiste des mauvaises interprétations d'Aristote alors que tout tournait déjà dans le bon sens. Autre erreur de l'Eglise de Rome, de prendre ses ouailles pour des imbéciles incapables de distinguer des contradictions aussi flagrantes que celles-ci. Surtout les jeunes esprits, intouchés, purs de toute distraction émotionnelle ou sensuelles. Avec les adolescents c'était évidemment beaucoup plus facile, avec la torture du péché, ça passait ou ça cassait. Or ce mensonge n'était rien à côté de l'autre, celui de l'école où j'avais placé très tôt toutes mes billes. Hélas, apprendre sèchement que le seul bien était la connaissance mais que la sagesse était finalement la reconnaissance de son ignorance, il fallait le faire. Des années d'espoir tout à fait légitimé par des millions de promesses qui finissent par le dit de Socrate : - ce que je sais c'est que je ne sais rien - ! quelle escroquerie manifeste ! Et comme on distingue bien la main du Christianisme derrière cette conclusion, forclusion faudrait-il dire, piège satanique de lumière noire. ILS ont gardé de la tradition antique juste ce qu'il fallait pour achever le travail, faire en sorte que l'immense hybris de connaissance qui s'écoule dans la jeunesse de l'Homme, finisse en eau de boudin tout en conservant un certain prestige, celui d'un Platon passé à la moulinette et dont nous ne possédons que les oeuvres qui se vendaient dans les gares d'Athènes et de Sparte... Les autres, qui sait, ne sont peut-être pas plus loin que les caves du Vatican...
Il restait le bâton de pèlerin, partir, retourner pour commencer dans ce berceau de la Civilisation que reste la Grèce et contempler à nouveau frais les aubes et les crépuscules. Et puis tout le reste, ballotté entre les mensonges politiques et la Loi morale, entre la nécessité de la complicité patriotique et la liberté aléatoire du refus. Je devins un nomade. Un nomade total, esprit et corps, émotions et sentiments, douleur et plaisir, détachement inouï de toute étance collective, de toute appartenance, de toute propriété commune. En même temps, ce qui était déposé en moi d'instinct sédentaire se réfugiait dans le langage, dans mon discours se précisait par le fil de la lame des livres, la connaissance du projet de la vie sédentaire. Et puis, quelque part dans mon être le motif insistant d'enfants à venir, à voir venir et à vivre, et donc la fin des pérégrinations, il fallait jeter l'ancre, dont acte.
Tout cela sur fond de recherche du Graal, du comment ça se passe, comment ça fonctionne, du pourquoi c'est plutôt que pas et caetera... Et tout cela seul. Mes amis des universités se méfiaient de moi, retenaient leur savoir et leurs passions dans leurs coffrets tels des Harpagon, là encore il fallut pérégriner seul et affirmer, afficher ses résultats seul, assumer la singularité de ce que je découvrais, me saisir moi-même dans l'être comme rien de moins que son enfant, légitime. En mémoire de mon père je ne dirai pas que je suis né sous X, mais cela ne change pas grand chose à une réalité beaucoup plus générale de telles naissances. Nous sommes tous nés sous X, il faut assumer.
Dimanche le 20 mai 2001
Curieux comme cette logique me poursuit. Ces derniers jours je rêvasse à une maison dans la forêt, celle de près de chez mon grand-père dans le piémont vosgien côté Haut-Rhin, où mes premières années de vie se sont gobergé des premières lumières et des premières odeurs de la vie. Je vois des murs épais et une petite Stub chaude, peut-être avec un évier en pierre surmonté d'une pompe à bras directement branchée sur la nappe phréatique. Un grand lit, haut, surchargé d'édredons en duvet d'oies de Pologne et d'oreillers divers et profonds comme leur rêves, sur un matelas de crin de cheval protégé de laine et capitonné solidement. Le crin vit avec votre sommeil et vos jours, il se plie et respire et se fatigue avec vous, mais seule la poussière en vient à bout, et alors on appelle les matelassiers, comme Bourvil ! quel pataquès alors ! Et un jardin sauvage où je pourrai voir la terre gonfler de mes attentions, se soulever autour des tiges fraîches où s'arrêtera alors mon souci. Mais avant tout, l'odeur des feuilles mortes sous la futaie tigrée de soleil où je me coucherai parfois, nu et abandonné, laissant monter la sève de être dans le silence des sous-bois.
Et puis, j'ai un beau voilier, Ustica. Il y a en lui plus de promesses que de rendus, mais partir, larguer, oh que j'aille à la mer ! Vous savez ? La côte s'éloigne et bientôt on ne voit plus rien, que l'horizon, et alors on peut aller par ici ou par là, tourner en rond, s'arrêter et rêver, se réserver des demi surprises même en cachant le GPS le mieux possible. Le mystère de la navigation n'est pas bien grand, il suffit de regarder le soleil ! Mais le monde n'est pas fait d'espace vide, il est fait de pistes et de lieux-dits, la moindre vague porte un nom, et bientôt le vrai marin les connaît tous. Alors ?
Terrien, marin, sédentaire, nomade ? Quoi ?
Mercredi le 23 mai 2001
Jean-Louis Gombault sur France culture se démène pour initier son public au marché. C'est incroyable comme la théorie sécrète la langue de bois chez les gens les plus distingués ! Une langue de bois qui s'ignore, bien entendu. Le langage théorique (de l'Economie) s'est fabriqué des catégories qui masquent la réalité qu'il faut voir (ou qui désigne ce qu'on ne peut pas voir). Ainsi, la théorie reconnaît globalement le caractère politique du marché qui reposerait sur le "duel" de Clausewitz. Fort bien, et on ne peut qu'applaudir à cette tautologie. Elle décrit aussi avec gourmandise les événements qui marquent l'évolution de ce duel, événements dont le plus lourd de conséquences est toujours présenté comme la décision de Nixon en 1971 de décrocher le Dollar de la parité or, c'est à dire de la garantie universelle de la valeur de la monnaie américaine. Encore mieux, mais là déjà, JL Gombault ne prononce même pas le nom de Nixon, comme s'il s'agissait d'un événement transcendant, d'un acte quasi naturel qui marque, non pas la volonté impérialiste de Washington et son désir de soumettre le marché mondial au Dollar, mais une fatalité économique qui fait partie de la logique du duel de Clausewitz ou de Hobbes. On ne veut pas reconnaître un crime économique justiciable d'un tribunal international, on ne voit qu'un "coup" habile dans un jeu mondial, sans même signaler que ce coup va permettre aux Américains de vivre pratiquement aux crochets du reste du monde pendant les trente années à venir, et sans signaler qu'aucun protocole du type Bretton-Woods n'a précédé la décision de Nixon, laissant entendre que l'époque de la concertation internationale sur le fonctionnement du marché monétaire était passé, que Washington s'est émancipé de toute négociation et de tout dialogue avec le monde. Il faut ajouter que Bretton-Woods est un accord politique, un Traité en bonne forme que la décision de Nixon viole sans autre, là-dessus aussi, le silence. Pire, reconnaissant la progression rapide de la part de marché international dans l'économie mondiale, l'orateur ne dit pas que c'est dans cette conjoncture précise que les USA retirent leurs billes du jeu, en disant aux autres de se démerder avec les conséquences de l'évolution de leur monnaie, devenue entre-temps monnaie de compte de la plus grande partie de ce marché. Il aurait aussi, l'orateur, pu indiquer comment, par la suite, la FED s'y est prise pour piloter le marché à partir de cette nouvelle situation du dollar : aujourd'hui il est devenu banal de suivre les mouvements de yoyo des taux d'intérêt en fonction de la flottaison plus ou moins profitable du dollar. Il suffit de manipuler ces taux à Washington pour porter le Dollar à la valeur qu'on souhaite et dont on a conjoncturellement besoin. On ne commente même plus cette manière de Diktat purement intérieur à l'Amérique mais qui exporte ses conséquences aux quatre coins du monde. On sait que la Dette extérieure US est vertigineuse, et elle l'est structurellement, c'est à dire que même lorsque la valeur du dollar vient alléger cette dette en passant par exemple de 8 à 6 francs (voyez l'écart ! (et pensez à ceux qui, sur le moment sont les victimes d'un tel ajustement !), ce remboursement qui n'en est pas un, ne change rien sur le fond, les fluctuations de la monnaie permettent seulement à chaque augmentation de reprendre un peu d'oxygène dans un déséquilibre constant : lorsqu'on achète plus qu'on ne vend, on ne peut pas résorber le déficit quoi qu'on fasse.
En réalité, la théorie répugne à désigner des personnes, des faits concrets et des responsabilités morales claires, quand bien même elle reconnaît le caractère politique de tout l'ensemble. Car de deux choses l'une : ou bien on pose l'existence d'un marché non politique, d'une utopie économiste bourgeoise (bourgeoise parce que le marché appartient à la classe bourgeoise), et alors on ne mentionne même pas des décisions comme celle de Nixon et on les tient pour négligeables, ou bien c'est le contraire, et alors on est dans la lutte politique et ses conséquences qui peuvent aller jusqu'à la guerre comme nous le rappelle Clausewitz.
Pourtant, l'histoire récente, les guerres qui ont ensanglanté les Balkans ou encore les massacres Ruandais, a abouti à une évolution des mœurs judiciaires internationales, à la création et au fonctionnement réel de tribunaux internationaux punissant les crimes contre l'humanité. Et dans ces prétoires, ce ne sont pas des Nations ou des gouvernements que l'on juge, mais des personnes. Pour la première fois dans l'histoire du monde (et l'exemple de Pinochet en est une remarquable illustration), on désigne des responsables ad hominem. En fait c'est un autre fait politique qui est à l'origine de cette innovation, à savoir le procès Eichmann et dans une certaine mesure le procès de Nuremberg lui-même. On voit aujourd'hui que l'histoire ne se satisfait plus de l'anonymat des institutions, l'enquête mène à
un
Homme, et c'est un individu précis qu'elle cherche et qu'elle inculpe. Ah si cette science pouvait, et elle le fera un jour, remonter dans ses enquêtes jusqu'aux individus réellement responsables de tout ce qui est considéré comme abjection et comme crime. Il faudra un jour inventer le contumax post-mortem : faire un procès public à des personnes privées comme Caligula, Louis XIV ou Torquemada. Mais la théorie protège ces hommes en en faisant des acteurs aveugles d'un développement rationnel, n'est ce pas ?
Mais tout cela n'a de réelle importance que théorique, paradoxe ! En effet, c'est la théorie qui doit se changer dans son approche analytique des événements, et cesser de généraliser les phénomènes sous de fausses responsabilités et de fausses continuités : TOUTE l'Histoire, tous les aspects de la vie ont pour sujet des individus, pour responsables des hommes précis qui portent un nom, il n'y a nulle part de transcendance fatale, de développement dérivé ou je ne sais quelle évolution aveugle. Les souverainetés présentes descendent d'une échelle de souverainetés instaurées, conservées et transformées par des hommes en chair et en os, je dis bien toutes les souverainetés dont celle, par exemple, du langage, et de la... théorie. La vérité marxienne la moins soupçonnable, c'est bien son renvoi de la responsabilité de toute l'économie à la classe bourgeoise sous le label d'Economie-Politique. On peut décrire le marché tel qu'il existe aujourd'hui, comme une pyramide de responsabilités au sommet de laquelle il y a QUELQU'UN et non pas un Ange. La tendance à rechercher, pour la sensation uniquement, l'Homme le plus riche ou les Cinq cents entreprises les plus puissantes, participe de ce vague sentiment qu'il y a des responsables bien vivants et bien précis à la situation présente dans son ensemble : tout ce qui manque c'est le courage de les chercher, de les désigner et de les juger. En réalité, le concept de marché est l'illusion elle-même qu'il existe une réalité détachée des responsabilités humaines, une réalité transcendante qui se forme par elle-même par sa propre ruse de sa propre raison d'être. Or, il n'y a aucune autre raison d'être d'un marché que la satisfaction de ses acteurs, et d'abord de celle des acteurs qui le dominent. Point. Tout le reste est pusillanimité ou superstition. Ou complicité.
Jeudi le 24 mai 2001
Quatre heures. Je suis à Mulhouse et je viens de me réveiller. Je n'entends que deux choses : le chant des oiseaux et le ronflement de la gare de marchandises, dite la gare du Nord, bruit dont je me passerais volontiers. Haine des moteurs sous toutes leurs formes. Pourquoi ? Enfant, j'aimais ces chants d'acier et de fumée ! C'était comme la musique de la vie, pas de vie sans moteur ! Et aujourd'hui on dirait que l'air est saturé de ces rengaines sourdes et sans mélodie. Il est vrai, et j'en ai fait la remarque hier soir, jadis les moteurs avaient une identité ! On reconnaissait sans coup férir un moteur de Citroën d'un moteur de Juvaquatre, ou celui d'un DC 3 de celui d'un Messerschmitt. Ah les Stukas ! Je les entends encore, hurler dans la nuit. Ou bien ? Ne les ai-je jamais entendu que dans les films d'actualité ? Je ne crois pas car je vois encore les cylindres de lumière des projecteurs allemands montant vers les forteresses volantes canadiennes. D'ailleurs le bruit des quadrimoteurs existe encore aujourd'hui, et parfois je me sens comme transporté un demi-siècle en arrière. J'hésite entre vous raconter une anecdote sur ces bombardements et continuer à spéculer sur l'identité des bruits ? Que faire ?
Les deux. C'était à Pointe à Pitre dans les années soixante-dix, un soir au bar de je ne sais plus quel Méridien. A côté de moi un homme d'une cinquantaine d'années bien tassées, portant beau, style moustache à l'anglaise et chemise à carreaux en laine épaisse (aux Antilles !), complètement saoul, peinant à se tenir sur son tabouret et visiblement désireux de parler. Le pauvre, il n'est pas dans une aire anglo-saxonne où il suffit de regarder quelqu'un pour que le dialogue s'engage. Mais il a eu de la chance ce soir-là, celle de me rencontrer, moi l'Américain de Mulhouse. Et il commence à me débiter une histoire incroyable, qui se passait un quart de siècle plus tôt... à Mulhouse ! Je n'avais encore presque rien dit. Il raconte. Son escadre avait atteint l'Alsace sans histoire, ç'avait été une mission pépère, sans alerte, les Boches n'avaient guère de moyens dans le coin et les objectifs étaient secondaires, routes, chemins de fer, usines, comme d'habitude. Les premiers avaient giclé leurs conteneurs de confettis pour dérouter les quelques radars allemands postés au-dessus de Riedisheim et la fête commença. Sniff, les larmes commencèrent à se montrer aux coins de ses yeux, il me prit la main. Tout baignait et l'escadre au complet avait repris le chemin de l'ouest quand l'horreur parvint à ses écouteurs : Ils avaient rasé l'hôpital de Mulhouse ! Terrible erreur de tir provoquée par la proximité de la voie de chemin de fer. Par dévers moi, je pensais à mon oncle qui à ce moment-là gisait sur un grabat du Hasenrein, il venait d'être amputé de sa jambe gauche et c'était le chaos autour de lui. Mon père était sur les lieux, rangeant les cadavres par dizaines et creusant les fosses communes. Je peux me rappeler, il était revenu au petit jour, couvert de sang des pieds à la tête, même son vélo avait changé de couleur. Mon Canadien ne s'en était jamais remis. Je n'en croyais pas mes oreilles. Un tel remord ! Il but un nième verre de Bourbon, disait-il la vérité ? S'était-il trouvé une excuse pour son alcoolisme patent ? Je ne sais pas, mais la coïncidence m'avait troublé et comme recousu un lien entre ma prime enfance et le présent. Je ne sais d'ailleurs pas si je me souviens réellement de tous ces faits qui eurent lieu alors que j'avais encore quatre ans, ou bien si les récits répétés autour de moi avaient fini par se transformer en mémoire vive ! Mystère. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, là, dans cet hôtel guadeloupéen, c'était la force de ce remord. Quelle sensibilité avait-il fallu à cet homme, ce guerrier, pour se voir frappé à ce point par la culpabilité ?
Oui, nous reconnaissions tous les moteurs. On pouvait encore identifier la nationalité des mains de tourneurs et de fraiseurs qui avaient fabriqué chacun de ces animaux sans âmes. Au fond c'était leur âme, ils en avaient encore une ! De nos jours, les composantes de toutes ces mécaniques sont aussi internationales que les monnaies dans lesquelles circulent les factures, et on aurait bien du mal à reconnaître le bruit d'une bielle française cachée dans le moteur de la BM qui passe ! D'ailleurs le silence et ses impératifs ont tué les moteurs et leur expression, on ne veut plus les entendre, ils sont devenus importuns. Toute chose passe, toute gloire finit par s'éteindre dans le temps qui avance mécaniquement, écrasant sans pitié le lit de ceux qui souffrent. Je pense à ces malades qui ont entendu comme moi les moteurs des Douglas vrombissant dans la nuit au-dessus de leurs têtes, juste avant que les premières bombes ne sèment la terreur. Ultime écoute de moteur, préfiguration de la haine du bruit dans nos temps chargés de fureur.
Vendredi le 25 mai 2001
Cinétique et absence de soi. Question : pourquoi la vitesse est-elle devenue le critère déterminant pour toute action humaine ? Il ne me semble pas que le philosophe allemand du cinétique, Sloterdijk, aie répondu, mais je n'ai pas tout lu. Bon, j'ai bien vécu toute cette évolution, relativement courte qui a conduit à la toute-puissance de la vitesse. Curieusement, la vitesse a été un phénomène de la guerre (la Première puis la Seconde) qui a perdu de sa force à chaque Armistice, puis a enfin pris son essor définitif après les années soixante : Mai 68 est aussi une protestation contre ce fait-là, l'essentiel des conséquences ayant été de paralyser le pays pendant quelques semaines vécues par tout le monde comme du vrai bon temps. D'ailleurs on pourrait dire que les Français forment le seul pays philosophique au monde, car c'est dans les Transports Publics que parle la citoyenneté lorsqu'elle s'exprime : la grève ralentit la vitesse et agace plus que tout au monde ! Elle utilise l'obstacle à la fausse urgence comme principale urgence ! Et rappelle que l'outil de transport est lui-même une réalité qui demande à être vécue et non pas simplement annulée.
Car tout l'enjeu de la vitesse est là : annuler la distance au lieu de la faire vivre. Dans l'organisation archaïque de la vie quotidienne, l'aller-à faisait partie des objectifs de l'existence. Cela signifiait pour un paysan, par exemple, que son aller-à la ville du jeudi ou du mercredi avait valeur ontologique, faisait partie du calendrier de sa présence au monde et à soi. Plus précisément encore, cela signifiait que l'homme transportait dans son déplacement la totalité de son souci qu'il mettait en scène tout au long de ses parcours vers ici ou vers là. Pour mieux comprendre référons-nous à la situation inverse : aujourd'hui on prend le train de banlieue pour aller le plus vite possible dans un autre lieu, en essayant d'oublier le trajet, d'oublier le soi qui voyage, de s'absenter de soi le temps d'arriver dans l'autre lieu. Bien sûr il y a des tropismes géographiques qui forcent ce schéma, c'est bien entendu Paris, mais ce forcing produit aussi la réalité environnante, celle des réalités provinciales : il faut aller aussi vite à Strasbourg qu'à Paris, c'est devenu l'âme du système. Pourquoi cela a-t-il eu lieu à Paris ? Fastoche, la capitale a secrété au cours du dernier siècle, un espace sans identité, ni ville ni campagne, c'est à dire sans référant existentiel. Comment être présent à soi derrière la vitre d'un train de banlieue, lorsqu'on ne parvient même pas à identifier le "genre" de lieu que l'on traverse ? Les premiers banlieusards du monde ont précipité le phénomène de cette absence à soi pendant le aller-à, devenu aléa permanent et perte assumée tant bien que mal. Le Transport en commun sophistiqué des grandes villes du monde sert désormais de décor préféré pour la mise en scène des tragédies et des drames. Voyez New-York ou Berlin, où s'est créé tout un romantisme des métros et des trains.
Alors, autre question plus redoutable : existe-t-il une culture de l'absence à soi ? Au sens de la distraction pascalienne, ou bien l'Homme est-il tombé dans un piège tendu (par lui-même) lors des deux grandes conflagrations humaines des guerres mondiales ? Comme je l'ai souligné plus haut, ces guerres ont été suivies par des sortes de repos, de retour à la normale des déplacements anciens, après qu'elles eurent déterminé le réel dans son essence pendant plusieurs années de suite. Ce qui pourrait laisser entendre que la réalité guerrière moderne reste le fin mot de la réalité tout court. J'ai fait allusion ( et un peu plus..) à ce développement dans mon petit roman autobiographique "Les lendemains qui shuntent", et le titre fait justement allusion à ce freinage général des années quarante et cinquante, suivi de la reprise en flèche des objectifs cinétiques, mais cette fois en période pacifique
De toute manière la mort est concernée par toutes les faces de ce problème, comme locus communis, comme point géométrique du aller-à ou du aller-vers. Le paysan du seizième siècle partait pratiquement chaque fois pour mourir : la vie prenait un tournant radical lorsqu'il quittait l'horizon de son village, et il s'engageait dans le risque total. De telle sorte qu'il se déplaçait dans une sorte d'abois, d'éveil plus vif et de conscience démultipliée de l'existence. De tels voyages représentaient à chaque fois le retour à la véritable dimension ontologique de son être, celle de la vie nomade !!! Se déplacer était alors une sorte de rupture provisoire de l'Alliance secrète établie entre l'homme et sa terre, une trahison passagère de ses engagements ontologiques envers le paysage. C'est pourquoi le voyage était action héroïque, demandait du courage et mettait en scène l'idée de mort et d'accident. Non pas parce que le déplacement lui-même contenait des éléments de danger, mais parce qu'on avait rompu la Praxis morale fondamentale, le lien permanent établi entre la terre et soi. Dans ma jeunesse, le voyage est revenu sur scène comme motif initiatique et suicidaire. On partait pour rompre volontairement ses accords avec la réalité, sa famille, les lieux de naissance et tout ce que cela représente en termes de familiarité avec l'étant. On allait au devant du danger en tant que tel, ne supposant même plus qu'on pourrait un jour revenir. Or, l'aller-à affecté du revenir, c'est tout autre chose, c'est un passage d'une présence à l'autre : on a inventé le saut de présences à présences avec passage par l'absence. L'insécurité dans les Transports en commun provient exclusivement de cette donnée selon laquelle le temps de déplacement est temps d'absence, temps donc d'absence de tout, et tout d'abord de comportement moral. Je pense pouvoir affirmer que les trains et les métros ont détruit plus de couples que quoi que ce soit d'autre au monde : Un homme et une femme qui se touchent dans un métro, ne sont "nulle part", ils sont cachés par un anonymat plus fort que le simple anonymat urbain au point que des voisins de pallier d'un HLM de banlieue peuvent en profiter tous les jours sans rien changer à leur vie quotidienne. L'absence à soi est véritable absence d'éthos, s'oublier dans le rien est bien le lieu de l'absence de Loi. C'est pourquoi l'idée d'un destin fatal qui conduit aujourd'hui les hommes à un retour vers le nomadisme est à prendre au sérieux et à envisager sous l'angle de ce que va devenir la Loi (morale et autre). Mais la question fondamentale est celle-ci : le retour à la condition nomade est-il programmé comme un retour à l'équilibre de l'être, ou bien est-il seulement la signature de l'échec de la position immobile ? Le face à face avec l'être est-il devenu trop encombrant dans sa forme sédentaire, ou bien ce face à face exige-t-il le retour du risque ontologique, l'effacement de ces plages d'absence à soi du aller-à dans un aller sans à, dans un aller sans limites et sans but ?
-----------------------------
Lu ce matin d'un trait le petit opuscule de J.M. Keynes préfacé par Attali et qui s'appelle "Le Docteur Melchior, Un ennemi vaincu". Eblouissant. De la vraie littérature. Du Proust vrai, pas le travail d'un virtuose légèrement imposteur. Et visionnaire avec ça, car ses remarques sur le Président Wilson précèdent, me semble-t-il, l'analyse extraordinaire de Freud, mais disent, en substance, la même chose, au point qu'on pourrait se demander si l'attention du grand psychanalyste n'a pas été attirée sur ce sujet par cet écrit destiné à l'origine à un cercle restreint d'amis de Keynes. L'économiste si controversé était un observateur génial et un connaisseur d'hommes peu commun. Sa sémiotique des visages et des tics a une réelle valeur mantique, il voit immédiatement au-delà des formes, il entre pour ainsi dire dans les âmes que portent les êtres sur leur visage. Bien sûr son texte peut s'interpréter comme un plaidoyer pro domo, c'est à dire du bien-fondé de la diplomatie britannique en ces semaines de plomb de l'année 1919. Surtout par rapport à l'intransigeance française quant au problème des réparations. La question était, fallait-il ou pas se hâter dans le ravitaillement de l'Allemagne qui pataugeait dans la pire famine qu'elle aie connue et qui menaçait de sombrer dans une guerre civile dont l'issue redoutée était le bolchevisme. Bref, Keynes faisait partie des "humanitaires" de l'époque, mais cela ne l'empêchait pas d'analyser froidement la position de Clemenceau qui n'entendait pas laisser l'Allemagne redevenir la puissance qui avait failli conquérir l'Europe alors que la France, c'est l'analyse de Keynes, s'affaiblissait de décennie en décennie.
C'est là que ça devient passionnant pour nous, car l'économiste a un tel talent d'écriture qu'il arrive à faire passer l'intuition de l'essence du nationalisme. Dans sa description de l'opinion de Clemenceau, Keynes a une manière géniale de présenter la nature profonde de la Realpolitik, la fameuse politique de Bismarck, que selon lui, Clemenceau aurait reprise à son compte telle quelle : les intérêts de la France d'abord, le reste on verra. Le reste c'est la Société des Nations, le relâchement de la pression sur Weimar etc... On peut sentir dans le texte toute la prégnance de l'idée de patrie comme absolu, c'est à dire le territoire comme abstraction fixe et sans discussion possible. A tel point que le vieux lion est persuadé, selon Keynes, que rien ne saurait changer en Europe entre les Nations, et combien il avait raison ! Il est vrai que la politique de Bismarck avait un autre but, qu'elle était en décalage par rapport à cette position, car le Chancelier allemand avait surtout en vue la survie de la Dynastie des Hohenzollern, ce dont les dynastes ne se sont eux-mêmes pas aperçu, sans quoi ils n'auraient sans doute pas déclenché cette guerre d'une manière aussi insensée. Au total, ce qui transparaît dans le texte de Keynes, c'est la réification du motif sédentaire ou, disons, son acmé sous la direction des élites françaises, dont surtout l'armée (voir la description de Foch qui est remarquable), en face d'une Allemagne qui a encore un pied dans le siècle précédant. On sait que Guillaume a déclenché la guerre d'abord pour enrayer le renforcement constant de la social-démocratie, et ensuite pour sauver son régime. S'il avait eu une idée plus moderne de la sédentarité des peuples européens, la guerre aurait pu être évitée. Seul Bismarck aurait peut-être eu le génie d'une concertation européenne sur la question sociale, une concertation des puissances de classe, sur la base d'une coopération militaire "civile". Autrement dit une sorte d'OTAN anti-communiste qui nous contraindrait aujourd'hui à une autre écriture de la suite de l'histoire du continent... Je suis sûr que Londres aurait marché sans discuter, mais les Allemands auraient eu toutes les raisons de se méfier de la démocratie française, aveuglée par son identité sédentaire. Paris n'aurait sans doute jamais accepté de partager avec l'étranger des éléments de souveraineté sur sa politique intérieure. Voilà qui éclaire du coup pour la première fois, pour moi, le concept de patrie. Tout cela ressemble à une lapalissade, mais il n'en est rien. Il faut tenter de retourner en arrière pour comprendre, de se glisser dans la réalité française immobile de la fin du Dix Neuvième siècle par rapport aux réalités dynamiques de ses voisins. D'un côté l'Allemagne qui venait à peine de naître à sa territorialité nouvelle puisque son unification ne datait que d'une quarantaine d'années, de l'autre la Grande Bretagne, Nation nomade par excellence, véritable réussite de la Grèce antique. Londres était une Carthage victorieuse qui tirait sa puissance de son commerce et de son Empire ; elle ne reprochait au fond à Berlin qu'une seule chose, c'est d'avoir osé se mesurer aux Anglais sur ces deux terrains. La France avait, certes aussi son Empire, mais on l'a souligné ailleurs, le coeur n'y était pas et jamais il n'a été question dans l'esprit des Français de s'établir en Afrique comme les Britanniques en Inde ou les Hollandais en Indonésie. Les colonies resteraient jusqu'au bout des défouloirs et des aventures passagères.
Ernst Jünger : intéressant de méditer sa thèse à cet endroit. Il comprenait la Grande Guerre comme un phénomène transcendant les Nations, c'est à dire sans motif réellement patriotique. Pour lui, la violence était aveugle et s'en prenait d'abord partout au monde bourgeois. Il n'oubliait pas, ainsi, les véritables causes de cette guerre telles que je les décris plus haut, mais il ne comprenait pas que le motif bourgeois recouvrait en réalité celui de la sédentarité. Tout son système qui aboutit à une réhabilitation des Aristocraties sous la Figure du Travailleur, est pétri de substance nomade, et il préfigure le nomadisme barbare choisi par l'Allemagne nazie. Et comme on le comprend ! aujourd'hui à nouveau, les Allemands nomadisent comme ils peuvent, des Canaries aux Baléares, tout, partout, sauf chez eux, dans leur Heimat qu'ils détestent copieusement et qui a fini par représenter pour eux le temps carcéral du travail. Jünger savait cela, et il devait s'efforcer d'absoudre, de trouver une solution à cette tragédie d'un peuple qui ne veut pas admettre son paysage. Aussi insiste-t-il sur la nécessité de la destruction totale, de la néantisation de l'étant allemand pour que puisse ressurgir une autre réalité. Il aura été bien déçu de ce qui est arrivé par la suite, sans le reconnaître d'ailleurs, ce qui diminue considérablement la portée de ce qu'il a écrit après les deux guerres et explique son romantisme géologique où il finit par se perdre. Ce qui est passionnant chez lui, c'est l'homme et son propre destin : Jünger commence sa vie d'homme comme légionnaire dans l'armée ..française ! Une aventure qui se terminera médiocrement pour lui mais qui montre qu'il va droit au but. La France qui le fascine possède une sorte de serre dans laquelle elle cultive son nomadisme résiduel, la Légion Etrangère, et c'est là que le jeune Ernst va se présenter. D'emblée il choisit ce qu'il va confirmer par la suite dans les tranchées de Langemarck, la dérive nihiliste, puis dans son œuvre théorique Le Travailleur. Après la seconde guerre mondiale, après un certain délai de courtoisie, dirais-je, il repart croiser autour du monde, comme s'il n'avait plus rien à faire ou à chercher dans sa Heimat qu'il avait si vaillamment défendue. Il finira d'ailleurs sa vie pratiquement en Crète où il passait le plus clair de son temps, totalement démobilisé.
Samedi le 26 mai 01
Pas fameux ce que j'ai fait hier sur Clemenceau, mais c'est difficile d'exprimer la vérité ! Essayons encore. Peut-être le concept de Kriegspiel donnera-t-il plus de lumière sur ce que je veux dire : la patrie est le corps, comme le corps du guerrier est ce qu'il doit défendre. Le corps du Roi d'essence divine est en réalité le corps du pays. L'intuition ou l'acception de la position sédentaire est dans cette identification de la terre au corps. Dans le jeu de la guerre auquel se livrent les généraux devant leurs cartes d'état-major, il n'y a que des abstractions, des kilomètres carrés de terre de telles et telles forme, hauteur, teneur etc... Mais cette abstraction n'est qu'apparente car la terre finit par être connue par ces soldats comme leur propre corps, immédiatement, pleinement, comme si la terre était le prolongement de leur individu. C'est ce qui fait toute la gloire de généraux comme Hannibal, qui n'avaient aucune connaissance du terrain, ou bien qui avait l'autre connaissance de la réalité, celle qui ne s'embarrasse pas d'une identification propre, celle qui circule partout et qui est partout chez elle. Je le dis souvent, il en va du vrai soldat des années 1900 comme d'un marin ou d'un Touareg qui finissent par sentir et avoir une forme de connaissance de chaque dune, de chaque vague, au point d'être capable de sentir le Tout en permanence à travers chaque élément. C'est le fractal en pratique, dont des hommes comme Foch ou Pétain avait fini par avoir une science parfaite, malgré le handicap de la cartographie. Car la carte d'état-major se révèle, dans ce contexte, comme parfaitement ridicule, comme une régression du rapport à la réalité, au sens où la carte vient en fait combler une carence de savoir. Elle est une prothèse intellectuelle très embarrassante car elle pompe le plus clair de l'énergie conquérante. Voir Napoléon et sa propre contradiction de nomade au pied léger doublé d'un érudit maniaque des représentations géométriques. Waterloo est le parfait résultat d'une telle contradiction. Le grand Homme est remonté du Midi sans la moindre technologie de reconquête, avec seulement son savoir politique de son présent, et il se présente sur un champ de bataille taillé sur mesure par son adversaire ! Il était persuadé que sa connaissance cartographique du terrain était suffisante pour lui assurer la mobilité de ses troupes, il avait dû étudier avec un soin inouï les campagnes révolutionnaires dans les plaines de la Belgique, et que se passa-t-il ? Il manqua de connaissance météorologique, marotte des marins anglais, pour anticiper les conséquences de la pluie diluvienne qui allait transformer le champ de bataille en torrent de boue. Trop nomade et pas assez ! La carte n'est pas le territoire, disait Van Vogt.
Au fond, le sédentarisme se montre au total comme une vaste reconstitution ou reconstruction du rapport au monde sur la base de la représentation. C'est bien là notre intuition première que vient confirmer le concept de déconstruction de la représentation que nous a apporté Derrida, sans la substance du télos, ou plutôt dans sa négation. Chez Derrida, la métaphysique illustre bien un échec du passage à l'immobile, mais dans une sorte d'hypostasie de l'écriture comme seul lien avec ce qui a précédé. Cela est encore vrai d'une certaine manière, au sens où l'écriture a repris globalement les éléments cognitifs immédiats pour les stocker dans les banques de la représentation. Mais l'écriture n'était pas plus que cet élément fondateur de la teknè, c'était la première technique, le technique en tant que tel. Ici je dois préciser que mes comptes sont loin d'être réglés avec le texte fabuleusement riche de Derrida. Il demeure que dans l'optique du déconstructeur, il n'y a de relation à l'être qu'à travers l'écriture, il n'y a rien AVANT. On peut admettre, en effet, qu'il n'y a rien A VOIR avant, au sens où l'écriture reste la seule trace de la pensée de l'étant en tant qu'étant. Cela ne permet cependant pas d'affirmer, même si on identifie les peintures rupestres à l'écriture, que le souci ontologique n'est rien d'autre que de l'écriture, que de l'œuvre d'art. Une telle pensée conforte en fait absolument la métaphysique traditionnelle, l'onto-théologie. Elle chosifie la pensée comme objet dérivé, oui, comme déchet irrationnel et proprement inconscient. Comme objet dérivé de l'écriture, c'est à dire de la technique de la représentation. C'est un peu le monde à l'envers : l'homme écrit, et cette écriture produit la pensée. Au fond c'est conforme à la vision eschatologique des historiens de tout bord, l'Histoire, entendez l'histoire de l'Ecriture, se joue après l'action en la sauvant. Autrement dit, il y a un seul progrès humain, c'est le style. Mais pourquoi, dans une telle perspective, qui est assez séduisante finalement, ne pas admettre que c'est l'écriture qui a détruit le style, le style étant la nature même de la relation à l'être, et que l'Histoire est seulement l'histoire de la reconstruction du style ? Ou de son invention, de l'auto-invention du style de l'être. De sa naissance.
En tout cas, il n'y a pas de réponse scientifique, et c'est sans doute le souci objectal scientiste qui interdit de franchir la barrière du néolithique, ou celle de la naissance de l'écriture. De poétiser notre relation au monde, ce dont nous avons le plus urgent besoin. Pourtant, l'Ecriture, la seule qui ait eu le culot de s'imposer comme Genèse (et comme Exode), n'est en soi rien d'autre que du poétiser, du choisir, mais cette fois a posteriori, comme relève de l'Oral, comme conservatoire de la Parole Divine. Mais, pardon, Derrida est beaucoup trop proche du dogme judaïque selon lequel l'Ecriture Sainte EST elle-même le Dieu parlant. Les mots de la Bible sont comme les parties du corps divin qu'il convient de commenter infiniment dans de l'écriture non divine. La Parole reviendra avec le Messie, seulement alors. Il y a de l'autre côté de l'Atlantique, des philosophes qui disent la même chose à propos de Heidegger dont ils font un commentateur de Parménide au sens judaïque de la représentation, ou de la représentification. Incroyable.
Dimanche 27 mai 2001
Ne pas radoter, ne pas se répéter ! Vieux leitmotiv intérieur, et pourtant je m'aperçois parfois que des répétitions se font inévitablement, comme des motifs récurrents de peinture ou de musique. Il y a des figures de savoir qui reviennent fatalement. Mais, en y regardant de plus près, et ces remarques serviront peut-être à d'hypothétiques commentateurs du quatrième millénaire, je me rends compte ou je me confirme à moi-même que ma pensée se forme, qu'elle prend une forme, peut-être SA forme ? Chacun de nous fait l'expérience d'une multiplicité de points de vue, d'opinions, de structures générales d'idées et d'un enrichissement du savoir qui semblent se succéder tout au long de la vie. Comme on dit, on évolue. Et parfois même on change d'avis, on passe à l'ennemi, on fait, semble-t-il, basculer toute sa façon de penser le monde. Il arrive même qu'on rétablisse des équilibres rompus ou qu'il se produise des accidents de la pensée, je pense notamment à la prise de LSD qui s'est révélée pour moi comme une rude école pour ma pensée, j'en ai déjà parlé, il me semble (sic). On peut donc en conclure que le moi change, que, ou bien il découvre ses erreurs passées et s'empresse honnêtement d'y remédier, ou bien il change dans sa nature, il mue, le moi devient un autre. Devant cette question il y a plusieurs réponses possibles. On peut imaginer qu'il existe, par exemple, dans la psyché, cette instance intellectuelle idéale qui juge constamment ce qui passe dans son collimateur. Chacun possède sa petite machine platonique immuable et incorruptible. L'intelligence n'a pas d'odeur ni de relations avec moi, elle juge de son point de vue logique, l'idéal de Valéry qui n'a cessé de rechercher la pureté, d'une manière maniaque parfois, la pureté des interventions de son intelligence, une sorte d'objectivité absolue. Mais Valéry est intéressant parce qu'il assume totalement l'égoïté ou l'égocité de son intelligence ; il estime même que la pureté de sa conscience appartient totalement à sa singularité, il existerait une singularité universelle (je le répète, logiquement c'est irréfragable), ou bien, si on préfère une universalité qui se joue toute entièrement dans l'unicité. Et c'est là un aspect du génie de Valéry, c'est qu'il souligne sans cesse que cette universalité se joue dans l'expérience de l'intelligence, dans son effectuation immédiate, dans sa "consommation" oserais-je avancer. Le poète mathématique ne se savait pas existentialiste, mais cette proposition est très exactement le fond de la thèse heideggero-sartrienne, tant pis pour ceux qui n'arrivent pas à supporter l'idée que Sartre aie pu comprendre quoi que ce soit à Heidegger ! On se trouve d'emblée dans la contradiction : comment une machine à portée universelle peut-elle exister de manière singulière, unique. Cela signifierait ou devrait signifier que chaque acte d'intellection est différent des autres quelles que soient les ressemblances logiques (au sens de Hegel, c'est à dire, hum, forme et fond). Si moi je dis que cette vache est blanche, cette vérité est de toute manière différente de celle que produit l'énoncé de quelqu'un d'autre en même lieu et place et sur la même vache. On ne peut jamais confondre deux intuitions a priori, et c'est là aussi que Kant a merdé, c'est que tout en se rendant compte de l'universalité du singulier, il n'a pas poussé ses scrupules assez loin, il est vrai qu'il en allait de l'objet de la science, et ce n'était pas rien. L'exemple de la vache est intéressant, car il semble ridicule : une vache blanche est une vache blanche, non ? Certes, dit de cette manière, c'est vrai, A = A. Mais ce n'est pas la même chose si je compare deux énoncés à propos de la même chose et si j'énonce une égalité abstraite. Ainsi, lorsque je dis qu'une vache est blanche, je peux vouloir signifier que cette vache est
innocente
! Alors que mon voisin ne parlera que de sa couleur ! De même, le sens de l'énoncé peut encore être différent, est différent dans l'intentionnalité en général, dans la structure de l'intention singulière. Ce qui me pousse à dire que telle vache est blanche n'est jamais la même chose que ce qui pousse quelqu'un d'autre à dire la même chose. Banalité.
Banalité qui n'empêche pas que l'on se mette soudain à dire autre chose que
soi-même
! Peut-on être différent dans le même ? Là est la question qui règle le problème des changements d'opinion ou de l'évolution d'une pensée, et qui aboutit, in fine, à cette autre question qu'est l'Histoire de la pensée en tant que telle ! Rien de moins, car il n'y a pas de raison de s'interdire de comparer les phases d'une seule pensée et celles de ce qui est enregistré dans l'Histoire comme La pensée humaine, même si cela s'avère logiquement impossible. Car il est tout aussi impossible de comparer deux performances de pensée d'un même individu que de comparer deux pensées différentes ! Ainsi se fait jour la tradition du "connais-toi toi-même", ou bien, autrement exprimée, l'idée que la pensée est toujours déjà là dans le Moi comme télos, comme idéal ou comme objectif que l'on finit par atteindre par l'exercice ou par n'importe quoi d'autre (les drogues par exemple). La vérité singulière, l'objectivité absolue du moi est dans le résultat de son évolution, elles s'obtiennent par maturation ou par vieillissement, comme le vin obtient sa véritable qualité dans le temps. Et c'est pourquoi il est inévitable que l'on se répète, que l'on radote, car ce qu'on a à dire globalement est toujours déjà là, toujours déjà auprès de soi, comme dirait Hegel, ce qu'on a à dire, c'est Soi. Toujours la Phénoménologie de l'Esprit qui remonte comme une vieille soupe indigeste ! Mais c'est tellement vrai, et c'est là que se joue pour chacun la tendance à systématiser, la tentation du système que produit la répétition dans la formation : le Moi se forme en étant, il est dans sa propre formation. Et que vient faire alors ce long commentaire fastidieux ?
Il est stratégique. Il pose les balises de l'action. En effet, si ce que je cherche se trouve en moi, alors je n'ai pas besoin d'aller très loin, de m'imaginer aller ailleurs que vers moi alors que je n'accomplis pas plus que cela. Plus précis, si ce que je cherche ne peut pas se trouver ailleurs qu'en moi... Sommes-nous dans un ipséisme qui ne ferait que répéter l'histoire de la philosophie idéaliste (échevelée comme diraient quelques uns de mes amis) ? Je ne le pense pas, car un tel point de vue s'interdit d'user de la vérité comme signification universelle ou comme instrument d'évaluation commun de la vérité du monde, qui n'existe pas sous une autre forme que sous celle de la vérité du sujet pensant. Difficile. Mais quel enjeu ! Tout un cartésianisme à repenser sans Dieu, sans le papa de l'intelligence qui garantit sa validité et qui ouvre sur des gouffres de dangers. Mais quel programme fabuleux ! Assomption du monde, assomption de l'existence comme assomption du moi en tant que règle du jeu social. Les Droits de l'Homme ne sont pas des droits passifs qui permettent seulement à l'individu d'exister dans le présent, de lui concéder la liberté de ne pas être privé de légitimité, mais ils sont cela qui autorise l'individu, le sujet de soi-même d'être son propre géniteur, de le rester tout au long de sa vie quelles que soient les différences que manifeste le comportement initial de ce dernier. Retour au fantasme de ceux qui regrettent, parce qu'ils sont mâles, de ne pas pouvoir donner la vie. Cela n'empêche en rien la formation d'écoles, le désir d'imiter l'autre et de s'en servir pour sa propre formation, à ses propres fins. Il n'y a même pas le choix, car le moi ne peut se jouer que dans la transparence de ses désirs : si l'autre ne comprend pas mon désir, aucune altérité ne peut voir le jour hors la violence. Mais cela signifie aussi que je dois d'abord comprendre mon propre désir, c'est un impératif catégorique que de m'atteler à saisir les fondements de mes propres volitions (et tout d'abord de distinguer quelles volitions sont proprement les miennes et non pas des imitations d'autres désirs). Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas que l'on me fît est à ce prix, celui de savoir ce que je veux et ce que je ne veux point, c'est sans doute aussi là l'un des enjeux de la psychanalyse.
Conclusion : répétons-nous sans scrupules, n'hésitons pas à reprendre dans notre herbier personnel des motifs qui semblent fanés seulement parce qu'ils ont déjà atteint la lumière de l'expression. Ces motifs forment comme le fil d'une méditation interminable qui est cette auto-génération du moi, et à chaque fois qu'elle a lieu, cette méditation est à la fois une renaissance et à la fois une progression vers un moi à chaque fois encore plus vrai que le précédant. La vérité est exemplaire, et elle seule l'est. Mais cela est un autre sujet, quoique le même.
Ma dichotomie chérie, nomade/sédentaire, a-t-elle une place dans ce tableau ? Certes, et pas des moindres. La notion la plus importante que produit la position sédentaire est celle du propre, de la propriété, de ce qui du monde ne regarde que vous parce que dans le monde vous occupez telle place, telle position, telle orientation. Voilà posée la pierre de la singularité, vérité qui n'a pas d'oxygène dans une variabilité constante des positions, qui est impossible à saisir dans le mouvement permanent qui saisit toute chose à chaque fois différemment. D'un autre côté, le sédentaire produit l'identité chosale, la nécessité de nommer et d'égaliser les choses et leurs attributs pour se les partager dans l'étant immobile, l'invention de la valeur, de toutes les valeurs. Bref, d'une universalité fonctionnelle sans laquelle pas de vie commune possible, l'universel nomade ne se laisse pas distraire ou absorber par la subjectivité conquise dans la sédentarité. Ce qui signifie qu'il y a désormais lieu de concilier les deux positions d'une singularité de fait et d'une universalité d'action : je peux réaliser mon moi, mais à condition de laisser autrui en faire de même. Si je compte me réaliser aux dépens d'autrui, je laisse à autrui la liberté de m'empêcher d'être moi, je n'ai donc pas le choix que de passer par une universalité réelle, la même que celle qui m'égalise automatiquement lorsque je ne m'approprie rien du monde des choses. On pourrait dire que la Civilisation est le passage de l'universalité objective dans l'universalité subjective, dans l'universalité de la singularité du sujet. Comme le temple recueille la réalité pour la stocker, le sujet recueille en lui l'objectivité pour la restituer dans sa propre singularité. Ou tout seulement pour l'atteindre, cette singularité. Au fond, l'Homme est une réalité qui est en train de se réaliser, de s'atteindre dans son être. Avec un certain retard.
Je n'arrive pas à m'arrêter ce matin. Urgence ? Bref, je reviens à l'écriture par le biais de cette invocation à la Civilisation, au motif de l'écriture comme absolu ou comme relatif, nécessaire ou contingent. Bien sûr que l'écriture est nécessaire et absolue, mais seulement, encore une fois, dans le sens instrumental : elle est elle-même la résultante d'une universalisation, ou plutôt la relève de l'universalité de fait de la réalité humaine, sa traduction sédentaire. Elle ne peut pas être la transcendance elle-même productrice de pensée de l'universel, cela n'a pas de sens, et je le répète, n'a de sens que si on admet un Texte fondateur, ou plutôt un Texte qui fonde la réalité dans sa Totalité, un Texte de la Genèse. Si la Bible est Dieu, alors l'Ecriture est source de toute pensée, mais seulement à cette condition. Mais je n'ai peut-être rien compris ?
Lundi 28 mai 2001
La différence entre le vrai Dieu et celui des religions, c'est la même différence qu'il y a entre un chef d'orchestre en concert et le même chef d'orchestre en répétition. Cette différence s'appelle le destin. Pendant le concert, le dirigeant perd son pouvoir de tout arrêter.
mardi le 29 mai 2001
Courir dans le monde avec son Histoire sous le bras. S'arrêter chaque jour et faire le point, comme là-bas, en mer. Là encore, le GPS a tout gâché, événement central, encore la guerre ! Plus besoin de cartes ou de compas, plus besoin de culture : le là est toujours là ! Etre-là s'est inventé une prothèse. Car tout cela se joue dans le symbole du spatio-temporel. Cet instrument, le GPS, avec ses waypoints, illustre en définitive le triomphe tardif de l'héliocentrisme parce qu'il introduit la relativité dans le principe lui-même : on se passe du soleil et des étoiles, on les fabrique et on les met en orbite nous-mêmes. On peut se passer de Dieu, quoi. Du monocentre. Mon petit boîtier noir est relié à douze satellites, il me suffit d'en toucher trois pour que mon point s'affiche. Mais cette petite merveille a bien d'autres pouvoirs, des pouvoirs qui minent déjà toute une série d'instruments de bord qui deviennent obsolètes, compas, loch et même sonde. Il détruit l'obligation d'enregistrer les distances parce qu'il affiche constamment les distances du point à n'importe quel point choisi. Je n'ai même plus besoin de cartes, si j'en connais assez bien le vocabulaire. Seul le vent échappe encore à sa compétence. Energeia : sans la force et la direction du vent, pas de navigation sérieuse, l'instrument ontologique a donc encore un défaut qui contraint le navigateur à faire appel à l'intuition. C'est donc bien comme mon Histoire que je trimbale avec moi, là-dessus mon savoir peut être total, ou disons relativement complet. Mais ça ne suffit pas. Dans ma démarche et dans le rythme de mes pas, il y a une force et une direction de la force qui ne correspond pas forcément avec ce que je peux lire de mon Histoire; et cela forcément puisque le but n'est pas encore là, lui, il est dans le futur. Le but de quoi ? Question. Réponse : du désir, de ce qui meut mon être comme le vent gonfle la voile. Qui va me dire, mélancolie, de quelle force encore je dispose dans les caves de mon être, et que cherche-t-elle exactement cette force, où veut-elle aller ? Toujours cette affaire de projets, mon dieu quand finirons-nous de nous torturer ainsi, quand serons-nous ?
Mercredi le 30 mai 2001
Un peu tendu ce matin. Comment l'écriture va-t-elle passer ? J'écoute France-cul un peu distrait, café et déjà ma sixième cigarette. Hier encore pire, angoisse due à la suspension du temesta, mais aussi à cause de l'université de Tous les Savoirs, mon émission préférée, quelque chose comme du sur-mesure intellectuel pour nous (qui est ce nous ? intéressant, quelque chose comme le Geist français, l'idéologie ambiante, ce qui se pense ou essaye de se penser, en tout cas ce qui se pense de mieux). Donc hier c'était un certain Philippe Lemoine, un des gourous (pardon) d'Internet et de la High Tech, à la fois impliqué dans l'action commerciale - il est responsable du secteur soft des Galeries Lafayette - et à la fois chercheur et pédagogue. Très sophistiqué dans la reflexion ! Ouaou ! Son idée est difficile à résumer comme ça en deux phrases, mais elle rejoint mes intuitions par certains aspects. En bref, il pense que le E-trade est en voie de moraliser malgré lui le marché : les gains de productivité servent enfin à une redistribution des richesses, c'est à dire à une baisse réelle du prix. Il cite un grand distributeur américain Wolmart (? audio seulement) qui serait en train de manger la laine à toute la grande distribution mondiale. Fort bien, le secret de ce succès réside dans la capacité de contact direct avec la clientèle que réserve Internet aux entreprises, entreprises qui n'ont pas encore pris toute la mesure de ce à quoi sert l'informatique, encore trop réservée à la gestion interne et à la rationalisation de la production, c'est à dire in fine à la supression des emplois. Il cite la surprenante logique de Wolmart qui crée des emplois au lieu de les supprimer, et pas en dizaines, mais en milliers. Attention Carrefour ! Quant à moi je bois du petit lait, car cette découverte rejoint mon analyse du retour de la marchandise comme marchandise, et non plus comme représentant de la monnaie : on pourrait énoncer le théorème suivant : plus la valeur d'usage se rapproche du désir singulier, plus le prix se rapproche de sa vérité. Il y a en effet un point aveugle dans notre économie, c'est l'accumulation ou la conservation du taux de profit. Il suffit d'imaginer la différence qu'il peut y avoir entre le coût de production d'une 4 Chevaux et celle d'une Twingo. Ce qui s'est passé entre les deux produits, c'est un ralentissement de la baisse nécessaire du prix, une baisse artificielle qui contre-carre à distance, la baisse tendancielle de ce même taux de profit. Ce qui explique d'ailleurs le niveau spontané des taux actuels, une sorte de rente cartellière ou monopolistique structurelle : les entreprises gagnent beaucoup TROP d'argent par rapport à leurs coûts de production, le capitalisme a ainsi trouvé une parade à son propre déclin.
Cette poule aux oeufs d'or serait donc condamnée à terme et la justice ferait retour dans l'échange ? Fantastique, car c'est peut-être l'occasion, non pas de rêver à une révolution des échanges vers je ne sais quelle transparence fantasmatique, mais de légitimer les états à opposer à cette réalité le ferme volonté de redistribuer de force la richesse collective : l'impôt négatif. Si le marché s'avère réellement, c'est à dire si l'opinion finit par comprendre comment se passent les choses sur ce marché, alors elle est aussi prête à comprendre le principe de l'impôt négatif. Naître salarié - oh ce n'est pas une nouveauté, il suffit de naître Néérlandais ou Danois pour l'être déjà pratiquement - et vivre libre d'intégrer le marché en y participant ou non; voilà l'enjeu d'une telle découverte. Les économistes sont quand-même de drôle de loustics, depuis un siècle ils avaient tout loisir de constater cette sommation de la plus-value du travail et celle de la productivité qui démultiplie de manière incroyable de vrai taux de profit. Complicité
Philippe Lemoine a cité la Part Maudite de Bataille, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait tendre l'oreille. Malheureusement il n'a pas développé, et peut-être n'a-t-il pas fait de lien direct entre sa découverte basée sur les fameux théorèmes de Moore et de Metcalf. Et pourtant le lien est clair : les énormes bénéfices dégagés par les entreprises du vingtième siècle ne servent pas seulement à contenter les actionnaires mais explique aussi la démultiplication géométrique des budgets au cours des cinquante dernières années. Je me souviens avoir noté qu'entre un budget dont disposait le général De Gaulle et les budgets actuels, il n'y a pas de commune mesure, là où on calcule en centaines de millions, on raisonne en milliards. Bref, la consommation globale de richesse est devenue démentielle, et dans une telle réalité, l'important n'est plus la relation entre l'entreprise et ses salariés, mais bien les stratégies d'investissement collectives de toute cette richesse. On peut comprendre comment les Etats peuvent se payer des danseuses aussi coûteuses que les budgets militaires, et on comprend aussi qui paye le nouvel évergétisme mondial, c'est à dire aussi bien les couvertures sociales que les sommes fabuleuses que constituent les aides internationales qui se transforment en dette. Regardons les dettes des uns et des autres, vertige. Nous sommes en pleine politique. Et encore ! Cette situation reflète seulement un compromis entre le capital et les états : les capitalistes acceptent de lâcher des sous pour ceci ou pour cela, mais conservent la haute main sur l'essentiel, les pension funds sont une véritable contre-attaque du capitalisme qui reste conscient que la baisse tendancielle du taux de profit est une fatalité malgré toutes les manips, et c'est ce que montre la méditation de Lemoine, les actionnaires en ont marre d'être les cocus de la redistribution, d'autant plus que ces actionnaires sont aujourd'hui d'anciens salariés, peu désireux de jouer le social-historique avec tous ses risques.
Bravo. Nous voici enfin arrivés tout près de la prise de conscience du problème de la richesse comme excès et non plus comme pénurie. Tout a toujours tourné autour de l'axiome de la pénurie, la liquidation de cet axiome est un phénomène comparable à ce que serait - à ce qu'est - la disparition des axiomes Euclidiens. Il était temps !
Jeudi le 31 mai 2001
Le risque sur transparent ! Encore l'Université de Tous les Savoirs ! Un Toulousain pâteux et peu convaincu. Management du risque : voilà, tout est dit. Organisation, affectation de ressources usw... L'orateur a vraiment l'air fatigué, et comme je le comprends, comment parler du risque industriel sans parler de la liberté ? ! C'est pourtant ce qu'il fait. Ah ah ah ! j'ai un peu attendu avant de continuer et j'ai bien fait. Figurez-vous que c'est la journée anti-tabac (anti-tabac ! l'Homme se dispose de manière hostile par rapport à une substance matérielle ! c'est incroyable, ça rejoint cette volonté surréaliste de faire de la politique avec les arbres...c'est le dernier avatar de la réification). Le drôle dans l'affaire, c'est que l'OMS, l'organisation mondiale de la santé (organisation de la santé, vous avez bien lu) "met l'accent" sur le risque passif. Autrement dit, fumer est dangereux pour les autres, il faut donc respecter leur liberté de vivre et de mourir. Le résultat prévisible est que le tabac sera interdit depuis longtemps alors que les capitalistes continueront gaiement à polluer à tour de bras en mettant en danger la vie de leurs salariés, du public et de la planère elle-même. Mais le risque sera bien organisé, pardon, bien managé ! Nous disparaîtrons la conscience tranquille en saluant le drapeau.
Mardi 5 juin 2001
La vie mûrit de manière multiple et contradictoire. Elle se remplit en se vidant. Elle se remplit ici, par exemple le ventre, et elle se vide dans les muscles. Elle remplit la tête et vide le désir. Peu de choses restent stables. Pour moi, la plus stable est sans doute l'envie de fumer associée à la question de l'être ! Etrange, n'est - ce - pas ? Ne serait-ce pas ce rapport vécu par bien des intellectuels qui fait peur et qui pousse l'humanité à s'en prendre à l'herbe à Nicot de cette manière parfois ridicule ? Lisez Valéry (mais qui va faire ça ?), il fumait beaucoup, mais ne craignait pas encore d'en mourir, la mort par cigarette n'était pas encore sociale. Autre chose me paraît n'avoir pas changé depuis mes vingt ans : ma force de refus et d'opposition à ce que je considère comme la bêtise (ou le mal comme on voudra). C'est ce qui explique ma situation présente, debout sur une lame de couteau avec d'un côté une mer de lait et de miel, et de l'autre une sorte d'enfer sans fin, où le droit m'est refusé de jouir des fruits les plus élémentaires de la vie sédentaire. Et curieusement les perspectives qui me taraudent en ce moment se mènent une guerre sans merci. D'un côté une retraite monacale dans une maison isolée près d'une forêt, près de la terre lourde et odorante. De l'autre les océans sans freins que mon ancre et mon caprice. Le tout dans cette affaire est d'attribuer les rôles ! Mais aussi de réussir car dans l'âge, ce qui vient à manquer est l'énergie, c'est du moins l'impression que donnent les années. Je pense que ce n'est qu'une impression, et que tout dépend en définitive des autres, de l'Autre. A un certain stade d'intellectualité, ou disons de "science", l'altérité se raréfie comme l'air des hauteurs, et s'il s'y ajoutent des choix moraux essentiels et rigoureux, on se rapproche dangereusement de la solitude la plus complète. On devient une sorte de fou sympathique que tout le monde renonce à prendre au sérieux car trop fatigant et trop dangereux. Ce que j'ai entendu de mieux dans le genre, c'est un ami professeur de philosophie qui me dit - "toi tu es vraiment un intellectuel" - . Cela n'avait rien d'une ironie pleine de modestie, mais c'était du pur cynisme, ce garçon ayant garé ses ambitions bien ailleurs que dans la sagesse, et ce depuis bien longtemps.
Que devient ma force de prévision, dans ce processus de vieillissement ? Elle me semble intacte depuis que j'en ai pris conscience, et ce qui s'ajoute ici, c'est la satisfaction d'engranger les boni du passé. Ainsi, hier j'ai appris qu'un vieux complice de l'audiovisuel venait d'être nommé à un poste important. Ce compagnon m'avait aussi traité de fou, il y a vingt ans, parce que j'avais osé affirmer dans un texte que la réforme essentielle de l'information résiderait dans la décentralisation de l'opinion, c'est à dire que toute réforme devrait désormais viser à ouvrir le droit à l'expression partout, au lieu d'en laisser le monopole aux capitales. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? La moindre radio locale se fait son journal national, international et régional. Hélas la plupart du temps il l'achète clé en mains à... Paris, mais quand même, la tendance est bien là et personne n'y aurait songé il y a deux décennies. Mon argument principal était qu'il n'existe pas d'information locale, et que les événements régionaux ne sont que les ombres ou les répétitions affaiblies des événements centraux. Précisément parce que les droits à la parole et à la décision y sont dérisoires en comparaison avec ceux du Centre. D'ailleurs, ce texte proposait une structure de réforme des chaînes de télévision qui comprenait la fusion de la Deux et de la Trois pour donner une vingtaine de journaux régionaux parfaitement indépendants les uns des autres (et comprenant le National et l'International). On y arrive tout doucement, mais sûrement. Du point de vue technique, et comme quoi il s'agit toujours d'un argument politique, l'expérience du 81/2 (d'ARTE) a montré qu'il était parfaitement possible de parler du monde à partir d'un tout petit endroit et avec de tout petits moyens.
Eclectique ce matin. Entendu hier les ténors de France-Culture du dimanche, la bande à Max Gallo. Sur la sellette Roland Dumas et tous ceux qui tremperaient dans les affaires Elf et autre. Avec cet accord insolite : l'Honneur et le Bien de la République exigent d'hommes politiques aussi importants que l'ancien ministre des Affaires Etrangères, d'être plus qu'irréprochables, d'être des Saints quoi. Curieux, mais cet argument, non seulement ne me convainc pas, mais il me paraît suspect. Cela ressemble à la souris qui se cache derrière le rat pour faire ses petites affaires dans l'ombre. Pourquoi un homme serait-il foncièrement meilleur qu'un autre ? Cette idée repose hypocritement sur la vieille métaphysique du plus ou moins de réalité, alors que tout réside, dans cette affaire, dans la capacité structurelle de l'institution à se réguler en fonction de la faiblesse générale des individus. On se fiche que Roland Dumas provoque une sorte de déception sentimentale, il est un homme comme un autre, ni pire, ni meilleur, et ne l'a jamais été. Ce qu'on pourrait lui reprocher, à titre amical, c'est de n'avoir pas été assez philosophe, car il se serait ainsi évité bien des déboires, il aurait réfléchi à chaque fois que l'existence lui faisait des propositions louches. Des bottines ! Vous pensez, un vrai talon d'Achille ! En fait, un militant de la laïcité comme Gallo devrait se méfier de tels jugements à l'emporte-pièce, il a tout à y perdre car on peut penser qu'il a quitté la carrière politique précisément parce qu'il ne se sentait pas moralement aussi irréprochable qu'il le faudrait...ou alors que la République ne méritait pas ses vertus. Il y a toujours du clérical qui se cache derrière les admonestations gratuites et infamantes. Ces ténors de l'opinion finissent toujours par devenir les bien-pensants, lorsque le droit à l'expression se trouve toujours entre les mêmes mains.
Mercredi 6 juin 2001
Le curseur palpite. C'est mon coeur du petit matin, délégué à l'extérieur pour signifier. Signifier ? Oui, je me souviens maintenant, c'était vers les années soixante quinze, j'avais rempli un petit cahier d'écolier sur le sujet : pourquoi écrire ? Trois ans auparavent j'avais détruit le seul produit écrit de mes années sauvages, un grand recueil d'aphorismes dont le seul mérite résidait dans son ancienneté. Donc, ce cahier d'une quarantaine de pages voulait dire ou expliquer pourquoi j'allais me remettre à écrire. La cause première était mon enfant, il venait de nous être annoncé. Je venais aussi de donner un grand coup de barre à mon existence en commettant mon premier mariage et en lançant un nouvel être humain dans le jeu, heureuse catastrophe de ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais le changement de cap avait été brutal et radical : sans grande conviction mais avec une détermination toute singulière, je me jetais dans la vie active et stable, du moins à sa recherche. Je pensais naïvement que ces deux qualités qui recoupent en gros la sédentarité, faisaient partie des conditions nécessaires du choix de la paternité, jamais je n'aurais pensé que mon ou mes petits n'avaient qu'à me suivre, pensée qui m'aurait sans doute valu moins de déboires dans les années qui ont suivi. Or, l'écriture s'est tout de suite imposée comme ingrédient majeur de la nouvelle vie qui m'attendait : elle devait constituer mon message à l'intention de mon ou de mes enfants. Pourquoi un message ? Ma réponse était univoque : à cause de l'absence de mon propre père. Je ne savais rien de mon père. En mourant il m'avait laissé une image puissante, écrasante de sens, tellement forte qu'il me représentait pour ainsi dire dans toute opération intellectuelle; il était devant, devant moi, comme un porte-parole de mes cogitations. Sentiment étrange qui ne se manifestait en fait que par la prégnance de l'idée de suicide, la question directive était en tout celle de savoir pourquoi on peut en arriver à ce geste, et corrélativement si j'étais concerné par un tel choix, si on peut parler de choix. Pourtant, ce qui m'intriguait à priori, c'étaient les opinions concrètes de mon père : que pensait-il à propos de tout ce qui me fait penser moi-même ? Quelles étaient ses pensées à Lui, mon père ? Quelles pensées, ou mieux, quelle Pensée l'a conduit là où il est, là où, pour moi, il ne devrait pas être ? Cyniquement dit, mon père a désespéré de MOI, quelle pensée, quelles idées ont pu le conduire là, lui qui m'avait manifesté tant d'amour et tant de présence ? Oh n'allez pas croire que je remâche quelque culpabilité cachée, il n'en va pas ainsi, il s'agit de pure logique, une logique de la soustraction : négation de la vie = négation de ses contenus. Bref, il y avait entre mon père est moi, une relation inégale, un gouffre mystérieux, ce qu'on pourrait appeler une totale non-communication. Entre son sourire si chaud et l'image de son corps pendu, il y avait une sorte de trahison incompréhensible. Il m'y avait préparé, d'ailleurs, son jeu préféré était de simuler la mort puis de renaître, jusqu'à ce soir de mai, où le corps n'a plus voulu repartir malgré mes efforts. La suite est simple. Je m'engageais dans la situation paternelle, une conscience nouvelle allait dépendre de moi de la même manière que j'avais moi-même dépendu du destin de mon père. Comment combler le gouffre qui s'ouvrait déjà entre mes petits et moi ? Comment faire en sorte qu'ils ne se mettent pas à errer autour de cette interrogation pénible autour de la pensée du père ? Il fallait que je recouse le tissu déchiré, ou du moins que je fasse en sorte de ne pas laisser mes enfants dans l'ignorance de ce qui m'a fait agir, respirer, continuer de vivre, et, qui sait, peut-être mourir. C'était, et c'est toujours d'ailleurs, une sorte de minimum vital que je pense devoir à ceux qui me doivent la vie, dans tous les sens du mot devoir. Quel intérêt ? Comment ce souci peut-il concerner mes enfants ? Il y a un soupçon assez terrible qui reviendrait à penser que je ne fais rien d'autre que de sauver mon propre père, de le réhabiliter : toute ma propre pensée tournerait autour de la justification du geste paternel : je n'ai jamais pensé que pour comprendre pourquoi cet homme a ainsi désespéré de la vie, non pas pour juger de la légitimité de son geste, mais pour l'absoudre parce qu'il en allait de mon propre salut. Il fallait que je survive au suicide de papa. D'un autre côté il est vrai qu'il m'incombe de par ma place de rétablir une communication entre les générations, la communication qui donne sens ou qui profère le sens pour ceux qui viennent. Pourquoi ? Bonne question. Une question qui n'a pas cessé de me tarauder tout au long de ces vingt dernières années, qu'est-ce-qu'ils en ont à faire de mes idées et de mes soucis ? Quel est le poids ou la valeur intrinsèque de mon univers spirituel pour que j'estime devoir les en informer ? Mais, là n'est pas tout à fait l'objectif, dois-je préciser, car je ne désire pas à toute force informer mes enfants sur les contenus de ma pensée, mais seulement leur laisser de la matière pour le cas où...pour le cas où ils se poseraient un jour la question. Pour le cas où ils se mettraient au fond à souffrir du même manque que moi à propos de mon père. Il est vrai que mon destin a quelque chose de monstrueux dans le sens où les filiations, les errances de mes deux parents et de leurs familles, les guerres et leurs conséquences, ont en quelque sorte anéanti tout ce qui avait été construit tant par les ancêtres paternels que maternels. Il fallait tout reconstruire, et cette reconstruction commençait par un suicide ! Je partais d'encore plus bas que tous les autres en ce lendemain de mai 1946. L'essentiel n'était pas alors de reconstruire un monde matériel, mais de reconstituer la raison elle-même de mon histoire et donc de celle de mes enfants, et il fallait le faire envers et contre toute l'hostilité du destin lui-même. Il y a au fond de moi une rancune contre les ancêtres que je n'ai pas cessé de formuler comme leur responsabilité des grandes catastrophes du siècle dans lequel je suis né. Je les en rends responsables pour la même raison que je me sens responsable de ce qui arrive aujourd'hui à mes enfants. Est-ce si fou que ça ? Oh, je ne désire pas avant tout leur léguer de quoi vivre ou protéger leur existence, je ne considère pas que mon rôle soit de me substituer à leur propre désir ou à leur propre force de vie. Ce qui m'importe c'est qu'ils détiennent une partie du secret de leur existence, celle à laquelle j'ai moi-même eu accès. Le sens de la vie se transmet sur les lits de mort comme les endroits secrets où poussent les bons champignons.
Jeudi 7 juin 2001
Quelle sinistre évocation. Quand cesserai-je de geindre ? C'est le syndrôme de la Shoah, quelque chose comme un paradigme du dernier siècle que chacun met à sa sauce de manière tout à fait sacrilège. Nous sortons tous d'une gigantesque Shoah morale et ontologique : la dévalorisation de l'humain a été poussée à sa limite, de telle sorte qu'il a littéralement fallu repartir à zéro dans le scénario de base. Voilà une théorie intéressante qui me fait penser à Varus et à ses Légions massacrées par le Germain Arminius, un événement qui a sans doute autant d'importance que Waterloo et qui a déterminé une véritable mutation de la politique impérialiste. Auguste avait été frappé au coeur de sa propre sensibilité, la bataille de Teutoburg avait détruit le côté automatique de la stratégie générale de Rome et réorienté son destin. Il fallait réinventer la martingale scénique, reconstruire l'argumentaire de la civilisation elle-même. Mais le résultat pratique de ce traumatisme aura sans doute été l'impérialisme autocratique lui-même : Auguste a vaguement compris que le social et ses développements aveugles menaçaient le coeur même du projet romain, il fallait donc reprendre les choses en main de manière humaine, et comment le faire autrement qu'en prenant soi-même toutes les responsabilités historiques ? Il fallait cesser de faire confiance aux institutions car elles s'avéraient encore plus faibles que les hommes. On connaît la suite.
C'est à peu de choses près la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le discours libéral recoupe exactement ce sentiment de crainte face à des institutions politiques qui foncent dans la nuit sans pilote, et c'est bien là le principal échec du projet sédentaire, la délégation de pouvoir. Nous arrivons enfin aux questions essentielles sur notre forme de démocratie, la démocratie de représentation. J'ai déjà parlé de cette question il y a longtemps, mais elle mérite qu'on y revienne, car si je me souviens bien, j'avais alors traité le sujet du point de vue des principes et non pas de l'histoire réelle de notre présent. L'un des traits importants de la vie sédentaire est la hiérarchisation des sujets, l'inégalisation des qualités qui confèrent l'humanité. Ce processus avait abouti immédiatement au despotisme le plus simple, despotisme dont on ne comprend pas bien, aujourd'hui, la logique implacable qu'il convient de rappeler : la sacralisation du souverain aboutissait au fait que le réalité dépendait totalement (totalitairement) d'un seul homme. Cet homme avait un pouvoir divin au sens que le moindre de ses désirs devait s'inscrire sur le champ dans la réalité, le pire de ses vices était enregistré comme volonté divine. On a parfois du mal à comprendre aujourd'hui les turpitudes d'un Caligula ou d'un Néron (encore qu'il faille se garder d'avaler trop vite des thèses historiques elles-mêmes complices d'un système de pensée ou d'une idéologie, il est si facile de liquider un homme en quelques lignes imprimées). Ce qui est difficile à saisir est la congruance entre la décision perverse et le fait : comment ces psychopathes parvenaient-ils à se faire obéir ? Il y a là un mystère qu'on se hâte trop souvent d'expliquer par la barbarie naturelle des humains ou par le retard civilisationnel d'une époque. Il faut comprendre ici que cette idée de barbarie naturelle recoupe l'idée de la vie comme problème à résoudre par le progrès ou par le travail et l'étude, elle postule aussi une perfectibilité historique de l'être humain, principal mensonge des religions et des cultures attachées au projet sédentaire : l'homme doit être archaïquement mauvais pour légitimer tous les comportements hiérarchiques, toutes les formes de monarchisme. Non, le despotisme est toujours le résultat d'un désespoir ontologique immédiat : tant qu'à faire, si les institutions nous trahissent, choisissons l'homme, avec tous ses défauts, il ne pourra pas faire pire qu'une machine qui s'emballe et détruit tout sur son passage. Louis est un exemple frappant du degré de délégation de la volonté générale à un seul individu, et il est parfaitement logique que son siècle soit le siècle de la dévotion, sentiment qui s'interdit a priori de voir ou d'entendre autre chose que la volonté céleste ou royale. Bien sûr, le despotisme arrange toujours une classe plus large qui sert de soubassement pratique à l'exercice du pouvoir, mais cet élément tactique n'a pas d'importance, c'est le choix de la nature du souverain qui compte, car ce choix se transmet comme modèle de haut en bas de la société et légitime à chaque degré un degré équivalent de despotisme : le chef d'entreprise sera despotique à l'image de son roi, le père de famille et même les élus d'une administration qui peut bien continuer de vivoter comme ce fut le cas au dix septième siècle dans les Parlements de province ou des villes.
Rappelons la fiction du nomadisme : au contraire des structures culturelles et politiques des peuples sédentaires, les peuples nomades ne possèdent aucune institution fixe. Cela ne signifie pas qu'il n'en possèdent pas du tout, tous les nomades traitent de la réalité politique par des conseils périodiques ou au hasard des feux de camp, ces réunions forment d'ailleurs le fondement des institutions parlementaires. Cette immatérialité des institutions rend inutile toute hiérarchisation car aucun profit n'est lié à son existence. Il faut aussi s'imaginer ici ce que cela signifie : les hommes sont des égaux au point que chacun a, en soi, la valeur d'un état ou d'une nation. Lorsque les hommes se réunissent et discutent (par forcément d'ailleurs, il faut aussi admettre la valeur de la dimension cultuelle et rituelle dans une situation où le langage est suspect a priori, et on peut fort bien imaginer des paw-paw où l'essentiel de l'ordre du jour est la consommation rituelle de drogues, de tabac ou encore de femmes. Mythes des ordalies et des orgies, lointains ancêtres de nos "teufs"...) ils sont tous plénipotentiaires, ils ne se mêlent pas de décider pour d'autres êtres que les membres de leur famille, et encore, il faudrait vraiment retravailler historiquement la réalité familiale dans les époques qui précèdent le néolithique. Certains rites mortuaires latino-américains suggèrent une place tout à fait différente des enfants dans le clan que celle à laquelle nous sommes accoutumés par la logique helléno-judéo-chrétienne. Idem pour la place de la femme dans le dispositif, dont la réaction moderne indique bien qu'un dol a eu lieu à son encontre, quelque part dans les millénaires qui viennent de s'écouler.
Plénipotentiaire, voilà ce que l'homme d'aujourd'hui revendique de redevenir, il veut les pleins pouvoirs sur tous les domaines de son existence. Le drame est qu'il ne le sait pas ailleurs que dans sa propre conscience et toujours de manière voilée, au point qu'il est tenté de s'illusionner lui-même parce que c'est plus facile que d'assumer la réalité de la liberté. Et cette timidité se comprend car le sujet est perpétuellement confronté à l'image d'autruis meilleurs que lui, pluss ceci pluss cela et il lui faudrait une sorte d'héroïsme tout à fait inactuel pour oser partager son désir et le rendre public. Or l'irruption du nomadisme par le biais de l'économie ne lui laisse guère le choix, l'homme est pour ainsi dire condamné à la liberté, et cette condamnation sera exécutoire dès que le capitalisme aura rendu les derniers éléments qu'il a emprunté aux diverses formes du despotisme sous le masque de la démocratie de représentation. C'est ce qui est en train de s'accomplir sous nos yeux, et pas moins. C'est aussi l'enjeu politique des années à venir, le Blairisme en est une figure symbolique.
Samedi 9 juin 2001
Ce texte a aussi été écrit afin de compléter la troisième partie d'Atopie.
L'INVENTION DU TEMPS
Dans son Histoire de la Propriété, Jacques Attali décrit minutieusement le processus qui conduit à la "possibilité de la durée". Le capitalisme naissant entre le onzième et quatorzième siècle introduit dans les mœurs le report de jouissance sous la forme de l'épargne de commandite : la bourgeoisie naissante investit dans l'aventure et invente toutes les formes de l'économie qui correspond à la rationalisation de la prise de risque. On arrive très vite au système de l'assurance et à celui de la rente, les deux piliers de la stabilisation de la vie économique au plan social. Jusque là, l'économie était un domaine réservé à l'individu et à la famille dont la richesse et le nom disparaissaient aussi vite qu'ils apparaissaient dans la consommation immédiate et à perte au hasard de la vie. Il s'agit là de rien moins que de l'invention du temps tel que nous le vivons encore aujourd'hui, un temps morcelé par les délais, les reports de jouissance et l'abstinence, mais aussi par un calendrier où la dépense d'énergie trouve une compensation dans le temps "férié" et dans les fêtes. Attali nous décrit avec talent la vie des aventuriers Génois et Vénitiens écumant les océans pour la seule gloire du Nom et le plaisir du gain que fertiliseront ensuite les futurs banquiers italiens.
Il y a là cette conjoncture en elle-même contradictoire dans laquelle l'instinct nomade se met entièrement au service de la nouvelle sédentarité qui s'installe à travers toute l'Europe, une contradiction qui rythme toute notre Histoire. Le capitaine de vaisseau devient capitaine d'industrie parce qu'il dispose désormais d'un Hinterland, des arrières où s'affairent les commerçants et les premières manufactures. La Figure du capitaliste surgit toute entière dans cette alliage contre-nature du bourgeois frileux et de l'aventurier mythique qui se rejoue une dernière fois toutes les Iliades et toutes les Odyssées d'un lointain passé. Mais dans cette opération, c'est le vécu du temps, la temporalité elle-même qui se transforme radicalement. Là où les impérialismes ont échoué, le capitalisme va réussir à fonder la structure phénoménologique dont se nourrit toute possibilité de sédentarité. C'est la naissance du temps rythmé, de la prévision et de l'étalement des événements tout au long de l'existence. En fait c'est l'apparition de la vie comme quantité de temps déterminée et réglée par l'économie de sa subsistance. Pour comprendre toute l'importance de cette mutation, il faut essayer de s'imaginer la situation ontologique
ante
, c'est à dire la structure phénoménologique dont sortent les peuples à cette époque.
Ici aussi il ne peut être question que d'analyse poétique ou de poésie analytique, personne n'aura l'ambition ou la prétention de pénétrer a posteriori dans la psyché antique ou pré-médiévale pour y découvrir cette temporalité oubliée. Mais cette entreprise ne paraît pas si difficile, il suffit de replacer l'homme d'avant le capitalisme dans la fluidité de son destin aux prises avec l'anankè, ce que l'on traduit communément par nécessité ou pénurie selon les besoins idéologiques du moment. Le point essentiel est l'absence de lisibilité de l'avenir, c'est ce dont rend parfaitement compte l'analyse d'Attali, une situation où l'individu n'a d'autre repère du futur que le fas ou le nefas, le faste et le néfaste, deux éléments mantiques qui tentent de donner à toute situation une place par rapport au hasard et à la chance, mais aussi par rapport à la volonté ou au désir divin. A la veille d'une bataille, les Légions romaines n'ont pas d'autre critère de jugement prévisionnel que leur gloire du moment et les prophéties de leurs prêtres. Ces derniers n'ont eux-mêmes que le vol des oiseaux ou la conformation des intestins d'un animal quelconque pour décider du temps faste ou néfaste, c'est à dire, en dernier ressort de la capacité à vaincre et donc à survivre : c'est de survie qu'il s'agit d'abord dans le délicat mécanisme de la temporalité. La plèbe romaine survit au jour le jour, et même lorsque l'empire aura institué un peu partout des sortes de rentes de nourriture - c'est le cas pour la plèbe de Byzance qui a droit par décret à des livraisons régulières de blé - on observe une incertitude permanente due aux nombreuses dérogations conjoncturelles ou politiques.
En gros, la sédentarisation des hommes a immédiatement abouti à la nécessité de colmater les injustices et les inégalités de départ : il n'était pas possible d'envisager de faire cohabiter pacifiquement des groupes humains riches et puissants et des masses d'individus démunis de tout. La première réponse a sans doute été le communautarisme le plus strict, ce que l'on peut observer dans les sociétés des lendemains du néolithique comme Sumer ou Israël. L'inégalité se jouait alors de peuple à peuple dans une incessante guerre de conquête pendulaire où le temps de paix et de gloire correspondait peu ou prou au temps qu'il fallait pour consommer les richesses conquises. Le mythe des "délices de Capoue" illustre parfaitement cette situation de guerriers (les Carthaginois) "consommant" leur victoire de Cannes au lieu de préparer activement la chute de Rome. Mais l'option sédentaire devait fatalement mener à un état de fait où la société allait se diviser en classes. Rome, d'emblée, se fonde sur une répartition hiérarchique stricte où une classe de chevaliers représente la substance dirigeante, directrice du destin commun, et la réponse au problème de la subsistance du reste de la population s'appelle l'évergétisme, abondamment décrit par Attali à propos de la société grecque où les riches sont tenus de financer volontairement une grande partie de la vie sociale. Son principe "du pain et des jeux" a officiellement pour objet la gloire de l'aristocratie, mais en réalité on sait qu'il y allait de la simple survie de ces sociétés marquées par la précarité historique. Quand certains analystes décrivent la guerre du Péloponnèse comme une guerre de classes, ils n'ont pas tout à fait tort, au sens où c'est bien dans la tension entre le démocratisme athénien et l'oligarchisme spartiate que se joue la rivalité entre les deux ethnies grecques. Là où un Solon ou un Clysthène tentent à Athènes de répartir la richesse pour assurer la paix civile, les rois lacédémoniens n'envisagent d'une seule alternative, celle qui consiste à nourrir le peuple afin qu'il se tienne tranquille.
L'évergétisme prend à Rome un caractère institutionnel. La plèbe ne possède ni terre ni trésor, elle n'a aucun moyen de subvenir à ses besoins et c'est donc l'état qui pallie cette carence foncière. Le Sénat légifère sur les distributions quotidiennes de blé et les libéraux d'aujourd'hui sont mal inspirés de critiquer l'état - providence au nom de la gloire des civilisations de l'Antiquité ! De nos jours, certaines nations riches lèguent à leurs peuples de telles rentes de situation, de telles rentes de naissance : naissez Néerlandais ou Danois et votre survie est assurée pour toute la durée de votre existence. Il s'agit bien là de formes contemporaines d'évergétisme à caractère nationaliste, phénomène qui représente un vrai casse-tête pour les dirigeants de la nouvelle Europe. Et cet évergétisme semble représenter la seule et unique réponse à la nouvelle situation dans laquelle nous a conduits le capitalisme lui-même : la pénurie de travail ne pourra à terme et quoi qu'en disent ceux qui nient la perspective d'une telle pénurie, aboutir à autre chose qu'à l'impôt négatif, nouvelle forme du pain et des jeux de la société moderne.
Or l'évergétisme souffre dans l'antiquité d'une incertitude fondamentale à savoir l'identité du souverain et sa capacité à stabiliser ses propres flux de richesse. On sait qu'à son arrivée au pouvoir, chaque empereur devait avant tout donner l'assurance de sa volonté de continuer à donner à la plèbe ce dont elle bénéficiait jusque là. Dans les passes difficiles de l'Empire, les nouveaux souverains n'avaient guère le choix que de pratiquer une stratégie "d'investissement" qui profitait surtout à la puissance militaire. Lorsqu'un usurpateur surgissait au détour d'une victoire militaire, son premier geste était généralement d'augmenter la solde ou de raccourcir le service actif de ses légionnaires. Il n'avait pas le choix. Sa capacité à nourrir le peuple dépendait trop étroitement du succès de ses armes, et ce succès lui-même de la richesse des armées vaincues. On peut donc essayer d'imaginer, de sentir la situation des peuples de l'antiquité : le temps n'a pas de dates fixes, le calendrier est pour ainsi dire vide. Les aléas de la guerre qui forme la rationalité générale de l'étant ne permettent à personne de s'installer dans cette dimension qu'est le temps. Le choix sédentaire est d'abord spatial, mais cette spatialité elle-même détermine l'impératif d'une autre temporalité : pour conserver son sol, l'homme doit désormais pouvoir calculer la durée de sa présence dans cet espace. L'agriculture, base foncière du projet sédentaire, ne peut se passer de toute une série d'assurances qui permettent de tout prévoir, y compris les guerres et les hasards climatiques. Or elle ne possède pas, à elle seule, le pouvoir de faire le calendrier de la vie, l'homme doit trouver un autre environnement historique, lui adjoindre une autre activité de régulation qui, à terme, doit remplacer les fortunes changeantes de la guerre. C'est le capitalisme dont l'originalité et la nouveauté résident dans la mission qu'il se propose, celle de vaincre le besoin, d'en finir avec la pénurie artificielle née de la violence que les hommes restent incapables de réduire. L'agriculture lui servira de modèle, car en définitive les nouveaux mécanismes du capitalisme reposent entièrement sur une dynamique en tous points semblable à celle de la culture du sol : on peut la résumer dans l'idée du report de jouissance. L'aventure commerciale reporte à plus tard la consommation des richesses exactement comme le temps de la maturation des céréales placent le paysan dans une situation d'attente. Mais la différence fondamentale avec l'agriculture, c'est que le capitalisme repose sur le commerce, c'est à dire sur cela même qui en d'autres circonstances signifie automatiquement la violence, c'est à dire les relations internationales.
Les pionniers génois ou vénitiens postulent déjà la situation présente, à savoir la possibilité illimitée de commercer avec l'étranger. Bien sûr, dans la plupart des cas, ce commerce reste très inégalitaire et ressemble davantage à de la flibuste au sens où l'aventure ne consiste pas à réaliser un troc égalitaire, mais à tirer un profit maximum des risques pris. Si on lève l'ancre à Gênes avec une cargaison de blé ou de vin, le capitaine anticipe un retour au pays avec une cargaison de valeur décuple, voire centuple. Certes, ces échanges reposent avant tout sur une estimation subjective de la valeur et le grand art sera précisément l'évaluation des désirs et des besoins des uns et des autres avant de se lancer sur mer. Plusieurs siècles avant eux, les Phéniciens avaient déjà exploité l'échange inégal, mais dans un tout autre contexte, celui d'une vie semi-nomade où le commerce était plus un prétexte qu'un but en soi. Cette flibuste originaire est loin d'avoir disparu du panorama du capitalisme et l'échange inégalitaire reste sa loi la plus essentielle, sans elle, pas de profit. Cette logique commence dans la manufacture ; là le propriétaire estimera comme il l'entend le rapport entre la quantité de travail de ses manouvriers et le prix de ses produits. D'où les théories parfaitement exactes de la valeur travail d'Albert le Grand, de Ricardo ou de Marx. Mais, à ce stade, le danger s'est à nouveau déplacé des frontières vers l'intérieur, de l'étranger dans la société civile. Ce déplacement s'accompagne de la naissance de la monnaie, égalisatrice apparente des valeurs, en fait la monnaie représente la nouvelle souveraineté réelle, celle de la bourgeoisie, même là où elle s'accommodera encore longtemps du principe monarchique. Peu d'analystes, voire aucun, ne se sont rendu compte que cette souveraineté ne s'exerçait pas surtout sur le temps et la qualité du travail des peuples, mais sur leur désir : la marchandise qui naît au Moyen Âge s'impose non seulement en tant que réponse aux besoins fondamentaux, mais en tant que nécessité esthétique. Il est ici intéressant de noter que les premières véritables marchandises fabriquées au cours de processus réguliers de conversion de travail en choses et de rotation normales de capitaux sont des objets de luxe. De même le commerce vénitien ou génois imposera aux bourgeois sédentaires et à ceux qui dépendent d'eux des biens nouveaux et parfaitement inutiles comme les épices, les pierres et les étoffes précieuses.
Dans notre manière de voir, nous commettons généralement l'erreur d'inverser la nature de ce développement. Nous pensons généralement que le commerce a apporté vers l'Europe ce dont elle avait besoin immédiatement, en oubliant que dans la plupart des cas, le commerce amenait vers nos pays des produits totalement inconnus dont il fallait encore découvrir et populariser les usages. C'est le cas de tous les légumes nouveaux comme la pomme de terre, les fruits exotiques, le sucre, le café ou le cacao qui vont prendre le plus clair de la place dans les cargaisons à venir. Le capitalisme invente donc le désir de ses clients en même temps qu'il s'agite autour des mers du globe, l'import export n'est pas seulement affaire de courage et de sueur, mais aussi déjà de marketing et de création du goût. Les classes nobles donnent d'ailleurs le ton et indiquent par leur propre comportement la voie à suivre pour l'avenir et pour ceux qui vont thésauriser la richesse qui tombe de leurs tables. En notre début de troisième millénaire, nous partageons encore sans sourciller la passion des marquis et des duchesses pour le café, le chocolat et bien d'autres biens de luxe dont nos organismes se passeraient la plupart du temps avec bénéfice. Le café représente de nos jours le plus fort volume de transactions marchandes, c'est dire.
Mais l'essentiel est la transformation radicale de la temporalité. L'homme est passé d'une situation d'attente permanente d'un bien et d'un mal aléatoires à une prévision mathématique de ses fortunes et de ses infortunes. En consolidant les résultats de ses commandites par des mécanismes financiers nouveaux comme l'entreprise par action et les nombreuses solidarités bancaires, le capitalisme transforme la nature du temps. Il ouvre en la détendant la vie de chacun; le salaire temporellement versé en échange d'un travail temporellement exercé, de même qu'un revenu régulier de capital issu d'une rotation régulière, éliminent progressivement le sentiment de catastrophe imminente qui est jusque là l'ordinaire de tout un chacun, souverain compris. Double conséquence ontologique : d'un côté le souci se dilue dans le "on" de Heidegger, c'est à dire que l'angoisse existentielle se partage en s'affaiblissant culturellement dans l'ensemble de la société qui organise une sorte de solidarité ontologique permanente. De l'autre cette angoisse change de nature : elle revient à son origine historiale, c'est à dire à la remise en question fondamentale du mode d'existence, l'interrogation ontologique se fait culturelle au sens large. Le succès de la religion chrétienne s'explique en grande partie par le fait qu'elle offrait miraculeusement le cadre nécessaire à ce nouveau partage du souci ontologique. Elle formait une réponse toute faite à la question que posait la laïcisation de la survie, c'est à dire ce que Hannah Arendt nomme joliment le métabolisme des sociétés. Nous disons laïcisation précisément parce que la survie dans l'antiquité dépendait d'un miracle permanent lié à la volonté des dieux, c'est à dire des souverains qui se succèdent sur les trônes et de leurs lieutenants. Dans le capitalisme ce mystère disparaît au fur et à mesure que se stabilisent des échanges qui n'ont plus rien à voir avec la nature du souverain sinon avec sa volonté. On sait que la reine d'Angleterre reste l'une des premières fortunes du monde, miracle de la puissance d'adaptation de cette dynastie, cependant qu'en France les Bourbons prennent enfin le vrai bouillon de leur longue histoire.
Mais à toute laïcisation correspond un vide. De même que l'athéisme ne fait que détruire une explication comme une autre du sens de l'existence, de même la disparition de l'anankè originaire, c'est à dire de la menace de mort présente en permanence, ne fait que vider ou anéantir l'objet du besoin immédiat, c'est à dire de la vie elle-même. Imaginons le nouveau calendrier, en fait le premier et le dernier : il se présente comme une droite régulièrement interrompue par des pics graphiques, tous les dimanches de la vie et tout ce que l'homme s'est fixé comme repères pour se remémorer les stations de son chemin de croix. Face à ce morceau de papier, devenu avec le temps l'alpha et l'oméga de toute vie quotidienne, l'homme apprend à vivre par procuration...du temps. Entre deux pics, entre deux dimanches s'installent malheureusement des vides de plus en plus manifestes. La vie perd son sol signifiant, son signifié de l'urgence mortelle, celle de la pénurie vraie, la disette sans phrases, et celle des fausses pénuries, celle de la grâce divine et des projections vers l'au-delà. Maintenant que l'on peut s'arrêter pour méditer, le regard tombe sur les lundi, les mardi, les mercredi, les jeudi et les vendredi de l'existence, des jours qui ne portent pas seulement un nom mais qui codifient la condamnation hic et nunc à un destin sûr mais qui se décline désormais sur le mode carcéral. Le souverain, lui, s'est mis à consommer ce qu'il arrive à pressurer de ses sujets installés dans cette nouvelle forme de servitude, à défaut d'autres projets, l'avenir n'est plus son affaire, c'est celle des capitaux et des capitalistes.
Nomadisme = compacité. Compacité du temps, compacité de la distribution sociale : il n'y a que des égaux qui survivent tant bien que mal avec la même épée de Damoclès sur chaque tête, le temps est si précieux qu'il est impossible de le débiter en temps vivant et en temps mort, de le programmer pour la joie ou la peine. Chaque seconde se déguste jusque dans le combat mortel et le temps est si dense que la seconde qui précède le coup fatal est encore pleinement vécue comme temps plein, comme bon-heur sans questions. D'où aussi un mépris absolu pour la mort, il faudrait dire une ignorance de cet événement qui n'est qu'un accident terminal que personne n'a le temps d'anticiper. D'ailleurs le souci individuel est si fort que l'homme nomade n'a pas le temps de s'appesantir sur le destin d'autrui. Voici le programme à venir : cette compacité est de retour comme exigence pratique. C'est la fin de ce que Abraham Molles appelait le temps intersticiel, à savoir un temps vide d'action, de pensée, de projet ou de sens propre. Dans l'ascenseur qui nous conduit au cinquantième étage, dans le métro, dans la salle d'attente, dans l'avion, on est fait comme un rat, que de temps perdu, que de rien à supporter dans l'angoisse collective. Mais le pire est que la presque totalité de l'existence est devenue intersticielle, elle ne sait plus d'où elle vient ni où elle va en elle-même et pour elle-même parce que le vide de la programmation englobe désormais la totalité du destin humain. Cette perte de compacité, de synchronisation directe avec le temps réel, marque le destin du capitalisme lui-même parce qu'il ne sait pas, apparemment, se détacher du modèle de souveraineté monarchique. La perte de dignité qui accompagne la servitude économique actuelle demeure estompée par la magie bourgeoise d'un pseudo renouvellement décrété par le monde du spectacle, ce que Baudrillard met sous le concept de simulacre. La mise en scène d'un échec du communisme vient de donner un sursis au capitalisme et une nouvelle religion de l'irrationnel est en voie d'aménagement. Mais tout cela appartient déjà au passé parce que le souci fondamental du temps présent n'est plus, lui non plus, le besoin tel que fomenté par le capitalisme. Ce dernier à inventé jusqu'aux produits les plus absurdes pour survivre, l'automobile en est le meilleur exemple qui a généré un tropisme du mouvement brownien qui s'évanouira du jour au lendemain, comme s'est évanoui l'autre opium du peuple. Il s'évanouira parce que le capitalisme s'est laissé aller à la facilité, une facilité qui l'a mené en deçà de la religion, en deçà d'un travail minimum sur la question du sens et de l'être.
Cette incroyable insolence, car c'est bien de cela qu'il s'agit, devra se payer et tout le monde paiera, ceux qui ont décidé comme ceux qui ont suivi aveuglément. Et l'histoire repasse souvent les plats, on le sait bien, l'évergétisme pourrait fort bien se retrouver très bientôt à l'ordre du jour. Dans la réalité économique et sociale de la plupart des nations modernes, cet évergétisme existe sous de multiples formes larvées ou avérées dont la protection sociale, et notamment le principe de la retraite par répartition, sont les meilleurs exemples. Mais d'une part la conscience politique se dissimule cette vérité sous le maquillage d'une pseudo solidarité objective de la société, alors qu'en réalité les déficits des états sont des condition sine qua non de leur existence. Depuis que les diverses protections sociales existent, les états financent le déficit, épongent comme ils peuvent les dettes qui s'accumulent. L'inflation n'en est que le résultat extrême, le fait économique qui identifie parfaitement la crise finale du capitalisme. Cela explique le caractère tabou que les autorités européennes tentent de donner à l'inflation depuis que le libéralisme américain s'est vu contraint d'en faire autant au nom de sa survie. Mais cette inflation, ces dévaluations silencieuses sont consubstantielles au capitalisme s'il veut lui-même survivre comme forme d'organisation sociale. On a vu après la Deuxième Guerre Mondiale comment les USA se sont vu obligés de financer le relèvement de l'Europe et du Japon à seule fin de leur éviter une chute dans le communisme. Qui leur a remboursé quoi, où, quand, combien et en quelle monnaie ? Evidemment que Washington a tiré de cette générosité qui leur vaut aujourd'hui encore une grande influence tant en Europe qu'en Extrême-Orient, d'énormes plus-values politiques et idéologiques. Mais ces capitaux ont été consommé, détruit sans fruits économiques, exactement comme les milliards que les nations consacrent pendant des décennies au développement du Tiers-Monde avant de se résoudre à des moratoires douloureux. On sait que cette douleur est toute apparente, puisque l'argent prêté au nations pauvres travaille quand même finalement dans nos banques, même si c'est sous un nom à consonance exotique. L'essentiel pour notre analyse demeure : cet argent est un cadeau des peuples, il a été donné par le contribuable sous forme d'impôts et ce dernier peut bien constater, mais il ne le fait jamais, que son argent est mal géré depuis toujours. Mais quel citoyen a une telle mémoire et une telle volonté de justice ? On traîne aujourd'hui dans la boue des hommes d'honneur pour une paire de bottine, alors que des maîtres incontestés d'hier ont pratiqué des politiques bien plus criminelles par leur côté veule et complice de nébuleuses privées. Ainsi le plus clair de l'aide aux pays pauvres doit sont existence à la volonté des gouvernements d'apaiser d'abord le contexte social dans lequel NOS nationaux continuent d'exploiter les principales richesses de ces pays lointains. Se rappelle-t-on aujourd'hui d'un certain Bokassa et du gaspillage des deniers publics français auquel son règne a donné lieu ? Il est un exemple minuscule dans la constellation financière du gâchis.
Oui l'évergétisme revient par la grande porte à cause précisément du tabou de l'inflation. Plus question de nos jours de laisser incognito les deniers de l'état s'envoler vers les Républiques bananières ou vers les poches des sans abris. Et pourtant les pauvres continueront d'exister de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres à travers le monde. Nos sociétés seront doublement assiégées, de l'extérieur et de l'intérieur et il ne restera tout comme hier et avant-hier comme seule solution de désamorcer concrètement cette pauvreté en l'absence d'une possibilité d'une liquidation par guerre ou par pandémie. Dans ses rêveries du simulacre, nos décideurs font mine de croire à une révolution de l'économie telle qu'elle va régénérer une fois de plus le puits aux emplois et la Corne d'Abondance. Et il y a du vrai dans cette description conjoncturelle, nous l'avons montré plus haut. Mais pour que ces deux mamelles de la stabilité sociale et de la paix mondiale puissent donner tout leur suc, il faudra rationaliser à nouveau le destin de l'être humain en lui conférant enfin une véritable liberté par rapport à ses besoins animaux. Le futur évergétisme se donnera pour objectif de libérer l'homme de toute contrainte quelle qu'elle soit. L'imagination créatrice grâce à laquelle l'homme peut entrevoir de fonder un nouveau monde d'abondance et de fertilité est à ce prix.
mardi 12 juin 2001
Brèves.
Bush en Europe, porte d'entrée, l'Espagne. Washington n'oublie jamais ses débiteurs, billard politique délicat car c'est un vote à l'OTAN qui est en jeu à propos du nouveau-vieux gadget de la guerre des étoiles. L'impression qui domine, c'est que les Américains n'arrivent pas à se renouveler, aucune imagination à droite, et c'est sans doute le cas de toutes les droites, même celles qui semblent réussir. Bush aurait certainement mieux fait de viser Londres que Madrid, le fait même qu'il snobe sa cousine montre qu'il y a de l'eau dans le gaz. On voit aussi que lorsqu'une droite est à court d'idées (et d'avenir) c'est toujours la guerre qui revient comme thème de sauvetage.
Berlin se prononce pour l'arrêt du nucléaire civil. Quelle connerie ! C'est un recul honteux, car plutôt que de relever le défi scientifique de la maîtrise de ce qu'on a fini par gagner envers et contre la soit-disante Nature, on se débine pour des motifs de petite politique. Bien sûr, sans doute que personne n'est dupe puisque ce retrait va prendre encore quelques décennies et qu'on peut donc jouer sur le temps et les modifications politiques. Mais quelle perte de temps pour l'Europe et quel mauvais exemple pour les autres. Il va falloir encore se battre pour ne pas se voir condamné à faire pareil ! Et puis ça sent tellement le romantisme débile et la magie à la Jacob Boehm. C'est l'amour du fossile.
On va voter une loi européenne qui associe les salariés aux décisions d'une grande entreprise, notamment en cas de plan de fermeture. Pas de quoi se gargariser car depuis la Loi (elle a fait un tel flop que j'en ai oublié le nom !) qui perscrit la consultation des salariés dans les entreprises françaises, on a compris que c'était une blague. La Loi Auroux (ah quand même !) est complètement oubliée. Pourtant son histoire mériterait d'être analysée scrupuleusement. Elle montrerait que c'est une des rares Lois sociales qui a fait l'unanimité contre elle. Les syndicats ont cartonné en parfaite harmonie avec le patronat, et pour cause ! La Loi Auroux inventait une nouvelle instance dans l'entreprise, une instance qui échappait aussi bien au patron qu'aux syndicats. Ouste ! Dans nos entreprises, le silence règne à nouveau comme avant. Il faut bien dire que les salariés n'avaient guère le choix face à la coalition de leurs défenseurs avec leurs adversaires. Je préfère penser qu'ils s'en foutent, et ils ont raison.
Quelque part dans le Pacifique un touriste américain s'est vu trancher le cou par des rebelles islamistes. Je m'y vois.
Mercredi 13 juin 2001
PROPRIETE PRIVEE ET HUMANITE
Quel malentendu ! L'impossible sédentarité implique une impossible propriété privée ! De Grotius à Schumpeter on sent la perplexité des savants et des philanthropes : l'homme sédentaire ne peut s'identifier qu'à travers la terre et son appartenance au sol. Or le sol, la terre, l'espace sont en eux-mêmes indivisibles. Dans Au propre comme au Figuré (Une histoire de la propriété, Biblio Essais 1995), Attali suit l'itinéraire de ce double-bind à travers les millénaires et c'est saisissant. C'est un vrai massacre, une charcuterie cadastrale où l'envergure du sujet tente de s'ajuster à celle de la terre, ou de faire plier la terre à la nature de son ambition. La réponse la plus courante et la plus logique à cette énigme c'est le choix délibéré de la propriété privée comme critère de l'humanité. Aristote avait déjà fait ce choix sans aucun état d'âme : les bons gérants de la richesse sont les bons gérants de la réalité (quand même, c'est assez sordide) et il faut leur confier le pouvoir politique. C'est la conclusion quasi unanime qui court à travers toute l'époque qui s'étend depuis les confins du néolithique jusqu'à nos jours. Avec une petite différence qu'il faut signaler, entre ceux qui font une nuance entre nécessité et superflu, et ceux pour qui la richesse est une. Pour ces derniers, la propriété privée est vraiment ce qui est nécessaire à un homme pour en faire un homme. Ils réfléchissent en fait comme ceux qui disaient jadis que seule la gloire identifiait l'être humain, tous ceux qui n'y avaient pas accès n'étaient que des animaux sans importance, propres donc à tout, y compris l'esclavage. Pour les premiers, la propriété privée ne doit pas mener à la misère et à la mort de ceux qui n'arrivent pas à se la procurer. Ils distinguent en effet une propriété du nécessaire de celle du luxe, en disant, comme Robespierre à la tribune de la Convention (je cite le livre d'Attali) que la propriété privée ne doit concerner que cette partie superflue des richesses, mais que la richesse comme moyen de survie doit être assurée à tout le monde. Paradoxe, car cette belle idée humanitaire est illogique à peu près à tous les plans tout en demeurant la seule solution au problème de la société sédentaire. Il faudrait que les Hommes choisissent de redevenir nomades pour que le problème de la propriété privée disparaisse sans laisser de traces, exactement comme il est apparu.
Les adversaires de la propriété privée, parmi lesquels on aurait tort de compter Marx qui se moquait copieusement de la fameuse phrase de Proudhon : "la propriété c'est le vol", occupent une position intenable. Pourtant, il avait tort de s'en moquer car c'est la vérité la plus originaire qui soit. Seulement, il faut préciser dans quel monde on se trouve : dans une praxis nomade, la propriété privée est vide de sens parce que les richesses passent comme le temps. Les hommes cheminent dans un espace qu'ils n'exploitent que temporairement. Ils n'ont rien à voir avec le sol comme alter ego et se contentent d'en tirer ce qu'il leur offre au jour le jour. Il ne viendrait ainsi pas à l'idée d'un nomade de se définir comme possesseur d'espace autrement que comme libre propriétaire de tout ce qu'il rencontre dans ses courses. Le sol est une richesse infinie ou indéfinie qui appartient d'emblée à celui qui l'exploite au moment de son passage. Ce qu'il faut comprendre avec précision ici, c'est que le sol ne peut pas être une propriété (un attribut) de l'homme parce que celui-ci n'entre jamais en relation stable avec celui-là. Il ne le prend pas en considération comme une prolongation ou une partie de lui-même ni même pour un miroir ou un cadre du mystère de son être. C'est pourquoi le nomade sera toujours un million de fois plus "humain" que l'homme sédentaire : il ne partage pas son humanité avec les choses, il prend à lui seul toute la responsabilité de l'étant, toute la responsabilité de la question de l'être. Il est seul, toujours absolument seul pour résoudre le terrible problème de la présence, de sa présence au monde et de la présence du monde à lui. Hercule, c'est bien la figure mythique de ce héros philosophique, et pas du tout musculaire, qui sert de fondement originaire à l'idée même d'homme. Il faudrait peut-être s'exprimer autrement et dire que pour un nomade, l'étant est son extension naturelle, il a partie liée avec la réalité en un sens que nous avons du mal à concevoir du haut de notre dualité sujet-objet, dans notre idéologie de l'hostilité de la Nature et de notre volonté de la dominer. Cette complicité naturelle explique d'ailleurs le génie pratique des nomades, leur immense culture botanique et zoologique (voir Levy-Strauss) ainsi que leur sens inné de l'orientation comparable à celle des animaux migrateurs : le sol est une propriété
intérieure
du nomade, elle est une vraie propriété, c'est à dire un attribut de son humanité, une qualité qui la définit en tant que telle. Le passage à la sédentarité est bel et bien une Chute ! Chute à laquelle il faut donc aussi associer la naissance du Bien et du Mal
Une seule conclusion est possible, ou disons une seule réponse s'impose lorsqu'on se demande qui a raison de ceux qui parlent d'une propriété privée absolue (la possession de la terre fait foi de l'humanité et seulement elle) et de ceux qui esquissent l'idée d'un superflu qui peut bien se reléguer au privé, à condition que les besoins essentiels de tous soient garantis. Dans notre contexte naïvement sédentaire, ce sont les seconds qui sont, depuis toujours, dans le vrai. Tout simplement parce que le sol ne peut pas se partager objectalement de manière égalitaire, ni le sol ni ses ressources. La terre et son appartenance resteront toujours la cause d'une problématique morale de l'être humain, de ces idées absurdes et comiques d'un homme Bon et d'un homme Méchant. C'est pourquoi la réponse au terrible problème que pose la propriété privée effective restera toujours, en époque sédentaire, l'idée de l'évergétisme. Les Grecs, encore eux, avaient compris intuitivement que les aristocrates ne pouvaient se distinguer que par le luxe et l'ostentation à condition qu'ils financent en partie (par l'impôt et par le don) la réponse à la question du besoin collectif. De nos jours, cette crise est intacte dans ses termes et dans ses menaces, et la seule réponse moderne réside dans l'impôt négatif. Ce Carthago delenda de toutes mes analyses économiques et politiques ne va pas sans soulever des difficultés car l'évergétisme, même rationalisé, ne supprime pas le fait que l'homme sédentaire ne puisse s'empêcher de s'identifier proportionnellement à la terre et à la richesse qu'il possède. Les différences qu'illustrent la variété des propriétés privées ne s'effacent pas par simple décret. Cependant, l'évergétisme rationel contient justement la seule mécanique incitatoire qui s'intéresse au désir propre des hommes : ce n'est qu'à l'intérieur d'un destin assuré dans son besoin que l'individu peut accéder au désir de se dépasser, c'est à dire, dans le contexte sédentaire, d'acquérir de la richesse superflue. Comme l'avait prévu et calculé Galbraith en traitant de la question dans les années cinquante, l'existence d'un impôt négatif n'aboutirait jamais à décourager la majorité de travailler, bien au contraire. Bientôt dans ces pages, une dissertation sur le besoin et le désir !
jeudi 14 juin 2001
Sacré Rocard ! Voici un homme qui me fait revivre la France de mon enfance, cette enflure narcissique du plus beau et du plus intelligent pays du monde !! Faut le faire. France-Culture : Le service public selon un ancien Premier Ministre de Mitterrand, un cours plus ENA que ça, tu meurs. Si seulement il ne mangeait pas toutes ses fins de phrases ! Je crois entendre mon ami Joël Creusat, grand pape de la statistique nationale. Mais quel talent ! Comment la France a réussi à contourner les problèmes les plus redoutables qu'a posé la sédentarisation confronté au capitalisme victorieux. Voilà le genre de choses qui permettent de penser que la France est une des plus belles réussites du choix sédentaire, un phénomène lié sans aucun doute à la variété ethnique originaire de ce pays si harmonieux. Je me souviens, lorsque, enfant, je regardais une carte géographique, je ne voyais pas une forme aléatoire d'espace, mais LA forme idéale d'un pays. J'avais du mal à comprendre pourquoi les autres pays n'avaient pas cette forme magique d'un hexagone parfait, bordé de montagnes et d'océans ! Véritable miracle qui paraissait on ne peut plus normal. Quand -même, c'est pas rien cette manière d'être bien dans ses frontières, je dirais presque dans mes charentaises ! Faut-il ajouter que le souffrance des frontaliers comme moi n'en est que plus forte, lorsque le côté problématique du sédentarisme se fait jour dans la réalité historique. Lorsque cette forme magique perd son prestige sous le sifflement des balles, des Stukas et des bombes. Mais voyez la mentalité de ces frontaliers : des fans de la France, des patriotes comme il y en a peu ailleurs, des amoureux de la matérialité du sol français, de son équilibre, et ce matin de son service public !!! Fabuleux. Comme j'ai toujours spontanément choisi le service public contre le privé, je ne me sens pas peu fier en ces temps où ce service se voit débiné à peu près partout. Le privé, c'est dégueulasse, faut le dire, c'est plein de vices perso, du jus de bactéries sociales. Au fond, l'esprit de service public c'est l'utopie d'un travail intellectuel pur et vertueux, d'une élaboration collective de la question de l'être, ou du moins de la mise de côté des problèmes d'intendance, comme disait De Gaulle, au profit de l'essentiel. Car le service public n'est pas une société de charité style britannique, c'est un instrument neutre de fonctionnement de la démocratie. Comme je fréquente beaucoup les gares ces derniers temps, je me surprend souvent à méditer sur un banc de quai, et savez-vous ce que j'ai découvert hier soir en regardant entrer le Corail Paris-Mulhouse ? Je vous le donne en mille, la SNCF est une géniale invention nomade, une manière vraiment conforme à ce génie français de satisfaire l'instinct foncier de l'Homme, le parcours de l'espace. Et puis il faut bien dire que l'état français a inventé deux éléments totalement nomade à l'intérieur même de l'appareil de gestion du sédentaire : la décentralisation et la flexibilité du service public. Un bon serviteur du service public ne cesse de voyager à travers son pays tout au long de son existence. Bon, cela dit, mon cher Michel, ce matin tu es bon sur cette question, mais je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, tu n'as rien fait, ou pas grand chose, pour empêcher la dérive du service public vers les marais du privé ! Ou bien ? Tu vas te réfugier longtemps encore derrière la soit-disante toute-puissance du Président qui donne les grandes orientations ? Non mais, t'as vu Chirac ?
Vendredi 15 juin 2001
Alger en feu. Un million de manifestants, deux morts (des journalistes) et deux cents blessés. Je dois faire amende honorable, car au moment où je commençais à avoir raison, j'ai fait comme tout le monde pour donner une chance à Bouteflika, mon ancien patron. Quand il est revenu au pouvoir, j'ai eu la faiblesse de penser qu'il pourrait et qu'il avait la volonté de pacifier la situation et j'avais affronté une militante du FFS complètement démontée contre lui et qui prévoyait assez bien ce qui se passe en ce moment.
Reprenons. Depuis vingt ans je pense que l'un des principaux problèmes de l'Algérie est sa coupure historique entre Arabes et Berbères. Cette situation que les Turcs et les Français avaient calmée par la force a repris tous ses droits dès l'indépendance. Je me souviens que la première opposition à Ben Bella est venue de Kabylie où le FFS de Aït Ahmed a tenté, dès 1963, de combattre le monopole du pouvoir que s'étaient arrogé le groupe de Tlemcen, c'est à dire les Arabes de l'Oranie, dont "Boutèffe" a toujours été un représentant fidèle. Cela m'a d'ailleurs valu une arrestation et une mise au secret dans les bâtiments anonymes de la Sécurité Militaire algérienne, situés tout près de l'Aletti. Pendant trois jours on a essayé de me tirer les vers du nez, sans me toucher, mais mon compagnon de cellule revenait de chaque interrogatoire avec un morceau en moins. J'avais été dénoncé comme appartenant à ce groupe de Pieds Rouges qui trafiquait avec Aït Ahmed, mais heureusement j'avais toujours refusé de me mêler de la politique intérieure de l'Algérie, et en plus je ne savais rien de précis sur les Français qui étaient dans le coup.
Le vrai problème est que les Arabes n'ont jamais accepté de partager équitablement le pouvoir avec les Berbères. Dès 1962, c'est à dire en rentrant en Algérie après la signature des Accords d'Evian, Ben Bella et Boumedienne avaient pris le pouvoir ensemble en écrasant les soldats de l'"intérieur", ceux de la Willaya 4 d'Alger, composée d'une majorité de Kabyles. L'injustice est flagrante parce que les Kabyles représentent une population très active (autant pendant la guerre de libération qu'en terme de poids économique actuel). La Berbérie ressemble en cela au Pays Basque espagnole qui est la province la plus riche de la péninsule ibérique, et qui s'était distingué dans le combat contre Franco. Le lobby arabe a notamment mis la main sur la manne pétrolière que se partagent les généraux. Ce qui est étrange, c'est que la plupart des analyses de ce matin ignorent cette dimension, alors que l'Algérie fonce vers une véritable partition, même s'il existe une solidarité de classe entre toutes les populations de ce pays, saigné d'abord par la rancune du Général De Gaulle, puis par l'arabisation forcenée entamée par Boumedienne. Lorsque j'étais enseignant à Tizi-Ouzou, de 1969 à 1971, les attentats émaillaient déjà la chronique locale, mais silencieusement. Comme quoi, les colonisations ne sont jamais que des parenthèses qui ne transforment en rien les données de base de l'histoire d'un pays : les Arabes ont conquis le Maghreb militairement et culturellement dès le Septième Siècle, mais les Berbères n'ont jamais baissé les bras, se contentant d'occuper les pitons de la Berbérie en restant à l'écart des routes turques. On ne mesure pas le fossé qui sépare les deux ethnies, et cela à cause de l'illusion qui provient de la religion commune, un malentendu vécu par d'autres peuples en d'autres lieux, avec les conséquences qu'on sait. De plus, il s'agit là, encore une fois, d'une guerre d'autant plus impitoyable en termes historiques de durée, qu'elle oppose une ethnie d'essence nomade, les Arabes, à une population sédentarisée avec succès par Rome dès l'aube de la civilisation. La tragédie est que le nomadisme arabe structure l'Islam tout entier et que les Berbères d'origine sédentaire pratiquent une religion qui trahit secrètement leur être originaire. Quel pataquès !
Samedi 16 juin 2001
Dans ma constellation intellectuelle il y deux systèmes de pensée, deux structures parallèles qui doivent, quelque part, trouver à se réunir en une seule unité de sens. Ouf ! Quelle ambition ! Mais je n'ai pas le choix, la pensée est une, et je dois parvenir à réussir cette opération afin que l'ensemble de ce que je pense soit cohérent, non ? En gros, pour ceux qui ont mis leur nez dans ce site Internet, il y a d'une part mon "système" ontologique, et de l'autre mon histoire anthropologique. Il faudra donc que je commence par situer le lieu de rencontre de ces deux catégories culturelles, si un tel lieu existe, et puis montrer que l'un ne va pas sans l'autre et vice et versa, que l'un s'origine dans l'autre, et vice et versa, logique naturelle de l'unarité. Le premier danger est le côté formel de cette exigence, il se peut que je me trompe sur l'importance stratégique relative de ces deux domaines de pensée, et que l'un ne soit subordonné à l'autre que par un ordre chronologique de parousie, d'apparition. Autrement dit, que l'un des deux est d'ores et déjà obsolète et qu'il a déjà laissé entièrement la place à l'autre. Mais ceci serait assez absurde puisque les deux ne semblent pas du tout parler de la même chose, ou, disons qu'il est difficile de distinguer par où les deux systèmes parlent de la même chose. Encore que, si on maîtrise bien les deux discours, comme j'ai intérêt moi-même à le faire, il paraît évident que les deux théories s'harmonisent parfaitement. Il me paraît même assez évident que c'est l'ontologie qui commande de manière exotérique et de manière ésotérique l'ensemble de la substance spirituelle articulée autour de la notion d'être.
Curieusement, les deux domaines d'analyse illustrent la dichotomie corps et âme, matière et esprit etc... le doublet qui fascine encore aujourd'hui toute pensée commençante. L'anthropologie qui tourne autour un concept de nomade et de sédentaire s'identifie évidemment avec le corps et la matière, alors que l'ontologie se cantonne exclusivement dans l'immatérielle spéculation intellectuelle. Rien pour moi que de logique dans cette impression, puisqu'il n'a jamais été question de faire une ontologie pour l'ontologie, c'est à dire une explication désincarnée de l'existence, d'exhiber une compréhension transcendante de notre être-là. M'intéresse pas. Les écoles de Martin Heidegger et de Karl Marx ont à cet égard été d'une importance capitale dans mon parcours culturel, car le faire et l'être m'ont toujours paru constituer une seule et même notion. La régression culturelle que représentent à ce titre les religions, procède précisément de ce défaut majeur de la métaphysique occidentale depuis Platon, à savoir le monopole qu'exerce encore aujourd'hui l'idée que la vie se passe à côté de la recherche ontologique. Le schéma platonicien, bientôt en passe de devenir une banalité médiatique, ne dit rien d'autre que cette ipséité de la pensée immatérielle, entièrement détachée de la réalité matérielle, pensée des formes parfaites d'un monde imparfait, d'une vérité absolue d'un monde relatif. Seul le platonicien Hegel échappe à ce piège en subsumant un monde à l'autre, ce qui fait la toute-puissance de son message ; il a suivi en cela l'exemple ancien d'Aristote. Il n'a pourtant pas évité de délivrer un message "de classe", c'est à dire une théorie de la païdeia, de la formation, qui ne s'adresse qu'à des esprits préformés à le recevoir, ou bien, comme on veut, qui interdit à d'autres de le recevoir. La scorie de son système, sa théorie de l'Etat, illustre parfaitement la nécessité où il se trouvait de donner à son discours un style et une logique théologique. Exactement comme Aristote s'est vu contraint, pour des raisons logiques, de légitimer l'esclavage tout en nous laissant le souvenir d'un Grec qui meurt en affranchissant tous ses propres serviteurs.
Alors, par où se croisent les deux orbites de ma pensée ? Résumons le parcours de la première, celle de mon ontologie : l'être-là se définit tout entier par le fait de la conscience, je dis bien fait, on pourrait aussi dire comme les grands philosophes de la conscience : l'état de conscience, mais cela laisse toujours entendre un aspect passif de la conscience, ce qui m'a toujours paru impossible. La conscience est acte, elle est même le seul acte qui ne puisse être voulu en tant que tel, même si sa constatation et sa méditation peuvent entraîner un développement rationnel et volontaire de l'action. La conscience est le point de départ. Rien de neuf en cela par rapport à la Phénoménologie de l'Esprit, même si Hegel prend soin de nommer cette conscience-là certitude sensible. En fait, la conscience est un double vecteur ontologique : elle ouvre le champ du réel et sert de connexion avec l'être par qui elle est enjointe d'agir, c'est à dire d'être active, d'être action. Cette injonction ne ressemble certes en rien à une révélation parce que la conscience se trouve être contenu en même temps que contenant. Dans cette perspective, la conscience pourrait être considérée, nous n'avons aucun moyen d'en apprendre davantage là-dessus, comme un outil ontologique qui apparaît historiquement (ici il faudrait employer le néologisme heideggérien d'historialement) dans sa forme actuelle, ce qui nous obligerait à spéculer sur l'existence avant le néolithique justement d'une forme primitive (animale ?) de la conscience. Une forme à laquelle manquerait certains mécanismes pratiques, mais non pas le principe de l'ouverture. C'est là une distinction qui me paraît capitale : la conscience aurait bien changé d'une certaine manière, mais jamais dans son degré d'ouverture par rapport à l'être. Il se pourrait même, et la théorie heideggerienne de l'Oubli de l'être est là pour le suggérer, que cette ouverture diminue dans l'autre sens du temps, et que nous soyons arrivées à un minimum critique, à la Crise vraie de la conscience, celle qui précède sa disparition. Or une telle disparition n'a pas de sens en tant que responsabilité humaine, elle ne peut provenir que de l'être lui-même qui pourrait bien se fatiguer et s'endormir pour de bon. Bon bon, soyons sérieux.
L'Homme nomade se trouve donc automatiquement relégué dans cette partie de l'histoire de la conscience où elle n'a d'attribut ou de propriété certains que cette ouverture. L'Homme de la préhistoire partage avec nous cette qualité de la conscience qu'est son ouverture à l'étant-là, au monde tel qu'il est simplement encore une sensation vague ou un monde élaboré et qualifié. L'Histoire ne serait rien d'autre que la qualification de ce réel qu'offre spontanément la conscience. Mais nous n'oublions pas que la conscience est être en acte, c'est par la conscience que nous acquérons la certitude que le monde EST, en cela Descartes ne s'est pas trompé le moins du... monde, non plus que Kant et ses frères allemands. Il vaudrait d'ailleurs mieux aller tout de suite à la proposition kantienne qui affirme qu'en même temps que la conscience constate le monde, elle le construit, pensée qui était déjà présente chez Descartes, mais affectée d'une incertitude métaphysique à caractère théologique. Il vaudrait mieux, car Husserl dit la vérité lorsqu'il affirme que toute conscience est conscience de quelque chose, proposition qu'il faut prendre selon ses deux génitifs : conscience de quelque chose signifie aussi bien conscience d'un OBJET que conscience DE cet objet, c'est à dire reflet de l'œuvre de la conscience, le monde. Le monde EST la pensée du monde ou le monde est l'actualisation de sa pensée. Rien d'idéaliste dans cette constatation, seulement l'évidence que tous les actes de la psyché - rappelons-nous comment Descartes caractérisait la pensée, dans laquelle il classait aussi bien la perception que les passions - procèdent de la même et unique pensée. Aimer c'est penser, exactement comme sentir, c'est une relation dans laquelle il y a deux pôles aimant, sentant et pensant, c'est la chair de la relation d'être-là.
Reste à rendre compte, poétiquement s'entend, du sens des changements de direction pratique opéré par l'animal humain, le choix qu'il fait, à un certain moment de modifier son comport à l'égard de ce qui est présent dans l'ouverture de sa conscience. (Il faudra méditer la notion de moment car il est difficile de se contenter de désigner une date, les dates n'ont en elle-même aucun sens, même si on les définit par rapport à des événements concrets comme par exemple les glaciations). L'Homme s'est arrêté pour prendre connaissance de ce qui l'entoure à ce moment-là ou du moins d'entrer en une autre relation pratique avec ce que lui livre de tout temps sa conscience : cette conscience semble, à un certain moment, lui révéler qu'il doit modifier son attitude fondamentale. Pourquoi ? Je l'ignore, mais on peut spéculer : il est possible, et ce sera ma thèse ontologique, que la conscience aie dû modifier son propre être pour continuer d'assumer son ouverture. L'agriculture est née parce que la conscience s'est trouvée brutalement ou progressivement menacée de disparition. La suite est connue, l'âge sédentaire ouvre les portes d'une nouvelle forme de connaissance, de "naissance-avec" c'est à dire d'origination des vivants et des choses. Ici tout devient obscur et difficile, car de même que la conscience est conscience de quelque chose, la connaissance est toujours connaissance AVEC quelque chose : nous ne sommes pas seuls dans l'acte de connaître, cet acte est plutôt à considérer comme une jonction entre un objet et un sujet. Etant entendu que cette double volonté de se joindre est toujours déjà là, dans l'ouverture primitive de la conscience. Mais ensuite les choses s'éclaircissent : la connaissance est attachement du sujet et de l'objet et comporte donc le risque permanent de la fixité, de la réification, de la paralysie. Le cours du temps du monde, c'est à dire de sa création continue par la conscience se trouve en danger de blocage, d'arrêt correspondant à ce que nous entendons sous le terme de mort. Les sauts de puces d'idéologies en idéologies, de Weltanschauungen en Weltanschauungen illustrent parfaitement ses événements de connaissance qui aboutissent toujours à des amorces de catastrophes dont les conséquences s'avèrent de plus en plus abyssales dans l'histoire. S'il arrivait que la volonté s'inscrive tout entière dans une connaissance, cela se ferait aux dépends de la subsistance du tout, cela pourrait être par exemple la conséquence du nucléaire, mais ce dernier n'apparaît que comme un risque un peu plus grand, c'est à dire, peut-être, justement ce qui préserve l'ouverture de la conscience, la notion de mort.
Résumons. Le temps n'a pas d'âge. Cette proposition mystérieuse ne voulait rien dire d'autre que le fait que l'ouverture de la conscience, la temporalité, n'a jamais varié et ne peut pas varier. Mais cette ouverture demeure constamment menacé de variations et l'être s'avère prêt à tout pour empêcher une volte destinale qui compromettrait fatalement cette ouverture. Et c'est normal puisque cette ouverture c'est l'être lui-même qui ne fait que se défendre en imposant à la conscience les outils nécessaires au maintien de cette ouverture. Les constructions de cathédrales sont de magnifiques illustrations de cette morale supérieure de l'ouverture, où l'architecture tournait entièrement autour des arrivées de lumière et, corollairement aux problèmes techniques que cela posait, les systèmes de contraintes et d'oppositions de force qui couraient à travers tout le bâti. Il ne fait pas de doute que c'est la grande perfection de ces réalisations qui font des cathédrales autre chose qu'un gratte-ciel quelconque, même si les gratte-ciel dégagent également quelque chose de fort dans le sens de l'acquisition de lumière et d'équilibre tectonique. On pourrait penser que l'architecture est le lieu essentiel de la pratique sédentaire, au sens où elle conjugue les deux oppositions fondamentales de l'ouverture et du mouvement de la force. La réalité est énergie et mouvement, Aristote l'avait déjà dit avant la physique moderne. Cela signifie que l'être est caractérisé par la force qui s'investit dans le mouvement : on peut imaginer ce à quoi expose alors la décision d'arrêter le mouvement en présence de la force !! Les murs du Temple de Salomon sont bien dérisoires pour contenir cette menace d'explosion permanente, et l'Histoire a montré la précarité des œuvres architecturales. Plus que précaires, elles sont condamnées à terme, mais non pas pour laisser la place à une nouvelle forme de mouvement synchronique avec la nature, mais pour s'incarner dans l'Esprit. C'est à de nouvelles formes architecturales de l'Esprit que l'Homme est condamné à s'ouvrir s'il veut amortir le choc entre la force qui s'accumule et l'immobilité qui la contient artificiellement. En ce sens, on ne créera jamais de symbole plus parfait du programme permanent de l'être-là humain que les cathédrales. Pas étonnant qu'elles déplacent des marées humaines à longueur d'année.
Dimanche 17 juin 2001
Souvent je me suis demandé pourquoi peu de dictatures se maintiennent longtemps. Inexplicable ! Pourquoi les militaires chiliens ont-ils fini par se laisser déborder par le mouvement démocratique ? Pourquoi en Argentine, au Brésil, en Afrique du Sud et même en Indonésie, le despotisme n'a-t-il pas tenu le coup malgré sa position a priori imprenable ? C'est la visite du pape au Guatemala hier qui a éveillé mon attention, car France-Culture ne rate jamais une occasion pour faire plaisir à JP II, même de la façon la plus perverse. En l'occurrence il s'agissait de rappeler l'action de l'archevêque de Guatemala City qui avait constitué un vaste service de défense des Droits de l'Homme et qui avait fini par être lui-même assassiné, voici un pays où l'adversaire de la théologie de la liberté, JP II, va être accueilli pour les mérites de ses adversaires... Mais là n'est pas la question. En écoutant les interlocuteurs de la radio, je me suis rappelé l'histoire tragique de ce petit pays d'Amérique centrale. En bref : la culture des bananes et des ananas pour la United Fruit ne tolère pas la démocratie, surtout pas celle que pratiquent les Indiens majoritaires au Guatemala. Aussi dès les années du Président Monroe, Washington pratique-t-elle une politique de paternalisme dur à l'égard du peuple guatémaltèque : le bâton de la dictature s'abat sur les Indiens depuis plus d'un demi-siècle, l'un des bilans officiels parle de 180 000 morts et plus d'un million de gens déplacés et poussés sur les routes de la fuite. Entre autre on peut signaler, et ce sera intéressant pour la suite, que les autorités d'origine espagnole ont profité de ce demi-siècle pour détruire de fond en comble tout ce que les Indiens avaient construit et tous les lieux qu'ils avaient choisis pour vivre. But : détruire la culture, le ciment du peuple, sa pérennité de peuple de l'humanité et plonger les Guatémaltèques dans une totale dépendance vis à vis du maître. Mais voilà, ce maître a aussi fini par se ranger et par une série de négociations entre une guérilla épuisée et des autorités soumis aux pressions de l'Amérique de Clinton, une paix durable, semble-t-il, s'est installée là-bas, au point que les touristes s'y précipitent déjà. Et en reviennent enchantés par les qualités de ces gens fiers et simples.
Bon, le cas des Amériques latines est assez limpide, et il sert de modèle à beaucoup d'autres pays où Washington exerce sa tutelle de manière évidente ou voilée : les tyrans fleurissent et dépérissent au gré de la couleur politique de l'Amérique du Nord. Le reaganisme a fait plus de victimes indirectes que l'ensemble des dictatures du monde entre 1982 et 1990, alors que la démocratisation s'est répandue un peu partout sous les deux mandats de Clinton, même en Haïti, il faut le faire. Or, on sait que Clinton comme Kennedy ou Johnson n'ont pas fondamentalement changé la donne. Les Démocrates de Washington sont loin d'être des gauchistes, et c'est bien sous le Président assassiné à Dallas que la guerre du Vietnam a pris un tour sanglant et que Washington a tenté un coup fourré contre Castro. Les intérêts de l'Amérique restent ses intérêts, quels que soient les maîtres de la Maison-Blanche, Carter a eu le plus grand mal a gérer la crise du Nicaragua, contre ses propres services secrets. Première conclusion : le destin d'une dictature reste toujours entre les mains de la grande puissance dont elle dépend sur le fond. Il faut préciser qu'en Amérique centrale tout entière, l'enjeu se situe avant tout dans la défense des intérêts des grandes multinationales agricoles américaines, au mépris des notions les plus élémentaires des Droits de l'Homme. Vérité en deçà des Pyrénées, mensonge et indifférence au-delà.
Mais ceci n'est qu'un aspect immédiat de la question, presque anecdotique. Ce qui est fascinant, c'est que dès qu'un peuple s'affirme par un comportement démocratique, il devient suspect et passible d'une sorte de châtiment historique, après quoi on le laisse respirer, convaincu que la totalité des souffrances endurées le laisseront assez pantois pour quelques décennies et à nouveau exploitable à merci. L'exemple du Guatemala est particulièrement intéressant parce que l'instinct démocratique est particulièrement vif dans la population indienne, opprimée sans pitié depuis la nuit des temps. Mais l'idée qui perce à travers ces exemples un peu exotiques, c'est que la même loi de punition historique a cours chez nous, dans l'environnement historique le plus sophistiqué du point de vue des Droits de l'Homme et des pratiques démocratiques. Et, eh oui ! Cela rejoint notre critique impitoyable de la situation présente dans toute l'Europe : parfois je me dis que le Français moyen est soumis à la pire des dictatures, celle qu'on ignore parce qu'on ne veut pas la voir, parce que la somme de peur intériorisée dans le passé est tellement grande qu'elle écrase encore aujourd'hui toute velléité de lutter pour une vraie dignité, un vrai respect de l'homme et de ses droits. Toute velléité de même constater le degré de servitude réelle dans lequel on accepte de travailler, de produire et de consommer. Cette servitude est évidemment pour sa plus grande part une servitude intellectuelle, une résignation cosmique telle que seul un crime comme la Shoah peut l'avoir engendré. Oui, le trauma nazi a produit sa conséquence naturelle, la terreur, mais pas seulement pour les peuples qui ont eu à en découdre directement, mais pour des générations d'Européens. Aujourd'hui le culte de la mémoire reste ambigu : d'un côté il permet de garder la dragée haute à tout ce qui de près ou de loin ressemble au fascisme, de l'autre il sert de pratique mnésique du temps de l'Apocalypse humaine et terrestre. C'est bien pourquoi nous pensions, jeunes, que tant que le principe de la guerre restait vivant, que ce soient les deux Grandes Guerres ou seulement les guerres coloniales qui ont suivi, il faudra plusieurs générations pour régénérer l'instinct d'orgueil et de dignité absolue de l'individu. Ici encore, Mai 68 marque une limite entre les générations perdues, résignées, et les hommes nouveaux ou plutôt qui avaient originairement vocation à être nouveaux. L'échec du mouvement était donc essentiel pour les tenants de l'exploitation de l'homme par l'homme, car dans les conditions bénignes dans lesquelles il se déroulait, il ne pouvait que souligner l'impuissance profonde et réelle du citoyen face à la machine à écraser l'humain. Aujourd'hui, le culte de la consommation est la dernière forme symbolique de la résignation humaine, les visionnaires de Mai 68 en étaient parfaitement conscients.
Mercredi 20 juin 2001
"Mais la morale exige d'accélérer l'inévitable. Aussi faut-il
vouloir
le "socialisme", non parce qu'à défaut d'une telle volonté il ne se réaliserait pas, mais parce qu'autrement, la classe ouvrière, qui vivra de toute façon son éternité dans sa victoire, aura subi d'inutiles souffrances". (Au Propre et au Figuré, J. Attali, Biblio Essai page 333). Je m'étais souvent posé la question morale de la Révolution, à savoir pourquoi faut-il la préparer, l'organiser politiquement, et ne pas laisser faire tout simplement le capitalisme qui, de toute façon, court à sa perte ? Attali présente cette réponse comme celle de Marx et celle-ci semble cohérente, du moins d'un point de vue chrétien, mais ce point de vue reste aussi une idée à résonnance capitaliste : il faut ici aussi
épargner
de la souffrance. ¨Pour ma part, la cause morale de la lutte contre le capitalisme me paraît se situer tout à fait ailleurs, car non seulement la lutte est de toute façon engagée en permanence dans le présent, même si elle ne s'affiche pas publiquement, mais surtout parce qu'il s'agit d'un choix de civilisation, d'une option volontaire humaine.
On a, en effet, affaire ici, au coeur même de tout le problème politique du capitalisme, mais aussi de tout problème politique en général : l'Homme ne peut pas d'un côté se contenter de disserter sur un phénomène historique qui s'accomplit malgré lui, et en même temps vouloir définir d'avance les critères de ce qui adviendra en fonction de son désir, un désir qui de ce fait même est condamné à rester stérile. Je m'explique. Ici le point de vue moral tourne autour de l'honneur engagé par l'être humain dans une quête de ce qu'on voudra, bonheur, justice, épanouissement etc..., c'est à dire d'un choix destinal. L'Homme ne peut pas
vouloir
avancer et progresser sans s'y engager lui-même immédiatement, ce serait trop facile et ne ferait que correspondre à une vaine spéculation de type capitaliste : on place ses billes sur une théorie politique et économique, et on attend, assis dans les chauffeuses. Non, cela n'est tout simplement pas possible, et repose une fois de plus sur une vision transcendantaliste de l'existence, sur une passivité religieuse reposant sur des Lois à prétention naturelle. Il y aurait une loi économique de gestation du bonheur humain ! Je ne pense pas, d'ailleurs, que Marx lui-même ait eu la faiblesse de penser ainsi, car il ne fait lui-même jamais référence directement à un bonheur eschatologique. Il se contente de parler de l'accouchement de l'Histoire elle-même, affirmant prudemment que ce que nous considérons comme l'Histoire n'est que la pré-histoire de l'Homme.
Je soupçonne, pour ma part depuis lontemps le Léninisme de reposer tout entier sur l'idée fallacieuse d'une lutte d'accompagnement, c'est à dire de la mise en place d'une dictature du prolétariat formée par une élite ouvrière (une notion totalement empoisonnée et qui repose sur un malentendu absolu de ce que Marx a voulu dire quand il a affirmé que ses écrits étaient lisibles par tout le monde à condition d'en faire l'effort, ce qui est vrai.). La crainte de Marx de voir surgir l'état prussien au lieu d'une véritable démocratie ouvrière provient justement de l'idée que la Révolution ne pouvait être réellement voulue que par une minorité de prolétaires "conscientisés". Les autres ne feraient jamais que suivre par la force et la terreur, car ils sont gangrenés sua sponte par le virus de la propriété privée. L'incroyable erreur petite-bourgeoise de Lénine aura été cette défiance à l'égard de ses propres troupes, un mépris qui pèsera lourd quand il s'agira de prendre des mesures terribles contre les différentes fractions du prolétariat russe après 1917. Ce en quoi, il faut le rappeler, Trotski ne se différencie guère de Lénine, lui qui ordonne et accomplit la dure répression contre les marins de Cronstadt.
De quoi est-il question ici ? Certes pas d'une nième critique du stalinisme ni d'une tentative de sauvetage de la Révolution d'Octobre. Celle-ci reste malgré tout ce qu'on en dit et qu'on en dira, un événement capital de l'Histoire, le véritable lever de rideau de la pièce qui va encore occuper le public pré-historique encore un certain temps. Il s'agit ici de tout autre chose, en fait de reprendre contact avec la réalité et de sortir des contes de fée des idéologies présentes qui plutôt que de s'opposer, semblent se compléter pour en finir avec l'idée de révolution et se tourner les pouces ou presque. Ou presque car j'en veux pour preuve la stratégie et les idées de la toute dernière organisation qui ne cache pas avoir à voir avec cette idée de révolution, je veux parler de l'association ATTAC. Formée à l'origine par des intellectuels tous plus marxiens les uns que les autres, cette nouvelle Internationale entend accompagner le capitalisme vers sa perte en limitant les dégâts qu'il cause en passant. Marxien est à prendre au sens où l'entendait Rubel quand il parlait de la pensée marxienne comme véritable culture du texte de Marx : on est marxien lorsqu'on a lu et compris le Capital, mais aussi toute l'oeuvre philosophique de jeunesse du grand homme. On sait aussi que Marx aurait dit que lui-même n'était pas marxiste, prétexte à inventer le néologisme de marxien, degré supérieur de la connaisance de la doctrine... Bref, l'âme de la machinerie d'Attac est la taxation du capital, la fameuse Taxe Tobin, prélèvement social d'une dîme sur les transactions financières internationales. Autrement dit, l'essence de ce qu'ils désirent se trouve dans le soulagement que pourrait apporter aux plus pauvres un mécanisme parfaitement étatique, et donc parfaitement capitaliste. On a affaire là à un charity business tout ce qu'il y a de plus classique, et qui ne ferait, s'il arrivait à ses fins, qu'à conforter le capitalisme lui-même puisque une telle taxe donnerait non seulement un nouveau sens au monde marchand, mais il produirait de plus une nouvelle dépaupérisation artificielle, ce dont le capitalisme contemporain a le plus besoin.
Tout ça ne peut pas marcher, en tout cas ne peut pas figurer dans une quête volontariste, c'est à dire consciente, de l'être humain. Ce serait à peu près comme si on disait à un machiniste de locomotive de démarrer sans qu'il aie la moindre idée du lieu où va son train. Non, la révolution a toujours été, là où elle a été Révolution, projet délibéré et conscient tant dans le fond que dans sa forme. Je suis toujours frappé par l'indigence de la pédagogie dès qu'il s'agit de la Révolution Française où il est très rare que les historiens s'intéressent aux débats interminables qui ont précédé les grands événements des années 1790. Pourtant, ces débats forment et illustrent cette volonté et ce désir qui bouillonne et s'exprime, posant des valeurs pour des millénaires. Les échecs répétés de la révolution ne sont pas les preuves de son impertinence scientifique, mais sont des échecs partiels, exactement comme une bataille perdue ne signifie pas toujours qu'une guerre le soit. Evidemment, la guerre elle-même peut être perdue, c'est peut-être aussi déjà le cas pour le projet socialiste, mais alors l'accompagnement du capitalisme sous sa forme actuelle risque de ne pas être autre chose qu'un accompagnement de mourrant; une action ridiculement vaine et qui se révélerait plutôt comme un ultime coup de main pour éviter le pire au...capitalisme !. Il n'en va d'ailleurs ainsi pas seulement pour la révolution, car tout projet humain, le pire soit-il, est d'essence volontaire et repose sur un désir humain. Le capitalisme lui-même est un projet de cette sorte, il n'est pas un phénomène sociologique ou pseudo historique dont nous serions les théoriciens découvreurs. La théorie historique, lorsqu'elle s'exhibe comme une telle fatalité, n'a pas d'autre but que de désamorcer les volontés, d'affaiblir les hommes qui voudraient s'opposer au projet dominant en les noyant dans le fatalisme pseudo scientifique de l'idéologie scientifiquement répandue. La prétendue fin de l'Histoire est bien le fin mot de cette roublardise qu'on a quand même encore généralement le bon goût de trouver scandaleux.
Il n'y a pas d'histoire-spectacle. Cette idée est le pire des avatars de la société du spectacle, et aussi son secret. Guy Ernest Debord le savait bien, même s'il ne l'a pas expliqué avec toute la clarté qu'il aurait fallu à une conclusion aussi grave. L'histoire-spectacle c'est l'idée d'un déterminisme transcendant, religieux ou scientifique, qui donne forme au destin humain comme le cimentier donne forme au béton précontraint. Dans une telle Histoire, l'Homme sautille d'un épisode à l'autre en cherchant à chaque fois seulement à tirer son épingle du jeu dans l'attente des développements ultérieurs. Cette vison n'est pas seulement condamnable d'un point de vue moral, c'est à dire du point de vue des morales qui ont encore cours forcé, à savoir les différentes déclinaisons du monothéisme parmi lesquels il faut hélas bien situer aussi le marxisme. Cette vision du temps humain a perdu de vue le temps humain, c'est à dire la temporalité. Il prétend voir un temps neutre, objectal, détaché du souci de l'Homme et de sa détermination mortelle. C'est aussi ridicule que de vouloir faire voir le monde à une taupe alors qu'il peut fort bien se passer de cette vision pour vivre : l'Homme ne peut pas vivre en étant Homme sans une telle vision, sa temporalité n'est rien d'autre que le souci permanent qui sous-tend tous ses choix : comme le disait autrement bien Sartre, l'Homme est toujours déjà engagé dans un choix et ne peut pas se laver les mains de sa propre histoire. Pas de poncepilatisme possible à moins de former le projet clairement énoncé d'en finir avec l'humain. Ce fut la tentative nazie et elle est toujours possible, elle demeure encore et toujours l'alternative macabre du destin de l'animal politique appelé Homme. En une telle occurence il faudra cesser de lui donner ce Nom.
Oui, il y a une nécessité morale à ce que l'Homme hâte sa Révolution, qu'il la pense, la prépare et en affronte les tragiques difficultés. Mais cette morale réside toute entière dans l'engagement pour des valeurs, engagement sans lequel aucune valeur n'a la moindre chance de voir le jour. Il faut bien garder à l'esprit que les deux millénaires qui viennent de s'écouler n'avaient qu'à sucer le sein chrétien pour y trouver substance à former un semblant de cohérence à ses actions. Il faut bien savoir et accepter de reconnaître la lointaine domination de quelques empereurs et Pères dits de l'Eglise sur toute la réalité temporelle de ces vingt siècles. Voilà qui n'est pas facile, ni du point de vue moral courant, ni du point de vue de l'honneur, honneur au demeurant pas perdu pour tous puisqu'il est aujourd'hui, plus que jamais, question de sens, de valeurs et de Droits de l'Homme. Oh bien sûr, cet affairement peut bien passer pour cela même qui désamorce tout sens de projet, et c'est ce dont j'accuse les gentils militants d'Attac, sans les condamner pour des actes dont ils ignorent les conséquences. Il faut bien dire à leur décharge que le capitalisme triomphant de l'après URSS avait de quoi confirmer tout le fatalisme contenu dans le marxisme et décourager tout volontarisme politique. Ce volontarisme n'est pas le volontarisme au sens moral-chrétien du terme, il n'est pas une injonction à l'effort laborieux pour construire un édifice sans objet comme on fabrique aujourd'hui les marchandises, il est esprit. Il est travail de l'esprit qui se reproduit en tant qu'esprit, c'est à dire en tant qu'attribut essentiel de l'Homme : l'Histoire est bien celle de Hegel, la temporalité dans laquelle l'esprit s'emporte et s'enroule sur lui-même pour demeurer, face au néant. L'Histoire est résistance au néant, et cette résistance elle-même porte en elle l'exigence du projet qui vaut dans le temps et pour le temps, c'est à dire pour le destin et l'être de l'Homme.
Samedi 23 juin 2001
Tout cela est bien beau, mais certainement très mal dit. Il faut toujours mieux dire, en fait d'abord trouver à dire, puis esquisser, puis affirmer. Ici nous n'en sommes qu'à l'esquisse, l'expression d'un sentiment qui ne se sait pas encore comme concept malgré le style de l'affirmation qui domine du début à la fin. Jean Michel Kanner m'a d'ailleurs laissé entendre sans ambages que je suis illisible, ce qui est un défaut majeur pour un journaliste, hi hi.. Mais le sujet est trop sérieux pour le laisser dans ce clair-obscur, il est impératif que le Dire puisse s'identifier avec l'action et qu'inversement l'action s'éclaire dans le Dire.
Alors quoi ? Alors, je voulais dire ceci : l'Histoire est affaire de sujet. En tant qu'Histoire elle n'est pas seulement un récit fabriqué et dit par quelqu'un, mais action imaginée, réalisée et cataloguée dans un Dire par un homme, par un sujet conscient. Paresseusement installés dans nos idéologies fatalistes, nous oublions volontiers, et ce pour de nombreuses raisons, qu'il y a toujours dans le passé que nous nommons Histoire, une décision humaine qui donne sens aux faits dont nous questionnons le sens. Comme disait Nietzsche, l'homme qui a été au plus près de cette vérité, il faut toujours demander QUI et non pas quoi. Ce que récusait cet immense penseur n'était pas les valeurs en tant que telles, mais le fait que ces valeurs se présentent comme transcendantes par rapport à la volonté humaine, étrangères. Il faut toujours savoir reconnaître à distance la volonté et même les caprices d'un esprit qui fut puissant au point de donner inflexion à la réalité humaine, c'est à dire former son Histoire. Bien sûr, Nietzsche mettait aussi en garde contre les conséquences des formes aléatoires de la volonté, il s'insurgeait en fait contre les Sujets qui ont monopolisé ce pouvoir d'infléchir la direction du temps humain en des sens mensongers. La religion chrétienne est dénoncée pour ce qu'elle est, c'est à dire système de domination irrationnel et égoïstement subjectif. Ce ne sont pas les dogmes qui sont récusés mais les hommes qui s'en sont servi pour asservir en dépit du sens. Les nouveaux philosophes auront, selon lui, à se mesurer au défi qui consiste à dominer selon la Raison, à assumer le danger qu'elle exhibe en tant qu'absence de sens de ce qui précède. Zarathoustra n'est pas du tout un Hitler quelconque, mais un Christ de la Raison, un crucifié du sens.
Or le sens lui-même est affaire d'Homme ! Il n'est pas vérité transcendante révélée par magie, mais très exactement ce qui demeure dans le présent comme signification absolue, absoute par notre propre esprit : il est le miroir de notre esprit, le lieu où ce dernier se reconnaît et se relie Historiquement aux esprits du passé. Encore du jargon ! Disons ceci : dans les actions du passé chacun d'entre nous peut reconnaître son propre désir transformé, voulu et transformé en réalité. Il peut aussi y reconnaître ses propres mensonges, ses propres petites escroqueries morales destinées à tromper, voler son temps aux autres et imposer une mise en scène collective qui finit, comme la religion, par donner au projet criminel personnel une force extraordinaire. A de telles mises en scène il faut des révolutions, il faut que les victimes parfois millénaires fassent alliance pour détruire les fausses vérités qui fondent le présent. C'est pourquoi toute révolution est dangereuse. Elle comporte l'inconnue fondamentale : QUI va prendre la direction du présent ? quel QUI mérite une telle reconnaissance collective qu'il peut légitimement imprimer sa marque à ce présent et fonder le contexte du futur ? Les tenants du pouvoir ont toujours intérêts à faire croire que la sagesse est dans la conservation de ce qui est, c'est à dire de ce qu'on mis en scène les Pères du passé ; ils ont un tel intérêt parce qu'ils sont les héritiers de ces Pères. Les anciens et les nouveaux dieux ne sont toujours que des hommes.
Tout cela pourrait nous aider à donner sens à la distinction Esprit / Matière : la vérité est que l'homme en tant qu'animal n'est effectivement que de la matière, mais il est esprit là où il est Homme, c'est à dire là où il manifeste sa volonté dans l'action, même la pire. Encore Hegel. Il est évident que la décision ancienne est immatérielle, même si elle garde dans le présent des représentants matériels. Une église est le fruit d'une décision passée, une décision qui n'est rien d'autre qu'un accord abstrait et vide de matière entre des hommes morts depuis longtemps, mais le fait que des hommes du présent se reconnaissent dans cette décision en poursuivant le culte dans cette église est purement spirituel, il est la continuation de la décision initiale, de la volonté originaire. C'est un fait spirituel. L'esprit n'est rien d'autre que le lieu où se reconnaissent les hommes d'un bout à l'autre de l'histoire, dans le Bien comme dans le Mal. Rien de plus matériel que les anges et les démons.
Dimanche 24 juin 2001
Pourquoi tous ces mots alignés ? Pourquoi cette écriture ? Personne ne lira plus jamais. Je me sens dans cette situation extrême où on a atteint la limite de tout désir d'intellection. Ca n'intéresse plus personne, le poids des photos a effacé le poids des mots, définitivement. Il y a, il faut le reconnaître, une certaine légitimité historique à cette surdité collective, le Savoir s'est tellement sali dans l'exercice du pouvoir ! A tel point qu'on ne sait plus aujourd'hui ce qu'est le SU du savoir, le prix de la tradition, son sens réel et son contenu.
Et pourtant je continue d'écrire et je continuerai tant que je vivrai. Le message de la tradition s'est presque totalement effacé. On ne sait plus ce qu'on dit, on ne comprend même plus ce qu'on écrit, les meilleurs écrivains ne produisent plus que des bribes de ce savoir, des particules éparses de la Connaissance fondamentale. Heureusement, pourrait-on dire, la nature de l'être est telle que chaque élément contient le tout, à la manière des grands textes philosophiques. Encore faut-il qu'une structure systématique se présente d'une manière ou d'une autre pour donner accès au détail : celui qui écrit doit avoir partie liée avec la tradition, que ce soit dans le produit de son travail ou dans sa vie. Dans le futur il faudra le plus souvent lire les vies pour comprendre les textes.
Car quel est le message de la tradition ? Il n'est rien d'autre que la transmission généalogique des actions. La Bible semble faible là où elle accomplit le mieux cette transmission, c'est à dire dans les longues filiations tribales, apparemment sans intérêt. Il est vrai que ce texte reste symbolique parce qu'il ne se comprend pas lui-même pour ce qu'il est, pour le secret de l'identité des auteurs du Temps humain. L'Histoire est, comme j'essaie de le dire plus haut, le fil que l'on peut tendre entre des hommes, leurs actions et le présent, et rien d'autre. Bien sûr, ce fil est extrêmement difficile à saisir car il se produit une sorte de tissage des causes et des effets, les hommes se meuvent à l'intérieur d'une concurrence sanglante dont le résultat le plus fréquent surgit comme compromis. Pour faire court, on peut comparer l'influence décisive d'un Alexandre sur le cours des actions humaines avec celles de ses lointains imitateurs, sans oublier que cette influence est concurrencée violemment par celles des grands monstres du passé comme Tibère, Néron, Justinien et tellement d'autres.
Dans le registre du savoir, la chose est encore plus manifeste et plus délicate. Aimer la vérité ou la justice aujourd'hui, c'est d'abord aimer les hommes qui ont inventé ces valeurs et ne pas se laisser abuser par ceux qui se sont saisi du monopole de la décision concernant le SU. La tradition est continuité de l'humain et non pas culte tabernaculaire de la vérité : il n'existe nul endroit où l'on peut stocker la vérité ou la justice, pas plus que le mensonge ou l'iniquité, il n'y a que la mémoire des hommes qui ont consacré leur vie à ces valeurs et leur reconnaissance. Ces mêmes hommes ont inventé les dieux pour se faire des alliés gratuits, de faux ancêtres qui viennent légitimer de manière fantasmatique une réalité présente. Le mythe de l'origine n'a pas d'autre raison d'être que la prétention de se donner des Pères, de donner à ses actes une légalité historique. Mais l'origine n'est jamais ailleurs que dans la vie d'un homme et de ses amis ou complices à travers les siècles.
C'est aussi pourquoi la faille du néolithique nous paraît infranchissable : les hommes d'avant n'existent pas, ils n'ont pas de nom, ils ne sont pas identifiés au sens sédentaire et n'ont aucune propriété discernable. Ces hommes ont sans doute vécu d'une manière inimaginable pour nous, précisément sans identité autre que la dimension humaine : ils formaient l'humain seulement ensemble, et c'est cela l'intuition d'Aristote quand il affirme la naturalité du politique. Lévinas retrouve cette intuition lorsqu'il déclare que l'humain naît seulement dans la rencontre. Seulement, la seule dimension de l'ensemble à laquelle Aristote avait accès était la famille, par conséquent il n'avait pas le choix que de la prendre pour point initial de dérive de l'humain proprement dit, c'est à dire du politique. Or il aurait fallu renverser les termes de l'analyse et dire que l'humain n'est apparu que sur les bords de la famille, là où des hommes se sont rencontrés hors de leur génération et de leur mort. Dans la négation de la famille.
Les maladies psychotiques en disent long sur les filiations réelles de l'esprit humain. Les identifications absurdes traduisent en fait une dépendance psychique tellement absolue qu'elle prend le pas sur une identité fragile et jamais totalement acquise dans le cadre de la fiction sédentaire : le sujet présent tombe dans le Sujet de son réel, dans le personnage qui détient toutes les clés de son être. On ne s'identifie à Napoléon que parce qu'on est dans l'impuissance à sortir du cadre ontologique qu'il a fixé à plusieurs siècles de distance. Le propre est une fiction libératoire, mais la liberté d'être est une loi sans pitié à laquelle on ne peut se soustraire que de deux façons : l'oubli par le divertissement pascalien et la névrose ou la psychose elle-même. C'est fou, non ?
Non. Car tout ceci a des conséquences infinies et incontournables. A commencer par des nécessités immédiates pour chacun de se trouver et de conserver une identité gérable ou maîtrisable malgré les influences aussi immédiates des parents. Ces derniers ne peuvent guère faire autre chose que de transmettre leurs propriétés, dans tous les sens du mot. On hérite des biens matériels, mais on hérite aussi d'une partie lourde de l'identité familiale, elle-même constituée par des identifications interminables et inextricables. Une psychanalyse étudie avant tout la constellation familiale qui domine en pratique tout esprit frais, toute âme d'enfant, qui la modèle plus ou moins profondément selon le degré de liberté d'esprit des aïeux. C'est le côté difficile à comprendre de soi-même lorsqu'on se remémore les croyances fortes qui ont marqué notre enfance, religieuses, morales, politiques. C'est aussi la raison de la convoitise sans pitié des pouvoirs pour les enfants et la formation : il est essentiel pour les possesseurs de pouvoir de garantir les valeurs qui le fondent, de génération en génération. Il peut s'agir d'une famille bourgeoise depuis cinq siècles, mais aussi d'une famille embourgeoisée par une volte aléatoire des mouvements sociaux.
Autrement dit, il est d'une absolu nécessité pour chacun de refaire le chemin inverse à la rencontre de ses vrais Pères. La culture est la discipline qui permet une telle expédition qui se trouve heureusement simplifiée par toute une série de codes parmi lesquels le langage se situe au premier rang. Remonter au mort, comme au bridge, est une obligation loin de n'être qu'un devoir moral, elle est une nécessité sanitaire et qui s'accomplit dans la plupart des cas sur une base commune et moyenne. La médiété aristotélicienne se retrouve également dans ce secteur de la vie, car s'il faut se garder d'être mauvais, il ne faut surtout pas être trop bon : il faut rester dans la moyenne, il convient de s'inscrire dans la conservation de l'héritage !!! Cette remontée au mort se fait donc à travers des codes, les philosophèmes de base, les grandes conventions morales et techniques, les axiomes de la vie courante, et le plus gros de cette quête s'acquiert par les habitudes et par l'imitation aveugle. L'une des définitions de la finalité de l'intelligence pourrait être le retour systématique sur tout ce qui a été produit par les habitudes et l'imitation. Il arrive ainsi à tout le monde de saisir tout d'un coup le sens d'une expression utilisée aveuglément pendant des années comme une pure imitation. Je peux me souvenir de l'ambiance d'ignorance totale qui entourait les prières catholiques, au point que des morceaux entiers de phrases comme "Jésus le fruit de vos entrailles", n'avaient tout simplement aucune signification tant que le mot clé, ici le mot entrailles, n'avait pas été traduit.
Cette question de l'identité est au cœur de notre présent historique parce que ses conditions de formation et d'existence sont en train de changer du tout au tout. Le retour au statut nomade s'accompagne du retour à une ontologie humaine dont l'identité ou le propre vont jouer un rôle de moins en moins important pour disparaître dans la liberté commune, la liberté d'avant le sédentaire. La reconnaissance de l'humain pourra à nouveau se faire sur la base de l'apparence, maintenant que les dés sont jetés et que l'Homme se sera totalement isolé dans l'étant comme son double intégral. L'Autre sera référence immédiate comme le sont les autres de l'Histoire et il sera en principe inutile d'aller chercher ses modèles de pensée et de comportement dans les siècles et les millénaires qui nous précèdent. Mais, bien entendu, ceci s'accomplira lorsque les modèles seront eux-mêmes usés, lorsqu'ils auront tout donné de leur force paradigmatique. Or cela ne pourra être le cas que dans une société hautement cultivée, où la plupart des individus n'auront pas seulement fait la critique de leur constellation immédiate familiale, mais encore identifié leurs appartenances spirituelles historiques. Dans la rue on pourra s'interpeller -"salut Platon ! " - "oh Parmenide, comment vas-tu ?" - et ainsi de suite. Pas fou, non ?
Non. Car les enjeux sont condamnés à monter sans cesse. Les forces de conservation auront beau tout mettre en œuvre pour maintenir au plus bas le niveau général d'acculturation, le mouvement de ce développement là ne se laissera plus jamais arrêter. Le technique, comme le rappelle chaque fois qu'il le peut Martin Heidegger, n'est pas seulement l'ensemble des instruments, des objets et des savoirs de la technologie, il est d'abord un choix initial de savoir en tant que tel, la concrétisation du désir de s'emparer de l'étant par la pensée autant que par les outils d'arraisonnement et d'exploitation. Il faudrait imaginer que l'homme cesse de cultiver et d'exploiter les richesses qui l'entourent pour pouvoir entrevoir une mutation de sa relation spirituelle à l'étant. Acquérir des richesses est la même action qu'acquérir des savoirs, c'est la même chose, nous étudions l'être avec la même brutalité et la même absence de scrupules que nous puisons le pétrole dans les poches fossiles. Mais cela est destiné à avoir une fin dans les deux sens de terminaison et de finalité. La terminaison se situe à vrai dire très loin, peut-être plus loin que le destin de la planète elle-même. Quant à la finalité elle se trouve dans la réussite elle-même du savoir, si bien exprimée déjà par Socrate et la plupart des grands penseurs. Pour eux, la sagesse la plus élaborée de l'individu se trouve dans la reconnaissance de son ignorance. Avec l'Histoire on franchira un pas de plus car cette reconnaissance sera collective, on pourra passer à autre chose.
Jeudi 28 juin 2001
Banalités ? Tout ça me paraît terriblement banal, ne refléter qu'un savoir durement acquis de choses évidentes, mais des choses qui se transmettent secrètement de maître à maître, et qu'un prolétaire comme moi n'a d'autre choix que d'apprendre et apprendre, à ses dépens. Consacrer une vie à dissiper l'obscurité que les hommes distillent volontairement autour de leurs motifs véritables et à percer des mystères qui ne sont que des secrets de polichinelle, c'est dur car c'est au prix de l'extériorité radicale, de la marge, perpétuelle comme un verdict d'Assises. Bof, je pense n'avoir pas le choix, aussi faut-il que je cesse de pleurnicher. Voilà.
Samedi 30 juin 2001
Les sujets me fuient. Voici deux thèmes que je me réjouissais d'avance à tartiner sur son Word et qui s'évanouissent purement et simplement dans la nature. Fatigue ? Besoin fondamental de renouvellement ? Faut-il que je me remette en question encore et encore ? Trop facile ? En tout cas c'est une refoulement manifeste, un refus inconscient bien conscient. Sic. En fait, je sens que cette écriture, comme toute écriture, s'éloigne de plus en plus de la vie. Comme moi ? Tout Plutarque, tout Stendhal, tout Balzac, tout Proust et tout Dostoïevski, tout Sartre et tout Heidegger pour en arriver à la Publicité ? Car il s'agit de la même chose, des mêmes peintures de l'existence destinées à faire des adeptes, à convaincre, enrôler, séduire, éclairer, faire marcher les gens sur la tête malgré la gravité, à les faire tenir, résister, en un mot : durer. Comme si cette vie était tellement surnaturelle, tellement absurde qu'il faille sans s'arrêter un instant en faire la publicité, inventer des mensonges qui rétablissent l'équilibre, donnent l'illusion de retomber sur ses pieds. Ah c'était çà ! Alors ça va, on continue.
Et pourtant la vie, cette fameuse vie me paraît simple dans ses prémices. Plutarque, tenez, avait une vision rustique mais lumineuse des choses, pour lui la réalité c'était les grands hommes, ceux dont on sait qu'ils avaient voulu quelque chose, posé des actions et engagé une chaîne de conséquences dont nous pouvons encore sentir les effets. Ce qui est intéressant c'est que cet écrivain ne perdait pas souvent son temps à théoriser en vain sinon comme pédagogue et moraliste. Il préférait étudier dans le détail le destin de ces "grands hommes" qui ne sont, en réalité, que des hommes tout court mais qui ont fait leur trou dans la mémoire des siècles. Mais là on a déformé le genre. On a transformé subrepticement le genre biographie pédagogique en hagiographie publicitaire ou en repoussoir moral ; voir ce que deviennent des canailles comme Justinien et des ploucs un peu zozo comme Néron. Mais ce n'est pas le plus grave. Le pire est la théorisation abstraite de la réalité, le présentation de l'Histoire comme un mystère insaisissable du cours des choses, et des hommes à condition de les considérer comme des choses... Il faut bien reconnaître que Marx a une grande responsabilité dans cette perversion de l'analyse ; sa préférence philosophique pour Démocrite peut sans doute expliquer bien des choses. Le fameux clinamen, c'est à dire la faculté des atomes d'obliquer pour rencontrer d'autres atomes et produire du neuf, permet de penser à un déroulement aléatoire du temps, un déroulement qui échapperait aux hommes. Les religions trouvent là un terreau fertile pour leurs théories de la fatalité aveugle et du pouvoir des dieux.
Non, non, non et non, l'Histoire des hommes est bien leur propre histoire et non pas celle du développement de l'économie ou de l'art ou de la science ou de je ne sais quoi encore. Aucun de ces domaines ne peut devenir sujet de l'histoire. Lorsque moi-même je tente d'expliquer l'importance de la césure du néolithique, ce n'est pas pour replonger l'homme dans une nouvelle forme de fatalité, mais en sachant et en posant fermement que cette césure est l'œuvre des hommes eux-mêmes et non pas des circonstances. C'est ce qu'il y a de plus important à comprendre dans mon texte : l'homme a choisi de mettre fin à sa course nomade, et même si on ne possède aucun repère, aucune trace et aucun document sur cet événement, il faut le postuler ainsi parce que l'Histoire n'est rien d'autre que l'histoire des hommes et jamais celle des dieux ou des températures géologiques. Bien sûr, il faut ajouter à cela que c'est UN homme qui a pris une telle décision, ou du moins qui a fait partager son idée par les autres. L'idée de mettre fin au nomadisme ne vient elle-même pas du ciel des idées ni de la volonté divine, elle est issue du cerveau d'un individu particulier, un individu qui a trouvé autour de lui l'assentiment pour une telle idée et qui était entouré d'autres individus comparables comme Cimon était entouré par des Périclès ou Louis XIV par des Mazarin et des Louvois. Comme l'écriture fait partie des conséquences de cette décision, on ne peut pas s'attendre à trouver une identité concrète, ne fît-ce qu'un nom. On peut, en revanche, chercher dans la mythologie ce que la tradition orale a retenu de cet événement, la mythologie ou la religion. Il faut certes se méfier sur la nature de la transmission, de la tradition qui fait passer les événements dans la mémoire collective. La réécriture de l'histoire n'est pas une invention de Staline ou de Mao, elle se pratiquait déjà bien avant l'écriture elle-même, dans le chant poétique ou lyrique, véritables scènes de la vie politique. Si on pouvait éplucher chaque héros des mythologies, le remettre à sa vraie place de personne, on pourrait comprendre ce qui s'est réellement passé. La plupart des tentatives d'explication a échoué malgré des approches fascinantes comme celle des romantiques allemands.
Dimanche 1er juillet 2001
Ce fait que des hommes parfaitement inconnus et à jamais inconnaissables aient fait des choix essentiels à notre propre vie me laisse pensif. Cela relativise considérablement l'importance de l'identité, du Nom et de tout ce que la civilisation sédentaire a inventé pour cultiver la Gloire et l'attachement au Nom. La matière est délicate, car c'est précisément cet effort d'identification et de nomination qui a permis cette nécessaire hypostasie de l'Homme, en même temps qu'elle posait ses limites. Or ont pourrait se demander, pour commencer, si cet affairement identificatoire n'aura pas été un simple argument démagogique pour encourager les hommes à se conserver intacts, à se garder (la garde étant l'ancêtre de la vérité) dans la vérité de l'être homme pour éviter de se perdre dans l'appropriation privative de l'étant. Il n'est pas impossible d'imaginer que les auteurs de l'après néolithique aient eu l'intuition des difficultés qui allaient surgir à cause de la nécessaire distribution des espaces et des richesses. Dans les luttes qu'on anticipait on voyait le danger d'une perte radicale de l'humanité, car toute la violence originairement réservée à la subsistance risquait de se retourner contre l'homme lui-même. Dont acte. Ainsi la généalogie devenait elle un précieux allié dans la sauvegarde de l'humain, les listes interminables de la Bible font foi du prix d'un tel souci. Il reste que le postulat d'un passage volontaire à la sédentarité, d'une construction volontaire et consciente de la civilisation d'après les plans de quelques inconnus, nous prouve que les actions importantes de l'Histoire se sont passé de ce repère et de toute généalogie. On n'en pas eu besoin.
Cependant, le développement de la civilisation sédentaire ne laisse pas ignorer qu'il est aussi celui de la singularité, de l'individu autonome. Certains s'en félicitent, d'autres le regrettent. Mais le problème n'est pas là, ce développement parallèle est au moins formellement fondé sur l'usage et le renforcement du Nom Propre, du nom du père. L'histoire peut même se considérer de ce seul point de vue de l'universalisation de l'usage du nom propre, phénomène au demeurant fort récent mais incontestable. La conséquence métaphysique est considérable parce qu'il donne la parole à tout un chacun. L'individualisation, la dissolution des sociétés en leurs éléments singuliers, c'est avant tout l'acquisition par chacun d'un droit à l'égalité, sous quelque forme que ce soit, politique, économique ou religieuse. Mais la véritable conséquence qu'engendrent de telles égalités est qu'elles engendrent nécessairement pour chacun le droit d'accès à la question de l'être. Il aura fallu créer de toute pièce un individu autonome pour qu'il soit reconnu que le pouvoir et le droit de questionnement ontologique sont devenus universels. En fait, on peut soupçonner que l'homme avait aliéné ce droit dans les religions, sans doute par un besoin urgent de simplification de ses multiples tâches nouvelles et qu'à présent il fait retour, il revient à l'individu tel qu'il le possédait dans la réalité nomade. Il lui revient certes transformé, une transformation qui fait certainement partie des effets escomptés par les auteurs de la civilisation. Il est transformé dans le sens qu'à présent le questionnement individuel peut s'adresser directement à l'humain en tant que communauté grâce à la perlaboration culturelle des millénaires qui viennent de s'écouler. On peut en effet supposer que le chasseur cueilleur des millénaires oubliés n'avait guère d'outils pour se faire entendre par ceux qu'il rencontrait dans ses pérégrinations : en fait il n'avait aucun moyen d'échanger le bien le plus précieux qui soit : le sens. Le partage du sens valait bien une civilisation.
Samedi 7 juillet 2001
L'affaire du père. Quelle histoire ! Il ne m'était plus arrivé depuis très longtemps de perdre un texte sur mon ordinateur. Eh bien il aura fallu que je fasse enfin l'analyse du Père pour que cela m'arrive, deux pages évaporée à cause d'une erreur de manipulation, et aussi parce que Mara ne veut pas installer l'enregistrement automatique pour des raisons très légitimes liées à la mise en ligne des textes sur Internet. Bref, c'est quand même un acte manqué parfait, et nous allons bien voir si j'arrive à ressortir cette extraordinaire thèse sur papa et sur le Nom du Père ! Celui-ci semble me narguer du fond de sa tombe, comme d'habitude... Mais il n'en sortira pas.
Bon, ma thèse sur le père est en gros que son invention correspond à une nécessité qui fait partie du projet de la sédentarisation humaine, et que, contrairement aux idées classiques et reçues à son sujet, l'invention du père marque une régression vers l'animalité. Je cite de mémoire, "l'homme naît libre et il est partout dans les fers", c'est, je crois le début de l'Emile de Rousseau. Le brillant nouveau philosophe du XVIIIe siècle a senti intuitivement le drame qui se joue dans le destin d'un petit d'homme du monde socialisé ou civilisé. Mais Rousseau ne comprend pas ce qui se passe réellement, il ne fait que constater que l'enfant naît dans une position hostile, il représente un danger pour la société, un danger contre lequel il convient de se prémunir aux dépens de celui qui vient de naître. D'où ce ligotage symbolique, cette infantilisation à outrance, l'invention en fait d'un être imaginaire, un être non humain et qui doit prouver avec le temps de l'Education qu'il est capable de devenir un Homme
C'est une situation toute nouvelle pour le petit de l'homme sédentaire, et on peut, il faut imaginer la situation inverse dans le monde humain nomade, à savoir que le petit nomade est non seulement intégré de facto dès sa naissance dans la horde humaine, mais encore qu'il bénéficie, avec tous les risques que cela comporte, de toutes les reconnaissances et de tout le respect auxquels ont droit tous les adultes. De nos jours il reste encore ça et là des exemples vivants de sociétés où il n'existe pas d'
infans
, c'est à dire d'être non parlant et partant non humain qui, par la suite seulement, a la possibilité de devenir homme à part entière. En Afrique (c'était dans les années 70) j'ai pu observer le déroulement de l'enfance de petits Gabonais vivant dans le fin-fond des forêts non encore reliées par terre et toute l'année à la capitale, et le tableau est saisissant : à Oyem, capitale du Nord gabonais, les enfants naissent exactement comme naissent les oiseaux ou les chats. En un premier temps leur dépendance est totale, et les femmes les élèvent exactement comme le font nos femmes avec nos bébés, mais cela ne fait encore aucune différence avec la méthode d'éducation d'une mère pingouin ou dauphin. La seule note qui différencie déjà leur manière de faire est dans la place qu'occupe le petit, il est accroché
en permanence
au corps de sa mère, et cela pendant un à trois ans, selon les talents et le rythme de croissance global de l'individu. Après cette période les choses s'inversent, l'enfant est littéralement jeté par-terre et condamné à se débrouiller à peu près tout seul pour subsister et passer son temps. Il est déjà adulte, adulte femme ou adulte homme. Bien entendu cette méthode tend à disparaître totalement, et l'enfant occidental prend partout la place de ce petit Africain "naturel". J'ai eu dans mes classes de philosophie d'Oyem les représentants de l'une et l'autre catégorie, et je pourrais disserter longuement sur les conséquences de l'une et l'autre formes d'éducation sur les capacités d'acculturation de ces enfants. Mais ce n'est pas directement le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est la place du père dans tout ça, et ce que l'une et l'autre pratiques éducationnelles impliquent par rapport au développement des sociétés
En Afrique en général, la place du père biologique n'est pas centrale. La proximité et la permanence des formes de vie nomades (au moins agricoles) ont pour effet que la paternité est partagée tantôt par les femmes, tantôt par les oncles, mais là n'est pas le vrai problème. La question est celle de la paternité en tant que telle, c'est à dire de l'autorité qui peut lier père ou fils, ou pas, que ce père soit l'oncle ou la grande tante. Le fait que ce soit l'oncle qui soit "propriétaire" de l'enfant et non pas son géniteur direct, témoigne seulement d'une certaine distance morale et politique entre les deux individus : l'oncle africain ne s'identifie pas tout à fait à une autorité parentale mais plutôt à un propriétaire jouissant, entre autre, d'un pouvoir de décision lors des grands moment de la vie de l'enfant, et ce jusqu'à sa mort, et non pas seulement pendant une certaine minorité. En Afrique on obéit toute sa vie aux anciens, même lorsqu'ils sont morts... Cette seule circonstance permet déjà de différencier radicalement la parenté vue d'Afrique de la nôtre : ici le parent commande pendant une période d'inaptitude supposée, là le parent ne fait que représenter une entité spirituelle d'appartenance à la tribu ou au clan et il conserve ce rôle à tout jamais. Autrement dit, la question de l'éducation n'est pas celle de la formation de l'individu afin qu'il puisse devenir un jour un membre à part entière de la tribu ou du clan, mais celle de la gestion de cette appartenance qui est un fait avérée et reconnue par tous à partir du jour même de la naissance.
Il y a donc deux manières d'être Père. La première, celle des Anciens, ne sert qu'à identifier conjoncturellement la place de l'enfant dans la société, une place qu'il possède déjà à sa naissance et qu'il gardera toute sa vie. La deuxième, la nôtre, est le fait de conduire l'enfant vers des savoir faire et des savoir être dont seul le père biologique est responsable : l'enfant devient l'oeuvre de la vie du Père. Bien sûr, la question de l'intégration sociale figure toujours et aussi dans le catalogue des devoirs pédagogiques du père, mais chez nous elle peut figurer à l'envers, c'est à dire que mon père peut m'élever contre la société, il peut tenter de faire de moi un révolutionnaire au lieu de seulement m'initier à l'appartenance, comme c'est le devoir de tout père primitif. Le père occidental a une responsabilité morale absolue, tellement absolue qu'il marque une véritable rupture entre les générations : le père est maître de son discours, de ses idées et de ses représentations, il peut élever sa progéniture dans le sens qu'il entend sans en référer à qui que ce soit. L'aléatoire entre ainsi dans l'éducation des enfants. Or cet aléatoire n'est rien d'autre que l'autorité abstraite, un droit absolu sur la personnalité future de l'enfant et l'idée que seul le Père peut assurer, par son autorité, le contenu humain futur des nouveaux venus. Poussé à la limite, c'est l'idée que l'enfant est un animal à l'origine dangereux, il doit être maté par une autorité sans appel afin de s'humaniser dans l'acquisition des significations auxquelles il est asservi par la pédagogie du père. En renforçant constamment le rôle de cette autorité et de la soumission qui en est le corollaire, on a pour ainsi dire chassé le sens de ce commandement abstrait, on a même pu oublier les finalités les plus banales et les plus nécessaires de toute éducation au point de supprimer par pure négligence des événements aussi importants que les initiations périodiques, comme celle centrale de l'adolescence. Par un paradoxe tout à fait logique, on peut remarquer que l'éducation aristocratique occidentale demeure essentiellement fidèle au modèle primitif : l'héritier est Homme dès sa naissance, par la seule grâce de son sang. L'éducation ne sera jamais qu'un adjuvant certes politiquement nécessaire, mais fondamentalement et destinalement contingent.
Notre Père, qui êtes aux Cieux. La religion a considérablement formaté les méthodes courantes d'éducation paternelle. On peut d'ailleurs observer un savant dosage, sans doute dû à Thomas d'Aquin, entre la morale judaïque du dieu cruel et autoritaire, et la morale chrétienne, faite de sourires et de bons sentiments. Il reste que le père réel, le géniteur éducateur, transmet à l'enfant sa marque personnelle, qu'elle ne contienne guère autre chose que la marque du père précédant ou des contenus sociaux et religieux de l'époque. C'est le Père qui représente à lui tout seul le monde futur de l'individu candidat à l'humanité, toute créance et tout espoir de devenir à son tout Homme repose entièrement sur la coïncidence entre son être et l'image du père. Dans la société sédentaire, la vie et le monde commence et finit avec la réalité transmise spirituellement par le père. Quelle incroyable responsabilité ! La réalité de cette solitude du père dans la responsabilité des futures performances de l'enfant se retrouve dans le développement historiquement récent du Nom Propre. Le nom propre est une nouvelle frontière des individus à l'intérieur de la société, il mime en fait la nomination sacrée dans les anciennes formes de souveraineté : jadis seuls les nobles avaient droit à un Nom. Le fait que le nom propre soit descendu dans toutes les classes sociales est la caractéristique principale de cette transformation du père primitif en père abusif, mais il illustre en même temps la libération des individus par rapport à l'entité sociale elle-même, le clan, la tribu ou la nation. Le développement ultérieur verra sans aucun doute le nom propre à nouveau disparaître au bénéfice de codes fonctionnels ou poétiques selon la direction dans laquelle vogueront nos sociétés. Le nom du père est bien entendu intimement lié à la propriété privée de la terre et des richesses, et le père géniteur doit partager son statut avec ses propres biens : l'enfant est fils de X et de tout ce qui fait les attributs de X à savoir ses richesses. Pas de richesses, pas de père, mais il faut aussi se souvenir que pas de père, pas de richesse, c'est à dire que le problème de la richesse est le même que celui du père, les deux mots sont tout à fait synonymes. Le concept de patrimoine en fait suffisamment foi.
Au plan spirituel, et partant celui de la psychologie, cette situation devient intenable. Comme on l'a vu, d'un côté l'histoire paternelle, le monologue didactique du père met en scène le tout du sens de la vie du nouveau venu, celui-ci est pour ainsi dire contraint de s'en libérer par simple et abstraite opposition de principe. Il doit tuer le père quel qu'il soit parce que son autorité spirituelle est abusive par son caractère singulier, mais en même temps l'individu qui naît possède déjà la même perspective de liberté spirituelle précisément sous la condition qu'il en finisse avec la domination du père. Personne ne peut faire confiance au père, parce qu'il est le père, il est ce père pour ainsi dire fabriqué par la sédentarisation des peuples, certes voué à la disparition comme d'autres formes de parenté ont disparu, mais encore bien en chair et en os dans notre présent. La psychanalyse offre une porte de sortie, une manière douce de tuer le père en soi ou d'absorber les violences psychiques qui émanent de cette pression abstraite de l'autorité spirituelle du père. L'oedipisme a été inventé à l'aube du sédentarisme conscient de soi, c'est à dire de la forme la plus évoluée de cet après-nomadisme, le capitalisme. Plutôt, cependant, que d'attester de la violence naturelle des relations de parenté, ce mythe décrit ce à quoi aboutit la parentalité sédentaire : l'instinct d'appropriation qui se développe dans la problématique du partage des terres se transfère à la vie sociale elle-même et il n'est pas étrange que des ethnologues contemporains fasse de la propriété des femmes la forme absolue de toute structure sociale. La propriété des femmes, c'est à dire le contrôle de la reproduction, est seulement le double de la propriété du sol, en elle se joue la même réalité de la gestion de la fertilité du monde. Une des réponses au mystère de l'action transformatrice de la réalité aura été le Père nanti de son Nom, mais il est désormais certain que cette figure a vécu. Par ailleurs, la sublimation de la propriété privée des richesses aboutira, elle aussi, à une sublimation des formes de parenté et à un retour à l'anonymat humain.
Lundi 9 juillet 01
Hier soir je regardais, je crois, un journal télévisé quand j'ai senti une de ces "vérités" du monde actuel, c'est à dire du monde qui ne me semble plus appartenir à celui de mes jeunes années, et encore moins à mon enfance. Il faut donc que je me méfie, comme chaque fois, des transformations subjectives qui peuvent entraîner des sortes d'erreurs de parallaxe et me faire prendre des vessies pour des lanternes. Bref la sensation venait de la publicité et de l'impression qu'elle donne de la labilité des désirs des consommateurs, de la facilité avec laquelle on modifie les messages concernant une marchandise afin de faire changer, ce faisant, le désir correspondant à ce type de produit. Ma conclusion porte sur la vie des idéologies. Une "vision du monde" naît, se développe et décline, comme n'importe quel être vivant, pour disparaître dans le catalogue des idées mortes. Or, l'idéologie a comme fonction principale de cimenter la réalité sociale, de permettre à chacun de se reconnaître dans un discours commun, discours qui reflète plus ou moins un consensus, c'est à dire une volonté et un désir plus ou moins collectifs. La politique est le premier secteur qui a besoin des idéologies pour légitimer et assumer les conséquences de ses décisions ou de ses non-décisions. Il y a longtemps, bien sûr, que l'économie s'est emparé des idéologies pour orienter collectivement le goût des consommateurs avec plus d'efficacité. L'EDF ne délivre plus de message qui ne contienne une allusion à la question de l'environnement, question devenue sensible dans le domaine politique. (C'est peut-être la prise en compte de l'écologie par la politique qui indique que le politique reste plus puissant qu'on ne le pense dans le destin collectif.)
L'exemple le plus facile à commenter serait le destin du fascisme, idéologie modèle au sens où le fascisme restructure d'un coup l'ensemble de la vision du monde pour initier des actions et des transformations sociales lourdes en elles-mêmes et lourdes de conséquences pour les sociétés voisines. Mais ce n'est pas mon sujet. Ce que j'ai ressenti hier concerne davantage les caractéristiques de la mécanique interne d'une idéologie, son efficacité immédiate et sa force de permanence : le constat le plus commun permet d'affirmer que les idéologies ont des vies de plus en plus courtes, que les messages collectifs tiennent de moins en moins bien la distance et demandent à être renouvelés très souvent, rôle principal de la publicité. N'oublions pas que cette dernière porte désormais sur tous les aspects de la vie sociale et non plus seulement sur la consommation des biens matériels. Sans elle la politique ne serait plus ce qu'elle est devenue depuis un siècle pas plus que les religions.
Pourtant, si on examine plus attentivement le panorama idéologique de notre présent, on peut déceler quelque chose comme un dédoublement en deux strates des ensembles d'idées qui sont l'objet de croyances (ou d'opinions favorables comme on dit aujourd'hui). Il y a d'un côté des modes de récit journalistiques ou fictifs qui reflètent des valeurs classiques : le discours public est, malgré des tentatives répétées et soigneusement ciblées, structuré sur une tradition de pensée morale simple qui comprend le rapport au bien et au mal, la justice ou l'injustice, le progrès ou la régression, etc.. En même temps un nouveau type de message voit le jour, en provenance d'outre-Atlantique, qui repose davantage sur le constat apparemment "neutre" des faits et qui les entérine sans connotation morale. Plus grave, c'est dans le discours quotidien, dans la rue, sur les lieux de travail, dans les foyers que s'insinue une sorte de cynisme constatif qui finit par faire message. Une réalité qui s'impose malgré la morale et malgré toutes les formes de légalité réelles ou idéologiques est la vraie réalité, elle reçoit le label de la vérité que seul peut décerner une argumentation morale et logique. Fascisme à la petite semaine, mais qui domine finalement l'ensemble de l'action sociale. Ainsi dans une entreprise, la délation et l'hypocrisie sont peu à peu élevées au rang de pratique vertueuse, porteuse de réussite et donc légitime. Dans la rue, le fait de blesser la loi ne choque plus que lorsque la tentative échoue, dans les foyers le mensonge est cultivé comme un sport parfaitement légitime, pourvu qu'il atteigne son but.
Il s'opère ainsi une sorte de conditionnement a ou immoral dont la structure sociale profondément inique a un grand besoin, faute d'une idéologie globale décisive comme la tyrannie ouverte ou le fascisme. Car il faut bien en arriver à ce schéma très simple : le discours moral classique, celui qui repose sur les valeurs "éternelles" et reconnues est improductif, pire il est un obstacle permanent à la croissance sans limites des richesses matérielles. L'injustice sociale doit être assumée intellectuellement par la société elle-même pour que celle-ci puisse se permettre d'entrer dans la compétition mondiale, c'est tout l'enjeu de cette fameuse mondialisation. En d'autres termes, un pays comme la France n'a d'autre choix que de s'aligner sur le jurisprudentialisme anglo-saxon s'il veut conserver une chance de surnager dans un monde de la concurrence où la réussite abstraite fait loi. La jurisprudence s'articule autour de jugements déjà prononcés sur un type de délit ou de crime et non pas exclusivement sur la loi. Mais si en France la jurisprudence sert à modifier la conviction des juges et à éclairer le problème des circonstances d'un crime ou d'un délit, elle ne peut pas se substituer à la loi, du moins pas encore. Il en va tout à fait autrement au Etats-Unis où la jurisprudence s'installe progressivement à la place de la loi, laissant aux juges la latitude de la modifier dans un sens ou dans un autre. Grâce à la jurisprudence, il arrive que dans certains états américains le crime de sang soit moins sévèrement réprimé que le vol à l'étalage ou la diffamation. Dernier recours légal, la Constitution américaine ne se prononce que sur les principes et jamais sur la nature et la matérialité des crimes, il est donc difficile voire impossible d'y faire appel. Ainsi s'installe et se développe une société inique où l'iniquité devient loi selon le principe qui attribue la vertu à la richesse et donc à la capacité de financer sa propre justice. A noter ici que l'Europe est sur la pente qui conduit à ce système et il est remarquable que les services juridiques des entreprises s'activent aujourd'hui autour de la constitution de jurisprudences qui doivent fonder le futur droit du travail européen. Attention danger !
Dans le registre des productions idéologiques littéraires, il existe aux States un genre de bandes dessinées qui rapporte les destins légendaires par leur gigantisme et leur sophistication de héros imaginaires du futur. Fantômes, X-men ou autre homme araignée, les actions de ces héros humanoïdes et de leurs adversaires baignent tous dans une ambiguïté totale dont le dernier mot demeure toujours la victoire ou l'échec. Les héros les plus négatifs, les plus méchants et les plus immoraux sont toujours présentés avec des motivations ambivalentes qui finissent toujours par opérer une sorte de légitimation "réaliste" de leurs crimes, comme si on finissait un jour par réhabiliter Hitler après avoir découvert qu'il aurait été traumatisé injustement dans son enfance. Cette littérature de gare fascine étrangement la jeunesse de l'Europe parce qu'elle gomme la strate classique morale logique du discours global et s'invente une jurisprudence éthique au fil des pages, une jurisprudence qui finit, il est vrai, toujours par donner la victoire au camp des justes, mais avec tellement de réticences et de précarité renouvelée que les mesures s'équilibrent de part et d'autre de la balance du jugement. Le principe même selon lequel les personnages ne se définissent que comme humanoïdes et non pas comme des hommes simples, indique la volonté des auteurs d'inventer une nouvelle humanité, en marge de la nôtre sur tous les plans et avant tout celui de la morale. Cela s'appelle flirter avec le mal.
J'en arrive enfin à mon propos central : il est vrai que cette idéologie pernicieuse gagne partout du terrain. Il suffit de voir ce que se permettent aujourd'hui les médias en fait de violation des consensus concernant la vie privée et les bonnes mœurs. L'impératif de l'argent prend le pas sur toute considération de respect et de bon goût tel qu'ils ont pu s'imposer au cours des derniers siècles. Sous le label de la liberté d'expression, les grands vecteurs discursifs s'autorisent toutes sortes de détournements qui restent la plupart du temps sans réaction de la part des responsables ou du public. L'émission télévisée qui porte le nom de Loft Story est une machine redoutable, qui, sous prétexte de montrer librement la vie intime de quelques jeunes gens, donne en fait à voir et à entendre des propos dont le cynisme et l'amoralité font discours. Autrement dit, le fait de laisser entendre et voir des comportements plus ou moins déviants par rapport à la morale commune, rend ces comportements socialement légitimes, et plus grave, les rends désirables. Bon, tout cela fonctionne et fonctionne plutôt bien : la morale classique participe de plus en plus d'un passé ringard et le présent est aux mains de la réussite et de l'argent. Mais, et j'en finirai par là, cette position s'avère aussi très fragile parce qu'elle n'est pas encore structurée dans la strate supérieure du discours social, dans la volonté politique et morale collective exprimée ouvertement. Elle ne tient donc qu'à un souffle de vent. Il suffit, dans une entreprise par exemple, qu'un individu réussisse dans son combat contre l'iniquité, pour que l'ensemble du personnel se reconnaisse immédiatement en lui et en son combat. Il en va de même pour la société tout entière. Tant que la loi écrite et prononcée n'aura pas donné l'onction morale à toutes les dérives criminelles qui constituent en fait la réalité, celles-ci ne sont pas assurées de durer ni de s'installer profondément. Il suffira d'une nuit d'orage, comme pour les chiens de Pavlov, pour que sautent tous les conditionnements qui entraînent la soumission à la fatalité du mal.
|

|
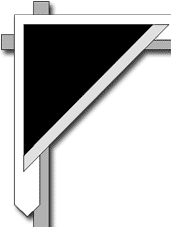




![]()