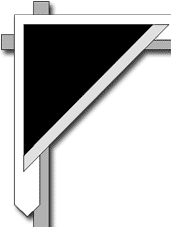
|

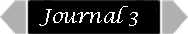
Vendredi, le 16 octobre 1998
Je viens de clore la deuxième partie d'Antémémoire, et j'ouvre donc la troisième partie. Cela me permet d'uploader plus rapidement. Je vous donne rendez-vous donc, peut-être, à demain samedi 17 octobre.
Samedi, le 17 octobre 1998
Etre habité par les formes.
J'ai toujours témoigné d'une grande indifférence quant à la décoration des lieux que j'ai habités. Plus précisément, j'ai depuis que je suis pratiquement autonome, c'est à dire environ l'âge de 16 ans, toujours préféré le dépouillement le plus total à toute mise en scène de formes ou de mobilier ou de «décoration». Ce concept, d'ailleurs, me chiffonne tout à fait. Sans doute est-ce dû à l'usage négatif de ce mot lorsque je me suis frotté aux artisteries parisiennes au début des années soixante : pour les Montparnos que nous étions, il y avait de la vraie peinture et de la «décoration». Ce qui reste assez exact quoi qu'on en ait. Je me souviens donc de période de fréquentation du temps (voici une formule assez marrante pour signifier la vie quotidienne continue, celle qui ne change guère, la ligne droite qui s'installe à la suite de grands choix; je vous en fais cadeau) où je dormais, par exemple, dans de grandes pièces totalement vides, sur un matelas jeté dans un coin ; tout cela avait de la gueule par la disproportion énorme entre la place minuscule que j'occupais, moi, l'homme, et la majesté du lieu, la majesté de l'espace. Bien sûr, je ne me doutais pas, alors, que c'est cet espace même qui constituait, alors, la plus décorative des décorations, la plus prétentieuse des mises en scène de ma fréquentation du temps. J'avais même la naïveté ou l'outrecuidance de penser que je mettais en batterie l'humilité ultime, celle du moine ou du soldat. Par la suite je suis toujours, il est vrai, resté très réservé quant aux accrochages de tableaux et autres couleurs, placement de meubles ceci ou cela, préférant souvent l'inconfort physique à la coulure dans le plastique des nouveaux modes de positionnement du corps. Or, les choses se sont mis à bouger, dans ce domaine, dans les vingt dernières années de ma fréquentation du temps (quand vous en aurez marre de cette expression, zapez !).
En effet, il y a une vingtaine d'années je me suis remis aux artisteries de ma jeunesse. Petits dessins, gouaches et puis, insensiblement et péniblement quelques huiles. Qui sont venus, sans coup férir, hélas, décorer narcissiquement les murs de mes appartements qui n'en pouvaient mais. Que voulez-vous, ça fait tellement de bien de se mirer dans ses «oeuvres». Ouille, ouille, comme dirait Jacques Dutronc. Le fond, cependant, de la décoration de mes lieux de fréquentation du temps, est toujours resté sobre, le meublement donnant même lieu, parfois, à de petits conflits de ménage liés au préjugé foncier qui ne m'a jamais abandonné. Cela dit, j'ai toujours fait une exception décorative : l'art africain, par ailleurs lié à quelques objets patrimoniaux et de mon enfance, notamment une fort belle statuette Baoulé ou Mossi (je n'ai jamais réussi à savoir car elle est vraiment antique) en ébène. Or, voici que nous faisons, l'été de 1996, l'une de ces rencontres du hasard qui, si on les analyse dans leurs abyssales profondeurs, ne manquent jamais de vous angoisser sur les mystères de ce qui se passe, là, dans les rues, les villes et les temps que vous...fréquentez. Rue de Seine, en plein Paris, où nous ne nous rendons que très parcimonieusement, nous tombons sur deux Africains attirés par le fait que nous sortions d'une galerie d'art du même nom, et qui ne semblaient être que deux traficants des objets correspondant, mais à des prix fort suspects. Il s'avère évidemment très vite que ces deux gaillards fort imposants, rigolards et d'une esbroufferie sans limite, sont deux ressortissants de l'Afrique Centrale, mon paradis un peu perdu, depuis que je l'ai quitté il y a plus de vingt ans. Pis que cela : l'un des deux se trouvait, preuve à l'appui, connaître mon meilleur ami gabonais, le chanteur Ondo Beyeme, dont il m'annonce d'ailleurs le décès.
Bref, nous voilà sur la piste d'objets qui risquent, à termes, de venir encombrer nos appartements, en bien ou en mal. Le fait est que depuis mes séjours en Afrique, j'ai toujours refusé de me transformer en pillard de l'Art Nègre. Je me souviens de ces collègues français qui au Gabon, passaient leur temps (sans le fréquenter) à remplir des cantines en fer d'oeuvres diverses et précieuses, rafflées par des sortes de coursiers de brousse qui passent leur temps à écumer les plus petits villages du fond de la forêt. On ne s'imagine jamais, d'ici en Europe, combien la brousse est peuplée, on pense toujours que le stock de «fétiches» et autres statuaires sont depuis longtemps épuisés, brûlés par les missionnaires ou achetés par les ethnologues. Faux et archifaux, car le talent de dissimulation des Africains est absolument fantastique. J'ai ainsi appris il y a quelques années, que lorsque Griaule est passé dans la Boucle du Niger lors de sa grande expédition des années Trente (entre Dakar et Djibouti, en compagnie notamment de Michel Leiris), les nègres de l'époque se sont marré comme jamais. Comme ils savaient que Griaule achetait absolument tout, ils se sont empressés de cacher toute leur vaisselle usée, cassée, depuis longtemps au rebut, dans des lieux tout à fait sacrés, consigne étant donnée aux «informateurs» de les signaler aux ethnologues. Au résultat et en échange de leur verroterie, les Dogons se sont tous massivement outillés en matériel absolument neuf, casserolles, couverts, machines de toute sorte. Griaule, lui, rafflait en jubilant tous ces pseudo-objets sacrés, pleins d'authenticité et de mystère, qui, depuis, se couvrent de couches successives de poussière dans les caves du Musée de l'Homme, à force de fréquenter le temps de manière bien trop immobile et insignifiante. Non, les blancs n'ont jamais réussi à tuer l'art africain, pas plus qu'ils n'ont réussi à juguler la vague esthétique musicale aux Etats-Unis, puis sur le continent même.
Mon ami camerounais-gabonais, puisqu'il est, entre-temps devenu mon ami, trafique donc de ces objets, masques et autres, qu'il ramène le plus légalement du monde de son pays. Fidèle, donc à mes convictions, je lui avais immédiatement fait savoir que je ne ferai aucune acquisition d'objets antiques susceptibles d'enrichir le patrimoine de son pays, bref, je ne voulais pas me rendre complice d'une Expédition d'Egypte-bis. En revanche, et allez savoir s'il s'agit là d'une contradiction ou non, j'étais prêt à lui chercher des clients-amateurs, libre à eux de décider d'acheter ou non ces objets. J'avais quelques amis dont je connaissais la passion pour l'Art Nègre authentique et qui ne partageaient guère mes scrupules. De fil en aiguille donc, mon ami s'est rendu dans notre ville de province et des liens se sont tissés qui ont abouti, quand même, à l'acquisition de quelques objets auxquels ma compagne et moi n'avons pas résisté. Notre «living-room» (cette expression me fait toujours exploser de rire) s'est donc peuplé d'un grand nombre de magnifique tabourets Bamoun et d'un fabuleux lit d'origine Fang, dont je rêvais à vrai dire depuis que j'ai quitté le Gabon. Vous savez, un des ces lits extrêmement simple en bambou taillé à la main, modèle transmis de père en fils depuis l'extrême nuit des temps que les hommes fréquentent, une merveille et qui ne devrait en rien compromettre la qualité du patrimoine gabonais, étant donné que de tels lits se fabriquent encore à l'heure qu'il est. J'ai d'ailleurs ramené d'Oyem un couple de Biéris, ces statues Fang traditionnelles, que j'avais commandées à un artiste local pour une somme tout à fait rondelette. Ame en paix.
Mais de quoi parlions-nous ? Ah, de décoration et de formes. Hé bien, progressivement il s'est passé quelque chose dans mon habiter. Ces objets, qui m'arrachent pour ainsi dire de l'amour, se sont mis à peupler mon imaginaire, à fréquenter le même temps que moi, à s'installer en moi en même temps qu'ils s'installaient dans les lieux où je vivais. C'est moi qui commençais d'être habité par ces formes, au point de les considérer chaque jour avec un peu plus d'inquiétude, comme si elles avaient fini par faire partie intégrante de ce qui me constitue in concreto et que je devais, d'une manière ou d'une autre, protéger, soigner et nourrir comme mon propre corps. (voyez comme lorsque les choses deviennent sérieuses c'est toujours le corps qui entre en scène...). Là aussi semble s'opérer une sorte de retour au début, au dépouillement absolu, à la fuite du décoratif, au sens où l'essence même de ce qui sort des mains des Africains est dépouillement, beauté séparée par des années-lumière de toute velléité décorative, sédative ou caressante. Il règne dans les lignes de mes tabourets et de mon lit Fang, une rigueur tout à fait apaisante, apaisante comme le rire de mes amis noirs, comme leurs mouvements de main chaleureux et leur candeur si menaçante. Et pourtant, cette rigueur est mortelle, sans fard justement, atterrante dans ce qu'elle suppose comme projet, comme origine de pensée et comme absence d'eschatologie, d'idéologie de la guérison ou du bonheur sur terre. Je ne suis pas très sensible, encore, à la statuaire d'Indonésie. Mais il est intéressant de voir que là aussi les masques sont conçus comme pour mimer le négatif pur, la mort et ses agents démoniaques. Pendant que nous peignons des anges, sauf quelques Jerôme Bosch bien sûr, les «primitifs sauvages et analphabètes» plongent leurs ciseaux dans le vif du sujet. Dans l'au-delà de l'essence ?
Tout cela n'est pas sans avenir. Mon amie et moi allons déménager, dans une habitation nouvelle, vierge pour ainsi dire de nos anciens problèmes esthétiques et de leurs différences. Sans doute les formes qui ont commencé de nous investir, prendront-elles encore un peu plus de champ, d'emprise. Mais une emprise ordonnée, une structure, un champ cohérent où les habiter(s) s'entrecroisent. Les mânes m'habitent et je les habite enfin, enfin je m'approche d'une sorte de purification esthétique, c'est à dire de clarté de vision et de perception. Voilà ce qui se cachait derrière l'Art Nègre et ce qui s'en est suivi (l'art moderne), la clarté de vision et de perception : Mehr Licht ! Qui l'eût cru ? Du coeur des ténèbres - mais on savait déjà depuis Joseph Conrad, que ces ténèbres étaient situées au coeur de ceux qui venaient piller l'Afrique et non pas dans la forêt - de ce coeur-là, sortait la lumière. Qui l'eût cru, que l'Afrique était le lieu naturel d'une Aufklärung qui n'a jamais eu besoin de romantisme pour s'affirmer et vaincre la superstition elle-même. Hier soir sur l'écran qui s'allume encore de temps en temps, le visage d'un petit Africain affamé : je me suis in peto demandé de quelle faim il s'agissait, celle qui semblait ravager ce petit corps malingre, ou bien la mienne de réparer tout le mal qui se résumait là dans ce qui peut encore ête lu par les analphabètes que nous sommes devenus, les yeux brûlés de fièvre d'un enfant.
Dimanche, le 18 octobre 1998
Pinochet en prison ! Je rêve ! Quelle fabuleuse accélération de l'histoire, qui, pour une fois, ne s'acharne pas sur les éternelles victimes des répressions sanglantes de Rangoon, Djakarta et autres Kuala-Lumpur, mais s'attaque bel et bien à un authentique tyran moderne. Le tyran symbolique de ces trente dernières années.
1973 : Salvador Allende est devenu pour les hommes de gauche du monde entier le porteur d'espoir, à la fois humaniste modéré et «hombre» à poigne et sans concession. Pour toute l'Amérique Latine, cet homme, à l'instar de Simon Bolivar, incarne soudain une alternative aux échecs successifs des guerillas trotskystes, communistes, guévaristes et que sais-je encore. On n'a pas besoin, alors, d'être Colombien ou Bolivien ou Chilien même pour comprendre que quelque chose de fondamental peut, cette fois, changer dans le continent des compradores et de l'Eglise Catholique, des révolutions de palais et de la misère paysanne. Par malheur, cette évidence est aussi comprise au Pentagone. A Washington on carbure fébrilement sur les moyens de mettre fin au développement pacifique d'un état de gauche, en plein coeur du dispositif sacré de la Doctrine Monroe. On applique la stratégie habituelle, on en a les moyens, on invente Pinochet. J'abrège : on tue Allende, on tue.
Symbolique, Pinochet ne l'était pas seulement devenu pour ses tristes exploits de l'année où il s'empara du pouvoir. Il était aussi devenu le héros-despote reconnu et invincible du discours libéral, preuve par neuf de la légitimité utile et rationnelle de la tyrannie fasciste. A peine trente ans après Hitler, les milieux bien-pensants de la planète se sont mis à construire le mythe du dictateur parfait, remake lointain de certains empereurs romains comme Justinien le sanglant défenseur des appareils politiques concoctés par l'Eglise. A cette époque, Washington était loin de subodorer tout le bénéfice idéologique et économique que les multinationales allaient pouvoir tirer de ce coup d'état. Les états-majors américains ne se doutaient pas que le Chili allait devenir le modèle de l'état libéral, le laboratoire le plus fou sorti des têtes malades de certaines universités de notre monde. C'est au Chili que Reagan va reaganiser le plus profondément, mettant en application le hold-up permanent des revenus des travailleurs par l'application radicale des Fonds de Pension. J'aimerais savoir, chiffres à l'appui, ce qu'est devenu l'argent des futurs et des actuels retraités chiliens, au sortir des crises qui se succèdent depuis le début de l'année à travers le monde. Si leurs intérêts avaient été préservés comme on le leur avait laissé entendre, cela se saurait car cela constituerait la preuve que le système fonctionne dans n'importe quelle conjoncture. Le silence est la meilleure preuve qu'une fois de plus ce sont les salariés que l'histoire cocufie.
Mais Pinochet est en prison ! C'est incroyable. Il est sans doute trop tôt pour en conclure qu'il en va pour lui comme pour un vulgaire Barbie, enlevé sans façon par des forces politiques conscientes et décidées à faire le ménage de l'histoire - épisode qui rend quelques lettres de noblesse à ce Régis Debray que j'ai tellement éreinté récemment. Il est trop tôt pour juger si c'est déjà l'Europe sociale-démocrate qui se manifeste par cette décision courageuse, mais on ne peut être que profondément soulagé. Trop de sang et d'horreurs ont été passés par perte et profit dans ce pays et à l'extérieur. C'aura été l'erreur de Pinochet de trop compter sur une immunité mécanique dans les espaces politiques qu'il estimait sous contrôle de ses commanditaires américains.
Oui, on peut déjà penser que cette mise en examen est le premier acte d'une politique européenne enfin émancipée de la tutelle directe de Washington. Quel que soit l'issue de cette tentative intelligente de quelques juges espagnols, il en va désormais de Pinochet comme de Papon : il est déjà détruit symboliquement, et cette forme de destruction est la seule qui compte.
Petit ajout auto-critique : il y a quelques jours j'avais appris, comme tout le monde, que la France avait refusé un visa à Pinochet. Cette information m'avait bien surpris et réjoui, mais je n'ai pas pris la peine de refléchir sur l'importance de cette décision française, j'aurais pu immédiatement y discerner un changement beaucoup plus profond et beaucoup plus important dans le climat politique européen, mais le septicisme est plus difficile à dissiper que l'espoir, après tant d'années noires. Il faut maintenant refuser de se laisser à nouveau entraîner par les discours haineux et catastrophistes que distille déjà la presse dominée par les anciennes droites. Au fait, cette arrestation va également contribuer à éclairer des domaines restés très obscurs, ceux notamment des relations qu'ont entretenu de nombreux représentants des droites européennes avec Pinochet et son régime. Combien de nos élus sont allés lui serrer la pince ? Il est à espérer que la procédure va se poursuivre contre Pinochet, cela contribuera aussi à faire le ménage ici. Je me réjouis de lire le Canard Enchaîné et Charlie-Hebdo, les deux : mercredi prochain. Youpi.
Encore une remarque à propos de la presse haineuse : même les Dernières Nouvelles d'Alsace, un canard que je ne porte certainement pas dans mon coeur, écrivent aujourd'hui que la coalition rouge-verte allemande semble réussir à s'entendre et à progresser vers la constitution d'un gouvernement viable et efficace « malgré les oiseaux de mauvaise augure» qui passent leur temps à prévoir des difficultés insurmontables. Le terme est remarquablement bien choisi : oiseau de mauvaise augure, les Droites sont acculés à jouer des rôles d'oiseau plastronnant et coassant, elles se condamnent ainsi elles-mêmes à devenir et rester sans doute pour longtemps les figurants de l'histoire. Bravo les DNA !
Lundi, le 19 octobre 1998
Relu hier avec beaucoup d'appétit, la «Lettre sur l'Humanisme» de Heidegger. A l'origine une discussion avec JL Nancy sur l'éthique à propos de Levinas et Heidegger. Comme je me déclarais partisan de l'idée selon laquelle il ne peut y avoir d'ontologie non-éthique, ou autrement dit, toute philosophie doit être éthique ou ne pas être, et que je lui faisais part de mes difficultés à distinguer une éthique chez Heidegger, JL m'a renvoyé à la Lettre sur l'Humanisme. Dont Acte. Je me souvenais assez bien de ce texte que j'avais lu et relu plusieurs fois, mais je suis toujours émerveillé par tout ce qu'une nouvelle lecture apporte de plus chez Heidegger. Chaque fois qu'on relit l'un de ses textes on a l'impression de tout comprendre enfin pour la première fois, ce qui est la preuve absolue de son génie. Comme d'habitude, je n'ai donc rien compris (puisque la prochaine fois je comprendrai enfin...), mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle lecture, c'est que ma première impression a disparu. La Lettre m'avait toujours paru le texte le plus faible de Heidegger, au sens où on peut avoir l'impression d'un texte mystique. Il y a vingt ans la Lettre m'avait rejeté dans le camp de ceux qui donnent un contenu théologique à son concept (mais ce n'est pas un concept) d'être. Aujourd'hui cette impression a radicalement disparu et cela m'encourage grandement à reprendre une lecture systématique de H.
Mais je n'ai pas trouvé l'éthique. Du moins ailleurs que dans le ton. Le seul passage difficile, voire impossible à comprendre, porte essentiellement sur cette question de la relation entre l'ek-sistence et l'éthique. Il y est question du ne...pas, de la néantisation de l'être ou de l'être néantisant, en bref de la dialectique hégélienne dont on finit pas ne plus distinguer la structure de celle-là même à laquelle Heidegger nous convie. Extraordinairement rusée, la Lettre s'efforce d'éviter toute dénégation de la Métaphysique occidentale, mieux même, elle engage à une discipline historique proprement métaphysique, étant entendu que les grands philosophes ou métaphysiciens ne sont que les interprêtes de l'Oubli de l'être, et à ce titre les programmateurs de ses envois destinaux. L'éthique, donc, c'est quand-même l'Humanisme au sens plat et métaphysique du terme, un terme habilement récusé par Heidegger, récusé mais «relevé» comme dirait Derrida, comme si cette Abschatung de la Vérité de l'être formait en définitive et malgré tout, le seul résidu palpable du passage ou de la vérité de la tornade ... Au fond, dans cette atmosphère d'attente - et on peut bien y distinguer un paradigme eschatologique - Heidegger peut se lire comme Levinas, ou Levinas comme Heidegger. Le Dit de Levinas et tout ce que j'avais appelé sa déchetique, ce n'est finalement pas autre chose que l'oubli de l'être et ses conséquences métaphysiques. La différence n'est plus dès lors perceptible que dans le problème de l'éthique, ou dans ce que Levinas en dit. Sa position, en effet, se radicalise seulement là où il s'agit de juger l'éthique métaphysique et d'en proposer une autre.
Opération qui joue sur La différence lévinassienne, savoir le statut de la subjectivité, le lieu même où Levinas fait donner son éthique à lui. Dans la Lettre, la subjectivité est récusée définitivement comme accident de l'histoire de l'être, de son oubli. Dans Levinas, au contraire, la subjectivité est littéralement hypostasiée, absoluisée au point de tout faire reposer sur le sujet enfermé en lui-même. Ou je n'ai rien compris du tout. C'est peut-être cela, la vraie révolte de Levinas contre Heidegger, l'assomption du sujet dans sa facticité et dans son impureté ontologique, sa finitude, un néo-Stirnérisme inattendu mais sabordé immédiatement par la fatalité de la Responsabilité, par la proximité et sa redoutable mécanique, par Dieu, quoi, ou la dialectique.
Comment, alors, peut-on rendre compréhensible la possibilité d'une éthique heideggerienne ? Etant entendu qu'il ne suffit pas d'admettre que Heidegger nous convie tout simplement à nous soumettre aux éthiques implicites à la Métaphysique, en attendant mieux. Non, il y a, (y-a-t-il ?) une possibilité éthique dans la position ek-sistante, en elle-même. Un passage, qui m'a un peu effrayé tant il me touche, note que « la vérité de l'Etre (ne) se laisse jamais situer sur le plan des causes et des raisons explicatives ou, ce qui revient au même, sur celui de sa propre insaisissabilité». C'est moi qui souligne puisque ma position éthique dérive entièrement de l'assomption de cette insaisissabilité, de la reconnaissance de cette forclusion absolue de la vérité de l'Etre, seul lien possible entre les «sujets» de l'éthique. Dans mon raisonnement naïf, sans doute, je me dis que de deux choses l'une, ou bien les hommes de l'Humanitas, sont d'accord sur des Tables éthiques, sur leur provenance du Transcendant, ou bien il ne reconnaissent pas de Transcendant qui pulse de la vérité, mais seulement un transcendant hors de portée, insaisissable : le Transcendant en tant même que question de l'Etre. D'ailleurs, il y a dans la Lettre, une admirable symphonie de cette question, qui suggère au fond que l'attitude éthique n'est pas autre chose que la conscience qui s'aiguise de se savoir sur la lame de l'ek, entre l'Etre et l'étant, le corps basculé vers la vérité. Mais comme je l'ai écrit ailleurs, l'étant est un concept grammatical impossible, à cause du temps. Rien ne peut être étant sinon dans une approche empirique ou pragmatique, c'est là qu'il faut relire Augustin à propos du temps : «De ce qui n'est pas encore, à travers ce qui est sans étendue, il court vers ce qui n'est plus». Qu'est-ce-qui, dans ce flux héraclitéen, pourrait encore être étant ?
Donc, si la vérité de l'Etre ne se laisse ni saisir par les causes et les raisons, ni par son insaisissabilité elle-même, c'est qu'elle refuse toute saisie, cela nous l'avons compris et encaissé depuis longtemps. Mais ce refus est un refus de saisie ontologique que Heidegger nous présente dans la logique de la saisie ontique. Cela ne va pas. Le refus de la vérité de l'Etre, c'est ce que nous appelons proprement la forclusion ontologique, même si cette forclusion a les caractéristiques de la forclusion ontique. Mais cette forclusion a aussi les caractéristiques d'un lien plus puissant que tous les autres : nous sommes menottés à l'Etre pour ainsi dire par derrière, comme dans la Caverne nous ne voyons que son ombre, mais notre dos repose bel et bien sur un banc de bois, sur un espace d'Etre vrai. Il faut apprendre à voir avec son dos.
Mardi, le 20 octobre 1998
Poursuivons notre méditation sur l'éthique. Heidegger et Levinas ont donc une certaine structure théorique en commun : celle du dégradé d'être, déjà connue depuis Descartes (et bien sûr Platon), qui dit que les choses sont plus ou moins réelles, selon qu'elles soient plus proches du monde des idées, de la question de l'Etre ou du moi responsable. On retrouve dans les deux orientations éthiques, l'idée qu'il y a, quoiqu'on fasse, un décalage, une perte, ou au moins une situation de différé originel dans la position humaine. L'homme semble toujours en porte à faux avec la réalité, qu'elle soit platonicienne, heideggerienne ou lévinassienne. De plus, cette situation erratique (pour le moins), est toujours décrite sur un ton apocalyptique, comme le dirait Derrida. Il y a, de part et d'autre, un engagement affectif et magistral envers le texte qu'on écrit et le lecteur qu'on imagine. Notons en passant que dans la philosophie occidentale, ce ton apocalyptique demeure par-dessus les différences théoriques. Nietzsche, dont l'essence de pensée me paraît justement s'exprimer dans le refus de ce différé, n'en use pas moins de cette sorte de contemption de l'espèce humaine, n'en encaisse pas moins cette vérité de l'homme mauvais, trompé et trompeur, minable et médiocre, hypocrite et malfaisant, impuissant et faible, même à déployer sa méchanceté. Bref, de quelque côté que l'on se tourne, l'homme met toujours à côté de la plaque.
On répliquera à cette constatation que s'il y a un besoin d'éthique, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de tordu chez l'homme, ou bien une situation qui torde quelque chose chez l'homme en permanence, qui l'expose au «péché», au crime, au mal, à la déréliction. Lorsque Heidegger ou Levinas, ou même Saint Augustin, décrivent cette déréliction, ils posent de facto la nécessité d'être d'une éthique, c'est à dire d'un comportement qui compense en quelque sorte le défaut initial. La paideia, le chemin dialectique de formation imaginé par Platon n'est rien d'autre que cette recette pour sortir d'un état originellement aliéné, et non pas, comme le disent Rousseau et Marx, socialement c'est à dire terminalement aliéné.
Ainsi chez Heidegger il y a bien un système de la déréliction. Chez Platon, la déréliction se joue par rapport à la vérité de l'idea, et elle suit une direction temporelle, puisque la paideia, quelles qu'en soient les difficultés, peut réparer l'injustice originelle de la déréliction native. Si l'homme naît dans la caverne, il peut en sortir par la voie de la paideia. Pour Heidegger, cette vision est déjà faussée par la nature même de cette paideia, qui n'offre pas la vérité de l'Etre, mais seulement l'objectivité de l'objet, la vérité de l'idea, paradigme des ombres de la réalité. Comme le dit Heidegger, la paideia ne fait que déshabiller l'objet, dévoiler ce que cèle les contours ombrageux des choses, alors que la vérité de l'Etre va bien en-deçà de ce dévoilement, vers le secret même de ce qui ouvre et éclaircit, vers l'arkè et vers le télos de cette ouverture.
Depuis Rousseau, mais on pourrait aussi invoquer des ancêtres beaucoup plus lointains comme les Epicuriens et les Sceptiques, l'éthique n'a plus ce caractère de rapport subjectif que l'homme peut entretenir avec telle ou telle vérité, mais elle se pose surtout la question de savoir comment les hommes peuvent vivre ensemble, quelles pratiques et quelles règles ils peuvent mettre en oeuvre pour rendre possible cette existence commune. Cette question, ou cette manière de considérer l'éthique, est, de surcroît, devenue une nécessité d'autant plus grande que le technique confère à l'homme un pouvoir de nuisance de plus en plus important. Si à l'époque des Grecs il était vital de poser les termes d'une éthique politique sous la forme des constitutions de la Cité, c'était bien moins en fonction de l'urgence de la survie de la Cité qu'en vue de pouvoir assurer la prédominance de l'aretè, des qualités aristocratiques définies par l'ethos grec, par ce que Heidegger appelle «l'habiter la cité grecque». A partir de Rousseau, l'immense capacité de nuisance de l'homme, que l'écrivain genevois intuitionne à travers son caractère d'écorché vif, l'éthique devient plus modeste. Elle ne se pose plus que la question de la possibilité de la vie en société. Marx va encore beaucoup plus loin puisqu'il intègre la dimension de l'impossibilité de la vie sociale à son effectuation elle-même. La violence accoucheuse d'histoire est l'histoire de cette impossibilité réalisée, dialectique.
On passe ainsi d'un schéma éthique ou l'altérité ne se joue plus entre l'homme et la vérité (de l'objet ou de l'Etre), mais entre l'homme et l'homme. C'est la «longueur d'avance» que prend Levinas sur Heidegger, en choisissant cette dernière esquisse et en posant que, quoiqu'il arrive et toutes choses restant égales par ailleurs (l'histoire de l'être, de l'étant etc..) c'est dans la relation à Autrui que se joue l'éthique. Levinas se pose ainsi en Aufheber de toute l'histoire de la métaphysique et de l'éthique en pratiquant ce renversement total, très comparable au renversement effectué par Marx de l'idéalisme hégélien.
Il joue sur du velours, car les capacités de nuisance et de destruction humaines sont passés, depuis Rousseau, dans un tout nouveau registre, celui de la néantisation totale, ou de l'anéantissement. Réalité intuitionnée par Nietzsche sur les champs de bataille de la guerre de 1870. L'éthique nietzschéenne, ce qu'on a appelé le nihilisme, ressort d'une sorte de fantastique insolence issue de la possibilité donnée à l'esprit humain de fantasmer le néant vrai, celui de la planète, de la disparition du tout de l'humain dans la barbarie destructrice. Sans, cependant, que cette possibilité n'existe en réalité, comme cela allait être le cas quelques décennies plus tard avec les armes nucléaires. Nietzsche, au fond, bluffait, mais comme Rousseau il pressentait l'avènement d'une réalité cataclysmique dans laquelle des choix fondamentaux allaient devoir être faits. S'il avait pu imaginer la puissance nucléaire, il est probable, comment ne pas le voir, qu'il aurait remisé son éternel retour du même au musée des éthiques artisanales.
C'est pourquoi il est essentiel de tenter de comprendre ce que Heidegger dit : - « Le néantiser déploie son essence dans l'Etre lui-même, et nullement dans l'être-là de l'homme, pour autant qu'on pense cet être-là comme subjectivité de l'ego cogito» - (Lettre sur l'Humanisme, Gallimard 1976, page147), puis page 148 : - «Seul l'Etre accorde à l'indemne son lever dans la grâce et à la fureur son élan vers la ruine» -. En tant que «berger de l'Etre», l'homme ne ferait que réaliser l'accord, le don de la grâce ou de la fureur ? Non, car plus loin est écrit ceci - «C'est seulement pour autant que l'homme ek-sistant dans la vérité de l'Etre appartient à l'Etre, que de l'Etre lui-même peut venir l'assignation de ces consignes qui doivent devenir pour l'homme normes et lois» - Ces consignes sont, pour l'homme, des injonctions à l'Etre.
Difficile. L'homme n'est ni un ego cogito, ni une somme quelconque de ces mêmes ego. Heidegger veut-il affirmer que l'homme n'est homme que pour autant qu'il se sait et se pense comme berger de l'Etre, et que tant que cette pensée domine son «ego cogito» l'Etre lui délivre les consignes éthiques, les normes et lois. Normes et lois ne sont pas fabriquées par l'ego cogito, elles ne sont pas le simple fruit d'une élaboration artisanale au sens platonicien, mais elles sont «délivrées» dans une sorte de schéma biblique de l'élection. Evidemment une telle théorie permet d'inclure sans problèmes le danger de néantisation, puisque celle-là reste dialectique tant qu'elle est reliée à la pensée de la vérité de l'Etre. C'est à dire que le négatif ne peut et ne veut jamais être absolu, mais toujours et seulement relatif.
Relatif à quoi ? A l'effectuation (shoking!) de l'Etre.
Un mot quand même : cessons de nous leurrer. On peut prendre l'éthique dans tous les sens que l'on veut, cela ne dispense pas de choisir, cela ne dispense pas d'être la relation, d'être ce qui relativise la négation, évite la barbarie et dément le volonté de néant. Que l'on se définisse comme ego cogito ou pas - qui donc a le choix de telle ou telle définition ? - nous sommes dans la pleine pâte des décisions capitales, en permanence, et ce dans le silence de notre place de citoyen, de père, de professionnel et d'homme de la rue. Sartre encore et toujours.
Il m'a semblé, autrefois aussi, qu'il était possible d'articuler une éthique sur une ontologie, ou, pour être plus précis, que l'ontologie pouvait délivrer elle-même une éthique. Cela se pensait sur le mode d'une théologie négative, dans laquelle le Bien était une carte forcée par l'absence de vérité. Etant entendu que l'ego cogito reste limité par son statut métaphysique et tient compte de cette limitation, il ne lui reste plus, dans l'incertitude même de cette position - position qui est elle-même le fruit d'une conquête, d'une paideia - qu'a opérer une suspension du jugement. Suspension du jugement est à prendre ici au pied de la lettre, c'est à dire en son sens juridique : il ne peut être question de juger autrui sur d'autres bases que celles de la fin et des moyens. Kant a parfaitement aperçu que ces deux catégories étaient les seules à même de structurer un comportement éthique parce qu'elles ne prétendent pas ressortir à autre chose qu'à la personne même, c'est à dire à ce que vise, en réalité, tout jugement. De quelque manière qu'on le prenne ou qu'on le comprenne, on doit reconnaître que le communisme est inscrit dans l'impératif catégorique. Cette suspension du jugement est rendue nécessaire et non contingente par le fait que l'ego cogito se sait en transit quelque part entre l'étant et l'Etre, car il ne se sait ego cogito que grâce au caractère transitoire de cette position. Il peut donc attribuer un statut social à la conscience, un statut d'égalité dont découle forcément aussi l'impératif catégorique.
Samedi, le 24 octobre 1998
Continuons sur l'éthique. Qu'est-ce-que l'éthique ? Une éthique s'apparente-t-elle à la loi ou aux lois, ou bien les lois dérivent-elles déjà d'une éthique ?
Heidegger fait dériver ethos de habiter. Habiter implique donc, au sens grec, la Cité. L'idée d'habiter contient ainsi une problématique extrêmement riche, à des années-lumières du simple fait de résider. On pourrait dire, par exemple, que, quel que soit l'endroit où je me trouve, j'y réside. En revanche, je n'habite, en général, qu'à un seul endroit, à moins que je n'habite nulle part - comme un SDF - ou que je partage ma résidence en de multiples lieux que « j'habite» successivement au cours de l'année ou de ma vie. Habiter ne signifie donc pas «se situer» en un lieu, mais être dans et par le lieu que j'habite.
Etre, nous y sommes. Que signifie ici, être ? Pour comprendre, il faut sortir de l'acception triviale de l'être. On peut être ici ou là, mais pas simplement comme on serait un point géométrique dans un espace, mais il faut pouvoir imaginer qu'en de certains lieux on ne pourrait pas être, que l'on ne peut pas être dans n'importe quel lieu. Ou encore qu'il y a un ou des lieux où je puis être, et d'autres non. Etre a ici un sens entéléchique : pour prendre une comparaison certes fragile mais facile à comprendre, on pourrait dire qu'à l'instar d'une plante, l'homme se réalise mieux en tel lieu qu'en tel autre. Dans le jargon actuel, on peut dire que la place du citoyen est dans la Cité. On ne peut pas imaginer d'humain, d'humanitas, hors du lieu qui s'appelle la Cité, la République et surtout ce par quoi ce lieu lui-même est habité, à savoir la démocratie.
Etre dans signifie donc autre chose qu'une localisation à l'intérieur de quelque chose, il faut constamment retourner la logique de la proposition en pensant «dedans, je suis», au lieu de dire seulement «je suis dedans». Ce qui permet de comprendre aussi que le lieu est ce par quoi je suis, ce par quoi mon être existe. C'est à dire, dans le vocabulaire de Heidegger, ce par quoi je suis placé dans la position ontico-ontologique, tourné vers la vérité de l'être. La vérité de l'être n'est pas, si je comprends bien, une réponse signifiante ou un objet vrai, mais elle n'est que le point entéléchique du là que je suis. Heidegger dit que l'homme est l'être-le-là, il est le là, c'est à dire le point d'ouverture du néant où s'ouvre la dimension de l'être. Point entéléchique veut dire ici, le seul point où je puisse être le là, la perfection géographique de mon être-là. Non pas géographique au sens purement spatial du terme, bien entendu, mais dans toute la richesse acquise par ce concept, richesse qui dérive sans aucun doute de la progression latente de l'idée d'habiter au sens de Heidegger.
Tout cela pose un nombre incalculable de problèmes et en tout premier lieu celui des liens qui peuvent unir en un point quelconque ou en plusieurs, la pluralité des êtres-le-là. D'abord que signifie cette pluralité ?
D'abord elle peut signifier que la multiplicité elle-même des hommes, c'est à dire qu'il soit seulement concevable pour un ego cogito qu'il en existe d'autre que lui-même, découle déjà de cet être-le-là et ne saurait même se concevoir sans le rapport à l'être, à la vérité de l'être. On ne peut dire «l'humanité» que dans et à partir d'un habiter déjà le lieu ouvert par l'être. A ce titre, la Cité grecque pourrait constituer cet abri provisoire de l'être, au sens où la parole sur la vérité de l'être fait irruption là, en Grèce sept ou huit cents ans avant JC. Identité et différence sont ainsi contenus non pas dans une axiomatique mathématique, mais dans l'axiome ontologique à partir duquel se définit tout humanité et, partant, tout humanisme.
La Cité grecque et son «éthique», celle de l'aretè, nous plonge directement dans l'éthique telle que la définit Kant et qui pour la définir, renvoie, dans le domaine des relations inter-humaines, exclusivement aux concepts des fins et des moyens. Pourquoi ? Parce que l'éthique de la Cité ne se préoccupe jamais que de la perfection, de l'entéléchie citoyenne, et pas du tout de l'homme-outil. L'homme-outil n'est pas homme, il est esclave, puisqu'il est esclave pour avoir déjà dérogé à son statut d'homme dans le combat. Il a déjà abandonné la perfection en refusant de mourir. Or que dit Kant ? Il revendique une situation éthique dans laquelle l'homme cesse définitivement de se servir de l'homme comme moyen, ce qui est la situation propre à la Cité grecque, qu'on le veuille ou non. Kant a d'autant plus de mérite qu'à son époque, non seulement l'esclavage n'a pas disparu, mais semble, au contraire à son apogée.
Le fait est qu'il «gomme» ainsi le problème de l'aretè, au nom d'une ontologie proprement métaphysique. Pour le quiétiste qu'il est, la vertu ou la perfection humaine sont des éléments transcendantaux, intérieurs et évaluables seulement par soi-même. A nouveau surgit le problème de la Grâce, la question de savoir si le sujet peut s'assurer lui-même le salut ou bien si de toute manière son salut dépend d'une décision arbitraire de dieu .
De toute manière se joue ici la différence absolue qui oppose une éthique chrétienne à une éthique païenne - il faut bien se servir de ce mot car il n'en existe pas d'autre. L'éthique chrétienne exclue toute la problématique de l'aretè puisque toute décision sur la qualité des âmes est reporté sine die, c'est à dire quand il n'y aura plus de jour, à savoir au Jugement Dernier. Situation extrêmement dangereuse pour la Cité, car la Cité a besoin de critères visibles, patents ; les hommes doivent être «patentés» pour avoir droit de cité. L'éthique chrétienne est donc un univers trouble où le mal lui-même peut se cacher en permanence et se saisir de tous les masques de la vertu ou des qualités aristocratiques. Même dans les civilisations primitives, il existe toujours le tribunal impitoyable des initiations, où le candidat-citoyen doit surmonter des épreuves qualificatives de la citoyenneté. Toute initiation comporte une relation réelle ou symbolique avec le combat, la mort et la douleur. Elle rend ainsi compte du degré de vertu de celui qu'on initie par rapport aux vertus exigées par la Cité. Sparte rend bien compte de la place de l'initiation dans la société, et ce n'est pas pour rien que l'esclavage tient une place particulière dans la société de Lacédémone, une place beaucoup plus évolutive et plus dynamique que dans celle d'Athènes. On n'est et ne reste pas esclave à Sparte comme ailleurs parce que la guerre est l'élément permanent de l'éthique. La guerre n'est pas l'élément aléatoire de la vie, elle est l'élément téléologique de l'existence. Autrement dit on vit exclusivement pour la guerre, pratique initiatique permanente, session de rattrapage pour tout individu qui veut accéder à la citoyenneté. Au fond, on pourrait se demander si les Lacédémoniens n'ont pas institué la guerre comme finalité permanente uniquement parce qu'elle est un moyen simple pour labelliser la vertu des citoyens. Pourtant ce label n'a pas permis d'éviter la formation d'une classe corrompue, ni de ralentir le déclin rapide de Sparte. Ethique pas viable parce que la guerre ne se laisse elle-même pas transformer en pratique, en praxis indéfinie, et qu'elle prend tôt ou tard le masque de la comédie, transformant donc les guerriers eux-mêmes en comédiens. Je vous renvoie au récit émouvant de Plutarque racontant le sort tragique d'Agis et de Cléomène, deux jeunes Lacédémoniens qui veulent faire renaître la grande Sparte vertueuse et glorieuse. Par ailleurs le courage ne se laisse sans doute pas définir exclusivement sur les champs de bataille, de même que les sentiments qui se déchaînent au combat ne permettent sans doute pas tous d'envisager un gestion sereine de la Res Publica.
C'est pourquoi les sociétés les plus sages ont su faire la différence entre les exigences de l'initiation et l'éthique guerrière, apprivoiser le côté militaire de l'initiation tout en lui conservant assez de rigueur pour assurer le ciment social.
Je n'ai pas tant digressé que cela, car la question de l'habiter rejoint directement celle de l'initiation. Tout lieu est d'abord le lieu de ce qui est commun, le lieu de la communauté. A remonter en arrière, comme le fait Aristote dans sa Politique, on trouve la famille, c'est à dire le foyer naturel. Le philosophe cite Hésiode «Une maison en premier lieu, ainsi qu'une femme et un boeuf de labour». Politique I, 2, 11 Vrin trad. Tricot 1962. La Cité, rassemblement de villages, «est au nombre des réalités qui existent naturellement, et (que) l'homme est par nature un animal politique», et comme l'homme a naturellement la parole, au contraire des animaux dont le langage ne peut exprimer autre chose que le plaisir et la douleur, habiter la Cité signifie donc à la fois être dans son origine naturelle et à la fois là où s'exerce la parole, c'est à dire aussi la Justice. Ce détour par Aristote doit tenter de faire comprendre que si la Cité et les lois peuvent paraître dépendre du nomos, c'est à dire de la convention, de l'artificiel autrement dit, elle est en vérité le lieu de la phusis. Phusis ne veut pas simplement dire Nature, au sens objectiviste dans lequel on le cantonne aujourd'hui, mais indique plutôt seulement ce qui a sa provenance en soi-même par opposition avec la Teknè dont les objets ont leur provenance en-dehors d'eux-mêmes. Or, avoir sa provenance en soi-même, c'est là dépendre directement de l'être. L'homme n'est à ce titre pas seul à dépendre de l'être, mais il est le seul à entretenir une relation avec la vérité de l'être, avec l'être de l'être, spécificité qui lui permet d'habiter une Cité et non pas seulement n'importe où dans les autres dépendances de l'être, où l'homme ne saurait être autre chose qu'un «dieu ou une brute». C'est dire si le dieu au sens d'Artistote n'a rien à voir avec l'Etre de Heidegger, alors que ce dernier souscrit totalement à l'analyse aristotélicienne de la Cité, retraduite bien entendue selon son entente à lui. Le dieu d'Aristote est lui-même un habitant et non pas celui qui donne aux hommes l'habiter.
En limant bien, on arrive donc à faire cohérer la notion d'éthique avec la construction de la Lettre sur l'Humanisme. Mais à quel prix ! Au prix d'une sorte de subsomption du discours de la Lettre à la logique du texte d'Aristote. Reste à savoir ce que l'on a gagné entre les deux. Il suffirait presque de donner un statut légèrement différent au premier moteur d'Aristote pour rendre presque inutile toute la construction heideggerienne. Si on extrait ce moteur de sa propre situation géocosmographique, on peut peut-être lui donner le titre d'Etre. Non ? Demain nous nous interrogerons une fois de plus sur l'éthique et sur ce que l'événement de la Shoah peut avoir lancé comme nouveau débat éthique, c'est à dire nous nous demanderons si toutes les données de l'éthique en tant qu'habiter, c'est à dire aussi bien toute l'éthique occidentale, peut «gérer» l'événement de la Shoah, c'est à dire, dans la réalité, la réduire historiquement comme un événement possible et dépassable. La question simplifiée étant : peut-on trouver un châtiment qui puisse apaiser la souffrance de l'Homme qu'a déchaîné le génocide nazi, et permettre ainsi de mettre fin à la suspicion qui pèse sur toute éthique ?
Dimanche, le 25 octobre 1998
Journée toute trouvée pour un pareil sujet, un dimanche ! Jour des seigneurs...
Il y a un paradoxe dans le racisme. En même temps qu'il rejette l'universel ou l'universalité de la race humaine, il la confirme. Il n'est pas difficile de saisir que pour poser une race inférieure, il faut d'abord identifier une «race», c'est à dire un ensemble identique, un sous-ensemble de l'ensemble humain. Il faut donc se servir des mêmes instruments logiques que ceux qui égalisent, car le racisme en tant que tel égalise bel et bien aux dépends des groupes globalement inégaux. Au fond, le racisme circule dans une vision tout à fait universaliste du monde, car son essence puise précisément dans une égalité fantasmatique d'une race, dont l'égalité garantit la supériorité, de même que cette égalité garantit l'infériorité de la race inférieure. L'égalité garantit parce qu'elle délimite universellement : tout aryen est supérieur, dit le racisme nazi. C'est bien une totalité qui est supérieure et non, ce qui ne serait tout simplement pas possible, une série d'individus. On ne peut pas dire : Monsieur Schmitt, Mr Untel, Mr Untel et Mr Untel sont de race supérieure, il faut trouver des catégories universelles que l'on peut imprimer sur des objets identificatoires, sur des listes et des passeports : Juif.
Le fait, par ailleurs, que l'égalité raciste n'a sa valeur que dans un sous-ensemble de l'ensemble humain, n'entame pas la forme universelle de sa logique pour une autre raison encore, c'est que le sous-ensemble raciste proclame sa supériorité absolue sur l'ensemble humain : tout membre de la race supérieure est totalement supérieur.
On serait donc en droit d'au moins soupçonner la logique des Lumières et ses conséquences désastreuses sur l'histoire. C'est un parti pris par toute une frange d'intellectuels dont nous avons déjà parlé.
Regardons-y de plus près.
Nous avons fait l'impasse sur une manière déterminée d'analyser ce phénomène, celle qui consiste à en circonscrire la dynamique à l'individu. Le racisme c'est la nature même du rapport à l'autre, un rapport qui commence avec celui qu'entretient la conscience avec elle-même. L'impossibilité du racisme comme vérité ou comme valeur se joue précisément dans l'impossibilité de la conscience elle-même de se prononcer sur elle-même. Pour que le racisme puisse «fonctionner», il faudrait d'abord que la conscience soit égale avec elle-même, c'est à dire, en réalité, qu'elle disparaisse. Cette disparition est donc programmée dans toute éthique ou loi morale qui se fonderait sur le racisme : un raciste ne peut plus douter.
C'est pour cette raison que le racisme n'a pas trente-six possibilités structurelles et politiques pour se développer et fleurir, mais qu'il ne peut exister comme loi morale que dans la forme la plus despotique des modes de gouvernement. C'est seulement dans le contexte d'un despotisme absolu que le racisme trouve sa possibilité d'expression et d'efficace. Dès qu'un soupçon de doute démocratique s'introduit dans une société, il ronge immédiatement tout socle possible pour le racisme : dans une société raciste, ce ne sont en réalité pas les membres de cette société qui sont supérieurs, mais seulement le maître de cette société. Celle-ci se construit alors culturellement et juridiquement dans un seul but : éliminer la moindre trace de doute à propos de cette supériorité. Si un despote réussit à rassembler tout le pouvoir, c'est parce qu'il représente à un moment donné la conscience collective elle-même à lui tout seul. En même temps que se condense sur lui tout l'espoir social, se referment sur lui tous les doutes de cette même société. Ils viennent en quelque sorte s'annuler sur lui, dans lui et dans ses décisions.
C'est pourquoi il faut absolument considérer la Shoah non comme un événement social, comme le résultat d'une infection pathologique de toute la société allemande, mais à la limite comme ressortissant de la seule responsabilité d'Hitler. Bien sûr, il existe parallèlement une pyramide de complicités qui se dégradent vers le bas, mais les grands artisans du génocide n'ont pas tout à fait tort de rejeter leur responsabilité sur leur Fürher, car il est l'unique lieu où le doute peut agir et où peut intervenir la décision. La question intéressante, est de savoir pourquoi les Allemands ont choisi le despotisme aux lendemains de la Première Guerre Mondiale, pourquoi ils se sont fatigués d'un coup pour la démocratie et ses doutes permanents.
Mercredi, le 28 octobre 1998
La question est évidemment mal posée : les Allemands n'ont rien choisi. C'est une sorte d'automatisme historique qui s'est déclenché dans la situation de l'entre-deux guerres. En termes d'historiens le schéma est assez simple : le fauteurs de la Première Guerre Mondiale, l'aristocratie impériale perd le sens commun face à Weimar, face à la naissance de ce qui leur a toujours été épargné, à savoir la démocratie. Certes, il faut encore distinguer : d'un côté les véritables Junker que définit un conservatisme aristocratique aujourd'hui totalement disparu, celui en gros de Bismarck, à égale distance de l'aretè grecque et des vertus luthériennes, qui on s'en souvient, sont taillées dans une étoffe à la fois rigoureuse et à la fois bigrement paillarde (Jünger appartient totalement à cette caste). De l'autre l'aristocratie des mignons de Guillaume II, les décadents de l'Empire dont le romantisme débile se partageait entre la dolce vita sur les falaises de Capri et les fantasmes guerriers que la technique allait leur permettre de manipuler comme un jouet. Cette classe de soldats de l'Empire tente alors le bluff de leur destin : Hitler. Sans doute parce qu'ils ont perdu l'essentiel de leur état, l'unité et l'esprit de corps. L'origine modeste d'Hitler ne les gène pas : ils peuvent y distinguer la grossièreté du fondateur de la Réforme, la rudesse des Chevaliers Noirs et pour le peuple il est une figure idéale de rassembleur, d'unificateur social.
Ce qui les inspire est le motif de la revanche et de la vengeance, et personne dans le monde occidental ne l'ignore. De telles perspectives ne laissent pas d'intéresser énormément tous les milieux que la paix est en train de ruiner : les marchands d'armes se frottent les mains devant le carnage qui s'annonce. Car il ne faut pas oublier qu'en 1918, la substance même de l'économie s'identifie toute entière à la guerre. Cela signifie, entre autre, que les neuf-dixièmes des investissements vont, depuis plusieurs décennies, dans la production d'armement, et qu'il est tout simplement absurde d'imaginer un instant de détruire une telle industrie ou seulement d'en ralentir le production.
Oui, le plus dangereux tout au long de ces années 1919 - 1945 aura été la conjonction de passions paroxystiques, la haine frustrée des Junker, et des intérêts du capitalisme (déjà) international. Hitler n'aura jamais été que le masque de la haine de l'aristocratie humiliée, mais dont il aura lui-même réussi à éradiquer tout ce qui restait de ses lointains fondements chevaleresques. Désunis eux-mêmes, les Junker avaient compris que leur défaite de 1918 était déjà liée à cette décomposition de leur classe. Il était donc naturel qu'ils misent, cette fois, tout sur un seul homme, quitte à se dissoudre eux-mêmes dans l'aventure. C'est un comportement classique dans l'histoire, qu'une classe sociale aristocratique se saborde elle-même lorsque le vent lui devient défavorable. Voir la Russie de 1917. Remarque : l'histoire de France contient de beaux paradoxes : c'est, entre autre, que la noblesse française a finalement dû de ne pas disparaître corps et biens à la monarchie dite absolue ! En 1789 il y avait, en effet, belle lurette qu'elle avait perdu sa propre conscience de classe et en partant en exil à Coblence, elle ne faisait que suivre les mouvements de la Cour et non pas se regrouper pour faire front. Depuis Louis XIV les nobles avaient appris à vivre sans conscience, c'est à dire à subsister dans la facilité grâce aux privilèges et à l'argent octroyés par Versailles, à tel point qu'une partie d'entre eux prit le parti de la Révolution, geste qui recoupe cette tendance au suicide des castes supérieures menacées. Donc à Coblence, les nobles se sont trouvés dans une couveuse dont ils sont sortis après Thermidor, mais sans avoir changé ni acquis une conscience plus aigu de leur condition et de leurs responsabilités aristocratiques, ce qui explique que la Restauration n'a pas eu vraiment lieu, comme en Allemagne et dans les autres pays européens. N'allez pas me chipoter pour quelques grands seigneurs qui sont allés se battre dans les diverses coalitions, demandons-nous plutôt pourquoi des ci-devants comme Talleyrand sont passés de la condition de révolutionnaires enragés à celle de Ministre de la monarchie puis de l'Empire ! Il représentait ce qui restait de l'aristocratie, point.
Pourquoi toute cette longue digression à propos d'Auschwitz ? Parce qu'il faut tenter de comprendre sérieusement, c'est à dire avec le moins de doutes possibles ce qui s'est réellement passé. Il faut, entre autre, élucider le plus rigoureusement possible la question de la décision initiale du génocide. A ce sujet on sait maintenant assez précisément qu'on peut exclure la thèse du pogrom qui a mal tourné. La thèse de l'Américain Goldhagen n'est pas fausse, qui affirme que l'antisémitisme allemand ne date pas d'Hitler et qu'il est consubstantiel à une histoire qui remonte très loin en arrière. Mais cela ne permet nullement de dire que le génocide est le fruit d'un consensus populaire, un degré naturellement atteint par un antisémitisme qui aurait obtenu sa garantie étatique. Non, le Protocole de Wannsee est clair : le génocide est une décision politique centrale et centralisée, planifiée ensuite selon des méthodes qui, au demeurant, n'auraient jamais pu s'harmoniser avec des mouvements populaires. Cette décision avait, par ailleurs, un coût auquel ne pouvait rester insensible une intendance toujours à la limite des moyens disponibles pour la guerre elle-même. Ce qui confirme qu'il a fallu une volonté unique et décisive pour entamer, développer et mener jusqu'aux limites du possible, c'est à dire jusqu'aux derniers jours de la guerre, l'anéantissement des Juifs.
Qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de vouloir innocenter des milliers d'Allemands complices à tous les échelons de cette horreur, et je considère le sort réservé à tous les hauts dignitaires comme parfaitement équitable. Mais il n'en reste pas moins que le fait du génocide, la réalité des camps et de leur sinistre besogne est le produit de la folie d'un seul homme, Hitler. Je peux parfaitement m'imaginer l'engrenage dans lequel une telle décision, fantasmée de longue date puisqu'elle figure déjà en toute lettre dans Mein Kampf, se trouve entraînée et appliquée avec toute l'intransigeance méthodologique et technique qui était requise. D'autant que cette mécanique se déroule dans une société où la terreur étatique a atteint son point culminant, où l'équivalence désobéissance = mort ne permet plus du tout d'envisager un dysfonctionnement quelconque quelque part dans la chaîne. Il faut donc accepter cette idée en elle-même effrayante, je le concède, que la Shoah est un événement parfaitement aléatoire au sens où la décision aurait pu, pour des raisons psychologiques diverses et variées, rester enfouies dans le subconscient du Führer, ne jamais surgir dans sa dimension réelle de systématisation industrielle de «fabrication de morts». Enfin, si cette thèse peut paraître ridicule en regard de ce qui s'est passé, c'est la réalité elle-même de la Shoah qui atteste de la justesse de l'analyse, au sens où seule cette volonté unique et absolue, qui étendait son règne sur la totalité de l'existence allemande, était en mesure d'en assurer une effectuation aussi terrible dans ses conséquences. Une volonté divisée en aurait divisé et amoindrie l'efficacité.
Il faut donc essayer de saisir comment cette volonté unique opère sur son entourage et, de proche en proche, sur une nation toute entière. Mais Hannah Arendt l'a fait assez brillamment pour que je puisse renvoyer à son analyse et ne pas m'attarder sur la mécanique du totalitarisme nazi. En revanche, ce qui vaut d'être analysé, et nous ne l'avons pas fait suffisamment, c'est le fait même qu'un despote comme Hitler, dont les actions participent elles-mêmes de l'approximation et du fantasme pathologique, puisse apparaître en plein vingtième siècle. Qu'on le veuille ou non, et malgré quelques tentatives avortées d'en finir, Hitler représente une sorte de dénominateur commun de la société allemande, et je le dis parce qu'il s'en est fallu de très peu qu'il n'entraîne toute la nation allemande elle-même dans le néant (ce dont il a d'ailleurs exprimé la volonté dans les derniers mois de sa vie). Le degré d'anéantissement auquel était parvenu la réalité allemande en 1945 prouve donc que cette réalité était hitlérienne au plus haut degré. Comme si la conscience allemande s'était réfugiée dans la folie d'Hitler et que les consciences allemandes avaient abandonné tout leur pouvoir à une seule d'entre elles ! C'est cela qui me fascine, car l'amateurisme d'Hitler était connu de tous, comme l'est aujourd'hui celui de Le Pen. La thèse selon laquelle c'est l'aristocratie allemande qui l'a joué comme on joue une carte au lieu d'une autre me semble parfaitement correcte. Les Junker ont très mal joué car il s'est avéré ensuite que celui qu'on croyait manipuler avait un sens plus fort et plus précis du pouvoir que ceux qui croyaient encore à ce moment-là l'exercer. Encore une fois : l'aristocratie allemande n'a pas compris que le fait même de choisir Hitler c'était signer son propre arrêt de mort et participait de cet instinct d'auto-destruction que je signalais plus haut. Ce qui confirme d'un autre point de vue que le peuple allemand avait aussi choisi et décidé d'en finir avec la caste militaire et la bourgeoisie qu'elle représentait.
1942, l'année du protocole de Wannsee qui planifiait le génocide, était donc aussi l'année où Hitler en avait déjà fini avec cette caste. L'opération Barberousse, lancée en Juin 1941, marque sans doute l'une des manœuvres centrales d'Hitler pour se débarrasser des officiers les plus encombrants de son entourage. Pour ma part, je me suis toujours demandé quels étaient les motifs stratégiques de la hâte avec laquelle il a déclenché la guerre contre la Russie. Le livre écrit pas le général Gudérian, responsable des premiers succès de la campagne de Russie, montre à la fois le degré d'amateurisme d'Hitler en matière militaire et son désir, à partir de cette époque, d'éloigner le plus loin possible et le plus longtemps possible ses troupes les plus compétentes et donc les plus suspectes. Von Paulus et Gudérian en Russie, Rommel en Afrique du Nord, le reste de l'état-major cantonné dans les pays d'occupation ou entouré par les sbires de Himmler, Hitler pouvait se targuer d'imposer comme loi naturelle la plus petite velléité de son caprice. Et ce, à son monde entier. Oui, il faut voir la Shoah ainsi, comme une simple volition d'Hitler, qu'elle ait été longuement contenue par la conjoncture - c'est à dire par l'hostilité prévisible d'une partie de l'armée - ou seulement improvisée à une époque considérée comme plus favorable. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que ce projet appartenait entièrement à la conscience d'Hitler et à lui seul. Lui seul possédait le degré de monstruosité nécessaire pour décider de l'anéantissement de millions d'êtres humains exactement comme s'il s'agissait de tuer un mouche. A suivre.
Jeudi, le 29 Octobre 1998
A suivre, oui, mais comment ? J'ai réfléchi ce matin au sens de ma démarche et cela me fait un peu peur. J'ai l'impression d'exagérer dans l'insolence théorique : affirmer que l'intrusion dans notre histoire d'une horreur comme la Shoah peut simplement provenir de la saisie du pouvoir d'un seul homme ! Que c'est mal dit ! Essayons autrement : que ce crime, que tant de gens pensent indépassable, qui a peut-être brisé tout notre culture et porté sur elle des soupçons indétachables, soit l'œuvre d'un seul homme ! C'est peut-être seulement ainsi que l'on peut exprimer cela, l'œuvre d'Hitler. Cela éclaire un peu notre propos, au sens où la stérilité essentielle du nazisme - qui est aussi l'œuvre d'Hitler - s'accomplit comme œuvre dans l'assassinat collectif, dans le génocide. Par stérilité j'entends essence destructrice et néantisante de réalité, et la Shoah serait, de cette négativité l'entéléchie presque artistique, ce qu'Hitler a voulu de toutes ses forces et de toute sa passion, le geste «gratuit» qui doit illustrer son génie d'artiste de l'humanité, de sculpteur des races. Comme je ne suis ni croyant ni superstitieux, je ne peux relier cet homme avec aucune «force occulte ou satanique», ça n'a pas de sens. Ne pas avoir de sens signifie ne pas avoir de statut dans la réalité, dans ce que nous pouvons comprendre de ce qui arrive autour de nous. Il reste que cette passion ignoble semble contaminer ou affecter la réalité elle-même, briser comme dit plus haut, les tables des valeurs. Car, à quoi servent ces tables sinon à faire constamment barrage à ce crime-là en particulier qui s'appelle génocide ?
Le génocide n'est pas une nouveauté dans l'histoire humaine. Ce fut même, aux dires de certains historiens, la règle de la guerre à certaines époques. Tamerlan encore participe de ces moeurs qui voulaient que la guerre de conquête ne s'embarrasse pas de donner un statut aux populations conquises, mais de les faire disparaître purement et simplement. On affirme ici et là que des milliers de civilisations ont ainsi disparu dans le néant, mais cette affirmation ne peut se nourrir que de soupçons puisque le principe même du génocide consiste en un effacement de la mémoire. Sans doute, cette pratique était-elle reliée à la croyance que l'homme appartenait étroitement à la terre, et donc que la terre portait en elle des attributs proprement humains, qu'il y avait une complicité existentielle entre terre et homme. Qu'en quelque sorte il fallait purifier la terre des hommes qui l'ont possédée avant de pouvoir en assurer soi-même la possession, une forme ou une conséquence de ce qu'on appelle l'animisme. Dans la Bible, cependant, on trouve l'anathème, cette condamnation sans appel de peuples étrangers à l'Election dont David est la figure centrale. Il y a un grand malaise à soupçonner la Bible de communiquer avec l'époque des génocides, mais il est impossible de ne pas poser la question. Hegel a vu dans le Livre la cruauté de la Loi, opposée à la Loi d'Amour promulguée par le Christ, nouvelle et dernière figure de l'Histoire de l'Esprit.
Revient alors par la porte de derrière le motif du nomadisme et de son contraire le sédentarisme. Le Peuple, celui-là même qui faillit périr entièrement à Auschwitz, est le peuple nomade dont toute l'histoire biblique n'est que celle de son installation, de son passage à l'état sédentaire et de son échec final à réussir cette installation. Là aussi il est question de terre, de terre devenue entre-temps «terre sainte», admettant dans ce nouveau signifiant, dans ce nouvel attribut, ce que nous avons analysé plus haut comme motif de génocide, comme anthropomorphisme animiste! Comment une terre peut-elle être Sainte ? Même symboliquement ? (ce qui pour moi est encore plus réel que le réel le plus concret). En fait, cette sainteté fait référence à la passion de Jésus-Christ : son sang a imprégné la terre de Palestine et lui a donc conféré non seulement de l'humanité biologique, mais encore de la divinité spirituelle. Ce sang peut et se veut avoir comme efficace absolu la réconciliation avec la terre, le Messie purifie lui-même la terre du crime originel d'Adam et Eve, et la rend ainsi habitable. Le sang du Christ ouvre l'habitabilité de la terre, c'est à dire en terme simple : invente l'homme sédentaire. Pour nous, cette habitabilité s'avère finalement plus comme une exploitabilité, un arraisonnement comme dit Heidegger. Ce dernier est d'ailleurs lui-même pris dans une contradiction déchirante pour qui sait lire. D'un côté, en effet, il analyse avec précision tous les dégâts causés par cette installation, la mise en chantier du monde pour les besoins subjectifs, son exploitation aveugle par un anthropos oublieux de l'Etre. De l'autre il exalte l'habiter, il vit lui-même en poète de la symbiose avec sa Forêt-Noire et de la notion de lien destinal entre l'homme et sa terre. Comment cela est-il compatible, et d'abord de quel homme s'agit-il ? A l'évidence de l'homme sédentaire, le nomadisme n'est nulle part au menu de la réflexion du philosophe. C'est là sans doute ce qui pourrait expliquer le fameux silence de Heidegger à propos de la Shoah : les nomades n'ont pas d'appartenance ontique, il n'ont aucune «propriété», au double sens du mot, il ne sont tout simplement pas. Peut-on tuer des êtres qui ne sont pas ? Dans l'esprit des génocideurs, la logique est la même : les Juifs ne sont pas des êtres humains, ils sont des Untermenschen, une sous-catégorie de l'espèce humaine. Tout ce qui est «sous», dans la case «en-dessous», doit disparaître pour ne laisser que ce qui est parfait, la purification est un très ancien fantasme humain et n'a pas fini de faire couler le sang et les larmes.
La Bible a cette double fonction redoutable : elle raconte l'échec du passage du néolithique à la période historique mais force quand même le passage par le Nouveau Testament. Hitler, quant à lui, se tient en-dehors de ce débat, son concept de Lebensraum contient une doctrine et une logique totalement nomades, mais s'appuie sur une structure idéologique absolument sédentaire dans son obsession identitaire, raciale et même culturelle. Il y a là, dans cette incohérence, tous les ingrédients de la psychose. Cette incohérence ne manifeste, au demeurant, rien d'autre que la contradiction du technique lui-même qui exploite indistinctement l'étant, le réduit de plus en plus à un objet sans qualités, à des particules identiques animées par l'énergie, tout en en revendiquant une identification de plus en plus précise et de plus en plus singulière. L'homme se cherche des racines mais ne songe qu'à s'envoler dans n'importe quel ailleurs.
Mardi, le 3 novembre 1998
L'ère industrielle touche à sa fin. Chaque samedi je vais faire les courses pour la semaine, et chaque semaine je constate la naissance d'un nouveau rayon d'alimentation dite «biologique». Il est devenu évident que la demande sociale de nourriture change rapidement de nature. Le développement de l'agriculture biologique est assez ancienne déjà, disons une vingtaine d'années, ce qui laisse entrevoir déjà des capacités assez importantes si on tient compte du fait qu'il faut du temps pour biologiser une terre, c'est à dire la rendre propre à cette forme de culture. Il faut la «désintoxiquer», ce qui n'est pas une mince affaire. Mais la vitesse de l'engouement pour le bio semble s'accélérer depuis l'affaire de la vache folle. Ce matin, pour la première fois j'ai trouvé dans ma grande surface, un stand de viande de boeuf bio ! Pas très belle d'ailleurs, tout comme les légumes ou les fruits bio.
Or c'est justement cet aspect rebutant qui lui donne toute sa force de séduction : le produit est «sincère», il ne cherche pas à mentir. De quel mensonge s'agit-il ? C'est intéressant : Dame Nature a ses caprices et semble même avoir sa volonté propre. Ainsi les récoltes se suivent et ne se ressemblent pas, comme se ressemblent les récoltes industrielles : il y a des mauvaises années, des années moyennes et des années fabuleuses. Il y a donc aussi des qualités diverses, chose que l'on accepte parfaitement dans certains produits comme le vin, avec ses millésimes, mais qu'on a fait mine de refuser pour la plupart des autres marchandises lorsque l'industrie a fait la preuve qu'on pouvait égaliser les qualités d'une année à l'autre, lisser les productions. Je dis qu'on a «fait mine de» parce qu'en réalité personne n'a eu le choix. Presque du jour au lendemain, les radis ont pris une forme parfaitement homogène, les pommes de terre se sont transformées en une nouvelle légumineuse que l'on ne connaissait pas auparavent et les autres légumes se sont tous stabilisés dans des formes, des couleurs et des saveurs parfaitement reproduits d'une année voire d'une semaine à l'autre. A cela on peut ajouter que les saisons ont disparu et qu'il ne reste que quelques produits qui sont encore asservis à des époques précises. Bref, on a trouvé le secret d'un clonage permanent des choses de la bouche.
Or voici que toute cette belle production, qui a demandé d'énormes recherches et d'importants investissements, commence de rebuter le consommateur. Catastrophe. Les agriculteurs sont très conscients de ce mouvement et utilisent depuis quelques années déjà une propagande qui est centrée sur la volonté de faire une agriculture de «qualité». Mais hélas il est trop claire, déjà, que cette qualité ne peut pas s'obtenir par des moyens artificiels, car ce que le consommateur exige à présent, c'est la VERITE et non pas le confort perceptif. L'industrie agro-alimentaire est donc confrontée à un formidable défi : produire des aliments véritables, c'est à dire, dans l'imaginaire social, des aliments qui ne ressortissent que de la volonté naturelle. Tout tourne donc désormais autour de la définition de cette volonté et de la capacité de l'industrie à se régler sur une telle volonté ou à la domestiquer sans qu'on s'en aperçoive. Par exemple, les légumes obtenues dans des serres peuvent-ils rester biologiques, simplement parce que la terre ne contient aucun additif chimique ? Ou bien faudra-t-il prendre en compte la relation directe au climat et à ses caprices ?
Pour ma part, je donnerais plutôt ce conseil : que les millions d'Africains ou d'Asiatiques qui disposent encore de conditions de productions artisanales et spontanément biologiques ne perdent pas leur temps à venir immigrer dans des pays où il faudra qu'il s'intoxiquent avec nos marchandises en attendant que leurs enfants puisse se payer des produits biologiques ! Qu'ils exploitent cette veine eux-mêmes, demandent à leurs gouvernement de mener une politique de développement de produits agricoles et vivriers «naturels» qui trouveront sans problème des marchés. L'aventure des haricots verts du Burkina-Fasso est un exemple intéressant qui montre que le transport n'est pas un obstacle ou de moins en moins. Un équilibre économique pourrait même ainsi se créer entre pays dits développés (industrialisés, c'est à dire pollués, à indice «qualité de vie» faible..) et les autres. Le plus grand crime économique que j'ai vu commettre ces derniers quarante ans, est l'exportation de blé industriel vers des pays qui produisent des céréales et des légumineuses des millions de fois plus nutritifs et plus sains. Ces exportations commencent toujours sous le prétexte d'aide humanitaire, et se termine par une dépendance nouvelle.
Plus subjectivement, je constate que je ne peux plus avaler de produits industriels. Je ne sais d'ailleurs plus quoi manger, au point que je fais cuire le plus souvent du riz et des pâtes, comme tout le monde je suppose. J'en parle car je suis persuadé que mon expérience est loin d'être unique. Depuis des années je traverse la ville pour acheter mon pain chez un boulanger qui veut bien encore travailler pour fabriquer ce qu'il vend, c'est à dire faire lever et pétrir lui-même les miches et les baguettes. Quand il m'arrive d'aller sur la Côte d'Azur ou en Bretagne je m'étouffe de rage de n'y trouver que ce que j'appelle ironiquement de la mousse de pain. Je n'ai toujours pas compris comment les «gens» ont pu accepter aussi vite et aussi facilement des qualités de nourritures aussi scandaleusement nulles. Il a dû y avoir un chaînon manquant entre deux générations. J'ai fini par penser qu'ils s'en foutent, préférant faire rugir leurs moteurs et leurs aspirateurs. Mais les choses sont en train de changer, gare à vos fesses messieurs les arnaqueurs !
Samedi, le 7 novembre 1998
Il est trois heures du matin. Je viens de relire quelques pages de ce journal des années 93-96 et je constate quand-même de grands changements dans le style et dans les contenus. Cela m'inquiète un peu car c'est dans le langage, et donc dans l'écriture, qu'il y a les vraies mutations, les véritables changements. Vieillissement ? Autant je m'avançais moi-même , il y a encore quelques années, autant j'avance aujourd'hui masqué par la théorie, de plus en plus. J'y suis de moins en moins, moi avec ma singularité, ma morve et ma morgue. Il faudra que je revienne à l'actualité du texte, que je cesse de m'absenter sous des pretextes de sagesse vaine. Car il s'agit d'un journal. Imaginons un instant qu'Internet devienne un réseau permanent, une sorte du mémoire du monde : cela signifie que ces considérations, ces textes resteront dans cette mémoire pendant des années, des lustres et même des siècles ! Voilà qui nous évitera de mourir pour de bon !!! Dans un millénaire, on inventera une machine pour analyser les contenus des mémoires-serveurs, pour faire des synthèses historiques fines, c'est à dire qu'on pourra faire ce qui est impossible aujourd'hui avec le passé parce qu'il n'y a que des documents lacunaires, rien des masses, des peuples, des individus lambda comme moi. Oh bien sûr, il n'y a que des individus lambda, me direz-vous, et si on lit bien Cicéron on n'y discerne rien de plus. Certes. Avec le dégradé du temps qui passe, cette position de consommateur de valeurs posées par l'ancêtre, ou d'évaluateur de ce qu'il pose comme valeur. On sait bien qui était Cicéron. Un brave homme, plein de bonnes intentions, mais pas très courageux, un rien hypocrite et magouilleur. Ce que nous sommes tous derrière notre écriture ! Ce que je regrette le plus par rapport à ce que je notais encore il y a quelques années, ce sont les états d'âme et un certain courage pour étaler sur ces pages des pensées «sauvages» et crues. J'ai l'impression que je me débine de plus en plus, au sens de la fuite. Je me cache derrière des pensées que je fais avancer devant moi comme des petits soldats qui doivent aller se faire tuer devant. 14-18 de l'esprit et du sujet. Allez vous faire tuer, moi je reste à l'arrière.
Mais tout cela n'est peut-être qu'une impression, celle qui fait qu'on finit un jour par ne plus se reconnaître soi-même, genre vivant de la mort réelle. Pas si facile, je suppose, de s'assumer dans l'écriture pendant des décennies car le temps joue l'objet, on devient à soi-même une chose, palpable, nantie d'attributs de plus en plus discernables et j'imagine que cela ne pardonne pas. Pourquoi ?
____________________________________
J'ACCUSE
J'accuse la Démocratie américaine de violer les Droits de l'Homme en permanence et dans l'indifférence générale. Ce n'est pas de l'anti-américanisme primaire, mais un dégoût profond de ce qui se passe dans l'univers carcéral de la plupart des états de l'Union. L'instinct sécuritaire américain, qui va de pair je suppose avec une criminalité culturellement et politiquement développée, a mené ce pays à des pratiques intolérables. Privatisation des prisons, châtiments intolérables de la personne humaine, jugements expéditifs et exploitation économique des détenus, tourisme carcéral (déjà des Prisoner's Land) et tortures physiques et psychiques.
Puisque les Droits de l'Homme commencent à bénéficier d'un droit supra-national et qu'il existe désormais des tribunaux internationaux qui ont compétence pour tous les crimes contre l'Humanité, je propose que l'on forme des commissions de contrôle internationales chargées d'enquêter dans le milieu carcéral des 52 états américains et que l'on vienne au secours des millions d'Américains qui tombent inexorablement dans des prisons infernales qu'aucun pays européen ne saurait tolérer sans voir le peuple envahir les rues. Le régime carcéral américain est l'un des plus graves sujets d'inquiétude parce qu'il prend sa source dans une démocratie sécuritaire dont on ne voit ni la fin ni ce qu'elle peut encore imaginer pour remplacer la punition de privation de liberté par des châtiments dignes du Moyen-Âge.
J'ACCUSE les autorités locales et fédérales des Etats-Unis de barbarie.
Dimanche, le 8 novembre 1998
Ce matin j'ai le choix entre deux sujets de méditation. Le premier j'en entends en ce moment parler à France-Culture : peut-on comparer la Shoah à l'esclavage des Noirs africains ? Le second serait de reprendre le sujet d'hier à froid, et c'est ce que je vais faire, car le premier sujet est de nature à m'aliéner, si je le traite conformément à mes idées, un grand nombre de mes amis. Ce sera pour plus tard. « Mémoire Juive Mémoire Nègre» quand-même, un beau titre pour ce sujet, c'est un livre dont nous allons faire l'acquisition et nous en reparlerons.
Etrange, au moment où je vais commencer à parler de la barbarie américaine, ma radio déclenche «le temps des cerises», musique des libres penseurs, l'émission qui suit tous les dimanches celle des Juifs. Sujet : la laïcité et l'Europe, ou les dangers de l'Europe vaticane.C'est aussi un sujet important dont nous avons déjà parlé, mais sur lequel nous serons certainement obligé de revenir souvent encore.
Mon J'ACCUSE m'est sorti des doigts comme une explosion après un nième magazine sur les conditions carcérales aux Etats-Unis. Reprenons ce sujet froidement, si c'est possible.
Le cadre général de cette question est tout d'abord statistique, mais je ne vais pas vous fatiguer avec beaucoup de chiffres, vous pouvez d'ailleurs vous reporter très facilement aux sites Internet du gouvernement américain qui donnent toutes les statistiques qu'on veut. C'est là le seul paradoxe, mais il est intéressant, les autorités américaines ne cachent rien, ou alors seulement par quelques mécanismes de voilement. Les chiffres de la criminalité, par exemple, sont plus ou moins dissimulés sous des rubriques dont il faut deviner l'intitulé, surtout lorsqu'on ne connaît pas les catégories américaines. Le seul chiffre qui m'importe est celui des homicides, je pense en avoir déjà parlé dans un autre contexte. Environ 40 à 50 000 meurtres par an dans les 52 états américains. 4 000 pour la seule ville de New York ! Il faut raporter ces chiffres aux nôtres pour comprendre l'étendue du problème. En France, 58 Millions d'habitants, il y a chaque année plus ou moins 600 personnes qui meurent par homicide. Je tire cette donnée de la meilleure source possible, celle de l'INSERM qui calcule chaque année avec précision le nombre de Français décédés avec les causes des décès. Prenons la variante basse en Amérique, cela donne 40 000 morts pour 250 Millions d'habitants. Rapportée au nombre d'habitants de la France cela donnerait près de 7 000 morts par homicides par an. Soit dix fois plus.
Il faut s'imaginer vivre dans un pays dont on assassine tous les douze mois 7 000 personnes ! Dans mon entourage cette donnée laisse indifférent, on n'arrive pas à imaginer ce que signifient ces chiffres si on les traduit en ambiance générale, en comportements sécuritaires, en attitudes générales vis à vis de la délinquance et de la criminalité. Et pourtant on s'indigne, à juste titre, de la barbarie de l'univers carcéral US. Première constatation donc : la prison aux Etats-Unis va de pair avec une criminalité inconnue en Europe, il est inutile d'ajouter que la France n'est pas une exception quant aux homicides, elle est dans une moyenne globale européenne, ce qui veut dire beaucoup de choses quant à la ressemblance des moeurs et des cultures d'un pays à l'autre de ce continent. En gros il y a une valorisation de la vie DIX fois plus forte que de l'autre côté de l'Atlantique. Ou, autrement dit, en Europe la vie vaut dix fois plus cher qu'aux Etats-Unis. En réalité, il s'agit ni plus ni moins aux States que d'une mini-guerre civile permanente. Souvenir personnel : lorsque je vivais en Californie, il m'est un jour arrivé de me rendre à San José, la capitale de la célèbre Silicone Valley, sorte de non-ville étendue sur des centaines de kilomètres carrés sans véritable centre, avec seulement des entreprises à peine visibles et des maisons d'habitation à perte de vue. Dans la rue personne, et comme j'étais arrivé par le Greyhound, j'étais condamné à me rendre à pied à l'adresse où je me rendais. Que faisais-je ! A peine en route, voilà qu'une voiture de police me coince au fond du trottoir, sorte d'allée vague longeant une immense route, projetant quatre flics autour de moi. : - « Vous êtes fou ? - Are you crazy ?». Bref, il était quasi interdit de se déplacer à pied à San José, au motif que les flics n'avaient pas de temps à perdre à protéger les piétons des attaques des bandits ! Texto. Vu d'Europe, un tel comportement des policiers peut être considéré comme un véritable épisode de guerre civile.
Pas question, évidemment, de légitimer ceci par cela : l'incroyable état de non-paix sociale n'excuse en rien les mesures barbares décidées et appliquées par la justice américaine. Au contraire : cette non-paix sociale est exactement la même chose que la prison, c'est l'échec patent de la Démocratie américaine. C'est l'échec de cette forme de société dont Alexis de Tocqueville avait décelé, au milieu de toute la magnificence démocratique et judiciaire, l'un des résultats paradoxaux : - « On se plaint en France que le nombre des suicides s'accroît ; en Amérique le suicide est rare, mais on assure que la démence est plus commune que partout ailleurs» - (De la Démocratie en Amérique, 10-18 page 292). Il ne pouvait certes pas imaginer à quel point et comment ce traduirait en chiffres cette démence, un siècle et demi plus tard.
Analysons. Il y a, me semble-t-il, deux aspects à distinguer :
- le système judiciaire politique et décentralisé, d'une part,
- l'instinct de mort, thanatos particulièrement fort dans cette société vantée pour son haut degré de «bonheur social» et de confort, de l'autre.
Bien entendu, ces deux aspects doivent trouver leur rationnalité dans un même moule, si je puis dire, qui explique à la fois le fort mépris de l'existence (la faiblesse de l'attachement à la vie) et la structure morale-judiciaire qui à la fois gère ce mépris et en est un ressort. Il existe par exemple des états du Sud, où il est plus grave selon la Loi (mais il faudrait dire «selon les Juges») de voler un cheval que de tuer un homme. De telles lois reposent sur des situations d'exception normalisées, c'est à dire décrétées lors d'une circonstance de la guerre (par exemple celle contre les Indiens où le cheval a joué un rôle vital) et passées dans la vie quotidienne normale. Dans le cas du cheval, comme dans celui de ce gamin condamné il y a quelques semaines par un juge californien à 40 ans de prison pour avoir récidivé un vol de confiserie, (dans le cadre de la fameuse loi des Three Strickes, troisième récidive qui donne au juge tout pouvoir pour décider de la peine), il s'agit évidemment d'une loi inique, destinée exclusivement à surprotéger la propriété privée. D'où il apparaît qu'une telle loi produit elle-même les crimes qu'elle fait mine de combattre, car le désespoir qui est lié à une inégalité des ressources aussi sauvagement défendue donc perennisée, ne peut conduire qu'au pire, à des actes qui ne sont rien moins que des insurrections individuelles. C'est ce qui a fait la grande force de quelques scénarios du cinéma américain et de son roman, et qui nous permet de parler de guerre civile larvée.
Quel dénominateur commun pouvons-nous trouver pour tenter de jeter quelque lumière sur ces phénomènes si cruels ? Un seul, le Moyen-Âge. La Constitution des Etats-Unis et la forme de sa «démocratie», en font le pays le plus éclaté qui existe. D'un état à l'autre, il peut y avoir les même différences que d'une ville médiévale à sa voisine. L'état-fédéral est en réalité un état fantôme, et les véritables lois qui gouvernent la vie quotidienne et la sécurité des citoyens sont des lois votées par les Législatifs locaux, par les cinquante-deux parlements de chaque état. Lorsqu'un citoyen se trouve accusé d'un délit caractérisé par la législation de l'un de ces parlements, il ne lui reste plus comme ressource que d'arriver à prouver que cette loi est contraire à la Constitution Fédérale et à ses Amendements. On peut certes penser que la Cour Suprême des USA constitue une grande et véritable garantie contre les abus des lois locales et de leur application, mais, à lois de classe, justice de classe : la pauvreté condamne de facto n'importe quel citoyen américain parce qu'il ne peut jamais envisager de se faire représenter dans une telle procédure par des avocats talentueux et efficaces. Trop cher.
Washington reste et restera encore longtemps la capitale du plus grand pays du désespoir organisé. On me répondra par des descriptions enthousiastes du bonheur et du rêve américain,
on me rappellera cette chaude ambiance de l'Amérique où le lien social est si facile et si direct. Je me tiendrai à distance de la paranoïa européenne sur la violence permanente dans les rues de Chicago ou de Los Angeles, mais je continuerai de consulter les statistiques de la mortalité par meurtre. Il y a là une réponse sans fards sur le degré de désespoir et de fatalité qui déterminent les vraies structures de la vie quotidienne américaine. Derrière le sourire du voisin de bar, il y a aussi le rire cruel de l'Américain moyen qui consacre son dimanche à visiter le bagne de son comté, célèbre pour les conditions de vie littéralement animales des détenus qui ont le malheur d'y séjourner.
Lundi 30 Novembre 1998
Le temps est un cheval fatigué.
De nos sottises.
Mardi 1er Décembre 1998
Pinochet est «retenu» à Londres depuis plusieurs semaines déjà. Il est devenu une rubrique à part entière de mon journal télé. Chaque jour on guette une décision, et chaque décision en profile une autre. Les Lords, dont on attendait qu'ils le relâchent pour son Chili, en ont décidé autrement. Dans l'immédiat je me suis dit qu'il devait y avoir quelque monnaie d'échange là-dessous entre Blair qui veut démolir la Chambre des Lords et les juges qui représentent cette institution ahurissante. Mais je crois que de toute façon leur destin est scellé, les travaillistes vont certainement liquider ce dernier quarré de la Noblesse anglaise. La Reine Elisabeth elle-même a déjà tiré le rideau et s'est déclarée prête à tout abandonner. Donc, Pinochet représente tout autre chose, mais quoi ?
Autre hypothèse, son cas vient apporter une eau bien précieuse aux projets actuels de constitution d'un Tribunal International contre le génocide, les crimes contre l'humanité etc.. C'est une occasion de sauter le pas entre les déclarations d'intention et la réalité, et à relativement peu de frais tant Pinochet a cessé de faire peur. D'autant qu'un tel tribunal, s'il était constitué pourrait inquiéter pas mal de monde; de quoi restructurer bien des comportements à travers le monde, mais hélas pas seulement en bien. Car qu'en deviendra-t-il de ceux qui se révoltent contre ce qui existe ? Curieusement il y a un autre cas qui fait la Une ces derniers temps, celui d'Öcalan, le leader du PKK, le parti communiste des Kurdes. Or, s'il est évident qu'Öcalan n'a pas fait le détail en matière de terrorisme et de purge interne à son parti, il est moins certain qu'on puisse le classer purement et simplement dans la catégorie des salauds comme Pinochet. Bref, pour Öcalan aussi on attend la création d'un tribunal européen, mais comment va-t-on réussir à subsumer des crimes essentiellement politiques sous les catégories Génocide ou crimes contre l'Humanité ? Par ailleurs, il y a des massacreurs pur sucre comme Suharto qui continue d'avoir pignon sur rue. Suharto ce n'est pas dix ou vingt mille morts, c'en sont trois à quatre cent mille !!
En attendant, Pinochet, dont j'avais en 1973 suivi effaré heure par heure le coup d'état, rend quelqu'intérêt à mes journaux télévisés, et je suis particulièrement ravi d'être encore témoin de ce second acte d'une carrière aussi révoltante. En réalité, je suis convaincu que Pinochet n'est qu'une baudruche sans envergure qui doit sa carrière entièrement au Pentagone. Avant de venir en Europe, il avait essayé de venir à Paris, mais la France lui a refusé son visa. Il aurait donc dû se méfier, mais il comptait trop sur le Pentagone, pensant que les Américains ne toléreraient pas que Londres en vienne aux derniers outrages ! C'est raté, il aurait dû se cultiver pour savoir d'où vient le Travaillisme...
Jeudi, le 3 décembre 1998
Levy Strauss et le structuralisme ont-ils démoli bien plus de choses théoriques que l'on ne pense ? Je dis bien, démolies, liquidées et renvoyées au musée des oeuvres pensées ? C'est l'impression que j'ai aujourd'hui, sans qu'il y paraisse, alors que le structuralisme est lui-même fort mal en point dans le discours général, sauf l'espèce lacanienne, dont Levy Strauss disait qu'il n'en comprenait rien.
Cette impression provient de la lecture de son débat avec Sartre à propos de la raison analytique et de la raison dialectique. A l'époque de Sartre, on pensait Histoire + Dialectique. A savoir que l'humanité, dans la conception sartrienne-commune (je dis commune en supposant un effet d'idéologie qu'on peut difficilement nier dans les années 50-60) commence pour ainsi dire avec l'Histoire gréco-romaine et dialectique, étant entendu que la dialectique est une dialectique de la lutte de classe. Dans l'esprit de Sartre, les sociétés dites primitives ou sauvages sont tout au plus passibles d'une analyse qui les classeraient quelque part dans la proto-histoire du capitalisme. D'ailleurs, il n'y a pas que Sartre. A l'époque des journalistes et des humanistes comme Maxime Rodinson ou JF Revel, l'idée est courante que l'occident est la grande lessiveuse de l'humanité, le lieu où elle se réalise finalement quand-même rationnellement, c'est à dire dialectiquement. C'est ce que Derrida appellera plus tard, pas beaucoup plus tard d'ailleurs, l'ethnocentrisme.
Avec le structuralisme, les choses prennent une autre tournure. Sans oser s'attaquer à la dialectique dont il se dit redevable, Levy Strauss unifie le phénomène de la formation des sociétés, qu'elles soient sauvages, primitives ou «civilisées». Pour lui, la société occidentale peut s'analyser selon les mêmes critères que les autres, au point que l'ethnologue va jusqu'à affirmer que la théorie de Sartre peut passer pour un mythe identique à n'importe lequel de ceux qu'il analyse chez les Indiens d'Amérique ou chez les Eskimos.
Et c'est là que les choses deviennent intéressantes pour nous, car le procès de Derrida s'adresse autant à Levy Strauss, accusé de Rousseauisme débridé, qu'à Sartre, le militant de la lutte de classe.
Jeudi, le 24 Décembre 1998
D'un jeudi l'autre, entre-temps nous avons déménagé ! Quel douleur ! Mais aussi quel résultat ! La plus grande différence entre ces deux lieux de vie réside dans le calme du nouveau. Je dors tellement profondément que j'ai la tête toute cotonneuse le matin. Je vais peut-être à nouveau prolonger mes stations au lit, quoique mon corps ne l'entende plus tellement de cette oreille tant il manifeste de besoins douloureux dès le matin. Bof, ce qui est important c'est le changement que l'on va percevoir dans l'esprit, et, justement, j'ai l'impression qu'il se passe déjà quelque chose.
Voilà : ce matin j'ai eu, ou subi, cette curieuse volte de la conscience qui donne l'impression de la certitude théorique. Et, de manière très cartésienne, cette certitude porte sur la conscience elle-même. Evidemment, il n'est pas facile de cerner immédiatement une intuition par des mots, et sans doute encore moins de transcrire cette intuition, de l'écrire. Pourtant je vais essayer. Il y va de la relation entre théorie et conscience. Mon intuition me donne à «sentir», pour ainsi dire, une sorte d'homothétie entre la conscience et ses contenus théoriques eux-mêmes. Sur tous les plans : scientifiques, moraux et ontologiques. Autrement dit, et c'est de là qu'est parti l'intuition elle-même, il y a une qualité de la conscience qui structure toujours les matériaux de la mémoire et du langage, de telle sorte qu'ils peuvent jouer dans tous les sens et s'affiner seulement dans le sens de cette qualité. Cela peut dire cette simple évidence : la conscience a un contenu subjectif, à savoir : elle est le sujet. Retour à une idée depuis longtemps abandonnée d'une identité du sujet et de la conscience, sans doute mal conçue et déformée, car déterminée à partir des pouvoirs de la volonté et de la question de la liberté. Ce qu'on a ignoré ou ne pas voulu voir, c'est la pure subjectivité du regard, indépendamment de son insertion dans l'action et dans le langage. Descartes est sans doute le grand coupable dans l'affaire : il donne à la conscience une neutralité absolue et proprement épistémologique, il en fait un outil ou un milieu comme dira Hegel plus tard, c'est à dire un attribut universel d'un sujet particulier. On peut d'ailleurs se demander comment cet universel peut s'articuler sur le singulier tout aussi absolu et reconnu comme tel depuis les Scholastiques. Où trouver, cependant, de la singularité dans de l'opératoire ? Comment la conscience, regard sur «l'extérieur», simple photographie mouvante de ce qui nous entoure, peut-elle comporter de la singularité ? Comment ne pas ? Cela rejoint une fois de plus mon ancienne idée de l'héritage des perceptions, des perceptions «souveraines» c'est à dire formées par des individus souverains et en quelque sorte imposées à l'appareil physiologique lui-même de la collectivité historique : Adam a vu bleu, donc nous voyons bleu, alors qu'on aurait pu voir tout autre chose, sentir autre chose. Sacrée remise en question de la science elle-même, car que mesure-t-on alors ? De quelles taxinomies parle-t-on encore, sinon d'échelles empilées de décisions singulières : fou, et si toutes les sensations, y compris celles du plaisir et de la douleur n'étaient que des interprétations ? L'universel, alors, est tout autre chose qu'un simple milieu ou que ce vide galactique qui engoutit toute chose, tout objet et le soumet à des lois de vide. A suivre, sans doute.
Tout cela en même temps qu'une reprise de contact très brutale avec l'aperception sociologique de l'humain. Durkheim et le «fait social total» : le suicide comme expression «sociale» de l'évolution, ou comme symptôme de l'évolution de la société !
Mais cela peut ne pas s'opposer. Pourquoi la conscience individuelle ne serait-elle pas un donné tout aussi rédhibitoirement incontournable que le corps lui-même. La philosophie du sujet-objet fait perdre de vue l'objectivité de la conscience elle-même, comme entité aussi déterminée et aussi solidement pourvue d'attributs particuliers et généraux que les corps hylétiques. La conception de la conscience comme abstraction vide est en réalité un héritage onto-théologique, dans la mesure où l'âme est conçue comme un réceptacle vide, comme un topos déis, c'est à dire comme la chambre sacrée où la divinité pourrait siéger si elle le voulait. Le sociologique devra alors répondre à la question de savoir quel type de relation il peut y avoir entre des consciences si singulières pour qu'elles en viennent à se corréler à des actions communes, collectives ou tout ce qu'on voudra et comment cela est possible. Au demeurant, l'erreur de paralaxe qui détermine une conscience purement opérative ou instrumentale ne provient-elle pas tout simplement de la mesure ? Il est si facile de mesurer toute chose, exactement comme la sociologie qui repose toute entière sur la mesure ! Et alors on dirait que parce que la conscience n'est pas mesurable, elle est de l'ordre de l'infini ou de l'indéfini vide ou instrumental. Mais je crois que Hegel a très bien posé les termes du problème dans sa Préface à la Phénoménologie de l'Esprit : si la conscience n'est qu'un milieu neutre à travers lequel nous parvient l'absolu, ou un outil grâce auquel nous parvenons à le capturer, alors cet absolu ne peut plus être l'absolu parce que le milieu ou l'outil transforment cet absolu et il faudrait, au résultat, retrancher les transformations apportées par le milieu ou l'outil, et ainsi on se retrouverait devant le non-absolu du début ! Non, Hegel pressent que la conscience n'est pas neutre dans l'affaire, mais il se contente ensuite de la noyer dans la neutralité de la logique, tentant de compenser par le mouvement de la conscience, la dialectique, ce qu'elle perd en singularité réelle et non seulement logique.
Puissance : si la conscience est absolument singulière, comme un corps matériel, elle est d'une incroyable et incommensurable puissance, et cette puissance a toujours fait peur, y compris à Descartes. Elle pose en fait l'homme comme dieu, les hommes comme des dieux, car le champ de cette conscience est aussi vaste que l'univers : quel est secret de l'affaiblissement de la conscience ? Comment les hommes ont-ils procédé pour donner de ce champ universel une idée aussi ridicule, quelque chose comme un écran vide, passif ? Seules quelques grandes philosophies ipséistes comme celle de Fichte ou de Stirner ont flairé la position vraie de la conscience et aussi son pouvoir, celui de la continuation de la création. Rien de moins. Car la conscience, et je reviens ainsi au début de cette méditation, n'est pas pure réceptacle de la théorie, c'est à dire l'écran sur lequel se déroule ce qui passe devant, mais elle est la théorie elle-même, elle donne le mouvement à ce qui peut ainsi se dérouler et passer sous le régime du savoir, du connaître etc..Mieux, elle est ce mouvement. Le monde, la réalité, se soutiennent seulement par ce mouvement permanent des consciences.
Ici se rejoignent peut-être conscience et temporalité à la condition que l'on sache accepter l'équivalence du temps et de la temporalité. Husserl aussi a touché de ses neurones cette vérité que la réalité, l'histoire, le destin et l'éternité étaient le transcendantal, c'est à dire non pas de la matière formée par les facultés transcendantales, mais le transcendantal lui-même.
Idéalisme ? Quelle importance ! Une fois que l'on est sorti des schémas théologiques ou onto-théologiques, une fois qu'on a posé qu'il n'existe aucune autre puissance extérieure (aucun Malin Génie, aucun empire du Bien ou du Mal) les notions de nature-culture ou d'idéalisme-matérialisme perdent toute leur pertinence. Hylè-Morphè, voilà un doublet qui mérite que l'on s'y arrête. Nous y reviendrons.
Lundi, le 28 décembre 1998
Pourquoi je dis tout ça ? Rien de plus absurde à première vue que cette vieille antienne idéaliste : tout n'est qu'idée. Mais on ne s'est jamais avisé que le contraire aussi était absurde, qu'il était tout aussi ridicule de postuler une double substance Matière/Forme que de poser l'un ou l'autre isolément. Pourquoi ? Car pourquoi la matière pourrait-elle avoir des relations plus simples avec la forme que nous ? C'est à dire pourquoi irait-il de soi que la matière soit informée tout naturellement, alors que nous doutons jusqu'au bout de la matérialité ou de son contraire ? Si matière et forme allaient de soi, alors il me semble que notre conscience devrait aussi encaisser ce côté naturel et qu'elle ne se poserait aucune question sur sa propre relation avec la matière : puisque la conscience est le lieu même où s'exhibent les formes, et que le corps et très immédiatement la matière qui les sous-tend. Pourquoi est-ce justement en ce lieu-là que se posent les questions et se bousculent les doutes sur l'essence de ce qui est ?
En revanche, on a certainement déjà convenu que la réalité n'existait, en tant que telle, que dans des consciences. Ma conscience unifie cette réalité de manière absolue : rien de cette réalité ne déborde de ma conscience, car même ce que j'ignore perseptivement ou intellectivement appartient au continuum de ma conscience. La réalité explose dans la multiplicité des consciences qui la portent, qui l'unifient chacune dans une unité singulière, formant des unités multiples qui s'entrecroisent dans les représentations du langage et de l'action. Langage et action sont ce qui unifie les unités, langage et action forment l'Un des Uns et rien de déborde de ces unités et de cet Un-là. Rien ne peut déborder, que du bavardage sur une matière ou un esprit transcendant, c'est à dire une substance que l'on postule comme Autre, comme différence qui, en fait, n'est rien d'autre qu'une faculté de la conscience elle-même de concevoir des frontières à l'Un qu'elle forme en permanence.
On peut ici mesurer ce que représente le discours et l'action, de quelque espèce qu'ils soient. Discours et action paraissent dans l'unité des consciences et doivent se partager les places dans lesquelles ils apparaissent. Pour exister, il faut bien que la conscience de tous apparaissent l'une ou l'autre fois dans l'image globale : personne ne peut rester exclu de l'Un, sinon il s'effondrerait sur lui-même. Il faut donc gérer le théâtre de l'existence comme un lieu démocratique où chacun peut à un moment et en un temps donnés tracer pour les autres les limites infinies de son image conscienciale, superposer son image aux autres. La souveraineté n'est rien d'autre que la faculté de placer son image-conscience devant toutes les autres. On peut ainsi reconstruire tout un monde, si on a le temps, comme les Pharaons ou les grands bâtisseurs, qui ont préféré la matière apparemment palpable pour étaler leur image, leur représentation du présent. Lorsque nous nous promenons parmi les Pyramides, nous nous attardons dans la conscience des dynasties de pharaons, dans l'image qu'ils ont su imposer plus ou moins bien à toutes les autres consciences de leur époque, et même de la nôtre.
C'est aussi de l'éternité qu'il est question ici : non pas de celle de la représentation d'une conscience singulière par son talent ou sa puissance, mais celle de la faculté même de représenter, d'écrire le réel en continu dans la nuit de tout ce qui n'est pas la conscience. Ainsi, le politique n'est-il pas un passe-temps marginal, secondaire au regard des nécessités biologiques et économiques, mais central parce qu'il fournit l'accès aux places des images, il donne les règles de la préséance des réalités, selon la justice de leur entrecroisement, selon le rythme de leurs existences conjointes. La matière vivante n'existe pas en tant que support de réalités aléatoires, l'aléatoire est dans ce qui dessine cette vie à chaque instant de son apparition. Le politique a donc affaire au jeu des consciences et non pas à des oppositions de corps et d'âmes : un projet matériel ou intellectuel n'est jamais que le substrat d'une représentation que l'individu pourra ou non imposer au champ consciencial commun par le biais du politique.
La réalité chatoie donc de la multiplicité des reflets unaires, à condition que s'établisse le libre jeu des consciences : plus il y a de consciences singulières à briller, plus il y a de lumière dans l'univers : dès qu'un tyran s'empare du devant de la scène par la force, il tire un voile d'obscurité sur l'espace. Toutes les grandes tentatives despotiques se sont achevé par la stérilisation de la science parce que le discours singulier y tient une place totalitaire. Si un savant nazi n'avait pas eu la puissance de décider urbi et orbi que la bombe atomique n'est pas possible, Hitler aurait peut-être pu sauver son troisième Reich. Mais le pouvoir de décision exhorbitant de ses officiers du savoir l'a trahi. Or le possible vient précisément de la liberté des consciences elle-même, il n'est pas un aléas de la transcendance. C'est, entre autre, ce qu'enseigne la physique quantique.
Retour donc à Lévinas, car son idée à lui, sa représentation de la Vérité, a ceci d'irremplaçable qu'elle permet de distinguer le lieu où elle se joue, de comprendre à quel point la relation entre les consciences est primordiale dans ce dont elle est chargée, dans sa responsabilité réelle. Il est quand-même le premier philosophe à tout faire dépendre de cette relation, sans se payer de mots ou de mécanismes dialectiques ou autres. Si on reprend la dialectique du maître et de l'esclave, on saisit aussi ce principe du passage des images de conscience dans le réel selon une dynamique historique, mais on ne comprend pas que maître et esclave sont complices dès le début, qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de se partager les rôles. La négativité absolue n'est rien d'autre que l'eclipse de l'autre, Lévinas dirait la disparition de son Visage. Car il y a un renversement un peu gênant chez lui, un renversement qui donne l'avantage à l'extériorité ontique de l'individu au titre de sa nature de créature : comme Berkley, Lévinas intègre la conscience singulière dans la Conscience divine comme partie. Pourquoi pas, mais il court ainsi le risque d'énerver le Moi, de lui enlever toute la puissance du désir de créer lui-même le tissu de son être, et ainsi l'événement lui-même de la création. La création ne peut pas provenir d'un processus ou d'un mécanisme, elle est à chaque fois neuve et totalement inédite, c'est à dire décret d'un jeu.
Dimanche, le 3 Janvier 1998
Leibniz, Plutarque, que de naïveté ! Ou bien, n'en est-ce pas, et leurs esbaudissements sur Dieu ne sont-ils que des comportements normaux autrement nommés de nos jours ? Quand -même ! A force de me balader dans les premiers siècles de notre ère, je suis pris d'un soupçon qui se renforce de jour en jour : le monotéisme est une invention grecque. Juifs et Chrétiens ont eu l'avantage d'une Ecriture ancienne nommant un dieu national, une sorte de modèle parfait d'un dieu unique, mais ce dieu était unique pour les tribus d'Israël, déplacement géographique de l'arithmétique du divin. En réalité, ce sont les philosophes et autres sophistes d'Athènes et d'Alexandrie qui ont parfait le modèle du dieu unique. Il n'y a qu'à lire les descriptions platoniciennes et périplatoniciennes pour y distinguer très clairement les fameux Pères de l'Eglise. Qu'ont apporté ces derniers ? J'aimerais bien connaître le récit de l'adresse que fît St Paul aux philosophes de l'Académie ainsi que les réactions des philosophes présents. Cela existe-t-il ailleurs que dans le rapport de Paul de Tarse lui-même ?
La philosophie n'est-elle qu'une théophilie ? Après la lecture de Berkley et la prise de conscience des conséquences qui découlent du système idéaliste par excellence, je me suis souvent dit que la métaphysique ne se tenait que par Dieu. La Métaphysique ! C'est à dire un discours qui se veut cohérent et qui se destine à la gestion du chaos de la réalité. Les Grecs n'avaient que ce mot à la bouche : le chaos, et toujours pour le débiner, sauf quelques présocratiques et Epicure lui-même dont on peut mesurer l'importance à ce seul titre. Mais la métaphysique n'est pas, et loin s'en faut, la sagesse ou ce que j'appelle la sagesse de l'amour, véritable traduction de philosophie. Levinas a fait la même traduction, j'ai découvert cela récemment, et cela me rapproche considérablement de sa pensée même si la théologie reste tellement prégnante dans ses écrits. Au fond, je me fous des origines théologiques des uns et des autres. Un certain passé marxiste, ou faussement marxiste, a toujours travaillé dans les amalgames de toute sorte : - tu as pensé cela ? - donc tu penses ceci -. Tu crois cela ? donc tu te plantes sur tout le reste.
Je ne pense pas que cela «marche» comme cela. Il faut, là aussi, admettre le chaos et sa fertilité éthique et gnoséologique.
Il y a dans ces questions tous les mystères de la soit-disante «entropie» et de son contraire. Question : pourquoi l'ordre est-il forcément la réponse au chaos ? Je travaille en ce moment sur la démocratie et ses difficultés. Celles-ci ne proviennent toutes que d'une seule cause ; la volonté farouche de tout ordonner à une ou à la logique. Nulle part on ne songe à y introduire l'aléatoire avec ses conséquences. Voilà pourquoi l'univers est un jeu, et que la vie humaine est un enfer où, comme des enfants qui ne savent pas encore marcher, les hommes perdent leurs forces à boiter dans une mauvaise position. Au fond, l'homme a beaucoup parlé de la liberté, mais il ne l'a jamais osé, trop dangereux.
Lundi, le 4 janvier 1998
Pour mon anniversaire, j'ai trouvé une belle citation de mon ami Plutarque (le serait-il s'il vivait aujourd'hui ? C'est à dire, existe-t-il quelque part un Plutarque ? Dites-le moi si vous en trouvez un...). La voici : « C'est se tromper que de croire qu'il en soit de la politique comme d'une guerre ou d'une expédition maritime, de croire que tout doive cesser quand le but est atteint. Les fonctions publiques ne sont pas une liturgie ayant une utilité déterminée ; il s'agit de la vie entière d'un homme pacifique, ami de la cité, ami de l'intérêt général, et organisé pour vivre tant qu'il le faudra dans l'exercice des charges civiques et de la société humaine». Le mot liturgie est en italique dans l'original. Ce Plutarque est d'une modernité totale; dans sa vie de Démétrios et Antoine, il raconte l'histoire des Spartiates qui obligeaient les hilotes (leurs esclaves) à se saoûler pour les montrer ensuite à leurs enfants afin qu'ils prennent conscience des ravages de la boisson. Et là, notre bon philosophe, qui vit en plein siècle des esclaves (le premier de notre ère), nous déclare que «bien que nous, nous considérions comme barbare et inhumain de contraindre d'autres hommes à boire....» : il avait déjà inventé les Droits de l'Homme. Et en ce qui concerne la liturgie, il sait de quoi il parle, puisqu'il était pendant la deuxième moitié de sa vie prêtre d'Apollon et gardien des temples de Delphes. Mais ce monsieur, car il en était un, s'occupait aussi de manière annexe au ramassage des ordures ménagères de sa petite ville de Chéronée...Quel homme !
Mercredi, le 13 janvier 1999
Il faut mettre les idées à l'épreuve de l'écriture. En France les voitures flambent dans les quartiers difficiles, le gouvernement s'émeut et les propos les plus imbéciles fleurissent dans les cercles de badauds qui se forment ici ou là.
En bref, la question c'est : mais pourquoi ?
L'occasion, hélas, de désigner les coupables de la manière souvent la plus fasciste et raciste qui soit : ce sont eux, les barbares bronzés, mais oui vous voyez bien, les statistiques font foi, il n'y a rien à faire avec eux, on peut leur proposer n'importe quoi, ils sont incorrigibles, et après c'est nous qu'on nous accuse de racisme, etc etc ...dehors les Maghrébins. Curieux comme ce mot est en train de prendre le pas sur toutes les autres désignations, les
Maghrébins !
Alors, soit. Tentons l'exercice qui consiste à vouloir comprendre le soit-disant incompréhensible.
Primo : un constat s'impose au primitif de toute cette histoire de vandalisme : pour aller de Sarcelles à Paris le billet de transport en commun coûte 47 francs ! Dans les provinces les prix sont plus abordables, mais il faut du liquide ! L'opinion réagit comme s'il suffisait que ces jeunes «acceptent» de payer, alors qu'ils n'ont, la plupart du temps, absolument aucun moyen de le faire. Alors me direz-vous qu'ils n'ont qu'à rester chez eux ? Me ferez-vous cette réponse débile qu'osaient à peine nous faire nos parents à des époques où les jeunes n'avaient presque jamais d'argent dans la poche ? Non, ce qu'en revanche je demande, c'est comment il se fait que les transports en commun ne soient pas encore gratuits, totalement gratuits, pour toute une série de catégories sociales ? Tant que l'on raisonnera en termes de rentabilité financière du service public, il ne faudra pas s'attendre à un miracle. Dans cette histoire il s'agit ici de l'aspect le plus simple : une dynamique de rebellion fondée sur un sentiment très clair d'injustice sociale. D'un côté les municipalités ne savent pas quoi inventer pour rendre les centre-ville attractifs et conviviaux, de l'autre on continue d'en exclure ceux à qui s'adresse tout cet affairement urbano-social. Contradiction.
Le deuxième aspect est plus vicieux, et il ne se sépare pas du premier : la société de consommation doit produire aussi les accélérateurs de destruction des biens consommables. Hannah Arendt écrit dans «Condition de l'homme Moderne» : - « Dans les conditions modernes, ce n'est pas la destruction qui cause la ruine, c'est la conservation, car la durabilité des objets conservés est en soi le plus grand obstacle au processus de remplacement dont l'accélération constante est tout ce qui reste de constant lorsqu'il a établi sa domination» -
Voilà la vérité ultime : nous produisons, dans les franges de la société, les destructeurs. C'est à dire nous plaçons des êtres humains dans des conditions qui les contraignent quasiment à remplir ce rôle. Alors finissons-en avec cette hypocrisie, ce n'est pas digne.
Jeudi, le 14 Janvier 1999
Qu'est-ce-que la vertu ?
C'est un mot démodé. Mais l'idée ? Pas le moins du monde si l'on en croit les affairements multiformes autour de la justice, de la corruption, des droits de l'homme etc...sans parler des militants de la gauche anti-finances et des justiciers du droit d'asile.
Et pourtant il vaut mieux ne pas prononcer le mot sous peine de passer pour au moins ringard. Il est donc à parier que le sens réel du mot est exactement ce qu'il faut retrancher à son histoire proprement dite, ou à le dégager de sa gangue historique et de son usage traditionnel. Il y a eu un abus de langage, dont l'auteur ne peut être que celui qui s'est toujours fait passer pour le gardien de ces vertus, l'Eglise et ses satellites. En «gardant» le catalogue des vertus, les religions ont fait travailler les mots dans leur sens contraire.
Samedi, le 16 janvier 1999
Mais encore, à propos de la vertu. Il n'y a pas trente-six vertus, il n'y en a qu'une. Mais comment la nommer ? Elle pourrait s'appeler Liberté, mais la sémantique nous interdit un usage aussi simple, car il est pratiquement impossible de dire sans paraître ridicule : - je suis libre -
Or c'est exactement cela qu'il faut dire : je suis libre, non pas libre des contingences extérieures à moi-même, ineptie qu'aucun philosophe n'a jamais pris en considération sérieusement, mais bien entendu libre de ma propre contingence. Seule cette liberté-là peut me laisser penser que je ne suis que la contingence extérieure d'autrui, et qu'à ce titre mon pouvoir sur lui est contingent et ne peut pas être essentiel : i.e. je n'ai pas à exercer de pouvoir sur autrui, d'aucune manière, même pas et surtout pas me faire servir de quelque manière que ce soit. C'est cela, ce n'est que cela qui ne colle pas dans le capitalisme : le fait qu'il implique la servitude, dure ou molle peu importe : il est d'un autre monde, proche de l'enfer, de laver le slip de mon voisin.
L'homme est un projet, une esquisse. Il est en projet. La relation de servitude est le produit d'une simple inattention ontologique, je dirais presque qu'elle fait partie de ce que Pascal entendait sous le terme de divertissement, et cela des deux côtés de la servitude.
La vertu est donc dans la volonté de l'essence en tant que liberté : cela ne peut que conclure de la manière la plus transparente possible à l'essence démocratique du politique, aucune autre forme n'étant en mesure de garantir une telle essence. Dans la démocratie il y a le plus d'espace possible pour le jeu, c'est à dire pour un «milieu» (environnement dirait-on aujourd'hui) où les hommes libres peuvent exercer leur essence, car c'est en démocratie que temps et espace sont distribués le plus efficacement possible pour briser tout empiètement et casser toute tentative de cultiver la servitude.
Jeudi, le 28 janvier 1999
S'agit-il d'une découverte théorique ? Ou bien d'une de ces portes ouvertes que je vais encore une fois enfoncer ?
Je ne sais. En tout cas, il me semble qu'il faille aujourd'hui commencer de penser la relation de classe - ou de maîtrise à la Hegel - à travers la question de la qualité de la vie. Non pas de pouvoir d'achat, mais de ce qu'on pourrait appeler «souveraineté sur la qualité» ou bien, autrement exprimé, contrainte à la merde. La puissance des multinationales ne s'explique que par la contrainte qui existe de consommer leurs produits. C'est ce qui explique la position perpétuellement excentrique des paysans dans le débat politique et économique, et aussi peut-être, le fait que les Romains n'attribuaient la noblesse qu'aux agriculteurs.
Des milliards d'être humains semblent aujourd'hui s'illusionner à ce point sur les marchandises que les capitalistes peuvent tracer des flux de ventes à long terme sans se tromper.
La marchandise est devenue, mais Marx n'avait pas dit autre chose, la médiation de la maîtrise, la mesure du degré d'asservissement.
Mercredi, le 17 février 1999
Il faut que je m'en prenne une fois de plus au pragmatisme. J'en ai assez d'entendre parler du pragmatisme de l'un ou de l'autre et en particulier de celui de Jospin. Qu'est-ce-que, une fois pour toute, le pragmatisme ?
Sans revenir aux éthymologies absconses, disons tout net qu'il s'agit d'une philosophie du compromis fondé sur un fatalisme métaphysique : dans tous les cas cette philosophie pose une impuissance ou une imperfection de la volonté humaine. Elle dit que les hommes proposent et qu'une puissance transcendante dispose, la morale de cette vision étant qu'on peut toujours modifier son action en fonction de l'apparition des exigences de cette transcendance. En politique cela signifie qu'on peut se permettre de reculer au nom de forces supérieures, même lorsqu'un recul est fatal pour les principes mêmes de l'action politique. Ainsi, ce n'est que lâcheté que d'ouvrir le service public au privé sous pretexte que le marché l'ordonne, car de quoi s'agit-il en dernier ressort, de ceci, écoutez-bien : la loi du marché c'est la loi de la tyrannie sous la forme marchande. Et cela signifie que le tyrannique fait son retour dans l'histoire sous la forme de la marchandise, et aussi que la volonté humaine, qui a depuis longtemps pris conscience de ce retour, démissionne en appelant cela pragmatisme.
Pourquoi le tyrannique ? Parce que les relations utilitaires de compétitivité et de productivité ne peuvent aboutir qu'à des relations de soumission entre les hommes.
Vendredi, le 2 Avril 1999, dit Vendredi Saint (!)
De février à Avril. Quel Bond ! Mais que de choses se sont bousculées dans ma tête, et quelle période explosive. Tellement explosive pour nous tous qu'elle s'est achevée la semaine dernière par cette nouvelle «guerre» dans les Balkans, au Kosovo. Comme si les préoccupations personnelles s'accélérant dans leur anarchie facticielle trouvaient toujours de nouvelles gommes pour effacer la panique d'être.
Alors voici : « Si tout d'abord la Philosophie n'est pas une activité inventée, un affairement purement parallèle (mitlaufende : marchant avec) à la vie autour de n'importe quelles «généralités» ou de l'établissement de n'importe quels principes, mais qu'elle soit, en tant que discernement questionnant, c'est à dire en tant que recherche, seulement la réalisation explicite originaire de la tendance explicative des mobilités fondamentales de la vie, dans lesquelles il y va, pour cette tendance, de soi-même et de son être - et si deuxièmement la Philosophie est disposée à mettre en lumière et à portée de main la vie facticielle dans sa possibilité ontologique décisive, c'est à dire si elle s'est décidée par elle-même et clairement, sans coup d'oeil oblique vers une exploitation des visions du monde, à prendre en charge, à partir d'elle-même et de ses possibilités facticielles, c'est à dire si la philosophie est fondamentalement athée, et en tient compte - alors elle a fait un choix décisif et posé comme objet la vie facticielle par rapport à sa facticité. Le comment de cette recherche est l'interprétation de ce sens de l'être dans ses structures catégoriales fondamentales : à savoir les guises en lesquelles la vie facticielle se temporalise, et en se temporalisant parle avec elle-même (katégorein).» Et ainsi de suite.
Ce texte de Heidegger est tiré de son plus génial opuscule intitulé Interprétations Phénoménologiques d'Aristote (traduction personnelle car celle dont on peut disposer, à savoir celle de J-F Courtine, Ed TER, contient une interprétation contre laquelle précisément se propose ce commentaire). A noter qu'il est tiré de la page 10 d'un ensemble de 40 pages et qu'il n'a toujours pas été question d'Aristote. Mais on s'en fout, car il s'agit pour le philosophe de poser d'abord, avant de s'en prendre à Aristote, les fondements de sa méthode, mais pas de n'importe quelle méthode, car il s'agirait ici en fait plutôt d'une anti-méthode où l'essentiel n'est pas d'établir un plan de vol catégorial ou logique, mais une carte des territoires que l'on se propose d'atteindre, étant entendu que ces territoires sont toujours déjà là, en-dessous des aîles de l'appareil de pensée.
En fait, la pensée est la vie facticielle qui se parle à elle-même, de sa facticité, ou plutôt, en se posant sa facticité comme objet, elle parle. Qu'est-ce-que, alors, la Parole ? Elle appartient en premier aux «mobilités» fondamentales de l'être-là facticiel, elle symphonise en quelque sorte le mouvement d'inquiétude de l'être conscient de sa déréliction originaire. Originaire est à entendre ici non pas dans un Temps absolu ou historique, mais dans une origine structurante de l'être-là. Ek-sister c'est déjà philosopher, au sens où toute parole qui dérive de cette ek-sistance, a pour thème conscient ou inconscient, cette position dérélictive de l'être exposé-ouvert au néant. A ce titre d'ailleurs, les fameuses «visions du monde» s'inscrivent quand-même dans la Parole comme dire dégradé du Dire ontologique, et c'est sans doute là une des portes camouflées de cette pensée dans lesquelles se sont engouffrés Levinas et quelques autres pour la contester.
En effet, erfinden, dans son sens simple, signifie inventer. Courtine dit «inventer de toutes pièces», Heidegger écrit «inventer». courtine ajoute donc une nuance : «de toutes pièces», c'est à dire introduit une discontinuité radicale entre l'inventeur et la réalité à laquelle il a affaire, «controuvé» est limitrophe de «créer». Où sont les « pièces» dont s'emparent les discours sur les «visions du monde» ? Bien sûr elles sont dans ce qui est, plus loin, considéré comme le contraire de «athée», c'est à dire les religions ou les onto-théologies dont Heidegger parlera abondamment par la suite. Remarquons tout de suite que c'est à l'intérieur de ces onto-théologies que Heidegger va remonter la piste vers un questionnement originaire de la vie facticielle. Déjà dans cet opuscule universitaire, c'est Aristote - et sa vision du monde - qui est visé comme fondement d'une recherche à propos des mobilités de la vie facticielle. Le côté «inventé» d'Aristote, c'est à dire en fait la véritable facticité de son déploiement discursif, est donc aussi bien le terrain du questionnement ontologique facticiel tel qu'il peut se dérouler dans le présent lui-même facticiel. Il n'y a donc pas d'invention «de toutes pièces» au sens où il existerait deux discours dont l'un prendrait en compte le véritable questionnement et l'autre non : c'est dans le cours même du questionnement ontologique que Aristote «invente» sa vision du monde. Et il en va de même pour tous les philosophes chez lesquelles Heidegger finit par discerner un questionnement ontologique, quand bien même ce questionnement ne ferait que dériver du texte, ou selon l'herméneutique propre à Heidegger. Il en va ainsi pour Kant qui a questionné l'être en posant la question des connaissances synthétiques à priori et de la «talité» (du Wassein) des étants.
Alors évidemment, l'expression dérangeante ici, c'est au début du texte considéré, le mot «mitlaufende», textuellement «qui marche avec». Là aussi, Courtine traduit à mon sens faussement, mais là c'est plus grave, car il dit «à emboîter le pas à la vie». «im Leben nur mitlaufende Beschäftigung» ne peut en aucun cas se traduire ainsi. Certes, l'affairement ne fait pas plus que «suivre» la vie, marcher avec, mais lui «emboîter le pas» reviendrait à admettre quelque chose comme une mimésis, une imitation qui ne serait rendue possible que par et dans la possibilité d'une extériorité suggérée par le mot «mit», avec. On pourrait aussi traduire par «va avec», dans le sens de ce qui va avec, en fait partie, lui appartient, mais alors il ne peut pas non plus être question d'emboîter le pas, car ce serait alors la vie elle-même dont la facticité - c'est à dire la fausseté originaire de la position - produirait les visions factices du monde. Cette facticité est donc fondamentalement hybride : d'un côté elle se révèle par l'inquiétude produite par la facticité même, cela signifie que de toute manière je suis condamné à penser que tout ce que je pense c'est de la merde par rapport aux «choses sérieuses», et de l'autre cette facticité me fournit une tchatche sur l'être, les buts ultimes, l'eschatologie et tout et tout. Mais, pour étudier cette déréliction, il faut quand-même que j'en passe par l'étude de cette tchatche, quel qu'en soit le décalement par rapport à l'inquiétude ontologique.
En clair : «la réalisation explicite originaire de la tendance explicative des mobilités fondamentales de la vie» passe par une herméneutique des visions du monde passées et présentes, nolens volens. Mais, n'est-elle que cela ? On sent bien dans les premières lignes de ce texte cardinal, que Heidegger veut à toute force sortir de cette herméneutique qui à la limite peut devenir un véritable divertissement pascalien. On se balade dans les contes de fée de l'histoire de la philosophie en perdant de vue l'objet de la recherche, à savoir l'être de la vie facticielle elle-même qui nous induit sans cesse à nous attarder dans les contes de fée. La tendance explicative est le contenu propre des visions du monde elles-mêmes, la réaliser n'est donc rien d'autre que de reprendre indéfiniment ce contenu dans toutes ses manifestations philosophiques-historiques. A quelle fin ? En inventer de nouvelles ? That's the question. Car comment reprendre une disposition qui fut celle d'Aristote ou de Kant, sans «finir» comme eux ? Suffit-il d'invoquer Hegel comme circonveneur définitif du questionnement pour cesser d'inventer «de toutes pièces» ? Et pour faire quoi dans cette enclos philosophique ?
Réponse aujourd'hui : de l'herméneutique, c'est à dire poursuivre le travail explicatif des grandes paroles, c'est à dire, qu'on le veuille ou non, des visions du monde. Car à bien cerner cette expression «vision du monde», il n'y a pas grand chose à y redire, sauf à regretter la «grande Foi aux outre-mondes». Ce qui est contestable sans doute pour Heidegger dans cette expression, c'est l'impression d'aléatoire qu'elle distille : moi je vois le monde ainsi et toi autrement, mais il nous reste loisible à chacun de bavarder subjectivement et de nous satisfaire ainsi du produit de notre imagination. Bien sûr, cette subjectivité de la vision du monde n'est possible qu'après l'accouchement historial du sujet et de la subjectité de l'étant. Mais alors, si déjà l'être a «envoyé» le sujet, l'a mis en orbite, pourquoi ne pas l'assumer comme guise de l'inquiétude originaire : et qui pourrait nier que c'est cette subjectivisation de l'étant qui produit aujourd'hui la plus grande angoisse. N'est-ce-pas le message principal de Sein und Zeit ?
La vision du monde «mitlaufend» n'est donc pas seulement le factice du facticiel, elle est la matière actuelle du jeu de la subjectité de l'étant subjectif. On ne peut pas faire l'impasse sur les «visions du monde» sous prétexte que les Pères de la Philosophie existaient en un envoi différent de l'être, c'est à dire en une époque historialement autre. Car cette altérité est en elle-même problématique, au sens où ces Pères ont aussi activement participé à la parturition de l'étant-sujet, en ont certainement été les pionniers et en même temps les premières «pièces». Toute l'analyse heidegerienne de la Wende socratique perdrait son sens, et il aurait fallu que toute l'herméneutique de Heidegger s'en tienne aux textes «sacrés», c'est à dire aux fragments pré-socratiques. Mais tel n'a pas été le cas, même si le souçi heideggerien tourne essentiellement et explicitement autour de ce qui reste de tout cela dans les textes ultérieurs. Encore que certaines formulations à propos d'Aristote dans ses différents commentaires, laissent abondamment supposer que le Stagyrite est «encore» totalement transi par le message ontologique de ses prédécesseurs.
Au fond, que veut dire Heidegger dans ces quelques lignes ? Rappelons que le sujet général de l'opuscule est la présentation d'un projet herméneutique, celui d'une recherche sur Aristote. C'est au cours de cette présentation qu'il se heurte à la la nécessité de légitimer cette recherche philosophiquement parce qu'il vient de rompre les ponts avec la théologie en tant que son affairement propre. Une recherche non théologique sur Aristote demande donc quelques éclaircissements sur ce que l'on peut bien se proposer de chercher dans des écrits jusque-là monopolisés par l'onto-théologie. Il faudra donc imaginer une sorte de grand écart qui doit à la fois reprendre à nouveaux frais la tradition herméneutique classique, c'est à dire l'interprétation du texte d'Aristote, et en même temps montrer qu'on le fait dans une toute autre perspective que purement herméneutique, dans un but proprement philosophique-ontologique. C'est la philosophie d'Heidegger qui doit surgir au détour d'une activité qui porte essentiellement sur le déchiffrement du texte d'un autre philosophe et avant tout d'une nouvelle traduction du Grec tel que cette langue a été prononcée par les Anciens et non telle qu'elle nous parvient, déformée par le traitement judéo-chrétien.
Les quelques lignes que nous avons traduites font donc partie de la déclaration d'intention purement philosophique de Heidegger, on pourrait dire sa philosophie. Quelle est-elle telle qu'elle se présent ici ? Elle est d'abord dépouillement de la «parures des visions du monde» expression que l'on trouvera, insistante, encore quelques lignes plus bas. En fait, Heidegger veut nous dire quelque chose de précis à propos de ce dépouillement, qui comme nous l'avons remarqué plus haut, n'est pas un simple dépouillement, mais plutôt une extrême prudence à tout faire avec ces visions du monde sauf jouer pour s'amuser. Ce qu'il nous dit, c'est que la philosophie n'est précisément pas un jeu historicisant, elle n'est pas une sorte de puzzle aléthéïque que nous aurions le loisir de construire, bon an mal an, à travers les siècles, en nous roulant dans les azurs des «grands principes» et en polémiquant tout notre saoûl en regardant la plui tomber. Non, ce serait plutôt le regard sur la pluie qui tombe et le souci qui en découle qui nous intéresse, plutôt que les résultats des courses philosophiques des siècles. Nous sommes arrivés dans la terre de ce qu'on appelle l'existentialisme. Le problème se situe hic et nunc, dans notre situation destinale dans l'étant aujourd'hui - et non pas aujourd'hui seulement en tant que vingtième siècle, mais en tant que présent, en tant qu'Aujourd'hui de toujours, en tant que cet aujourd'hui que Aristote a lui-même ausculté en tant qu'étant.
Mais pour autant, on ne peut pas renvoyer les philosophes des siècles passés à leurs chères études, et les philosophes anciens moins que tous les autres. Il faut, au contraire, les prendre très au sérieux, et tenter, à travers un plongeon résolu dans leur parole, retrouver chez eux le coeur de ce que nous avons «sous la main» nous-mêmes, mais que l'impérialisme onto-théologique a transformé en idéologie destinée à éloigner l'homme ek-sistant de la question du sens de la facticité de son dasein. Ce qu'on doit retrouver dans une telle herméneutique, c'est la manière propre des uns et des autres de réaliser ou de satisfaire leur «tendance à l'explicitation des mobilités fondamentales de la vie» . Bewegtheit, voilà un autre mot-clef de ce petit passage, car il concrétise cette double démarche de Heidegger, d'un côté ne s'occuper que de la présence du présent, et de l'autre chercher des traces de ce souci dans les grandes oeuvres passées. En effet, cette idée de mobilité, Bewegtheit, est un concept crucial à ce moment de pensée du philosophe allemand car elle unifie deux branches de la philosophie allemande de son époque, celle des philosophies de la vie et la phénoménologie. Or, étrangement, la Bewegtheit est en même temps un concept-clef du système de pensée aristotélicien - aucun étudiant en philosophie n'a échappé au pensum de la dynamis-energéia, de la puissance et de l'acte, sans, il est vrai, jamais bien comprendre quelle importance pouvait bien avoir une telle banalité, tant qu'il n'avait pas fait le lien entre le réalisme aristotélicien et sa «vision des mondes» potentiels, virtuels mais effectifs, en un mot étants.
Samedi, le 3 Avril 1999, dit Saint
( suite)
La révolution heideggerienne aurait donc beaucoup de chances de ne s'avérer que comme un habile et tonitruant habillage d'une activité somme toute traditionnelle qui consiste à présenter un commentaire nouveau comme une pensée nouvelle, vérifiant ainsi le mot de Montaigne : «il n'y a jamais que des commentaires de commentaires». D'autant plus que Heidegger insiste sur le fait que Platon, Aristote, Saint Augustin et quelques autres, ont été eux-mêmes au coeur de l'explicitation des «mobilités fondamentales de la vie».
Mobilité : la vie vient d'entrer avec fracas - de rentrer ? - dans la conceptualité de l'occident, d'où elle était sortie à la faveur de la Scholastique, déjà des Pères de l'Eglise. Mobilité : «l'intentionnalité, prise purement et simplement comme être-référé-à-, est le premier caractère phénoménal, susceptible de prime abord d'être mis en relief, de la mobilité fondamentale de la vie, c'est à dire du souci». Ibid, page 28. Il est certain que depuis le De Anima et la Métaphysique TO, on avait résolument quitté le thème de la mobilité, celle-ci ayant subi une OPA radicale du Très-Haut. Entre-temps, la raison avait tenté d'occuper le terrain, se heurtant toujours à nouveau sur le problème de la volonté - substrat idéaliste de la «mobilité» - jusqu'à ce que Hegel mette à terme à l'affrontement en subsumant définitivement toute «mobilité» à la volonté. Mais voilà qu'un certain Heidegger écrit des phrases comme celles-ci : « L'être-là facticiel est ce qu'il est, toujours seulement en tant que propre et jamais en tant qu'être-là général d'une quelconque humanité universelle, chimère dont il n'est aucunement besoin de se soucier».(nous soulignons) Il ajoute tout de suite, adressant à Hegel un clin d'oeil complice : «La critique historique est toujours seulement critique du présent».
Est exclue du souci la chimère d'une humanité universelle. Sommes-nous pour autant tombés dans une égologie quasi stirnérienne ? L'homme du présent de Heidegger, l'homme de son histoire, est-il soudain devenu capable de gérer seul la mobilité fondamentale, alors que les Anciens, à commencer par Aristote, n'ont jamais détaché cette mobilité soucieuse de l'analyse de la Cité.
Samedi, le 10 Avril 1999
La nuit dernière j'ai rêvé tout ça : le souci, la pensée comme hiatus etc...Je vais donc prendre de la distance.
Et ça tombe bien, car il faut que je raffraîchisse mon image actuelle. Vous ne pouvez pas savoir combien un homme change en peu de temps. Surtout s'il ne l'écrit pas avec honnêteté et clarté. Voilà donc ce que je me propose de faire à propos de la «guerre» du Kosovo.
La pensée qui m'est venu ces derniers jours à la lecture de toutes les réactions que suscitent les événements des Balkans, c'est que je prends un coup de vieux : non seulement mon pacifisme de dissout dans le Kosovo, mais mon anti-américanisme secondaire (le primaire est depuis longtemps liquidé) en a pris un coup. Coup de vieux, parce que je me rends compte que je suis d'accord avec ce qui se passe et avec, en gros, les décisions qui se prennent ici (Bruxelles) et là (Washington). Ce n'est pas vraiment parce que j'ai de mauvais sentiments à l'égard de Slobodan Milosévic (même si son air adipeux me dégoute un tantinet), mais parce que je me sens tout d'un coup Européen d'une manière inattendue. En effet, l'attitude des Serbes depuis les affaires croate, slovène et bosniaque, me paraît radicalement décalée par rapport à notre histoire, injustement décalée. Depuis 45, la Yougoslavie de Tito est restée, jusqu'en 91, la seule région européenne qui a échappé aux sacrifices de souveraineté. Regardons en revanche l'Europe occidentale, c'est un bilan politique désastreux pour tous les pays en termes de souveraineté politique : Bruxelles a vampirisé les plus beaux fleurons du pouvoir de nos gouvernements et de nos parlements. Tant mieux. Tant mieux si tout le monde avait joué le jeu, et notamment les pays qui aujourd'hui se pressent à nos portes pour rejoindre le peloton européen.
En ce qui concerne les anciens satellites communistes, pas de problème, ils connaissent. Ils savent ce que impérialisme soviétique veut dire, avec tout ce que cela signifie de renoncement nationaliste. Pas de gros problèmes pour intégrer la Pologne, la Hongrie, les Téchécos et les Slovacos, même les Bulgares peuvent prétendre rejoindre la grande famille européenne des éclopés de la seconde guerre mondiale.
Pour les Balkans, en revanche, et la Roumanie fait partie du lot, (ainsi que les pays miniatures comme l'Albanie, la Macédoine, bientôt le Banat et je ne sais quelle Voïvodine). Pourquoi ? Réponse : décalage culturel, déphasage politique. Le titisme, le céaucescuisme et le Hoxjaïsme ont eu cette incroyable particularité de conserver ces nations dans une situation, dirais-je, de nationalisme absolu. Dans un vrai bocal de formol nationaliste, ces peuples ont perpétué en plein vingtième siècle, des moeurs et une pensée inscrites dans la tradition des Machiavels, révisées style Mussolini et aggravées paradoxalement par la résistance elle-même aux nationalistes de l'horreur, les nazis. Ce qui ne contribue pas peu à une bonne conscience nationaliste ou à un nationalisme de la bonne conscience indécrottable. Qui constitue, il faut le souligner afin de ne pas l'oublier, le principal danger de cette situation. Il faut bien comprendre que c'est cette extraordinaire bonne conscience qui permet aux ultra-nationalistes serbes, dont certains personnages qui sont de vrais gangsters (=nazis) comme le célèbre Arkan, de tenir des discours ouvertement racistes. Seselc (pardon pour l'orthographe) donnait, dans ses tracts de 98 (l'année dernière) toutes les recettes pour «démontrer à la population serbe que les Albanais sont atteints de pandémies» et donc pour s'en débarrasser sans prendre de gants, y compris de faire disparaître les cadres et les intellectuels par les moyens criminels habituels : attentats, faux accidents etc.. Ces nationalistes style Haider ou Jirinovsky, ont toujours été pris pour des rigolos sans rélle influence sur le cours de l'Histoire : il est temps de changer d'avis.
Viennent ensuite les arguments positifs : l'Europe. Car notre époque est une époque dangereuse, où on parle naïvement de «construction» européenne, comme s'il s'agissait d'un bâtiment, alors que cette construction est une croissance vivante, douloureuse et risquée. Nous, Européens, sommes en passe de réussir ce que les Grecs eux-mêmes ont toujours raté, alors même que les conditions de leur unification semblaient de loin moins problématiques que les nôtres. L'Europe ne se «construit» pas dans une position hégémonique, voilà qui est central : nous avons le culot de vouloir nous hisser au rang continental alors que la prépondérance est américaine, un redoutable concurrent dans les domaines de l'économie et de la politique : je vous rappelle que Europe versus Amérique, c'est République versus Démocratie, ce n'est pas peu pour l'avenir de la «globalisation»...
Raison de plus pour faire une sorte de mea culpa : fini donc l'anti-américanisme secondaire, celui qui correspond précisément à cette opposition purement idéologique, en apparence, mais grosse de conséquences historiques. Au Kosovo, Washington a fait jusqu'à présent, tout ce qu'il fallait faire, sans barguigner et dans des conditions pas faciles pour les gouvernants. Bravo, continuez ! A l'époque de la guerre du Golfe, on a eu quelques doutes, même si, au fond, le cas Saddam Hussein est exactement le même que le cas Milosévic, le même déphasage culturel, la même rigidité psychique face aux changements du monde. Et je rappelle qu'en ce temps-là je ne m'y étais pas trompé, soutenant déjà alors l'initiative de Bush, même s'il y avait lieu de le faire du bout des lèvres seulement, étant donné les enjeux sonnants et trébuchants qui donnent toujours un haut-le-coeur. D'autant plus que cette aventure, si elle ne s'envenime pas à l'est, va servir directement et très efficacement à l'inititiation politique des Européens : la «guerre» du Kosovo va accoucher d'une Europe vainement appelée par les voeux de tous, l'Europe politique et militaire, militaire, c'est à dire politique, comme on veut.
Alors pour le reste on peut discuter : intervention au sol ou pas, frappes totales ou pas, tactique et stratégie, tout reste ouvert et il faut se garder de la hâte, même si la rapidité de l'opération semble à tous garante de sa réussite. En tous cas aussi, il faut admettre que Slobodan Milosévic a fait son temps et en tirer toutes les conséquences, sans perdre son temps à comparer le dictateur à Saddam Hussein et à ce qui arrive en Irak depuis dix ans. Car nous ne sommes pas en Irak, la Serbie est un l'un des plus anciens états des Balkans, ennemis héréditaire des Albanais pour les avoir trahi même dans des alliances contre les Turcs, alors que le pays de Saddam est une invention récente : il y a une trop grand abîme entre Sumer et Bagdad, et pas assez de continuité historique.
Dimanche, le 11 Avril 1999
J'ai longtemps cherché à posséder la liberté de conscience, maitenant c'est elle qui me possède. Il est à peine huit heure, ce dimanche matin et je m'empresse de transcrire cette phrase que je viens de...rêver ! Excusez du peu.
Retour en Albanie. Et à Skanderbeg, un héros très mal connu dans nos écoles, et pour cause. Il s'appelait Georges Kastrioti (certains écrivent Kastriota), est né dans la première moitié du 15ème siècle en Albanie, fils d'un seigneur local. D'autres sources disent qu'il s'agissait d'une famille humble (version Eisenstein). Les Balkans, déjà à cette époque, étaient «au contact» avec l'ennemi, le Turc. Skanderbeg, que l'on peut traduire par Alexandre le Grand, mais on ne le fera pas pour la raison que vous devinez, devint donc le héros de la Chrétienté en défaisant à plusieurs reprises les armées ottomanes dans lesquelles il avait lui-même servi en tant que janissaire.
Je parle de ce personnage pour deux raisons. La première est que je le connais depuis plus de 37 ans, ayant présenté pendant plusieurs semaines, dans les campagnes algériennes de 1963, le film de Eisenstein (+un autre metteur en scène albanais dont je n'ai pas retenu le nom) sur ce personnage, devenu à cette époque héros du communisme pur et dur du camarade Xhodja. On écrivait Hodja dans les années soixante (?). Un beau film au demeurant, l'une des plus belles reconstitutions historiques que je connaisse avec Alexandre Nevski, mais qui est très mal connu. Hors des frontières albanaises, car je parie que la totalité de la population albanaise a vu, revu et encore revu ce film mythique, idéologique etc.. Alors peut-être ne lui a-t-il pas échappé ce détail, c'est que la Chrétienté européenne, menacée de loin par les Pashas, tenait un grand discours croisadier, mais se montrait d'un pingrerie absolue dès qu'il fallait mettre la main au portefeuille. Ce qui arriva donc à Kastrioti, c'est qu'il se fit battre finalement par les Turcs faute de moyens. Lui-même, aurait sauvé la papauté elle-même dans le conflit qui l'opposait à la maison de Naples. Bref la deuxième raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il est d'actualité : voilà un personnage européen avant la lettre, et dont le pays resurgit en vedette un demi millénaire plus tard. On va voir ce que vont faire les Européens cette fois-ci.
Pas fini avec l'Albanie, ex-Yllyrie (pardon pour l'orthographe, je n'ai pas la référence sous les yeux), drôle de coin quand-même, qui, je crois déjà l'avoir souligné à l'époque des événements de la Bosnie, a fournit une demi-douzaine des plus grands Empereurs romains, dont Dioclétien (mort en Croatie dans un Palais dont on peut encore voir les ruines, je crois) et Justinien, le juriste de la Chétienté doublé d'une canaille assez sinistre et nanti d'une épouse encore pire. En fait, il s'avère que ce petit peuple étonnant avait inventé, dès le 4ème siècle avant JC, l'égalité des hommes et des femmes et aussi, mais ça doit aller avec, le bonheur de vivre. Il y avait, dans l'actuel Vlora, ex-Appollonia, l'une des plus grandes écoles philosophiques après Athènes, mais hélas le Christianisme d'abord et l'Islam ensuite ont bien lavé les cerveaux albanais. Enver Xhodja n'a fait qu'achever le boulot...
______________________________
Pourquoi la douleur psychique est-elle plus insupportable que la douleur physique ?
Réponse : parce que l'on craint moins la mort que la folie. La folie ? Pourquoi craint-on moins la mort que la folie ? Parce que la folie est une sorte de mort, mais vivante. Elle est cela dans l'imagination anticipatrice, évidemment, mais pourquoi ?
Pas si compliqué que cela. Imaginez que votre existence est cadrée par un discours bien construit (par celui de la famille, de la culture, de ce qui constitue votre «sujet» etc...). Cadrée signifie soutenue, motivée seconde par seconde, portée en quelque sorte jusqu'à la mort avec le sentiment naïf d'accomplir quelque chose comme la «vie». Dès que ce filet de sécurité est menacé, commence la douleur psychique. Lorsque, par exemple, quelqu'un vous accuse et met en doute l'un des aspects de ce dispositif de défense (et d'agression) psychique, alors commence votre torture. Vous pouvez répondre par la violence, mais en général cela ne fait que prouver que votre filet est fragile, qu'il est facile de le remettre en question et ça fait encore plus mal. Le pire, sans doute, est de négocier avec le soupçon que vous n'êtes pas celui que vous pensez vous-mêmes, et c'est là que la psychanalyse est intéressante, parce qu'elle vous débarrasse (ou prétend le faire) de votre responsabilité d'être ce que vous croyez être. Ah! Imaginez que vous pensiez être innocent, juste, bon et loyal, et qu'on vient vous prouver, ou tenter de prouver que vous n'êtes rien de tout cela, mais juste le contraire ! Quelle épreuve ! Car de deux choses l'une, ou bien vous êtes convaincu par les arguments qu'on vous propose, et à ce moment-là il y a un doute, car cette reconnaissance même prouve que vous êtes au moins honnête, et que l'accusation n'est pas totalement bonne, mais vous restez coupable. Ou bien vous niez tout, et alors votre adversaire a l'air d'avoir raison, car votre négation ne peut rien prouver par elle-même. Ne compte alors que ce que l'on appelle la force d'âme, c'est à dire la force de votre filet de sécurité théorique et moral.
Pour la douleur physique, il en va tout autrement, et il n'est pas difficile de comprendre que pour supporter la torture, il vaut mieux avoir une grande force de caractère et d'âme qu'une bonne santé. En effet, la «mise en scène» de l'existence, c'est à dire ce qui motive l'aller à la mort, est plus important que le fait de mourir, or la douleur n'est que l'annonce de la mort s'amplifiant dans la torture. Si donc la conviction est plus forte que tous les arguments qu'on vous oppose, il est plus doux de se faire arracher les ongles que de la trahir.
Je passe du coq à l'âne, mais sans doute pas tellement : le marquis de Sade. Comme je travaille (quel grand mot) sur le thème de la vertu, je suis allé voir du côté de Sade, dont à vrai dire, je n'ai jamais réussi à lire les longs pensa que l'on lit, paraît-il, d'une seule main...
Je n'y arrive toujours pas. Refoulé encore à mon âge ? J'ai quand-même essayé ces jours-ci, car les textes sont disponibles gratuitement sur Internet. Et je dois dire que c'est bien pénible, aussi pénible pour moi que de lire des romans à l'eau de rose. La thèse est si simpliste : «(le crime) n'a-t-il pas sans cesse un caractère de candeur et de sublimité qui l'emporte et l'emportera toujours sur les attraits monotones et effeminés de la vertu ?»(les 120 jours de Sodome) . Le crime candide et sublime ! La vertu «monotone et effeminée». C'est intéressant d'un point de vue historico-sociologique, au sens où le virilisme, l'idéologie proprement patriarcale, se dénonce ainsi elle-même au détour d'une réflexion qui se veut philosophique. Quand au caractère de candeur, c'est plutôt celui de la candeur continuellement et absolument défigurée, écrasée, mise en charpie. Sade insinue sans doute que le mal est plus originaire que le bien dans l'âme, et que la candeur (blancheur) est cette originarité. Peut-être, peut-être a-t-il raison quand à l'antécédence de la volonté de nuire, mais cela ne prouve encore rien du tout quand à la pertinence d'y demeurer et d'y consacrer son existence. Si l'on remplace le mot «méchanceté» par l'idée de prédation systématique, on ne fait que consacrer ce que nous entendons par animalité (sans que les animaux n'y soient d'ailleurs pour rien). Or quel est l'intérêt de la prédation continue ? Cette idée fait assez de ravage dans ce qu'on appelle l'ultra-libéralisme qui se condense finalement dans des idéologies comme le nazisme : le struggle for life ! Quel pauvreté morale, et surtout quel manque d'imagination ! Je ne comprends toujours pas pourquoi mon professeur de philosophie de terminale nous a dit un jour : - «vous savez, Sade c'est très fort» - Sade revu et corrigé par Kierkegaard, Nietzsche et Bataille, sorte de nostalgie du vice comme, je cite encore Sade «cette vibration morale et physique, source des plus délicieuses voluptés». Source des plus délicieuses voluptés ? Sans doute la masturbation est-elle une délicieuse volupté, mais pourquoi et comment assimiler la déchéance physique elle-même à la volupté ? Les personnages de Sade campent toujours des situations de même tabac : soit il s'agit de personnages physiquement sains et beaux qui tirent le plus de jouissance de ce qui est vieux sale et décomposé, soit de vieillards eux-mêmes décomposés qui abreuvent leur dépravation à la source de la jeunesse et de l'innocence.
En réalité, le sadisme s'avère très proche du monachisme, du sado-masochisme religieux qui prône l'anéantissement du soi devant l'ineffable divin. Le double-bind que Sade met en scène partout, me paraît plutôt s'avérer comme le déni de la volupté en tant que telle, c'est à dire qu'il n'y a jamais d'orgasme en tant qu'événement, en tant qu'histoire de l'individu, mais seulement un jeu avec l'impuissance ou la surpuissance qui sont le même car ne se connaissent pas en tant que «dynamis», en tant que puissance susceptible de passer dans l'acte.
Revenons sur le caractère «monotone» de la vertu. Il y a là une anticipation de tout ce que reprennent les philosophes dont j'ai parlé plus haut, et aussi quelques personnages comme Debord et Vaneighem, qui n'arrivent pas, finalement, à se détacher de ce raisonnement pourri. Quel est-il, ce raisonnement ? Le vice est créatif, il refuse de s'installer dans le répétitif. Je me souviens que le répétitif était une sorte de thème constant chez les situationnistes, c'était même le sujet des «examens» que Debord faisait passer aux candidats à l'IS. Le vice possède l'antidote au répétitif, car il contient, paraît-il, une force exponentielle qui produit sans cesse des situations nouvelles (je n'accuse pas Debord d'avoir tenu ce raisonnement, mais de n'avoir pas su s'en démarquer suffisemment, ce qui a alimenté chez lui ce qu'on a appelé son stalinisme dévoreur de situationnistes). La seule logique discernable là-dedans, c'est que le vice doit sans cesse détruire pour survivre dans ses turpitudes, il «explore» la volupté dans toutes ses possibilités, quel que soit le prix de cette exploration. Soit, mais qui dit que la volupté obtenue dans une pratique vertueuse soit moins forte ? Les religions, pas toutes d'ailleurs, ont bien tenté de débouter la volupté elle-même, de lui attribuer un statut définitif de «vice» et de «crime». Mais nous n'avons pas (plus) besoin de Sade pour renvoyer dans leurs foyers ces sottises à usages idéologiques et donc politiques.
De plus, ce qui prouve que c'est l'impuissance sexuelle et la terreur qu'elle suscite qui ordonne la logique du sadisme, c'est cette ignorance de la véritable teneur de la vie sexuelle elle-même. C'est à dire que contrairement aux affirmations de Sade et de quelques autres, la volupté n'est ni stable ni répétitive dans le cours d'une existence, mais elle varie constamment, et si l'aventure est bien conduite, dans le sens positif. La vertu n'a pas pour conséquence de brider la force de la volupté, mais au contraire de la renforcer, simplement parce que la vie psychique possède elle-même une puissance démultiplicatrice bien supérieure à tout ce que peut offrir le physique. Foucault a, me semble-t-il, assez bien compris la dynamis sexuelle qu'il y avait dans la vertu. Toujours ce mirage du phusique, de ce qui se meut par soi-même et qui possèderait, se faisant, une spontanéité et une originarité parfaite ! Mais le psychique est, en tant que physis, bien plus puissant que ce qui procède de la hylè, ou plutôt le moment hylétique n'est qu'une étape du mouvement de possession de la puissance totale. Celle-ci se trouve précisément dans la mort elle-même comme accession ultime à la puissance globale du phusique. Rien ne peut donc, en principe, arrêter la progression de la force de la jouissance au cours de la vie, sauf le vice ! Car le vice détruit le vecteur physique lui-même. Sade ne se ment-il pas à lui-même lorsqu'il prétend faire dépendre l'orgasme de la douleur et de la mort d'autrui ? Ce faisant, ne prétend-il, pas lui-même attribuer une dimension psychique à la volupté ? Car si la mort d'autrui provoque une jouissance, elle ne peut être que psychique. Bien sûr, on va me piéger avec cela même que j'écris à propos de la mort, mais le paradoxe est que la seule volupté que l'on peut tirer de la mort, on ne peut la tirer que de sa propre mort et non pas de celle d'autrui, qui n'est jamais que le théâtre de la sienne, la mise en scène de la négation de sa propre mort. Distraction pascalienne, rien d'autre.
En tout état de cause, il est absolument faux d'affirmer l'infirmité structurelle de la vertu, au sens d'une vertu simplement déterminé par l'impératif catégorique, on ne parle pas des phantasmes de vertus religieuses elles-mêmes pathologiques.
Si j'avais le temps - et peut-être l'aurai-je un jour ? - je ferai comme Sade, une histoire de la jouissance sexuelle ( ce qui est insupportable dans Sade, c'est son côté méthodique et prétendûment scientifique, on se dirait parfois dans un soviet de Saint-Anne), une histoire «vertueuse» de la possibilité d'une progression infinie de la volupté jusqu'à la mort comme orgasme final. Je pense que cela devrait intéresser pas mal de monde, non ?
En me relisant, je me rends bien compte que tout ce que je dis paraît bien faible en regard de ce qui se dit et se lit sur l'histoire humaine. Il suffit de songer un instant aux pratiques guerrières décrites à longueur de pages et de discours, au «sadisme» spontané des situations de guerre (Kosovo) etc..
Certes, mais il y a là aussi la possibilité d'insinuer de grands soupçons, c'est par exemple que la fascination qu'exercent les tabous, alimentent les récits eux-mêmes, indifférents à la vérité ou à la fausseté de la relation, et qu'il aura toujours fallu se servir des chroniques pour terrifier, pour dissuader à l'instar des bombes atomiques. Qu'y-a-t-il de vrai dans les récits qui font état d'une cruauté quasi dominante dans l'Histoire ? Je n'ai pas pour habitude d'hypostasier le présent, mais à la lumière de ce présent, je constate plutôt que le vice et le mal restent très largement des phénomènes marginaux. Hobbes a donné une version des choses, Rousseau une autre. Je préfère cette dernière, elle parle plus directement à mon âme.
Dimanche, le 18 Avril 1999
Une date anonyme : terrifiant ! On entre dans du temps brut, sans qualités, déjà plus pascal, pas encore natif, ni même estival ou hivernal. De l'avril tout court, quelle horreur ! Et c'est là un gros enjeu. Voilà un sentiment, certes poétique mais il n'y a que celui-là qui compte, qui témoigne d'une certaine désagrégation du temps historique vécu. Le discours qui soutient la vie se défait, il manque des liaisons pour passer d'une date à l'autre. Cela me rappelle ce que j'avais remarqué à propos des Juifs et de leur Alaha, la Loi ou les 613 lois qui régissent leur temps : rien de plus séduisant que ce mode d'emploi de l'existence qui prescrit chaque étape de l'existence, cela constitue une sorte de filet de sauvetage permanent. Et, si l'on y réfléchit bien, l'herméneutique du Texte vient renforcer les endroits où le tissu légal pourrait se défaire. Cette herméneutique n'est rien d'autre qu'interprétation juridique du déroulement des actions humaines selon le canon des Lois fondamentales : mais c'est aussi un discours qui vient renforcer le discours là où il peut ne plus fonctionner, c'est à dire remplir son rôle de passeur : on fait, au fond, semblant de se retrouver devant des problèmes réels, mais qui le sont sur un tout autre plan que celui sur lequel on fait mine de le régler.
Donc, ce qu'il y a de génial dans les religions, ou disons ce qu'il peut y avoir de plus ou moins génial, c'est certes l'envergure du récit global, mais aussi et bien plus me semble-t-il, le détail des temps interstitiels : il est sans doute plus important de décrire avec précision combien de tours le phylactère doit faire autour du bras, que de rappeler les grandes lignes du rite de Pessah. Autrement dit, comment remplir le temps, comment le ritualiser de telle manière qu'il coagule pour donner de la vie, ou de l'existence, du dasein. L'expression de Heidegger, le dasein, contient une seule faiblesse, c'est qu'elle n'est pertinente que lorsque le Sein est da, c'est à dire lorsqu'il vraiment question pour une conscience de son exposition à l'ouverture, ou au vide. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vérité ne se laisse pas dire, puisque seul le hiatus du néant place la conscience devant son être. Aucun mot, et encore moins un concept, ne peut franchir ce vide, encore moins un concept car il y a du temps dans le concept, il implique, à l'instar du rite, la saisie et le maintien de la notion. Comment contourner cette difficulté ? C'est difficile, car il faudrait abandonner réellement la prétention à la subjectivité du dasein. Je dis réellement, car on laisse croire un peu facilement que la critique philosophique-historique de la subjectité métaphysique place de facto le philosophe en-dehors du domaine subjectif. C'est le problème de la place réelle du philosophe entre la Parole «divine» et le discours, entre la révélation muette et privée et la rhétorique publique.
Samedi, le 24 Avril 1999
LUMINEUX : je crois me rapprocher d'une compréhension palpable de ces fameux livres 1-2-3 de la Métaphysique TO d'Aristote, relus et (traductions) corrigées par Heidegger.
Voilà de quoi il retourne : dynamis=force ou puissance, energeia= acte ou réalité. Heidegger affirme de manière abrupte qu'Aristote ne fait pas ici de la physique au sens de l'étude de l'énergie, du mouvement etc.. mais qu'il s'agit bel et bien d'une vision ontologique décisive. Bon. Le coeur de la démonstration réside, me semble-t-il, dans le fameux exemple que donne Aristote du triangle rectangle. Pour illustrer ce qu'est la puissance, il passe par l'impuissance, et dit que la diagonale du carré «n'a pas la puissance du nombre», autrement dit et comme le traduit Heidegger : «la diagonale du carré est impuissante à avoir la même mesure que celle du côté».
Ce qui est rigolo là-dedans, c'est que l'exemple semble particulièrement mal choisi : pourquoi, en effet, prendre un exemple dans le domaine de l'abstraction la plus pure, celle de la géométrie ? Aristote aurait peut-être dû se contenter de l'exemple suivant, celui de l'homme debout, mais qui pourrait être aussi bien assis, qui a la puissance de s'asseoir; ce serait là quelque chose de tangible dans la problématique sensible du mouvement, de la force ou de la puissance. Non, il prend le carré et attribue ainsi à une demi droite nommée diagonale, les mêmes qualités qu'à un animal ou une chose quelconque. Pourquoi cette espèce d'animisme absurde ? Pourquoi attribuer une puissance à une abstraction ? D'abord, sans doute, parce que le nombre est considérée comme realitas realitatis à l'époque d'Aristote, or, si sa spéculation est réellement ontologique comme le laisse entendre le titre choisi de Métaphysique, et comme l'affirme hautement Heidegger, alors il est évident qu'on ne peut pas mieux choisir la figure du carré pour parler de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. La racine carré de la diagonale est, par ailleurs justement, ce qu'on appelle un nombre irrationnel, c'est à dire au sens de Hegel «qui n'existe pas, qui n'est pas réel». Comment mieux illustrer alors l'impuissance, c'est à dire l'irrationnel, c'est à dire le «ce qui n'existe pas» qu'en parlant de ce débat entre le côté du carré et sa diagonale, rebelle à toute commensuration. Heidegger traite d'ailleurs tout ça avec beaucoup d'humour, semble-t-il, car il va jusqu'à parler d'une diagonale qui «échoue à supporter la mensurabilité par le côté du carré». et il ajoute «C'est pourquoi elle refuse à l'énoncé sur elle l'attribution de la mensurabilité». Et là nous sommes au coeur du problème, celui de l'énoncé : le réel aristotélicien, l'être, est dans l'énoncé, et seulement là. Nous sommes déjà, chez le prétendu empiriste Aristote, dans le pur transcendental. Et Heidegger, du coup, peut fort bien parler du carré et de sa diagonale comme de purs objets parfaitement présents là, devant-nous, devant notre propre force d'énonciation. La petite chose qu'il fallait bien comprendre, et je dois cette illumination à un exposé de mes amis sur le nombre, c'est toute la dimension de concrétude que revêt le nombre chez les Grecs : plus tangible tu meurs.
Samedi, le Premier Mai 1999
Bel exposé sur la destinée humaine hier soir, sans niaiserie et sans pathos, juste ce qu'il faut de réalisme cynique et de sens de l'action fraternelle. Je me casse la tête sur le thème de la vertu, en découvrant peu à peu que, contrairement aux opinions reçues, la vertu est bel et bien l' «objet du désir», le vice n'en étant que l'apparence. Pensée difficile pour un néophyte du lacanisme comme moi, mais je me demande ce qui se serait passé si Nietzsche l'avait tentée au lieu de passer simplement la gomme sur le «discours» moral. En réalité, l'obstacle c'est toujours l'eschatologie au sens des onto-théologies. En relisant Berkley, on peut se rendre compte à quel point on est passé juste à un doigt de la vérité, comme avec Spinoza. Phénomène extraordinaire, car en Iran, au même moment, c'est à dire les 17 - 18 èmes siècles, on a Molla Sadra Shirazi, cet espèce d'existentialiste avant la lettre, peut-être encore beaucoup plus explicite que Spinoza ou Berkley. Je pense que ces trois individus ont réalisé ce que l'on peut entendre par vertu, c'est à dire queque chose comme le bonheur sur terre - ce qui me rappelle aussi Nicolas de Cues, autre «cabaliste» de la joie de vivre.
La question est évidemment de savoir pourquoi ces grandes écritures ne marchent pas, pourquoi la praxis n'embraye pas là-dessus, et pourquoi il faut la douleur hégélienne pour installer de la Wirklichkeit. Curieuse, la Wirklichkeit, car la traduction habituelle par réalité me paraît l'un de ces raccourcis qui conduisent aux contresens. Dans ce concept, c'est le wirken qui domine, est réel ce qui est effectif, c'est à dire ce qui produit des effets. Pour un esprit français, et aussi grec, la réalité ne se limite pas à ce qui agit, à ce qui est effectif, mais comprend tout le reste. On dirait que les Allemands ont retranché une fois pour toute la dimension contemplative de l'être, c'est à dire immanente, au moins jusqu'à Husserl, et même Heidegger est parti sur les chapeaux de roue du wirken, avant de changer de cap. C'est Aristote, bien sûr, qui se dissimule derrière cette réalité-action, energeia. Son opposition aux Mégariques est peut-être le moment du passage d'une ontologie à l'autre, ce que laisse entendre Heidegger, mais à un moment de son parcours où il est lui-même encore submergé par la toute-puissance du facticiel. Le poétique appartient à autre chose qu'au wirken, qu'on le veuille ou non. La vision de Berkley, la substance de Spinoza et les pénétrations métaphysiques de Shirazi aussi.
La vertu serait donc pure intelligence. La vertu, pas la science ou la méthode. Mais qu'est l'intelligence ? Là aussi il faut balayer, intelligence = vision/substance/pénétration/accès à la quiddité, pas adéquation ou même pas seulement alethéia. Il faut voir le côté sexuel de l'intelligence. Le poème de Hölderlin dans le sac du soldat, c'est très exactement ça.
Dimanche, le 2 mai 1999
Remarque sur ce qui précède : le bonheur est comme la vérité, il ne s'écrit pas, il est allergique aux mots. Comment alors en parler ?
Berkley : très curieux comme l'un des plus intégristes de l'immatérialisme se prononce avec des paroles d'une très grande tolérance, et, ce qui va avec, une extrême clarté. Comme je l'ai déjà remarqué, Berkley est quasi indestructible. Il suffit de bien saisir que c'est un concept de la scholastique - c'est à dire des péripatéticiens revus et corrigés par les Pères de l'Eglise - qu'il remet en question, et non la réalité en tant que telle. Une fois qu'on a compris que l'idée de matière ne peut pas en être une, et comment le nier ? on s'est rapproché d'un grand pas d'une résolution de cette fausse opposition esprit/matière, qui traîne dans un paquet d'autres oppositions comme corps/âme, nature/culture, inné/acquis etc... La théorie de la vision de Berkley est sans doute la clef de la compréhension de l'essence de ce que Heidegger appelle l'onto-théologie : à partir de cette théorie de Dieu, on mesure combien toutes les métaphysiques dépendent absolument d' une construction théocosmique et théophanique, Hegel compris, et même en première ligne. Il devient même très difficile d'admettre qu'il puisse exister un autre discours philosophique.
Jeudi, le 13 Mai 1999
C'est dans de tels moments que je reprends contact avec le sens de cette écriture, dans ces moments où je viens de me casser la tête sur des textes abscons, par exemple la dernière partie de l'Encyclopédie de Hegel, des moments où je redoute davantage de me retrouver coincé dans une adhésion redevenue aveugle à force d'éblouissante clarté (ça me rappelle ma préface à mon travail de Maîtrise dans lequel je parle des aîles d'Icare dont la cire fond au contact de la chaleur des rayons du soleil, savoir absolu qui confine à la mort aveugle) que de comprendre réellement la pensée de l'auteur. Car alors, c'est à dire ici, je peux écrire en toute liberté, réfléchir en alignant les mots, en les laissant s'aligner sans même que j'intervienne énormément, selon cette mystérieuse symphonie qui se déroule dans et à partir des mots. Alors qu'en lisant, en pratiquant cet exercice proprement masochiste, je me sens torturé entre une accumulation de vérités linguistiques et conceptuelles, et leur refus, qui est mon refus. Je ne peux pas penser l'ordre.
Oui, je dois parler depuis longtemps de la vertu, et j'en ai déjà pas mal parlé, mais plus je progresse dans la réflexion et l'étude, plus je me noie, ou plutôt je suis entraîné dans des profondeurs inattendues de la réflexion. Et pourtant ce sujet paraît simple : qu'est-ce-que la vertu, à quoi sert-elle, est-elle le secret de la vie ensemble, de l'Etat, du bonheur, de la République, donc de la démocratie ? Plus simplement, la vertu me fait-elle perdre quelque chose en échange d'autre chose ? La vertu est-elle un miroir aux alouettes, comme le laisse entendre quelqu'un comme Sade ? Ou bien, comme le dit Spinoza, est-elle la même chose que la Raison, et donc la seule manière d'entrer dans la pensée de Dieu, c'est à dire selon la pensée de ce panthéiste, dans l'effectuation de l'Etre lui-même ? Ou encore d'autres questions : la vertu est-elle historique, c'est à dire est-elle le fruit d'une «accumulation primitive» ou est-elle compréhension synchronique de Dieu dans toute histoire, dans n'importe quel temps de cette histoire ? Faut-il «parier» sur la vertu contre les vices ou faut-il, plus subtilement ou plus hypocritement ignorer les vertus en tant que telles pour ne voir dans la réalité que l'effectuation de l'Esprit à travers la négativité du négatif, c'est à dire tout aussi bien à travers les pires passions ? Je nage, donc je suis.
Et en tant qu'être, je sais aussi beaucoup de choses sur toutes ces questions. Reprenons.
Qu'est-ce-que la vertu ? En un terme actuel, qui sert à toutes les sauces mais en dissimulant à chaque fois son véritable sens, je dirais qu'être vertueux c'est être «sympa». Ce mot condense aujourd'hui, dans la pauvreté passagère des concepts ou dans les mues linguistiques qui semblent s'accélérer, à la fois le sens de gentil, c'est à dire généreux et ouvert, et à la fois celui d'honnête, respectueux, digne, juste et loyal. Il est sympa résume une pensée certes monolithique mais expressive à propos d'une personne globalement évaluée dans un sens positif. Dirait-on sympa d'une personne affectée d'un vice quelconque ? Oui si ce vice est strictement ipséique, c'est à dire s'il ne concerne que lui-même. Et il faut ici se poser la question du concept ou du mot vice : que recouvre-t-il dans son existence diachronique, est-il une idée simple ou une idée composée, intuition universelle ou élaboration particulière propre à telle ou telle idéologie, théologie, théorie etc.. Exemple, il fume, mais il est sympa car il n'impose pas aux autres le désagrément de sa fumée. Autre exemple, il pratique l'onanisme, mais n'impose à personne de partager ces moments de plaisir solitaire, à tel point qu'on n'en sait même rien (sauf la religion, qui elle sait toujours tout, et à ce titre s'immisce dans toutes les intimités sans respect aucun, terrorisme de base). Il est avare ? Mais il peut quand-même rester sympa, car ce vice ne fait pas forcément de tort aux autres. Il est orgueilleux ? Pareil, car orgueil n'est pas vanité, et ne comporte donc pas le mensonge, il ne comporte rien qui le mette en relation effective et négative avec autrui. On pourrait continuer longtemps comme cela, et reprendre toute la nomenclature d'Aristote des vertus et des vices. Mais je ne pense pas comme lui que la vertu est dans la «médiété», c'est à dire dans le comportement moyen, à égale distance des excès.
Je pense au contraire qu'il y a des vertus définissables en tant que telles, parce qu'elles représentent des comportements généraux identifiables : ainsi on peut dire à la manière de Kant, que tout comportement qui ne nuit pas à autrui ou qui ne prend pas autrui comme moyen mais toujours comme fin, qu'un tel comportement est absolument vertueux. Il faut admettre qu'il n'y a pas de comportement neutre ou indifférent : il y a des vertus et il y a des vices. Je préférerais, pour ma part, dire qu'il y a des comportements vertueux et des comportements vicieux, c'est à dire le contraire de ce que nous décrivons plus haut : à chaque fois qu'un comportement personnel entraîne par force ou par ruse un empiétement sur une autre personne, il y a vice. Tant que le comportement individuel reste dans les limites de la relation avec soi-même, toutes les formes d'action ou de non-action sont permises et peuvent donner lieu au titre de vertueuses. Bien entendu, dans une telle acception, nous sortons définitivement du sens d'un devoir abstrait ou d'une sujétion à une transcendance dont le désir s'objectiverait comme alter-ego, c'est à dire viendrait ruiner la solitude du sujet.
Le but ou la finalité d'une attitude en ce sens vertueuse s'impose d'elle-même, cette vertu sert avant tout, et se définit donc à partir du vivre-ensemble des êtres humains, un vivre-ensemble qui ne semble pas, comme chez les animaux, défini a priori comme un simple s'entre-tuer ensemble dans une rationnalité de prédation mystérieusement équilibrée pour des raisons à vrai-dire pas très claires, sinon celles de la «conservation des espèces» et autres fariboles, qui me paraissent procéder avant tout d'un anthropomorphisme qui s'ignore. Sur le sujet des animaux, j'ai pour religion de me taire.
Etre vertueux, ce n'est donc pas afficher quelques capacités ou facultés ou encore preuves de renoncement figurants comme des sortes de règles de compétition humaine, mais bien tout faire pour assurer la possibilité de vivre ensemble. Voilà pourquoi la République a besoin de vertus, parce que la République est la seule forme de vivre-ensemble qui ne prenne en compte que le vivre-ensemble, et non pas le bonheur particulier d'un souverain ou d'une classe de souverains. La République est en réalité le secret de la vertu, la vertu n'est pas celui de la République. C'est aussi la raison pour laquelle Robespierre a raison contre Danton, car ce dernier ne s'est pas contenté de laisser se déchaîner ses passions dans le secret et avec les moyens qui étaient propres, (propriété), mais il a trahi le vivre-ensemble de la République pour assouvir ses passions, il avait besoin de l'argent de l'ennemi pour assurer son train-de-vie de débauché. Il est à supposer sans guère de doute, que Danton n'était pas un être «sympa» pour quiconque ne partageait pas, ni sa fortune ni ses goûts. Son exemple est cependant intéressant car on se demande où Danton a cherché son élan personnel pour la Révolution, comment un comportement qui ressemble plutôt à celui des nobles libertins et cyniques va de pair avec son inspiration démocratique ? A chercher sans doute dans la faiblesse soudaine, il aura craqué parce qu'il avait de tout temps accumulé des passions basses et anti-démocratiques : il n'a pas voulu parier jusqu'au bout sur la vertu, car il ne croyait pas qu'il était possible de vivre avec les autres hors du crime permanent si l'on voulait satisfaire quelques-uns de ses besoins pour lesquelles des classes de brigands se sont formées en société au cours de certaines périodes de notre histoire. Disons qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son pari, de ce qui avait été le pari de tous les Révolutionnaires dès 1789, celui de la vertu dont il est question ici et non pas dans les livres de catéchisme.
Le pari : oui la vertu est un pari, un jeu de l'homme parmi les hommes, un investissement risqué parce que, comme le disait un ami récemment, la démocratie n'est nulle part dans les faits, alors que la tyrannie l'est immédiatement et partout. La démocratie est invisible parce qu'elle n'est pas une forme de l'exécution d'un plan divin ou d'une pensée royale, elle est le fond de la relation entre les hommes, elle en est l'essence : la relation entre les hommes est ou n'est pas; si elle est, elle est démocratie, si elle n'est pas elle est autre chose. Lorsque l'état dans lequel on se trouve se définit donc comme démocratie, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'au fait de pouvoir être librement parmi les autres.
Alors, est-ce-que la vertu me fait perdre quelque chose en échange d'elle-même ? Est-ce-qu'elle représente un sacrifice ? Redoutable question, car en elle se profilent plusieurs acceptions, toutes les acceptions du mot vertu. Mais nous avons déjà fait le tri, nous savons que le seul obstacle
Samedi, le 15 Mai 1999
à ce qu'un comportement ne puisse entrer dans les «vertus», est son empiètement sur autrui. On est loin d'Aristote, avec ses vertus innées ou acquises par manque d'exercice (puisque certains vices - comme certaines vertus - seraient des habitudes). Je préfère de loin prendre le mot vertu dans son acception physique : la vertu d'un médicament est de guérir. Donc est vertu tout comportement effectif : tout comportement effectif a pour but l'être de celui qui se comporte, par conséquent il ne peut être que bon s'il s'en tient à cela. Au contraire, dès que ce comportement, ou disons sa pratique, empiète sur le domaine de la pratique et de la volonté d'être d'autrui, on est dans le vice. A tel point que si le vice peut parfois séduire, c'est parce qu'il peut passer pour altruiste, au sens où dans certaines situations de déréliction, l'empiètement peut passer pour un acte de charité.
Réponse à la question du sacrifice : aussi curieuse que paraisse ma réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'exploitation d'autrui ou son utilisation comme moyen est un bien, de quelque manière qu'on puisse entendre l'idée de bien, profit, jouissance, plaisir etc.. Exemple : la femme de ménage me lave mes slips. Est-ce un bien pour moi ? A priori oui, puisqu'elle m'épargne une corvée, et que je la paye en échange de ce service. Mais une question se pose immédiatement : le prix que je la paye peut-il équivaloir d'une manière ou d'une autre le geste auquel est contrainte cette femme, c'est à dire le contact avec les déchets de mon intimité, un soin direct de ma personne dont la sous-traitance, pour ainsi dire, blesse nécessairement la dignité d'autrui, mais me blesse aussi moi-même dans la mesure où elle dévoile cet intimité, l'expose à une conscience qui elle-même possède son intimité dont l'essence est justement de n'être pas exposée à celle d'autrui. Si donc le fait qu'on fasse mes corvées paraît me faire gagner quelque chose, le temps par exemple, il me fait aussi perdre une partie de mon intimité et celle de quelqu'un d'autre.
On atteint ainsi une définition de l'exploitation (de l'homme par l'homme) à laquelle on n'est sans doute pas habitué : exploiter quelqu'un c'est empiéter sur son temps en vue de tirer profit de cet empiètement. Mais c'est aussi placer cette personne dans une situation de conscience où elle est en contact direct avec cet autre intimité qu'est la volonté de tirer profit du travail d'autrui : il y a là une sorte de complicité obligée, l'exploité doit admettre en permanence qu'il accepte de travailler, non pas pour le bien de la société ou pour son seul bien propre, mais bien pour le désir de profit, l'esprit de lucre d'une autre personne. Les capitalistes protestants me font bien sourire lorsqu'ils se justifient de pratiquer l'exploitation en invoquant la nécessité de transformer la nature pour la plus grande gloire du royaume de dieu. En vérité ils méprisent les travailleurs autant que les féodaux méprisaient les cerfs et les travaux des champs. Encore une fois : ce qui distingue absolument les citoyens romains des brigands du Moyen-Âge, c'est bien qu'à Rome, du moins la Rome archaïque, fondatrice de civilisation, le travail de la terre était honorable en tant que tel et même obligatoire pour recevoir la dignitas de citoyen. Au Moyen-Âge les choses sont tout à fait différentes : le travail de la main est devenu entièrement une action servile.
La dialectique du maître et de l'esclave de Hegel pêche par une sorte de trou logique : elle montre bien comment l'esclave finit par s'approprier l'en-soi de l'objet lui-même en travaillant au service du maître dont l'activité se limite à la négativité absolue, c'est à dire à la consommation de l'objet, à son anéantissement. Mais on ne comprend pas bien pourquoi l'esclave peut réellement devenir un maître, autrement qu'en mimant sa situation dans le monde objectal : obtenir le pouvoir du maître ne me paraît pas encore suffisant pour que l'on puisse dire qu'on est devenu le maître. Le maître ne s'est pas défini sur la base d'une accumulation de travail au service d'autrui, il s'est défini comme maître dans l'action de mépriser la vie. Mais la vie en tant qu'existence, en tant que possession du temps ou acteur de la temporalité, je ne sais pas comment dire, en tant que présence.. Il ne suffit donc pas simplement de dire que l'esclave a lui aussi méprisé la vie en reportant sa jouissance immédiate pour pouvoir affirmer qu'il devient ainsi un maître. Cette dialectique est, en réalité, une dialectique déjà bourgeoise, c'est à dire que le maître hégélien est déjà un esclave qui s'est affranchi de la même manière, c'est à dire par le travail. Reste que cette dialectique a le mérite de montrer qu'il y va, pour les deux partis, d'une opération de la conscience : le maître empiète sur la totalité du temps de l'esclave, c'est le moment du combat mortel, mais ce combat se poursuit sans arrêt jusqu'au retournement de situation (c'est à dire la Révolution, en réalité, et ici on pourrait profiler toute une critique de la notion de moment dans le système hégélien, car la servitude est bien loin d'être un moment, c'est même le contraire, c'est une véritable infinitude confrontée à la présence du présent. De considérer de tels moments dans l'infini de l'Histoire de l'Esprit ne change pas grand chose en termes subjectifs; sous ce jour on peut comprendre la détestation qu'un Kierkegaard ou un Schopenhauer pouvait entretenir à l'égard de ce fatalisme, fanatisme (?) de l'objectif de Hegel), retournement qui contraint bel et bien l'esclave à risquer lui aussi sa vie pour prendre la place du maître. D'ailleurs, lorsqu'on est réaliste, on reconnaît que le combat et son issue sont déterminés déjà et bien plus rigoureusement par l'objet et par sa nature que par le courage ou autres vertus fantasmés par les onto-théologiens. Ce qui veut dire que la technique militaire et ses arsenaux déterminent bien plus de choses dans un combat que les attitudes psychiques des combattants. Il suffit de lire l'histoire des quelques grandes batailles dont on possède la description. On pourra toujours citer les exemples idéologiques du type David et Goliath, mais cela ne suffira pas à supprimer la profonde inégalité objective qui opposait par exemple les légionnaires romains aux Germains ou au Gaulois, simplement parce que l'armement et la tactique des Romains étaient infiniment supérieurs à tout ce qui existait à l'époque. Comme aujourd'hui, l'armement de l'Otan et sa puissance objective ne laisse guère de chance à qui que ce soit dans le monde, sinon celle de se suicider.
Que gagne-t-on donc à la vertu ?
Dimanche, le 16 Mai 1999
Pour quel but faudrait-il parier sur la vertu plutôt que sur des vices dont le rendement paraît immédiat, je dis paraît parce que l'idée même de rendement d'un vice me semble antinomique tant la satisfaction d'un vice ressemble toujours au paiement d'une dette. Faut-il ici poser la question qui a longtemps divisé les philosophes : l'homme vertueux peut-il viser le bonheur, ou bien le bonheur n'a-t-il rien à voir avec les vertus ? J'ai envie de répondre rageusement que le bonheur est un but universel et que la méconnaissance ou le refus de cette proposition constitue très exactement la ligne de partage de la pensée morale et politique qui séparent deux mondes depuis toujours opposés. Il est donc évident que tout comportement, spontané ou choisi, inné ou acquis par l'exercice ou l'habitude volontaire, - j'ajouterais même le vice, voire Sade - vise au bonheur. Il faut donc renverser la logique de la question et demander si c'est le vice ou la vertu qui peut apporter ce que tout le monde recherche de toute manière et quoi qu'il fasse : même celui qui cherche son malheur, le cherche pour son bonheur.
Réponse : il n'y a pas à parier sur la vertu. La vertu n'est pas une monnaie ou une marchandise, elle s'impose dans le comportement social et personnel comme la logique s'impose dans le langage ou dans la pensée. En réalité, la vie morale est une lutte consciente et inconsciente pour atteindre la pratique libre des règles naturelles de la vertu. De même que la vie est avant tout action libératrice, activité en vue de la liberté, de même et en même temps elle est recherche de la vertu en tant que la vertu est seule garante de la liberté de l'individu dans le monde. Il n'y a pas de liberté sans vertu, pas de vertu sans liberté. Autrement dit, aucune vertu ne peut dicter quoi que ce soit de contraire à la liberté, et aucune véritable liberté ne peut être contraire à la vertu, et enfin le contraire de la vertu est forcément contraire à la liberté ou le contraire de la liberté. Certains philosophes affirment cette équation : liberté = vérité, je pense que l'on peut tout aussi bien écrire : liberté = vertu. Et on peut commenter un autre aspect de la dialectique du maître et de l'esclave : dans le combat, celui qui est appelé à devenir le maître, méprise la survie (car rien n'indique qu'il s'agisse du mépris de la vie elle-même, au contraire). Mais un tel mépris est manifestation de liberté - ce que Hegel ne conteste pas - et en tant que tel vertu : l'issue dialectique se montre ici plutôt comme un détournement vicieux, amoral de la pratique de la vertu. Si l'esclave était «beau joueur» et vertueux, il ne songerait même pas à reprendre son pouvoir au maître autrement qu'en remettant en jeu sa propre existence, comme l'avait fait autrefois le maître et comme, semble-t-il cela se passe réellement dans l'histoire des hommes. Le salut dialectique est une facilité historique très justement contestée par Marx, une sorte de pacifisme idéologique simplement destiné à installer la classe bourgeoise du temps de Hegel dans le vrai de la Raison historique. Hegel n'a pas encore accès à la notion de prolétariat, trop vite confondue avec celle du servus laborans. Or le prolétariat ne prend pas la place laissée vacante par l'esclave dans l'histoire, mais bien celle du citoyen républicain : le bourgeois n'est qu'une mouture nouvelle du féodal ou du despote correspondant au prolétaire, ou s'opposant à lui. Dans le communisme, la vertu est pour la première fois identifiée comme liberté dans la mesure où l'égalité pratique, économique, est conçue comme espace de liberté où il est pratiquement impossible d'ériger un système du vice, c'est à dire un système dont l'essence réside dans la négation ou l'anéantissement d'autrui. Car, enfin, ce que le vrai maître nie, ce n'est pas l'objet, c'est bien le sujet nommé esclave : c'est de la négation de la personne humaine de l'esclave que le maître tire sa jouissance et son plaisir, et non pas de celle des objets que lui fabrique l'esclave. Encore une fois le piège petit-bourgeois dans lequel se débat Hegel est bien celui de ne pas vouloir tirer toutes les conséquences de sa théorie de la passion : Hegel reconnaît lucidement que la passion est le moteur principal de l'histoire, mais dans les descriptions concrètes de cette histoire il tourne autour du pot en s'aidant des «objets», objets qui n'existent pas, ou qui n'existent que dans la mythologie nouménale de Kant et de l'idéalisme allemand. Et là, le marquis de Sade est quand-même la bienvenue, qui ne cache pas, lui, l'essence de la passion. Celle-ci ne réside pas dans l'appropriation des objets ou de leur jouissance, mais dans l'appropriation d'autrui et de la jouissance que l'on peut tirer de lui, avec ou malgré lui. La mort de Jésus-Christ en tant que mort est la seule vraie passion. Seule la publicité peut faire rimer passion et objet.
Vendredi, le 21 Mai 1999
Mémoire vive et disque dur : tout tourne autour de la mémoire. L'intelligence et la pensée ne sont que mémoire, dit la tradition. Or, que c'est-il passé à propos de la mémoire depuis deux siècles ? Elle s'est totalement transformée, cela on ne peut le nier, il faut le constater froidement. Si on se représente la mémoire d'un paysan du 14ème siècle, qu'y trouve-t-on ? Question certes pour un historien, mais on peut grosso modo imaginer, sans trop se tromper, que les contenus ne dépassent pas le bout du champ, la surface de la ferme et, peut-être, de l'agglomération dont elle dépend. Ajoutons-y l'histoire de la famille et le domaine des souvenirs subjectifs, étant entendu que ces souvenirs ne s'organisent sans doute pas du tout de la même manière que les nôtres, justement parce que les nôtres sont «encadrés» par une toute autre forme de mémoire, l'historique, la mémoire permanente des événements du monde, substance qui s'est accumulée dans la culture depuis, en gros, le milieu du 19ème siècle. On pourrait donc dire qu'avant cette date, la mamoire était essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui une «mémoire vive», c'est à dire la partie d'un ordinateur qui pilote le reste, la quantité de mémoire nécessaire pour lancer l'autre mémoire, celle qui est contenue dans ou sur le disque dur. Au fond, à partir de la naissance du roman populaire et de la presse, il s'est formé peu à peu un disque dur de la mémoire collective, en chacun de nous.
Aujourd'hui, nous naissons pratiquement avec une mémoire dure : l'école établit en nous des connaissances historiques qui encadrent notre propre histoire. On connaît le débat autour de l'histoire, les questions philosophiques que pose l'historiographie en tant que telle, ce que l'histoire systématisée peut contenir de réécriture de la véritable histoire etc... Mais là n'est pas la question, la question est que de nos jours, chaque acteur du drame social possède un cadre mnésique beaucoup plus vaste, quelque chose qui tend vers l'universel ou le tout. Songeons que Jean-Baptiste Vico, celui qu'on appelle l'inventeur de l'histoire, a vécu entre le 17 et le 18ème siècle ! Avant lui, avant sa vision évolutionniste et progressiste de l'histoire, pas d'histoire du tout : aucun repère temporel dans la mémoire des gens qui dépasse l'histoire familiale et peut-être communale, là où existaient des communes. Bien sûr, les castes souveraines et aristocratiques avaient quelques documents et quelques versions éparses sur ce qui s'était passé avant leurs époques. De Thucydide à Albert le Grand ou Jean Bodin, il existait des documents, mais non pas d'histoire en tant que telle : ce dont disposaient les souverains monarchiques en France et en Europe, c'était le corpus même de la culture, qui, se voyant adjoint les sciences humaines, dont l'histoire scientifique, est devenu la Culture disponible sur le marché et dans les institutions démocratiques gratuites qui existent encore.
Plus haut, je m'étais un jour interrogé sur ce que pouvait signifier pour le peuple, pour les êtres humains comme vous et moi, une mémoire comme celle qui précède l'ère historicienne, et je n'avais pas trouvé de réponse. Aujourd'hui encore, j'hésite, mais une évidence m'apparaît immédiatement quand-même : l'absence de cadre universel de mémoire, et disons de mémoire scientifique, est un excellent instrument de gouvernement, un antidote massif et invincible à la démocratie.
Conclusion : les mots fétiches aujourd'hui pour nombre de manipulateurs d'ordinateurs sont les mots «ERASE» et « DELETE». Ils signifient détruire la mémoire, effacer ce qui est conservé. C'est, autrement dit, ce à quoi doit nécessairement s'employer l'ennemi déclaré de la démocratie : détruire la mémoire du monde, détruire l'histoire scientifique, voilà tout un programme qu'on peut peut-être détecter déjà dans la mise en place commerciale et industrielle des marchandises du futur, y compris et surtout les marchandises didactique. Etudions ce qu'on appelle les didacticiels, ces logiciels construits pour remplacer les professeurs, je suis persuadé qu'on y trouvera tous les mécanismes destinés à supprimer progressivement l'âme de la connaissance historique, au bénéfice d'une histoire plus proche de ce qu'est la mémoire vivante de l'ordinateur, c'est à dire une mémoire qui n'a plus d'autre fonction que d'enclencher le fonctionnement global du futur robot humain. Son futur disque dur ne contiendra lui-même plus que les logiciels de fonctionnement de sa compétence sociale et professionnelle.
Lundi, le 24 Mai 1999, dit de Pentecôte,
Ce fut un peu le scénario du Timée et l'histoire des Atlantes : la mémoire des Grecs annulée par une catastrophe naturelle. Naturelle ? Certes, mais sans doute aussi humaine que le fut le nazisme et dont les conséquences auraient pu signifier exactement le même anéantissement de mémoire. Le dix-neuvième siècle a peut-être pressenti quelque chose de cet ordre dans son immense effort encyclopédique, mais peut-être qu'après tout il est dans l'ordre de la nature de notre culture que de fictionner en permanence la perte des données, la perte du su, d'où l'écriture comme piège métaphysique, glue du su.
Horst Althaus, encore un de ces noms à forte résonnance germanique, mais quel voyage ! Il s'agit de l'auteur d'une récente biographie de Hegel, encore une, mais quelle belle croisière dans l'histoire de l'Esprit ! Il y a, en ce moment, une génération d'historiens de la philosophie en Allemagne qui travaillent encore réellement à l'allemande, avec un sérieux et une intelligence qui laisserait croire que l'ancienne Allemagne est en train de renaître - celle précisément de Hegel et de Kant, et aussi de Fichte, Schelling, Hölderlin et Marx - une impression que m'avait déjà donné le Safranski de la biographie de Heidegger. Mais, en est-on arrivé, en Allemagne, à l'époque des biographies ? et pourquoi ? Le livre de Althaus est une forme de réponse à cette question.
En effet, l'historiographie philosophique allemande contemporaine nous apporte un enseignement précieux sur ce qu'est la philosophie : elle n'est jamais que l'être d'un homme qui s'exprime à travers ses actions. Et ces actions sont multiformes et comprennent un domaine bien plus vaste que ce que les lecteurs de leurs oeuvres retirent comme substantifique moelle sous la forme des «systèmes» ou des vérités particulières et générales. D'ailleurs il est remarquable que plus un Althaus insiste sur l'existence d'un système hégélien, alors que les commentaires le mettent en doute depuis un siècle, plus il s'avère que ce système n'a aucune importance parce qu'il se trouve, ou «a lieu» à peu près partout dans l'oeuvre et les actes du philosophe : Hegel est une conscience tellement universelle que tout ce qu'il exprime d'une manière ou d'une autre est système. Le système n'est pas une matrice objective tirée une fois pour toute par une méthode pour ainsi dire technique - quoiqu'on se demande parfois jusqu'à quel point l'accélération foudroyante du technique, qui se fait déjà sentir au tout début du Dix-Neuvième siècle, ne joue pas un rôle décisif dans ce souci de systématisation, une dérive que l'on doit à Kant, déjà - le système est l'angle d'ouverture de la conscience, simplement. Et qu'est-ce-que ça veut dire ? Ca veut dire que Hegel, ou le philosophe, est lui-même une ouverture, et rien d'autre. La conséquence est importante, il n'y a rien à attendre d'un penseur en terme de vérité ou d'objectivité décisive, décisoire : on ne peut qu'apprécier plus ou moins ce que l'oeuvre conserve de cette ouverture qui, ne l'oublions jamais, ne s'adresse évidemment pas directement à notre réalité, à notre époque de l'être. Ce décalage est d'autant plus sensible que le génie - disons l'ouverture - est moins grande, et à ce titre Hegel a fait fort, car non seulement il a écrit pour le siècle qui a suivi, mais encore pour presque tous ceux qui l'ont précédé.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, pour oser une telle interprétation de la philosophie, c'est qu'au fond, l'un dans l'autre, Hegel et Spinoza disent exactement la même chose. Ce qui signifie qu'on ne peut pas dire grand chose de plus. N'est-ce-pas là le cauchemar de Heidegger qui ne souffle pas un mot (ou presque) sur Spinoza ? Cauchemar est sans doute un grand mot car le défi, si je comprends bien tout l'enjeu de ce que je découvre ici, c'est de répéter à travers l'histoire - je comprends enfin le terme de «ressassement» comme il faut - une compréhension ontique d'un état ontologique. Le philosophe doit parler dans son «envoi» de l'être propre afin de se comprendre lui-même et de se faire comprendre par ses contemporains. Car il est vrai que l'on aurait pu, peut-être, et ce peut-être est bien lourd à porter, en rester à Parménide et Héraclite, comme les Juifs en restent à la Torah.
Quand même, Luther aurait traité la philosophie grecque de «vieille femme puante de Grèce»! Quelle impudence ! Ce ton insultant traîne toute la rancune des Germains contre Rome, Luther personnifiant la vieille Germanie libre contre l'Empire-Vatican. En réalité, Rome n'a jamais été que la vitrine fallacieuse d'Athènes : même la fondation de Rome (dont on se plaît à classer les fondateurs parmi les Grecs de Troie) n'est qu'une imitation de l'accomplissement grec, et une imitation qui a beaucoup plus de commun avec les Germains qu'avec les Hellènes : d'où une complicité millénaire entre Rome-Papauté et le Saint-Empire. A Ravenne, les Goths étaient chez eux, sans aucun doute. Luther n'est que celui qui a voulu mettre les choses au point définitivement à une époque où les Pic, les Ficin et les Bruno recommençaient à tirer toute l'idée, toute l'ouverture vers (ou d') Athènes. Ils voulaient être les refondateurs de l'Italie romaine. D'où cette méditation à faire : en quoi et en combien la Papauté a en réalité combattu l'hellénisme au profit d'un fétichisme curial et pontifical ( ce n'est pas un hasard si le Pape possède le même titre - Souverain Pontife - que le prêtre-architecte du Pont de Rome, premier dignitaire religieux des Rome successives. Mais la Papauté reste un mystère aussi grand que la montée du Christianisme dans l'Empire, sa souveraineté invincible est exactement le même phénomène qui a donné aux évêchés des premiers Chrétiens une puissance que les Empereurs les plus lucides n'ont plus réussi à compromettre. Dioclétien avait parfaitement vu la dérive de sa puissance vers l'Eglise réseautée en noyaux économiques et idéologiques, mais il n'a pas trouvé le moyen d'y mettre un terme, parce qu'il était trop grec et que le sang répugnait aux Grecs lorsqu'il ne coulait pas sur un champ de bataille.
Et voilà un progrès considérable pour ma gouverne personnelle : il faudra relire tous les textes philosophiques à la lumière de la simplicité de la situation subjective des philosophes. Le cas Spinoza est légèrement différent, il est peut-être l'exception historique car il n'a pas eu, dit-on, la prétention d'inventer un système, mais de transcrire seulement le système de la Kabbale. L'Ethique est une traduction de la Weltanschauung transcrite dans les textes cabbalistiques et hermétiques. Les dialogues d'Hermes Trismégiste peuvent être aussi intégralement retrouvés dans l'Ethique du Juif néérlandais, sans aucune retouche. Au fond, Spinoza aura été conscient dès le début de sa situation de philosophe-adaptateur des ouvertures anciennes.
Mais alors il y a quand même bien des choses qui se cassent la figure, et notamment toute la dialectique historique hégélienne elle-même, même s'il est certain qu'il y a présent dans l'oeuvre de Hegel au sens large tout ce qu'il faut de négatif pour contourner ce problème. L'une des failles que relève Althaus est précisément l'ambiguité du statut de l'histoire de l'Esprit : est-ce-que l'Esprit avance linéairement, selon une dialectique (discernable dans la Phénoménologie par exemple) certes circulaire mais en réalité spirale, ou bien l'Esprit se manifeste-t-il par caprices, ou bien encore, et c'est là ce qu'on pourrait dire de pire à propos de la pensée de Hegel, mais pourtant on peut parfaitement le dire, (puisqu'on peut et doit tout pouvoir dire...) que l'Esprit est parfaitement immobile en lui-même, substance spinozienne une fois pour toutes, vision divine berkleyenne, Eon des éons, être de l'étant, étant en tant qu'étant. USW...
Pardon. Quels ravages ne se sont-ils pas accomplis sous la houlette du hégélianisme ? Mais qu'était-il ce hégélianisme ? Une machine de guerre conceptuelle ou seulement un homme ? Nous optons aujourd'hui pour la version humaine : Hegel était un homme d'une lucidité tout à fait exceptionnelle, sa vision était monstrueusement perçante pour une vision humaine (et sans doute la proximité de l'autre regard de géant qu'a été celui de Kant n'est-il pas pour rien dans cette perception surnaturelle, puisque Kant a en fait littéralement déchaîné une époque philosophique, avec tous les géants de l'idéalisme allemand) et Hegel ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de TOUT voir, de voir toutes les possibilités, toutes les issues. D'où cet instinct qui a révolté les Kierkegaard et les Schopenhauer eux-mêmes piégés par l'universalité du singulier ou la singularité de l'universel, comme on voudra. Ils ont vu chez Hegel une trahison de ce qui est le choix destinal de la Grèce, à savoir l'individu, ce qui signifiait pour eux une trahison proprement historique ou historiale, alors qu'en réalité Hegel ne faisait qu'accomplir le regard individuel, réaliser la raison singulière anticipée par les Grecs. Hegel est cette tragédie-là, de l'ouverture totale du jeu de la conscience tournée vers l'infinité du questionnement, dernier mot de toute biographie philosophique, et là, Althaus n'a pas failli.
Mercredi, le 26 Mai 1999
Et Lévinas donc. L'enjeu semble être le suivant : l'être agit le tout, or le singulier ne supporte pas le tout, dans le tout il n'existe pas en tant que...Tout, donc l'être n'agit pas le singulier en tant que tel, il n'y a pas d'être spécifique au singulier, autrement dit, le singulier n'est pas. Hypothèse redoutable car vérace : il n'y a pas plus de raison de totaliser le singulier pour en faire quelque chose comme un moi effectif que de considérer le moi comme une simple partie d'un moi plus grand dont l'action réelle lui échappe, ce qui corrobore vaguement les versions spinozistes et berkleyennes de l'être. Ce n'est pas l'abolition totale de l'effectivité du moi, ce n'est que la négation du moi = moi de l'idéalisme allemand (ce dont Descartes s'est bien abstenu). Comment se défaire de cette idée ancrée en nous au plus profond, que notre esprit individuel, ou notre Logique dirait Hegel, peut contenir la totalité ? En bref, que nous pouvons, à défaut de tout être, avoir la prétention de tout comprendre ? Si nous pouvions tout comprendre, cela ne signifierait pas encore que nous ayons tout compris, mais seulement que nous avons trouvé la satisfaction, que les réponses que nous avons trouvées nous conviennent : que nous avons pris rang dans les espèces que nous considérons comme des espèces non-questionnantes. Nous n'aurions aucune preuve du contraire. C'est pourquoi il faut redéfinir l'opération de la compréhension elle-même : toujours et encore les hublots de la sphère.
Pourquoi le schéma antique du ciel - sphère pleines de trous qui laissent passer de la lumière là où il y a ce que nous appelons des étoiles - a-t-il tenu si longtemps ? Parce qu'il illustre à merveille une étance transcendante, il atteste l'existence d'un espace de lumière totale, opposée à la nuit intra-sphérique où ne règne qu'un entre-deux d'obscurité et de lumière, d'ignorance et de savoir, de bien et de mal usw.
Samedi, le 29 Mai 1999
Découverte presque surnaturelle : les nazis n'auraient-ils pas épuisé le mal ? En réfléchissant ce matin, après avoir relu pour la xième fois le Maus de Spiegelmann, je me suis rendu soudain compte du fait qu'il est devenu impossible de faire pire que ce qu'ils ont fait. Ils sont allé au fond de ce que peut donner le mal, ce dernier a donné toute sa mesure, en entier, d'un coup historique, d'un seul. C'est une manière de voir le mal sous son angle le plus réaliste possible, mais il faudrait admettre qu'il y a dans l'être une quantité déterminée de mal ( et donc aussi de bien ). Comment serait-ce possible ?
Dans l'ordre du temps, dirait Anaximandre. Bien et mal seraient quantifiées par époques. Empédocle pensait aussi vaguement quelque chose de ce genre, puisqu'il estimait que l'être était rythmé sur des cycles de «compression amoureuse» et de «désagrégation haineuse». Mais cela pourrait peut-être mieux se comprendre si on admettait l'idée de quanta moraux : dans l'ordre du temps, les quanta d'énergie psychiques seraient po ....ça s'arrête là, nous sommes déjà :
Dimanche, le 30 Mai 1999
Nous y reviendrons certainement. Aujourd'hui je voudrais parler de ma pierre. Je l'ai ramassée en 1970 autour du site de Maison Rouge, situé près d'In Aménas, à environ 2800 km au sud d'Alger en direction du Hogar. Ce site préhistorique se résume à une sorte de monticule pierreux avec quelques parois lisses sur lesquelles nos ancêtres ont dessinés des animaux. Entre autres une giraffe dont j'avais essayé avec quelque succès d'ailleurs de faire une photographie que je possède toujours quelque part dans mes archives.
La pierre est très étrange. D'environ dix centimètres sur dix, elle est comme un poing fermée, et possède donc une forme qui s'adapte parfaitement au creux de la main, avec quelques points précis pour placer quelques doigts de manière à fermer le dispositif ainsi créé et à prednre appui sur eux. J'en ai donc conclu qu'il s'agissait d'un outil, hypothèse qui me fut confirmée plus tard lorsqu'on me montra des «opercules», c'et à dire des entailles qui ne peuvent, selon les archéologues, n'être faite que volontairement par un autre outil, et donc ne peut pas être la conséquence de chocs naturels comme ce qui se produit pour des pierres qui roulent dans un torrent ou qui sont broyés par une machine.
Ce qui est le pus frappant, c'est sa couleur et la matière géologique elle-même. Elle est à moitié rouge orangé, et à moitié brun-crême, ce qui me fait penser à de la latérite fossilisée ou volcanisée, si cela existe. En tout cas elle est d'une dureté extraordinaire et aussi d'un poids spécifique sans doute très élevé. Volcanique elle l'est certainement, car on peut discerner des bouillonnements figés ainsi que de nombreux petits trous qui indiquent sans doute d'anciennes bulles d'évaporation, la surface est brillante sans doute par cette vitrification évidente.
Outil ou matière première, et l'on pourrait aussi se dire que les opercules sont les traces d'éclats de pierre détachées pour en faire des pointes de flêche, nombreuses dans cette région du Sahara; j'en ai ramené une pleine boîte d'allumettes depuis disparue.
Mais encore. Trace d'une lointaine humanité. Pas si lointaine que cela. Rien n'est lointain, tout est si trop proche, trop près de nous, du nous. Magma rouge d'autres millénaires qui ont roulé leur bosse à travers le chaos.
Lundi, le 9 Août 1999
Rarement ce journal s'est tû si longtemps. Deux mois sans écrire, sans sortir des mots de mes doigts et de ma tête ! Aussi n'est-ce pas par hasard, je me sépare de mon épouse. Pour un temps ou pour toujours ? Je ne sais pas, ce que je sais, c'est que cet événement a une grande signification pour mon existence. C'est une fracture importante autant qu'étrange. Ces dernières semaines je me rendais parfaitement compte que dans les fonds de mes préoccupations quelque chose bougeait. Car le reste se paralysait rapidement, comme si s'annonçait une panne de moteur inquiétante et fatale. Dois-je ici tenter de fouiller dans les causes et les conséquences ? Tenter d'analyser ce qui s'est passé ? Mais pourquoi ? Dans nos récents commentaires devant les banquiers et les avocats, l'affaire semble entendue, on fait comme si on entrait dans des modèles de comportements, et ce n'est pas l'aspect le moins pénible. Pourtant, je suis sûr que ce n'est pas vrai et que cette rupture comporte en elle-même autant de mystère que notre rencontre. Ce que je peux dire, c'est que la force d'attraction qui nous liait n'a pas faibli, mais qu'elle s'est retournée contre nous, qu'elle a travaillé à l'envers tout d'un coup. C'est le côté le plus inquiétant pour l'avenir, car cela montre que cette force fait ce qu'elle veut. Pour ma part, je pouvais tout absorber, aller au sacrifice suprême sans doute. Le verdict est donc venu d'elle, même s'il a fallu que la décision pratique me revienne en dernière instance.
Et pourtant il s'en est passé des choses depuis le Trente mai ! Kosovo et tout ça, mais aussi des lectures passionnantes, l'illumination grecque ! En lisant Plutarque, Vernant, Vidal-Naquet et Glotz, la figure du Grec me devient de plus en plus claire, ce paradigme de l'existence telle qu'il n'apparaît ni dans Hölderlin, ni dans Heidegger, mais qui conditionne pourtant toute la valeur que ces deux Allemands ont investi dans le «commencement grec». La dimension qui échappe à ces attardés des Lumières, c'est la dimension praxistique de l'existence grecque, le fait incontournable que le Grec n'est ni d'abord un penseur ni d'abord un citoyen ou un guerrier, mais qu'il est tout ça ensemble. Lorsqu'il partait pour une bataille de la guerre du Péloponnèse, le Grec n'ouvrait pas une parenthèse de sa vie, laissant la philosophie et ses valeurs au prytanée d'Athènes pour se transformer en sauvage hoplite. Comme le firent tous nos vaillants trouffions de 14 avant de déchanter. Platon et Aristote, au fond, n'étaient pas des Grecs entiers, même si le premier des deux a été tenté par le vent de la Grande Grèce. Ils sont ceux qui sont venus après le miracle, les commentateurs pas toujours inspirés par la vérité et la grandeur de l'événement.
Il est important de souligner ce hiatus, car les catégories philosophiques elles-mêmes en ont souffert. Comment l'égalité Clisthénienne se transforme en «médiété» aristotélicienne et comment l'injuste et le non-vrai doivent avec le stagirite se réfugier dans la mécanique du pathos tragique, du patein qui, au fond, ne fait que refléter la condition maudite des esclaves. Mais le plus grave c'est la perversion du théorique, l'impérialisme du transcendantal qui se détache de plus en plus gravement du sujet, qui l'anéantit proprement au point qu'il faudra que Descartes lui fasse, vingt siècles plus tard, un véritable bouche à bouche pour le ranimer !
Mardi, le 10 août 1999
Evénement considérable, ce matin à 9 heures 35 j'ai battu mon ordinateur aux échecs pour la première fois depuis que j'ai le programme, c'est à dire cinq ans ! J'étais parvenu au mieux au pat à deux reprises. Je ne sais pas si c'est le triomphe de l'acharnement - je fais en moyenne deux parties par jour - ou bien si certaines données psychiques ont été bouleversées par la situation ? Quoi qu'il en soit, mes relations avec ChessMaster 3000 ne seront jamais plus les mêmes.
Considérable car il met en jeu (on peut le dire) une sorte d'infernale auto-évaluation de plusieurs aspects de la personnalité. Tant que je n'avais aucune victoire à mon actif, je pouvais constater mon impuissance à faire fonctionner mes neurones de manière statistiquement raisonnable. Combien de questions finissent par se poser lorsqu'on se fait ridiculiser ainsi pendant de longues années ! La plus courante était que je me demandais pourquoi je ne parvenais pas à me concentrer, car je joue très vite et commets donc d'énormes bourdes. La seule consolation que j'avais, étais que je ne m'étais pas formé professionnellement aux échecs, et que mon programme calculait tellement plus vite que moi que je n'avais quasiment aucune chance. Autre critique : je n'ai aucun sens de l'attaque, or je joue toujours avec les blancs. Un ami, maître aux échecs, me l'avait dit un jour, haussant un peu les épaules comme si cette «tare» me définissait entièrement. Reste le plus mystérieux, le hic et nunc de l'affaire ! Que se passe-t-il réellement ? Quand on parvient à ses résultats, on se rapproche de la mort, n'est-ce-pas ? Mais ne nous emballons pas, cette victoire est peut-être un petit hasard à la Pyrrhus, mon ordinateur est peut-être fatigué ?....
Autre chose en vitesse : je commence à cerner de manière très précise le concept d'histoire. Une très vieille intuition refait surface : il ne peut pas y avoir d'histoire. Dit comme ça, cela paraît scandaleux, mais je pense toujours au sujet dans le temps, à l'homme en tant qu'individu nanti d'un destin, quelle que soit son époque. Et je ne peux pas me résoudre à l'augmenter ou à le diminuer d'aucune manière selon les échelles du progrès ou de je ne sais quoi d'évolutif. Cela peut aussi être le déclin. Non, je crois même que la responsabilité de ce sujet est totale, en tous les temps. Les formes sociales trompent, car elles exhibent des différences qui en elles-mêmes suggèrent un échelonnement entre les êtres, une gradation qu'il suffit dès lors de replacer sur l'échelle du temps pour obtenir quelque chose comme l'histoire de l'humanité.
Car d'Humanité il n'y en a que pour autant qu'il y a des sujets individuels assumant individuellement leur destin. C'est ça le commencement grec : la barbarie est le contraire de cette nécessaire assomption individuelle, elle «socialise» l'humanité de telle sorte que c'est la dépendance réciproque qui domine la responsabilité particulière. Si l'histoire se joue autour de la mobilité des hommes par rapport aux classes sociales, c'est parce qu'en réalité c'est toujours une classe sociale qui monopolise le discours sur l'histoire.
Vendredi, le 13 août 1999
Assumer son destin ne suffit ni comme formulation, ni comme programme. Car à ce compte on peut nommer le destin comme on veut et lui faire porter tous les chapeaux de l'histoire. C'est que dans le commencement grec, il y avait quelque chose de plus qui permettait l'assemblage des destins individuels, la possibilité pour eux de jouer ensemble sans se laisser dominer par la nécessaire individuation. Il y avait l'égalité, cette fiction qui naît à Athènes dans les pires conditions que l'on peut imaginer, dans une civilisation du génos, de la pure biologie familiale, toute puissante, tyrannique dans son modèle et dans son acte. Dans rien de différent, au fond, de ce qui les entourait depuis la Perse jusqu'à la Phénicie, et qu'ils appelaient barbare.
Mardi, le 31 Août 1999
Si j'ai bien compris les dernières leçons auxquelles j'ai eu droit, la vie d'un adulte consiste avant tout autre chose, à comprendre comment s'est tissé son passé ? A comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui lui est arrivé alors qu'il n'était encore qu'un être passif, recevant ses injonctions de partout sauf de lui-même. Ainsi est-il maintenant clair pour moi que je n'avais guère le choix dans mon adolescence que de me révolter contre cette arrogance dépassée de la bourgeoisie à laquelle je n'appartenais pas. Quand je pense qu'en 1950, les élites de Mulhouse se comportaient encore exactement comme elles le faisaient cinquante ans plus tôt, alors que les guerres n'avaient pas encore montré combien ces élites étaient compromises dans ces catastrophes humaines et responsables des millions de morts qu'elles comptabilisaient. Les jeunes, alors, étaient encore associés à un système d'élevage des petits du prolétariat, un système qu'on ne peut comparer qu'à l'élevage des poulets en batterie. Dans mes nombreuses colonies de vacance, on pratiquait encore joyeusement tout le conditionnement des petits d'ouvriers à coup de réjouissances gymniques et autres socialités de bas-étage. Tréfilerie de cons dont la conscience collective elle-même ne pouvait que désirer se débarasser le plus vite possible. Mon malheur est d'avoir appartenu à la pointe avancée de cette conscience parce que j'en souffrais dans mon corps et dans mon coeur. Au premier abord, il y a eu la religion pour me freiner, car elle prétendait que le problème allait de toute façon se résoudre. Le sentiment de trahison que j'épprouvais lorsque je me rendis compte du mensonge religieux, n'a fait que radicaliser mon désir de rupture avec un monde qui parvenait si mal à se changer de lui-même. Indécrottable paresse de nos aînés qui ne songeaient à rien d'autre qu'à tirer leur pauvre monde de fous en longueur, en longueur, tenir le plus longtemps possible avec quelques pauvres valeurs mitées, pourries et bonnes pour les poubelles de l'histoire. Dire qu'aujourd'hui encore on gymnise, on prône l'hygiène et on tire à boulets rouges contre les fumeurs et les drogués, sans RAISON, simplement parce que cela va de soi et parce que quelques gugusses qui ne rendent de comptes à personne votent des lois imbéciles. Qui analysera un jour le degré d'inconscience collective qu'il aura fallu pour concevoir, voter, maintenir et renforcer tout le carcan des lois contre les drogues, toutes les drogues, quelles qu'elles soient. Sans RAISON autre que la vieille défiance sociale, le clin d'oeil entre nantis de l'existence qui savent que leur bien dépend de l'exacte fidélité avec laquelle il répriment tout désir d'autonomie existentielle chez les autres. Le pire, sans doute, est la peur qu'on a de prendre conscience qu'il n'y a pas de raison, la terreur collective d'apprendre un jour qu'on a été con. Cela vaut bien toutes les mauvaises foi du monde.
Dimanche, le 19 septembre 1999
Ecouté comme presque chaque dimanche les émissions du Cahier des Charges de France-Culture, c'est à dire les émissions religieuses et areligieuses, sauf la catholique qui est inécoutable...Mais aujourd'hui quelque chose de nouveau m'a frappé, c'est le ton de conviction philosophique qu'empruntent les «bergers» du protestantisme ou du judaïsme pour vendre leur camelotte. Ce matin ce sont les Juifs qui m'ont agacé par la manière de pontifier sur des thèmes invreaisemblables, surréalistes : comment peut-on aujourd'hui broder, sans pudeur et sans aucun sens du ridicule, sur des sujets comme la «purification de l'âme» ? Non mais, où sommes-nous ? D'habitude, les émissions juives sont beaucoup plus subtiles, s'élevant souvent à la reflexion ontologique, ce que font couramment les protestants, de loin les plus retors dans le marketing religieux. Il leur arrive même parfois de ne pas citer leur «produit» tout au long d'une méditation, pas de «Jésus», pas de Père, de Fils ou de St Esprit, mais seulement quelques énergiques questions sur l'être ou la déréliction humaine. Quel talent ! Mais ce matin Claude Vigée, poète alsacien, n'a pas hésité à parler comme le pire des curés catéchistes qui nous parlaient il y a de cela une cinquantaine d'années, du «lavage de l'âme» et autres sornettes, sans même un sourire d'ironie ou de distanciation. Ah le rite !
Mais le fait que je ne comprenne pas toute cette soupe (comprendre signifie ici admettre que ce soit des hommes adultes cultivés et raisonnables qui nous servent cette soupe) ne fait que souligner ma solitude, de plus en plus grande, ici comme ailleurs. Il faudrait savoir s'aggréger à un sens collectif du destin, il faut être heureux selon la recette collective, collectivisme beaucoup plus totalitaire que ceux qu'on évoque à propos du communisme ou du fascisme. Mais souterrain, encore souverain dans les couches profondes de la conscience de l'espèce.
De moins en moins je m'intéresse aux événements et aux comportements individuels. La réalité humaine est en réalité complètement «fluctuaire», c'est à dire composée de flux, et non d'action discrètes. Il faut donc regarder autour de soi, lire les symboles qui naissent de l'acte collectif, de l'événement d'ensemble qui se prépare. Inutile de s'attendre à, de regarder le spectacle des choses qui passent, car on en est : il suffit de regarder en soi, de distinguer les petits mouvements de son corps et de son esprit pour lire dans le livre de ce qui se passe et de ce qui va se passer. La voyance repose là-dessus : la possession individuelle du secret du mouvement. Il suffit de distinguer. Si donc je suis dans cette situation de palper les flux autour de moi, et que ces mouvements de pensées me font horreur, justement parce que je les reconnaîs quelque part en moi, je ne peux que me sentir comme arraché de la communauté, renvoyé dans une solitude effroyable.
______________________
La vie n'est-elle qu'une longue distillation de la culpabilité ? Dites-moi dans quelle situation l'homme ne se sent pas immédiatement coupable ? Naturel ou culturel ? Acquis ou inné ?
Structurel ou conjoncturel ? Ah Freud, tu as joué sur du velour, exactement comme St Thomas ou tous les autres...A croire que le langage est lui-même coulé dans l'alliage de ces sentiments de merde.
Puisque le contraire existe.
Mardi, le 28 septembre 1999
Encore la morale et ce qu'ils appellent la «téléologie». Quel langage parmi les philosophes de la politique et de la société ! Habermas et autres.. Lorsqu'on lit ce qu'écrivent ces intellectuels, on comprend fort bien pourquoi la pensée se trouve la plupart du temps discréditée. Les pensées les plus intéressantes ne peuvent s'empêcher de jargonner et de construire des périodes insensées, aussi limpides que les paragraphes infinis de Derrida.
Bref, il faut tenter de traduire tout ça, ce qui représente déjà un énorme travail.
De quoi s'agit-il ? Si j'ai bien compris le petit opuscule de Gérard Raulet qui s'intitule «Apologie de la citoyenneté», la question est de se représenter comment s'exerce et comment progresse la moralité dans la société. Autrement dit, quelle forme de souveraineté garantit le mieux cet exercice et ce progrès. L'alternative moderne, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui sous la pression anglo-saxonne et de celle des événements sociaux et judiciaires, semble s'établir entre République et Démocratie communautariste. La grande différence entre les deux, c'est avant tout le mode d'existence : la République existe par une structure législative et exécutive qui se modifie de l'intérieur, c'est à dire par le jeu de l'exercice de la démocratie qu'on peut résumer ainsi : l'opinion se forme dans la lutte politique qui aboutit au suffrage des représentants de la Nation. La République existe selon le rythme des rendez-vous électoraux dont dérivent, historiquement, les lois et la moralité sociale. La Démocratie communautariste, quant à elle, existe par les tribunaux et la jurisprudence. D'un côté une universalité juridique, de l'autre une justice éclatée en cas particuliers, c'est à dire une société fondée sur la gestion des différences assumées par des décisions de justice.
Mais tout cela devient déjà et tout de suite très compliqué, tant que ça reste dans la description abstraite. Prenons un exemple actuel, qui fait couler beaucoup d'encre et qui, au fond, pose assez bien la question dans toutes ses applications. Il s'agit du problème de la femme. On pourrait, sans doute, choisir aussi l'exemple des noirs américains ou encore des populations de nos régions d'Europe, qui se réveillent en tant que sociétés dont la volonté semble être de se refermer sur elles-mêmes.
Faut-il transgresser l'universalité de la loi en faveur de la femme ? Faut-il, par exemple, réserver des quotas de femmes dans les instances républicaines, de façon à introduire une proportion fixe de femmes dans ces instances ?
Ce projet, déjà bien établi dans les états-majors politiques, aurait, s'il était adopté, plusieurs conséquences théoriques (logiques) et pratiques.
Premièrement, l'introduction de quotas de femmes aurait pour conséquence paradoxale de créer une scission entre la notion d'homme (de masculin) et de femme (de féminin). Autrement dit, l'universalité de la notion d'être humain disparaîtrait pour laisser la place à une notion double, bifide : à la limite il faudra dire, si cela arrive, qu'il existe deux humanités, la masculine et la féminine.
Au plan pratique, cette décision législative provoquerait une dénaturation de la formation elle-même des instances républicaines. A savoir que les flux naturels du jeu démocratique seraient perturbés artificiellement par une loi qui «inventerait» en quelque sorte des personnages publics qui ne l'auraient jamais été sans cette peréquation. Pour parler clair, les femmes seraient obligées de trouver dans leurs rangs des candidates aux fonctions publiques qui ne l'auraient jamais été en d'autres conditions. Autre conséquence claire, les femmes seraient soumises constamment à la tentation sinon à l'obligation de la cooptation, car il faudra toujours trouver assez de candidates aux fonctions publiques alors qu'il n'en existe pas naturellement, c'est à dire historiquement.
Si on repense au suffrage censitaire, on pourrait dire que le suffrage à quotas de femmes réintroduit une forme du cens puisqu'il réintroduit une obligation formelle ou attributaire dans la composition des groupes éligibles. Le cens c'était l'homme plus une certaine richesse, le quotas c'est l'homme plus un certain nombre de femmes : la richesse pas plus que la féminité n'étant des attributs de la citoyenneté, mais seulement une idée pratique de la garantie de bonne fin de son exercice. Parce qu'Aristote pensait que seuls les riches avaient la compétence pour diriger la société, les législateurs des siècles passés ont lourdement exploité ce lieu commun de philosophie politique pour retarder le plus longtemps possible la naissance d'un véritable démocratie républicaine.
Reste une question intéressante. En posant les quotas, on interrompt le jeu naturel de la formation des élites républicaines, on force la composition de ces élites, mais ce volontarisme n'est-il pas réellement positif ? N'a-t-il pas toujours fallu un tel volontarisme pour progresser vers la moralité républicaine ?
Que cherche-t-on en posant des quotas ? Satisfaire ce qu'on pourrait appeler le lobby des femmes, ou bien améliorer la représentativité des instances ? A priori c'est la deuxième réponse qui compte : on introduit des quotas afin que les femmes soient mieux représentées. Mais si on dit cela, on divise, comme je l'ai dit plus haut, la société en deux groupes qui devraient être représentés à égalité. Et si tel est le cas, cela signifie que chaque groupe a des intérêts divergents à faire valoir, et que si on décide de quotas, c'est qu'il existe au moins deux séries de valeurs morales républicaines qui devront toutes deux pouvoir se promouvoir dans la République.
Autrement dit, la morale républicaine est remise globalement en question, elle est accusée de ne promouvoir que des valeurs masculines, même si la vérité des textes dit le contraire. S'il est vrai que la situation concrète des femmes ne reflète pas exactement les valeurs morales écrites de la République - Liberté Egalité Fraternité - il n'en reste pas moins que la femme est comprise dans les requisits moraux de la société en tant que citoyenne et que, s'il existe un retard d'application de ces requisits dans l'histoire, il n'est pas évident que cela provienne exclusivement de la faible proportion de femmes dans les instances. Il n'est pas évident du tout, ou disons que rien ne permet d'affirmer qu'une gestion paritaire des affaires de la République parvienne à un meilleur résultat pour la femme que celle qui a cours.
C'est un exemple parfait pour se poser la question du progrès de la moralité : est-ce-qu'une telle décision concernant la représentation des femmes dans les instances républicaines serait un progrès dans la vertu ou la justice ? Est-ce- que l'on gagne quelque chose en terme de Liberté, d'Egalité ou de Fraternité ?
Ce qui paraît évident, c'est qu'au contraire, on y perd dans ces trois domaines de valeur. En ce qui concerne la liberté, il est clair que les quotas iront plutôt avec toute une série de contraintes plutôt que vers davantage de liberté. L'Egalité, elle, est carrément niée, puisqu'on crée artificiellement une nouvelle catégorie de citoyens, on dédouble qualitativement la République. Quant à la Fraternité, la valeur la plus importante sans doute, un geste comme l'établissement par la loi de quotas ne peut que dissoudre celle qui doit lier tous les citoyens, hommes et femmes.
En conclusion, on pourrait dire ceci : l'histoire de la République a sans doute laissé les femmes en arrière du progrès, dans une situation où elles bénéficient moins que les hommes des valeurs et des droits dits «citoyens». De cette situation on ne peut pas attribuer la responsabilité à la République elle-même, ni à la loi en général, mais seulement aux faits eux-mêmes, c'est à dire à l'application défectueuse des lois, au manque de rigueur de l'application des lois républicaines, pas à leur nature.
Alors, on peut évidemment prendre un chemin de travers, un raccourci dangereux en créant en fait une «seconde République», celle des femmes, qui doit équilibrer celle que l'on accuse en même temps d'être celle des hommes. Pourquoi pas, il s'agit certainement d'une décision tactique efficace, mais en aucun cas une décision morale, un progrès dans la moralité de la République. En posant les quotas on ne fait que donner aux femmes plus de pouvoir afin d'en finir avec des inégalités pratiques persistantes, au risque de porter atteinte à la définition même de l'homme, ce qui pourra ultérieurement avoir des conséquences insondables, y compris celle de permettre à ces deux nouveaux groupes de citoyens de promouvoir des lois et des valeurs propres et contradictoires. Ainsi pourrait périr le consensus lui-même sur lequel se fondent ceux et celles qui réclament des quotas !
Lundi, le 11 octobre 1999
Maman. Un mot simple, aussi simple que la situation dans laquelle on s'en sert. Ne pourrait-on pas tenter d'en rester là, dans l'enfance du «maman» ? Y pêcher un sentiment de l'existence qui semble d'ici si étranger à celui de ces années qui annoncent déjà le passage dans la mort ?
C'est quoi l'enfance ? Seulement ce passage furtif dans une existence splendide, fastueuse de chaleur et de bonheur permanent ? Si permanent que ça ? Oh non, je peux me souvenir d'heures tout sauf heureuses, des pleurs systématiques - on me laissait pleurer dans mon petit lit bleu où l'on me couchait immédiatement avant le repas du soir, je pouvais donc anticiper le bonheur familial du repas dont on m'excluait sous prétexte que j'avais à peine deux ou trois ans. On me laissait pleurer, m'endormir, puis on me mettait dans le grand lit de mes parents où je faisais fonction de bouillotte. Le grand bonheur, le Grand, venait alors plus tard lorsque mon père se couchait et qu'il ne manquait jamais de me réveiller pour me faire le grand jeu du père.
Laissons les exceptions, les trous dans le bonheur, parlons de Maman. Je n'ai jamais compris la maman de Rousseau, je n'ai sans doute pas eu la même, ou du moins celle qui est restée en moi n'est pas la même. Mon amour pour maman n'était pas de l'amour, c'était du bonheur, le sien et le mien mélangés, se vivant en entier et dans le même temps. Un bloc de bonheur, une réalité symbiotique primordiale ou originaire. Curieux mots, existe-t-il quelque chose d'originaire, de primordial ? La seule chose c'est cette symbiose qui n'est originaire que parce qu'elle est condamnée à se dissoudre. L'enfance c'est donc la laïcisation de l'être UN, c'est ce qu'on appelle et ressent comme le bonheur.
Donc tout cela sans le reste. Peut-on en parler, faire de la poésie «non-engagée» comme disait ce poète portugais si naïf ? Comme si l'engagement en poésie était contrôlable ! Comme si la vie pouvait se disséquer en «engageable» et en «non-engageable» ! D'où provient donc cette imbécillité, cette idée idiote qu'on pourrait être en l'être tantôt ainsi et tantôt autrement ?
Mais l'enfance. Maman. N'y-a-t-il pas justement là un non-engagement primordial ? Je ne le pense pas, car la séparation qui se joue dans l'enfance est un processus politique et pas du tout biologique ou je ne sais quoi d'autre. Politique, maman est le premier partenaire politique de ma vie, le bien que mes frères possédaient en propriété pléniaire face à cet avorton qui entrait dans le jeu. Alors mon bonheur c'était aussi un sentiment permanent de victoire, une victoire qu'il faudra d'ailleurs payer plus tard très cher, très douleur. Souveraineté, c'est le mot de l'exercice réciproque de maman et de moi, souveraineté sur nous dans l'oubli des autres, dans le détachement du reste, comme une civilisation arrivée à son apogée, commençant déjà de se replier sur elle-même pour entamer son déclin. Voilà ce que furent maman et moi, un royaume, un législatif et un exécutif parfaitement autiste. Même pas un couple engagé dans la vie des hésitations et des échecs, un couple royal où le pouvoir était le pouvoir et non pas une forme définie par des philosophes du politique. Le pouvoir sur le bonheur, le vrai pouvoir.
Ca tombe bien. Ma carrière à Arte touche à sa fin. Je devrais dire ma tentative de carrière, car en huit années je ne suis pas arrivé une seule fois à m'exprimer, à exercer le pouvoir réellement. Echec et mat sur toute la ligne. C'est la raison pour laquelle on veut se débarrasser de moi, le projet pour lequel je figure dans cette équipe n'est tout simplement pas réalisable, de moins en moins. je ne peux donc pas continuer de figurer dans le décor, même pas comme souvenir des idéaux originaux, des rêves partagés dans les commencements. Je n'aurais sans doute même plus l'occasion, tant les choses se précipitent, de parler à l'ensemble de la rédaction, et c'est bien dommage. Car j'avais à leur dire justement tout cela, qu'il fallait rejoindre la maman de l'existence, le bonheur. Qu'il était inutil de chercher à travailler pour les téléspectateurs, pour leur délivrer des messages vrais, riches ou intéressants, mais qu'il fallait se donner comme objectif d'être heureux dans ces bureaux et ailleurs, rire de la vie retrouvée dans la symbiose d'une rédaction harmonique. Or justement dans cette rédaction il existe depuis longtemps une sorte d'unanimité philosophique ou idéologique. L'isolement strasbourgeois et surtout le mélange franco-allemand nous préserve absolument ou presque de ces courant de pression politique qui fait faire tant de bêtises aux grandes chaînes de service public ou privées. Nous possédons une liberté qui, si elle était connue des autres, serait devenue un objet de la jalousie fraternelle.
Et pourtant ça n'a pas marché. Nos hiérarques font des efforts titanesques pour implanter la tristesse et la douleur, stratégie qui m'exclue tout naturellement. Si donc je pouvais encore une fois leur parler, je leur dirais qu'avec moi ils ont ri, qu'ils étaient heureux pendant huit heures par jour, ou presque. Je leur dirai aussi que le rire et le bonheur est la seule chose qui puisse produire un objet intéressant pour d'autres, pour le regard des hommes et des femmes qui se vissent les yeux sur cette question qu'est la télévision. Télévision déjà foutue, déjà ridicule de déhiscence par rapport à une réalité qui glisse de plus en plus vite hors des normes péniblement établies dans le demi-siècle qui s'achève. Hier j'ai regardé le dernier film de Wenders sur la violence. C'est très beau et ça montre très bien combien tout est déjà passé dans une autre dimension, même la violence. La semaine dernière j'ai prophétisé la disparition des notions de richesse et de pauvreté, avenir dont la conscience manque cruellement à tous ceux qui font aujourd'hui de la politique. C'est le même phénomène que la disparition de la violence décrite par Wenders, c'est une mutation du Da Sein qui à présent n'attend plus pour s'inscrire seulement sur un bout de papier, mais qui s'installe dans la vie, dans toutes ses artères, tous ses muscles et dans son cerveau. Le vrai problème est le vide que creuse l'absence prévisible de la violence et des valeurs qui définissent le bien de la richesse. Il viendra quelque chose d'autre, mais quoi ? Comme dit le personnage de Wenders, l'ennemi s'averra comme l'ami, sans même que l'on sache pourquoi, pour quoi. Mais je crois que Kafka ou Musil avaient déjà dit tout ça, leur grandeur publique ne sert qu'à le masquer, comme pour Cervantes. A tchao bonsoir.
Mardi, le 13 octobre 1999
Le sommet de l'OMC se pointe à l'horizon, cette année ça se passera à Seattle, le Vancouver américain, c'est à dire la capitale du capitalisme électronique, avionique et consort. Donc, on reparle à gogo d'exception culturelle et de protectionisme européen sur un certain nombre d'autres produits.
Examinons cette affaire de «culture américaine» et de «culture régionale» - la France étant, par exemple, considérée comme une simple région.
Donc, nos films sont écrasés par les productions américaines, sur nos propres marchés européens, sans complexes en Allemagne, avec beaucoup de criailleries du côté français. On met le peu de succès de notre cinéma sur le compte de la puissance financière des Américains sur notre propre marché : la distribution serait phagocytée par un diktat d'outre-Atlantique. Hélas, cela ne change rien au fait qu'un film marche ou ne marche pas : tous les films français qui ont eu du succès ont eu leur place dans les salles. Quant à l'argument de la publicité ou du marketing, il y a bien longtemps qu'il n'a plus aucun sens pour moi : la publicité et tout ce qui tourne autour, ce n'est qu'une consumation marginale de la valeur globale des marchandises, une phénomène culturel (ou anti-culturel) comme un autre qui a le mérite de créer des emplois mais qui ne fait que polluer l'activité humaine normale. Encore un mot là-dessus, si je hais littéralement la publicité, c'est parce qu'elle pourrit la vraie culture : elle s'empare des états de conscience entrevus par des concepteurs pour les adapter à des vécus relatifs à des marchandises. C'est un véritable piratage ontologique, de surcroît très grave car il use le fonds universel au nom d'une merde particulière. C'est la musique de Mozart pour une savonnette, un scandale. C'est la vraie et unique pollution qui mérite qu'on en parle.
Mais pour en revenir à nos moutons culturels, je pense que le problème se situe tout à fait ailleurs : là où règne l'émotion.
Primo, je pense qu'il ne faut pas accuser les produits américains d'être ceci ou cela, racoleur, facile, démagogique ou autre, il vaut mieux accuser alors la psychologie des citoyens européens de s'être progressivement adaptée à ces produits, c'est l'Européen qui devient américain et non pas les produits américains qui américanisent l'Europe. C'est comme si on disait que le succès des MacDo était dû à la puissance financière qui peut les créer ou à la publicité, alors que chacun de nous sait pertinemment que ce sont nos propres enfants qui programment ce succès depuis des lustres. Nos enfants sont devenus assez américains pour que la merde américaine les séduise. On ne peut rien y faire.
Donc, il faut se rappeler que le succès du cinéma comme art ne sort pas de la tête des réalisateurs de la nouvelle vague. Pour deux films à succès, Godard a fait une floppée de bides, alors même qu'il faisait partie de toute une équipe qui passait son temps à étudier le cinéma américain pour....l'imiter. Voire les Cahiers du Cinéma des années cinquante et soixante. Non, non, le cinéma, «ça marche» ou ça ne marche pas : pour réaliser les conditions décrites par Benjamin ou Brecht dans leurs analyses du cinéma, il faut qu'il «marche», c'est à dire qu'il soit capable de réaliser la fonction aristotélicienne de Catharsis. Un film doit être capable de se rendre maître de la centrale émotionnelle des spectateurs et de les absorber dans sa dramaturgie au point qu'ils sont emportés et qu'ils recrachent pour ainsi dire les sentiments qui sont inscrits dans le scénario. Ici on pleure. Là on rit. Si cela ne marche pas, le film est raté, exactement comme pour un vulgaire roman.
D'où l'intérêt de se demander pourquoi le cinéma américain marche et pourquoi le nôtre n'arrive pas à sa cheville (ou presque). C'est pourtant pas si difficile à comprendre : c'est tout simplement parce que l'esprit ne souffle plus dans nos productions, parce que l'intellectuel, ou disons à la manière kantienne l'entendemental, a pris la place du spirituel. L'intellectuel ne peut pas «religere», il ne peut pas unir des hommes dont l'entendement n'est pas exercé de manière homogène, uniforme. Si nous étions tous - six milliards d'êtres humains ! - agrégés de philosophie (et de préférance hégélienne), alors le cinéma américain n'aurait aucune chance commerciale dans le monde entier. Serait alors venu le temps des Godards et des Louis Malle. Nous en sommes loin, très loin. Pour l'instant l'esprit du temps, le Zeitgeist de Hegel patauge encore bien loin de la propre philosophie de son inventeur.
Cela dit, il est trop facile de mettre tout cela sur le compte de l'analphabétisme des citoyens des Etats-Unis, puisque par ailleurs il faut bien constater que leurs produits dominent notre propre marché (de 80% de bacheliers !). Mon propre philosophe de fils ne crache ni sur les production de Hollywood ni sur les MacDo, et pourtant qu'est-ce-qu'il en sait des choses !
Donc, il faut se poser la question autrement. Le cinéma américain, c'est le cinéma en tant que tel, c'est du moins ce qu'on dit et répété tous les Truffaut, Godard et autre Chabrol. C'est le cinéma américain - plus quelques russes et quelques japonais - qui ont ont donné son titre de Septième Art au cinématographe, longtemps considéré comme un simple passe-temps. Il est curieux d'ailleurs que ce soit l'autre fonction de l'art, la propagande politique, qui ait poussé à la roue de cette définition : Eisenstein a longtemps occupé la première place dans la liste des chefs d'oeuvres du cinéma mondial avec le Potemkine, chef d'oeuvre de propagande politique ! Alors, quelque chose a-t-il fondamentalement changé dans ce cinéma consacré cinéma Number One ? Tellement changé qu'on doive lui retirer brutalement cette consécration au nom d'un danger qui menacerait notre propre production ? Holà ! doucement, d'abord le cinéma est américain, même si ses inventeurs sont européens et même si l'Europe a donné le jour à un tas de metteurs en scène de grand talent - qui sont tous allés travailler à Hollywood, du moins ceux qui ont pu le faire. Il est américain parce que ce sont les Américains qui lui ont donné sa dimension pratique mondiale : lorsque Hollywood produit des films en 1930, ces films sont immédiatement assimilables et visionnables par la planète toute entière. Regardez si on peut dire la même chose du cinéma français. Boudu sauvé des Eaux n'est pas exportable, excusez moi, ni même Jeux Interdits. Pourquoi ? Sans doute parce que l'esprit avait déjà quitté le langage : l'esprit parle Anglais, qu'on le veuille ou non, et ce n'est pas parce que ce sont les Américains qui dominent stratégiquement le monde qu'on parle leur langue, mais c'est parce qu'on parle leur langue qu'ils dominent le monde. D'où cette inférence : on n'aurait pas pu concevoir Jeux Interdits dans la langue anglaise, encore moins Boudu sauvé des Eaux.
Mais que signifie exactement parler Anglais ? En très bref, cela signifie parler la langue du réel. Et qu'est-ce-que le réel ? Le réel c'est ce qui reste lorsque l'Amérique a sauvé par deux fois le monde entier de la destruction et, en passant, de la barbarie. C'est bien la langue anglaise que pratiquaient ceux qui sont venus risquer leur peau sur nos plages pour en finir avec le grand bouffon germanophone. Les Allemands, soit dit en passant, en sont plus conscients que nous, car eux ne boudent pas l'Anglais et sa culture comme nous semblons le faire. Je dis «semblons», car les films américains continuent de faire un tabac sur notre propre marché, ce «semblons» est bien une semblance, une pure apparence, une représentation fomentée par quelques uns dans un but bien défini. Lequel ? La concurrence, tout simplement, ce principe tellement honni chez nous, tellement villipendé par les média qu'il en est purement américain, comme les Mac Do et les films de Spielberg. Nos critiques sont dupes du principe qu'en public ils vomissent comme l'un des traits de caractère dominants des Américains. Pour auver la peau de nos artistes, tous les moyens sont bons, y compris la connerie. Mais dans ce secteur dit de la culture, il ne sera certainement pas sans conséquences d'utiliser la connerie, ou alors il faudra redéfinir la culture.
Mais le plus grave dans cette affaire, c'est que cette connerie prend des allures xénophobes, elle est xénophobe. Pas de doute là-dessus.
La langue a partie liée avec l'histoire, qui voudrait contester cela ? Les deux victoires qui nous ont sortis de la merde sont anglaises, comme la Révolution qui a imposé la Démocratie Républicaine était française. Si seulement les républicains français voulaient le reconnaître au lieu de peaufiner leurs conneries de représentations sur la spécificité de la République haxagonale ! L'Esprit, c'est la vie + la civilisation. Non ? Or qui a failli en 1914 et en 1940 lorsqu'il était menacé d'anéantissement ? C'est nous, les Européens qui nous sommes comportés comme des irresponsables face au cauchemar qui nous attendait. Nous avons baissé la garde de l'Esprit, la garde de l'Etre tout court, bon dieu, pour nous laisser aveugler en 14 par l'appât du gain, en 40 par notre lâcheté et notre concupiscence à l'égard des barbares. Oui, j'ose rappeler que le général Weygan avait plus de respect pour l'armée nazi que pour la sienne propre, plus de goût à servir l'ennemi qu'à combattre la barbarie. Peut-on croire que la réalité culturelle issue de tous ces renoncements puisse se hausser au niveau de celle du peuple qui a tout mis en oeuvre pour sauver le monde libre ?
Il faut cesser, et cela je me le dis à moi-même, de tisser des kilomètres de mensonges sur les intentions impérialistes des Américains et sur le machiavélisme fondamental de toute leur action au cours de ce siècle. Ou alors, ou alors il faut très vite changer de discours sur Hitler, sur la Démocratie, sur la Barbarie nazie, sur Staline et le totalitarisme etc, etc... Tout est discours, ne l'oublions pas. Et parce que tout est discours, il y a ceux qui marchent et il y a ceux qui ne marchent pas. Depuis 1914, une chose a changé : à cette époque le discours était monopolisé par quelques-uns, les peuples étaient tantôt pacifistes, tantôt le contraire, selon le bon vouloir des pouvoirs. Aujourd'hui, le discours s'est diffusé, malgré toutes les précautions des pouvoirs, dans les peuples, les peuples ont appris à parler, et ce qui se passe, c'est qu'ils comprennent mieux l'Anglais que l'Européen.
Cela ne signifie pas - j'imagine ce qui m'attend lorsqu'on aura bien découpé ce que je dis ici - cela ne signifie pas que l'Anglais véhicule quelques chose comme la vérité ou le Bien. Certainement pas, pas plus qu'une autre langue. Cela ne signifie modestement qu'une chose, c'est qu'elle est plus crédible, elle donne un bien plus grand sentiment de sécurité. Et d'ailleurs les thèmes du cinéma américain sont bien choisis pour faire durer leur victoire sur les champs de bataille européens ou du Pacifique, ils traitent presqu'exclusivement du salut des hommes et du monde et du courage qu'il faut pour le garantir. Un film comme «Independance day» serait infaisable en France, ou alors il faudrait en faire une comédie, car le monde entier rirait de notre volonté d'imiter les Américains. L'Anglais est plus crédible parce qu'il fonde le monde survivant et survivant libre, aussi bien du nazisme que du stalinisme, ne l'oublions pas non plus.
Assez sur ce thème. Nous y reviendrons un autre jour.
Vendredi, 16 octobre 1999
Etrange. Jeudi matin le Monde publie une discours tenu par le brave Bourdieu devant un parterre de personnalités du monde du spectacle, PDG et autres techniciens de haut vol des médias. Evidemment, le sujet c'est l'exception culturelle, et pour vous donner une preuve de la justesse de mes propres réflexions que je vous ai livrées mardi dernier, quelques heures avant que le grand sociologue ne prononce ce discours, je vous cite un passage : « Il s'agit en fait d'une lutte entre une puissance commerciale visant à étendre à l'univers les intérêts particuliers du commerce et de ceux qui le dominent et une résistance culturelle, fondée sur la défense des oeuvres universelles produites par l'internationale dénationalisée des créateurs». C'est donc bien de concurrence qu'il s'agit ! Le monde du commerce serait en concurrence avec le monde des créateurs ! Ce n'est rien moins qu'une Apocalypse que nous annonce Bourdieu. Comment cet homme si intelligent est-il tombé dans un tel manichéisme ? Comment peut-on sérieusement se permettre de désarticuler à ce point la Praxis sociale, de la réduire à une concurrence entre le mal - le commerce - et le bien - la culture ? C'est parfaitement ridicule et d'une pauvreté étonnante pour un analyste aussi fin de la réalité humaine. Comme quoi les choix militants nous mènent souvent dans des impasses que l'on est tôt ou tard condamné à regretter amèrement, et je suis sûr que ce sera le cas pour Bourdieu. Son raisonnement global me semble tout aussi invraisemblable : en gros il affirme que les créateurs auraient des sortes de droits acquis depuis le Quattrocento, une sorte d'indépendance par rapport au commerce estampillée par la République. Quelle absurdité ! Comment peut-on oublier la place du créateur à ce point ? Le créateur - je déteste ce mot - est celui qui crée, c'est à dire qui fait changer le réel, le modifie dans son essence, descend dans ses profondeurs pour opérer les mutations vivantes de l'histoire. Il n'est pas un artisan qui tire quelques privilèges de ses talents, posté dans une transcendance ou une altérité mystérieuse par rapport aux autres mouvements (ou moments) du monde. Ce n'est par parce que la création en vient à s'opposer au principe même du commerce qu'il s'engage dans une croisade nouvelle contre le commerce réel : c'est au principe commercial que la culture contemporaine s'attaque, pas au commerce. Et ce, autant dans la culture des Américains que dans la nôtre, observons calmement les productions de ces «épiciers» US, et nous verrons que ce message (un peu ringard) de la lutte pour une désaliénation fantasmatique est encore bien plus fort dans les superproductions US que dans les productions européennes. D'ailleurs ce n'est pas un hasard si c'est le traitement précis de cette question qui permet, ces dernières semaines, au cinéma européen (belge), de sortir de sa médiocrité grâce à des films enfin assez violents, assez insolents et cyniques pour ressembler de plus en plus à ce qui se produit à Hollywood. On en est enfin arrivé à l'imitation directe de ce cinéma, et c'est à la fois tant mieux, et à la fois inquiétant, car on en arrive à copier cela même qu'on critique si radicalement. Alors quoi ?
Alors il faut enfin reconnaître que nos intellectuels n'arrivent pas à se résoudre à reconnaître la liberté des masses, leur liberté de faire des choix aussi légitimes que les leurs, des choix qui ne sont pas forcément des réussites parce qu'ils ne visent pas forcément la réussite, mais souvent des buts tout à fait différents. Si Bourdieu va au cinéma à chaque fois en vue d'une sorte de réussite culturelle, d'une messe intellectuelle positive d'où il sort avec un sentiment d'enrichissement etc..., qu'il se garde de penser que les choix des gens recoupent ou doivent recouper cet instinct de la recherche du Bien philosophique : tout simplement parce qu'ils vivent autre chose que Bourdieu, une autre vie différemment intégrée au réel, réglée par d'autres paramètres existentiels. Les «gens» reçoivent leur spiritualité d'où ils peuvent, y compris monsieur Bourdieu, et elle ne les conduit pas toujours forcément à la vérité, car cette quête est elle-même partie intégrante des questions suspectes. Rien à voir avec le sublîme, cher Bourdieu, le sublîme est un événement, et non pas un programme culturel. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis toujours senti proche des vieux réacs qui feraillent contre le mécénat public. Le jour où l'état aura monopolisé le destin des créateurs, c'en sera fini de la création, on a vécu cela sans réserve et sans ambiguité dans l'ancienne Russie soviétique.
La véritable question, en fait, n'est pas celle-là, la véritable question est de savoir comment la moralité peut continuer de croître dans notre société. Il est trop facile d'attribuer ce rôle à n'importe quelle forme de la culture alors que la réponse se situe sans ambiguité dans le rôle et la réalisation de l'école. C'est à l'enseignement, c'est à dire à l'étude et à l'exercice offerts et imposés par la République que l'on doit la formation des personnes, des personnes libres et conscientes. Et non pas de la consommation de biens culturels. Cette consommation est bien plutôt la résultante de cette formation citoyenne, et si cette formation est compétitive, alors il n'y a plus rien à craindre du marché. Malheureusement, et là je ne peux que donner raison à Bourdieu, ce que menace le marché par une pression constante, c'est l'outil de cette formation, c'est l'enseignement lui-même et la liberté des citoyens par rapport à la qualité de cet enseignement. Mais dans ce domaine, c'est à la République, à l'état républicain de faire des choix clairs et de mener la lutte contre les tendances impérialistes du marché. Mais n'oublions pas que cet état, c'est nous. Là aussi, pas question de pleurer dans les juppes d'une entité transcendante inconnue, il faut se taire et agir.
Samedi, le 16 octobre 1999
Question A : comment faire pour éliminer ou limiter la violence de la jeunesse dans les cités ?
Ca tombe bien. Hier j'ai loué une K7 vidéo d'une remarquable film américain (tiens tiens !) qui porte le titre de «Sleepers». Intraduisible, ça peut aussi bien vouloir dire «Les Dormeurs» que les «wagons-lit», ou peut-être même les «somnifères» en américain. Le scénario est simple, il s'agit d'une sorte de reportage sur la vie d'un quarteron de jeunes new-yorkais d'un quartier pauvre, de la génération des années 50-60, monde à cheval entre l'Amérique des années trente avec ses truands devenus des vieillards et celle de Silicone Valley, l'époque où tous les Bronx et autre quartiers pauvres sont définitivement devenus les zones des noirs, de quelques latinos et surtout de la drogue et du rap. Quatre jeunes gens dont l'existence se partage curieusement entre l'apprentissage du gangstérisme et l'église catholique, dont l'auteur du film, qui pratique beaucoup le commentaire du style documentaire, nous fait savoir qu'elle joue un rôle important encore dans ces quartiers d'origine irlandaise, italienne et autre. Bref, ces jeunes gens s'entraînent eux -mêmes dans une farce tragique qui se termine par une condamnation pour tous les quatre à un an de prison pour jeunes. Et là commence leur destin : viol, torture et humiliation absolue par une équipe de gardiens sadiques et pédophiles. Le film, récit pris dans l'âge adulte de ces gosses, raconte en fait l'histoire de la vengeance de ces enfants, qui a lieu par hasard, alors que deux d'entre-eux sont devenus des petits voyous, tueurs à l'occasion, qui rencontrent dans un bar le meneur de l'équipe de gardiens et le tuent froidement. Scène extraordinaire, peut-être une des plus frappantes que j'ai pu voir, car je peux affirmer que le geste de vengeance est totalement partagé par le spectateur, il devient complice immédiat en regardant cette scène hallucinante. La suite confirme cette unanimité morale, car toute l'action du film s'organise autour d'un procès, organisé par les deux autres garçons du groupe, bien décidés à sauver leur copains de la chaise électrique. Et ça marche, grâce à la solidarité du quartier - y compris celle d'un ancien gangster tueur au grand coeur - et surtout au témoignage du curé du quartier qui se résout à faire un faux-témoignage, il souscrit à cette vengeance collective. Le film se termine en montrant que cela ne change rien dans la vie des deux jeunes truands qui meurent assassinés quelques années plus tard, après la grande fête de la vengeance réussie, car en même temps qu'ils sont blanchis devant la justice, ils réussissent à faire châtier les autres gardiens complices des sévices qu'ils ont endurés pendant un an dans cette prison.
Tout tourne évidemment ici autour du drame du faux-témoignage du prêtre catholique : l'église est sommée de choisir entre le mal qui règne dans les centres de détention et le commandement qui interdit le mensonge. En Amérique l'église est capable de remettre en cause le dogme pour rétablir la justice que les institutions ne sont pas capables de rendre. Le spirituel se sâlit les mains, compte-tenu de la gravité de la faute et du dénuement des hommes qui en sont les victimes. Sans en avoir la preuve, je suis sûr que ce film est à l'index. Impossible d'admettre que le Vatican a laissé passer un tel sacrilège sans alerter tous les diocèses du monde entier pour condamner ce scénario. Mais ce genre de chose n'est que rarement connu du bon peuple, sauf dans la phase où parfois l'église fait un scandale qui en général tourne en faveur de l'oeuvre grâce à la publicité qu'elle lui offre. En fait, ce film est destiné à l'évidence à redorer le rôle du curé de quartier, à rendre à l'église le plein exercice de son emprise sur les âmes simples. Vieille histoire de la comédie des prêtres-ouvriers en pseudo rupture de ban avec Rome, mais dont l'action catéchistique est bien plus pernicieuse que celle des curés orthodoxes. Dans l'un des numéro de l'Internationale Situationniste, il est question d'un jeune qui tue un tel curé venu à son aide, et guy Debord ne manque pas de l'en chaudement féliciter. Ce jeune a compris où se situait la véritable trahison, la trahison spirituelle. Le curé de Brooklyn trahit d'abord la Loi et ses institutions : il confirme l'impuissance des hommes à rendre la justice, confirmant paradoxalement que seul l'être théologique, le prêtre, peut assurer cette justice au bout du compte. En fait, il fait une OPA sur la justice en vue de gagner de l'emprise sociale et d'assurer ainsi le pouvoir de son église, voire sa simple survie. D'ailleurs la grande et inacceptable ambiguité du film, exactement comme dans «Sur les Quais» d'Elia Kazan, c'est le subreptice blanchiement des âmes des jeunes voyous : du début à la fin du film, on nous montre des braves jeunes-gens, dont on n'arrive pas à penser et à admettre que ce sont simplement des délinquants qui deviennent logiquement au bout du processus, des tueurs. Bien sûr, on suggère en plus que c'est le séjour dans la prison qui a imprimé, au moins pour deux d'entre-eux, sa marque d'infamie et les a conduit à devenir de véritables bandits. Ces êtres sont de purs êtres expérimentaux chez lesquels l'auteur du film ne laisse jamais entrevoir la moinde culpabilité réelle, on a toujours l'impression que ces gosses ne sont finalement que des victimes.
Ce n'est pas entièrement faux, et il faut rendre hommage à la lucidité américaine : la délinquance est un phénomène lié d'abord à la jeunesse. Le crime est «laïque» au sens où dans sa phase initiale il n'est jamais lié à des intentions méchantes, mais toujours à une révolte. Révolte contre l'injustice que chaque jeune peut spontanément constater autour de lui, révolte contre l'ennui que le monde lui sert sur un plateau, surtout mais pas forcément à cause de cela, si la pauvreté vient pimenter ce sentiment de dérive et de vide, et révolte
contre lui-même, contre la puissance et la violence de ses propres instincts et pulsions. L'homme jeune vit le monde intensément. Son aperception des valeurs est bien plus forte que celle de l'homme adulte, qui est déjà passé par les médiations des conséquences de ses actes. Il existe une technique, dans les collèges de Jésuites, qui consiste à créer des situations artificielles d'injustice personnelle, afin de débusquer les natures fortes pour les briser, ou bien pour provoquer des catharsis artificielles, des médiations ou des règlements de conflits tels que le jeune collégien aura plus tard à les régler lui-même quand il sera devenu l'un des cadres de la société. Le but c'est justement de faire comprendre à terme à l'individu que le monde est imparfait par nature, et qu'il faut accepter l'injustice comme constituante structurelle du monde, et non pas comme accident. Si les Jésuites ont été ici et là persécutés par les pouvoirs temporels, c'est à cause de cet ammoralité fondamentale, fondée sur une philosophie politique proprement machiavélique. Le mal n'est pas conjoncturel, il est le tissu même de la réalité, et par conséquent même le simple fait de vivre est déjà un crime passible de châtiment : en fait vivre est en soi un châtiment.
Une telle vérité s'imprime dans l'esprit de l'homme faible et le forme à l'exercice des fonctions de direction et de répression : il devient d'un réalisme totalement cynique et sans espoir de salut autre que dans l'outre-monde du dieu catholique et romain. Dans le film de Chatiliez «La vie est un long fleuve tranquille» tout cela est remarquablement mis en scène, et l'on peut constater la naïveté cruelle et obectivement cynique du bourgeois catholique, élevé chez les Jésuites sans doute, qui pense que son argent peut tout acheter, même un enfant, et que la morale et la charité n'ont rien à voir avec la légitimité de la naissance ou la souffrance d'une mère qui se voit séparé de l'enfant qu'elle a élevé comme son propre fils.
Le problème central des enfants des cités, c'est précisément l'école qui les accueille. La société a déjà compris qu'il fallait adapter l'enseignement dans ces écoles «chaudes», mais cette adaptation se fait toujours négativement, c'est à dire au bénéfice des professeurs qui doivent être déchargés d'horaires et de classes surchargés pour pouvoir mieux se consacrer à la pratique de la même pédagogie. Les classes allégées, c'est comme les aliments allégés, on pose le problème en termes de quantité sans chercher à comprendre les racines qualitatives du drame que vivent ces enfants. Avant les réformes des trois dernières décennies, ces jeunes étaient autoritairement orientés vers l'usine dès l'âge de quatorze ans. Dans le milieu du travail, ils trouvaient tout d'un coup ce qui leur manquait le plus dans leurs familles, c'est à dire une cohérence affective. Paradoxalement l'usine était la première famille pour ces jeunes, exactement comme la prison devient la première famille réelle pour la plupart des délinquants qui en font l'expérience une première fois. L'usine est une initiation bien plus profonde et plus réelle que les familles fragiles et la plupart du temps délabrés de ces enfants. La mine est l'exemple le plus pur d'une famille de travail qui agrège absolument ceux qui y sont condamnés et qui devient un lieu sacré où se réalise peut-être le mieux le destin du prolétaire. Cohérence sémantique et concrète entre un destin voué à la souffrance et cette souffrance vécue heure après heure, destin qui circule entre une damnation immédiate de la douleur et de la peur et l'eschatologie du retour quotidien à la lumière du jour et de la retraite à cinquante ans, même si alors, le corps ne pourra plus jamais assurer la jouissance pleine et entière de la vie qu'on fantasme tout au long de cette épreuve.
Jeudi, le 21 octobre 1999
On ne peut être sûr que de ce qu'on pense. Etre sûr signifiant ici faire confiance, donner crédit. Je n'ai pas de raison fondamentale de transiger avec ce que je pense.
Vendredi, le 29 octobre 1999
La finalité de ma vie : élever ma mort au niveau du rêve. Travailler le rêve comme la pierre ou l'acier, et mourir sur son arête. Mais comment accomplir cela seul ?
Dimanche, le 31 octobre 1999
Parlons clair. Serait-il intéressant que l'on apprenne un jour quelque chose de concret sur moi, ma vie, mes rêves, souffrances, et tout le reste ? Pourquoi ? Question corollaire : suis-je en mesure de dire quelque chose sur tout ça ?
En ce moment mon destin, disons plus modestement ma place dans le monde, est en pleine mutation. Je me suis séparé de ma compagne - nous nous sommes séparés - et je vais sans doute me séparer d'Arte. Je vais donc me retrouver contraint à une révolution copernicienne personnelle. D'abord vivre seul. Trouver des resources matérielles et morales pour continuer. Il ne me reste presque rien de mon passé : «l'homme naît plusieurs et meurt seul». La mort en effet rode autour de moi. Cela veut dire qu'elle ne cesse de se thématiser, qu'elle s'étend comme de l'huile sur le présent, prenant de plus en plus de place. Difficile alors de lutter. J'ai marqué un point en allant sur la tombe de mes parents, belle journée calme, ils ont été très gentils, couchés devant moi, perpendiculaires. La tombe n'était pas trop sale, elle pourrait me convenir.
Pourquoi tout ça ? Pourquoi toute cette soudaine solitude ? Aurais-je trop donné à Myriam, qu'il ne me reste rien ? Elle m'accuse d'avoir ourdi cette séparation, mais elle sait que ce n'est pas vrai, surtout que ce n'est pas aussi simple. Hier je lui ai dit que nous étions pour ainsi dire tombés l'un de l'autre, comme une feuille de l'arbre. Mais qui est l'arbre et qui la feuille ?
Lundi, 1er novembre 1999
Toujours la mort. Mon corps me paraît tellement fatigué. Serait-ce cette fatigue qui me débranche pour ainsi dire de la société des hommes ? Animal fatigué, arrivé dans le coin de l'enclos parce qu'il n'arrive plus jusqu'à l'auge du troupeau ?
Ce matin, je me suis demandé ce que finalement j'attendais avec tant de passion de la réalité. Réponse : je crains de ne plus le savoir, de l'avoir oublié, abandonné quelque part dans toute cette violence. Pourquoi les hommes cachent-ils cette violence avec tant de talent ? Cette guerre sanglante dont on croit trop facilement qu'elle ne se livre que sur des champs de bataille avec des fusils et des canons ?
Mais encore : m'éblouir du réel, voilà sans doute ce que j'ai toujours cherché, comme un papillon de nuit j'ai toujours couru en direction de la lumière, toutes les lumières, quitte à me brûler les ailes du corps et de l'esprit. Or, depuis quelques temps il s'est glissé une sorte de verre dépoli entre la réalité et moi, les choses m'apparaissent dans un trouble qui m'en tient à distance. Serais-je déjà en cendres, une partie de moi est-elle morte ? Il faudra pourtant que je recouvre toute ma santé spirituelle, je ne peux pas m'imaginer mourir ainsi dans la fumée d'une réalité qui se camoufle. Psy, je compte sur vous.
Mardi, le 2 novembre 1999
Plus j'y pense, plus je me rends compte qu'il le sera très difficile voire impossible de retourner travailler à Arte. Mes relations morales avec les êtres humains qui composent la rédaction sont définitivement pourries. Mes supérieurs se sont blâmés par des mensonges machiavéliques, mes collègues journalistes sont de tels lâches que je ne vois pas comment je pourrais à nouveau les regarder en face. Depuis trois semaines que je suis scotché dans mon trou, aucun d'entre-eux ne s'est manifesté : 1996 bis repetita, mais deux fois, c'est une fois de trop. C'est plus qu'une simple trahison, c'est une nouvelle tonalité de ce qui constitue mes relations avec les autres. Je dois comprendre que quelque chose est devenu radicalement impossible. Il est vrai que je sentais cela depuis longtemps par cette espèce de surdité de mon entourage, cette crainte de comprendre ce que je dis. Mais ça c'est un phénomène ancien, ici il s'agit de manque de solidarité minimale, simplement humaine : même si j'avais tort, et peut-être est-ce le cas, pourquoi pas, cet ostracisme effrayant ne se justifie aucunement. Jamais je n'ai été anéanti dans le réel de cette manière. Que dire des autres amis ? Seul Théo s'est montré à la hauteur et je lui en saurai gré, c'est le symptôme d'un retour d'une époque, celle de la lutte révolutionnaire. Allons-nous commencer cela à deux ? Pourquoi pas ? Maintenant que Debord est passé dans la marchandisation, il n'y a plus d'obstacle à la naissance d'une autre vision, moins manichéenne des enjeux. Au fond, la séparation d'avec une certaine société pourrait s'avérer être le début de la naissance d'une autre forme d'être ensemble ou de cesser de l'être. Théo a très bien vu le danger totalitaire du «social», il est donc urgent de voir comment le poïétique individuel peut percer dans ce contexte stalinien.
Samedi, le 6 novembre 1999
Incroyable, les intellos de France-Culture ont fini par se rendre compte que la Guerre des Etoiles n'était qu'un tissu de mythes qui vont de Gilgamesh à la Vierge Marie ! Vingt ans pour une découverte aussi pauvre ! Et ils ne se rendent même pas compte que la fameuse force - et l'analyse qui en est faite - n'est rien d'autre que l'energeia d'Aristote. Lucas est encore moins débile que ces messieurs ne croient. La force d'Aristote, et lorsqu'on a comprend cela on a à peu près tout compris (seulement compris, attention, pas de triomphalisme), est la fiction fondatrice de notre aperception de la réalité, c'est le décor planté par la pensée grecque tardive et qui a faussé d'une manière assez perverse le message fondamental de l'UN parménidien. Car la force est par essence double, elle ne peut que circuler (la circulation est devenue le mouvement même de notre temps) entre le plus et le moins, entre le bien et le mal. La force a également besoin d'une source et d'une «pile» : Dieu et les démons, voilà ce que Milton a si bien senti et contre quoi il a tenté de se rebeller. La force c'est évidemment aussi le mouvement, et donc.... le temps ! Et pas le contraire comme on le pense, ce n'est pas le temps qui génère le mouvement, c'est l'idée de mouvement qui invente le temps. Dans l'immobilité de Parménide, il n'y a pas de temps et le paradoxe de Zénon est tout simplement aussi vrai que son contraire.
Alors, que vient faire Lucas ? Tout simplement renforcer le mythe de la force, la binarité essentielle de la réalité (comme celle de l'informatique qui pourra s'avérer un jour aussi fausse que les clepsydres par rapport aux horloges atomiques), cette matrice primitive du monde aussi primitive que les mythes les plus anciens. Ce sont des toiles de fond, des décors de l'univers qui forment toujours la structure des scénarii qui permettent à la conscience de se supporter. La force est un jeu, comme un autre, mais il n'y a là rien de neuf et encore beaucoup de religieux, c'est tellement facile.
Ma force, elle, fout le camp. Or, même en moi je sens que cette histoire de force est une blague. Ses flux se présentent selon une telle discontinuité qu'il est impossible de la localiser ou de la mesurer. Si le sport a un tel succès, c'est parce que le jeu y est premier, et non pas la force accumulée : le sport c'est le doigt de dieu au moment de l'épreuve, c'est la présence du bon flux - et tout cela est fictif - au bon moment. Pourquoi le dopage tient-il une telle place dans la pratique du sport ? Parce qu'il y a un doute sur la force et non pas parce que les substances chimiques y changent quoi que ce soit : les médicaments ne donnent pas de force supplémentaires, ils se concentrent sur la résistance du sujet, curieux ! Le sujet doit résister à sa propre force ! La garantie du succès est dans l'immobilité, la résistance du corps ! Ca représente aussi, dans notre idéologie, le faux ou le mal, parce que le Bien ce n'est que le mouvement ou la Force mythique.
Alors ? Je me souviens d'un moment critique de ma vie. Un radiologue m'avait injecté un opacifiant dans la colonne vertébrale et installé sur sa machine à bascule, et tout d'un coup j'ai vu ma dernière heure arriver. Des photos de toute ma vie défilaient à toute vitesse et j'ai tout revu depuis le début, une anamnèse totale mais incroyablement effrayante car elle contenait la mort. Que croyez-vous que j'ai fait à ce moment-là ? J'ai eu le reflexe qui sauve, je me suis pour ainsi dire annulé en force, immobilisé totalement, essentiellement, en me disant très clairement : «laisse passer la mort, et reste là». Résultat je suis encore là. Le médecin m'a simplement dit, quelques heures plus tard, j'ai quand même fait les clichés, de toute façon vous étiez en place et vous aviez une chance de vous en tirer...Il a appelé ça un choc clonique ! Clône de quoi ? Cette histoire raconte l'ambivalence présente dans l'histoire de la force-non-force du Jeddai, et que Lucas utilise à merveille, se servant donc d'un peu de vérité pour donner cohérence à son sujet.
La force est un concept, rien d'autre, le derrière de l'être, comme on dit la face cachée de la Lune, dark vador, sombre père des choses, conte à dormir debout, ce que font très précisément les êtres humains dans leur très grande majorité : bonne nuit !
Dimanche, le 7 novembre 1999
Il faut vivre sa mort et mourir sa vie ! Voilà ce que l'on entend chez les chrétiens orthodoxes du dimanche matin ! Autrement dit, il ne faut surtout pas vivre. Voilà une racine bien cachée du conflit des Balkans, cette sorte de guerre civile mêlée de djihad : les chrétiens orthodoxes méprisent la vie et l'avouent hautement, rappelant que cette doctrine mortifère est l'origine même du Christianisme : Grecs et Romains étaient fatigués de la vie, je crois que Nietzsche dit aussi cela quelque part à propos de la naissance du Christianisme. La première caractéristique de cette secte a été d'offrir à le jeunesse romaine une occasion d'ascèse et de mortification. Au premier siècle l'Egypte et le Sinaï étaient couverts de lieux saints où des anachorètes se massacraient gaiement et, signe des millénaires qui allaient suivre et surtout de notre époque, se livraient en spectacle, provoquant déjà une espèce de tourisme religieux pour les foules habituées aux horreurs du cirque. Au fond, les Romains ont tourné leur regard de voyeur sadique vers eux-mêmes, s'ennuyant de ne voir souffrir que les animaux ou les barbares, ce qui était pareil. Christianisme = reflexe sado-maso, une fois pour toute. Voir tout ça dans Gibbon qui n'est pas tendre pour certains Pères de notre église !!
Cela dit, l'anachorèse, ça me connait. Monachisme naturel, souffrance permanente, familiarité totale de la douleur. Mon psy - car voilà que j'ai un psy - va croire que je me prends pour Jésus, ah ah ! Or, les anachorètes orthodoxes n'ont pas tout à fait tort, il est très vrai que «vivre sa mort et mourir sa vie» peut devenir très juteux en termes de résultats ontologiques. Silence, solitude, douleur du corps, anéantissement du désir et du besoin, tout ça n'est qu'une opération spéculative dans la bourse du destin, prise d'intérêt anticipatifs sur l'au-delà. Ce qu'on pourrait considérer comme une farce, si cet au-delà n'était pas le centre du souci humain. Mourir sa vie, au fond nous le faisons tous, mais en différé, comme on dirait à la télé. Le direct est beaucoup plus intéressant et c'est ce qu'éspèrent les moines : mourir SANS mourir, vivre sa mort A REPETITION. Pas con, n'est-ce-pas ? Car, ainsi l'on
se rend familier du grand saut.
Mais ce n'est pas le seul bénéfice. L'abrasion de la lettre, car c'est de cela qu'il s'agit - le moine lime les formes de la vie, les lettres de l'alphabet - annule les différences. C'est comme lorsqu'on veut coller la plèvre au poumon, on gratte les deux surfaces pour augmenter l'espace et faciliter l'emmêlement des deux éléments. Le monachisme, c'est ça : il faut défigurer l'homme qu'on est, le rendre méconnaissable et identique à la nature chaotique en vue du grand mariage, de la grande fusion. L'anachorète se transforme vivant en charpie mélangée au sable et à la cendre du monde, il est déjà dans sa tombe, mais vivant. Et là, il est vrai qu'il se passe quelque chose, de cette manière, l'effort vers l'être ça marche. Secret de la survie des religions en nos siècles scientifiques.
JM m'a posé une question hier soir : peut-on transmettre une chose sans la comprendre ? Mais mon cher, les religions ne font que ça depuis quatre mille ans ! Comprendre est une affaire de vilain, c'est vrai, mais l'homme est d'abord un vilain, et il a autant besoin de comprendre que de manger. Les doctrines religieuses ressemblent un peu à des grimoires où la vérité doit disparaître et non pas se conserver. Sinon on se ferait chier, n'est-ce-pas ? Maître Ekhart avait bien compris, lui, qu'il fallait comprendre afin de cesser d'avoir besoin de comprendre, exactement comme nos moines du Sinaï ou de Pathmos. L'un de mes vieux rêves, aller vivre au Mont Athos, heureusement que d'autres y sont déjà allés avant moi, ça m'en préserve...
___________________________________
Ecrivons. En reprenant la vieille question de Lénine : Que Faire ?
Tout indique que je suis dans une situation nouvelle. Un tournant, dit-on. Première chose à faire donc, le bilan. Il faut réduire à la cuisson intellectuelle les quelques vingt-cinq années passées pour en retenir ce qui peut résister, puisque le reste est déjà mort. Dur, heureusement que le traitement de texte permet de tout effacer.
Donc, vingt-cinq ans, j'ai coutume de dire, entre femmes et enfants. Tout ça a commencé en 1975 à San Francisco, autre tournant de cette existence. A ce moment-là j'ai accompli ce qui m'avait toujours paru naturel, naturel signifie ici quelque chose comme «réaliste», conforme à l'être de l'étant, c'est à dire ce à quoi on ne peut pas se soustraire sans risquer une sorte d'infirmité ou d'incomplétude : faire des enfants. Pourquoi pensais-je ainsi, alors que la plupart de mes amis pensaient tout à fait le contraire et me raillaient copieusement de ma volonté mainte fois exprimée d'en arriver là. Si je m'en réfère aux amis de ma génération, il n'y en a pas beaucoup, mon désir ne paraît pas «générationnel», ils sont presque tous célibataires ou vivent en concubinage, mais sans enfants. En y regardant de très près, il n'y a qu'un seul de ces vieux amis qui m'ait imité, Daniel, un homme qui a joué un grand rôle dans ma vie intellectuelle et affective, il l'a pour ainsi dire mise en route, fait démarrer, ce n'est pas rien. Mais Daniel - je ne sais pas s'il vit encore - est un homme fragile, beaucoup d'esprit sur un destin branlant et un corps absent. Je ne sais rien de ses enfants, de ses rapports avec eux et du reste, tout ce que je peux dire c'est que ça ne m'étonne pas qu'il en ait eus. Il a, d'ailleurs vécu la même galère que moi, divorce etc...Il était aussi le premier ami. Voilà, malgré tout, une réduction à une certaine origine. Il n'est d'ailleurs pas le seul, Jean-Louis aussi a eu des enfants, de deux femmes même paraît-il. Nous sommes tous les trois de 1941, nous avons tous les trois fréquenté la même onzième au petit-Lycée de Mulhouse. Trois destins familiaux catastrophiques, mais bien existant, avec la totale des petites-enfances, des adolescences et de cette entrée en douce dans l'âge adulte, concept inepte.
Que retenir de tout cela ? Qu'on ne parle pas beaucoup des femmes ? Certes, je reconnais assez crapuleusement que la femme qui m'a donné des enfants ne comptait, a priori, pas autant qu'eux. Peu avant de l'épouser j'avais quitté une autre femme qui s'était toujours refusée à m'en donner, et pourtant c'est la seule que je connaisse qui aurait pu faire une vie avec moi, question de courage prolétaire. Obscur désir que celui d' «avoir» des enfants ! Une idée qui ne se manifeste presque jamais, mais qui lancine et perce brutalement lorsque l'occasion se présente ou que se tourne une page.
Où en étais-je alors ? Quelle vie ais-je abandonnée pour celle de père ? J'ai beau visiter ma mémoire, je ne vois pas grand chose de précis, je crois que j'avais atteint un certain vide. Mes années d'action politique s'estompaient dans un épicurisme modéré et surtout dans l'alcool. Mon désir d'enfant n'était-il alors qu'une manière de relancer ma vie ? De lui donner une nouvelle substance ? Il est vrai que l'enfant a toujours été à mon programme, au point que je pourrais dire que ce désir est à peu près tout ce qui me reste de ma propre enfance, si on exclut les problèmes libidinaux. Avoir des enfants, c'était pour moi comme devenir professeur et me marier. Athéisme, rebellion politique, désenchantement social, semi-nihilisme philosophique, tout cela n'a pas touché à ces deux secteurs, amour et sexe. Car l'enfant est l'amour, la femme le devient, ou pas. Ce qui est clair, c'est que la décision de me marier et ses conséquences m'apparaissaient alors comme un véritable problème global, un cadre absolu auquel il fallait conformer tous les autres comportements. Au fond, je choisissais le conformisme social, la société. Et c'est ainsi qu'a commencé mon chemin de croix, c'est ainsi que j'ai appris les invasions de haine et de colère, la furie du réalisme froid et la stuppeur devant ces réalités absurdes, toujours en retrait de ce qui est attendu et espéré, voulu.
La suite a été assez extraordinaire, le premier enfant, le fils, un bonheur tel que je n'aurais même jamais osé le penser; je n'avais d'ailleurs jamais pensé à la procréation en terme de bonheur ou d'autre formes d'acquisitions, c'était toujours resté pour moi un acte muet, mystérieux et totalement à découvrir. Et puis tout de suite une stratégie de reconquête sociale. Je ne me voyais pas le choix, il fallait que j'assume, il fallait que je crée une arche pour cette famille en laquelle j'avais tout investi. Tout, cela signifie ma mort, la lente construction d'un génos où aurait dû finir par briller un soleil tranquille et permanent jusqu'au jour où mes enfants iraient accompagnant mon cercueil là où il devait aller, dans la tombe de mes propres parents. Tout cela était loin de la grandiloquence de ma première jeunesse où se jouait le destin du monde plutôt que le mien. En fait, c'était la vérité, quand on naît pendant qu'un dictateur prépare les plans d'un génocide et de la plus grande invasion de l'histoire, quelle réalité peut-on avoir face à l'impitoyable dureté du ciel et des nuages qui passent au-dessus de cette folie ? Et puis ce cauchemar à peine terminé, la kyrielle des guerres suivantes ? Que reste-t-on, enfant ou adolescent, dans la guerre ? Encore dans un régime de guerre où il y a la conscience qu'il faut nourrir les guerres futures, cela va encore, comme chez les peuples de l'Antiquité. Mais après le cataclysme de 40, nous n'étions plus rien, que des sans-avenir, sans destin, destin épongé par l'horreur et tous les excès. Que pouvait encore donner cette terre après cet anathème ? Quels fruits pourrait-elle encore nous promettre, à nous les tard-atterris dans le néant ?
J'arrête, je me laisse aller. Mais on avance. Aujourd'hui, c'est tout différend. En allant vers l'enfant, j'allais donc vers moi-même, à croire que je m'étais complètement abandonné. J'allais aussi vers le travail aliéné, la posture sociale tant abhorée, pour laquelle je nourrissais depuis ma tendre enfance une haine sans répit. Il allait falloir transiger avec l'homme et ses saletés, me courber devant mes besoins et ceux des miens, d'abord ceux des miens. Pour ma part j'avais appris la vie légère, la guérilla simple de la survie non-accumulative, hors patrimoine et économie, le cabotage destinal, la vie chez les autres, les étrangers, ceux qui sont à peine une société. Avec Alexi et Elise, je prenais conscience qu'il n'y avait qu'une seule société pour eux, et pour moi, la mienne, où il a donc fallu que je fasse retour, la corde au cou comme le bourgeois de Calais.
Or voici que mes enfants sont grands, que j'ai échoué par deux fois à fonder l'arche de la paix familiale et de fleurir par anticipation ma tombe, alors quoi ? Je me retrouve face au vide de ces années soixante-dix, comme s'il ne s'était rien passé ? Il faut tout reprendre à zéro ? Peut-être pas, si l'épreuve de cette séparation s'avère réellement dialectique, si elle se transforme réellement en son contraire. Se donner du temps, mais qu'est-ce-que ça veut dire ? Où trouver le temps que l'on se donne, il n'y a pas de temps gratuit, et Myrie le sent bien qui ne veut rien entendre d'espoir. Elle semble porter un deuil, mais ce deuil n'est visible, et elle me l'a confirmé, que lorsqu'elle me voit. Il y a de l'espoir...Mais moi, quelles sont mes intentions, comme elle dit ? Je n'en sais rien, il est trop tôt pour choisir entre une nouvelle tentative de couple et ce qui ne pourrait devenir ou redevenir qu'une longue dérive à travers ce qui reste de réalité. Je suis bien tenté par ce projet de me perdre dans la solitude des océans, vivre avec les poissons, les tortues et les oiseaux. Ma grande capacité d'amour pour tout ce qui vit me mettrait certainement à l'abri, dans l'abri de l'être, mais, il y a un mais, puis-je plaquer tout le reste comme ça ? C'est le noir pour moi. Je sais que ce projet m'avait effleuré une fois dans mon île, après avoir rencontré cet anachorète, mais je n'avais pas encore d'enfants, et maintenant j'en ai, quoi que je pense. Ces derniers temps je suis repris par cette sourde angoisse de mourir loin d'eux, comme quand ils étaient petits et que je partais en reportage.
Quant à mon parcours professionnel, je m'en fiche royalement. Là aussi il faut que je ferme une boucle. Je les ai contraints à me prendre en considération, à me laisser prendre une place dans le babil social, et sans doute ai-je pu jouer un rôle non négligeable, même parfois contre ma propre volonté. Mais je sens bien, à tout ce qui m'arrive, qu'ils ont peur maintenant. Ils ont dû reculer jusqu'à ce point, et au moment où ils font mine de me donner un véritable pouvoir, il me tendent un piège pour me décourager définitivement. Il faut donc, là aussi, que je prenne une décision, et sans doute de loin la plus importante. M'arrêter totalement, rebondir comme ils disent et faire autre chose ? Trouver exactement ce que j'ai envie de
faire ? Quel langage naïf !! Jusqu'ici j'ai toujours navigué entre deux eaux, j'ai surtout su m'adapter à toute nouvelle donne, mais quel désespoir l'adaptation quand il n'y a pas derrière un but stratégique essentiel. Longtemps je me suis bercé de paroles en me disant que l'important c'était de me préserver pour mes vieux jours, ceux de la «liberté», et que là on allait voir ! Quelle foutaise, sans doute. J'ai pourtant tout fait pour sortir de ma paranoïa ontogénétique, passé tous les compromis, accepté de traverser la mêlée, tête baissée, le ballon sous le bras, malgré tout mon dégoût. Je n'en ai pas fait assez, mais en faire assez signifie trahir, se salir les mains une bonne fois pour toute. Un subordonné, c'est là pour ça et seulement pour ça. Rompez.
Lundi, le 8 novembre 1999
En fait, les choses pourraient être entièrement différentes. Il y a bien d'autres points nodaux dans mon parcours, et il commence à me sembler que ma situation ressemble bien plus à celle de mes vingt-ans, ou peut-être de mes vingt-cinq, lorsque je me suis retrouvé sur le trottoir de Fresnes, à moitié hagard, me bourrant de café pour oublier que je n'avais rien mangé depuis quinze jours et qu'il fallait continuer à supporter encore quelques jours cette douleur profonde de la faim. C'est une sorte d'agressivité latente que je sens en moi en ce moment qui me fait penser à cette époque, quelque chose s'assez étrange en moi et rare.
D'un autre côté il y a des symptômes moins alarmants. Il y a trois jours j'ai flashé pour une chanteuse grecque entendue par hasard sur France-Culture, et depuis je suis comme intoxiqué par cette musique : j'ai compris ce matin que c'est une sorte de retour à mon Odyssée grecque en 1960. Donc, c'est peut-être là qu'il faut que je cherche à me situer, et j'ai tout lieu de me réjouir, mais aussi de m'inquiéter. Mais comme dit Marx, lorsque l'histoire se répète, c'est toujours pour la farce.
Au total, ce matin les choses s'éclaircissent quand-même un peu, malgré la brûme qui encombre ma tête : dans un cas comme dans l'autre, c'est de la vie qu'il me faut, ou plutôt, ce qui ressort toujours de ce que l'on attend de moi, c'est de vivre résolument, n'ayant jamais su rien faire d'autre. Même écrire m'est pour ainsi dire inutile, tout ce que j'aligne ici n'est qu'un pâle reflet de mon absence d'action. Pourquoi ai-je écrit si peu de choses sur mon travail à Arte ? Réponse parce que ce travail ne s'impose pas comme réalité, moins qu'une miche de pain. Pourquoi ne suis-je pas devenu boulanger ? Peut-être toutes ces vingt-cinq dernières années seraient-elles à rayer de ma biographie s'il n'y avait pas mes enfants et ce qu'ils vont devenir eux aussi. Que ne ferai-je pas encore pour eux ?
Mais que veut dire vivre ? Etre ? Belle et bonne question, tant il est devenu éblouissant que ces deux mots de vivre et d'être n'ont plus aucun sens en eux-mêmes, qu'ils ne sont plus que deux vecteurs abstraits pour d'autres fonctions, d'autres mouvements browniens, d'autres finalités erratiques. Etre est devenu un scandale. Je trouve cette formule tellement belle que je m'arrête là.
Mardi, le 9 novembre 1999
Je dois être très fatigué pour écrire des choses pareilles. L'être a toujours été un scandale, il arrive seulement qu'on vive la vérité de ce fait avec plus ou moins de violence. Voir Artaud.
Jeudi, le 11 novembre 1999
C'est une date que je ne rate jamais, je l'aime trop la Grande Guerre ! Bon, mon psy a regretté que toute cette écriture «en reste sous cette forme», ou quelque chose comme ça. Mais que voulait-il dire ? Peut-être pense-t-il que c'est sur un divan que je devrais m'exprimer ? C'est une question. A laquelle je peux lui rappeler que j'ai écrit un livre de philosophie dont le titre est «Deuxième entretien préliminaire». Il devait donc faire fonction d'auto-analyse en même temps qu'il me permettait de déposer ma pensée du moment. Au fond tout ce que j'ai tartiné depuis peut aussi fonctionner de cette manière. C'est peut-être ce qui me sauve de la psychose. Soupçon, Myrie a peur de moi parce qu'elle me croit fou. Elle me l'a dit tellement souvent, que j'étais fou. Moi aussi je l'ai traité de folle, mais ça n'avait pas le même sens, dans ces cas-là je parlais surtout d'excès, d'excès dans la peur ou la haine ou l'angoisse, mais pas de psychose. Différence. Il faudrait que je lui en parle. Mais à quoi peut servir le dire du fou ? Norbert aussi me croit fou, mais avec un certain respect et aussi une certaine intelligence car il sait se servir de ma «folie», il sait en tirer la substance mantique. Il y a un problème central dans la psychose : en principe et en résumé, le fou devient l'objet d'un principe extérieur, il perd son autonomie psychique tout en se «centralisant» comme point focal de la réalité. Or, il faut prendre position sur la centralité même du penser. Toute la critique contemporaine de la subjectivité, ou plutôt de la subjectité, signifie bel et bien que l'homme est pensé plutôt qu'il ne pense. Que ce soit le structuralisme ou l'idée heideggerienne de Da Sein, au fond ce qu'on essaye de théoriser c'est l'idée de la marionnette de Kleist, dont on parle d'ailleurs depuis la haute Antiquité. Alors où est la folie ? En 93, je crois, j'avais pris un contrepied de l'interprétation classique de la folie comme déréalisation, en disant que le psychotique avait un sens plus aigü voire totalitaire de la réalité, ses filtres sociaux ou génético-évolutifs ne fonctionnent pas ou peu. Il «subit» le tout, comme catégorie logique, ce qui fait tout de suite penser à la folie de Nietzsche ou à celle de Hölderlin.
Certes, il faut nuancer à propos de l'idée du penser. Si on se contente d'en faire un mécanisme psycho-moteur, la psychose peut bien se décrire comme dysfonctionnement. Or penser est loin de tout cela, penser c'est construire selon le temps la rationalité même du réel, c'est soutenir en permanence précisément le non-fou. Penser n'est pas une opération aléatoire, penser c'est assumer l'être du monde, et c'est de cette pensée que l'on parle lorsqu'il est question de marionnettes. Legendre au plus près. Par conséquent, il y a une position psychotique fondamentale dans le rationnel, car il est impossible de le réduire à un mécanisme psycho-moteur, il faut toujours un metteur en scène. C'est là peut-être la fatale nécessité de la fiction, et aussi la raison de la haine de Myrie pour ceux qui contestent cette fatalité. Mais elle confond un peu vite les grandes fictions, comme les religions ou les théories métaphysiques et le roman. Même si sur un fond logique il s'agit de la même chose, les soucis qui sont à la racine de l'événement ou de l'avènement des uns et de l'autre sont de nature radicalement différends. Même dans la Recherche du Temps Perdu, il n'y a pas une trace de souci ontologique, il s'agit tout au plus d'une expérience de restitution de l'ayant été, mais en aucun cas de l'être. Le roman a fait croire que l'anamnèse pouvait accomplir l'idée d'être, un peu comme la psychanalyse - les deux sont du même siècle - mais je ne le pense pas, et c'est là tout l'enjeu de nos disputes.
Vendredi, le 12 novembre 1999
Boum ! Retour à la case départ, ou presque, pour Myrie et moi. Etrange attirance, plus forte que la plus forte des violences. Je n'y comprends rien et pourtant c'est moi qui ai ourdi tout ça en quelque sorte. Etrange événement, car nous avions rendez-vous, Myrie et moi à Gènes le 11 novembre. J'avais fixé ce rdv en précisant que les choses auraient changé à cette date, et patatra j'oublie le rdv. Or, ce même 11 novembre a quand même fonctionné comme ce à quoi il était destiné, étrange.
Alors que va-t-il se passer maintenant ? Nous sommes très méfiants, tous les deux, mais ce qui s'est passé cette nuit ne laisse pas beaucoup d'espace de jeu, il faut refléchir vite et bien.
Jeudi, le 18 novembre 1999
Cité, citoyen, citoyenneté. Tout se joue entre gestion de la fourmilière et projet politique. Mais qu'est-ce-qu'un projet politique, voilà tout le problème. Le néo-libéralisme veut nous faire admettre qu'il n'y a plus de projet politique, et que l'histoire humaine est devenue une histoire économique, l'histoire de la gestion de la consommation de la terre. Autrement dit, l'homme a atteint une sorte d'homéostase politique avec le modèle démocratique qui semble permettre d'éviter le retour des despotismes. L'homme serait «rentré» dans son essence ! C'est ce qu'ils appellent la fin de l'histoire.
Quel incroyable connerie ! D'abord on oublie l'essentiel, c'est à dire le fait que la société n'existe que grâce à un projet politique, ou plusieurs. Il n'y a pas de société donnée par une transcendance quelconque, il n'existe pas de communauté que l'on peut affubler du nom de société sans à l'origine un désir politique collectif. Qu'il se nomme Liberté Egalité Fraternité ou autrement, peu importe, mais il faut un scénario moral : il n'a jamais suffi, même pas certainement dans la préhistoire, de gérer convenablement le rapport à la survie pour la collectivité. Comme le rappelle Marx lui-même dans l'Idéologie Allemande, il n'y a pas de société dans la préhistoire capitaliste, il n'y a que des collectivités aveugles, et c'est exactement ce dans quoi fonctionne aujourd'hui la-dite «société».
Qu'est-ce-qu'un projet politique ? Il n'y a pas de choix. Le destin humain n'est pas un supermarché des visions du monde, où il suffit de sélectionner la façon de vivre qui plaît à un moment donné. Le projet politique est un projet rationnel au sens de la fatalité incluse dans la raison collective qui se développe dans l'Histoire. Ce développement n'est pas non plus recevable sous la forme d'un automatisme historique comme le laisserait entendre l'histoire hégélienne, sauf à admettre que le savoir absolu n'est rien d'autre que l'assomption de la singularité en tant que fin des fins. Le communisme ne se sera trompé que de peu, en négligeant la singularité de la singularité : l'homme «achevé», c'est à dire l'homme de l'histoire au sens de Marx, est un homme totalement singulier, sorti de toute dépendance réciproque, qui n' «est» que par et pour lui-même. Du moins s'agit-il là du modèle lié à l'histoire du capitalisme et, partant, à celle de la métaphysique occidentale. Ce qui ne marche pas chez Marx, et encore faudrait-il y voir de plus près, c'est l'idée d'une entité transcendante qui réglerait une justice distributive selon des critères moraux, alors que la fin de la préhistoire, c'est à dire l'avènement du projet métaphysique, c'est précisément aussi la fin du souci moral parce que le problème des moeurs est définitivement réglé.
Pourquoi un tel homme, débarrassé du moral ? Parce que la relation d'altérité qui passe par l'éthique reste l'artefact de la relation ontologique, et que l'homme ne pourra jamais passer à cette relation de façon fructueuse tant qu'il en restera au sociétal et à la relation de dépendance réciproque : l'homme doit conquérir le courage d'en finir avec la solidarité en même temps qu'il doit rompre avec l'exploitation. Il doit conquérir sa solitude.
Dimanche, le 21 novembre 1999
Planté hier, dans des conditions étranges, perdu deux pages sur la folie. En gros j'ai repris le thème de la déréalisation pour la retourner : le fou prend tout dans la gueule, désarmé face à la pression du réel, contenu pour les autres par la culture et la tradition. Venait ensuite un questionnement sur l'art comme persistancee des folie originelles ou subversion de la culture.
Ce sera le thème d'un film que nous préparons, Jean-Michel Kanner, Jean Vermeille et moi. Ce sera aussi une auto-psychanalyse ou, ce qu'a magnifiquement compris immédiatement Jean, une plongée dans mon problème identitaire et narcissique. De trop pour moi ? Je me le demande avec un rien d'inquiétude, mais il faut avancer, conclusion de la discussion que j'ai eu hier aussi avec Myrie, qui ne veut résolument pas s'appeler Kobisch. D'un certain point de vue je la comprends, même si le point de vue n'apparaît pas comme très généreux : il faut que je me débarrasse de cette valeur, ou plutôt il est nécessaire que j'en exclue Myriam. Amour sans générosité, ou avec générosité à sens unique, c'est le modèle du joueur, encore une fois, je risque donc de partager le sort de Marek, l'ancien mari. Quelle carrière !
Ce que je ne comprends pas, ou mal, c'est qu'elle veut bien continuer de s'appeler Mitelman-Kobisch : comment un nom comme le sien peut-il s'harmoniser avec Kobisch, c'est un vrai défi permanent. Pourrons-nous un jour nous trouver? Nous appellerons cela l'empire du milieu !
Qu'est-ce qui domine dans l'âme humaine aujourd'hui ? Les images, très certainement. Les images sont d'ailleurs un enjeu antique à travers toutes les religions ou presque. Mais l'occident a imposé l'image d'une manière telle qu'aucune religion n'y est parvenue : il a persuadé tout le monde qu'elle était UTILE. L'information est l'alibi le plus parfait du crime iconique. Que faire s'il faut en passer par là pour seulement respirer ? Tuer l'image par l'image, ce que fait d'ailleurs gaiement l'informatique dans l'inconscience générale. C'est l'inflation qui tuera l'image, elle n'est, après tout qu'un aspect de la perception qui prend un place spéculative dans l'idéologie commune au détriment du concept. C'est là la véritable révolution copernicienne de ce siècle qui a commencé à vrai dire au milieu du siècle passé. Jünger le disait en parlant de la naissance des Titans mais sans doute sans penser aux images car il était obnubilé par les vécus de la Première Guerre Mondiale. C'est sur le tard qu'il a compris la puissance des images en inaugurant le Musée qui y est consacré dans la Somme. Il était assis dans un chaise roulante, déjà agé de 100 ans, militant encore pour la reconnaissance de cette catastrophe humaine comme acte fondateur de la nouvelle réalité. Alors qu'il ne faisait que se faire ainsi le complice du nouveau monde des images. Bientôt le temps sera totalement infesté par l'image, plus rien ne pourra disparaître dans l'oubli, les archives vont devenir une mémoire vivante mais mutilée de sa force d'oubli. Accélération infinie du désir de cet être étrange qu'est l'homme, le manducateur.
Je raisonne comme un iconoclaste, moi qui ai consacré plusieurs décenies à l'image ! J'ai convenu hier avec Myrie que j'avais passé un grand nombre d'années de ma vie à faire n'importe quoi, et que mon problème avec elle était qu'il fallait que je fasse le ménage si je voulais avoir une chance avec elle. Elle a vu dans tout ça une grande lucidité et en a parue étonnée, mais elle devrait se méfier, car si un changement avait lieu, ce qui est dans la nature des aventuriers comme moi, elle risque d'en payer les frais d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas nier que la réalité soit agonistique, mais seulement entre l'homme et la femme. Nous en avons souvent parlé, mais ces paroles semblent s'évanouir dans son esprit, ne pas avoir d'impact ni laisser de trace. Quelle duperie !
________________________________________
Que signifie faire n'importe quoi ? A partir du moment où la foi chrétienne m'a déserté, il ne restait littéralement rien à faire de la vie, du moins linéairement, accomplissant un parcours logique marqué par les étapes rituelles de l'existence chrétienne pour finalement se voir partir pour un au-delà préparé au carré comme un lit d'armée. Il fallu donc reconstruire toute cette logique malgré l'absence de ces plaques de circulation plantés à tous les carrefours. Donc dériver. La dérive permet beaucoup de choses, notamment d'emprunter des chemins dont on ne soupçonne pas que ce sont des voies aussi droites et aussi logiques que les autres, par exemple les voies de la psychologie. J'ai au moins appris ça chez les Situs, c'est qu'il est possible de faire parler l'urbanisme et l'architecture, mais plus encore d'entrer en dialogue avec eux et jouer avec la géographie. Retrouver le drame ancien dans la pierre, retrouver aussi les constantes infinies comme les océans et les grandes montagnes, bref prendre vraiment sa place dans le monde, un monde qui commence alors à monder. Les vies sculptées à l'idéologie ou à la religion restent tellement à côté de leurs pompes terriennes, on ne se réfère plus qu'aux inflexions de la vie du discours et des actions. Je suis allé au barbare alors qu'il en était temps pour y faire mon apprentissage, il faut dire que cette barbarie m'était programmée pour ainsi dire au berceau, celle de mon père mélancolique et celle de ma mère fanatique. La religion a entre autre pour conséquence d'éloigner l'homme de son temps, du temps en tant que substance de sa vie. Le temps alors se vide et c'est l'ennui. C'est comme si l'homme se mettait à vivre à côté de sa vie, à côté de lui-même, décalé dans une abstraction où son corps et sa psyché se désincarnent progressivement, vieillissent profondément dès l'âge le plus tendre. «Il n'y a que le vrai et la quête du vrai», belle phrase du film d'Engelopoulos qui s'appelle «L'éternité et un jour». Cette quête est vraiment tout ce qui reste de l'Europe, de cette Europa enlevée par le Taureau. J'ai aussi oublié l'univers des femmes et des enfants, mais je peux toujours y revenir, quand je veux. C'est ma seule force.
Lundi, le 22 novembre 1999
Fasciné par Arris Alexiou, une chanteuse grecque découverte dans une émission de France - Culture. Je n'y croyais pas trop et puis je suis littéralement intoxiqué par cette voix et le style à moitié sirtaki et à moitié turc. De deux choses l'une, ou bien la Grèce se réveille, ou bien c'est ma vieille aventure grecque qui me travaille à nouveau, comme je l'avais remarqué un peu plus haut. Cette musique a vraiment une dimension charnelle, ontologiquement charnelle. Elle va plus loin que l'oreille, elle relie des extrêmes dans le plaisir. Ce n'est pas un hasard si je l'ai découverte par un émission qui présentait une intellectuelle très particulière, Françoise Bonardel, philosophe spécialiste de l'alchimie et qui passe son temps en Grèce. Allons-nous enfin vers un engouement pour la Grèce avec deux siècles et demi de retard sur l'Allemagne, grâce à Heidegger. Les choses travaillent en profondeur et le goût du public ne fait jamais que faire surgir ce qui s'élabore dans l'esprit, sous une forme assimilable : la futilité est toujours un sous-produit ou un erzatz de ce qui se joue au coeur de la réalité, ce qui a fait dire à Peirce qu'un philosophe aurait tort de négliger la mode. A vrai dire, c'est une époque grecque pour la France, car jamais sa cohérence républicaine n'a été aussi forte, même si l'imagination fait défaut à cette République aujourd'hui admirée par les Romains d'Amérique. Le parallèle peut faire peur si on se souvient qu'Athènes et morte de cette admiration latine, mais l'histoire ne se répète jamais.
Je préférerais que ce soit la Grèce qui se réveille, et j'ai tout lieu de le croire après avoir vu le film d'Angelopoulos qui s'appelle «Une éternité et un jour». Pure merveille de poésie. Donc, les événements qui se bousculent en ce moment dans ma vie ne sont pas tout à fait gratuits, il y a un signe pour aller de l'avant. Oserais-je, à nouveau ?
Mardi, le 23 novembre 1999
Gerschwin, quelle emphase ! on dirait vraiment les trompettes de Néron avec cette jubilation triomphante. Myrie aime cette musique, comment fait-elle ? C'est sans doute un reste de l'esprit de conquête économique des Juifs polonais. Mais elle aime aussi Schubert, comment tout cela est-il compatible ? Quel bordel dans le goût du siècle ! Toujours le reflet de l'éclatement du scénario, empirisme du chaos. Son goût pour cette musique américaine trahit aussi un alter-ego bien caché et dont j'ai eu à souffrir gravement. Volonté de puissance dans un gant de velour, c'est ce que j'ai toujours pensé et qui, au fond, ne me déplait pas autant que Gerschwin.
A l'heure qu'il est, Myrie et moi sommes parvenus dans une nouvelle ère. De mon côté je vois les choses d'une manière très pragmatique, j'ai l'impression d'aimer cette personne à un point de non-retour et aussi que cet amour est partagé, quoique le mot ne soit pas vraiment très exact. Il n'y a pas vraiment de partage, plutôt un désir de possession réciproque et douloureux. La tendresse ne vient qu'après, de manière tout à fait fugace et si fragile. Je me sens toujours dans une arène avec elle, comme des gladiateurs. Mais c'est avec des mots que nous nous battons, la moindre phrase est comme un pas sur la glace où l'on ne sait pas qui va tomber le premier. Cette manducation sémantique et interprétative - quelle traitrise de psychanalyste - nous a menés à notre perte, mais je crois hélas qu'au bout de notre amour c'est cette perte qui nous attend de toute façon. Oh bien sûr, je sais que ma structure idéologique à propos de l'amour est désespérée d'origine. Mon grand échec initial a sans doute marqué ce qui devait venir après. Mais pourtant j'ai su, depuis, renaître à ce sentiment sans méfiance, le fait qu'à chaque fois ça se soit soldé par un échec n'est pas une preuve de mon impuissance, il y a tellement de pièges sociologiques et historiques. Ce que Myriam ne veut pas comprendre c'est que l'amour est à chaque fois quelque chose de nouveau et d'inconnu, ici et là-bas dans les siècles et les millénaires passés. Elle ne veut pas prendre conscience du fait que nous avançons tous les deux dans la nuit de l'aventure, que l'aventure est l'essence même de l'amour. C'est sans doute la raison principale pour laquelle les Juifs ont créé un Dieu radicalement déçu par les hommes, un Dieu qui a abandonné l'amour. Myriam est dominée par le problème du nom propre exactement comme les rabbins le sont par le nom de Dieu. Elle le cherche, mais elle refuse le mien, ce qui est la contradiction même, peut-on vivre dans le refus d'un nom en même temps que dans la recherche d'un amour ? Ah, si seulement mon nom comportait 216 lettres !
Jeudi, le 25 novembre 1999
Toubab.
Lundi, le 26 novembre 1999
On y est. Grâce à Myrie j'ai réussi enfin à me faire une image générale du lacanisme. Etonnant, étonnant que ce soit après près de quatorze ans que nous avons enfin une discussion que j'ai tellement désirée et à laquelle elle s'était toujours dérobée, comme si cette fois c'est moi qui réussis à lui dérober quelque chose. Quelque chose de son jardin secret. Et pourtant, ce qui ressort de tout ça est précisément ce qui nous bouffe tous les deux depuis toujours : l'affrontement des singularités qui se contemplent comme de vieux poissons au fond de l'océan, cherchant à percer jusqu'à la pointe d'épingle du Je, guettant le mouvement qui trahit et permet le happement mortel. J'ai voulu lui dire que ce qui la tuait dans tout ça c'était la singularité de ma singularité, car elle, elle se méfie de son propre trésor théorique, singulier, un peu, mais pas trop. En fait, c'est ça ses suées d'angoisse, cette solitude si théorique et en même temps si absolument vraie, imprenable et qui manduque cette société par tous les bouts. Cette société qu'elle défend bec et ongles, avec ses simagrées, ses structures délirantes, ses fictions répétitives, sa jouissance mortelle et ses lois qui protègent tout ça.
Etrange aussi que l'ennemi que je suis pour elle soit son ami théorique, son crédo existentiel. Parfois je doute qu'elle pusse être sans cette colonne vertébrale spirituelle. Ce n'est pas faute d'en avoir cherchée une autre dans les religions douces comme le miel, mais on ne revient sans doute jamais de Lacan et de son cynisme ironique. Rien de plus intelligent que ce désespoir virilisé par des mathèmes pour Comedia del' Arte. JAM ne s'y trompe pas, qui donne une toute autre version de la vérité lacanienne, la dure, la qui ne rigole plus, et ceux de l'Ecole le savent.
Je vais peut-être finir par entrer en analyse, ce n'est plus qu'une question d'argent, car en ce moment c'est la Sécu qui paye. (ce n'est pas un message, Monsieur le psychiatre). Mais au fond, pourquoi ? J'ai failli demander à Myrie si on pouvait faire la passe sans avoir subi de psychanalyse, mais je sentais bien qu'elle m'aurait immédiatement percé à jour, méfiance. Question : ma vie n'aura-t-elle été qu'une vaste auto-analyse ? Freud l'a bien fait, pourquoi pas moi ? Il faut cependant rester modeste, non pas de la tête, mais du dos, et se coucher sur le divan. Posé, en revanche, une vraie question : comment a commencé son analyse à elle ? Pas de réponse. Seulement celle-ci, qu'on rêve toujours. Ce qui est douteux, selon mon expérience. Que peut-on dire pendant douze ans ? La vie n'est pas une citerne sans fond ni le sommeil si créatif. Je crois que ce qui m'a toujours retenu de la psychanalyse, c'est ça, cette ridicule amplification, boursouflure de soi au quel il faut sans doute se livrer pour en arriver à cette tête d'épingle. Il faut se prendre au sérieux, dure évidence, mais, est-ce si légitime que cela ? Il faut encore renifler quelque part une transcendance pour le croire. Ah la confession ! Ah le grand Autre ! Sur le lit de mort, peut-être, et encore...
Mardi, le 30 novembre 1999
Le symbolique, au fond, c'est le ciment du réel. Ce par quoi il tient, le leurre de l'identité. Prenez la comparaison entre le Tazieh (dont j'ai déjà parlé dans ces écrits), la grande fête des Chiites, et notre Noël. A part le fait que le premier de ces deux rites rappelle une mort et l'autre une naissance, rien ne les différencie en tant que rite identitaire. Que les uns accomplissent encore ce rite en se flagellant dans les rues alors que les autres se contentent de vider les rayons des supermarchés n'a aucune importance. Ce qui est important c'est la dimension du rite, c'est à dire exactement le nombre d'êtres humains qu'il concerne. D'un certain point de vue, notre Noël est bien plus important comme culte collectif que l'Achoura ou Yom Kippour, même et surtout parce que personne n'y croit : les symboles sont totalement dépouillés de leurs impuretés doctrinales, c'est le monde à l'envers. Toutes les analyses sur la réification des rites, leur corruption par la marchandise sont tout à fait négligeables. Peut-être même est-ce précisément ce phénomène qui annonce la parousie du rite et du symbolique en tant que rite et en tant que symbolique. Peut-être les communautés vont-elles enfin (à nouveau ?) s'imposer le symbolique en tant que tel. La mythologie grecque était beaucoup plus sincère en tant que fable. Les Grecs n'étaient pas plus crétins que nous pour aller placer de la foi dans leurs dieux et comprenaient fort bien que tous ces récits n'avaient pas d'autre fonction que de les identifier dans une histoire, frêle argumentaire pour continuer d'exister. De plus les Grecs ont eu le bon goût de faire les dieux à leur image et non le contraire !! Je dis le bon goût mais je devrais dire l'intelligence ou la lucidité. Le sens de l'honneur.
Le symbolique a sans doute un grand avenir en tant que lieu vide d'un récit muet et reconnu comme tel, comme base ou portée transcendantale de la musique de l'être, car il ne noue pas seulement les vivants entre eux, mais le tout en tant que tout. C'est de cette seule manière que je peux comprendre le risque pris par Lacan dans sa tentation de mathématiser l'étant psychique. Il est parfaitement véritable que le symbolique en tant que tel est, au fond, la même chose que la res extensa ou espace mathématique vide et cependant divisible à l'infini.La barre du sujet n'est rien d'autre que l'annulation d'une identité inexistante, en tant que sujet, c'est à dire en tant que substance universelle, que l'hypokeïmenon des Grecs.
Reste que les rites religieux appartiennent à la jouissance, les en retirer au profit du symbolique en tant que symbolique serait comparable à la révolution copernicienne, et je ne suis pas loin de penser que la réification de Noël est déjà l'entame de cette révolution-là. La marchandise identifie certes autant que la religion, mais elle isole radicalement le sujet symbolique, le détachant des pulsions biologiques collectives : consommer est un geste radicalement singulier, totalement différent de l'effectuation d'un scénario collectif sur la scène de la représentation. Consommer est une manière de revenir au présent ou d'y coller sans ciller. C'est ça la révolution capitaliste, une descente aux enfers à grands risques comme prix de l'accès à l'être en tant qu'être. Il faudra raffiner cette analyse au plan ontogénétique et voir comment la sagesse nait du scepticisme : pourquoi les Sceptiques et même les Epicuriens n'ont jamais renié la nécessité du culte religieux ou mythologique tout en rejettant les contenus non symboliques, les signifiés rituéliques. Il n'y eût jamais que les cyniques pour aller jusqu'au bout, mais presque toujours au prix de la folie. Voir Nietzsche. La tête d'épingle, cependant, elle aussi, conduit à la folie, celle de Sainte Thérèse d'Avilla ou de Jean de la Croix. Ce sont les premiers héros de la psychanalyse ! Nous marchons résolument entre deux enfers, en avant !
Comment, alors, toutes ces réflexions peuvent-elles conduire à une éthique de vie ? Que «faut-il» faire ? Sans doute éduquer et encore éduquer : la logique est en elle-même l'annulation des substances, de même que les mathématiques, l'annulation des pulsions de jouissance. Ca, c'est clair. Pour les tenants de la psychanalyse, cependant, l'objectif est moins clair, la finalité obscure. Ils se somportent encore en combattants héroïques de l'abandon du faux sans savoir quel vrai doit surgir, ou ce qui doit surgir du vrai. Ils ressemblent en cela aux théologiens négatifs, à ceux qui se contentent de promouvoir l'abandon en tant que tel de tout discours véritatif. Mais Eckardt ou Nicolas de Cues postulaient un remplissement par Dieu de la place laissée vacante. Qu'est-ce-qui, alors, se substitue à l'analyse, que ce passe-t-il lorsque le sujet s'est dépouillé de toute sa subjectivité ? Lorsque le savoir a pris la place de la science ? Quelle «vie éternelle» peut-on en attendre ? Quel est le sens du monachisme lacanien ?
_________________________________________
Allons ! Il faut que tout cela se mette en place. La pensée, la pensée singulière en équilibre instable sur les mythes, et aussi le fait que cette pensée n'est pas celle du sujet. Bigre. Mais au fait, les mythes non plus ne sont pas le fait du sujet, ils sont comme des pluies de météorites dans le vacuum du langage, ou bien ils sont les épluchures mêmes du langage qui se créé, de ce qui mue en laissant apparaître le langage. Qu'est-ce-qui mue ? L'être ? L'être aurait-il eu besoin de l'homme porteur de langage pour sa garde ? Die Warheit, c'est bien la garde (wahren, bewahren, la conservation), et donc la vérité est aussi le fait de conserver à travers le temps l'être en tant qu'être comme question. Mais cela, c'est attribuer sans grande rigueur le langage à l'être, sous le prétexte qu'être est un mot. Mais sans lui nous ne pourrions pas le penser, et peut-être encore beaucoup moins.
La pensée au sens cartésien, c'est à dire de l'ego cogito, est aussi quelque chose qui est traversé par les sémantèmes, identiques en cela aux météorites de tout à l'heure, raison pour laquelle Descartes a eu besoin du bon génie, car cette pensée ne saurait être mauvaise. En réalité, il y a lourd à parier que ce sont les mêmes rayons gamma du sens, mais ils sont filtrés par la force, la volonté et le pouvoir. De temps en temps, un penseur se retourne pour se souvenir de l'être et en reparler. Heidegger pense que cet oubli lui-même est oubli de l'être dans les deux génitifs : l'être nous oublie autant que nous l'oublions, il nous oublie dans le mythe, dans l'histoire, dans la fiction, dans les eschatologies de toutes sortes, que nous fabriquons pour oublier l'être. Or, tout cela nous le formons avec la parole et les mots, avec le langage.
Jeudi, le 2 décembre 1999
Les Grecs, encore : La démocratie ou la République, ne seraient-il pas cette nouvelle mythologie qui s'impose d'elle-même lorsque la force de la foi ne fait plus foi ? Ces nouvelles valeurs sont de nouvelles règles du jeu, issues directement de la découverte de l'un. Dès lors que l'univers esthétique, non pas celle du beau mais celle de l'aïsthésis, du monde perçu, devient une totalité, toute transcendance se pose automatiquement comme dualité. Cette dualité légitime une souveraineté séparée, ce qu'on peut mettre sous la catégorie des souverainetés monarchiques ou despotiques. Elles ont un avantage substantiel sur la démocratie, c'est qu'elles restent forcément humaines, alors que la démocratie a montré son risque majeur de tomber du côté de l'objet. La Shoah, celle des nazis mais aussi celle de l'ancienne idolâtrie sont le risque majeur de la démocratie et le resteront, mais cela ne signifie pas que la démocratie soit une regression, mais seulement que le jeu s'est ouvert sur une nouvelle dimension de l'être. La Shoah aura été une fantastique leçon de modestie pour l'espèce humaine : l'homme devenu objet de l'industrie. Même les esclaves de l'Antiquité ne sont sans doute jamais tombés aussi bas dans l'échelle de valeur de l'être, sombre avertissement de la véritable place du langage et de son double le politique. Car la démocratie aura aussi été une révolution dangereuse, un saut dans la prise de risque que comporte la responsabilité de l'être humain dans la garde de l'être.
Pourquoi ? parce que la démocratie est la vraie naissance de l'espèce qui garde, de l'animal qui prend une responsabilité dans le monde qu'il construit. Etant entendu qu'il ne commence à construire un monde qu'à partir du moment où il se décide en direction de l'être. La fameuse rhétorique grecque ou romaine n'avait pas d'autre sens que l'échange égalitaire du sens, comme des enfants qui découvrent une clairière inondée de soleil et en parlent. Si les Anciens ont pu concevoir une légitimité à la tyrannie, c'est parce que les peuples plaçaient dans leur souverain leur propre double, s'identifiaient au roi, semblant ignorer qu'ils pouvaient penser leur monde autrement qu'ils ne le faisaient. Cette unité était pout ainsi dire intellectuellement organique, exactement comme le fascisme. Contradictoire ? Non, car le nazisme n'est pas une déformation de la démocratie, mais sa brutale disparition, le risque réside dans cette fragilité d'une souveraineté partagée qui ne connaît pas de médiation dans la négation, pas de situation intermédiaire. De plus elle se passe après la dissolution organique de la volonté commune et chaque homme se retrouve seul face au pouvoir. Dans le fascisme, c'est connu, chacun se retrouve absolument seul face au dictateur, ce qui devrait aussi moduler le jugement de tous ceux qui ont eu à y faire face. Une démocratie peut aussi de trouver en position de faire des mauvais choix, ou des choix mauvais, et dans ce cas l'individu est confronté à la nécessité de se déterminer dans le sens de la résistance ou de la complicité. La France de 1940 en est un bel exemple, mais aussi celle des guerres coloniales.
Enfin, il faut le dire, la démocratie, qui fut l'invention de l'égalité de droit, est aussi celle de la solitude de l'être humain.
Dimanche, le 5 décembre 1999
Le capitalisme est désormais le système économique qui contraint les êtres humains à consommer du non-sens. La recherche du profit creuse la substance du sens, la vide de sa chair. Cherchez l'erreur : le besoin n'est pas lui-même vide de sens comme le postulent ceux qui monopolisent de plus en plus tyranniquement ce secteur psychique. Comme l'économie politique a inventé la pénurie, elle a produit des fonctions psychiques correspondantes comme le besoin. Comment légitimer toute cette construction de l'inhumaine exploitation sinon sous la forme d'une sorte de «raison d'état» de la survie.
Imaginez le profil d'un PDG de l'une de ces entreprises qui suent l'idéologie qui veut régner, par exemple une radio locale commerciale : Trente ans, Bac + 2, casier judiciaire grisâtre, fondu de voitures anciennes ou exotique - c'est une nécessité interne à sa position de marchand de marchandises, la voiture représentant aujourd'hui la légitimité suprême du capitalisme, légitimité quasi philosophique tant certains faux philosophes s'affilient à la secte des communicateurs et de la communication -, passe ses nuits dans les boites (je n'arrive pas à illustrer ce qu'il peut bien y faire, tant cela ressortit d'une pure grégarité aveugle, en tout cas il s'y agite parfois, souvent par pure sentiment du devoir), se rend tôt à son entreprise où le manque de sommeil le charge de la dose de mauvaise humeur suffisante pour manier la chicotte, puis s'enchaîne à son téléphone portable pour conquérir une petit bout de marché, se rend tonitruant dans son «petit resto» où il fait la loi, pense à cette petite blonde qui lui résiste depuis deux jours et qui l'empêche de dormir, sort toutes les cinq minutes sont transistor ultra sophistiqué pour écouter ses esclaves au mépris de la clientèle du restaurant, remonte dans sa Béèm rouge sang pour rouler pour rien au bord de l'ennui, et puis recommence. Voici le profil de quelqu'un qui vectorise le capitalisme, un pur parasite du projet humain dont les revenus forment les rogatons du système marchand. Le pauvre, il ne peut pas être autre chose, il est condamné à se mouvoir dans le non-sens, ou plutôt dans l'absence de sens qu'il trouve encore le moyen de vendre à ses semblables. Heureusement si tous en sont atteints, tous n'en sont pas encore morts !
Le capitalisme, en réalité, n'est ni un système spontané d'échange de biens, ni une structure scientifique de la production et de la consommation. Il n'est que la forme la plus accomplie de l'oubli de l'être, une sorte de tumeur sur son flanc, ou plutôt un cancer systémique. La marchandise elle-même, en tant que marchandise, est bien l'être vidé de son sens propre - la valeur d'usage - pour devenir une valeur abstraite, la valeur d'échange. L'homme réifié est cet homme coincé dans ce processus auquel il identifie de plus en plus totalitairement son existence. Du milliardaire parcourant le monde sur son yacht jusqu'au petit patron de PMI, cette condamnation est désormais sans appel, et c'est ce que révèle cette farce de sommet de l'OMC. La conscience collective a commencé à s'offusquer de cette mascarade et ne cessera pas de si tôt.
|

|
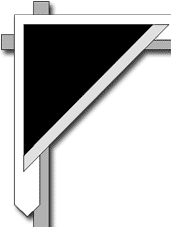




![]()