Dimanche, le 31 Août 1997
La bouteille est à l'eau. Le premier volume de mon journal est sur un site d'Internet, et j'ai déjà eu plus d'une trentaine de visiteurs, inconnus pour la plupart, mais aussi mon fils Alexi. Mystérieuse question. Que va dire mon écriture à mon fils ? Peut-elle seulement lui dire quelque chose ? La mer le dira et son éternité.
A propos de la mer, la mue se poursuit dans les caves de notre avenir commun à moi et à ma femme Myriam. Après avoir frôlé les abîmes, nous avons fini par progresser d'un bond qualitatif non négligeable. Nous avons acheté un nouveau bateau. Onze mètres et des poussières, grande navigabilité, confort etc... : plus d'excuse pour entamer l'exploration de la vie future, vie toutes voiles larguées.
Samedi, 13 Septembre 1997
Le temps passe si vite ! Treize jours que je n'ai rien cru devoir écrire ! Ou rien pu mettre sur le papier...Bref, le rythme change d'une année à l'autre et en fonction de la nourriture spirituelle que l'on / je me sert. A ce propos, je viens de terminer les textes du dit «Hermès Trismégiste». J'avais l'impression en les lisant, de parcourir de vieilles recettes de cuisine de mes aïeux ! On dit qu'au début du siècle encore, l'église catholique a eu beaucoup de mal à faire brûler les livres de magie noire que possédait à peu près toute maison paysanne ; en Alsace on dit qu'on les a fait coller, tout en les laissant au grenier (prudence toute paysanne, en effet). La philosophie de ces textes est, en fait, un ramasse-tout des diverses représentations platonico-aristotélico-plotiniennes et gnostiques. Beaucoup de temps passé à la rhétorique de glorification du Dieu-Premier Moteur-Créateur etc..., mais quelques formules simples et d'une logique rigoureuse sur la substance, l'Un, la forme, l'être et le non-être, la matière et l'Intelligence. L'Intelligence semble avoir un statut intéressant car elle domine absolument tout : en fait, l'univers n'est rien d'autre qu'un dégradé d'intelligence. Bien entendu, cette intelligence se définit comme l'accès plus ou moins grand à la connaissance de dieu, autre dégradé. Encore que l'intelligence renferme toutes les autres qualités propres au bien : amour, justice, bonté. C'est intéressant, car pour nous l'intelligence n'a plus cette étendue signifiante. L'intelligence s'est réduite à une qualité technique du cerveau individuel. Mais peut-être avons-nous oublié à quelle espace moral se réfère l'intelligence des choses. C'est à dire combien il est moral de seulement comprendre les phénomènes! Ou bien, combien l'intelligence moralise, c'est à dire nous indique très clairement le bien, exactement comme la science nous révèle des relations objectives. Ce qui signifie aussi qu'il n'y a pas d'intelligence possible sans moralité immédiate, c'est à dire que la moralité elle-même est phénoménale, le bien est visible. Voilà qui rejoint le point de vue selon lequel (Plotin ?) la simple vision est un absolu qui contient le souverain bien en tant que tel. Vivre c'est voir, au sens de comprendre, mais non pas simplement mathématiquement ou seulement selon une rectitude épistémologique, mais seulement par les sens. Béatitude de la contemplation de ce qui est créé, c'est à dire devenu manifeste.
Mercredi, le 17 Septembre 1997
Jusqu'à présent, ma vie a été relativement égale, son intensité pour ainsi dire étalée dans le temps, tout au long de ces cinquante-six années. La jubilation est toujours présente, sous des formes certes changeantes, mais à y penser très rigoureusement, je suis certain que je ne pourrais pas exister autrement.
Aussi ai-je été frappé durement l'autre jour en tombant sur une photo de Montserrat, réduite en cendres par l'éruption du volcan que je parcourais il y a vingt-cinq ans avec une véritable, parce que première, religion de la nature. La capitale, Plymouth, n'est plus qu'un espace fantomatique parsemé de quelques ruines recouvertes d'un manteau de cendres. Un manteau de cendres ! Ici on dit poétiquement un manteau de neige ! Là-bas, il s'agit de cendres, de mort empilée sur le souvenir le plus vivant que je connaisse ! Plymouth ! il faut s'imaginer une sorte de grand village qui voulait prendre l'air d'une ville continentale, un port qui n'est pas un port parce qu'il ne peut pas l'être, une capitale en réduction, un modèle réduit de cité, avec une église, des banques, des commerces très britanniques, c'est à dire très sales, une prison «Her Majesty's Prison», du bruit, de la poussière et des couleurs partout, surtout autour du marché qui se faufilait à travers toutes les places et toutes les ruelles. Et puis surtout cette odeur de morue séchée qui dominait tout, quelque chose comme une damnation joyeuse et insupportable qui courait le long du magasin de la dernière famille d'épiciers originaire d'Ecosse, du genre Jardine ou Klestil.
Tout cela mort ! Une disparition qui a sur moi un effet rétroactif, comme si ce volcan m'avait arraché quelque chose de ma vie. Au point que je me dit même que sa colère me vise directement, punition pour quelque infidélité occulte ! Au fond, ne sommes-nous pas tous infidèles à l'étant, au monde, à la réalité ? En mourant, ne trompons-nous pas ce que nos yeux avaient créé ? Nous partons toujours de partout, intranquillité fondamentale.
Curieux de voir qu'il y a une logique qui persiste quand-même : c'est le monde du spectacle et de la musique qui s'occupe aujourd'hui de Montserrat et des Montserratiens, les Elton Jones et Cie font des concerts pour gagner un peu d'argent, parce que la mère-patrie ne veut pas payer ! Car Montserrat est encore une colonie, l'une des dernières colonies au monde, ayant refusé par référendum de vivre indépendante. J'ai vu, sur cette île que l'on devrait classer dans le folklore colonial mondial, l'un des derniers gouverneurs à casque blanc surmonté d'une crête de plumes blanches, exactement comme le vice-roi des Indes !
En réalité, il n'y a pas disparition. Cette éruption durera ce qu'elle devra durer, puis tout rentrera dans l'ordre et la terre de Montserrat recommencera à donner des richesses encore plus grandes. Peut-être même qu'on recommencera à l'exploiter ? Lorsque j'y vivais, je faisais de grande promenades dans des plantations abandonnées de citronniers et dans d'anciens jardins splendides. On rencontrait de temps en temps une ruine de moulin à cannes à sucre d'une ancienne rhumerie. J'ai même pu boire, encore, du rhum produit on ne sait comment mais sûrement illégalement sur l'île. Montserrat, disait-on, exportait ses tomates jusqu'à Londres.
Donc, les rockers sont plus fidèles à ce petit paradis du Reaggae et de la danse que les politiques.
Jeudi, le 18 Septembre 1997
Comment décide-t-on de ses lectures ? C'est une question que je me pose depuis longtemps, car souvent je me surprends à interrompre un livre pour un autre, quitte à ne plus jamais, ou seulement très longtemps après, me remettre à mon premier ouvrage. Pourtant, en ce moment je suis fidèle à un sujet : l'Antiquité gréco-romaine, et en ce moment surtout grecque. Donc, j'en étais à lire les commentaires classiques de Vidal-Naquet, Finley et consort (au demeurant de remarquables pensa dont il est toujours agréable de retenir la grande érudition), lorsque j'oblique soudain pour l'Iliade en personne. Texte déjà parcouru dans ma jeunesse, mais dont l'actuelle lecture n'a plus rien à voir avec ce que j'en ai retenu depuis.
Iliade. Au moins ce détour a-t-il une certaine logique dans mon plan de culture, puisqu'en fait j'ai été attiré par Homère précisément en lisant les commentaires de Finley. Mais quelle surprise ! Et que dire d'Iliade ? C'est sans doute trop tôt, et cependant il faut que je dise tout de suite ceci : au tiers du poème, (dont il faut reconnaître qu'il est d'une beauté tout à fait philosophique, au sens où il peigne et peint l'espèce humaine comme une véritable pièce de la physis, comme une pars extra partes de la nature, ce qui peut paraître contradictoire mais reste vrai), au tiers du poème donc, les choses semblent devenir sérieuses : les dieux décident de laisser les humains se démerder. On va bien voir jusqu'où, mais cette décision me paraît contenir une sorte de fondement de l'épos grec, à savoir une taille de plus en plus précise et aiguë du réel qu'affrontent les humains. Au début du poème, on peut se laisser aller au gré des caprices des dieux et des sous-dieux, on peut attendre des retournements de situation miraculeux et fantaisistes, mais plus on avance, plus se dessine clairement le destin des uns et des autres. Les humains sont sommés de donner ce qu'ils ont et de faire comme ils peuvent, seulement programmés par de lointaines paroles, oracles qui me rappelle la parole d'Anaximandre : «ce dont est ce qui existe est aussi ce vers quoi procède la corruption selon le nécessaire, car les êtres se paient les uns aux autres le prix de leur injustice dans l'ordre du temps». Cette traduction est contestée à juste titre (pour autant que je puisse juger, moi qui ne sait presque pas le Grec !) par Heidegger, mais elle colle parfaitement avec le destin de Troie.
Cela dit, je suis effaré par la dimension «polar» d'Iliade. Déjà ? Déjà on fabrique des héros qu'on tricote ensuite dans le suspens ? Déjà on fait du «choc des photos» ? etc... et du Paris-Match et du Gala et du Diana ? La stabilité caractérielle des humains à travers les millénaires est incroyable, quoiqu'il faille quand-même faire la part des choses entre cette société d'Achéens et de Troyens fous, et nos sociétés hyper policées où ne coule plus le noir sang sous l'éclatant bronze pareil au soleil ! Et pourtant, Hélène / Diana : même combat ? On pourrait être tout près de pouvoir le penser. Brrrrrrr.......vertige, vertige. Bon, j'y retourne immédiatement. A moi Hector et Ajax, Zeus et Héré, Calchas et Nestor !
Mardi, le 7 Octobre 1997
Je n'ai plus envie d'écrire. Pourquoi ? Peut-être parce que tout me paraît de plus en plus simple et, à ce titre, ne mérite pas ce mythe gonflé en absolu qui s'appelle, dans nos têtes, écriture.
Exemple : le Tadzieh, vous connaissez ? C'est la saga, ou la geste de Hossein, le bâtard de Mohamed, défait et l'Illiade décapité à Kerbela, jouée rituellement sous forme de tragédie par les Chiites iraniens. C'est en persan et avec quelques siècles de retard.
Trop fatigué. Ne peux pas expliquer comment le rap est devenu le retour de la prosodie, ou plutôt d'une langue de la compulsion que nous avions perdu, ou dont nous nous étions débarrassé par le biais de la raison, en donnant du champ à la prose, c'est à dire aux affects domestiqués. Intégrismes / mimésis de ce décalage encore vivant. Vous pensez, Homère récitant dans un café de Téhéran en 1997. C'est ça, sans restriction, avec la même démesure. Trop fatigué.
Samedi, le 18 Octobre 1997
L'art que l'homme a amené à son point le plus parfait est celui du mensonge. Autour de moi, que du mensonge, sous toutes ses formes. Le vrai héros de notre culture si morale, c'est peut-être l'individu qui ne sait pas entrer dans les règles du jeu de mensonge. Le plus grave, ou le plus ridicule comme on veut, c'est que l'ensemble de l'équilibre social repose sur le mensonge, sur les mensonges. Mensonges anciens et nouveaux, qui s'accumulent comme du limon, se repoussent les uns les autres ou se bousculent dans la sphère publique avec la rage du désespoir.
Que du mensonge ? Pas si facile, je constate que mon texte ressemble à de la moralisterie larochefoucaldienne, et pas de ça ici !. Donc il me paraît plutôt qu'il existe pour ainsi dire deux dimensions. C'est ça, nous voyons le monde en deux dimensions, celle qui nous est imposée, et, lorsque s'installent des temps intersticiaux (on dit des «moments de liberté»), la nôtre. Or cette dernière n'a aucune raison d'être mensongère, même s'il ne faut pas oublier les servitudes intérieures, je ne dis pas psychiques, car il en existe certaines, parfaitement conscientes et qui ne ressortissent pas des élaborations de l'inconscient. Le souvenir d'une faute, par exemple, est un fardeau intérieur.
Au demeurant, on peut s'entendre sur la définition du mensonge, de telle sorte que le problème de l'inconscient soit mis entre parenthèses, c'est tout simplement d'admettre la sincérité. Ne ment-pas, même s'il ment, tout homme qui sincèrement ne ment pas.
Mais mon aphorisme du début fait surtout allusion aux industries modernes du mensonge: la publicité, la communication, la médiatisation de l'existence sont les mamelles de l'art moderne du mensonge. C'est, de surcroît, un art collectif. Tout le monde, ou presque ( ou encore tout un chacun dans son for intérieur ) consent à l'expression publicitaire. Il y a encore quelques années, je croyais que je pouvais impunément hurler mon indignation contre cette peste. Et puis, avec le temps, l'hostilité de mon entourage a insensiblement augmenté, il a fallu que j'en rabatte : lorsque la dénonciation du mensonge atteint un certain seuil, elle devient un danger de mort, même si elle porte sur des productions extrêmement élaborées du mensonge.
Certains mensonges traversent le temps sans aucune altération comme par exemple la collaboration ou la complicité de crimes contre l'humanité des gouvernements français dans leurs guerres coloniales. De cela on ne parlera pas de si tôt, même si des milliers de Papon continuent de défiler devant des milliers de jurés.
Dimanche, le 19 Octobre 1997
Peut-être que si, après tout. Peut-être que notre histoire est entrée dans une sphère «positive». Ce deuxième essai de socialisme français est peut-être le bon. Si on dédramatise l'histoire de France et du monde, cet étalage de vertus et de bonne intentions européennes pourrait bien ressembler à ce qui se passait à Paris entre 1788 et 1789. Rien n'interdit de penser que l'échec subreptice de la droite française Marx sonne le glas d'une évolution libérale généralisée, ce serait le chant du coq gaulois de Karl ! Car cette droite, en réalité, n'a pas réussi à faire passer le moindre message faute d'oser le faire, au moins autant que le font les Américains.
Nous serions donc à la veille de la réalisation du vieux rêve du Consul Bonaparte, et sans la moindre bataille ! Du point de vue économique, la situation n'est guère différente de celle d'il y a deux siècles, il suffit de remplacer l'Angleterre par les USA pour constater que nous sommes dans la même conjoncture, le dollar ayant remplacé l'or.
Lundi, 20 octobre 1997
Journée initiatique pour moi. Je vais écrire cela :
La réalité est la mémoire de l'Etre,
elle est la matière de son examen de conscience,
et à ce titre elle participe à sa critique, c'est à dire à son accomplissement.
A ma mort, il sera donc essentiel pour moi que l'on puisse dire de moi que j'ai honoré ma naissance.
Sommes-nous la psychanalyse des Dieux ?
Samedi, le 1er Novembre 1997
Pourquoi l'honneur est-il si précieux et si méprisé ?
Parce qu'il est gratuit. Ses enjeux aussi, toujours.
Pouvoir dire, sur son lit de mort : «je n'ai pas dérogé» ne rapporte rien, comme ne rapporte rien le fait de ne pas déroger.
La culture, ce n'est peut-être que cela, rendre de plus en plus sensible le dard de l'honneur. A ce titre, le crime se définit comme dérogation à l'honneur et seulement comme cela. La civilisation serait donc un processus d'affinement du sentiment collectif par rapport à ce qui est acceptable, c'est à dire correspondant à l'honneur.
L'honneur est, quant à lui, dépendant du jeu, ou du sens ludique de l'existence. Dans les actions humaines, l'honneur traduit la fidélité à un engagement. De fil en aiguille cet engagement devient celui des peuples et des nations. Un peuple engagé peut sombrer dans l'honneur même si son engagement est erroné, mais il faut qu'il sombre, car l'erreur dans l'histoire est de supprimer la possibilité de l'engagement lui-même. La démocratie a cet avantage sur toutes les autres formes politiques, de s'opposer à toute fermeture du champ de l'engagement. L'homme joue malgré lui un jeu absolu car, qu'il le veuille ou non, il court sans cesse le risque d'entendre se fermer derrière lui, les portes de cette liberté. L'honneur est donc lié impérativement à la liberté.
Que peut-on faire avec de telles considérations ? Pas grand chose, sinon de tenter de faire comprendre que tout cela n'est pas affaire de choix moraux, mais que cette logique de l'honneur, de l'engagement et de la liberté structure la réalité humaine dans un sens comme dans l'autre. Il faut apprendre à lire les faits de l'actualité dans cette logique, car il n'y en a pas d'autre. Matérialisme dialectique, idéalisme moral, transcendantalisme, toutes ces représentations ont toujours cherché à ruser avec cette loi impalpable mais sans appel, que l'homme naît avec la notion d'une dette envers lui-même, avec un oeil moral qui ne le laisse jamais déroger pour lui-même et le tient informé de son infamie ou de sa vertu. Kant a dit cela d'une certaine manière, mais l'a fait avec une certaine rigidité qui exclut le sens ludique de la situation humaine. L'impératif catégorique est plat, au sens où il n'inclut pas le risque ni le combat douteux, ni surtout l'erreur. La dialectique du maître et de l'esclave, quant à elle, est plus proche de cette structure, mais elle souffre d'un préjugé sur le mouvement du désir, elle postule que le besoin animal finit toujours par prendre le dessus sur l'honneur. Pour Hegel, l'honneur se «fatigue» et doit toujours céder la place à son contraire. A vrai dire, l'Histoire semble lui donner raison, si l'on compare
l'Aretè grecque, c'est à dire la définition grecque de la vertu, et la nôtre, si elle existe ... La décadence n'est jamais qu'un affaiblissement du sens de l'honneur. Nietzsche est bien le seul qui se soit approché au plus près de cette vérité.
Les cyniques vont rire, en allant répétant que le plaisir et la jouissance des biens de ce monde sont des choses palpables et que la vie est courte. Que l'honneur c'est de la roupie de sansonnet à côté de la puissance du pouvoir et de la richesse matérielle. Cette position est excessivement naïve, car le jeu est présent partout, à commencer dans le désir érotique et dans tout ce que le pauvre homme doit mettre en batterie pour jouir. En règle général, l'homme qui organise sa vie en fonction de son propre plaisir, ou bien périt d'ennui parce que son propre désir finit par le trahir, ou bien il joue le jeu jusqu'au bout, accumulant les crimes pour compenser la perte de désir. Le Marquis de Sade a très bien décrit ce type de désespoir.
Reste Oedipe et la psychanalyse. Justement Oedipe. Il commet les pires crimes sans jamais déroger, car il juge ses actes d'après la force de sa fidélité à son engagement. Que les circonstances de son action soient les pires que l'on puisse imaginer, et que son jeu soit littéralement pourri par un arrière-plan infernal, n'atteint en rien la pureté de son parcours. D'une certaine manière il est scandaleux qu'il paye pour cela le prix fort, et cette honnêteté-là est précisément à mettre au compte de son sens supérieur de l'honneur. Oedipe est la seule illustration totale du sacrifice comme Don supérieur d'un soi trahi par le destin. Que la trahison ne soit pas de son fait n'est pas important, car le courage de l'honneur réside dans le fait d'être capable, à chaque instant, Oedipe, de reprendre conscience d'une réalité nouvelle et d'en tirer les conséquences. Or, pour avoir été trahi ou s'être laissé trahir est une sorte de dérogation à sa perfection. Pour n'avoir pas su s'opposer à la trahison, il doit payer et il ne lui viendrait pas à l'idée de se soustraire à ce châtiment. La diminution de sa personne qu'implique le châtiment, son aveuglement réel, n'entame en rien la pureté de son être et de son honneur. La vertu de l'honneur est la seule qualité qui soit absolument relative, et seulement relative.
Samedi, 8 Novembre 1997
Peut-on vraiment construire quelque chose ? Peut-on avoir cette prétention de planifier le futur ? On est parfois tout à fait certain que de telles choses ont été faites par le passé : on a construit des réseaux ferrés, des centrales électriques, des routes etc... Et puis on se rend compte qu'à côté de l'effet escompté, il y a en d'autres qu'on n'a pas voulus, et ce qui était prévoyance et long travail pour l'avenir, devient une sorte de fatalité. Il «fallait» faire des routes, construire des usines, industrialiser l'agriculture, etc..etc.. C'est comme les empires ou les colonies, il «fallait» y aller. Et puis tout d'un coup, ce n'est plus ça, on s'est trompé.
Alors ? Moi qui rêve d'une dérive océanique, qui cimente jour après jour les éléments épars de cette future initiation cosmique, que va-t-il se passer ?
J'ai beaucoup de certitudes à propos de ce qui m'attend au milieu des mers. J'imagine avec facilité l'inimaginable, c'est à dire le recueillement destinal de la vie autour de moi. Les naufragés volontaires ou pas n'ont pas compris cette dimension, c'est que lorsqu'un élément de la vie (du tout de la vie) se trouve en danger, c'est le tout de la vie qui se mobilise selon ses moyens, qui sont infinis. Lorsque la volonté du naufragé de subsister dans l'existence rencontre cette mobilisation, il est plus assuré de survivre que dans n'importe quelle autre situation.
Mais, justement. J'ai l'intuition qu'il y a aussi une relation impossible entre la logique de ces concepts et le déroulement du temps qui vient. Comme si ce temps allait d'abord user mes vérités avant de me jeter dans la tourmente. mais quelque part il doit y avoir une maîtrise ou au moins un sentiment de sûreté du savoir, ou de ce que l'on croit être du savoir. Toujours la pensée de Nietzsche sur les dangers qui guettent une pensée qui ose franchir le seuil de l'expression. La pensée devrait rester collée à son sujet ? Ne jamais glisser dans les mots ?
La vérité se transforme en mensonge dès qu'on la jette à l'extérieur ?
Pourquoi ? En admettant tout cela, il faudrait envisager une civilisation du silence. Est-ce possible ?
Pourquoi pas ? Le rejet de la culture est une forme de ce silence, redoutable. Le fracas de la fausse culture aussi. Brrrr.
Dimanche, le 9 Novembre 1997
Un étudiant m'a envoyé un e-mail avec un sujet de philo qui interroge la contingence de l'existence et l'angoisse devant l'absence de sens que doit susciter cette contingence. C'est un sujet intéressant car il oblige à refaire des tours dans la problématique de la nécessité et de la contingence.
Or, mon expérience m'a permis de découvrir une chose étrange : la nécessité et la contingence vont toujours ensemble. Ainsi, dans le cours de l'histoire politique, il y a des éléments contingents qui finissent toujours par être rattrapés par la nécessité. Le dernier exemple est celui de la gestion de la ville de Mulhouse. A observer ce qui s'y passe, je peux parier que son Maire, le socialiste Jean-Maris Bockel, est sur le point de suivre l'exemple de l'un de ses prédécesseurs Emile Muller. A savoir tourner sa veste à droite ou au moins vers le centre. Motif : la nécessité que représente la position particulière de cette ville de l'Est de la France, enclavée dans une germanité et dans une fausse prospérité qui semble fatalement provoquer l'indifférence de la Nation. Mulhouse finit toujours par être abandonnée dans les cartons des ministères - pour des dossiers importants comme le Canal Rhin-Rhone ou le TGV, des infrastructures dont cette cité a le plus grand besoin. Le résultat est connu depuis longtemps : la ville est obligée de se vendre au plus offrant. Il y a deux cents ans Mulhouse s'est vendue aux puissances capitalistes protestantes d'origine germanique, ce qui en fît le Manchester français. Après la deuxième guerre mondiale, lorsque le textile est entré dans sa crise finale, le Maire a négocié le site de la ville avec..Peugeot ! C'était, dira-t-on, ça ou rien.
Ainsi, la pérennité des structures et des situations géo-politiques débordent toujours, à la fin, la contingence des volontés politiques des hommes. C'est, en politique française, tout l'enjeu de l'aménagement du territoire. Car à l'inverse de l'Alsace, la Bretagne, par exemple, a fini par bouger parce qu'un long travail de désenclavement, commencé il y a quarante ans, a fini par produire ses effets.
Bien sûr, cela ne prouve rien quant à la relation entre contingence et nécessité. Pourtant, il est remarquable, dans l'exemple d'Emile Muller, que la contingence de son opinion politique (à l'origine il est socialiste) doive s'effacer pour
suivre en quelque sorte la nécessité de la géopolitique mulhousienne. En passant à droite, ce maire est resté cohérent avec le choix qu'il avait fait de traiter les habitants de sa ville comme un Directeur de Ressources Humaines. Voilà un exemple remarquable de problème politique où l'histoire joue tout son rôle dans l'analyse des tactiques et des stratégies possibles.
De l'exemple ci-dessus on peut d'ailleurs conclure, par exemple, que la ville de Mulhouse est pour ainsi dire condamnée à un certain rythme politique, car aux choix d'industrialisations «sauvages» auxquelles elles est contrainte, correspondent des réactions politiques de classe. La nouveauté, aujourd'hui, c'est que la «classe», comme on disait dans les années soixante, se reconnaît de plus en plus dans le Front National. Voilà qui ne laisse guère de choix à Jean-Marie Bockel. Cette nouveauté s'explique peut-être, d'ailleurs, par la transformation de la structure industrielle elle-même : la mono-industrie conduit au fascisme, parce qu'il n'y a même plus de «famille» industrielle, et donc de concurrence et donc de vie locale.
On est loin du sujet de mon étudiant, et pourtant cet exemple montre qu'il y a quelque part un sens de la contingence qui rejoint celui de la nécessité. C'est précisément là que peut intervenir la volonté pour ajuster l'un à l'autre, et pas forcément dans un sens plutôt que dans l'autre.
Dans Frall.doc j'avais évoqué les relations entre la volonté et l'histoire qui s'inscrivent dans les paysages avec les effets des retards ou des décalages entre le moment de la volonté proprement dite et sa réalisation tardive. Il y a là la fameuse «ruse» de la raison qui sanctionne impitoyablement les erreurs, c'est à dire l'absence de cohérence entre nécessité et contingence.
C'est un sujet fort intéressant et sans limites à la réflexion : il indique en passant, combien s'opposent des volontés «jacobines» et des volontés «libérales».
_____________________________________
Le quinze octobre de l'an dernier, je me suis posé, dans ce journal, une question étrange : comment les Anciens ont-ils pu vivre avec pour seule conscience historique la tradition orale? Je retrouve cette question dans un ouvrage de Finley sur les Grecs et les Romains et la naissance de la science historique. Disons que j'y retrouve cette confirmation du fait que l'histoire, telle que nous l'entendons et la pratiquons, n'avait pas de sens pour les Anciens.
Quelle sens a-t-elle donc pour nous ? Pourquoi ne nous contentons-nous pas d'une mythologie ou d'un vague récit ritualisé et cultualisé ? Pourquoi, enfin, avons-nous transformé en science, ce qui à l'origine était poésie ? C'est à dire divertissement ? (?)
Tout cela, je ne m'en rend compte que maintenant, rejoint évidemment la précédente réflexion sur les relations entre volonté et politique. Faut-il en conclure que les Grecs ne faisaient pas de politique ? Car enfin, si les Grecs faisaient de la politique comme nous, alors il n'y a aucune raison pour qu'ils n'aient pas eu autant besoin de cet outil qu'est la science de l'histoire. Et ce, pas seulement à partir de Thucydide ou d'Hérodote, mais déjà dans la Grèce archaïque, si ce concept a un sens.
Pouvons-nous imaginer une vie sans histoire ? Faut-il, peut-être, postuler qu'une grande partie de l'humanité, aujourd'hui, vit toujours sans Histoire ? Sans doute, et ceci expliquerait cela.
Comment ? Il faut relier l'histoire à l'histoire des formes de souveraineté et de pouvoir. L'histoire est une sorte de conquête du temps, une volonté de maîtriser la succession des faits dans leur causalité, de manière justement à poser le nécessaire par rapport au contingent. Mais une telle volonté ne peut pas provenir d'une forme autocratique de souveraineté, puisque cette dernière est par définition contingente, même si elle est rationalisée dans une structure dynastique. C'est donc bien la République (ou la Démocratie) qui a fait naître la contrainte de l'histoire comme science exacte. En me référant à mes réflexions sur le destin de ma ville natale, je me rends compte à quel point l'histoire est consubstantielle à la possibilité même de la gestion politique. Cela signifie, d'un autre côté, que le développement de l'histoire - il n'y a qu'à se reporter à Vico - implique une rationalisation, et donc une démocratisation, qui dépasse la volonté des monarques. A observer le traitement que font subir les tyrannies - communistes ou non - à l'histoire de leur pays, on voit tout de suite qu'elles se défont de cette science, en la réécrivant selon les besoins du moment. On efface un personnage d'une photographie seulement parce que sa présence ne correspond plus à l'interprétation présente du passé.
Cette logique conduit aussi à penser en termes plus graves : comme le pensait Marx, la démocratisation est un processus plus profondément relié à l'infrastructure de la société humaine qu'on ne le pense. Elle était déjà à l'oeuvre du temps des monarchies. Mais il reste à repenser cette infrastructure elle-même, il ne suffit pas de dire simplement que c'est l'économie, même si les transformations de l'économie font partie de la redistribution générale des cartes du jeu de la souveraineté et de son exercice.
L'éclaircissement de tous ces points me paraît crucial par les temps qui courent. L'antagonisme République-Démocratie libérale entre dans une phase dangereuse où la seconde possède les atouts d'une thèse qui peut se passer, justement, d'histoire, alors que la première est fondée sur une compréhension historique du temps. Il faut voir, à présent, si les valeurs de la République sont gérables, malgré tout et malgré notre scepticisme, par le libéralisme. Car la nécessité de l'histoire se fait jour sous la nécessité des valeurs : dans le cas de Mulhouse, c'est la répétition de l'injustice qui produit la répétition des crises. En réalité, l'indifférence de la Nation aboutit à une situation de ce qu'on appelle aujourd'hui de «subsidiarité». Démerdez-vous! Il n'est plus question de considérer le territoire comme un espace où doivent régner les valeurs choisis dans la Constitution, mais de renvoyer chaque parcelle de l'espace national (qui de ce fait n'est même plus national) à son propre destin aléatoire par rapport aux valeurs. Dans le libéralisme, la contingence est partout et la nécessité nulle part, puisque les conséquences des erreurs de gestion n'ont aucune importance morale, puisque la morale n'a plus aucune place dans les impératifs de gestion.
Tout cela me confirme dans le soupçon que les oppositions classiques entre Jansénistes et Jésuites, Protestants et Catholiques, Anglo-Saxons et Latins, républicains et démocrates libéraux, passent toutes par cette simple différence entre Platon et Aristote, entre le transcendantalisme et l'immanentisme. Mais c'est là que tout devient inextricable, car les deux thèses sont loin de s'opposer, comme le montrent Spinoza et d'une autre manière Kant et Hegel. Il faut en rester à l'idée que les «clans» d'idées se forment autour de dogmes amoindris, usés ou déformés par une utilisation réifiante.
Samedi, le 15 Novembre 1997
USTICA. N'en-ai-je pas encore parlé ? Notre nouveau bateau s'appelle Ustica. «Petit A» a été vendu, il était «trop vert».. Notre nouveau voilier est suédois et mesure onze mètres dix. C'est un magnifique sloop aménagé comme un yacht de luxe avec un confort absolu autant pour naviguer que pour vivre. Voilà, c'est fait, en un instant dessinés les contours de notre future existence.
Dimanche, le 16 Novembre 1997
La culture humaine est pleine de mystères. Savez-vous ce que sont les hâdith ? Comme le nom l'indique, il s'agit d'une chose arabo-islamique. Les hâdith sont des écrits classant les propos et les observations du prophète Mohamed dans la vie courante. C'est sans doute à un hâdith que l'on doit l'obligation pour les hommes de porter la barbe et toutes les autres joyeusetés de l'islamisme pur et dur. En fait, les hâdith forment une partie du «droit canon» de l'Islam, le reste provenant du Coran et aussi des fiqh, prescriptions plus juridiques que les hâdith, qui ressemblent plutôt à des conseils sur la vie de tous les jours. Ce sont des hâdith qui condamnent la femme musulmanne à la condition qu'elle connaît dans beaucoup de pays islamiques comme l'Afghanistan. Le plus intéressant là-dedans, c'est que le prophète lui-même avait interdit la prise de notes, précisant qu'il n'y avait que le Coran d'authentique. Il est frappant de constater, exactement comme dans le Christianisme, que ce commandement est gaillardement contourné, mais seulement deux ou trois siècles plus tard. Ce qui fait que les hâdith sont tous construits sur une tradition orale, bonjour l'authenticité !
Tant qu'on y est, un petit commentaire du Coran. Sourate LVI, verset 10 et suivants :
10 - «que ceux qui ont pris le pas en ce monde dans la foi y prendront le pas avant les autres:
11 - Ceux-ci seront les plus rapprochés de Dieu.
12 - Ils habiteront le jardin des délices,
13 - (Il y aura un grand nombre de ceux-ci parmi les peuples anciens,
14 - Et un petit nombre seulement parmi les modernes).
15 - Se reposant sur des sièges ornés de pierreries,
16 - Accoudés à leur aise et se regardant face à face.
17 - Ils seront servis par des enfants doués d'une jeunesse éternelle,
18 - Qui leur présenteront des gobelets, des aiguières et des coupes, remplis de vin exquis.
Stop. Pas la peine de répéter Salman Rushdie, je suppose, mais avouez quand même que la jeunesse éternelle des enfants pose un sacré problème. Quel fatras ! «jardin des délices», «sièges ornés de pierreries» : une curieuse opposition entre le végétal de l'Eden et le minéral «technique» (et économique) des pierres précieuses. Le tout d'une naïveté invraisemblable. «Accoudés, à leur aise, servis», «peuples anciens plutôt que modernes». Bref, il y a là un véritable déni du sérieux de l'existence. Si l'au-delà doit ressembler à cela selon la vision du prophète, c'est que ce prophète est un véritable béotien qui reconstruit son propre monde avec ses propres fantasmes et ses propres petits désirs de plouc. «Servis» : voilà l'idéal du musulman ? Etre servi ! Reproduire dans l'au-delà la servitude comme jouissance ! J'ai plutôt l'impression qu'un texte comme celui-là est destiné avant tout à justifier toute une biographie, voire donner le style de la maison !!!
Lundi, le 17 Novembre 1997
J'avance à petits pas vers l'intelligence de l'objet de la littérature. La notion de supplément devrait convenir à l'idée qui se dessine dans ma tête : ce qu'on écrit, c'est tout ce qu'on fait «de plus» que vivre. C'est ridicule, dit ainsi, mais c'est l'intuition de base que l'écriture est une sorte de plus-value de l'existence, et qu'il n'y a que celle-là.
Mais encore. L'écriture est une représentation qui fixe d'une manière ou d'une autre, car il y a mille écritures, quelque chose qui a été étant sous une forme ou sous une autre : une facture est la représentation d'une transaction qui a eu lieu, grâce à elle, on peut attester de l'existence d'une telle transaction. Une perception : une expérience est enregistrée par une inscription. C'est ainsi que naît l'histoire, par accumulation de documents écrits. On dit que les Grecs n'avaient pas, avant Herodote et Thucydide, ni le sens ni le besoin de l'histoire. Et si ces deux historiens n'étaient en fait tout simplement nés qu'au bout d'une certaine accumulation de représentations, à un certain seuil de possibilités d'exploitation de ces représentations ? Avant qu'un projet ne naisse, il faut bien que sa possibilité existe. A l'époque d'Hérodote, l'écriture était, après tout, encore à ses débuts.
Quand on commence vraiment à écrire, l'idée est avant tout de laisser derrière soi quelque chose de soi. Mais cette idée est sans doute encore très naïve, car après la mort on n'est plus dans le coup et le bénéfice escompté est purement fantasmatique. Que signifie «vivre dans la mémoire des autres ?» Pas grand chose. Au contraire, la représentation, elle, continue de vivre et elle s'ajoute aux représentations en général pour former, dans la logique de ce que je disais plus haut, une plus-value universelle. Voilà qui est plus intéressant que la prolongation du souvenir.
D'ailleurs l'histoire est une accumulation de représentations qui finit par faire une masse critique à forte valeur ajoutée :
c'est le premier pas de l'homme dans le temps ! Ainsi l'écriture forme un produit qui devient tout à fait autre chose que ce pour quoi elle a été inventée et utilisée. L'écriture commence avec les petits cailloux du Petit Poucet.
Samedi, le 13 décembre 1997
Libéralisme et ......? Au fait, qu'est-ce que l'on peut opposer au «libéralisme», concept éminemment ambigu depuis que l'on confond les libéraux des dix-huit et dix-neuvième siècles, où ils passaient pour les démocrates progressistes, avec les nôtres qui s'apparentent à la droite internationale et en gros aux conservateurs.
Libéralisme et républicanisme ? Allons-y, car l'idée de République est la seule qui puisse offrir une idée suffisamment structurée pour présenter une antinomie avec «l'anarchie de droite», devenue entre-temps l'ancêtre des nouvelles formes de fascisme. Ce qui différencie le fascisme historique avec le libéralisme, c'est la structure étatique du fascisme italo-allemand opposé à la structure éclatée du capitalisme international et à la forme «homo lupus hominem» qu'elle implique au stade micro-social (voir la criminalité américaine).
Le libéralisme et la République s'opposent, me semble-t-il sur deux plans psychologiques : passion et raison. Cette banale dichotomie indique deux voies totalement différentes. La première englobe la fameuse «loi du marché». Lorsque Adam Smith en fait le régulateur absolu de l'économie et finalement des relations humaines, il sous-entend implacablement que ce sont les domaines de la passion, c'est à dire ceux du besoin, des désirs et des tendances qui doivent dominer les relations humaines.
On pourrait invoquer ici, pour défendre ce point de vue, la position de Hegel qui affirmait que «rien de grand ne se faisait sans passion», ou celle de Hobbes qui pensait que l'état n'avait pas d'autre rôle à jouer que de limiter le degré de violence interne à la société à la seule fin de sa survie.
Dans ce schéma,
le marché est le point de rencontre des passions. Sur ce marché, les individus sont libres de choisir les règles qui conviennent à leurs ambitions, quittes à encourir, s'ils décident d'en prendre le risque, les foudres de la Justice, au cas où :
- ils auraient été reconnus coupables d'une violence considérée comme illégitime par l'état,
- et qu'ils n'auraient pas, à ce moment-là, disposé des moyens d'acheter la justice elle-même, autre forme de dominance du marché.
L'analyse marxienne de l'histoire montre relativement bien comment la violence est originelle ou consubstantielle à la formation du marché. Disons simplement que, de l'esclavage antique au salariat en passant par la forme féodale, c'est toujours la menace de mort qui forme le cadre de légitimation et d'efficacité. Personne n'a encore démontré le contraire, Hegel lui-même reconnaît cette logique impitoyable, même s'il la sublime dans la dialectique du maître et de l'esclave. Le fameux retournement qu'opère Marx par rapport à ce texte fondamentale de l'éthique hégélienne, c'est justement de soustraire tout le processus à sa forme fatale et idéalisée. Le SavoirAbsolu de Hegel fonctionne en fait comme le veau d'or qui avale les vies humaines pour se constituer sempiternellement le même. Pour Marx, au contraire, ce processus se détruit historiquement, il commence par un projet de perfectionnement de la nature humaine (il dit par exemple que les hommes ont choisi de se forger des yeux, et ils se sont forgé cette forme de perception). Historiquement ce perfectionnement c'est un projet qui passe par la formation du capitalisme et de l'industrie, puisqu'il s'agit précisément de détruire les causes de l'opposition entre le désir du maître et la peur de l'esclave. Forger un homme nouveau c'est détruire les raisons de l'angoisse primitive de l'autre, car l'autre n'est que la forme active du mystère de la réalité en tant que telle.
La République, alors. Dans la formation du marché, la République joue le rôle principal de guide du projet humain. Autant la passion se voue à des buts immédiats, ceux de la satisfaction des besoins et des désirs, autant la Raison ou l'Etat Républicain, vouent leur action à la l'élaboration continue du projet de perfectionnement de la nature humaine et de son cadre d'existence.
Une contradiction entre libéralisme et république m'apparaît sans cesse dans la difficulté que peuvent avoir les états «libéraux» comme les USA pour justifier des investissements massifs dans des projets aussi gratuits que la conquête de l'espace. La guerre froide aura abondamment servi de prétexte à des dépenses qui concourent en réalité à des projets totalement disjoints des finalités du marché. La conquête de la Lune illustre ce point aveugle, puisque l'échec d'une mise en coupe industrielle de notre satellite a été suivie par une quasi paralysie du projet spatial. Or, ce projet se poursuit malgré tout, malgré son coût pharaonique et l'absence de profits immédiats visibles. Depuis, bien sûr, les nombreuses applications des techniques satellitaires sont venus donner raison au projet initial, ce sont les retombées de l'effort et de l'investissement créatif aussi imprévues au départ que les applications fantastiques de la machine à vapeur, de la domestication du pétrole ou de l'électricité, ou celle de...l'oeil.
Ces exemples montrent au demeurant que le projet de perfectionnement de la position humaine dans l'univers se poursuit, au-delà de la critique des «utopies» fondatrices des Lumières. Le capitalisme creuse sa propre tombe, puisqu'à chaque avancée il détruit les raisons de l'asservissement humain en détruisant le travail inhérent à la production de richesse. Tout le discours actuel sur le travail représente en fait une sorte de chant du départ d'une forme de relations sociales dont on ne connaît pas la suite. Pourtant, elle s'invente déjà partout, et notamment sur le réseau de communication qui se tisse autour de la planète.
Le travail, en fait, change de nature, et en changeant de nature il change la relation à autrui. Ce changement est essentiellement une réduction à l'individu, une individuation qui a curieusement épargné cette forme d'action humaine. Demain l'homme ne travaillera plus pour une collectivité, car elle n'en aura plus besoin, mais il devra continuer de travailler pour lui-même, au sens où le travail - et ici Hegel retrouve sa pleine vérité - n'est pas une simple production d'objets de consommation, mais d'abord et avant tout de sens.
Dimanche, le 21 décembre 1997
Discussion avec Alexi. Etrange enfant. Maintenant qu'il est un peu piégé par ses études d'informatique, il cultive ses souvenirs de grec. Cela me rappelle douloureusement mon année d'études techniques à Morez en 1957, où je potassais en douce mon Speath, le manuel de Latin, en attendant de retourner au Lycée ! J'ai eu la chance de réussir, mais je crains que Alexi ai du mal.
Sujet de discussion, la question que je me posais plus haut : comment les Grecs ont-ils pu vivre sans mémoire historique ? Réponse d'Alexi, c'est pas si bête, c'est parce que les Grecs ne se posaient aucune question sur le changement de société, sur le progrès ou son contraire. Ils étaient contents de leur sort, ou disons qu'ils étaient incapables d'en imaginer un autre. Conclusion, en écrivant sa «Guerre du Péloponnèse», Thucydide n'a rien fait d'autre que de libeller l'acte de décès de la civilisation grecque ! Intéressant : notre rage d'histoire ne serait qu'un lent suicide culturel ?
L'Europe est donc un rêve américain ? Nous, Européens, ne rêvons pas de l'Amérique, ni de ce qu'elle représente, même si nous avons adopté leur installation technique dans la vie. Nous restons profondément étranger à leur...à leur quoi ?... A leurs états de conscience ? A leurs manières de concevoir le présent et le futur ? Comment pourrait-on définir leur vision du monde ? Cela doit se situer quelque part entre bouffer du pop-corn et regarder des matchs de base-ball à la télé. Dans les romans policiers américains les plus lisibles, la vie privée des bons flics (souvent juifs) tourne toujours autour des petites bouffes (juives pour faire contrepoids au pop-corn justement) et du sport. Les enfants de ces flics ne sont, en général, mis en scène que dans ces moments d'intimité culinaires et sportifs, ce qui est un signe qui ne trompe pas. Bien sûr, il y a aussi plein de scientifiques en Amérique, des savants qui s'esbaudissent devant leurs découvertes spatiales ou informatiques. Mais que cherchent-ils exactement ? Je n'arrive pas à le cerner. Ce que je constate, c'est qu'ils rigolent tout le temps, sans rien ajouter. Ils envoient des sondes sur Mars, font des milliers de photographies et se montrent à la télé en train de se réjouir devant leurs résultats. Mais on ne sait pas pourquoi. Ils sont contents, c'est tout. A la bourse de Wall Street ils sont aussi contents. Ils rigolent tous les soirs quand la cloche sonne la fermeture sur un nouveau bénéfice. Et puis ils vont bouffer et dormir.
Et nous ? Est-ce-que nous faisons autre chose ? Est-ce-que nous parlons d'autre chose ? Déjà nous passons une grande partie de notre temps à nous démarquer de tout ça. Depuis que j'accède à Internet au boulot, je regarde les chiffres : ils s'entre-tuent gaiement, les Américains, et je ne comprend pas comment ils font pour négocier cette réalité. Je crois l'avoir déjà dit, mais là où la France compte 600 homicides annuels, les Etats-Unis en allongent 25000. Proportionnellement ça fait au moins dix fois plus, ce n'est pas rien. Cela signifie très exactement que les Américains méprisent la vie dix fois plus que nous, Européens. Que faut-il en penser ? Faut-il se dresser sur nos ergots, indignés par ce mépris ? Ou bien les admirer parce qu'ils ne mégotent pas la qualité de leur existence ? Quelle est cette qualité ? L'honneur ? La drogue ? Je ne dis pas cela ironiquement, car on pourrait soupçonner les Américains de pratiquer une sorte de révolution permanente, ce qui leur éviterait d'en faire de vraies. Après tout, la Terreur de 1793 n'a fait que 4 000 morts, selon les recherches les plus récentes. Vingt-cinq mille par an ! Ce n'est pas encore un génocide, mais cela y ressemble fort. Toujours proportionnellement, cela fait plus d'une Terreur par an ! En France, les éditorialistes hurlent à l'absence de sécurité et exigent que la République remplissent ses devoirs à cet égard : pour six cens morts. Six cents homicides sont considérés comme intolérables ! Il y a un malaise.
Culturellement ils y paraissent sensibles, car la violence domine définitivement la scène. Elle fascine aussi le public européen, mais Derrick n'a pas grand chose à voir avec Silvester Stallone. Il n'y a jamais, dans le polar européen, cette démesure dans le crime, cette fuite en avant dans l'accumulation de cadavres. Maintenant je m'en souviens, ce qui m'avait frappé en tout premier lieu, lors de mon séjour en Californie, c'était la sirène des flics toutes les cinq minutes. Drôle de fond musical !
Samedi, le 27 décembre 1997
Encore quelques lignes pour cette année curieuse. J'ai envie de tordre le coup au dix-septième siècle. Quand je pense que c'était la référence de Debord ! Du moins son style qu'il a toujours exhibé partout, aristocratisme de dame de petite vertu, c'est si tentant. Bon, ne soyons pas si méchant, il est vrai que Guy était fasciné surtout par le cardinal de Retz, au demeurant le pire ennemi de Louis.
Tordre le coup à ce siècle du malheur, de la pénitence et du masochisme. Il me semble avoir déjà parlé plus haut dans ces mémoires de la réalité des chiffres démographiques : le grand Louis à dépeuplé la France et ses forêts comme le pire des Gilles de Rais, avec un raffinement de cruauté et d'arrogance telles qu'il n'y a peut-être que Hitler qui soit comparable. Mais qui osera comparer ces deux monstres ?
Le siècle de Louis est l'une des matrices du monde actuel : la crédibilité de notre époque va se chercher, entre-autre, dans ce qui s'est passé entre 1600 et 1700, pour aller vite. Au siècle suivant, n'existait pas encore notre manière de mythifier les monstres, il n'était pas question, sauf pour quelques protestants du Nord de l'Europe, de haïr ce monarque comme nous haïssons vigoureusement les Hitler et autres tyrans. Et pourtant ! Comment comprendre ce incroyable phénomène qui a si profondément marqué ce pays. Serait-ce tout simplement parce que ce siècle fut celui de sa naissance ? Une naissance qui ressemble à si méprendre à celle décrite par Lucrèce au début de son De Natura Rerum.
Dimanche, le 28 Décembre 1997
Je reviendrai sur le dix-septième siècle un de ces jours, après avoir refait un petit tour chez Bossuet et chez le petit duc de St Simon.
Ce matin j'ai des petites choses délicates dans la tête. De petites pensées anodines captées hier à la lecture de St Anselme de Cantorbéry. Voilà de quoi il s'agit : le brave théologien est célèbre pour en avoir «fini» avec les doutes sur l'existence de Dieu.
Samedi, le 17 Janvier 1998
Le texte de dimanche dernier a tourné court. Tant pis, je reviendrai bientôt sur la logique dite formelle des Scholastiques. Il me semble qu'il y a là des gisements de compréhension largement inexploités pour revenir à une méthodologie plus rigoureuse de toute appréhension ontologique.
Mais aujourd'hui je veux un peu délirer : la vie n'est-elle pas une vaste amplification artificielle de presque rien ? Le «presque rien» de Kirkegaard ou de Pascal ?
Mais encore. L'intuition est que, ce qui se donne aujourd'hui pour le sens ou la question du sens, ce n'est rien d'autre qu'une difficulté, un poids excessivement lourd. Celui d'une sorte d'obligation de justifier de l'existence, de lui donner une «substance», un ordre de nature à lui conférer son caractère de nécessité : en fait, la nécessité, autrement exprimé sous le nom d'Ananké ou encore de tragique, ce ne serait pas quelque condamnation transcendante qui se déroule, mais une astuce proprement littéraire pour donner du «goût» à ce qui se présente comme un immense vide. D'où la pertinence évidente des thèses hédoniques ou épicuriennes, ou encore bouddhistes. Le Tao ne dit pratiquement rien d'autre.
La nuance, c'est que le côté triste, douloureux et finalement ennuyeux de l'existence est totalement fomenté, totalement construit : exactement comme la pénurie du capitalisme est une fausse pénurie - qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire des hommes que des pénuries accidentelles qui ont bon dos pour justifier une «économie» des richesses qui permettent à certains de gérer les biens au nom des autres. La leçon que peuvent encore nous donner les Indiens d'Amérique du Nord ou du Brésil, c'est qu'une vie escomptée est une vie foutue.
Encore : bien sûr toutes les formes sociales choisies pour affronter les nécessités de la survie ont leurs côtés faibles et difficile à admettre pour nous. Le côté collectif de la vie des Jivaros, par exemple (encore qu'on surestime largement la dimension proprement tribale de leur existence) nous est proprement impossible. Mais nous devrions nous souvenir qu'à quelques décennies d'ici, en arrière, nous étions encore à peu près aussi tribaux que n'importe quel Fang ou n'importe quel Nambikwara.
Il faut que je relise encore une fois la Part Maudite pour comprendre quel rôle exact joue la consumation dans ce schéma. Car s'il est vrai que l'homme «surproduit» exactement comme les êtres naturels, alors il y a un défaut quelque part, quel que soit le sens de ce défaut. Ou alors cette surproduction recouvre exactement le caractère mystérieux de l'existence de la conscience. A la profusion naturelle, correspondrait la profusion psychique ( la libido, en fait), la pulsion qui décide de l'entropie ou de son contraire. La consumation serait donc le lieu où s'opèrent les choix fondamentaux, ceux qui doivent orienter, donner son sens, à l'existence.
D'où l'importance fondamentale du politique : notre histoire tragique ne reflète peut-être rien d'autre que le caractère totalement aléatoire des choix antérieurs, leur absence de rigueur politique. A lire Montesquieu, par exemple, on se rend bien compte que ses modèles sont toujours des fictions qui ne marchent qu'à de rares occasions et pour un temps très bref : les Monarchies ne sont de bonnes Monarchies que à telle époque, les bonnes Démocraties etc....
Aujourd'hui le panorama est particulièrement brûlant : la question du chômage et de la destruction du travail laisse entrevoir que l'on se trouve devant un nouveau choix, et ce genre de situation s'appelle Révolution.
Dimanche, le 18 Janvier 1998
Encore une page noire pour Catherine Trautmann dans le Monde de ce matin. La greffe ne se fait pas entre les «ploucs» provinciaux et l'Establishment des châteaux de la Loire et du 16ème arrondissement. Les explications politiques ou sociologiques ne manquent pas pour comprendre cette allergie des Parisiens. Une situation florentine de dagues cachées sous les beaux costumes Cerruti des ex-hiérarques du secteur. En fait, une langueur de languiens sans intérêt aucun.
Mais encore. La question du statut de la culture n'est jamais réglé. Ou plutôt des relations entre la culture et l'état. Mon collègue allemand Wolfgang me fait, ces derniers temps remarquer que l'important pour les collectivités responsables (l'état en France, les Länder et les communes en Allemagne) serait de trouver un concept de remplacement ou de compensation à la diminution drastique des budgets. Il dit : - On supprime les corps de ballet, OK, mais que met-on à la place ?
Comme si la question était évidente et comme s'il était absolument certain que ce soient ces collectivités qui ont vocation à fabriquer la «culture» et, qui plus est, à la définir forme et fond.
En ce qui concerne Catherine, j'ai l'impression qu'elle ne fait rien d'autre que gérer les mécontentements inhérents à l'absence, non de pensée ou de pensée des finalités propres au domaine culturel, mais de celle d'un projet plus global de tout le gouvernement. Jack Lang bénéficiait en 1981 d'une marge de manoeuvre énorme : celle qui séparait de facto vingt-cinq ans de gouvernement de droite d'un projet abstrait, mais qui avait toutes ses chances. Aujourd'hui c'est le projet de la Gauche qui est d'avance suspect, et cette suspicion s'exerce d'abord à l'encontre de la représentante de la «Culture» parce que c'est là que se trahit le mieux l'absence de projet de cette nouvelle gauche. L'absence ou l'impuissance, ce qui revient au même.
Cette situation reflète en même temps l'incapacité des acteurs de cette culture à comprendre eux-mêmes ces enjeux, alors qu'ils paraissent à priori plutôt favorables en général à ce gouvernement. Il est sûr que les mécontentements ne sont pas magiques. Ils prennent racine dans des situations bien concrètes, l'absence d'argent venant en premier, liquidatrice de projets culturels, d'emplois, de situations humaines trop humaines etc.. D'où l'esprit de scandale tout naturel : c'est la gauche qui «liquide» elle-même ce que la droite a encore laissé vivre, par prudence, quelques mois de plus.
Mais encore ? Que penser de définitif sur le rôle précis de l'état par rapport à la culture ? Existe-t-il une dialectique qui puisse donner une réponse claire à ce souci ? En gros, en très gros, la droite serait plutôt passive alors que la gauche est supposé culturellement créatrice. Mais bon dieu qu'est-ce-que ça veut dire ? Que la droite ne se mêle pas de modifier la superstructure alors que la gauche devrait fabriquer de l'idéologie sous toutes ses formes ?
Absurde, comme il est absurde de maintenir que la vraie culture naît de la tyrannie, car en disant cela on a déjà typé la culture en question, déjà défini d'avance ce qu'était la vraie culture ou les «arts nobles». En ce moment on défend ces arts nobles avec un acharnement douteux, douteux parce que ces arts nobles proviennent directement de l'élite, c'est à dire d'une bourgeoisie dont les intérêts sont protégés par cette forme et pas par une autre. Je veux parler ici du tragique : le tragique est la nourriture première des arts bourgeois. Il enseigne mieux que tout le reste le cynisme, la résignation et l'absurde. Au fond, on ne s'est jamais demandé pourquoi les élites occidentales se complaisent depuis si longtemps dans la représentation de la Tragédie. La réponse la plus simple est qu'elles n'ont pas le choix que de représenter ce qui les constituent, représentation qui vient corroborer la justesse de leur situation ontologique. Brecht avait vaguement compris cela mais son théâtre fonctionne hélas encore dans une auto-dérision qui ressemble à s'y méprendre à cela même qu'il critique. La souveraineté de Shakespeare provient de ce qu'il ne montre jamais autre chose que le résumé de cette critique du tragique.
Jeudi, le 29 janvier 1998
Le succès est le prix à payer pour une trop grande correspondance avec son époque. Toutes les analyses transcendantales échouent à rendre compte des décalages entre la pensée et l'étant, ou du moins y-a-t-il là des asynchronies dont il est aisé de tirer des conclusions idéalistes. Si, en effet, la pensée vit en avance (ou en retard ?) il est difficile d'admettre les thèses d'un entendement synthétique à priori. Hegel dit que l'homme peut, «au mieux», être son temps. Si je me réfère au mien, je dirais plutôt «au pire».
Cette pensée me vient en écoutant un pot-pourri dirigé par Léonard Bernstein. La lourdeur enragée de cette direction fait immédiatement penser à sa clientèle américaine si vulgaire, un style pompier difficile à supporter, surtout avec des airs comme ceux de Verdi ou de Haendel. L'eclectisme de Bernstein est d'ailleurs extrêmement suspect, pour lui tout est musique, y a qu'à balancer les bras en l'air et aimer ça !
Mercredi, le 4 Mars 1998
Tout un mois de silence ! Un douzième d'année ! Le mille deux-centième d'une vie ! Comme le temps est élastiquement relatif ! Pendant ce temps mes autres mots continuent de travailler sur le Net !
Mais je ne suis pas resté inactif pendant tout ce temps. J'ai affiné ma théorie, MA théorie. Non, je rigole, comme dit Lucas. N'empêche, mon idée-soeur de la Docte Ignorance de Nicolas de Cues fait son chemin. Fait ses chemins devrais-je dire, car elle s'affine en moi en même temps qu'elle se fraye un chemin à l'extérieur. Il faut être extrêmement prudent lorsqu'on envoie une idée à l'extérieur, car ce voyage risque de lui être fatal. Je m'en suis rendu compte en rédigeant toute une série de textes différents sur le même sujet. Il aura fallu réécrire de multiples fois pour ne pas trahir l'intuition fondamentale du «Deuxième Entretien Préliminaire». (interruption)
Jeudi, le 5 Mars 1998
Il faut que je me ramasse sur ce qui me reste à vivre. Lors de mon dernier exposé sur la Docte Ignorance et les Droits de l'Homme, j'ai provoqué deux types de réactions : la première a été une sorte de désespoir chez certains. Ceux-là prenaient brutalement conscience de leur position réelle par rapport à la vérité et aux fables de la science : ils ont au moins compris que les vérités de la science ne les concernaient pas là où ils pensaient ( où plutôt là où ils s'abstenaient jusque-là de penser...). D'où des exclamations du genre :- «mais que reste-t-il alors ?» ou encore - «qu'est-ce qui pourra encore nous aider ?» . A ceux-là j'ai tenté de répondre en disant que le désespoir lui-même était savoureux et que c'est l'absence d'aide qui donne le véritable bonheur. Il faut creuser cela, car j'ai dit ça un peu en l'air, j'avoue. Ce serait peut-être le lieu de refaire faire surface au sujet, justement. Qu'est-ce que le sujet ? Sinon la réalisation de sa position solitaire dans le puzzle de l'immanence ? Quelle est cette position ? Elle est destin, et le bonheur ne peut provenir que de l'assomption du destin. L'assomption du destin est ce qui manque peut-être au socratisme, et que reprend Nietzsche. D'où peut aussi se poser la question du destin individuel et du destin dit «historique».
Les autres réactions étaient le doute. Ceux-là veulent un exemplaire de mon texte pour «vérifier» s'ils ne se sont pas laissés avoir par ma rhétorique. «Il faut voir si tout ça ne tourne pas en rond». A quoi j'ai répondu que ça ne tournait pas moins en rond que la Phénoménologie de l'Esprit. Excusez du peu, mais comment dire ?
Bref, la Docte Ignorance a commencé de faire un chemin.
Une réaction plus originale a été de classer ma réflexion dans un «idéalisme échevelé». Etant donné le peu de cheveux qui me restent, j'ai trouvé cela très flatteur... Mais encore. Il est vrai que le concept d' «égalité gnoséologique» que j'ai utilisé peut prêter à confusion, c'est à dire entrer dans cette catégorie métaphysique que j'ai moi-même critiqué dans le Deuxième Entretien, celle de la connaissance. Tout reporter à la connaissance a été une opération idéologique conforme à celle de la Théologie et à la définition de dieu. Il est donc difficile et dangereux, voire une pure et simple trahison, de paraître répéter l'opération sans précautions et sans affinement du concept.
En réalité, l'idéologie de la connaissance ne commence que là où elle prend toute la place en positif, c'est à dire là où elle se présente comme progression positive liée à une méthode et à une finalité. En général eschatologique. Au contraire, là où la problématique de la connaissance s'est détachée de son chemin de croix hégélien, elle est devenu autre chose qu'elle-même, elle est devenue praxis, c'est à dire choix radical de soumettre les idées à la souveraineté de la vie, et donc de la «matière». Voyez Marx et la lutte de classe. Voyez Eckart, son «idéologie» est pratique, et essentiellement pratique, exactement comme n'importe quel yoga.
D'ailleurs il faudrait vérifier certaines choses.
_______________________________________
Le langage doit s'émanciper.
Vendredi, 6 mars 1998
Le langage doit s'émanciper. C'est l'époque qui le demande.
Samedi, 7 mars 1998
Il faut que je réfléchisse en écrivant. Les menaces qui pèsent sur la démocratie du fait de la renaissance de courants fascistes reposent toute une série de questions. Furet fait rage autour de ceux qui prétendent trouver la naissance du totalitarisme dans la Terreur.
Question : pourquoi les actes immondes du vingtième siècle doivent-ils se refléter dans cet épisode de la fondation de la République ? Sinon que l'opération qui a consisté à établir une telle réflexion, et cette opération seulement, permet de remettre en question ce qui a été fondé, à savoir la démocratie. On perçoit d'ailleurs dans les discours le déni constant de la démocratie : par exemple dans le fait de poser la question de savoir qu'est-ce-qui justifie le droit de la majorité alors que le principe de l'égalité donne à chacun autant de valeur qu'aux autres ? Ceux qui posent cette question refusent l'idée que la sommation des droits et donc du fait que la valeur des individus se réalise dans les majorités, justement, et non pas dans les individus. La vertu civique ne peut pas exister dans les individus, elle est dans la démocratie, c'est à dire dans la répartition de la volonté collective en majorité et en minorité. Ce que ces messieurs ne veulent pas non plus admettre, c'est que le respect des majorités n'est pas le respect d'une force majoritaire - une force n'est jamais majoritaire par définition - elle est le respect de la volonté coagulée en majorité. Les minorités deviennent, au contraire, les représentantes des volontés individuelles, ou de l'individualité de la volonté, à ce moment-là contradictoire avec l'intérêt général. La majorité n'est pas non plus la somme des volontés individuelles, car le principe de la majorité implique une transformation du désir individuel en désir collectif, deux éléments de volition qui ne peuvent pas se recouper. C'est ce qui fait la fragilité de la démocratie. La démocratie repose sur une base «irréelle» en ce qu'elle prend sur elle de transmuter les volontés individuelles en volonté collective.
Précisons encore. Que se passe-t-il lorsqu'une majorité se dégage en faveur de tels partis ou tels représentants de la nation ? Cela signifie-t-il que chaque électeur s'attend à ce que son désir soit satisfait en échange de son suffrage ? Certainement pas. Ce à quoi il s'attend, en donnant sa voix à un représentant, c'est que ce représentant, ou son parti, exerce le pouvoir. C'est la faillibilité de ces représentants elle-même qui fait la démocratie, c'est à dire qui donne l'occasion et impose la nécessité de remettre en jeu régulièrement et le plus souvent possible, la possession du pouvoir. Les bonnes âmes - celles-là mêmes qui ont fondé le principe de la représentation - souhaiteraient, ou font semblant de souhaiter, que la représentation ne soit qu'un paravent pour l'exercice d'une démocratie directe ; c'est à dire qu'il font semblant de croire que la démocratie c'est l'exercice du pouvoir par la majorité
des citoyens et non pas par
la majorité qui s'est exprimée dans les suffrages. Et qui n'a rien à voir avec la première.
La majorité qui s'exprime dans un suffrage, c'est le pari démocratique, c'est la confiance provisoire que fait une majorité de citoyens à des représentants qu'ils choisissent. C'est le choix qui est démocratique, la désignation de tels représentants par préférence à d'autres, et non pas l'effectuation
des choix programmatiques.
En un certain sens, le principe démocratique s'oppose à la métaphysique de l'individuation, sauf à se souvenir que l'individu ne peut naître que dans les conditions de la cité. Les thèses furetistes, qui ne sont rien moins que les thèses des Girondins, des Feuillants et des Indulgents, exhorbitent l'individualité de sa sphère citoyenne (ou politique). Elles ne font que cacher le désir de remettre en usage ou de redonner cours forcé à
l'individu-souverain , c'est à dire à la Monarchie ou pire.
Essayons maintenant de faire pièce à l'argument qui consiste à dire que le principe de la majorité comporte le risque de la médiocrité ou pire, de la paralysie de l'état. Une République n'est jamais paralysée, précisément parce qu'elle comporte toujours des mécanismes d'appel de la situation présente. Les Romains avaient par exemple la Dictature, qui n'est pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui par dictature. Les dictateurs romains avaient plein pouvoir pendant un an pour redresser une situation désespérée, mais lorsque le terme était échu, et quelle que soit la situation, ils perdaient leur pouvoir, sauf à être réélus, ce qui n'est pas arrivé très souvent. Notre république a d'autres mécanismes, dont nous avons eu un exemple en 1997, la dissolution, sans parler des Questions de confiance au Parlement ou les motions de censure, qui peuvent aboutir à une dissolution de fait.
Une remarque historique s'impose ici. Depuis le coup d'état de Charles De Gaulle, en 1958, une abondante argumentation veut prouver l'impéritie de la Quatrième République, incapable selon ses adversaires de stabiliser l'état afin de parvenir à gouverner. Cette critique a fait long feu, mais personne n'ose aujourd'hui lui tordre définitivement le cou. La Quatrième République a été une période hautement efficace dans tous les secteurs de la Nation. Les continuels changements de gouvernement n'ont aucunement nui au rétablissement des libertés - remises sous le boisseau par le général De Gaulle - au développement économique ni aux profondes réformes de structures, comme la démocratisation de l'enseignement qui est un projet socialiste, repris par les gaullistes dans les tiroirs des ministères. On sait que cette république est tombée sur la question coloniale, véritable maladie congénitale héritée de la Troisième République. Le dictateur De Gaulle qui a réglé cette question, exactement comme le dictateur Fabius a réglé la guerre Punique, s'est incrusté au pouvoir, contrairement à Fabius.
Car, le principe de la majorité doit se retrouver dans le fonctionnement de l'état républicain. C'est à dire que les gouvernements passent, l'état demeure, mais l'état demeure en parfait état de marche. La solidité de l'administration républicaine est garantie par la pureté du fonctionnement démocratique. Autrement dit, une administration républicaine ne doit pas pouvoir se détacher de la logique politique des autorités législatives, exécutives et judiciaires, de par la fixité même des règles démocratiques. Une administration qui ne peut pas compter sur une permanence abusive d'un pouvoir ne peut pas dégénérer en bureaucratie parasite parce qu'elle est le lieu même d'une instabilité active déterminée par la variété des politiques qui sont mises en œuvre. Une administration ne devient une bureaucratie tyrannique que si le pouvoir politique s'enlise dans une caste permanente qui phagocyte progressivement tous les rouages de cette administration. Faut-il choisir entre le spoil-system américain et l'administration fonctionnarisée à la française ? Oui, je pense que le spoil-system comporte le danger d'une administration politisée qui dispose de longs mandats, c'est à dire de temps suffisant pour infliger des corrections irréparables à la démocratie elle-même. L'exemple actuel est fascinant : Clinton n'arrive pas à se servir de son administration parce que le Législatif est Républicain, ce qui aboutit à une paralysie quasi totale.
La fascination pour un état fort provient directement des changements d'échelle de l'économie mondiale. A l'heure où certaines multinationales pèsent plus lourd que beaucoup d'états, il est tentant de critiquer une démocratie qui ne suit pas un rythme de planification dans les termes de ces multinationales. C'est confondre la planification économique avec la gestion politique d'un peuple et de ses désirs, c'est à dire identifier la finalité citoyenne à la finalité économique. Il s'agit là, à l'évidence, d'un choix idéologique qui ne peut en aucun cas se prévaloir d'une rationalité supérieure, d'autant que l'économie elle-même ne peut se soustraire à la sphère politique. A la limite, la sphère politique peut se déplacer dans les conseils d'administration des multinationales, un phénomène qui s'est déjà produit à la suite de l'écroulement de l'Empire romain, lorsque la Papauté a monopolisé les richesses et tiré des siècles de pouvoir de ce monopole. L'Eglise Catholique a été la plus grande multinationale de notre histoire, c'est le lien secret qui lie le libéralisme contemporain aux religions et au fameux «retour du religieux».
Vendredi, le 13 mars 1998
Coup dur mercredi soir à Condorcet. Joel me bâillonne littéralement à propos de l'impérialisme et de l'échange inégal. L'occident n'aurait tiré aucun profit de ses nombreuses colonies ! Aucun profit ?
Si c'était vrai, cela emporterait une grande partie de mes «certitudes», il faudrait réviser sec la structure générale de mes opinions historiques !
Sur le moment je n'ai pas pu reprendre mes esprits. Joel a une méthode assez stalinienne pour faire taire un «opposant»..Mais voyons. L'Empire romain n'aurait tiré aucun bénéfice de ses multiples conquêtes ? Bon, sans retourner jusque-là, mais pourquoi pas, tenons-nous en aux impérialismes classiques et révisons tout ce qui s'est écrit là-dessus. On verra bien. En tout cas il me paraît énorme d'imaginer que l'impérialisme nous a «coûté» plutôt qu'il ne nous a rapporté, ne fût-ce qu'en terme de développement intérieur.
Samedi, 14 Mars 1998
Quelle était mon idée, au fait ? Simple, et partie intégrante de tout ce que je pense de ce siècle : les pays industriels (en gros l'occident) commencent à souffrir de pertes de substance liée à l'affaiblissement de la domination impérialiste-coloniale (ou néocoloniale, comme on voudra). Cette perte de substance m'a paru particulièrement importante en Grande Bretagne, ce qui m'a paru expliquer, sinon justifier, d'une certaine manière le Thatchérisme : il n'y avait pas le choix pour compenser la perte de l'Inde, il fallait compenser notamment par du surtravail et une réduction de la protection sociale.Cette thèse m'a valu les hauts-cris du genre : la thèse de l'échange inégale est fausse, c'est démontré etc...
Cette perte de substance va évidemment de pair avec l'augmentation de la puissance des multinationales qui délocalisent les zones de richesses en homogénéisant le tout du monde, c'est ce qu'on appelle la mondialisation : la pauvreté aux USA n'est qu'une expression de l'importation du Tiers-Monde dans les zones développées. Pour être plus clair : à la belle époque des pays de l'Asie du sud-est, on pouvait penser que le capital financier mondial s'était attelé à la tâche de former de nouveaux marchés solvables au détriment des anciens, c'est à dire au prix de leur affaiblissement. Cette hypothèse semble aujourd'hui compromise par la crise qui sévit en Extrême-Orient, mais les crises passent et il n'est pas certain que le trend général ne soit pas celui d'une extension de la zone industrielle, ce qui est une absurdité tant il est vrai qu'on ne pourra pas éviter une division internationale du travail. On ne me fera pas avaler que Cantillon avait tort lorsqu'il disait qu'entre l'hectare de lin qu'il fallait pour fabriquer un boisseau de dentelle et les quarante hectares de vigne qu'il faut pour fabriquer la quantité de valeur équivalente en vin de Champagne, il y a une inégalité de l'échange : c'est l'économie coloniale dans sa plus belle expression, même s'il y a derrière cette comparaison un zeste de la théorie des physiocrates. Ce que les économistes qui critiquent ce point de vue oublient, c'est que dès le seizième siècle, la Hollande et la Belgique avaient soutiré à l'Espagne le plus clair de son capital financier, ce qui a donné une accélération foudroyante à l'industrialisation de ces pays et à leur puissance politique, par ailleurs. Voir le bel impérialisme néerlandais en Indonésie et ce qu'il a rapporté.
Pire : le néocolonialisme tel que l'analyse par exemple Pierre Moussa, se présente comme un blocage planifié de l'accumulation primitive de capital - ce qui maintient définitivement la dépendance capitalistique des pays en développement. L'ancien colonisateur fait opérer à son capital fixe (usines et machines) X rotations équivalent à Y profits, puis il revend ce capital déjà obsolète en terme de productivité à des pays en développement. Comme ces pays n'ont pas de capital financier a priori, on leur prête aussi cet argent dont le remboursement porte sur la période d'utilisation restante du capital fixe d'occasion. Au moment de la fin de l'amortissement de ce capital, il est bon à jeter. Résultat : il n'a pas produit un sou de profit et encore moins une amorce d'accumulation. Tout juste a-t-il permis de créer quelques emplois en assurant une certaine autarcie dans le secteur de production (en général, et on l'a vu systématiquement en Afrique ex-française, des usines de mise en bouteille de boissons, des usines d'allumettes ou de cigarettes, de boîte de conserves etc.. En général aussi, ce sont les groupes français de production de ce secteur qui, en fait, tirent une sorte de sur-surprofit de ce capital obsolète, dans un contexte où il ne risque pas de concurrence liée à la productivité).
L'histoire de l'Indonésie, ces dernières années, me paraît parfaitement illustrer ce piège dans lequel sont pris les pays qui n'ont pas de capital financier assez solide. La crise qui frappe Djakarta aujourd'hui est principalement liée aux projets pichrocolesques de Suharto, voulant se construire une industrie aéronautique et automobile dans un marché mondial déjà saturé. Cela signifie clairement que si l'occident se sent menacé dans ses oeuvres vives (Boeing, Airbus ou General Motors) il se retire du jeu, préférant se reporter sur les anciens marchés solvables plutôt que de continuer à financer un développement qui risque à terme d'entrer
vraiment en concurrence avec lui. Voyez l'histoire d'Airbus en Chine : les habitants de l'Empire céleste ne sont pas dupes, ils veulent des transferts de technologie parallèlement à l'acquisition des marchandises de haute technologie. Cela reste d'ailleurs assez illusoire pour eux, dans la mesure où ils n'en ont pas pour autant acquis le capital financier nécessaire pour mettre en oeuvre un tel développement. Voyez ce qui est arrivé aux conquérants de l'espace et grands producteurs de Bombes H de l'ex-Union Soviétique. (A propos de laquelle il est intéressant de noter aussi 80 ans de troc inégal avec l'occident. Là aussi on a pillé la substance d'un pays au nom d'un différent idéologique).
Et cet exemple m'amène à un autre mécanisme qu'il faut bien aussi identifier comme une conséquence du développement inégal (et de l'échange inégal) : c'est la stérilisation forcée des pays qui possèdent d'immenses richesses minières ou agricoles, stérilisation qui a surtout pour motif le contrôle des cours de produits des monopoles déguisés. Exemples : le Congo Kinshasa ou le Gabon. L'un et l'autre de ces pays possèdent de quoi faire baisser de manière drastique les cours du cuivre, de l'or, du diamant, du manganèse ou du fer et de beaucoup d'autres produits. Par le biais de la rétention de capitaux (ce fut le cas pour le Gabon qui a cherché pendant trois décennies à mettre son fabuleux gisement de fer en exploitation, mais Bongo n'a jamais trouvé les sous qu'il fallait, alors que le pétrole a immédiatement trouvé investisseur, pour d'autres raisons dont la concurrence), les multinationales préservaient bien mieux leurs propres profits qu'en tentant de les exploiter eux-mêmes. Pas de capitaux financiers, pas de capitalisation ni accumulation primitive : où sont les bourgeoisies nationales des pays africains ? Y a-t-il des cadres supérieurs africains ailleurs que dans les gouvernements et les organisations internationales ?
L'Asie a pu faire illusion, notamment le cas des «dragons». Mais la crise montre étonnamment bien ce qui se passe lorsque les capitaux financiers étrangers se font la valise : ce qui reste ne suffit pas à maintenir l'appareil industriel péniblement construit en activité. Encore une fois : comment peut-on nier l'échange inégal ? Dernière question, a-t-on vu un jour les cours du café ou du cacao menacer le panier de la ménagère européen ? Oui, pendant la guerre les Allemands ont dû se passer de café parce qu'ils n'avaient aucun marché colonial, mais en France on continuait d'en boire après les rutabagas...
Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui explique les fascismes de l'entre-deux guerres, et celui qui recommence à ramper au coeur même de l'Europe ? Sinon ce choix idéologique de repli sur une position provisoirement supérieure ? Mais tout le monde sait que ce repli est impossible sans qu'une guerre n'éclate tôt ou tard. La xénophobie a toujours crû là où l'impérialisme a connu des faiblesses pour une raison ou une autre. Ce fut le cas même chez les Romains à des époques où l'Empire n'avait rien à craindre, mais où certaines marches étaient constamment menacées (entre l'Italie du Nord et la Provence au deuxième siècle avant JC).
Dimanche, le 15 mars 1998
Les dimanche sont-ils rédempteurs ? Je voudrais sortir de la théorie. Pourquoi des théories? La vie n'est-elle pas d'abord simple ? Mais faite de quelle simplicité ? Hier j'ai relu quelques pages de Saint Just. Ce type était vraiment génial, une souplesse d'analyse pas du tout idéologique. A propos des premiers temps de la Révolution : «La conduite du peuple devint si fougueuse, son désintéressement si scrupuleux, sa rage si inquiète, qu'on voyait bien qu'il ne prenait conseil que de lui-même. Il ne respecta rien de superbe ; son bras sentait l'égalité qu'il ne connaissait pas». Il ne prenait conseil que de lui-même : c'est exactement la rupture du lien d'autorité que nous avons tous forcé il y a trente ans dans les universités. Au grand dam de nos vieux mandarins.
On est venu récemment me solliciter pour le trentième anniversaire de Mai 68 ! C'est une plaisanterie. Si encore cet événement avait été une véritable révolution, il méritait un hommage, comme la Révolution Française a mérité son bicentenaire. Mais une vulgaire fiesta de jeunes bourgeois déboussolés, une Fronde de petits seigneurs décavés ! Celui qui me demande cela est en plus celui qui a imprimé sur sa Ronéo mon premier tract du tout début de Mai, où je disais justement qu'il ne fallait pas s'attendre à une révolution de la part de jeunes bourgeois énervés, mais néanmoins ne pas se gêner pour faire la fête. On fait et on dit des conneries quand on est jeune, ce que reconnaissait d'ailleurs fort bien Saint Just qui avait aussi fait quelques conneries au début de sa jeunesse. Voyez sa biographie.
J'ai disgressé sur Mai à cause de ce sentiment qu'exprime St Just dans la phrase citée plus haut. En Mai 68, il faut bien reconnaître que nous avons connu une ivresse semblable. A propos des situs, j'ai déjà noté une fois que leur illusion principale - une illusion qui était aussi une géniale découverte tactique par l'audace qu'elle a conféré aux étudiants - était que la démocratie était devenue une réalité telle qu'elle ne pourrait plus se défendre contre un mouvement révolutionnaire intellectuellement légitime. Je pense que Debord a dissout l'Internationale Situationniste à partir du moment où il a pris conscience de son erreur. Il pensait que l'Europe démocratique était déjà faite. Debord n'était ni Marat, ni Hebert, il n'envisageait de voir couler le sang que métaphoriquement ! Mais l'Histoire ne va pas si vite. L'Histoire ne va d'ailleurs nulle part où l'on ne veuille qu'elle aille. Cela, Guy-Ernest l'avait compris.
Saint-Just : «Vous vous révoltez tous, lorsqu'on vous parle de déployer la force ; point de sang, dites-vous sans cesse ; j'ose donc vous demander ce que vous prétendez faire de la force que vous appelez ici, s'il est selon votre coeur de ne la déployer jamais : si vous ne devez jamais l'appliquer, pourquoi l'établissez-vous ?» (Jacobins, séance du 22 Octobre 1792). Courage et lâcheté. Mais aussi grand réalisme : des arguments comme ceux-ci son sûrs d'emporter la décision politique, car ils sont comme une lecture psychanalytique de l'action qui a lieu : St Just fait prendre conscience aux sans-culottes qu'ils ont mis en place un dispositif et une force auxquels il suffit maintenant de donner un but. L'action révolutionnaire est ainsi faite, que les masses bougent, font et défont, organisent spontanément et amassent du pouvoir sans avoir immédiatement conscience de la finalité de leurs actes. Les dirigeants sont ceux qui donnent cette direction de l'action. Ils portent donc aussi la responsabilité de la réussite et de l'échec.
Toujours la théorie ! Pas moyen d'en sortir. Et pourtant, j'aimerais habiller le présent de ses vrais atours, de ses véritables beautés et laideurs. Me saisir dans ce présent et me saisir tellement bien (par l'écriture ?) que ce présent pourra rester éternel : que ce que mon esprit a représenté ici, sur cet espace abstrait de mon ordinateur, soit tellement vrai et près de ce qui est là, maintenant et ici, que cela participe de l'éternité des choses en leur vérité. C'est peut-être cela le génie de la littérature que je méconnais tellement, la capacité d'atteindre une sorte de coïncidence entre le présent et l'éternité par la saisie de l'immobilité de l'être présent. Encore.... de la théorie !!
Et pourtant ne devrais-je pas décrire combien je souffre dans mon corps, par exemple ? Que mon dos est une plaie fermée qui contient de la douleur brute et que bien d'autres points de ce corps me font parfois penser que je souffre d'un tabès, cette séquelle d'une syphilis que je n'ai pas eu. Je n'en suis pas encore à me mettre soudain à hurler, je me tais plutôt, comme s'il ne se passait rien, mort à petite dose quotidienne. Actuellement je fais un mi-temps existentiel. A partir de midi, le courage et la force que j'ai pu accumuler pendant la nuit où j'ai encore l'immense privilège de dormir, m'abandonnent. C'est pourquoi je me lève très tôt pour encore vivre un peu. Comme quoi il vaut mieux faire de la théorie, car le présent ne mérite pas l'effort de la description.
Jeudi, le 19 mars 1998
O Königin ! O Göttin ! lass mich ziehn !
Samedi le 21 Mars 1998
En faisant l'inventaire du mitterrandisme, Jospin n'a pas fait qu'un travail de brocanteur politique, il en a pris de la graine. Son appel du perron est un trait de génie tactique dont les conséquences vont se diffuser très rapidement selon une arithmétique politique implacable.
En fait, le Premier Ministre a littéralement donné une onction de gauche à la trahison de la droite, non pas parce qu'il cherchait à achever ce qui restait de cette droite,
mais à la sauver.
Jospin se trouvait, Jeudi soir, devant une alternative simple : ou bien sauver les présidences de la gauche en se taisant, privant ainsi la droite d'un argument décisif, ou bien faire comme il a fait, servir à la droite une trahison sur mesure, c'est à dire lui donner un alibi.
Mais, chacune de ces deux solutions peuvent n'être qu'apparente. La première aurait été une fausse victoire, et chacun le savait, puisque la gauche aurait hérité de quelques régions parfaitement ingouvernables, ce qui à terme lui aurait été plus dommageable que le contraire. La deuxième est la victoire apparente du Front National, apparente parce qu'en réalité cette alliance massive signe son arrêt de mort. Il précipite, en effet, la crise qui s'est nouée entre Le Pen et Megret, l'artisan de ces alliances locales, et il y a lourd à parier que le fondateur du FN ne s'en relèvera pas.
Car cette volte d'une grande partie des élus UDF-RPR est l'occasion rêvée et unique pour les mégrétistes de se dégager de Jean-Marie Le Pen et de ses lubies puantes et inconfortables. Pour la droite, à y réfléchir correctement, c'est l'occasion de retrouver son homéostase proprement vichyste, c'est à dire ultra-libérale, girondine et nationaliste, juste ce qu'il faut, sans les remugles du passé.
Nous pouvons donc nous attendre à voir très rapidement de nouveaux événements «sismiques». L'éclatement du FN et le renvoi de Le Pen aux poubelles de l'histoire, le rassemblement autour des Madelin, Millon et autres Megret d'un nouveau parti politique que l'UDF ne se fera pas faute d'intégrer lorsque les remous se seront calmés. Car le soulagement lié à la disparition du côté anti-républicain de ce bubon politique qu'est le FN, servira largement à compenser et à dissimuler le véritable raidissement et la pétainisation d'une partie majoritaire de la droite.
Pour le reste, on verra. Philippe Seguin est, pour le moment, le principal cocu de cette manipe, mais rien n'exclut une nouvelle fédération d'une droite dont la composition, au demeurant, ne change pas tellement, mais qui se trouvera considérablement affaiblie en termes électoraux, car le véritable but est atteint, séparer ce qui restait de bon grain de l'ivraie droitière. Une telle évolution souligne deux évolutions : le retour de la droite à son idéologie de droite, dont le FN avait fini par représenter ce qu'on en pouvait laisser filtrer dans l'opinion publique, et plus largement la transformation sociologique de la France. Notre pays n'est désormais plus le pays des rentiers capitalistes, mais bien celui des salariés, des chômeurs et des RMistes.
Jospin avait-il tout cela en vue Jeudi dernier ? Peut-être qu'il n'a fait que réagir dans un moment de panique, mais il y a lourd à parier qu'il a pris des leçons chez François Mitterrand.
Dimanche, Le 22 mars 1998
Mouvement du 22 Mars. Voici Mai 68 qui se profile à trente ans de distance. La comparaison est curieuse, car si la réalité spectaculaire-marchande, comme on disait alors, a atteint un degré inouï, il y a eu aussi un glissement idéologique qui donne à la vie politique un tout autre tour. Question : un coup d'état comme celui du Général De Gaulle serait-il possible aujourd'hui ? Réponse immédiate non, parce qu'il n'y a pas de personnalité de même acabit. Mais de toute façon, même s'il y en avait une, ça ne se passerait plus du tout comme en 1958. En fait, De Gaulle a pu prendre le pouvoir uniquement parce qu'il avait des accointances avec les généraux qui menaçaient la République, ils étaient ses amis et il fallait en quelque sorte le porter au pouvoir afin qu'il soit en mesure de les trahir. C'est un aspect de l'oeuvre du grand homme sur lequel on ne fait pas beaucoup de commentaires, sauf à l'extrême-droite.
Le seul homme qui soit prêt à faire un coup d'état est Le Pen, mais il est de plus en plus décavé et ne contrôle plus ses propres troupes. Or, en 1958 les Français qui sont descendus dans la rue pour faire barrage à De Gaulle ont été une minorité, ce qui ne serait pas le cas aujourd'hui. On irait donc vers une révolution sanglante ou une guerre civile sans fin.
Le glissement idéologique est celui de l'évidence démocratique. Celle-ci a fonctionné aussi en Mai 68, mais seulement un certain temps, c'est à dire jusqu'à ce que De Gaulle décide de s'en remettre aux forces de l'OTAN. Après le voyage de Baden Baden, les dés étaient pipés, car une prise de pouvoir par la gauche aurait été considéré comme un coup d'état que l'armée aurait réprimé, sans aucun doute. De Gaulle comme Pinochet ? Certainement, même s'il est certain qu'il y aurait mis les formes. Comme d'autre part l'exercice du pouvoir lui-même était idéologiquement décavé, la gauche n'avait aucune raison d'en prendre les risques. Le résultat a quand même été la dissolution et les élections législatives anticipées. Voilà la seule arme dont dispose encore Chirac aujourd'hui, mais il n'a aucun intérêt a manier une arme qui se retournerait contre lui.
Mardi, le 24 Mars 1998
La première partie de ma prévision s'est accomplie sans coup férir. Les grandes régions de PACA et d'Île de France sont allées à la gauche comme prévu, de quoi «guérir» les bobos moraux de la droite qui ne pouvait pas continuer à ce jeu, malgré les tentations qui furent grandes. Le plus coupable de tous, Charles Millon, revendique sa culpabilité, ou plutôt se paie le luxe de ne pas parler la langue de bois de droite : il fait tout haut l'analyse que toute la droite fait tout bas sans le dire, à savoir qu'il faut intégrer l'électorat des fachos car les différences idéologiques ne sont, après tout, pas si grande. Il faudra tout simplement émonder un peu le programme FN pour le rendre aussi potable, ou aussi peu, que celui de Madelin. Ce dernier ne cesse de zigzaguer depuis le début des hostilités, il attend son heure, et cette heure ne saurait tarder. Cette fois le signal viendra du Front National lui-même où les comptes se règlent en ce moment. Une conclusion est sûre et certaine : Le Pen va endosser tout l'insuccès de leur opération ratée, car en définitive le Front ne ramasse même pas de miettes. Mais le lider minimo va s'empresser de rejeter la faute sur Megret, qui est l'inspirateur de cette politique. La colère et l'ambition de Megret fera le reste. Au fond, la droite française va retrouver son homéostase, c'est à dire qu'elle restera divisée en deux parties, mais ces deux parties auront encore moins de chances que celles que l'on connaît de se rassembler en un seul parti. Le seul changement véritable que ces événements augurent, c'est la confirmation définitive de l'existence de trois partis politiques dont deux républicains et un qui continuera vraisemblablement à jouer le rôle de repoussoir. Vivement l'Europe que l'on sorte de ce merdier historique.
Samedi, le 28 mars 1998
Le merdier s'amplifie médiatiquement comme d'habitude. Quand est-ce que les Français vont-ils se révolter contre ce conditionnement permanent, cette façon de se laisser donner des leçons sur ce qui se passe réellement dans le pays, sur ce qu'ils sont et font eux-mêmes en réalité ?
la dernière manipulation est scandaleuse. Le pataquès électorale des régionales et des cantonales a évidemment affaibli considérablement l'image de la droite. Elle aura bien du mal à se remettre d'une trahison aussi manifeste de ce qui lui restait d'honorabilité. Mais elle a des ressource, principalement médiatique. Avant ces élections, le ton général était plutôt optimiste ; les chiffres sont désespérément bons, l'économie ne manifeste, elle, aucune solidarité avec la droite du patronat. Mais à peine a-t-on su que cette droite était en difficulté, qu'il a fallu mobiliser sur les écrans et sur les ondes tout ce qui existe d'inquiétant, de difficile dans ce temps de mutations, même les faits divers sont exploités comme s'ils étaient des signes avant-coureurs de l'anarchie ou de la déliquescence de la Nation. Le sérial-killer de l'Est parisien entre sur scène comme un personnage politique. Du coup je constate autour de moi ce paradoxe d'une société de gauche, dans un pays gouverné par la gauche, qui se lamente et sombre dans la dépression. Heureusement, cet après-midi nous allons manifester contre le Front National, ça va faire bouger les gens et les sortir de cet abattement qui n'est rien d'autre que
l'effet concret du fascisme sur la société française, une névrose d'échec à vrai dire assez inquiétante. Mes prévisions optimistes pourraient en prendre un coup, mais il ne faut jamais faiblir devant ce que l'on pense, sinon il n'y a plus qu'à démissionner complètement de l'histoire. Comme j'en ai fait part déjà à mes proches, ce qu'il y a à craindre dans les tout prochains temps, c'est le retour à des pratiques terroristes classiques, attentats politiques, assassinat de Jospin etc... Les factieux ont maintenant besoin d'un état de tension permanent. C'est pourquoi Le Pen traite lui-même les gouvernants de factieux, manière de créer et maintenir un climat. La guerre civile pourrait être plus proche que je ne le pensais.
Samedi, le 4 Avril 1998
Le temps n'est qu'un petit traître de moindre envergure. Sa manière de passer en douce doit nous rendre attentifs à ce qu'il peut cacher. En économie surtout ce «passage» peut être douloureux... Mais l'envergure n'est pas grande, une semaine sur l'autre, si on ne fait pas attention on peut se retrouver à son point de départ ...
Bref, déchirement, décidément. Il faut que je revoie toute cette question des échanges inégaux. Quel travail en perspective ! Et comment ? Et quand ? J.C me sadise littéralement à propos de cette question.Sa tactique est simple, il distribue les spécialités, me branche Philo et m'exclut Eco, comme si je n'avais pas passé la moitié de ma vie à étudier l'histoire de l'économie de ce foutu monde de merde !! Sans grande méthode, je le reconnaîs volontiers et surtout sans leur chiffrage économétrique de merde, mais foutre dieu, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à ma méditation du 14 Mars ?
Tout reprendre à zéro. Dimanche dernier j'ai discuté de tout ça avec R.M., qui semblait plutôt favorable à mes thèses, mais on ne sait jamais, et puis de toute façon, pour une raison ou une autre J.C. fait autorité dans ces questions parce qu'il travaille au Chiffre !! Il gère les hautes questions chiffrées, pas question de moufter. Comment procéder ? Hier soir j'ai avancé l'argument de l'or espagnol. Réponse : ce n'est pas un apport de substance, seulement un accélérateur de la circulation monétaire. Sur le champ j'ai voulu lui demander si c'était des capitaux zimbabwéens qui alimentaient la spéculation mondiale, mais je n'en ai pas eu l'occasion... Il faut que je me démerde seul, avec les gus de la nouvelle centrale d'intellos marxistes qu'il y a sur Internet. En attendant, reposons une nouvelle fois les termes du problème, car il faut clairement définir ce qui est en question.
1 - oui ou non l'Occident s'est-il constitué en puissance politique et économique au dépens du reste du monde ? Ceci est une question d'histoire économique et elle doit être soigneusement distinguée du mouvement de l'économie actuelle, même si cette histoire ne peut pas ne pas déterminer fondamentalement ce qui se passe aujourd'hui. En parler avec Théo.
2 - oui ou non les échanges internationaux demeurent-ils inégaux malgré l'extension du marché et de ses lois et malgré la dislocation politique des empires ? Et de quelle manière peut-on considérer que l'inégalité reste active malgré tout. Il y a un exemple fascinant, c'est la relation USA-Japon. Le pays du soleil levant possède de quoi mettre Wall-Street à genoux, environ 4000 Milliards de francs de bons du Trésor américain. Pour des raisons politiques Tokyo ne peut pas les mettre en vente, Clinton l'a clairement laissé entendre à plusieurs reprises. Derrière cette affaire, il y a des engagements de nature historique certainement, des engagements qui datent de l'après-guerre, lorsque les Américains ont décidé de requinquer les nippons à coups de dollars, de même que les Allemands. Cette affaire est une affaire de donnant-donnant, c'est une affaire politique. La bombe atomique décide. A décidé. Exactement comme les chevaux et les fusils des Espagnols on décidé de l'écroulement des Empires d'Amérique Centrale et du transfert de milliers de tonnes d'or et d'argent vers le continent européen. Toujours l'étalon-or : pourquoi on ne ferait pas la généalogie des stocks d'or de nos banques centrales, pour voir... La question n'est pas tranchée d'ailleurs. Je demeure persuadé que si l'Euro échoue, c'est à dire si tout s'écroule en Europe, c'est finalement l'or qui va émerger de la barbarie qu'une telle crise risque de déclencher.
Bref, je suis impatient d'entendre J.C. me démontrer le contraire de tout cela. Ce serait une véritable révolution copernicienne pour moi, car il faudrait éliminer en même temps toute la théorie de la plus-value, de la valeur-travail et tout le reste, tout le reste ! Pourquoi pas ?
Nous verrons bien, si j'ai encore les moyens intellectuels et le temps pour mener cette recherche à bien. Il faudrait que je ne fasse plus que ça. Chiche ?
Mardi, le 7 Avril 1998
La tension monte dans le «temps». Plus rien ne se passe comme prévu, calculé, planifié par toutes les catégories de gérants de la chose publique et économique. Actuellement la terreur règne sur les affaires du Japon. On se demande seulement quand le géant va s'effondrer, tellement on est sûr qu'on n'y échappera pas. Les termes de cette débâcle sont étonnant : le Japon reste proportionnellement le pays le plus riche du monde, le seul qui dispose d'une épargne plus grande que l'investissement. Le pays n'arrive pas à dépenser ses sous. Alors les explications classiques sont un peu courtes. On parle d'une crise de confiance et d'une augmentation de l'épargne de refuge et une spirale infernale qui conduit vers une récession sérieuse à l'identique de celle de 1929. OK, il y a eu quelques faillites fracassantes dans l'archipel mais la crise ne date pas d'hier, les économistes reconnaissent que cela fait cinq ans qu'elle se met doucement en place, et j'ai pu remarquer, au cours de ces cinq ans comment, au Japon les mêmes questions se posaient sans cesse, sans réponses efficaces. En fait, je me demande si nous ne trouvons pas devant la première crise de la consommation proprement dite. Les gens en ont marre de consommer, de jouer la comédie des marchandises actuellement disponibles. Les nippons ne veulent même plus voyager, tellement on les a pris pour des cons à travers le monde, ridiculisés dans leur rôle de connards photographes et de suceurs de produits de luxe : ILS ONT FAIT LE TOUR de nos saloperies de marchandises, et peut-être se font-ils simplement chier avec toute cette bimbloterie. Si j'ai raison, c'est grave, et peut-être enfin les choses vont-elles craquer là où elles doivent. On va progresser vers les vrais problèmes, les vrais questions et les réponses radicales. Fini de pleurer sur des pseudo crise de pénuries, de maladies, de stress, de droits de l'hommes bafoués et autres amuse-gueules.On va se rendre compte où ces Droits de l'Homme sont réellement bafoués. Passer dans le véritable espace du crime contre l'humanité : le marché mondial. On arrive peut-être au point X de la rupture avec l'objet. Catastrophe mondiale, mondialisation de la catastrophe : les hommes réapparaissent avec des désirs et des volontés d'homme : plus de quartier avec l'honneur, plus de quartier avec l'humiliation permanente de vies non choisies, de salariats esclavagistes et de fourmis disciplinées. Mais je dois rêver encore une fois.
Vendredi, 10 Avril 1998
Je viens de comprendre la médecine de Gallien. En deux mots, Gallien prônait que les maladies étaient des êtres, des entités vivantes avec leur propre destin. La médecine c'était donc avant tout une méthode destiné à garder le corps et son destin global à distance du destin de la maladie. En découvrant le monde bactérien, Pasteur n'a en rien détruit cette théorie, au contraire il n'a fait que la confirmer en l'expliquant et en justifiant une thèse qui innocentait le corps propre en tant que tel. En revanche, les théories modernes, liées aux idées de systèmes et de fonctions, ont une responsabilité dans l'oubli de cette théorie. Le rappel et la modernisation de l'intuition de Gallien, déjà préssentie par Hypocrate, pourrait changer pas mal de choses dans la disposition d'esprit vis à vis du problème de la santé.
En gros, que peut vouloir dire la thèse de Gallien ? Elle dit qu'il existe une entité «corps» qui possède un destin en propre, distinct de celui des maladies qui l'affectent, c'est à dire qui le parasitent. Cette idée écarte déjà la croyance en une responsabilité particulière du corps lui-même dans ses affections. Elle introduit aussi une plus grande responsabilité dans l'attitude de l'esprit (ou de la conscience) quant à l'évaluation de la relation entre le corps et la maladie, lorsque celle-ci se présente.
Mais le plus important, me semble-t-il, est que le corps jouirait, dans ce dispositif, d'une totale indépendance vis à vis de la maladie : à condition qu'il sache se prononcer avec précision sur la nature des relations qu'il est decidé à entretenir avec la maladie. Cela signifie que le corps peut s'opposer à la maladie en tant que la maladie n'est pas un symptôme du corps lui-même, mais une agression extérieure qui peut utiliser la faiblesse spirituelle de l'individu propriétaire du corps ou se heurter à sa détermination. Ici le terme de résistance peut s'utiliser dans un sens militaire ou politique mais dans un tout autre contexte que la guerre ou la lutte politique. Un lieu commun traîne dans les couloirs des hôpitaux : celui qui se bat contre le cancer peut s'en sortir. C'est certainement plus vrai que ne le laisse entendre la trivialité du propos et son aspect non-scientifique, encore faut-il l'étayer. Voilà qui est fait.
Samedi, le 11 Avril 1998
Bof. C'est pas très clair tout ça, mais il faut encore creuser.
Parcouru en détail le Monde Diplomatique. En Avril 1998 ces gentils rédacteurs de gauche semblent inventer le revenu d'existence ! Ah la mémoire ! Depuis les Romains ça existe, et personne ne semble s'en douter. Cela portait le nom d'évergétisme, je crois en avoir déjà parlé dans ce journal qui traîne maintenant sur Internet. Ce qu'il faut donc souligner c'est cette timidité qui veut faire croire qu'il y a une audace extraordinaire à évoquer cette possibilité d'être «payé pour exister» et non pas d'exister pour payer !.. En fait, cette faiblesse de la mémoire est bien le talon d'Achille de notre civilisation techno-scientifique. Au fur et à mesure que les inventions sont jetées sur les étals, elles gomment le passé, elles gomment le naturel, c'est à dire non pas des idées de solutions considérées jadis comme folle ou exceptionnelles, mais ce que l'homme avait le courage d'exiger pour être homme, malgré les circonstances inégales de la vie. La plèbe de Rome acceptait son sort, mais en échange de sa position inférieure dans l'histoire de Rome, elle obtenait en échange l'insouciance de la survie garantie par l'évergétisme. Nous, nous sommes tellement intégré dans le schéma post esclavagiste du salariat, que nous sommes devenus incapables de «tenir notre rang». Par rapport aux animaux, tellement décriés dans nos anthropologies contemporaines, nous glissons ainsi vers le bas.
Je viens d'uploader ce qui précède sur Internet, ce qui explique l'interruption brutale du texte. Pas fâché d'ailleurs qu'il y figure, car ces quelques derniers mois ont été fructueux. J'ai l'impression de me rapprocher de...Mai 68 ! Etrange sensation que j'ai vécu avant-hier lorsqu'une ancienne amie journaliste est venu me solliciter pour témoigner à propos du 30 me anniversaire de la révolution étudiante. J'ai été particulièrement éloquent, semble-t-il, car ma copine a parfaitement compris mon topo, au demeurant assez simple : Mai 68 n'est qu'un lieu et un temps de passage entre Vichy et la révolution. Le retour des fascistes démontrent parfaitement qu'il n'y a pas solution de continuité entre 1945 et aujourd'hui, malgré toutes les tentatives pour phagocyter le passé, l'embaumer à coup de remémoration et de procès Papon. Nous sommes hélas toujours dans la dynamique issue de la Grande Guerre et la révolution de cette période n'a pas eu lieu, tout simplement. Nous sommes, en réalité, au coeur du «malaise de la civilisation», quelque part entreWeimar et la Commune de Paris. Tout un pan du discours ambiant est en toc : le chômage et la destruction du travail ne sont que des étiquettes. Elles sont fabriquées à partir de la pensée réifiée du présent. Il faudrait, au moins, les retourner en leur contraire pour commencer de comprendre ce qui pointe sous le malaise. La volonté des hommes de passer à autre chose. J'ai tenté, il y a quelques semaines d'expliquer que la grande faute intellectuelle des marxistes en général, aura été leur vision eschatologique. Que notre civilisation a pris son cap depuis Aristote et Platon et que le capitalisme n'est qu'une étape de transition vers la nécessaire assomption de l'individu dans l'immensité solitaire et glaciale de l'étant. En somme, le capitalisme pourrait être considéré encore comme une fête collective (et les entreprises ne se gênent d'ailleurs pas pour exploiter cette demi-vérité), si on le compare à ce qui attend l'homme au bout du parcours. Aujourd'hui déjà, les gens sans culture sont livrés aux fauves et gourous de tout genre, qu'en sera-t-il lorsque nous serons sortis de ce système de dépendance réciproque et qu'il faudra établir son destin tout seul, son destin, son sens et celui de tout ce qui nous entoure ? La formation ne devrait plus tourner qu'autour de cette seule question et nous foutre la paix avec les emplois.
De toute façon il faudra consumer la part maudite, ou mourir sous le poids de sa richesse.
Dimanche, le 12 Avril 1998
Jour dit de «Pâques». Des cloches dans l'air et des cloches sur les ondes radio, des cloches de la Libre Pensée qui nous endorment, tant l'imagination leur fait défaut. On meurt d'ennui en écoutant ces émissions, il faut faire quelque chose, mais quoi ? Exercer la liberté.
C'est ce que je vais faire dans cette page en méditant le concept de SENS. J'écrirais bien un petit ouvrage saignant là-dessus, si je n'étais convaincu qu'il n'y a que peu de choses à écrire et que ça ne fera jamais qu'une dizaine de pages. Ecrire c'est opérer, ou plutôt charcuter, découper en petits morceaux, désarticuler, poser en rangs ordonnés, mesurer, comparer et pour finir rassembler en un nouvel objet. La plupart du temps on aboutit à une sorte de monstre. Enfin, on raconte tellement de conneries sur le sens que cela vaut le coup d'essayer, quitte à faire bref.
Le sens, donc. D'abord une constatation : la question du sens ne vient pas de Mars, elle ne nous vient pas seulement de l'extérieur, c'est à dire du discours ambiant des médias ou de l'écriture en général. La question du sens NOUS prend chacun de nous en particulier. Je veux dire que la revendication du sens, dans son universalité
et dans sa particularité historique s'adresse à chacun de nous. Je veux dire par là qu'il ne suffit pas de critiquer ou d'ironiser sur le bavardage général qui entoure cette question en se moquant de ceux qui paraissent le découvrir. Car la manière d'agir de cette question nous est aussi particulière et nouvelle qu'aux autres. Autrement dit, la question nous travaille tous avec la même nouveauté et avec les mêmes impératifs spécifiques de notre époque. Je dis cela, car nos «professeurs» ont la fâcheuse tendance à nous renvoyer à des règlements passés de ce problème. Les hégéliens nous renvoient à Hegel, les gnostiques à Plotin et les curés à Saint Thomas, comme si la question du sens avait été réglée une fois pour toute, hors l'histoire, hors ce que Heidegger nomme l'historial, c'est à dire ce qui dans l'histoire est destin. Destin, c'est quoi ? Destin c'est le chemin sur lequel on ne revient pas, chemin qui ne «mène nulle part» parce que le là d'où l'on ne revient pas s'appelle nulle part. Le destin exclue l'idée de but, l'idée que nous parcourons un itinéraire tracé de A à B. Il nous impose son propre labyrinthe en fermant au fur et à mesure toutes les issues de retour. Au bout de cette route, on meurt.
Voilà déjà, d'un coup, pour la dimension «navigation» du sens, une impasse sans bavures. Le sens n'est pas un panneau de circulation, en aucun cas. Il est à supposer que la prolifération de la circulation abstraite des hommes et des marchandises a démultiplié cette illusion selon laquelle il existe, sous la croûte de la réalité, des panneaux indicateurs de caps à prendre ou à conserver. Non, nul, rien à faire, il n'y a pas de panneaux, d'aucune sorte sur notre route.
C'est d'ailleurs très simple, dès que de vrais panneaux commencent à se dresser autour de nous, c'en est fait de notre liberté. L'occident s'est couvert de crucifix comme autant de flèches indicatrices du mouvement de l'âme et du corps, on a vu ce que cela a donné. Car il y a là un enjeu fondamental, celle de l'engagement.
Il y a quelques années, j'avais fait une série de reportages sur la Kashrout, c'est à dire l'ensemble des lois et règlements qui ordonne à la minute près toute la vie d'un Juif. Au cours de cette investigation, je me suis rendu compte qu'il y avait, derrière les 666 lois du Talmud, un fantastique moyen d'en finir avec la question du sens. Imaginez un Juif qui se réveille le matin, il sait exactement tout ce qu'il a à faire jusqu'à ce qu'il se couche à nouveau pour dormir afin de «régler» son problème avec dieu, la Loi et son peuple. Que faut-il de plus à l'homme surchargé de questions, qui ne demande au fond pas mieux que de se décharger le plus possible de ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est à dire l'inconnu, l'insensé et surtout l'interrogation personnelle ? Il est évident, faut-il le souligner, que c'est le même topo pour n'importe quelle religion, avec parfois les arrangement avec le ciel qui sont encore plus ridicules que cette discipline après tout consentie et dans laquelle on est bien obligé de s'engager tout entier, quitte à rater de la vie des aspects que l'on n'a pas choisi. Il y a dans l'existence d'un Juif orthodoxe quelque chose d'héroïque et de souverain, dans le fait qu'il parie délibérément sur ses Lois en les adoptant pleinement et sans mégoter. En revanche, le Chrétien est un minus habens en ce qu'il se réserve toujours une porte de sortie, il peut toujours pratiquer le péché d'une certaine manière,
pourvou qué ça né doure pas...
La tendance naturelle, qui fait surface à propos de n'importe quoi - le régionalisme par exemple - est de dire que l'homme trouve des panneaux signifiants dès sa naissance. Certains vont même jusqu'à dire que c'est la naissance qui détermine le sens. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais qu'il faut soigneusement analyser et éclaircir dans ses attendus avant de l'accepter pour tel. Nous y reviendrons peut-être. Donc, le sens ne peut pas être dans le religieux, et ajoutons le tout de suite puisque nous l'avons évoqué, dans le tribal ou dans l'ethnique.
Qu'est-ce-qui reste ? Il y aurait le social, une notion moderne, issue de l'anéantissement des logiques tribales et ethniques. Le social, pour aller vite, serait le «culturel». Le sens serait ce qui émerge de la réflexion du groupe, entendu comme ensemble abstrait, qui repose sur des relations souples liées au marché et aux formes politiques convenues, par exemple la démocratie. On sait bien que la culture est composée de tout le reste : du religieux, du tribal, de la tradition ethnique et de tout ce qui a «fait figure» de sens par le passé, le sens, en ce sens, n'étant rien d'autre que l'expression finale, la distillation en formes bibliques, évangéliques ou artistiques des passions. Mais il y a quelque chose qui distingue absolument la culture de tout ce reste. La culture naît libre : en fait, elle naît avec les grands événements qui marquent, dans l'esprit des hommes, la naissance de la liberté elle-même. Ainsi Kant en arrive-t-il à définir ses matrices de l'esthétique exactement au moment où la Révolution Française se propose de dégager définitivement l'humanité de la servitude des formes despotiques des religions et de la souveraineté elle-même. La notion de culture est impossible hors la République, ce qui explique le débat qui l'entoure aujourd'hui encore, puisque les ennemis de la République ne se gênent pas pour faire de la culture une simple et stricte répétition de certaines traditions liées à certaines formes politiques déterminées. Le régionalisme sent le soufre précisément parce qu'il véhicule le danger de ne s'avérer, en fin de compte, que comme un moyen politique démagogique de ressusciter la structure politique qui va avec les moeurs et le langage dont on encourage la pratique : attention, Lionel Jospin, les lois et directives européennes que l'on est en train de concocter sur les Langues Régionales et leur privilèges, contiennent autant de pièges pour la démocratie. Mais, là comme ailleurs, la Tradition offre un certain confort à la pusillanimité générale : elle formule que les ancêtres avaient raison, et que donc
on peut avoir raison dans cette histoire apparemment sans issue. La tradition peut donc être un auto-aveuglement efficace, une manière de s'en remettre à une immobilité ontologique qui nous évite à nous-mêmes de bouger. Et de s'ouvrir à la question du sens.
Première conclusion, on peut donc se féliciter que la question du sens semble se généraliser pour occuper tout le champ du politique et de la culture. Si les anciennes significations étaient appelées à se pérenniser, on ne se poserait pas tant de questions. Mais il y a un danger directement lié au questionnement lui-même :
et si l'on n'agitait cette question que pour revenir aux solutions passées ? Ce serait une manière de mettre le feu à l'esprit, mais un feu destiné aux autodafés de la conscience, une manière de dire simplement : voilà, nous avons essayé le sens de la liberté et ça n'a rien donné, il faut donc REVENIR aux anciennes recettes, celles de la religion, du despotisme politique et de la violence guerrière. Il faut donc bien prendre soin de situer le domaine dans lequel on pose la question du sens.
Le domaine à la mode, c'est le politique. Le soupçon que nous venons de porter sur la véritable finalité de certaines interrogations sur le sens se renforce ici, parce qu'il faut bien constater que ce sont les esprits de la Gauche française qui sont littéralement assiégés par une sorte d'ultimatum à la conscience. Le libéralisme mondial (ou son fantôme, car il ne faut pas donner l'existence à ce qui n'en est qu'au stade de la revendiquer) presse de tout son poids sur tout ce qui s'oppose à son déchaînement. Lui-même se pose en SENS ABSOLU, affirmant depuis ses forteresses financières, que le marché est Roi. Le marché, ce lieu en passe de devenir mythique, où devrait se distiller tout seul le destin des peuples, tout seul c'est à dire selon la mathématique de leurs passions. Le marché est cette symphonie des passions qui se joue au gré des inégalités de fait et qui les intègre en les éternisant et en les développant. Lorsque l'opposition entre marché et état faiblit, c'est à dire lorsque l'état se désengage de la régulation du marché, ce dernier ne peut pas faire autre chose que d'enclencher un processus qui conduit inéluctablement à la barbarie. C'est exactement ce qui a conduit l'Italie et l'Allemagne au fascisme : la démission de l'état de cette tâche fondamentale qui consiste à faire barrage au développement anarchique de la puissance économique. En Allemagne, ce sont les conglomérats géants de l'industrie, de Krupp à Siemens, qui ont fait la fortune du nazisme. La preuve la plus éclatante a été la complicité immédiate et sans discussion de ces entreprises avec l'anéantissement des Juifs. De Mercedes à IG-Farben, aucune entreprise n'a émis la moindre critique à l'égard d'impératifs d'exploitation puis de génocide. On a très bien étudié comment Daimler-Benz, par exemple, a accepté sans broncher, non seulement de faire travailler dans des conditions effroyables des milliers de Juifs parce qu'il y avait un manque de main d'œuvre qualifiée, mais encore de les envoyer dans les camps d'extermination dès que cette main d'œuvre a été trouvée ailleurs. Pire encore, il est établi en toute vérité historique que certaines multinationales américaines ont poursuivi l'exploitations de leurs filiales en Allemagne jusqu'à la libération, en toute connaissance de cause. La démonstration n'est plus à faire, elle est faite et tous ceux qui reviendraient là-dessus, d'une manière ou d'une autre, par un AMI ou par un GATT ou par un NTM, auraient dans le futur à rendre compte de leurs actes à la manière de Papon, voire d'Eichmann.
Mais qu'est-ce-que la République par rapport au sens ? Voilà l'essence de la question
actuelle ou de la forme actuelle de la question du sens. Réponse sans ambiguïté aucune : la République est l'espace du mouvement de la Raison. Elle est une zone artificielle de la praxis sociale où la liberté s'autorise de la raison pour délibérer de ses buts et du sens de ses actes. Artificiel n'est pas ici à prendre par opposition à naturel, mais dans l'opposition qui met face à face la volonté et les passions. L'artifice est aussi bien le milieu naturel de la volonté que celui des passions. Mais dans le premier milieu, celui de la volonté, l'artifice réside dans la résistance aux passions, alors que les passions, elles, se servent de l'artifice pour parvenir à l'être et à la subsistance dans l'être. Cette remarque permet de comprendre pourquoi nous disons «milieu artificiel», car la totalité du champ humain est de l'ordre de l'artifice, est artificiel : rien dans l'humain ne peut ressortir du naturel, sinon le côté aveugle du besoin et celui des passions lorsqu'elles s'identifient justement aux besoins. Or la délibération de la raison vise d'abord à fermer le passage à l'aveuglement des passions, par la force et la violence s'il le faut. La République n'a pas besoin de rien postuler sur la nature humaine. Elle est ainsi faite qu'elle juge sur pièce et qu'elle conserve toujours les moyens de juger de l'humain et de l'inhumain, étant entendu que c'est la République qui juge, en vertu de sa constitution et par son droit. Il n'est pas faux de dire que la République est un tribunal permanent, exactement comme n'importe quel gouvernement, n'importe quelle souveraineté dont l'essentiel réside dans le jugement.
Revenons au sens en tant que tel avant d'aller plus loin dans la sphère politique. Ce que nous avons essayé de dire plus haut, c'est que le sens ne peut pas se donner comme une direction de conduite ou d'action historique ayant un but eschatologique ou autre. Il n'y a pas de «sens de l'histoire» au sens de bonne direction vers le salut. Etre dans le sens de l'histoire ou avoir le sens de l'histoire, c'est plutôt le fait, pour un peuple, d'avoir retrouvé les constantes de la vie des hommes du passé qui ont permis leur persistance dans l'être et d'appliquer ainsi les bonnes recettes de gouvernement. Les révolutionnaires de 1789 n'ont pas hésité à chercher chez les Romains une sagesse politique qui a grandement contribué à l'édification de leur république. Mais encore. Si le sens ne se trouve pas en-dehors de nous, comme un jardin des Hespérides ou un Eden futur, c'est que le sens se trouve en nous, exactement en proportion inverse de son absence apparente dans le monde qui nous entoure.
Le sens, en effet, nous paraît absent de la scène naturelle du monde. Nous sommes aujourd'hui très loin de cette admiration béate des philosophes antiques et médiévaux face à la beauté et à la perfection de la nature. (à suivre)
Lundi, 13 Avril 1998
Dit de «Pâques».
Il faut donc reprendre cette méditation sur le sens, à partir du changement qui s'est opéré en moi depuis hier. Non ? C'est intéressant de sortir de l'idée qu'on est le même à 24 heures de différence et qu'on n'a qu'à continuer d'écrire comme si on était à soi-même sa propre éternité. Il n'en va pas ainsi, loin s'en faut.
Revenons quand-même à nos philosophes antiques et à leur naïve admiration (pas si naïve que cela) pour la nature. Pour être fidèle à ma mémoire, je dois avouer que lorsque mon curé nous a fait le numéro «nature miraculeuse», on a tous marché, bien que je me souvienne aussi qu'il me restait un arrière-goût interrogatif sur la pertinence de la logique qui relie perfection et auteur. Les Pères de l'Eglise disent : - «une telle perfection doit être le produit d'un esprit supérieur» - , je demande : pourquoi ? Chez Aristote et Platon la démonstration repose toujours sur la comparaison avec l'artisanat. Ils disent qu'un objet fabriqué par les mains d'un artisan doit d'abord être pensé. Il doit avoir déjà existé en idée ou en forme dans l'intellect de l'artisan ou de l'architecte. Puis ils appliquent ce schéma à un dieu ou à un démiurge qui a dû «penser le monde» avant de le construire. L'existence même du monde serait liée à un projet-monde, qui est en fait, l'idée primitive du sens. Le monde entre dans un plan général, mais ce plan se heurte au problème du temps, puisque les formes que nous voyons, celles de la nature et celles des objets techniques (ce que nous construisons de nos mains avec la méthode divine du projet formel),
se décomposent dans le temps. «Ce dont est ce qui existe est aussi ce vers quoi procède la corruption» : cette phrase d'Anaximandre reste superbement ignorée par le socratisme ou les péripatéticiens parce qu'elle s'attaque en fait directement à l'idée même de dieu. Elle rejoint la découverte scientifique incontournable que le monde, c'est à dire l'univers si parfait que nous contemplons, est tout aussi condamné à la disparition que nous-mêmes. Le projet de dieu n'est donc pas parfait si on n'y ajoute pas un scénario qui explique la corruptibilité de l'univers, c'est à dire une histoire sainte des relations entre l'homme-ange (doté d'une âme qui, selon les textes hermétiques et la kabbale est un ange, «de corvée» dans la matière) et son maître dieu. Cette histoire a un commencement et une fin, préservant ainsi la crédibilité du système, mais elle a, en réalité, la fonction de voiler la vérité de la nature physique de tout phénomène. Cette nature, nommée
phusique par quelques philosophes gnostiques contemporains qui veulent distinguer le concept de celui de la science physique, est appelée ainsi parce que tout ce qui surgit d'elle, y compris les oeuvres techniques, les projets de la téknè, c'est à dire ce qui ressort de la méthode divine de création, doit se corrompre et disparaître. Même la pensée, même ce qui permet à dieu de projeter un monde ! La physis des Grecs est, en effet, d'abord caractérisée par cette condamnation au temps et à la corruption inhérente au temps. D'ailleurs Hermes Trismégiste voit comme seule permanence du monde, le mouvement même du renouveau constant des formes qui ressuscitent constamment du néant. En accéléré, le monde peut s'imaginer comme une pâte qui fermente éternellement, produisant des formes identiques. La téknè a donc ceci de fascinant, qui lui confère l'immense pouvoir de battre cette représentation en brèche, c'est qu'elle propose des formes nouvelles. Le Temple est une forme nouvelle, en apparence non phusique, c'est à dire non soumise à la corruption visible du temps. Visible ! Nous savons ce qu'il en est réellement.
La détermination du sens se joue donc quelque part dans le néolithique, à la limite assignée en vérité seulement par un fantasme, où l'homme semble se dégager de la pâte naturelle, c'est à dire constituée exclusivement par le Bios. Ce dégagement apparaît d'ailleurs comme un dégagement du Temps lui-même, puisque l'essence de la révolution néolithique réside dans l'accumulation primitive de nourriture destinée à assurer les soudures alimentaires des saisons. On se bat ainsi contre la loi du temps, en contournant ses préceptes apparents. On sait par ailleurs, que le temple originaire n'est rien d'autre qu'un silo où sont conservé les grains de la soudure. Chez les Grecs il deviendra un coffre-fort où sont conservés les lingots d'or et les pièces d'argent. Seul alibi du libéralisme ! Seule trace généalogique qui fait un lien entre la philosophie du marché et celle de l'existence. Mais on peut voir tout de suite que cette découverte en cache une autre, c'est que le Temple est collectif ! Avant qu'il devienne une banque de dépôts privés, il est une banque centrale où se concentrent les moyens collectifs d'existence. Le déchirement idéologique du monde commence ici, dans le temple, le jour où le premier homme de l'Antiquité a fait un placement à son nom propre dans le grenier de la communauté.
Ce qui va de pair avec la métaphysique de l'individuation, née précisément en même temps, celui des Grecs. Le sens, alors, n'est guère autre chose que l'assurance de la survie. Ce qui s'accumule dans le Temple, c'est à dire ce qui s'opère ou s'accomplit dans le projet-Temple, définit l'utile, et seulement l'utile. On entre ici dans des eaux difficiles, car il va falloir fictionner. En effet, le passage, dit du néolithique, semble requalifier d'un coup, l'existence et la praxis des peuples, ou de ce qui, à ce moment-là peut s'imaginer comme peuple. Ce que nous avons analysé plus haut comme lutte contre le temps, devient aussi choix de l'utile, c'est à dire épargne de vie. Il ne va pas de soi que les hommes qui viennent de vivre des millions d'années sous une forme que nous pensons précaire, se décident brutalement pour une autre forme, dans laquelle le principe premier devient, du jour au lendemain, la survie à tout prix. C'est ce qui fait tout le mystère du néolithique, et explique sans doute aussi la nécessité pour les hommes qui ont opéré ce choix de l'expliquer à leur manière, c'est à dire par les textes dits sacrés. La naissance du monde, la «Genèse», c'est donc l'explication du passage de la vie sauvage (de l'Eden) à une autre vie, l'explication ou la justification post festum, dans la nostalgie du passé ? Nous ne possédons pas les catégories de compréhension de ce qui s'est passé, d'aucune manière. L'histoire est-elle une catégorie interne à notre ère, et à ce titre incapable de pénétrer plus loin en arrière ?
Quelques symboles marquent cette épopée, qui peuvent nous mettre sur la voie d'une compréhension superficielle. Par exemple les arbres de l'Eden. Il y en a deux : l'arbre de la connaissance, et l'arbre de la vie (ou de la puissance). Selon les Gnostiques, Dieu aurait soustrait l'arbre de la puissance à la liberté d'Adam, ne lui laissant que celui de la connaissance. Que représentent ces deux arbres ? Je me sens un peu comme le Sartre de la Nausée devant son arbre : angoisse. Mais il y a peut-être quelques pistes, si l'on suppose (il faut toujours supposer) que les objets du pré-néolithique, les êtres animaux et végétaux de la nature, représentent autre chose dans la conscience des hommes édéniques que dans la nôtre. On peut supposer, par exemple, que l'arbre demande du temps pour être. Il en demande encore plus pour devenir utile à l'homme, c'est à dire ce devenir-utile implique que l'homme s'arrête, prenne place à côté de cet arbre et y demeure en vue de la croissance de l'arbre et de sa production. Ce qui représente une révolution dans le comportement que nous pensons primitivement nomade. L'arbre serait le symbole du passage à la sédentarité. Ayant découvert les vertus nourricières de l'arbre (qui symbolise alors aussi l'ensemble des végétaux de la toute nouvelle agriculture), l'homme-Adam décide de s'arrêter, une décision qui implique un nombre considérable de changements.
Premièrement, la décision porte sur une relation fondamentale avec la terre. Celle-ci passe dans le registre de l'exploitable en permanence. Elle perd sa liberté de renouvellement selon le hasard des phénomènes. La vision d'Heidegger d'un «arraisonnement» de l'étant par l'homme prend ici tout son sens. Dans la tempête de la fermentation de la pâte mondiale, l'homme bloque tout, et décide de se séparer des éléments en les domestiquant. L'homme sort du monde, se dégage d'une symbiose ou d'un rapport d'immanence. Peut-on prétendre, par exemple, que les animaux d'aujourd'hui possèdent encore ce rapport d'immanence avec le monde, rapport dont nous excluons abusivement, car sans preuves, la conscience ? Tout le discours et toutes nos pratiques concernant l'animal prouvent que c'est ce que nous pensons. Nous paraissons certains que les animaux livrés à la prédation réciproque, vivent en symbiose aveugle avec la terre, et cette différence de statut nous autorise, par ailleurs, à les identifier avec la terre et donc à les mettre en exploitation exactement comme nous mîmes la terre en exploitation il y a seulement une dizaine de millénaires. Le «péché originel» est donc lié à cette décision de s'arrêter pour entrer dans une relation de «culture» du monde, culture signifiant ici aussi bien manipulation agricole que mise en perspective «sachante» du temps, c'est à dire l'usage du savoir. Le savoir est-il né en même temps que ces décisions, ou le savoir a-t-il seulement changé de statut ? Selon les ethnologues, et en particulier Levy-Strauss, il n'y a pas de différences entre notre savoir et le savoir des peuples dits primitifs. Cela ne prouve rien, bien entendu, mais laisse quand même entendre des différences dans la mise en exploitation de la terre, des différences paradoxales puisqu'elles laissent entendre que la savoir jouait un plus grand rôle AVANT le néolithique qu'il n'a finalement joué après. Un plus grand rôle du moins dans la conscience collective, car ce savoir était également partagé dans la collectivité et non pas confié à une caste. Les «primitifs», on le sait, sont de véritables encyclopédies vivantes pour ce qui concerne la taxinomie des objets de la nature, selon des logiques changeantes et diverses, mais avec un raffinement visant autant l'utilité que la poésie ou l'activité cultuelle.
Il peut s'agir synchroniquement d'une réaction vis à vis de l'envahisseur. On peut, en effet, supposer que les peuples comme les Indiens, les Esquimos ou d'une certaine manière tous les peuples de montagne, sont des peuples «en fuite», qui ont fui des rationalités qu'ils ont refusées, soit qu'elles leur causaient directement du tort, soit qu'ils les rejetaient par fidélité à des principes anciens. Ces peuples ont donc appliqué leurs anciens savoirs dans de nouvelles conditions, toujours difficiles car ces nouvelles conditions étaient ce qui les protégeait des anciens ennemis, le froid, le désert, les montagne, la forêt vierge. Thèse incertaine, mais que nous comprenons assez bien à la lumière du présent. La différence ontologique ou de civilisation entre ces «primitifs» et nous, est une fructueuse raison de penser une différence dans le développement historique, des carrefours où des minorités quittent le chemin central ou la pratique commune qui, pour des raisons inconnues, ne correspondraient plus à la volonté des membres de cette minorité. Ce qui, plus profondément, se rapproche de cette faille du néolithique, zone temporelle dont nous connaissons des survivances aujourd'hui, dans des formes presqu'absolue comme celles des Papous, et dans des formes intermédiaires comme celles de la plupart des peuples dits primitifs. Les Esquimos, par exemple, vivent aujourd'hui encore dans certaines zones comme la Sibérie Orientale, en parfaits nomades, pêcheurs et cueilleurs, sans aucune forme de culture ou de production économique marchande.
Qu'est-ce-que le sens pour ces «primitifs» ? Notre positivisme indécrotable nous suggère qu'il s'agit de la survie, purement et simplement. Si tel était le cas, ces nomades auraient depuis longtemps choisi la servitude technique, car celle-ci garantit bien mieux la durée de l'existence brute que les hasards de leur périples autour des pôles. On peut donc soupçonner qu'il y a quelque chose de plus dans le sens ici considéré. Les commentateurs de documentaires sur ces primitifs parlent de liberté, de poésie, bref, use d'un langage lui-même très centré sur nos valeurs. Les analystes de tendance écologique estiment qu'il y a, chez ces peuples un savoir intuitif sur la capacité de la terre à donner de la vie, et un sens des équilibres naturels. Mais cette explication est piégée elle-même par les notions scientifiques d'équilibre physique de la planète, une notion qui ne peut se développer qu'à partir du Temple et de ce que le Temple libère en fait de savoirs sur le temps et l'espace. Il faut donc admettre une ignorance totale des véritables motivations des primitifs, du moins de ceux qui se battent aujourd'hui pour conserver leur mode de vie. Pourtant, le comportement de ces humains nous rappelle à ce qu'est un engagement, c'est à dire un sens choisi. Si la thèse de la fuite des primitifs, comme la fuite des Juifs hors d'Egypte après tout, possède quelque consistance, alors il faut bien admettre qu'il s'agit de la naissance d'un sens. La fuite donne la direction de l'action et le contenu de ce qu'on en escompte, à savoir la fin ou la terminaison de ce que l'on vit au moment de l'effectuation du choix. Ainsi, le sens n'est pas «lu» dans aucun texte, même si la mythologie prend soin de cadrer ces choix fondamentaux par des prophéties ou des avertissements sibyllins, il surgit de la conscience humaine directement, de là où il gît en permanence comme dans le reste de l'étant. La perte de sens ne serait alors qu'une perte de contact avec la racine de soi-même, au plan de l'individu comme à celui des peuples. Cette tautologie vaut mieux qu'une banalité cueillie au hasard des balayages sémantiques et linguistiques, car elle rappelle et renvoie à une responsabilité individuelle et collective totale, sans compromission avec quelque théologie que ce soit, religieuse ou scientifique.
La fuite «fait» sens, comme le disent si bien les Anglais. Mais elle ne le fait qu'à posteriori, lorsque le peuple d'Israël sera installé dans son Canaan avec sa Loi et des Douze Tribus. Au moment même où les Juifs se rassemblent pour fuir l'Egypte, il ne s'agit encore que d'un acte de désespoir consécutif au comportement despotique de Pharaon. Alors ce qui est intéressant dans les interprétations bibliques ultérieures de ces événements, c'est que c'est finalement Dieu qui subtilise le sens, en devenant, dans le commentaire des faits, l'auteur de l'information et ordonnateur des actions, et donc le véritable auteur de la décision, il s'empare de la propriété du sens. Voir le dialogue de Yahvé avec Moïse tout au long de cette péripétie.
Mardi, le 14 Avril 1998
Curieux comme ce commentaire tombe, finalement, sur ce que commémore la Pâques juive ! Mais, ne passe-t-on pas son temps à commenter toujours les mêmes choses, il y en a si peu ? Du coup j'ai fait un petit tour par la Bible, hier, hé oui, pour remarquer quelque chose qui m'a toujours échappé : la Genèse est un texte d'un modernisme fou à côté de l'Exode, du Deuteronome ou du Lévitique. Dans ces derniers textes, on a affaire à un Dieu quasi National ! Une sorte de propriétaire terrien du peuple juif, jaloux de son invention de peuple élu, qui retombe pourtant si souvent dans la trahison ! A côté de ces récits un peu grossiers et pour tout dire fastidieux, la Genèse parle de l'univers, un parfum qui fait penser aux philosophes de la période classique et qui me persuade qu'elle a été écrite
après les autres textes, comme la cerise sur le gâteau. Il faudra que je demande à mon ami Kanner ce qu'en pense un Juif orthodoxe.
En tout cas la Pâques, finalement, tombait assez bien pour parler du rapt du sens, car la dramaturgie de la Passion est exactement le genre de «fast meaning», le McDonald du sens, qui ponctue notre pauvre histoire de temps en temps. J'ai été frappé, l'autre jour, en pensant que nous vivons encore au rythme des fêtes religieuses ! C'est incroyable si l'on songe, non seulement au degré d'athéisme qu'un homme normalement constitué, comme moi, a atteint, mais encore à l'indifférence, certes camouflée, dans laquelle vivent les Eglises ! Vive les Décadis de Robespierre, vivement des fêtes anonymes où la fête est à elle-même son propre but, chose qui s'est délayée dans ce temps pressé et coupable. Comme ce texte qui pourrait bien me valoir un jour de terribles ennuis.
Le destin de la fête illustre bien le destin du sens. C'est une aubaine. Comme la fête devrait être à elle-même son propre objet, la vie devrait valoir par elle-même en tant que sens. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'une différence s'installe entre vivre et vécu, telle que du vécu surgisse un supplément par rapport au vivre. Pourtant, cette différence existe a priori. Quelle que soit la manière dont on «vive», le vécu constitue toujours une somme supérieure au vivre, mais la plupart du temps on l'ignore, on ignore ou on manque ce supplément, par inattention, par paresse. Il n'y a là aucune culpabilité, puisque la punition est immanente. La culture, en définitive, c'est ce travail contre la paresse qui dévoile la différence entre ce que l'on est et ce que le monde nous offre en permanence. Dans la Bible, Dieu parle de nonchalance. Mais sans doute s'agit-il d'une mauvaise traduction, car la nonchalance ne me paraît pas contradictoire avec une aperception riche du monde. Sans doute Moïse voulait-il signifier cette veulerie spirituelle qui jetait, paraît-il, les Juifs dans les bras des idoles. Cela est encore visible de nos jours, où le sens se postiche sur les écrans lumineux. Il faudrait analyser le phénomène de la luminosité des écrans pour saisir leur magie, il doit y avoir une analogie avec l'idolâtrie, je dis cela parce que mon ami Kanner cherche avec désespoir à comprendre la jouissance idolâtrique telle qu'elle figure dans le Talmud. Pour lui, ce plaisir est comparable au plaisir sexuel sinon il ne vaut pas la colère de Dieu. Ce qui semble logique. Lumière, donc, et sexe.
Il paraît facile, ne trouvez-vous pas, de parler du sens dès que l'on parle de Dieu ? Normal. Le sens a été confisqué par les représentations religieuses une fois pour toutes, c'est le principal message des intégristes. C'est pourquoi la République ne peut pas se mêler de religion. Elle contribue rationnellement à l'élaboration du sens, comme élaboration de la vie elle-même et ne peut pas se contenter de recevoir des directives transcendantes.
Jeudi, le 16 Avril 1998
Sens : il faut poursuivre. J'ai écrit plus haut : «(la République) contribue rationnellement à l'élaboration du sens». Bon, maintenant que signifie «élaborer» ? On ne peut pas dire qu'il s'agit de fabriquer un objet dont le rôle serait d'indiquer un but. Cela appartient aux régimes politiques idéologiques ou despotiques. Elaborer a ici la signification d'ajuster. Ajuster le comportement de l'état aux circonstances changeantes de la vie des citoyens. Cet ajustement est un rappel constant de la nature de la République, c'est à dire de sa Constitution, qui doit trancher à propos des interrogations qui naissent de la conjoncture. Ainsi, la République va chercher en son sein la réponse, ou le sens, de sa relation au réel. Il en va ainsi de la relation simple de l'homme au monde, qui doit, avant tout, chercher en lui-même les réponses qu'il doit donner aux questions qui se posent à propos des choix qu'il doit opérer au fur et à mesure qu'ils se présentent. Chercher en lui-même signifie ici, faire référence aux valeurs qui se sont inscrites dans la conscience, qu'elles l'aient été dès l'origine, par une préinscription de type freudien ou kantien, ou bien qu'elles aient été acquises au cours de l'éducation ou d'un travail personnel. La recherche du sens n'est donc jamais la recherche d'une réponse toute faite ou d'une finalité quelconque à l'existence, mais bien d'une constante recherche d'adéquation de ce que l'on est avec ce qui est, et de ce qui est avec ce que l'on est, étant entendu que l'on est soi-même aussi ce qui est, que l'on en fait totalement et intimement partie. L'ek-sistence, comme dit Heidegger, est seulement cette position ontico-ontologique, c'est à dire de l'étant à l'être, c'est à dire non pas de la matière à la pensée ou à l'idée, mais de la différence interne à la matière-pensée ou à la pensée-matière.
Ici, on va me rétorquer qu'avec une pareille description du sens, on ne peut rien faire, on ne peut pas anticiper sur l'avenir et donc rien construire. Il n'est pas faux que le problème de la futurition du monde n'est pas aussi simple que le présente un plan quinquennal, la preuve, c'est que tous les plans se cassent la gueule. Et c'est bien là que la République prend «tout son sens», dans la mesure où sa temporalité est rythmée en ensembles et sous-ensembles temporels, destinés à laisser toute la souplesse nécessaire à la gestion du destin collectif, si l'on peut utiliser une telle expression...disons, l'administration, et encore, en un sens d'une absolue neutralité. Ainsi, la République permet de mesurer l'engagement vers le futur, c'est à dire vers une zone du temps où la relation ontico-ontologique, tout en restant identique à elle-même, aura varié de l'effectuation elle-même de son destin. Le mesurer signifiant ici l'anticiper avec toute la prudence qu'exige la liberté et son exercice dans le flux des générations. Que sert-il à une génération comme la nôtre de se voir plombée par le choix massif de l'industrialisation ? Ce choix est bien un choix destinal, c'est à dire que personne ne l'a fait exactement et en toute connaissance de cause. Il est destinal parce qu'il vient de loin, selon des voies impossibles à remonter, et à ce titre il représente déjà une préinscription d'un sens établi, préinscription qu'il faut gérer comme le reste, c'est à dire se définir par rapport à lui et faire les nouveaux choix qui s'imposent selon nos valeurs intimes et elles-mêmes historiales.
Quels choix pourrions-nous faire par rapport à l'industrialisation du monde ? En gros deux possibilités : revenir en-deçà ou la mener à son terme. Car l'industrialisation n'est pas, en tant que telle, la finalité totale des choix initiaux, elle n'en est qu'une partie. Revenir en-deçà signifierait détruire à peu près tout, y compris notre manière de penser le monde et de le vivre. La tentation d'une telle destruction a été énorme au cours de ce siècle, puisqu'on a mis au point les moyens de parvenir à une telle destruction. Il faut concevoir les deux dernières catastrophes mondiales comme de telles tentatives de détruire ce qui se formait alors, c'est à dire le monde industriel. Cela n'a pas été fait, parce que ceux qui sont à l'origine de ces guerres ont joué, en réalité, de l'autre côté, c'est à dire du côté de la domination absolue de l'industrialisation. Le nazisme aura été l'une des tentatives d'accélération les plus folles de cette industrialisation, une accélération fort bien décrite par «Le Travailleur» de Ernst Jünger. Cette vitesse, n'englobait cependant pas, comme Jünger le pensait en écrivant son ouvrage, la totalité des secteurs de l'existence. Elle s'est concentrée sur la technique de destruction elle-même, mettant le projet global de la métaphysique du technique en danger. Le nazisme aura ainsi été une sorte de cancer du développement de la civilisation technique, dont il existe, contrairement aux assertions des libéraux, une finalité existentielle globale, c'est à dire un cours positif par rapport aux valeurs fondamentales (choisies) de l'occident. Ce qu'on peut dire de ce cours positif, avec les moyens dont nous disposons, c'est, en gros, l'avènement de l'individu autonome. Le sens de la production industrielle, c'est à dire le contenu significatif par rapport au présent et à l'avenir, montre qu'elle axe toute son inventivité là-dessus. L'Avant-Garde, qu'elle soit technique ou esthétique, ne peut plus être réservée à la minorité aisée de la planète, parce que toute la machine économique s'est transformée et ne peut plus servir aux objectifs exclusifs des classes possédantes. Cette transformation de l'économie n'est rien d'autre que son déclin programmé, exactement comme Karl Marx l'a anticipé, c'est à dire, en somme, sur le modèle du processus de désaliénation ontologique que représente la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel. La «sortie» de la certitude sensible vers les formes de l'Esprit qui s'enroulent les unes dans les autres jusqu'au Savoir Absolu, c'et la même chose que la «sortie» du travail aliéné. L'industrie détruit le travail aliéné, pas le travail en tant que tel, c'est à dire pas le travail du sens. En termes de déréliction, la révolution technique ne changera rien du tout, elle ne fera que précipiter une crise de la conscience telle qu'aucune période de l'histoire ne l'aura vécue. Peut-être, maintenant que j'y pense, la Bible a-t-elle été conçue et formalisée à l'époque où le choix destinal du technique commençait de se présenter aux hommes. Si l'on suit bien le tracé des différents textes de la Bible, on voit bien qu'à un certain moment, dans Samuel, se présente pour les Juifs la nouveauté de la monarchie. «Les Juifs veulent un roi, Yahvé». Réponse : «donne-leur un roi». Or cette transformation de la situation politique-technique du peuple Juif, signe son arrêt de mort en tant que peuple élu qui entretient des relations prophétiques avec Dieu et conserve même en permanence l'Arche de sa présence. Le développement des formes techniques de la souveraineté va entraîner la destruction du Temple, la diaspora et même la répétition tragique du geste qui a entraîné la royauté de Saül et de David sous la forme de l'état d'Israël.
Vendredi, le 17 Avril 1998
On écrit presque tous les jours, en ce moment, effet d'entrainement des grandes lectures qui se font en même temps. Comme disait Debord, on n'écrit jamais que ce qu'on lit. J'espère ne pas trop me répéter, danger permanent de ce genre de journal. Bof.
Suis allé voir ce matin sur de nouveaux sites Internet d'où l'on peut enfin télécharger des textes littéraires qui ne figurent pas forcément dans votre bibliothèque. Pour rendre service, voici ce site : un2sg4.unige.ch/athena/html/athetxts.html
J'ai parcouru quelques petits textes rares de Voltaire, notamment à propos de Luis XIV. Voltaire est vraiment le modèle du journaliste français, avec ses qualités et ses défauts. Capacité d'indignation et veuleries monarchistes. A propos du Grand Roi je le trouve bien flagorneur et bien compatissant. Cet ogre de l'histoire de France ne mérite pas autant de compliments et de pitié. Bref, dans le panorama médiatique, il faudrait classer Voltaire au maximum dans les Jean-François Kahn, et encore ! Bon, je sais, tout n'est pas de la même eau, il faut être mesuré. D'accord, mais certainement pas Charlie Hebdo qui fait de l'excellent travail. On sent la France se réveiller avec ses accents gaulois, le coq dont parle Marx ? Pourquoi pas, de toute façon il ne reste guère d'autres solutions, il faut forcer le passage dans l'histoire, ce n'est pas la première fois. Ne pas se laisser fasciner par les grandes idées de déplacement des centres historiques, tout cela est très contestable. Rome est resté dans Rome beaucoup plus longtemps que ne l'apprennent nos têtes blondes dans les écoles, si elles l'apprennent encore ! Et Paris rentre tout doucement dans Paris. Paris s'éveille, dit la chanson, et ce réveil est très certainement le symptôme d'un réveil de l'histoire ici en France et en Europe. N'oublions pas : le chant du coq gaulois ! Curieux retour de l'histoire, nous qui avons toujours sabré la place jacobine de cette capitale et qui aujourd'hui en saluons le retour!
Je n'oublie pas le sens. Mais que puis-je encore ajouter à ma dissertation ? A me souvenir de ce que j'ai écrit, il me semble que tout peut coller. Faut-il résumer ? Il y a en gros deux manières de concevoir le sens : Un : la direction, Deux : le sentiment ou la sensation. Il faut toujours préférer le deuxième, car le premier n'existe tout simplement pas, ni sous forme de direction de l'esprit, ni sous forme de direction de l'histoire. Autrement dit, il vaut mieux toujours dire «j'ai le sens de..» que de dire «le prends le sens de...». Car la vérité est que le sens est en nous comme relation de ce que nous sommes avec ce qui est, domaines qui ne sont pas si différents que nous le pensons, mais qui, au contraire, sont intimement liés par une identité d'origine. Connaîs-toi toi-même est bien le meilleur conseil de la philosophie occidentale, la preuve est qu'il aboutit, à son autre extrémité, à celui de Nietzsche : deviens qui tu es.
(fin d'upload au 18 Avril 1998)
Samedi, le 18 Avril 1998
Retour au sens. Il faut en finir, mais cela est-il possible ? On peut voir du côté des formes. Je vais encore une fois prendre le risque de me faire passer pour un «idéaliste échevelé», tant pis, mais ça ne signifie plus grand chose dans cette ère post-moderne ! Il est donc possible de faire appel à l'idée que le sens est une harmonie des formes, ou le moment de l'harmonie. Si j'ajuste mes élucubrations du Troisième Entretien Préliminaire sur cette réflexion, je peux me risquer à dire que le sens est le mouvement qui relie le centre de la sphère du réel à sa surface, par opposition aux mouvements erratiques de et à la surface de cette sphère. Etant entendu que le réel est ici représenté métaphoriquement comme une sphère. (Ce qui nous replonge dans toutes les appétissantes questions du Parménide, mais ne nous gène pas beaucoup, car la sphère n'est qu'une forme axiomatique de la représentation). Centre-surface illustre le chemin de l'intérieur vers l'extérieur (et inversement, bien entendu). Si on pouvait forcer les choses on parlerait de Zoom du Moi, étant entendu que, dans son intériorité fantasmatique, le moi est aussi extérieur que la surface. Le sens est la pure circulation entre ces deux pôles.
Dimanche, le 19 Avril 1998
Si tout cela était de l'humour, je serais assez fier de moi.
Vendredi, le 24 Avril 1998
Le temps desquame ses formes.
Samedi, le 25 Avril 1998
Le modèle platonicien continue de faire des ravages, tout le monde se prend pour un générateur d'idées (ce qui, d'ailleurs, n'est qu'à moitié à mettre au passif de Platon). Certains se plaignent que leurs associations n'arrivent pas à être des «laboratoires d'idées» ! En fait, ce sont les idées rationnelles-léninistes qui persistent malgré les démentis de l'histoire. L'idée, entre autre, que la conscience de la majorité à besoin d'être ouverte comme une boîte de conserve par la minorité «agissante». On pourrait appeler cela le complexe de la boîte de corned-beef !
C'est une question théorique délicate, que la relation entre les idées qui circulent, qui sont mises en circulation et leur prise en compte par la société réelle. L'un des résultats du positivisme scientiste, aura été d'objectiver n'importe quoi, de gadgétiser les idées, c'est à dire de les confondre avec des objets manipulables.
Samedi, le 2 Mai 1998
La lassitude du corps entraîne-t-elle la lassitude de l'esprit ? J'ai tout lieu de le penser car depuis quelques jours je ne suis pas bien du tout et, du coup, je suis fatigué de voir et d'entendre autour de moi cette ruée permanente sur le sens, cette chasse sauvage et qui se prend au sérieux, des moyens et des fins de l'existence. Maintenant que mon corps se demande matériellement pourquoi il souffre, mon esprit n'a guère envie de venir s'ajouter au problème. Je voudrais plutôt me cacher au fond d'une grotte comme un animal blessé et tout oublier dans l'obscurité. Dans la préface de ma traduction de Szondi (Essai sur le Tragique), j'avais décrit le destin d'Icare, qui, assoiffé de lumière, finit carbonisé tout près du soleil. Peut-être notre civilisation a-t-elle déjà pris le chemin de cet incendie final.
En politique, (peut-être la politique est-elle un moyen de contourner la raison du sens ?) l'Europe connaît un «momentum», comme disent les Anglais. L'Euro reçoit ses prescriptions pendant ce week-end du premier Mai. Mais du coup, les politiques nationales se taisent, comme si l'on s'était donné le mot pour convenir qu'il fallait taire les bobos nationaux et laisser la place à ce qui vient.
Pourtant, les dernières semaines ont été plutôt fertiles en événements de toute sorte. Le plus important est le voile levé sur la véritable progression du fascisme en Allemagne, avec l'élection de la DVU en Saxe-Anhalt. Comme je n'ai jamais cru que le retour du fascisme était un phénomène purement français, je suis comme soulagé de constater que mon analyse était bonne. Soulagé parce que j'ai toujours pensé que Le Pen ne verrait jamais les fruits de son action politique (mais peut-on appeler cela action ?) et que le fascisme était désormais à considérer comme un danger européen. Ce danger repose sur l'hypothèse d'une alternative historique : le repli ou l'ouverture totale. Si l'Europe doit devenir une Suisse mondiale, alors nous aurons sans aucun doute le fascisme. Une
nouvelle figure du fascisme, bien entendu, qui pourrait bien être pire que la précédante, sans pour autant qu'elle se livre aux formes atroces de la barbarie nazie. Le génocide ne devrait plus être à l'ordre du jour, mais plutôt l'accomplissement aveugle du technique, tel qu'il a commencé avec l'industrialisation de la mort dans les camps et tel qu'il risque de se poursuivre par l'anéantissement de la poésie. Disons, l'anéantissement des derniers soubressauts de la poésie. Comme j'ai toujours pensé que la démocratie et la République sont les garde-fous de la pensée, je pense que les forces révolutionnaires de gauche sont ce qui reste des potentiels de défense de la possibilité poétique du monde. L'avenir de l'Europe se jouera donc dans la renaissance d'un mouvement global de contestation, l'accomplissement, en quelque sorte, de Mai 68. C'est pourquoi je me suis refusé, ces derniers temps, à répondre à toutes sortes de sollicitation d'interview et de démarches journalistiques à l'occasion du trentième anniversaire de cet événement. J'ai quand-même fait comprendre à quelques jeunes journalistes en herbe, que Mai 68 n'est pas un événement repérable en tant que tel dans une échelle temporelle, mais un mouvement de fond, un mouvement spirituel (qui s'ignore d'ailleurs) qui continue de nourrir la réalité européenne. Il suffit, pour comprendre cela, de procéder à un reclassement conceptuel de toutes les libertés qui s'exercent à l'heure qu'il est à travers l'Europe (droits de l'homme, peine de mort, avortement, femmes etc..) pour saisir l'importance de ce mouvement. La liberté n'est pas un concept, c'est un exercice, et l'Europe exerce de grandes libertés sans même s'en rendre compte ; on va voir maintenant comment elle pourra continuer. C'est le grand problème des fascistes et de ceux qui sont tout prêts d'enfourcher cette idéologie : comment éteindre cet exercice de la liberté sans se mettre à dos d'immenses majorités ? C'est pourquoi, je le répète, Mitterrand ne pourra jamais être évacué de l'histoire du monde, parce qu'il aura matériellement et irréversiblement formé d'avance, une Europe républicaine dans sa nature. Il aura fait mieux que sauver la démocratie, il aura sauvé les perspectives d'une démocratie républicaine pour le continent. On va voir très rapidement si j'ai raison, car le premier élément qui va se présenter est la laïcisation ou pas des institutions et des éléments constitutionnels de la nouvelle Europe. Pour l'instant, les religions ne font pas plus que pratiquer un lobbying intensif à Bruxelles pour faire partie de la fête. Mais le projet fou, qui a consisté à vouloir inscrire sur les billets et les pièces de monnaie de l'Euro «Dieu avec nous», n'est pas passé, premier signe d'une retour impossible vers tous les «God on our side» et «Gott mit uns». C'est un symptôme encourageant, car on peut supposer que c'est la peur du ridicule de la chose qui a prédominé dans la décision, or cela signifie que Dieu est définitivement passé du côté du ridicule. Ce qui laisse entrevoir toute une série d'autres passages dans le ridicule : force de l'exercice de la liberté. Pour un homme libre, le ridicule n'est jamais que le contraire de la liberté. En réalité donc, nous sommes dans le même cas de figure que Mai 68, mais cette fois à l'échelle du continent. On disait déjà en 68 que tel était le cas, ce n'était qu'une anticipation de la réalité, car dans les autres pays d'Europe, le mouvement s'était vraiment limité aux étudiants, ce qui n'était que le côté symbolique de la chose, alors qu'en France, les «travailleurs» ont fait savoir lourdement qu'ils n'étaient pas inéxistant. Et voilà exactement ce qui va se produire dans l'Europe de demain. Non pas que je veuille une fois de plus hypostasier la «classe», celle des salariés, mais cette classe n'a pas disparu du tout, comme nous l'aimeraient faire croire toute une catégorie de scribouillards stipendiés. Qu'on le veuille ou non, la société capitaliste n'a pas encore remis en question le travail aliéné, c'est à dire producteur de plus de profit pour les uns et de moins en moins de profits pour les autres. Déjà on se demande comment cette situation ridicule peut subsister, la réponse à cette question est au bout des toutes prochaines manifestations européennes.
Le côté amusant de cette affaire, c'est que cette Europe est à majorité sociale-démocrate. Les peuples (et la dynamique qui a conduit vers la situation présente, ainsi que le programme partiellement visible) ont mis aux rênes des gens de gauche. Avec l'illusion, mais aussi avec la froide détermination d'un électorat décidé, que ces gouvernements réussiront à ne pas trahir tout l'acquis démocratique de ce continent. Amusant et dangereux, car si les social-démocrates échouent, ce seront les fascistes qui prendront la relève. D'ici que les échéances donneront des réponses sur la capacité des socialistes à mener la barque, les droites d'ici et d'ailleurs auront déjà réussi à pactiser avec les fascistes, comme les partis de la droite du Reichstag se sont adaptés à la nouvelle donne à moustache. In fine, nous verrons bien si l'on fera tirer sur les manifestants, à Bruxelles, comme le général De Gaulle aurait souhaité qu'il fût fait en Mai 68, selon les carnets de Foccard. Brave sauveur de la France ! Bonjour les hagiographies en tous genres, bonjour monsieur Lacouture !
Dimanche, le 3 Mai 1998
Par quoi commencer ?
Le plus délicat. Une intuition esthétique qui pourrait bien finir en système philosophique ! Ce matin j'écoutai une musique juive classique de la période Mendelsohnienne, et j'y distinguai, grâce à mon oreille «arabe», les origines atonales des bords de la Meditérranée. Et puis, en distillant cette impression, je me suis dit que cette musique que j'entendais n'était, au fond, qu'une grossière immitation de ce qui se fait de mieux dans le génie musical oriental, et je pensai, entre autre, à Oum Khalsoum et à bien d'autres expériences musicales que j'avais connues en Algérie. Rien que de banal dans tout cela, si je n'avais raccroché à ces pensées un tout autre wagon, celui de la géométrie. Allez savoir pourquoi, mais il m'a semblé tout d'un coup qu'il y avait le même rapport entre l'architecture classique et celle de Goethe (celle des anthroposophes), c'est à dire entre nos constructions géométriques et les formes arrondies des temples goethéens, qu'entre cette musique juive un peu ronflante et les formes délicates de l'harmonie orientale.
De là, ma pensée a vogué vers des idées finalement assez classiques. Le monde comme harmonie globale. L'art comme rappel d'une ruche initiale édénique et toutes ces sortes de choses. En fin de parcours, il y a la réalité comme voile. Un voile fait de gaze crochetée en dentelles, ou un tissu grossier de fibres obscures. Bien sûr, on ne me comprendra pas de travers : il ne s'agit pas de débiner l'art juif au bénéfice des Arabes, car il y a dans les formes liturgiques juives des harmonies tout à fait géniales et dignes de figurer au panthéon des oeuvres d'art. Le Kiddouch, la prière des morts, est un chant tout à fait incroyable, on dirait qu'il se chante
entre les lignes des harmonies ou à côté de toute structure musicale formalisée. C'est pour cela, sans doute, qu'il fait mal, c'est la seule musique que j'ai entendu qui produise des effet de douleur réelle, mais une douleur transfigurée en beauté, car toutes sortes de musiques produisent de la douleur, en permanence et sans pitié...
Ensuite, la Bible. Je continue vaillamment de lire cette immense chronique, cet immense «journal» du peuple juif, et parfois j'ai littéralement peur. Dans II Rois VIII 12 à 14, on peut lire la description de ce qui se passe actuellement en Algérie. Je vous épargne les citations, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la Bible fait partie des Livres Musulmans, au même titre que le Coran. Il y a là quelque part une discrépance absolue entre ce qui se pense à travers ces homélies sanglantes et nous, et ce que nous sommes décidés à penser. Je ne peux pas me figurer que ce fanatisme prescrit traverse les millénaires sans aucune modification. Je me rends compte en même temps de ce qu'il aura fallu verser de sang pour écarter cette fantastique intolérance, qui resurgit pourtant à chaque tournant de siècle ! Je commence à me prendre pour une sorte de Luther, à force de redécouvrir le Livre ! Qu'est-ce-que ça va donner ? Ca va donner, c'est tout ce que je sais.
Dernier chapitre aujourd'hui : encore le dix-septième siècle, que je n'écrirai certes pas avec des majuscules ! Entendu ce matin une émission sur l'Edit de Nantes et sa célèbre révocation. Eu l'intuition effrayante d'un siècle CATHOLIQUE. Vous ne pouvez pas comprendre ce que signifient ces majuscules-là, mais elles valent pourtant leur pesant d'or. La catholicité de ce siècle, dont j'ai déjà longuement parlé plus haut, c'est ce qui a maquillé, me semble-t-il, son innocence historique, alors que le règne de Louis XIV n'est pas très différent de celui d'un Hitler. Autrement dit, la Culture Française s'est tellement adossée à ce siècle parce qu'il est le siècle représentatif de la France Catholique, il est l'Assomption catholique de ce pays, une assomption qui va de pair avec sa redéfinition en tant que territoire abstrait, désossé de ses particularités féodales et ethniques. C'est au fond l'époque de la France davidienne, le Grand Moment de ce peuple qui s'homogénéise autour d'un souverain de droit divin. Il est devenu le siècle de référence parce que c'est le plus réactionnaire : bonjour la Grande Culture !
Beurk. Dans ce choix séculaire, c'est toute l'influence de Rome et de l'Eglise qui se dessine. Toutes les contre-révolutions françaises sont catholiques et le resteront. Attention à l'Europe de demain. Demain matin. Et avec tout ça, il faut encore s'entendre répéter la prétendue culpabilité des révolutionnaires de 89, leur prétendu totalitarisme ! C'est proprement fou, mais il y a toujours une dose d'amnésie dans la folie. Et s'il n'y avait qu'une parcelle de vérité dans cette chronique qui se dit Le Livre, j'y verrais le même vertige de la folie humaine entièrement tournée vers le sadisme. Exténuer la vie en versant le sang, voilà ce qu'on imaginé tous les prêtres et tous les monarques de notre histoire, et ça continue avec messieurs Michelin et Calvet. Pas au bout de nos peines.
Mercredi, le 6 Mai 1998
Je change légèrement d'avis sur l'opportunité de fêter Mai 68. Jusque-là j'ai toujours pensé que ce genre de commémoration ne servait qu'à phagocyter les valeurs portées par l'événement et à les enganguer dans une admiration finalement culpabilisante, excellent moyen de se débarrasser avec le temps de tout ce qui encombre les désirs troubles des candidats - décideurs. Autrement dit, on répète, on se mire, on tire une gloire illusoire aussitôt réprimée par un sentiment de vanité. A force, cela ne peut que dévaloriser définitivement ce pauvre Mai 68 qui n'en peut Mai...
Bon, et puis en ce moment, il me semble que cela prenne un tour intéressant, car en réalité ce qui se passe, c'est que nous sommes comme dans la phase de réalisation absolue de ce que nous décrivions à cette époque, et que tout colle très bien dans le déroulement et l'exposition des faits avec ce qui se passe aujourd'hui. J'ai toujours pensé que Mai 68 n'atait finalement qu'un accident-relais entre Pétain et Le Pen. Ce qui se confirme terriblement ces derniers temps, car le procès Papon est une sorte de non-événement terriblement symbolique de la survie du Vychisme dans la France d'aujourd'hui. Le Pen je n'en parle même pas. En ce qui le concerne, il est aussi intéressant de noter qu'il vient de subir toute une série de revers qui marque en fait la fin de son règne, sinon celui de son mouvement. Celui-ci continuera certes en roue libre sous les hauspices de la droite la plus bête du monde, mais les aîles si bien rognées qu'on n'y verra plus qu'un clône de cette droite qui ne fait que des conneries depuis qu'elle a perdu son pouvoir discrétionnaire, c'est à dire depuis 1981. Revers, mais aussi, plus grave, reflux d'électorat. J'ai remarqué hier, lorsqu'on a publié les chiffres du recul du chômage, que les deux reculs sont strictement synchrônes. Le nombre des sans-emploi tombe en-deçà des trois millions, Le Pen passe en-dessous des 15 % et perd le seul siège qu'il a à l'Assemblée Nationale, ce qui est encore plus grave pour son image parisienne. Il n'y a pire ennemi en politique que l'absence. Voilà aussi une conclusion théorique : Le Pen ne vaut pas plus qu'un chiffre économique, alors qu'il veut se hisser au niveau des valeurs de notre République ! Grossier nabot !
Vendredi, le 8 Mai 1998
Je m'en vais «uploader» ce qui précède, car il s'agit de matériel hautement stratégique. Il se précise quelque chose comme ma «pensée». Nous y reviendrons plus tard et je l'uploaderai dès que ce sera mis noir sur blanc.
Voilà qui est fait. Je viens donc de relire les quarante dernières pages de ce deuxième Journal, et cette lecture m'a réservé une heureuse surprise. Non pas que je sois béat d'admiration pour ce que j'écris, quoiqu'il faut bien que j'avoue que je n'ai rien à redire (!), mais j'ai cette curieuse et réconfortante impression qu'il commence à se dégager une sorte de colonne vertébrale à ce que je pense. L'une de mes grandes terreurs est de devoir un jour m'apercevoir que dans tout ce que je pense et que j'exprime, il n'y a qu'un grand bordel sans queue ni tête. C'est un peu comme si je me rendais compte que je suis désarmé, vulnérable, comme si la cohérence de la pensée était le gage de ma solidité, de ma puissance à survivre et à affronter la mort. (Il faudra qu'un jour je médite l'affrontement de la mort, promis)
De quoi s'agit-il ? Puisque j'ai cette impression, autant la résumer le plus vite possible, elle pourrait, telle l'oiseau qui se dégage de la glue, s'envoler pour ne plus revenir !
Tant qu'à caresser l'idée d'un système opérationnel qui émerge après-coup, un système qui apparaîtrait en somme par maturation, tentons d'en donner quelques lignes de forces.
Destin, jeu, volonté, honneur et contingence. Cinq mots qui centrent assez bien ce que je pourrais systématiser de l'homme tel que je le perçois, ou plutôt tel que je le fictionne à travers mes aspirations et ma manière de considérer la vie, l'histoire, mon passé et la conjoncture présente.
Le destin est. Mais en tant que destin il doit ête vu comme Jeu, dans lequel la volonté se joue à elle-même la comédie de la nécessité et de la contingence selon la règle de l'honneur. Mein Gott ! Est-ce-que je comprends moi-même ce que j'écris ? Oui, rassurez-vous et ce n'est pas si original que cela.
Evidemment, on est loin des théologies religieuses ou historiques à usage utopique ou eschatologique. C'est d'abord une théorie du sujet radical.
Qu'est-ce à dire ? Est radical le sujet qui se conçoit dans sa nécessité et se joue dans sa contingence. Je me conçois dans ma nécessité, c'est à dire avec les éléments qui me constituent et qui constituent mon monde. Cette conception, et là surgit la première difficulté, ne peut pas être considérée comme faite ou réalisée une fois pour toutes : elle est dans le temps. Il est donc indispensable de saisir le plus vite possible tous les invariants de ma nécessité : si je suis aveugle, les choses sont claires, je ne peux pas me tromper bien longtemps. Mais si je crois détenir la vérité, ce type d'aveuglement peut résister longtemps, comme a résisté, par exemple, la certitude de Goliath d'être plus fort que David, jusqu'à sa mort inattendue. Il faut donc que le concept de la nécessité soit souple, à même de s'adapter à toutes les situations, ce qui explique qu'il faut aller le chercher, non pas en-dehors, comme le politicien qui devient la girouette des événements, mais bien au-dedans de soi. La nécessité ne peut pas être autrement perçue que comme la limite de soi, ou encore comme ce qui est, en soi-même, limité. A partir de là peuvent se faire les choix contingents, c'est à dire non garantis par autre chose que par le cours ou par l'effectuation de sa propre nécessité, de son propre être. On suppose donc qu'on est obligé, d'une part de faire une estimation de soi, elle-même conditionnée par les estimations de ce qui n'est pas soi, et de l'autre de mesurer la nécessité extérieure à l'aune de ce qu'on a saisi comme nécessité intérieure.
Jusque-là, rien de bien original, il s'agit en somme de faire le travail de la Pythie : il faut construire un discours sur soi et sur ce qui arrive à ce soi, et sur ce qui va lui arriver. Or le moment essentiel qui vient ensuite, c'est la décision : die Entschlossenheit comme on dit en Allemand, si bien. Si bien, car ce mot ne signifie littéralement rien qui concerne directement la décision ou le choix, il parle de «dégagement de la fermeture», ce que nous traduisons en Français par « ce qui a le caractère du délibéré», puis, par dérivation «décidé», «résolu». De cette résolution dépend donc la poursuite et le sens de ce qui va arriver ; or, comme on ne peut pas prévoir à long terme les conséquences d'un choix ponctuel, même pas à court terme, il faut le stigmatiser, le marquer ou l'enregistrer dans une sorte de croyance qui est le moteur de l'action. Cette croyance, c'est l'honneur, c'est à dire le degré de confiance qu'on a dans sa propre capacité à se connaître soi-même, d'introspection, le degré de confiance qu'on s'accorde à soi-même. C'est crucial, car l'honneur exige une parfaite transparence entre la conscience et ses contenus, et s'il s'avère que les contenus changent dans une mesure incompatible avec la conscience, alors le sujet doit payer, voire s'anéantir. La conscience est
toujours dans une position de joueur. Mais à la différence du joueur aveugle, elle peut avancer avec sa propre lumière qui lui prescrit les étapes de son cheminement. Ainsi, il n'est pas besoin de s'imaginer que le monde exige d'emblée des choix fondamentaux, ces choix se font (et ne peuvent d'ailleurs se faire) qu'en fonction de la maturation du soi. Une conscience immature ne peut pas poser de choix, elle doit entrer dans le choix des autres, les parents, les aînés etc..Une conscience ne peut le faire qu'à partir du moment où elle possède assez de conscience de soi pour relever le défi de l'inconnu avec la marque de l'honneur. L'exemple le plus simple est celui du duel. Si je défie mon voisin au pistolet, je pose un pari qui repose sur la double connaissance de moi-même et de l'autre. D'un autre côté, l'honneur déjà inscrit dans mon être, m'interdit d'éviter un duel en certaines circonstances, parce que celles-ci mettent en doute le soi que je connais et que je garantis en prennant les risques qu'il faut.
Bien entendu, le jeu est double : il porte d'abord sur l'estimation de soi-même (de quoi suis-je capable ?) et ensuite sur le monde (que me réserve-t-il ?). Mais quel que soit le résultat, l'ingrédient qui s'appelle l'honneur intime l'ordre
d'assumer l'ordre initial du choix. Ce n'est que si cette assomption s'opère régulièrement, que l'action réelle a lieu.
Faut-il en déduire qu'il est, par exemple, impossible de changer d'avis ? Difficile question, à laquelle je répondrai en disant que tout dépend de la nature et de la profondeur de l'engagement initial. J'ai souvent eu du mal à comprendre comment des hommes de valeur comme Jean-François Revel ont «tourné leur veste» d'une pensée de gauche, vers une vision libérale droitière. Mais cet exemple est intéressant, car, en réalité, ce ne sont que les applications politiques particulières à une situation donnée qui ont changé, le propos essentiel n'ayant jamais varié. Revel est un chrétien qui a seulement oublié, pendant une partie de sa vie le sens réel du Christianisme, c'est à dire sa réalité historique : l'assomption du despotisme compris dans le Judaïsme de Iahvé. Le schéma libéral est le même que le schéma de la Bible : la seule valeur est l'amour aveugle de Dieu pour le peuple élu, et cet amour vaut toutes les jalousies et toutes les cruautés : on parle ici de la passion, celle qu'on retrouve sur le marché et qui ne pardonne jamais. L'erreur principale de Hegel est bien d'avoir encaissé historiquement l'histoire féérique du pardon christique. S'il n'en avait fait qu'une étape de la vie de la conscience, alors on pourrait bien admettre qu'il y a une nécessité d'auto-pardon de la conscience fourvoyée. Mais faire de cette figure l'assomption même de notre histoire signifie rien moins que ce qui devrait être le paradis sur terre : l'histoire serait ainsi l'Eden, un Eden sans fin qui s'est auto-proclamé sur la Croix.
Revenons en arrière, car on s'égare. Le destin est une idée globale de la nécessité, c'est à dire ce que l'on se représente si on se transporte à notre propre mort, ce qu'on «aurait pu voir» si, mort, «on était vivant». Même dans les mythologies (et les religions), Dieu est toujours doublé lui-même par le Destin. Ni Zeus, ni Iahvé n'ont le contrôle du déroulement de la création. Elle a lieu avec ses propres nécessités, et la marge de manoeuvre est nulle, puisque le Destin est toujours fictionné à partir de la Fin, c'est le mot Fin (c'est à dire la somme de tout ce qui s'est passé) qui contient le destin, et dieu ne peut pas intervenir sur cette sommation finale, il ne peut que jouer le jeu qu'exige le bon déroulement de cette dramaturgie globale. Ses interventions incessantes dans les péripéties des tribus juives ne sont que métaphoriques, elles ne traduisent aucun suivi au jour le jour de la situation, mais seulement une conséquence de la conséquence : les tribulations des Juifs découlent du destin global de la création et non pas des actions partielles strictement historiques. Les avertissements que lancent les prophètes sont exactement ces moments-charnières de la décision où s'investit l'honneur : le savoir que débitent les prophètes est la conscience que le peuple a de lui-même par rapport à la conscience qu'il a de son environnement. Le degré de respect pour la alaha, la Loi divine, c'est le degré ou la qualité de son engagement, de sa décision. Ce qui est intéressant dans le panorama pseudo-historique de la Bible, c'est le mouvement
imparfait de cette mécanique et finalement l'échec. Les deux destructions du Temple renvoient à l'anéantissement de l'engagement initial, mosaïque, mais l'échec, lui renvoie à l'échec de la divinité elle-même à se faire aimer radicalement. Cela nous livre, d'une certaine manière, la relativité destinale du sens. Dieu a échoué parce qu'il n'a laissé aucune chance aux hommes de fonder eux-mêmes leur royaume, de délibérer eux-mêmes de leurs amours et de l'opportunité de construire des temples. Iahvé, lui, prescrit tout, y compris la décoration du temple. Iahvé a voulu fictionner un sens radical et éternel, sans jeu, sans espace aléatoire, sans possibilité pour l'homme de parier sur lui-même et sur son monde. Il y a lourd à parier, mais je n'ai pas l'érudition qu'il faudrait pour le démontrer, que le Talmud et la Torah contiennent tout ce qu'il faut pour réintroduire le sens de l'aléatoire : tout peut arriver, l'honneur est écrit et demeure, l'Honneur est dans l'Ecriture et elle seule, finalement, rendra des comptes au destin. D'où le mystère de la disparition des prophètes. La Parole ne se fait plus entendre, ce qui voudrait dire que l'homme a cessé de vivre dans l'honneur, car l'honneur et la parole ne font qu'un.
Tout cela est devenu un peu trop large, tendance naturelle à me laisser phagocyter par mes dernières lectures. Je reviens au début où je parle de sujet radical. Que signifie cette expression ? J'écris plus haut : est radical, le sujet qui se conçoit dans sa nécessité et se joue dans sa contingence. Explication : ma conscience (parlons comme Bergson) détermine elle-même la nécessité selon ses critères, mais cette nécessité se présente à elle dans toute la force de la nécessité. Exemple : j'estime que l'impôt est une nécessité incontournable, mais cette manière d'estimer l'impôt nécessaire ne signifie pas que je puis encore avoir le choix de ruser avec les conséquences de ce qui est évident pour moi. Cette nécessité englobe tous les aspects sous lesquels se présente le fait impôt, elle est donc absolument acceptée et ne me laisse aucune chance de me défiler, sauf à contredire ma propre pensée : si je vole l'état, je me vole moi-même ma propre vérité, ma propre évidence de conscience, c'est à dire je me moque de ce que je suis. Voilà comment je considère que ma responsabilité est engagée dès que j'accepte la véracité d'un jugement. Lorsque je dis donc qu'il y va de mon honneur de scrupuleusement payer mes impôts, c'est de cela qu'il est question, de ma volonté de ne pas penser plusieurs chose à la fois sur la même chose : c'est ma décision, ma résolution, mon choix judicatoire qui est en jeu.
Il reste évident en même temps que je ne suis pas dupe de la possibilité d'erreur inhérente à mon choix. Après tout je peux me tromper sur la pertinence à financer un état en échange de ses services. Mais, et c'est là que le jeu entre en ligne de compte : si je ne prends pas le risque d'avoir raison ou tort, tout s'arrête, car je finis en âne de Buridan, mort de soif et de faim pour n'avoir pas su choisir entre le seau d'eau et le sac de picotin. L'autre position est celle de la solution intermédiaire qui consiste à limiter la portée du choix, mais alors on ne peut plus parler de choix, tout au plus d'un opportunisme condamné au court terme. Edgar Faure, encore.
Le temps devient ainsi un véritable parcours du combattant, où les obstacles, c'est à dire aussi le choix des modes de contournement ou de solution, se dressent en continu, et pour chacun desquels il faut être en mesure de choisir, choisir et assumer le choix. Cela finit rapidement par constituer tout un tissus de choix qui s'imbriquent les uns dans les autres, se contredisent parfois, s'annulent ou se complètent. La sanction ne se fait en général pas longtemps attendre. Pour essayer de me faire mieux comprendre, je vais prendre un exemple négatif, l'une de ces situations dans laquelle nous finissons tous par nous trouver un jour ou l'autre. La banque. A la banque, nous signons un contrat dont nous ne connaissons pas toujours les termes, si on manque de prudence. Si donc une telle aventure m'arrive, que ma banque me retire un jour brutalement un paquet d'agios totalement imprévu au nom d'une clause d'un contrat que j'ai à peine lu, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, pour n'avoir pas cherché à connaître pleinement les conditions de la gestion de mon compte. Avancer, c'est donc d'abord regarder où on met les pieds. Si on ne regarde pas, on tient compte du fait qu'on a négligé de le faire, tirant une sorte de profit immédiat du temps qu'on a gagné et des soucis que l'on s'est épargnés : on comptabilise pour soi-même l'erreur et on ne peut plus en faire grief à l'autre.
La première fois que je me suis trouvé aux prises avec cette mécanique difficile, c'était en pleine mer, sur un beau voilier au milieu de l'Atlantique. Mes amis et moi-même avions subi une escroquerie dans le port de Gibraltar et cela nous avait obligé à faire du bateau-stop pour continuer notre tour du monde. Ce bateau trouvé, nous avions dû signer un contrat moral qui nous engageait à faire diverses tâches à bord en échange de la gratuité de la traversée. Moi-même je m'était engagé à faire la cuisine, mes amis à faire la manoeuvre, la navigation et l'entretien du bateau. C'est évidemment du côté de l'entretien du bateau que ça a lâché, car les skippers un peu snobs et très arrogants exigeaient que les cuivres soient nickel, jour et nuit. Mes amis ont donc craqué, et commencé à refuser les cuivres sous pretexte qu'ils se ternissaient au fir et à mesure qu'on les nettoyait, ce qui était vrai. Mais il n'était pas moins vrai que les cuivres avaient fait partie du contrat, et je considérai, à la grande fureur de mes amis qu'il fallait les faire. C'est ma médiation qui a d'ailleurs évité à la traversée de s'achever dans les îles du Cap-Vert. Signé, c'est signé, est devenu mon leitmotiv dans toute transaction, tout conflit quel qu'il soit.
Le vol. Pourquoi le vol est-il un mal ? Le vol est un mal parce qu'il est une dérogation à soi-même. En volant, je ne fais que mettre en évidence, pour ma conscience, que je ne suis pas capable de me procurer par moi-même ce que je vole. Je déroge à l'estime que je puis avoir de ma personne. C'est un manquement à l'honneur personnel, pas à la morale divine.
Le sujet radical, c'est donc un sujet qui se constitue lui-même à partir de l'assomption de ses choix et non pas sur le respect d'échelles de valeurs extérieures à lui-même. L'échelle de valeur provient de son exercice de la liberté de choisir résolument, à chaque expérience de la vie. Mais, j'avais aussi écrit «se joue dans sa contingence». Précisément, c'est là que nous en sommes : le choix s'opère toujours dans la contingence estimée par le sujet? Autrement dit, lorsque je choisis, je choisis en même temps la dose d'aléatoire qui entoure le choix. Ce qui ne veut pas dire que je puis me retirer du choix à n'importe quel moment, dès que ça sentira le roussi, mais que j'assume aussi cet aléatoire, cette contingence avec toutes les conséquences qu'elle implique. Difficile, mais c'est cela, très exactement, la loi de l'honneur. Je me souviens d'images cinématographiques de Poudovkine, les officiers du Tsar qui attaquent les Rouges. Des jeunes gens chamarrés, marchant au pas de l'oie en rangs parfaits, avec chacun une flutte de champagne à la main, marchant au massacre. La grandeur de cette image peut être interprétée de deux manières :
- Poudovkine, qui est communiste, décrit avec lyrisme, la folie des jeunes nobles, leur inconséquence criminelle en regard de la réalité de la mort. En définitive, ces cosaques auront eu autant de mépris pour leur propre vie que pour celles de leurs moujiks : ils ne savent pas le prix de la vie, et c'est le prolétariat qui devra enseigner cette vérité au monde.
- Ces jeunes nobles se savent perdus et refusent de combattre dans des termes qui ne sont pas les leurs, car les Rouges leur ont tendu un piège de moujik, une tactique traitreuse où les armes automatiques jouent un plus grand rôle que le courage personnel. Il s'agirait donc d'un suicide d'honneur, un hara-kiri. Pour eux, la série des choix délibérés s'achèvent sur une ultime volte d'une réalité qui a brutalement changé.
Il y a dans tout cela un sens de la gratuité de l'être-là dans le monde. Cette gratuité a peut-être pour fonction de valoriser paradoxalement l'essence de l'action, et donc de l'être. De même que l'ignorance valorise a priori autrui et interdit de le prendre comme moyen pour ses propres fins (c'est le sens de la dignité humaine : exploiter quelqu'un c'est d'abord prétendre le connaître, c'est mépriser son intimité constitutive, c'est pourquoi les Chrétiens ont toujours préféré simplifier les choses en décrétant que l'homme était mauvais en tant que tel, sautant par-dessus la question de la singularité), de même la fidélité gratuite à ses résolutions donne sens à l'être. Retour à la Bible, cette gratuité est le fond de commerce des Prophètes, mais elle est tellement dur à gérer qu'elle échoue sans cesse dans l'utilité. Les Idoles avaient l'avantage d'offrir du divertissement en même temps que la protection des dieux et la mantie, alors que Iahvé ne faisait qu'exhiber les lois de sa jalousie. Cette jalousie repose sans doute précisément sur la force de la concurrence des dieux païens, c'est la mesure de l'exigence divine, que de se refuser aux idoles, donc aux «prostitués sacrés et au Moloch». Iahvé est un looser, il reste que sa loi finit par conquérir même les Perses (sans parler des Grecs, des Romains et de tout l'occident). Le secret de cette efficacité est sans doute inscrit dans la gratuité de la Loi, c'est à dire son ouverture : la Loi n'est là que pour laisser ouvert le possible de la vie, alors que les idoles sont à elles-mêmes leur propre but et ne font en rien progresser la civilisation. Il y a, au fond, vis à vis de l'idolâtrie dans la Bible, le même tabou que notre rejet de la drogue. Celle ci fonctionne comme la menace du déclin.
Il y a beaucoup à dire sur tout cela. A demain.
Samedi, le 9 Mai 1998
Je trouve tout ce qui précède très gonflé. Quel culot quand même de prétendre avoir une pensée !! Mais peut-être qu'on peut exprimer les choses autrement. Selon ce qui précède, d'ailleurs. S'il y a un zeste de réalité dans ce texte, ce qu'on appelle la «personnalité» se forme dans le cours des décisions successives d'un individu. Il prend en quelques sorte la forme de ses choix, et ce qui lui tient lieu de pensée se calque en quelque sorte sur cette forme. Comment pourrait-on nier que le «discours» d'un individu, à supposer qu'il se soit formé - et pour cela il faut au moins un minimum vital de socialité - soit directement informé (c'est à dire mis en forme) par l'expérience ?
Pour ma part il y a une logique continue dans l'exercice de la liberté : si l'enfance, par exemple, est marquée par une éducation chrétienne scrupuleuse, il ne fait pas de doute qu'en cas d'abandon de la foi, ce n'est pas l'ensemble de l'endoctrinement qui part avec l'eau du bain. Il reste certainement des aspects de cette éducation qui vont servir de champ d'accueil pour les nouveaux greffons doctrinaux. C'est pourquoi il est toujours intéressant de demander à un militant quelconque de quelle provenance religieuse il est. Dans Acheminement vers la Parole, Heidegger dit ceci en substance : « sans ma provenance théologique, je ne serais jamais arrivé sur le chemin de la pensée». Etonnant, non ? car il ajoute : «provenance est toujours avenir». Il se fait une greffe de choix en choix, mais au lieu de cultiver la nouveauté dans le sujet, elle le rapproche de son originel. Je dis originel, mais on ne se trompera pas, il n'est pas question ici d'origine, mais d'être ou de singularité. Je rappelle que la catégorie de la singularité est dans l'ordre de l'universel, ce qui est facile à comprendre puisque le singulier est seul, et que cette solitude est de fait universelle, elle n'est pas entachée de particularités. Singulier et universel peuvent se représenter comme le point et la droite. La droite n'est que le transport d'un point et le point n'est que le repos de la droite. Ils sont le même.
L'expérience, c'est à dire ici l'aller vers la mort avec ses étapes, c'est donc un transport de point. On naît point et on va vers sa mort. Sur la droite que l'on trace en avançant vers la mort, on rafle en passant toutes sortes de figures abstraites qui éclairent les moments du mouvement mais ne change rien au point.
Dimanche, le 10 Mai 1998
Le bruit court que le gouvernement Jospin aurait rétabli l'habitude de pavoiser le jour de la Jeanne d'Arc !! Serait-ce possible ? Ou bien s'agit-il de l'un de ces pièges dans lequel était tombé Mitterrand, le jour où la presse a découvert que la République faisait déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Pétain, conséquence de l'un de ces décrets dont personne n'entend jamais parler, pris par un quelconque cabinet de droite pendant la Quatrième, et c'est Tonton qui trinque. Après tout, c'est peut-être mérité, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais quand même ! Jeanne d'Arc ! Où va-t-on ? Quel serait ce symbolisme à la noix ? En tout état de cause ce ne serait pas sérieux : on ne construit pas un mythe avec des mensonges.
Revenons à nos brebis. La singularité et le point. La droite est le transport d'un point, pas une somme de points, car une telle somme est impossible en raison même de la singularité du point. Si on mettait les points simplement bout à bout, on aboutirait à une droite totalement hétérogène et pour ainsi dire percée par tous les intervalles entre les points qui demeurent rigoureusement séparés, donc discontinue.
Mais, qu'est-ce-qui permet de postuler la singularité de chaque point ? Je vous renvoie au chapitre 15 de la Somme de Logique de Guillaume d'Okham, où il est très clairement expliqué comment les universaux ne peuvent être que des représentations singulières : dans la conscience il peut y avoir des universaux de logique, mais dans le monde de la substance, il ne peut y avoir d'universaux, mais que des singularités. J'ajouterais, pour ma part, excepté l'être. Car l'essence est à nouveau une catégorie logique, située dans l'âme et qui se permet de s'appliquer à la substance du point de vue spéculatif, sans qu'il soit possible de distinguer dans la substance quelque chose comme une essence. En revanche, l'être ne peut pas être retranché de la substance, ni en totalité ni en partie : il y a une relation ontologique absolue entre l'âme et la substance, car elle est en même temps et au même titre que la substance, même si l'on admet que c'est elle qui fait être la substance, cela ne change rien au statut universel de l'être.
Le problème est que l'être ne se voit pas : «une entente de l'être est chaque fois déjà comprise dans tout ce que quelqu'un saisit de l'étant». Thomas d'Aquin montre ici combien l'oreille est sollicitée, plus que l'oeil, dans le rapport à l'être, quoique on pourrait aussi comprendre le mot entente par le mot accord. Mais, le mot latin traduit par entente est apprehensio, ce qui donne à nouveau autre chose pour notre «entente», à savoir saisie. Alors saisit-on, entend-on ou s'accorde-t-on sur l'être ? Peu importe, dans les trois sens du terme, il y a bien un universel au résultat. Le seul universel, et donc très certainement l'élément qui libère la logique de l'universel et toute la logique en tant que telle. Extraordinaire comment on comprend alors le lien d'acier qui relie la question de l'être à tout son déroulement philosophique et scientifique ultérieur. Qui fait dépendre ce dernier de la naissance du concept d'être. Sans le concept d'être, il n'y a rien, mais comme le dit aussi Heidegger, cette question de l'être n'est pas une invention intellectuelle, elle est réquisition de l'homme par l'être lui-même, qui classe l'homme en lui et le charge de reclasser l'étant selon l'être. L'être est un événement historial, une actualité tombée dans le temps : ce qui nous permet aussi de soupçonner la vraie cause de la transformation de la mythologie en histoire, avec l'effet boomerang de cette constatation sur l'énnoncé présent.....
Quel dérapage ! Et pourtant quelle pépite trouvée au détour du cheminement sur la voie de l'introspection, car je vous rappelle qu'on cherche ici à déterminer quelque chose comme sa propre pensée, comme sa structure du moins, comme ce qui s'est déposé avec le temps comme un ordre intellectuel présent dans ma ..tête ? dans mon âme ? mon corps ? où cela ? OU ? Nulle part peut-être, que là où se joue l'auto-compréhension de l'être, dans l'écriture ?
Mardi, le 12 Mai 1998
Vite, pour dire qu'ici se joue une aventure à nulle autre pareille : qui pense quoi et à quoi ça sert ? Penser ? Qu'est-ce-que ça veut dire ? Oui, je sais, on a déjà écrit «Qu'appelle-t-on penser ?», mais pas moi. Et je ne prétends pas avoir compris ce que veut dire le texte d'Heidegger. Il m'a apporté quelque chose que j'ignore encore. Bof, allons nous reposer.
Mercredi, le 13 Mai
Sorte de compulsion. Je dois être de nature mimétique. Ce matin j'ai regardé sur Planet (chaîne cablée) un beau documentaire sur Leonard Cohen, le chanteur retiré dans un ashram canadien du Mont Baldy (chauve..). Magnifique, quoiqu'un peu tristounet, on a vaguement l'impression qu'il s'emmerde au milieu d'un tas de belles phrases sur le silence partagé, l'amour du tout etc etc...Bref, en cinq secondes j'étais dans le personnage, définitivement installé dans sa peau, sa manière de penser, de s'exprimer, ses goûts finalement très épicuriens, et sa manière de fumer. Comment comprendre cette sorte de plaisir qu'on éprouve à se dédoubler dans autrui ? Bien sûr Cohen est une sorte d'idole pour moi, depuis les années soixante, je connais tous les enchainements de son disque principal (Suzanna), j'aime beaucoup sa voix grave et à la fois si fragile. A le regarder, il est plutôt du genre costaud, avec des traits assez grossiers. Je trouve qu'il a vieilli plus vite que Dylan (autre idole), il est vieux, mais aussi loin que je remonte, je crois qu'il m'a toujours donné cette impression de vieillesse, alors que Dylan a toujours eu une tête d'adolescent, et l'âme avec. J'ai revu le Dylan d'aujourd'hui il y a quelques semaines lorsqu'il était avec le pape, il a certes des traits de vieille jouisseuse ravagée, mais sa jeunesse perce encore à travers les joues flétries et les cheveux hagards.
Donc je me suis littéralement incrusté dans cette personne, Cohen, comme si elle était moi, ou bien comme si j'étais le même. Plus tard j'ai songé que nous devions avoir à peu de choses près le même âge, et ces derniers temps je sens combien l'indistinction gagne les hommes avec le temps qui passe. Dans mon enfance, il y avait nous, les enfants, les parents-adultes et une classe de vieux, indistincte, impossible à distinguer, exactement aussi difficiles à distinguer que les bébés dans une pouponière ! Les vieux sont-ils sur le retour vers le tout, comme les nouveaux-nés sont dans la proximité du tout qu'ils viennent de quitter ? Sans doute, et cela leur confère une identité destinale qu'il vaut bien de méditer. Mais la question demeure de savoir si les adultes, c'est à dire au fond les seuls vrais humains, ne sont pas logés à la même enseigne malgré tous leurs efforts pour le dissimuler. Etre en propre, cela existe-t-il et cela a-t-il un sens ? Quel statut a le sens par rapport à cette illusion de la propriété du moi et cette liberté de la conscience qui
pense pouvoir
tout penser ? Ce soir je ne tenterai aucune réponse ni élaboration d'un tel thème, mais nous y reviendrons bientôt. Cette expérience avec Cohen n'est pas neuve, elle a seulement été un peu trop totale, les marges trop étroites, l'adhésion trop forte. Peut-être qu'il ressemble aussi un peu à mon père ? Bonsoir.
Samedi, le 16 Mai 1998
Une date qui me rappelle vaguement quelque chose, la transgression politique. C'est un 16 Mai que De Gaulle a suspendu la Constitution et pris les «pouvoirs discrétionnaires», en fait il a exercé la dictature pendant, je crois, six mois, suspendant toutes les libertés et embastillant l'un ou l'autre journaliste rebel. Il s'est un peu joué la comédie latinisante du dictator, car il était totalement inutile d'aller si loin, malgré les menaces de l'OAS, son second enfant handicapé (voilà que ne comprendront qu'un happy few...). Bref, la mémoire a sa petite musique : 13 Mai, Alger et les généraux félons, 16 Mai, le général-président félon. Je continue d'être scandalisé par les révélations concernant cet encombrant personnage. A ce qu'il me semble, il faudrait relativiser la grandeur des personnes, et montrer comment les situations historiques et politiques suscitent les hommes comme elles peuvent, c'est à dire selon les stocks disponibles !!! Ainsi Jospin. Qui est-il ? Longue dispute hier soir avec mes proches à propos de l'expulsion des immigrés clandestins.
Je vais être clair à ce propos. Je ne partage pas du tout le sentiment de ces intellectuels bouffis de charité vis à vis de ces femmes et de ces hommes qui ont pris le risque de venir en cachette dans ce pays pour y gagner leur vie et celles de leurs familles. Je vais paraître dur, mais je pense qu'il faut cesser de pleurnicher sur leur sort. En tant qu'ancien émigré (plus d'une fois clandestin), je veux dire ceci : celui qui quitte sa patrie pour ailleurs, quelles que soient ses motifs, prend le risque de partir de chez lui et de vivre toutes sortes d'aventures qui ne correspondent pas forcément à ce qu'il prévoit ou espère le jour où il prend la route. S'il échoue dans le projet de travailler clandestinement dans un pays quelconque (cela arrive des millions de fois au USA chaque jour), c'est qu'il s'y est mal pris : il a violé les lois (la loi sur les visas temporaires, les lois du travail etc...) et s'est fait prendre, il doit assumer ce qu'il a fait. Point. Tout cet affairement de gens charitablement universalistes me laisse parfaitement indifférent, et si j'étais un immigré en situation difficile, je ne voudrais à aucun prix bénéficier de cette charité-là, qui concerne surtout l'univers psychologique de culpabilité de ces Français qui se croient riches. Je prendrais cela comme une injure.
Que me rétorque-t-on ? On ne peut pas nourrir toute la planète. Bien, et les premiers à le savoir sont les immigrés eux-mêmes qui acceptent de travailler dans les pires conditions pour des salaires de misère (je signale en passant que ces salariés-là forment une concurrence parfaitement libérale et illégale sur le marché du travail dont nous défendons si énergiquement le droit : pourquoi cette main d'oeuvre échapperait-elle au droit du travail ? à leur dépens et au grand bénéfice des gangsters qui les emploient ? ) Je viens d'apprendre que le nouveau Palais du Parlement européen de Strasbourg aura coûté d'énormes dépassements budgétaires entre autre pour la raison qu'on a exclut dès le début du chantier tous les travailleurs clandestins. Cela signifie que les ratios du bâtiment sont liés à la clandestinité ! Arrêtez l'hypocrisie, c'est trop !
Donc j'explique à mon entourage, que l'expulsion de quelques dizaines de milliers d'immigrés ne vise pas à vider le réservoir de clandestins, mais à dissuader les millions d'autres qui s'y préparent, à venir à leur tour prendre les sales boulots ici. Je ne suis pas xénophobe, d'aucune manière, et pour ma part je créerais une toute autre législation sur les étrangers, c'est à dire aucune. En revanche je serais intraitable pour le droit au travail : plutôt que de financer de la Police, je financerais de l'Inspection du Travail, et cela conduirait inéluctablement à une situation où les gens du Tiers-Monde n'auraient plus aucune raison de venir chez nous à d'autres conditions qu'aux nôtres, condition de formation, de vie et de salaire. Contrairement à ce que l'on pense, cela n'entrainerait aucune «préférence nationale» mais une rigueur absolue sur le degré de formation et de compétence de ceux qu'on embauche : nationaux ou pas. Peut-être même que cela entraînerait, dans les pays dits sous-développés, un effort plus concret pour assurer des formations compétitives dans le monde.
Mardi, le 19 Mai 1998
La mondialisation n'est pas ce qu'on pense, mais la véritable mondialisation est encore pire que ce que l'on imagine d'habitude. Dans tous les cas, le mythe de cette mondialisation est le produit direct et constant de notre indécrottable anthropocentrisme. Tout pour NOUS, NOUS pour tout. Mais cela ne serait rien si nous n'avions pas cette invraisemblable prétention de calculer, mesurer, regarder le monde comme s'il était un morceau de fromage qui tantôt est là qui s'affine, tantôt menace de fondre magiquement à cause de notre appétit sans bornes. On va interdire les filets dérivants dans les océans, parce qu'on est convaincu de la disparition prochaine de toutes les richesses piscicoles ! Bon, je n'ai rien contre les beaux sentiments, mais que des gens si bien, qui nous dirigent, qui se persuadent à eux-mêmes de l'importance vitale de leur science et de leur intervention dans la marche du monde, pensent sérieusement de telles choses ! Ils les pensent parce que les espèces traditionnelles se raréfient dans les eaux faciles dans lesquelles on les pêche depuis quelques siècles. Plus de morue ! C'est la fin du monde !
Peut-être ont-ils raison, mais il faut me comprendre, je ne peux pas croire, je ne veux pas croire qu'il existe sur cette terre un homme qui sache assez de choses sur elle pour en arriver à des décisions de ce genre. Quoi ? on prétend connaître les richesses, toutes les richesses de ce monde ? on prétend connaître le fond de l'utérus de cette réalité avec une insolence que je ne peux plus supporter. Sentiments troubles, mais réels.
Mercredi le 20 Mai 1998
Revenons sur cette question apparamment équivoque. Ce qui me chiffone, c'est le langage publicitaire qu'on utilise à tout bout de champ, le langage «efficace». Ainsi, pour convaincre quelques décideurs politiques de procéder à l'interdiction des filets dérivants, on use tout de suite de grands mots apocalyptiques, comme si on disposait de toute le savoir nécessaire pour prévoir un avenir si absolu ! Mais peut-être le pire n'est-il pas là, peut-être que ce que je ne supporte pas, c'est précisément qu'on en sache si long sur ce petit-pois de planète Terre ! Que me restera-t-il à découvrir, que me restera-t-il à vivre pour moi et par moi si tout est joué en mètres, en tonnes, en litres et en béquerels ? C'est la poésie qui disparaît avec toute cette chiffrature de merde ! Je m'imagine au milieu de l'Atlantique : au lieu de méditer sur ce qui vit, se cache, lutte, jouit et se reproduit sous la surface bleue de la mer, je ne verrai plus que des chiffres de pollution, de pénurie, de mort et de vide. On fait à l'échelle de la planète ce que l'on a fait à toutes les autres échelles, on tue le mystère de ce qui n'est pas nous. Nous envahissons tout, nous occupons tout, il n'y a plus que nous partout. Déjà il y a quelques années j'ai découvert que toutes les forêts d'Europe étaient des forêts cultivées par l'homme, qu'il n'y en avait pas une qui ne soit le fruit d'une replantation lointaine. D'ici que l'on découvre que l'Amazone est un vaste jardin tracé par quelque lointaine civilisation ! Pourquoi pas, mais alors il faudrait réviser beaucoup de choses, beaucoup beaucoup de choses, et je ne suis pas sûr que nous en soyons capables.
Dimanche, le 24 Mai 1998
Une question brûle la France et l'Europe : quel sens a la renaissance du fascisme ? Quel sens signifie évidemment aussi quel avenir. En se projetant quelques années en arrière, disons vers 1975, on s'aperçoit avec horreur qu'à cette époque, le fascisme nous apparaissait comme une monstruosité historique passagère, la conséquence ultime de la grande crise économique de 1929, en tout cas une forme politique pathologique dont on n'avait même pas besoin de dire «plus jamais ça». Une curiosité de la fin du millénaire, presque. Pourtant, il y avait quelques hommes lucides, qui avaient déjà vu un fil rouge (ou noir) commencer à se dérouler, bien après la fin des combats de quarante-cinq, bien après les grandes grèves de quarante-sept, et tout au long des Quatrième et Cinquième République. Ces hommes, qui s'intéressaient et combattaient déjà les poujadistes, les partisans de l'Algérie Française, puis la Nouvelle Droite et le Club de l'Horloge, avaient l'air de vieux historiens avides de curiosités et un peu dérangés de la tête. Or, ces Français-là avaient seulement un peu d'avance à l'allumage intellectuel et politique. Ils savaient faire les généalogies historiques correctes et voir ce qu'il y avait dans les cases blanches de ces années de plomb. Par exemple, Papon. Même parmi les Soixante-huitards il y avait une minorité d'esprit à sang froid qui s'est rendu compte que la Milice de Pétain était là, dissimulée dans les SAC, ex-OAS et groupe Charles Martel, attendant de pouvoir casser de l'étudiant, sélectionné pour l'occasion parmi les meneurs. Qui sait aujourd'hui, que certains d'entre eux ont dû se cacher pendant la période la plus chaude, entre le 10 et le 20 Mai, parce qu'on les avait prévenus que l'extrême-droite faisait le pied de grue dans les préfectures pour qu'on les «lâche» sur les étudiants ?
L'histoire de France, pourtant, ne fait pas le détail. Celle de la Révolution Française est assez éloquente pour qui s'est donné la peine de l'étudier un peu, de tenter de comprendre ce qui s'était réellement passé entre 1789 et 1794. Certains disent aujourd'hui que cette Révolution était un événement nouveau, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et d'en profiter pour asséner quelques «vérités» nouvelles du genre «ce fut l'invention du totalitarisme» !
Et si on renversait ce raisonnement ? Si on disait que les Français, fidèles à l'esprit de cette Gaule assez fière pour combattre César et assez lucide pour adopter les principes républicains, ont réagi contre un fascisme alors naissant ? Je sais, hélas, quel déficit de connaissance grève les esprits. On ne peut ni conceptualiser ni imaginer dans quel état vivaient les Français à la veille des Etats-Généraux, il faudrait avoir lu quelques uns de ces cahiers de doléance et savoir les déchiffrer sous le fatras stylistique des curés de campagne qui les ont rédigés, respectueux et apeurés devant le
totalitarisme régnant. C'est donc de là qu'il faut, au moins, remonter pour comprendre le fascisme français, cet autoritarisme hérité des Francs et érigé en machine de guerre sociale et politique par la Monarchie Absolue. Le Pen ne fait que réincarner cet orgueil aveugle d'une classe supérieure, supérieure comme la tristement célèbre Race des Seigneurs d'Outre-Rhin. Cette réincarnation n'est certes encore qu'une fantasmagorie à la limite du folklore, excellent paravent pour prospérer sur fond de désespoir d'une droite - dite républicaine - et qui n'attent que le bon moment pour faire sa jonction avec les fascistes avérés. L'histoire de la Révolution Française fourmille d'exemples de telles tentatives de fraternisation contre-révolutionnaire, qui se sont toutes terminées sur l'échafaud ou dans des batailles en Vendée ou sous le soleil du Midi. La fameuse Terreur, tant décriée par les meilleurs esprits d'aujourd'hui, fut en réalité la première lutte anti-fasciste de l'histoire de l'Europe.
Voilà de quoi nous décoiffer et nous enseigner une fois pour toutes que le Mal fasciste n'est pas une nouveauté, même si la Shoah demeure son exploit le plus moderne et le plus monstrueux. Le Pen a raison de dire qu'il s'agit d'un «détail». Pourquoi ? Parce que pour les fascistes, un tel massacre n'a aucune importance, parce qu'il leur est congénital et moralement sans aucune question.
Mais revenons à la question fondamentale, quel est l'avenir de cette peste ? Faut-il envisager un nouveau long et douloureux combat ? Une nouvelle guerre sans merci, où il faudra chaque soir tenter de s'endormir en repassant dans son esprit la carte des chemins de repli ? Avez-vous déjà connu cette situation, où la ville du jour devient un échiquier rempli de soldats entre lesquels il faut, comme le Fou, se glisser sur la pointe des pieds, et la nuit une caverne qui risque de se refermer sur vous dans la fumée, les cris et les coups de pied ? Avez-vous déjà vécu en passant votre temps à guetter les bruits de la rue et en vous demandant à chaque véhicule qui passe si c'est le panier à salade ou la traction de la Milice ? A reconnaître la mélodie des moteurs et la véritable identité de tel crissement de pneu ?
Nos questions sont encore plus simples. Dans quoi pouvons-nous encore nous investir à moyen ou long terme, investir l'avenir de nos enfants ? Que nous reste-t-il comme marge de manoeuvre pour construire des projets pacifiques de vie, quels arbres vaut-il encore la peine de planter pour les années qui viennent ? Quelle formation pour quel métier pour quel atelier de quelle entreprise dans quel état et protégés par quelles Lois ? Et question suprême, où aller si l'on refuse de laisser sa vie de dégrader sous l'oeil goguenard des fascistes (voyez la situation des citoyens d'Orange, de Vitrolles ou de Toulon, Toulon cette ville qui avait déjà fait tant de martyrs parmi les républicains de la Révolution) ? Le fascisme n'est-il pas en train de se mondialiser ?
Pas de parano. Certes. Il faut avant tout éviter de leur ouvrir la route par nos peurs et nos paniques. C'est ainsi qu'ils ont procédé dans l'Allemagne de Weimar, à une époque où la violence n'avait pas encore d'odeur, elle émanait encore toute fraîche de la Grande Guerre et tout le monde était blasé par l'odeur de la poudre. Quelle importance alors qu'une poignée de communistes se fassent tuer dans la rue, la télévision n'était pas encore là, avide d'images et de sang pour répandre l'indignation et contraindre l'autorité à se manifester. Imaginez un quartier de Cologne ou de Mannheim, un samedi soir ; des SA armés assassinent méthodiquement un groupe d'ouvriers communistes. Qui intervient ? Quand ? Qui en parle le lendemain dans les journaux et pour dire quoi ? Quel commissariat de quartier, depuis longtemps infiltré par les nazis, intervient dans le massacre ? Quelles suites judiciaires menacent les commanditaires de la boucherie ? Bien avant, rappellez-vous cela, bien avant la prise de pouvoir de 1933, Hitler régnait déjà sur les rues des villes allemandes à coups de révolvers et de crochets de boucher.
Voilà qui sera certes plus difficile pour Le Pen, son ascension ne pourra pas si facilement se lier à cette forme de terreur, non plus que le fascisme dans le reste de l'Europe. Il faudra donc prévoir d'autres formes, celles du terrorisme ordinaire ou celle du coup d'état.
Mardi, le 26 Mai 1998
La maladie de l'authentique. Je me suis découvert une maladie, une nouvelle maladie... Malade d'authenticité, de simplicité rationnelle, d'élémentaire (mon cher Watson), de rare et de compact (j'ai déjà parlé plus haut de cet attribut des machines et des concepts), de vrai, de sobre et d'incontournable, de là comme un arbre et non comme un oiseau virevoltant, de lourd et de dense et non pas de plumes ondoyantes, de profondément enraciné dans la Raison, inébranlablement emplanté dans le sol opaque et dur du su et du consciemment voulu, du non gonflé par les apparences de ceci ou de cela, par les couleurs châtoyantes des fausses pierres, par le rire léger des alouettes et des singes qui volent de branche en branche, bref, je veux du pur et du dur.
Quel con ! Comment sortir de cette ânerie ? Comment m'entraîner à un autre style ? Comment sortir de la pesanteur des choses irréfutables et des vérités premières ?
Au secours !
Samedi, le 30 Mai 1998
Ce mois aura été pour le moins consistant dans ce journal. Allez savoir pourquoi ? Aujourd'hui je vais vous entretenir d'une idée qui s'appelle «herméneutique de la prédation». Il faut, à mon avis, tenter de relire la logique de la nature selon d'autres axes que celles que nous utilisons couramment. Celles-ci disent en gros que l'homme est devenu le prédateur absolu du monde, que la prédation est la loi fondamentale du règne animal, végétal et humain. Quelle que soit la vérité qui réside en ces représentations, elle demande à être interrogée en quelques uns de ses aspects. Et tout d'abord son concept fondamental : la prédation. Qu'est-ce-que la prédation ?
Dimanche, le 31 Mai 1998
Nous reprenons. La prédation est définie de deux manières par les dictionnaires.Un : mode de nutrition des animaux prédateurs. Deux : mode de subsistance des populations prédatrices.
Quant à prédateur, cela donne : Un : Qui vit de proies animales ou végétales. Deux : Se dit de l'homme qui établit son pouvoir, sa puissance en profitant de la faiblesse de ses concurrents.(Petit Larousse).
La définition la plus neutre, c'est celle qui fait de la prédation un mode de nutrition. La notion de subsistance contient déjà une inférence logique de menace, subsister signifie tenir en face d'un danger. En gros, l'idée de prédation connote celle de lutte entre espèces animales, d'un rapport de négation absolue. Chasser, pêcher, cultiver, font partie des fonctions guerrières d'un organisme vivant. C'est pourquoi la définition qui se limite à la nutrition est intéressante, car elle est dépouillée de cette affection négative. La prédation est nutrition. Cela signifie qu'on se nourrit des autres, et que les autres se nourrissent de nous. Point.
Quelle différence ? Elle est grande, car dans ce cas de neutralité cela peut signifier qu'il s'agit d'un mode de nutrition «global», c'est à dire une chaîne nutritionnelle et non une guerre nucléaire inter-individuelle. Quelle différence ? Une chaîne nutritionnelle, c'est en somme la logique de la vie, c'est à dire exactement comment tous les membres de cette chaîne se nourrissent afin de survivre et...de faire survivre les autres !! Il n'y a donc pas de fatalité ou de hasard dans la mort prédative, il y a une logique interne à la vie et qui entretient une certaine relation (de conscience) avec chaque individu.
En résumé : la prédation n'est pas une activité d'agression sans limites d'autrui, mais une mécanique qui règle plus ou moins la reproduction et l'entretien de la vie. Cela expliquerait quelques phénomènes abérrant comme le sacrifice ou l'auto-livraison au prédateur. Tous les naufragés qui ont survécu à de longs séjours en mer, ont rapporté qu'à partir d'un certain moment, les poissons se laissaient prendre, comme s'il y avait un accord tacite, une offre de nutrition attachée à une logique mystérieuse et à une mystérieuse hiérarchie animale.
Lundi, 1er Juin 1998
Je n'aime pas les idées de «mécanique». Elles relèvent en général d'un positivisme très primitif qui n'a même pas connu les affres de la dialectique, encore moins les faits irrationnels ou surréels. Irrationel ou surréel doit s'entendre d'une manière précise et qui n'a rien à voir avec les miracles ou le débarquement des extra-terrestres. L'irrationnel et le surréel doivent être définis comme la manière de saisir l'étant, et non pas l'étant lui-même. L'homme reçoit la réalité et ses événements selon certaines échelles de valeur, parmi elles il y a l'irrationnel et le surréel. L'irrationnel peut tout simplement être la conséquence du refus de classer un fait par humilité ou refus idéologique. Le surréel est, en revanche, plutôt dans le registre de la production artistique, une manière de défier la rationnalité banale par des «créations» dont la nouveauté sort de sentiers battus des arts courants. Dans les deux cas, ils sont des dispositions de l'esprit par lesquelles l'homme reçoit les événements et non pas des qualités intrinsèques de ces mêmes événements. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de faits irrationnels ou surréels, il ne peut y avoir qu'un refus d'intégrer les faits dans les échelles rationnelles de saisie du monde.
Donc, toute idée de mécanique appliquée au vivant, me gêne. D'ailleurs je ne suis pas le seul, car la science appliquée au zoon, c'est à dire à ce qu'on appele le vivant, continue d'être traversée par un malaise permanent : comment éviter de pratiquer à fond et totalement le «rationnel» dans le vivant, c'est à dire y épuiser toutes les virtualités de la raison? D'où toutes les questions sur le clonage et toutes les techniques qui pourraient s'emparer de la matière humaine pour la transformer à l'instar des autres matières. Mécanique, c'est donc précisément appliquer un schéma, et ici un schéma de pensée, sur le vivant, même si ce schéma n'est pas vrai. Car le principal problème moral que représente l'application de la raison froide et expérimentale au vivant, est qu'il se dérobe en tant qu'objet. On peut par exemple faire des clones humains, mais la question surgit tout de suite de savoir si l'on a le droit de le nommer «homme» ou pas. L'objet se dérobe comme résultat, au sens où le clonage est possible, mais pas de ce que l'on croit au départ, c'est à dire de l'homme dans son intégralité sémantique et ontologique. A l'époque nazi, on pouvait se poser la question de savoir si les sectataires du parti national-socialiste étaient ou non des hommes, car ils étaient aussi, pour la plupart, le produit d'une sorte de clonage culturel dans le résultat duquel ne se reconnaissaient pas la grande majorité des être humains.
Autrement dit, on ne peut pas appliquer purement et simplement les protocoles expérimentaux à l'espace du vivant. Il n'y a aucune raison, en outre, de faire une différence entre le vivant humain et le vivant en tant que tel. Lorsque donc, on applique les protocoles universaux de la science au vivant, on prend immédiatement le risque de «dénaturer» l'objet de l'expérience. On dit aujourd'hui d'un poulet de batterie que c'est un mauvais poulet, impropre à la consommation. Il faudrait en fait refuser le label de poulet à un tel animal. De même, il faudra bientôt inventer de nouveaux noms pour désigner les produits des manipulations génétiques. Il faudra appeler le maïs «plante qui résiste à tels virus ou à tel insecte», mais non plus maïs (pour les insectes prédateurs du maïs, cette forme transgénique
n'est plus du maïs, il s'agit donc là d'un déséquilibre sémantique fondamental, même si nous, les êtres humains continuons de l'appeler ainsi).
Retour à la prédation : il faudra aller voir du côté de la manducation universelle : l'univers se mange pour être, et cette manducation générale représente le tableau d'ensemble de la prédation universelle. Il faut bien lire : manger pour être : la nutrition n'est pas une opération objective qui a pour seul but la reproduction de la matière vivante, c'est à dire la face matérielle de l'étant, elle atteint la reproduction de l'être.
Dimanche, le 7 Juin 1998
J'ai retrouvé le concept de manducation dans la Bible, ou plutôt dans le commentaire qui en est fait par son traducteur Edouard Dhorme. Dans son introduction au Pentateuque il parle des «ordonnances concernant la manducation des choses saintes, c'est à dire des victimes offertes en sacrifice». C'est Dieu qui mange ici, qui ordonne les holocaustes qui doivent satisfaire son appétit. Mais surtout, si j'ai bien compris l'essence du Sabbat, Dieu libère le rythme des sacrifices, c'est à dire le calendrier agricole de la consommation des diverses choses «saintes», c'est à dire nourrissantes ! Le monde se mange lui-même, d'accord, mais selon un ordre saint ! Selon l'ordre inspiré par une Raison supérieure qui règle la préparation, la consommation et le digestion de ces choses, céréales, bêtes et boissons. On a envie de dire qu'on est en face d'un réglement d'hygiène ou de diététique. Les Sumériens, comme les Chinois, disposaient d'une certaine liberté dans le comput du temps. C'est à dire que, par exemple, les gouverneurs de province (ou les seigneurs locaux) avaient le privilège de déterminer le début et la fin de l'année, c'est à dire décider des saisons et de tout ce que cela implique sur l'usage même du temps, ce qu'on y fait, ce qu'on y tue, mange, boit ou ne boit pas, fertilise ou pas, ensemence (dans tous les sens du terme) ou pas. Si on s'interroge sur cette liberté, on peut peut-être discerner des causes dans les variations microclimatiques (?). En gros, c'est la même chose que le calendrier sabbatique : l'année est «sabbatisée» bien ou mal. Etonnant, non ?
Ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette sabbatisation devenue inutile depuis au moins l'industrialisation de l'agriculture, je ne parle même pas de l'agro-alimentaire, continue de survivre dans l'idéologie commune, comme si elle avait encore une utilité fondamentale. Les Américains, encore eux, qui sont en général si proches de la Bible, ont depuis longtemps détruit tout contenu sabbatique de la vie quotidienne. Aux Etats-Unis il n'y a plus de jour et de nuit, il n'y a plus de semaines ou de mois. La notion de Sabbat s'est diluée dans le continuum de la production-consommation, manducation permanente et désordonnée, qui illustre parfaitement le contraire éthique d'une société agricole, soumise aux rythmes des saisons. Je pense souvent à l'obésité, nouveau fléau de l'Amérique (pas si nouveau que cela, mais la presse en rajoute toujours). Comme quoi le corps a des raisons que l'industrie ignore. L'Europe ne saurait être trop prudente dans son imitation débridée de son voisin d'outre - Atlantique, et il faudrait ici, mais c'est bien trop compliqué, y intégrer les analyses économiques modernes et tout le débat qui se joue entre les deux côtés de l'océan sur le rôle de l'état dans le procès général de la manducation.
Aussi à méditer, est le fossé qui se creuse entre l'absence de nécessité idéologique d'une manducation ordonnée confrontée à l'exacerbation des comportements religieux. Que les Talibans se retournent vers un sabbatisme intégral, cela se comprend lorsqu'on constate la régression totale de l'Afghanistan vers une autarcie purement agricole. Mais qu'à New-York on continue de prêcher les éléments idéologiques du sabbatisme, il y a là un mystère et sans doute un danger. On pourrait penser que cette stase dans le religieux n'est qu'une réalité qui trahit le manque de confiance dans la société industrielle et technique. C'est aussi la preuve que la formation intellectuelle qui doit aller de pair avec l'industrie fait défaut là où elle serait le plus nécessaire. A voir toutes les perversions théoriques dans lequelles se fourvoient les Américains, la prolifération des sectes, on comprend le poids du théorique, du penser, de la formation intellectuelle. A quoi sert-elle ? Pas seulement à calmer les angoisses d'un progrès infini dont le sens se perd parce qu'il a perdu le rythme de l'agricole, mais encore à découvrir les nouveaux rythmes et les nouvelles formes de la manducation universelle.
Le rythme de l'agricole est sans aucun doute le modèle même du sens. Chaque action des membres d'une société agricole peut être rapporté au rythme fondamental de la vie et de la mort des «choses saintes». Ainsi, le berger n'a pas à chercher le sens de sa vie, ce sens s'inscrit dans le ciel qu'il contemple, comme le réservoir du temps imparti aux différentes opérations de traite de son troupeau. La raison de ses actes se trouve bel et bien là-haut dans le ciel, sous la forme du temps astronomique qui dépote sans discontinuer les finalités de l'être-là du berger. Qu'en est-il de l'ouvrier d'une chaîne de fabrication automobile ? Si la pensée s'est vu attribuer une finalité transcendante au rythme même de l'existence rurale de l'être humain, ce n'est sans doute pas en vertu d'une quelconque nécessité de préparer les circonstances de l'au-delà, mais sans doute bien de régler ce redoutable problème de ce que Bataille appelait la consummation, dont nous avons, je crois, déjà parlé. D'ailleurs, manducation et consummation sont des concepts qui devraient jouer dans la même cour.
___________________
J'en profite pour parler un peu du «modèle français». Rappeler que la France est aujourd'hui au centre d'un feu croisé permanent de tous les idéologues anglo-saxons (et alliés). Objectif : démolir ce fameux modèle ! Et d'abord une question ingénue : quel modèle ? On répond les yeux fermés : l'état omnipotent, dirigiste et protecteur. Omnipotent en politique, ce qui me paraîtrait logique si c'était vrai, car il ne faudrait pas être trop naïf, messieurs, déterminer une politique est aujourd'hui une chose aisée et hélas trop fréquente pour être sérieuse, l'appliquer est une toute autre histoire, et l'a toujours été. Une première constatation, c'est que le rôle de l'état a toujours été surévalué, et il l'est aujourd'hui plus que jamais, alors même qu'il est devenu presqu'impotent jusque dans ses oeuvres les plus vives, maintien de l'ordre, sécurité et politique étrangère. L'omnipotence politique est un leurre savamment distillé par ceux qui veulent s'emparer de l'état et rien d'autre.
Le dirigisme, c'est aussi une belle plaisanterie qui date des campagnes publicitaires autour de l'aménagement du territoire. Rappelez-vous : c'est au milieu des années soixante qu'est né le mot d'ordre «décentralisez-vous», envoyez vos usines en province ! Avec quel résultat ? Une croissance phénoménale de la région Ile de France, un exode biblique entre les régions de France et ce bassin parisien qui s'asphyxie chaque jour un peu plus de cette concentration sans limites ! Bel aménagement du territoire ! Ce dirigisme-là nous a produit son contraire, et pourtant on pouvait encore parler de dirigisme du temps de De Gaulle, tant le rôle de l'état était essentiel pour la survie des entreprises du pays. Les contribuables ne savent même pas tout ce qu'ils ont financé de leur poche, combien leurs impôts ont servi à enrichir des patrons parfaitement privés d'entreprises parfaitement privées, requinquées pour un oui ou pou un non par les deniers de l'état ! Voyez Monsieur Seillières, rejeton de la dynastie De Wendel, un patron que l'état n'a pas laissé mourrir en même temps que sa sidérurgie, parce que cette sidérurgie avait été le commanditaire occulte de ce même général, si prompt dans les années vingt déjà, à encourager l'emploi des chars d'assaut ! Acier = De Gaulle, il faudrait encore y ajouter le sucre... L'état ? Quel état ? En France, l'état commence d'exister lorsque c'est la gauche qui est au pouvoir, c'est à dire lorsque des citoyens se permettent d'imaginer qu'on pourrait utiliser l'état pour défendre les intérêts de la société dans son ensemble, et non pas seulement ceux des «joueurs» de la réalité mondiale.
Lundi, le 8 Juin 1998
Tout est dans le crachat.
Samedi, le 13 Juin 1998
Encore une de ces remarques qui va me valoir beaucoup de haine. Mais j'expliquerai plus tard cette énigmatique proposition sur le crachat. En bref : le mépris et l'arrogance constituent la partie faible de la forteresse des cons. Bof.
Des images me hantent. D'abord celle d'un Indien d'Amazonie avec son sarbacane. Avez-vous déjà médité sur cette forme d'arme de chasse ? L'Indien tue avec son souffle ! J'ai «consommé» un documentaire sur Planète, qui reconstitue tout le scénario du petit homme tout nu qui coupe son morceau de bois, le triture, l'effile, le coupe en deux dans le sens de la longueur, creuse un petit canal, recoud le tout et part à la chasse. Fabuleux. L'oeuvre principale de Simone Weil s'appelle, je crois, «La Pesanteur et la grâce». C'est de cela qu'il s'agit, même si le spectacle du petit homme soufflant dans sa longue tige de bois ne s'avère pas si gracieux que cela, comme quoi donner la mort ne sera jamais classable dans le beau, malgré l'Iliade et l'Odyssée. N'empêche, ça en jette : le sarbacane est bien plus long que le chasseur, cela donne une curieuse impression de déséquilibre, on ne comprend pas pourquoi la flèche doit parcourir toute cette longueur, pourquoi le Jivaro se met dans cette inconfortable position pour tout d'un coup éructer sa force par la bouche en projetant tout son corps dans l'opération. Le clou s'est le fauve qui s'écroule, endormi par le curare : ces «féroces» sauvages tuent leurs proies exactement comme nos médecins endorment leurs clients ! Que voici une mort humainement donnée, avec respect, sans cette boucherie des Saint Hubert. Quel sens de l'harmonie ! Quelle adaptation intelligente et douce aux «terribles» conditions de la nature ! Cela me fait penser aux récits de Bougainville sur les moeurs des «sauvages» du Pacifique.
L'autre image, également vue sur Planète, ce sont des enfants courant dans la rue d'une ville paumée du Nicaragua, en poussant une petite roue. Comme nous, enfants, poussions une vieille roue de bicyclette sans pneu avec un petit bâton. Pousser des roues ! Encore un défi à la pesanteur ! Enfant, nous avons un sens spontané de la grâce, voilà la vérité. Comme les Jivaros, nous sentons bien ce qu'il faut faire pour ne pas avoir l'air ridicule ou ballot. Dans ces courses sans fin, il y a un rythme entre la vitesse de la roue qui tourne et celle des jambes qui s'activent. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu agonique, pas de défi macho entre enfants, on court tout seul, au bord du trottoir, sans se soucier de quiconque. La poésie est totalement pure, sans tenant et sans aboutissant. Comme si l'enfant était, mais je crois l'avoir déjà signifié dans ce journal, parfait d'emblée, pas besoin d'y revenir, pas besoin de retouche métaphysique : il prend spontanément sa bonne place dans le décor. Quel sens a donc l'éducation ? Peréquation des âges ? l'Ecole fait vieillir plus vite ? Toujours la même question : vieillir plus vite et mourir plus tard ou rester jeune et mourir tout de suite ?
Lorsque je vivais au Gabon, j'avais toujours beaucoup d'admiration pour les sculptures des enfants. Ils ont le génie de transformer le moindre bout de bois en Boeing 747, parfaite maquette qui ne demande aucune machine pour la «designer» ou calculer ses proportions. Ca sort des doigts de l'enfant, parfait, avec un petit côté encore mieux que l'original par sa légèreté et sa solidité combinées. Comme les femmes des marchés africains qui prennent vos mesures en vous toisant simplement de bas en haut : - revenez à midi !
Deux images de notre monde. Mais pour combien de temps encore ? Les ordinateurs sont-ils en train de remplacer tout cela ? Le David de la Bible traite de la question, mais quelle réponse ! Quand on voit ce que devient la poésie de la fronde, la truculence de l'enfant insolent qu'était David, on baisse les bras, convaincu qu'il ne s'agit que d'un passage fugace, certes nécessaire, mais seulement un levier utilisé par Jahvé parce qu'il en avait besoin. C'était déjà l'exploitation des enfants... C'est pourquoi le Jivaro est intéressant, parce qu'il a pérennisé son état d'enfant, l'a transformé en praxis, en culture, en éternité sans phrases. David n'était qu'un «moment de la dialectique», le Waonari est un aboutissement refusé par nos civilisations du lourdingue, du pompeux et de la blessure suppurante. Nos vies sont des blessures que notre culture nous inflige et qui ne se referment jamais. La pensée, quoi. Savoir : quel enjeu, la pensée ? Serait-ce le super-jeu de super-enfants ? Sans doute pas grand chose d'autre. Heureusement que j'ai mes certitudes métaphysiques sur l'immanence et toutes ces sortes de choses, ça me permet de souffler....!
______________________
Confort d'intellectuel. A ce propos j'ai entendu notre Finkielkraut national, comme tous les samedis matin sur France-culture. Charlie-Hebdo lui a conféré le sobriquet de Finkielkon, et je crois ma foi que ça lui va assez bien. Ce matin on parlait de Camus et de l'Algérie. Réflexion de Finkielkraut qui s'en prend à Sartre et à Fanon : «si les intellectuels avaient soutenu le FLN avec plus de discernement ...» etc.. Discernement ! Les intellectuels français auraient dû, en fait, «diriger» la guerre d'indépendance ! Quel crétinisme historique et moral ! Cet intellectuel de micro ne veut tout simplement pas reconnaître l'indépendance de l'Algérie, il ne veut pas souscrire à la différence. Il reste donc un simple exportateur d'empires, c'est à dire un colon comme un autre. La violence algérienne a resurgi ces dernières années, et cette violence n'entre pas dans les arcanes mentales de l'intellectuel parisien. Il ne veut pas comprendre que ce qui arrive en ce moment là-bas est exactement la même chose que la guerre d'indépendance, mais une guerre à l'envers. Les Algériens se rebellent contre l'Islam, et cette rébellion fait couler le sang. Finkielkraut rapporte lui-même le jeu trouble des Etats-Unis qui a encouragé la naissance du panislamisme destiné à combattre le nationalisme arabe et donc des responsabilités coloniales, voire simplement impérialistes. Analysons ce qui se passe en ce moment en Afrique, on peut y contempler l'acte deux de la tragédie de cet impérialisme-là.
Dimanche, le 14 Juin 1998
Petite réflexion sur l'usage du temps. Les peuples se réveillent souvent le lundi matin avec une gueule de bois qu'ils ignorent. La semaine leur révèle alors ce qui s'était réellement passé pendant l'apparente trêve du week-end. C'est que les forces qui agissent dans le monde ne connaissent pas les trêves, utilisent cette inconscience collective des humbles pour pousser leurs pions. Depuis que l'informatique règle définitivement les transactions financières, la cloche de Wall Street est une vraie plaisanterie : il n'y a plus de règlement, plus de mi-temps comme au Mondial. Il y a ceux qui décident et qui choisissent les meilleurs moment pour décider, et ceux qui s'illusionnent sur des règles du jeu communes et qui sont les cocus de la réalité. Le vieux Jahvé n'arrive plus à placer sa camelote du Sabbat parce que la maîtrise du temps lui a définitivement échappé. Ce qui compte, cependant, c'est l'organisation
apparente du temps. C'est pourquoi l'Eglise se décarcasse tellement pour garder la haute main sur les destinées de l'Europe : telle les Empereurs chinois, elle veut continuer de régler le temps à sa guise : imaginez l'impact sur la crédulité humaine de l'idée que le Dimanche est consacré au repos ! La question des 35 heures révèle parfaitement le statut privilégié des «cadres» qui échapperont toujours à un rythme de travail imposé. Le rythme de travail est avant tout un rythme disciplinaire, les interstices sont réservés, et de ce fait, décisifs.
Petite satisfaction ce matin. La Libre Pensée s'inquiète des manipulations de l'Eglise à Bruxelles. Il paraît que Kohl a déjà fait savoir qu'il exigeait une référence à la religion dans une future constitution européenne ! Rien que ça ! J'avais écrit un article récemment sur les troublantes ressemblances entre la construction actuelle de l'Europe et ce qui s'était passé lors de la Querelle des Investitures qui a abouti à Canossa, et par la suite à la toute-puissance de l'Eglise en Europe au détriment des politiques. La banque centrale européenne risque, en effet de devenir notre futur Vatican, et qui plus est avec l'aval et toute la sollicitude du véritable Vatican ! Rappel : ils sont tous membres de l'Opus Dei, entre autres Monsieur Van Duisenberg et Tietmeyer. De quoi rêver. Dernière remarque : les Internationales ouvrières ont toutes échoué, mais les internationales des décideurs capitalistes se portent à merveille, merci pour elles et vive Davos, Bilderberg et le FMI !
Samedi, le 20 Juin 1998
Tabula rasa. Faut-il réinterpréter la psychologie de Descartes ? Qu'est-ce-que la tabula rasa ?
Une opération vaguement historique -présentée toujours dans le cadre de l'histoire de la philosophie comme une sorte de fossile précieux mais dépassé, un mécanisme de la pensée «qui a eu son temps et que seul Descartes aura dû accomplir » - ? Je ne le pense pas.
Tabula rasa me paraît être une opération «rituelle» de l'être humain : chaque homme doit, à un moment ou à un autre de son existence, faire tabula rasa et s'exposer lui-même. Lisez-bien : s'exposer lui-même, en tant qu'il est une partie (et aussi un tout) de la réalité. Autrement dit, on ne peut pas rester toute sa vie caché derrière ses pré-inscriptions, sa culture et ses acquis esthético-expérimentaux. Il faut, à l'instar des prescriptions de Nietzsche évidemment, en arriver à se jouer soi-même dans le jeu universel. Il faut donc inventer une morale qui engage à un tel «je dois».
C'est une opération qui comporte beaucoup de risques, certes. C'est sans doute pourquoi les commentateurs de Descartes, et sans doute Descartes lui-même, ont toujours poussé cet impératif du côté de la connaissance plutôt que de quelque chose comme l'action, telle que l'entendaient les Grecs. L'action est d'abord discours, certes, mais seulement sur la base des «exploits» et de leur glorification voire justification. Jamais en tant que tel, c'est à dire en tant que pure rhétorique. Notre sortie, ou notre échappée, de la configuration morale de la guerre, nous rend cette dimension opaque. On ne sait plus ce que pourrait être un exploit en-dehors du cadre des actions de champ de bataille, et c'est pourquoi la violence et ses défis revient toujours à la surface des pratiques humaines, avec leur lots de justifications bidons dont le racisme ou le souci identitaire tiennent la première place.
La tabula rasa est dangereuse, car elle oblige le plus souvent, à sortir du cadre du discours dominant. Le discours dominant est cette culture orale qui «tient» les choses ensemble, immerge les contradictions dans une soupe tiède de compromis qui fait l'équilibre de l'immobilité sociale, politique et spirituelle. Surtout spirituelle.
Car c'est dans l'Esprit que doit commencer la nouvelle guerre, c'est l'Esprit qui doit devenir le champ des nouveaux «exploits» et faire rendre gorge à cette prétention de l'économie à s'emparer de la praxis humaine. Il faut très exactement créer des entreprises de conquêtes spirituelles, engager nos «économies» dans des opérations de grande envergure.
On fait des phrases aujourd'hui sur les sphères de l'économie et les sphères du politique, comme si ces multi-chotomies existaient ! Il n'y a pas, il n'y a jamais eu de dichotomie entre l'économique et le politique : c'est l'une des plus diaboliques inventions du Vingtième siècle, et même très récente, car lorsque j'étais encore étudiant, l'économie n'existait pas encore, nous ne faisions que de l'économie-politique.
Samedi, le 27 Juin 1998
Retour sur le problème de la dichotomie économie-politique. Je me suis très mal exprimé.
Dimanche, le 26 Juillet 1998
Un mois presque, la croisière en Sardaigne à bord d'Ustica, ce dont on reparlera peut-être. Mais je me sens déphasé par cette interruption assez violente d'une vie quotidienne que j'ai du mal à recadrer. Il me faudra quelques semaines de convalescence pour récupérer le sang-froid qu'il faut pour continuer à jouer la comédie de l'existence.
Samedi, le 8 Août 1998
Toujours pas suffisamment de goût pour écrire pour écrire. Mais j'ai un travail en vue, et je n'aime pas le travail. Je me suis engagé pour un exposé sur la séparation du politique et de l'économique. J'avais en tête une vieille lecture, celle d'Hannah Arendt, un livre qui porte le titre assez neutre de «Condition de l'Homme Moderne», un titre de l'époque Marcuse, dont elle était d'ailleurs une grande potesse. Etrange livre, que j'ai relu trente ans après, et qui semble marquer une rupture abyssale avec Heidegger. J'affirme cela parce qu'il se passe dans ce livre un chose extraordinaire, Arendt cannibalise totalement l'ontologie heideggerienne sans souffler un seul mot du philosophe dont elle a été la maîtresse !! Sans citer ses véritables sources au fond. Curieuse escroquerie intellectuelle qu'on comprend mal de la part d'une femme aussi «vertueuse».
Peu importe, la seconde lecture me laisse plutôt perplexe quant à mon sujet. Son coeur c'est la définition de l'action par rapport à la fabrication. Le da sein humain se passerait, selon Arendt, entre ces deux pôles qui subissent un complet renversement dans l'histoire. Donc, d'abord, il y a de l'histoire chez Arendt, il faut le souligner car tout dépend de là. Ce renversement s'opère par une sorte de fantastique réhabilitation des fonctions que Arendt appelle «métaboliques» de la société, c'est à dire son économie. L'économie est définie comme l'espace ou l'homme assume essentiellement sa survie (c'est dans cette optique que les situationnistes définissaient cette survie). Cet espace est aussi celui des relations de violence, de maîtrise et des formes politiques despotiques, selon le schéma de la horde primitive. Le «privé», c'est en résumé ce qui est privé de public, c'est à dire exclu de l'espace de l'action. Il faut s'attarder un peu sur cet espace-là. L'action, c'est d'abord ce par quoi l'homme expose son apparence, c'est à dire exprime son être. Citant Dante, Arendt affirme que l'homme ne peut poser son humanité qu'en exposant son être dans l'action et la parole, à condition donc qu'il existe un lieu où ces actions et ces paroles sont observées, jugées et entendues. Ce lieu c'est la Polis, la Cité, un lieu totalement retranché de l'espace familial et qui n'entretient aucun lien avec lui. Dans cette martingale, l'esclave n'est pas un réprouvé, il est seulement un individu qui ne peut pas, pour des raisons diverses, faire état de son humanité, publier son être à travers les exploits et les paroles.
Or, l'histoire, c'est à dire le mélange fait du développement des religions et du capitalisme, a fait disparaître progressivement la séparation entre ces deux espace. D'un côté, l'homme peut agir dans la production (le capitalisme réhabilité par le protestantisme en est une preuve éclatante). Cela signifie qu'il peut trouver son salut dans le travail, donc aussi bien dans les fonctions subordonnées que dans la maîtrise capitalistique. L'action et la parole ne disparaissent pas, mais elles sont récupérées par le domaine des fonctions digestives de la société. Cela a toute sorte de conséquences sur l'oeuvre, artisanale et/ou artistique, supposée jadis s'opposer par sa permanence à la mortalité des vivants, et tombée aujourd'hui dans les cycles de la production-consommation. Aujourd'hui on change de meubles ou de maison comme de chemise, pour le plus grand bien de l'économie.
Tout cela a eu pour effet de brouiller les cartes du «être humain». Que peut signifier aujourd'hui «être humain» si les actes de l'humanité ne se différencient pas absolument de ceux des animaux qui, somme toute, assurent leur métabolisme sans autres problèmes que ceux que, nous les hommes, leur posons.
Nous y reviendrons.
Samedi, le 22 Août 1998
On pourrait poser la problématique autrement. Aujourd'hui, encore, nous dépendons, en tant qu'être public, d'un état. Nous pourrions, selon l'évolution qui se dessine depuis des lustres, dépendre de tout autre chose, savoir une entreprise, c'est à dire d'un conseil d'administration, d'un directoire et en dernier ressort d'un président. Dans le premier cas, nous sommes dans une dépendance récurrente, c'est à dire qui va dans les deux sens : en tant que citoyen électeur et éligible, je représente une partie de l'état. En tant que salarié d'une entreprise je ne représente strictement aucun pouvoir autre que fonctionnel dans une échelle qui m'est imposée. On pourra longtemps gloser sur la capacité des entreprises à se démocratiser, mais cela me paraît l'une de ces contradictions rédhibitoires, car l'entreprise est l'affaire d'un homme, la propriété privée se charge de le rappeler. L'entreprise a donc forcément une structure politique despotique. Si l'entreprise devenait réellement démocratique, on se retrouverait dans le cas de figure du communisme...ce n'est pas l'évolution dont nous parlions plus haut.
Quels sont donc les domaines qui peuvent régir un choix qui se ferait par rapport à cette alternative, état ou entreprise. J'en vois deux, en gros, le domaine moral et le domaine pratique ou celui de l'efficacité. Encore que celui de l'efficacité peut aussi relever de la morale en tant que finalité utilitaire, mais qu'est-ce-que l'utile, question posée par Arendt, et laissée sans réponse, car il n'y en a pas. Arendt écrit : « C'est en raison de l'utile en général que l'homo faber juge et fait tout en termes d' «afin de ». L'idéal de l'utile, comme les idéaux d'autres sociétés, ne peut plus se concevoir comme choses nécessaires afin d 'avoir autre chose ; il défie qu'on l'interroge sur sa propre utilité ». Elle ajoute cette citation de Lessing : « Et à quoi sert l'utilité ? ».
Du point de vue moral on peut rappeler ce que nous disons plus haut à savoir que si les états se transformaient en entreprises (ou plutôt si les peuples se redéfinissaient comme membres d'une communauté économique et non plus politique : exemple : les Etats-Unis deviendraient l'état de Coca Cola etc...), la position morale des êtres humains faisant partie de ses ensembles pourrait passer sous l'appellation de «servage», car tout comme pour l'esclavage antique où dans la sphère privée TOUT était privé, le tout de l'existence humaine ressortirait du privé. L'homme serait exclu de la sphère politique, ce qui est le propre des peuples asservis par une dictature ou soumis à un régime despotique.
Il n'y a pas beaucoup de place pour de la poésie dans tout ça, et il n'y a pas de grande complexité dans la question de savoir s'il faut ou non garder une séparation entre le politique et l'économie. Il en va tout simplement de la liberté. Ce rappel est d'autant plus important qu'à l'heure qu'il est ce sont les despotes virtuels, c'est à dire les chantres des grandes entreprises, qui revendiquent et se revendiquent de la liberté !!
Et qu'en est-il du fameux dépérissement de l'état ? Question redoutable, car elle met dans le même panier, aujourd'hui, les marxistes et les ultra-libéraux. Les marxistes parce que l'état ne représentent pour eux que la superstructure de la société capitaliste, c'est à dire que les fonctionnaires de cet état ne seraient que les représentants d'une classe sociale déterminée, celle des possédants. Cette version ne semble pas du tout aller dans le sens des intérêts des multinationales, et donc de leurs thuriféraires politiques du genre Madelin, car, entre-temps, il s'est avéré que l'état pourrait bien être autre chose que le défenseur des intérêts capitalistes, à savoir le défenseur des lois qui protègent l'ensemble de la société. Cette protection, selon qu'elle se définisse comme ceci ou comme cela, mobilise des moyens collectifs plus ou moins importants. Ce sont donc plus ou moins de moyens qui échappent à la sphère de la production capitaliste, et, ce qui est plus grave, ce sont aussi des citoyens en plus ou moins grand nombre qui échappent aux lois implacables du despotisme capitaliste. Il y a manque à gagner lorsque l'état fait appel à la solidarité pour financer la protection des citoyens, plutôt qu'à des contrats privés. Les choix libéraux déjà faits dans le monde, comme aux Etats-Unis, cela donne des prisons gérées par des entreprises privées, même certaines polices publiques sont déjà mises à l'encan ! Réfléchissons : la prison, dont le sens est déterminé par la loi, c'est à dire que c'est la loi qui décide si elle est un châtiment ou une simple privation de liberté, est administrée par des personnes détachées de la loi et de ses obligations. Vous allez dire, mais ces prisons sont soumises aux mêmes lois que les prisons publiques. Non, et pour beaucoup de raisons, dont la principale est que le privé n'est pas forcément spécialisé dans le domaine juridique et proprement philosophique de l'application des peines. C'est tout le sens des Grandes Ecoles de notre République, que de former des hauts-fonctionnaires capables non seulement d'appliquer des lois qui ont cours, mais encore de suivre les évolutions législatives avec toute l'attention et la compétence exigée. Pensez-vous qu'une entreprise pénitentiaire du Sud des Etats-Unis va se payer des hauts-fonctionnaires uniquement pour épiloguer sur le sort des taulards ? Pragmatisme, c'est le seul mot qui peut résumer ce qui se passe. J'ai récemment lu un reportage de Charlie-Hebdo sur l'un de ces pénitenciers, c'est tout à fait révélateur : non seulement les prisonniers sont traités selon une véritable philosophie du châtiment, c'est à dire que leurs conditions de vie sont affreuses, mais on les contraint de surcroît à produire de la richesse économique pour le privé, selon des tarifs d'exploitation dignes de Dickens. L'article était intitulé Archipel du Goulag du Sud.
Dimanche, le 23 Août 1998
Reste maintenant une autre question à propos de la séparation de l'économie et de la politique. Remarque : j'utilise tantôt l'expression «le politique», tantôt celle de «la politique». Il faut bien sérier les concept. Le politique peut avoir lieu dans l'économique, tandis que la politique est une sphère pour ainsi dire fonctionnelle, pratiquement et théoriquement détaché de l'économie, sauf, bien entendu, les institutions proprement économiques de l'état lui-même. A noter que ces institutions peuvent rester parfaitement politiques, à l'abri de toute immixtion avec l'économique proprement dit. C'est d'ailleurs là tout notre problème : comment l'état peut-il traiter des questions économiques sans sortir de son rôle politique ? La grande illumination des libéraux dit ceci : l'état ne doit, en aucun cas, s'immiscer dans la sphère productive, il ne doit pas devenir patron ni s'octroyer des moyens produisant des bénéfices. En d'autres termes ou par conséquent, l'état doit se contenter de gérer ses affaires par le moyen de l'impôt en laissant tout le secteur marchand au privé. Question : qu'est-ce-que le secteur marchand stricto-sensu ? Se pose la définition des entreprises de Service Public. Et là, tout dépend du mode de gestion. La Poste, l'Energie, les Transports etc... tous ces services peuvent (et on pu) être gérés de manière à ne produire aucun bénéfice, c'est à dire à ne produire que du service et non pas d'argent, ce service étant financé par l'impôt. J'ai déjà rappelé dans ce journal que ce sont les technocrates de Pétain qui ont conçu les lois de rentabilisation forcée des services publics. Jusque là, le service public n'était soumis à aucun critère de rentabilisation, les impôts augmentaient en fonction des investissements, et pouvaient baisser en raison de la conjoncture. Cette «modernisation» était déjà un cadeau d'outre-Atlantique, par rapport auquel l'état n'a jamais su, par la suite, se démarquer raisonnablement. Heureusement, la taille du service public, et notamment la SNCF, ne permettait pas de systématiser rapidement ce nouveau credo économique. Les investissement décidés par les technocrates de l'après-guerre (qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que les précédents.., malgré les Bousquet et les Papon) devinrent trop importants pour pouvoir se passer de la garantie publique, c'est à dire du remboursement par l'impôt, hé hé ! Je veux parler du nucléaire, de Concorde, du TGV, d'Airbus etc..etc...Des investissements qui ont fait la fortune de la France, c'est à dire qui lui ont permis de se relever des deux guerres et de figurer à nouveau dans les dix puissances économiques mondiales, hé hé ! La garantie de l'impôt, c'est la sécurité de l'investissement : les Français ont payé rubis sur l'ongle la casse de Concorde et de bien d'autres projets comme le Plan Calcul (Bull) et le train aérien. Au total, la pratique française du service public a valu à l'état des possibilités d'investissement et de garantie telles qu'on a pu financer assez de projets fous pour qu'il s'en dégagent juste assez de réussites pour assurer la survie et la prospérité à terme du pays. On peut poser la question sans peur : sans les «grands projets» cités plus haut, de quoi aurait vécu la Frane dans la seconde moitié du vingtième siècle ? Sachant que son territoire ne contient pratiquement rien, que les colonies ont disparus (et n'ont jamais rapporté grand chose), qu'est-ce-qui restait à la France ? L'agriculture et l'agro-alimentaire ? Certes, mais qu'aurait représenté ce secteur sans la Chimie et sans l'énergie bon marché ? Rappelons quand-même que Rhône-Poulenc est l'une de ces entreprises nationalisées qui, à l'instar des Télécommunications sont devenues des entreprises pilotes du point de vue économique (pour devenir rapidement des pompes à phynances pour les gouvernements décavés). Et pourtant elles étaient gérées par des fonctionnaires de l'état ! Aujourd'hui une seule entreprise sert de modèle historique : c'est le Crédit Lyonnais ! Mais cette banque ne représente qu'une très infime partie des entreprises gérées par l'état.
Qu'est-ce-qui est en jeu ? Et au fond, pourquoi les marchés mondiaux font-il la gueule parce que c'est l'état qui gère des entreprises plutôt que le privé ? Très subtilement, et depuis les balbutiements de la construction européenne, les marchés ont martelé cette pseudo-vérité : des entreprises garanties par les peuples créent un déséquilibre dans la concurrence naturelle. Le financement par l'impôt permet le dumping et menace les entreprises privées. Je dis pseudo-vérité parce qu'il n'a jamais été vérifié que les états faisaient du dumping, car il est tout à fait vrai que l'état n'a pas du tout besoin d'en faire, puisqu'il n'a aucune raison de considérer que les services publics doivent être concurrentiels sur le marché. Le service public n'a aucune vocation marchande. Mieux, son fonctionnement peut et doit même introduire un certain équilibre sur les marchés en y introduisant des critères qui limitent les désordres naturels liés à la spéculation et aux sautes de conjoncture. Mais ça c'est une autre histoire. Restons dans l'analyse simple des sentiments du «marché». La rage des dealers de Wall-Street provient d'une seule vérité : la solidarité est un principe intolérable, car il permet à des peuples entiers de se dérober à la fatalité du marché, à ses aléas, ses catastrophes, et finalement à ne pas se soumettre à la raison du despotisme capitaliste. En fait, le marché ne tolère pas l'existence des peuples, entreprises déguisées, entreprises forcément géantes et difficiles à acheter ou à conquérir en bourse ! Au fond les Français sont un peuple de cols blancs comparé globalement à la plupart des autres peuples, une réalité totalement inacceptable pour des gens pour qui compte exclusivement l' «exploitabilité» des peuples et non pas leur indépendance économique. L'exploitabilité au plan mondial, bien entendu. Faut-il ajouter cyniquement qu'il n'y a aucune raison morale pour qu'une nation ne se ligue solidairement en vue d'une réussite économique. Pourquoi l'entreprise serait-elle réservée à des personnes privées ? Existe-t-il une seule raison morale ? Farce.
Le plus comique est que le marché achète les entreprises françaises et même les privatisées, mais que cela ne change rien : leur profitabilité est liée au système, les nouveaux patrons restent donc parfaitement impuissants à changer la structure politique qui sous-tend ce système. D'où le curieux phénomène qui fait que les socialistes finissent toujours par séduire les marchés et que les droites françaises n'arrivent pas à faire imploser l'état. En fait, on peut conclure ici cette curieuse vérité : c'est que ce sont les systèmes politiques qui dominent la scène économique française au moins depuis la guerre, les uns pour reconstruire et faire prospérer le pays, les autres pour faciliter l'invasion des grandes forces économiques mondiales. Gauche et Droite. En ce sens, De Gaulle a été de gauche à cent pour cent, le premier président français à faire ouvertement le jeu des multinationales ayant été sans conteste Giscard d'Estaing et son théoricien du marché Raymond Barre. Pourquoi sont-ce des anciens de l'extrême-droite pétainiste et d'Algérie Française qui ont formé la garde prétorienne de Barre ? Pas de mystère, la «Révolution Nationale» de Pétain n'avait pas d'autre but que de vendre le pays à l'ennemi, celle de Barre a tenté de vendre la France aux multinationales sans considération pour la paupérisation qui allait en résulter dans les années quatre-vingt (voir la saga des «nouveaux-pauvres» attribués, évidemment, à la gestion socialiste ! En conclusion on peut peut-être simplement dire que l'évocation répétée d'une France dont l'état aurait perdu progressivement tout véritable pouvoir politique n'est qu'une pétition de principe des marchés qui souhaiteraient en fait une politique plus forte que jamais, mais dans un sens tout à fait différent de la démocratie, cette empêcheuse d'exploiter en rond. La solidité du pouvoir actuel, celui de Jospin, montre au contraire, que l'économie française est structurellement solide, c'est à dire dans sa relation avec l'état et le peuple. Le peuple français reste solvable malgré toutes les tentatives de le ruiner politiquement, et cette solvabilité reste l'atout-maître de son histoire présente.
Lundi, le 24 Août 1998
J'écris peu le lundi, depuis un certain temps. Comme le rythme du temps nous est imposé ! De quelle type d'individuation s'agit-il, si nous ne disposons même pas de cette liberté fondamentale de disposer de notre temps ? Parfois c'en est à envier le sort des SDF et clochards de tout poil, tant cette liberté-là nous fait défaut. L'individu est encore une simple utopie, car tant que chacun ne disposera pas de son temps - à plein temps - on ne pourra pas parler de liberté individuelle et donc d'une véritable individuation. Il n'y a pas, selon ma façon de voir, des hommes avec des âmes individuelles (une intériorité singulière comme le voudrait Levinas) dans une nécessité à la Spinoza. Non, il y a bien plutôt une nécessité dans laquelle il n'y a pas encore d'individus, et donc pas encore même le problème du libre-arbitre. Ceux qui en ont parlé et qui en parlent sont dans la dimension de la fiction et posent les choses à l'envers : pour qu'il soit possible d'envisager un choix pour un sujet, il faut que ce sujet existe. Habituellement on se contente de postuler le sujet, d'après les axiomes religieux de l'anima individualia (?). Mais c'est bien entendu une ânerie, de même d'ailleurs que le sujet aristocratique de Nietzsche, fantasmé quelque part dans un passé fuligineux peuplé de surhommes blonds et aryens. Reconnaissons qu'il y a des écrits, et donc des pensées, chez Nietzsche, qui ne méritent pas le détour. Confère les premières pages de la Généalogie de la Morale ! Sans parler de certaines pages de la Volonté de Puissance.
Non, il n'y a tout simplement pas d'Homme unairement constitué. La faculté que nous avons de nous supprimer ne prouve rien du tout, d'abord parce qu'elle existe à travers tout le règne vivant. Il faut donc admettre que nous sommes constitués par des champs et des domaines comme le pensent les gnostiques modernes comme Ruyer et Lupasco. On peut ajouter à cela que l'individu est en gestation (par le simple fait qu'il se pense) dans l'histoire et qu'il se libère progressivement des champs. Je pense qu'Internet, par exemple, joue un rôle important dans un mouvement de ce genre : la communication, au lieu d'emprisonner dans une toile, comme le suggère l'image du réseau, détache les individus de la nécessité de dépendre physiquement les uns des autres, ce qui est un gain considérable. Comme je l'ai déjà maintes fois écrit, l'individu est le projet des Grecs, non pas leur découverte, et toute leur métaphysique, y compris ce qui reste dans le Christianisme de l'évangile, n'est que la structure idéelle d'une histoire qui conduit vers l'individuation. Celle-ci est vécue par les artistes et les poètes grecs comme tragique parce qu'elle n'a tout simplement pas lieu : encore une fois Oedipe n'est pas libre, il n'est libre que de retourner, comme le dit Kafka, son invention contre lui-même et de payer jusqu'au bout les conséquences de ses actes aveugles. Nietzsche d'ailleurs ne s'y trompe guère qui finalement reconnaît la toute-puissance des masses. Il la comprend, hélas, comme un Chrétien, et non pas comme l'athée qu'il prétend être. Paradoxe.
Comme un Chrétien, cela signifie qu'il fait des foules la sommation des âmes, au lieu d'en faire un tout organique et non représentatif de l'humain dont il parle à longueur de journée.
Mardi, le 25 Août 1998
Myrie et moi venons de découvrir le petit cimetière juif de Koenigshofen. Admirable. C'est chaque fois un bouleversement pour moi, un cimetière juif. D'abord à cause de la fantastique sobriété de ces lieux, aucun entretien à grand frais, donc beaucoup de végétation sauvage, des pierres très simples, presque aussi simples que les tombes musulmanes qui sont également très belles. Mais ce qui me frappe le plus c'est l'ambiance réelle d'espace pour les morts, une ambiance que les Chrétiens savent maquiller si bien que leurs cimetières en paraissent ridicules. La simplicité de ces lieux fait ressortir l'essentiel : Geboren / Gestorben : Né / Décédé. Ce binôme est implacable de surréalisme, car notre créance en la mort est tellement nulle que de telles attestations sont formidables d'absurdité condensées, mais en même temps apaisantes, curieusement apaisantes. La mort devient quelque chose de simplement réel comme l'existence des pierres et des montagnes, rien d'extravagant. On se sent presque prêt à prendre la file pour venir s'allonger ici. Mais il me semble que j'ai déjà longuement parlé des cimetières juifs, excusez-moi, on se répète, c'est l'ennui des journaux personnels, j'ai déjà vu ça chez les vrais écrivains...
Lundi, 31 Août 1998
Une intuition en passant. En lisant les articles qui accablent en ce moment le pauvre Bourdieu dans les journaux «chics de gauche», je discerne quelque chose d'intéressant. Les scientifiques ne savent pas comment se contorsionner pour à la fois contester la scientificité de la démarche de Bourdieu et à la fois lui laisser un peu d'humanité. J'ai comme l'impression qu'ici la science avec un grand S se détache de la vie : on ne peut pas envisager, au fond, que Bourdieu fasse son autocritique, car cette démarche porterait atteinte à la Science en tant que telle. Hegel avait bien dit que la Science vient «peindre gris sur gris», c'est à dire qu'elle vient toujours en décalage de la vérité, c'est à dire en dernier ressort de la vie. Que Bourdieu soit lui-même emberlificoté dans sa science, cela ne fait pas de doute, comme il ne fait pas de doute qu'il me paraisse difficile, voire impossible, qu'il mette cette science au service de son action de citoyen. Ce qu'il faut retenir de la science, ici, c'est la méthode et la démarche rationnelle, dont Bourdieu ne veut pas de priver, à juste titre, dans sa «militance». Il arrive toujours un moment, dans l'histoire, où le savoir doit laisser la place à l'inconnu. Voilà ce que les scientifiques gorgés de vérité stérile ne peuvent pas comprendre, il n'est pas question pour eux, de laisser l'action se déchaîner dans l'Histoire sans filet. Et c'est là que non seulement ils se trompent ridiculement, mais qu'ils se voient soupçonnables de jouer un jeu, c'est à dire celui de l'attentisme civil au nom d'une vérité qu'ils savent eux-même impossible. Bourdieu a au moins le courage de ne pas s'effacer dans ce double-bind éternel, même s'il se sent à l'étroit entre sa revendication intellectuelle et les choses grossières et forcément populistes qu'il doit traiter dans son action politique.
Pour ma part, il faut que j'en parle, le problème se pose exactement de la même manière : en tant que journaliste je sais que les données de la réalité sont quasi-inexplicables à la grande majorité des citoyens, une inextricabilité dramatique. Mais ce qui est toujours simple à décrire à l'intérieur de cette réalité, c'est l'attitude et l'action humaine proprement dite. La sociologie nous a, il est vrai, gâté grandement l'idée qu'on peut se faire de l'action humaine, en lui attribuant une trop grande part de la nécessité scientifique. Mais cela ne change rien car le problème reste moral et non pas scientifiquement génético-évolutif. Explication : pour la sphère politique, il s'agit bien moins d'atteindre une pertinence historique parfaite entre une évolution supposée latente et implacable, et l'action humaine, que de justifier la pertinence morale des réussites comme des échecs. Ainsi, l'action engagée pour défendre les sans-papiers ne vaut que pour autant qu'elle repose sur des principes intangibles, et que l'on ne se trompe pas de principe ou que l'on n'en oublie point. Ce qui me gène par exemple dans cette action bien trop «caritative», c'est un certain mépris de la nature humaine, on oublie un peu trop que chaque immigré est un homme supposé libre, qui fait des choix dans un contexte pas plus ou moins clair que pour les autres humains. Il y a une dimension évidente de jeu dans la décision de s'aventurer hors de son pays, même si on peut longuement gloser sur les nécessités objectives qui pèsent sur les populations des pays «pauvres». La pauvreté n'est jamais qu'une piètre explication du comportement humain, surtout si on s'en sert sans référence à la dignité et à l'honneur. Je vais peut-être vous scandaliser, mais je suis persuadé que les immigrés clandestins sont à peu près tous prêts à reconnaître qu'ils ont violé les lois du pays qui ne les a pas accueillis légalement, et à repartir sans râler s'ils se font arrêter. Ceux qui s'étranglent de fureur scandalisée parce qu'on veut les jeter dehors, ont tous de bonnes raisons, car entre-temps on les a utilisés, on leur a fait croire dans les plantations du Midi ou sur les chantiers du bâtiment qu'on leur pardonnait leur délit et qu'ils avaient un avenir dans ce pays. Ils pensaient avoir réussi à se faire pardonner leur détournement de la loi en payant de leur personne. Vieille question du respect du Code du Travail dans nos entreprises : si ce code était respecté à la lettre, aucun immigré clandestin ne pourrait demeurer assez longtemps sur le territoire pour avoir une raison de revendiquer d'y rester. Allez en Suède ou au Danemark et vous pourrez y voir les résultats d'une politique sociale cohérente dans ce domaine, car il ne suffit pas d'arriver dans un pays, il faut encore pouvoir y demeurer. Bien sûr, il faut ajouter à cela le caractère aléatoire des lois d'un pays ! Pour ma part, je ne verrais aucun inconvénient à ce que l'on ouvre toutes grandes les portes de notre pays à n'importe qui, sans le moindre contrôle : à condition que cette liberté-là n'en menace une autre, c'est à dire celle qu'a la République de décider des mécanismes de la solidarité sociale. Les capitalistes français par exemple, ne se sont jamais gêné pour exploiter la main d'oeuvre immigrée pour faire pression sur les salaires. La France a même longtemps fondé sa prospérité sur la faiblesse des salaires que permettait l'immigration, une immigration qui par le biais de l'Office National d'Immigration, ressemblait à s'y méprendre à un ratissage d'esclaves du Tiers-Monde. Je peux en attester, j'ai encore vécu les dernières années de cet Office en Algérie, où les candidats à l'émigration se voyaient «maquignonnés» dans leurs douars comme des bestiaux avant de prendre le paquebot pour Marseille. Que l'on cesse toute cette hypocrisie, car le sort des immigrés en France peut se définir ainsi : ils ont dû passer d'un esclavage légal à une forme délictueuse d'esclavage. Horreur classique de notre histoire de Celtes avares et méchants, nous avons progressivement forcé les «pauvres» à venir se vendre illégalement chez nous, ce qui nous laissait encore la possibilité de finir par les traiter en délinquants pour nous en débarrasser.
Les délinquants, c'est donc Nous, car nous violons ainsi la nature humaine elle-même, nous nous servons de la pauvreté pour humilier l'Homme, ce qui me paraît être une sorte de comble du crime contre l'humanité. Pour ceux qui sont familiers des récits de camps de concentration, cette affirmation ira de soi. Les autres auront encore un long chemin devant eux pour comprendre les véritables données de notre histoire.
Jeudi, le 3 Septembre 1998
Je croyais que ce mois d'Août n'aurait pas de fin, tant j'y ai écrit de balivernes. Etrange fertilité dont je prends conscience maintenant que nous sommes bien engagé dans ce mois d'automne. Après tout ce sont les mois des récoltes, et quelque analogie secrète doit nous conduire selon des saisons qu'en fait nous ignorons. Nous sommes seulement surpris lorsque ces saisons, par hasard, correspondent aux saisons astronomiques. (remarque tout à fait digne de Jünger)
Mais aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé hier, sur les ondes de France-Culture. Il s'agissait d'une rediffusion d'une émission réalisée en 1987 sur Martin Heidegger, avec quelques invités prestigieux comme Derrida et Lacoue-Labarthe. Et c'est précisément mon ami Philippe qui m'a fait passer un merveilleux quart-d'heure en parlant de la théorie heideggerienne du langage. Le langage parle ! Depuis des années je lis et relis le livre de Heidegger qui s'intitule «Acheminement vers la Parole», et je dois humblement avouer que je sèche terriblement, que c'est un des rares textes de Martin Heidegger qui me scotche l'esprit et me procure encore l'une de ces angoisses qui me brûlaient encore en permanence il y a une vingtaine d'années. Bref, j'ai commencé de comprendre et c'est lumineux. Mais une chose est quand-même grave, c'est que cette pensée du langage recouvre logiquement ce que moi-même j'écris (notamment dans le Troisième Entretien Préliminaire). Alors je ne sais plus si j'écris sous la dictée d'une sourde mémoire de mes tentatives de lecture, ou bien si ma subjectivité m'interdit même de comprendre le style du maître. Ce qu'il faut comprendre, il est vrai, n'est pas rien. En fait, il faut l'admettre plutôt que de le comprendre, comme beaucoup de choses en ce monde ! Il faut admettre que nous sommes parlés par le langage ! Nous, c'est la parole, ce qui signifie non pas que nous parlons en nous parlant, mais que la parole nous parle. Comme elle entendait cela, ma compagne Myriam remarque en passant que Lacan s'est bien servi chez Heidegger, reconnaissance tardive mais bien réelle et méritoire pour une psychanalyste lacanienne.
Mais tout cela n'est ni simple ni innocent. Il faut maintenant donner chair à cette fantastique affirmation, ne pas se contenter de l'encaisser, et l'occasion m'est justement donnée dans le travail que je prépare sur l'état et l'économie, l'action et la parole, la parole-action. Pas facile.
Surtout que je dois essentiellement présenter la version Arendt de tout cela, une version qui trahit beaucoup de choses et qui, finalement, ne dit pas grand chose.
Samedi, le 5 Septembre 1998
La seule contrainte qui domine la vie de l'homme est l'injonction qu'il se fait à lui-même de découvrir pendant qu'il est vivant, tous les fils qui le relie à l'étant, de telle sorte qu'il ne peut plus avoir peur de passer du côté de cet étant particulier que nous appelons le royaume de la mort. Le travail de la conscience est ainsi un travail sur elle-même. Le «connais-toi toi-même» de Socrate ne signifie nullement qu'il faille découvrir les singularités qui devraient constituer un Moi unique, car ce sont précisément ces singularités qui sont chargées de l'opération de découverte, mais qu'il faut tâcher de voir un jour comment ce Moi s'harmonise avec l'océan qui l'entoure. L'homme est toujours dans la position du naufragé. Dès sa naissance il n'a d'autre choix que de chercher en-dehors de lui les appuis qui lui permettent de s'ancrer, non dans la santé ou le bonheur, mais dans ce qui se trouve en-deçà et au-delà du présent. Au bout du compte il se rend compte que la carte marine dont il a besoin figure dans son for intérieur comme compréhension du rythme de ses propres passions, compréhension qui est la paix elle-même de l'étant. Au demeurant, la santé ou le bonheur ne sont que des symboles d'une adhérence profonde, mais qui ne peut conserver sa qualité qu'à condition de parvenir à trouver le rythme du tremblement de l'être.
Dimanche, le 6 Septembre 1998
Terminé le travail sur Arendt. Très scolaire, résumé difficile car finalement la pensée de cette femme se dérobe pour rester dans les panoramas historiques et critiques. Elle n'a rien à offrir de bien précis, pas de passion, pas de véritable foi ni en l'homme ni en rien d'autre. Bon, c'est à prendre ou à laisser, me dit Myrie. Certes.
Mon véritable sujet c'était le statut réciproque de l'état et de l'économie. Essayons de rassembler nos idées, personnelles, et ce qui en reste après les analyses d'Arendt qui restent quand même incontournables.
A vrai dire, cette dichotomie n'en est pas une pour moi. La chose va de soi au sens où toutes mes analyses récentes aboutissent au fond au même résultat, c'est à dire à l'identification de l'économique au politique, ou plutôt à « l'éternelle possibilité de subsomption de l'économique au politique».
Explication. L'économie en tant que telle me paraît devoir ressortir de la catégorie ou de la qualité de la neutralité, au sens où elle n'est pas originellement relation d'homme à homme, mais relation homme-nature. Les Grecs ne se trompaient pas là-dessus, l'économie est une fonction métabolique devant assurer la survie physique. Dans le schéma historique d'Arendt, l'économie prend la place du politique, ou s'empare de la souveraineté en détruisant - dans un processus qu'elle se garde de décrire comme achevé - l'oeuvre de la cité, c'est à dire la culture de l'humain dans sa lutte contre le Temps, la mort et l'absurde, pour le bien, beau et l'éternel.
Principal accusé, au fond, le Christianisme, qui aurait évacué la nécessité même de cette lutte, en postulant l'éternité divine dans sa dimension subjective. L'âme catholique n'a plus besoin de culture !!!
Ce schéma ma paraît un peu naïf. D'abord parce qu'il confère à une religion déterminé un pouvoir opératif immense, en oubliant de signaler que les thuriféraires de cette religion ont, à leur tour, utilisé politiquement et économiquement leur doctrine, à des fins tout à fait identiques à celles des anciens Grecs ou Romains : l'Eglise s'est constituée elle-même en Cité, St Augustin ne le cache même pas. La Chrétienté peut elle-même s'analyser comme une entité politique, avec son monde propre, l'appareil ecclésial, et son monde exogène ou impropre, le monde qu'elle a elle-même qualifié de «laïc».
Ensuite parce qu'il postule une incroyable passivité humaine, alors que l'histoire ne montre, en réalité, que violence et lutte contre cet appareil, même quand l'Eglise tente de récupérer cette histoire à son profit (les schismes, les Croisades, la Réforme, etc...). L'enseignement historique a longtemps tenté d'escamoter la lutte féroce qui a opposé les divers pouvoirs politiques (féodalité, empires) à l'Eglise Catholique elle-même, ce qui ne prouve pas seulement la résistance du monde gréco-romain au système totalitaire chrétien, mais aussi le fait, que l'Eglise ne domine pas réellement les millénaires qu'elle s'attribue. A noter aussi que l'Eglise se caractérise dans les batailles qu'elle livre, plutôt comme barbare, il suffit d'évoquer ses méthodes 17ème que l'on peut observer depuis sa guerre contre l'arianisme jusqu'aux guerres de religions du siècle.
Il se passe, en réalité, entre l'Eglise et les états, ce qui se passe aujourd'hui entre l'économie et les états à la différence près que l'économie a fait place nette des controverses doctrinaires pour aller à l'essentiel. Je veux dire par là que l'économie, en tant que domaine culturellement vide et neutre (comme nous l'avons dit plus haut), est devenu
le champ de bataille du politique.
Pour aller vite, disons que la guerre au sens grec, c'est à dire recherche d'héroïsme, de valeur, d'actions à résonances éternelles et fondatrices d'humain, a lieu aujourd'hui dans les entreprises et sur le marché mondial. Ce que Marx appelait la Lutte de Classe ne semble une notion douteuse que parce qu'elle s'insère dans une théorie scientifique et en apparence mécaniste de la société, mais si on réinterprète le concept au plan subjectif, on doit admettre que cette lutte est ce qu'il y a de plus universel dans l'économie et l'état.
Que signifie subjectif ? Cela signifie
individuellement confronté au destin. Qui, parmi nous, peut se targuer de vivre à l'écart de cette confrontation ? Qui, parmi nous, peut dire qu'il ne doit défendre sa dignité jour après jour, lutter pas à pas contre les empiétements de ceux qui sont à côté de lui comme ses supérieurs en hiérarchie et en décision ? Le discours actuel fait passer tout naturellement cette incroyable ânerie qui prétend que nous vivons dans la paix sociale ! Les malaises sociaux nous sont présentés non pour ce qu'ils sont, c'est à dire la conséquence des iniquités, mais toujours pour des phénomènes erratiques, voire des conséquences de la folie collective. On présente les conflits sociaux comme des accidents de parcours naturels, comme des réajustements conjoncturels, alors qu'ils ne font qu'exprimer, à chaque exemple, l'existence permanente de l'injustice et de l'iniquité, même si les victimes de ces injustices sont souvent manipulées à des fins elles-mêmes subjectivement iniques.
Ajoutons à cela que ce sentiment individuel d'hostilité sociale, dans le travail, là où l'on vit, dans son immeuble, dans sa ville etc.. se cristallise collectivement. Une collectivité peut former un sujet en tant que tel. Le communisme fait peur, précisément parce qu'il ne cesse de subjectiver les communautés humaines, classes, partis, nations, d'en faire des acteurs collectifs de l'histoire. La crise qui secoue en ce moment tout l'Extrême-Orient fait resurgir le fantôme des confrontations impérialistes, tant le destin des peuples d'Asie dépend aujourd'hui du bon-vouloir des grands empires financiers. Dans ce contexte il faut se demander où sont les Barbares ? Et qu'est-ce-qui pourrait se définir aujourd'hui comme barbare sur ce champ de bataille économique ? Les faits ne manquent pas : du scandaleux travail des enfants aux profits coloniaux des multinationales, pourquoi poser encore la question de savoir si ce que nous considérons chez nous comme des crimes, le sont ailleurs ? Hypocrisie totale. Mais plus près de nous : ne peut-on qualifier de barbares les nouvelles déréglementations que les entreprises en France voudraient faire correspondre à l'introduction des 35 heures ? Minuter l'hygiène personnelle, faire payer les temps de repos à l'intérieur de l'entreprise ? Barbarie, il n'y a même pas de question. Résurgence des anciennes barbaries sous le prétexte économique.
Que représentaient les barbares pour les Grecs ? Ils étaient, certes, ceux qui ne parlaient pas la langue grecque. Mais cela n'était pas une raison suffisante pour réduire en esclavage ceux qu'on réussissait à capturer. La vraie raison est que les barbares sont ceux qui ne partagent pas les lois de la cité, qui n'appliquent pas les codes de l'humanité civique ni même les lois de la guerre. Si on lit bien l'Iliade, on se rend compte du caractère incroyablement chevaleresque des batailles qui se livrent à Troie. Au-delà des pièges et des stratagèmes rusés que les uns et les autres utilisent pour vaincre, le principe de la bataille antique reste le corps à corps loyal, dans lequel n'interviennent que les héros. Les serviteurs de ces guerriers ne prennent l'épée qu'en dernier ressort et seulement pour tenter de protéger leur maître blessé, mourant ou mort. Ce que les Anciens reprochent aux Barbares, c'est la barbarie, c'est à dire la cruauté naturelle et sadique, non médiatisée par la Cité et les lois de l'honneur. Ce qui subsiste de cette cruauté et de ce sadisme dans les moeurs des Grecs et des Troyens, Homère le réserve aux morts : ce sont les héros morts qui sont menacés de destruction physique ; la cruauté noble, celle qui est le fruit de la médiation culturelle de la Cité, c'est de refuser aux morts le rite funéraire. On comprend ici clairement que la finalité civique, le but de la Polis, n'est pas la survie, mais l'éternité et c'est dans l'éternité que l'on punit les hd'Allende,éros, pas sur cette terre.
Ce matin lecture du Monde, le récit de la mort héros grec.
En conclusion, le résultat de l'évolution qui a, en apparence, unifié l'économique et le politique, est la guerre totale et permanente, avec ce redoutable problème que pose une guerre totale qu'est l'identification et la localisation des protagonistes. Cette guerre totale n'a pas encore son propre cadre, c'est à dire un monde entièrement dominé par les grandes entreprises en une société unifiée, où le sens et les acteurs des confrontations devraient apparaître au grand jour. D'une part il reste encore des formations politiques résiduelles (nations, regroupements régionaux, hégémonies). De l'autre subsistent encore des lois et des moeurs correspondant à la dualité classique état-économie (la Polis et l'Oikia). La question reste de savoir si le lissage économique est une fatalité, c'est à dire si ce que Arendt appelle le
processus est appelé à aller à son terme, c'est à dire l'homogénéisation pratique et morale de la société mondiale dans une fonctionnalité économique pure.
La question pendante est de savoir si une force politique quelconque a une chance d'empêcher tout cela. Cette force pourrait aussi bien être un état démocratique voire despotique, qu'une forme quelconque d'unification de forces sociales : lobbies, associations, organismes supra-nationaux etc...De grandes organisations mondiales existent qui pourraient, le cas échéant, refonder concrètement, c'est à dire avec le pouvoir politique correspondant, la cité antique et sa praxis. Malheureusement, ces organisations sont minées elles-mêmes par le paramètre économique de leur financement et sont elles-mêmes le lieu d'une confrontation permanente entre nations plus ou moins riches.
Jeudi, le 10 Septembre 1998
L'actualité répond admirablement à mes préoccupations. L'effondrement de la Russie font se multiplier les commentaires sur l'absence d'état dans ce vaste pays. Il manquerait là ce que certains de mes amis appellent un «régulateur». L'état régulateur de l'économie, ou bien l'économie régulateur de la totalité ? Notre petit club a eu une longue discussion, hier soir, après mon exposé sur Arendt, d'où est ressortie cette notion de régulation. L'économie serait, selon les uns, ce régulateur général et la question de poserait, mais ce n'est pas du tout mon avis, de savoir quelle forme de régulation prendrait la relève si l'on parvenait à revenir à une situation semblable à celle de la Polis, c'est à dire à la précellence du Politique. Je n'ai pas beaucoup discuté la dessus, me contentant de faire valoir que le concept de régulation était par essence un concept économique, et que toute pratique non purement économique ne pourrait, d'aucune manière, se référer à une régulation. J'ai bien compris le souci qui se cache derrière cette question, à savoir celui de la cohésion sociale. A ce propos j'ai dû très mal résumer la pensée d'Arendt, car il n'a pas été possible de faire comprendre que la société, loin d'être ce dont on attendait l'avènement à travers une révolution quelconque, était ce qui occupait désormais tout l'horizon. L'homme est devenu social, après avoir été esclave, sujet ou citoyen. Mais il aurait fallu, en quelques minutes c'est difficile, décrire toute l'évolution qui tisse le système de dépendance réciproque marchand, à partir duquel il n'y a plus de famille, d'ethnie, de tribu, de nation ou même d'empire, mais plus que de la société, étendue sur toute la planète.
Mon explication sur le sens n'a pas non plus été bien comprise, j'ai seulement senti qu'elle éveillait une certaine sympathie. J'ai décrit le sens comme la réalisation du destin singulier. A quoi on m'a fort justement opposé que la Cité était précisément l'endroit où l'on devait abandonner sa singularité au nom de la loi commune. En réalité, ce que je disais était un peu différent, car la réalisation du destin singulier ne peut se faire qu'à travers, si je puis dire, les yeux de la Cité. C'est la Cité, avec ses lois et ses règles du jeu, qui permet à la singularité elle-même de se manifester, sans quoi celle-ci reste l'indéterminé proprement barbare. Et j'ai ajouté que tout destin qui n'est pas repris par le discours civil, immortalisé par le poème et la reconnaissance de la cité, est perdu dans le métabolisme de la nature. C'est pourquoi l'économie ne peut pas être le lieu de cette effectuation, ni le sport, espace réservé totalement à la nature.
Ce qui nous ramène à la question du sens : le barbare, c'est ce qui ne peut pas faire sens parce ce que ce n'est pas déterminé par les lois de la Cité, qui sont les lois des hommes libres. Il ne faut pas faire d'archéo-impérialisme, et prétendre que les Grecs et les Romains ont été les seuls peuples d'hommes libre etc... Il reste que la perfection de leur modèle a défié le temps, alors que les règnes des Rois et des Empereurs les plus éclairés n'ont pas résisté à l'oubli, ne se sont pas inscrit dans la culture, c'est à dire dans la tradition. Même les grands empereurs de Rome, Auguste, Trajan, Claude ou Dioclétien ne doivent leur grandeur dans la mémoire que parce qu'ils ont constamment veillé à entretenir les traditions démocratiques du peuple romain. On oublie trop souvent que dans la vie quotidienne de l'Empire, rien n'a changé entre la République et Constantin, la structure politique a fonctionné jusqu'à la Rome chrétienne exactement comme elle avait fonctionné avant César. Evidemment, les Grecs comme les Romains, ont écrasé, comme nous-mêmes au cours des cinq derniers siècles, des quantités de «cités» politiquement admirables dont nous commençons à peine l'étude. Mais cela ne change rien à la qualité de modèle abstrait que représentent ces deux civilisations.
Le barbare, ai-je ajouté hier soir, c'est ce qui permet l'exploitation dans les entreprises, parce que l'absence de culture, c'est à dire l'absence d'assimilation des lois, c'est à dire de la structure de la liberté, oppose au travailleur une réalité aléatoire, aussi fatalement dangereuse que l'était la jungle des hommes de la préhistoire. Là où les travailleurs se sont organisés pour fonder leur propre cité, leurs organisations de lutte, ils ont pu découvrir que leur destin n'était pas simplement déterminé par les lois de la nature, les mystères de la prospérité et des calamités, mais par des relations politiques entre hommes. Il est pourtant simple de comprendre que tout homme qui travaille entre forcément dans une relation d'évaluation de son pouvoir, de sa force, de la relativité de son revenu et de celui des autres. Dans une entreprise, il y a une pyramide des revenus qui correspond forcément à une pyramide politique, non pas parce que les hauts revenus ne sont pas justifiés dans un absolu fonctionnel de l'économie elle-même, mais parce que l'inégalité fomente la relation politique de facto.
Tant que les relations restent politiques, cela signifie qu'elles trouvent des médiations de toute sorte et qu'il y a une sorte de consensus. La hiérarchie se vit comme une nécessité à multiple visage, compétence réelle, chance, qualité et puissance de travail, études etc...mais aussi et toujours comme une intolérable inégalité de fait. L'élaboration de cette inégalité peut conduire à la résignation, comme elle peut motiver l'individu pour se dépasser d'une manière ou une autre, ou encore à organiser la lutte selon les règles de l'alliance avec les autres.
Ce sur quoi il faut insister c'est que l'injustice ou le despotisme se sont possibles que là où règne la peur de l'inconnu, la terreur des longues nuits de la préhistoire, ce qui explique le profusion idéologique des discours millénaristes sur les caprices de la Bourse et de la Finance Mondiale. Dans ce monde économique, les hommes affrontent la réalité comme les esclaves la nature, c'est à dire des phénomènes qu'ils ne maîtrisaient d'aucune manière.
Mercredi, le 16 septembre 1998
Levinas. Un mot, un signifiant comme un autre, et une énorme gifle métaphysique. C'est comme cela que j'ai toujours reçu ce penseur insolent, sans, jusqu'ici, réussir à calmer toute l'irritation qu'il suscite en moi. Irritation qui signifie évidemment qu'il touche quelque chose d'important en moi tout en bousculant allègrement le reste.
Je m'y suis donc remis ces derniers temps, car il me semblait que la contamination dont parle Derrida gagne de plus en plus de terrain autour de moi. Voyez à quoi tient un effort de penser, ou du moins de lecture. Si je me souviens bien, il n'en est pas allé autrement avec Heidegger, car c'est cette sorte de bruissement général autour de moi à l'université dans les années soixante qui m'a maintenu sous pression jusqu'à ce que sa pensée finisse par se frayer un chemin vers la mienne.
Alors l'anti-Heidegger qu'est Levinas ! vous vous rendez compte ?
Que pense ce penseur occidental, grec et juif ? Il pense tout simplement que tout ce qu'on a pensé jusqu'à présent (sauf peut-être au fond de quelques pages du Talmud) est faux. Je sais bien que c'est là une de ces coquetterie bien connue des philosophes, que de toujours annoncer l'obsolescence de ce qui s'est pensé avant eux, mais Levinas fait plutôt, lui, l'effort inverse, qui consiste à montrer que tout le monde a toujours pensé comme lui, sans le dire, même, et surtout, Platon. A ce titre, d'ailleurs, on le comprend, puisqu'il se fonde sur l'anti - parménidisme de Platon pour le tirer vers lui, mais les choses n'en sont pas moins énormes. Comment Levinas peut-il faire l'économie de la théorie des Idées au prétexte d'un platonisme qui serait pensée du multiple ? D'autant que Parménide n'est pas du tout, à mon sens, penseur de la Totalité ou du Même, ou bien qu'il ne l'est que dans l'usage logique et intellectuel de la généralité ou de l'universel. Héraclite, auquel on aboutit instantanément chez Levinas, n'aura jamais été, pour nous autres penseurs du Crépuscule, que l'envers de Parménide, ou son complément ontique.
Mais ce sont là, aussi, des généralités. Je ne vais pas tenter de dissimuler mon état de perplexité devant l'incontournable quinte-flush intellectuelle que représente le positionnement, comme on dit si vilainement aujourd'hui, d'autrui, ou d'Autrui. (Je ne vois pas très bien pourquoi Levinas se croit contraint à cette majuscule, car cette manipe porte une ombre de suspicion sur le reste, à mon sens. Je dis manipe, car autrui reste autrui, déjà avant que Levinas ne le revête d'une telle importance ontologique. N'y-a-t-il pas là une trace de doute, dans cette nécessité qui s'affiche de consolider le concept par une manipulation purement esthétique ? Sans doute, car beaucoup de commentateurs ont débusqué chez Levinas cette propension à contourner le discours et la mathématique conceptuelle.)
Mais revenons à la position d'Autrui : rien moins que l'origine.
Autrui est ce par quoi l'être arrive ! On se croirait chez Freud ou chez Lacan, alors que ces deux penseurs sont eux-mêmes de fieffés penseurs de la Totalité.
Il y a une vingtaine d'années, il m'était venu cette illumination d'une subjectivité totale du langage et, surtout, de la relation esthétique (au sens de «sensation-perception») avec la réalité. Cela donnait l'Histoire comme le développement progressif des entrelacs de souveraineté. Pour illustrer cette idée, je me persuadai que de percevoir telle chose en bleu, provenait d'une sorte de façonnage de cette perception particulière. Une idée qui reposait en partie sur une petite remarque de Marx disant que «l'homme s'était proposé l'oeil, et qu'il a créé l'oeil», exactement comme il a créé l'industrie et son rapport de domination sur la nature.
Pareil pour le langage. Je résume : on ne parle que la langue établie par les hommes - souverains, ceux qui ont eu la force de dominer ce qu'aujourd'hui on appelle les consensus ou encore les conventions. Autrement dit, je postulai que les hommes parlent et sentent comme il le leur est imposé par le passé, et modifient la parole et la sensation selon leur degré de souveraineté. On parle toujours la langue d'un lointain Empereur, on jouis toujours de l'art entièrement créé par un ancêtre aussi ontique que chacun de nous, aussi palpable que l'est notre propre corps. Je pensais donc qu'il n'y avait pas de mystère transcendant l'humanité, et mon idée était de débusquer toutes les naïvetés de l'idéalisme d'origine théologique. En gros, d'ailleurs, je reste fidèle à cette pensée, compte-tenu de l'enrichissement prodigieux dont j'ai bénéficié avec la pensée de Heidegger. Ce dernier, il faut souvent le rappeler, est, à mon sens, totalement laïque, aussi laïque que le requiert une telle pensée.
Donc, Levinas. Sa thèse est très proche de tout cela, du moins techniquement. Puisqu'il fait dériver toute l'ontologie de la relation à autrui, il entre parfaitement dans ce schéma matérialiste, car la pensée n'est, en dernier ressort et dans la tradition philosophique, que le comput du langage et des perceptions. Sauf que ce n'est pas de l'ontologie qu'il produit, mais «autre» chose. Je ne prétends pas avoir saisi toutes les finesses de son «Autrement qu'être» et de son «Au-delà de l'essence». En lisant d'ailleurs son «Totalité et Infini» je me suis immédiatement rendu compte qu'il y avait confusion entre être et essence, et que toute l'insolence de Levinas se trouve là-dedans, dans cette confusion. Il fait mine d'ignorer que l'être est décalé par rapport à l'essence, décalé car engagé dans le temps, alors que l'essence est un être transcendantal, une simple catégorie logique. Cela me paraît central, car personne ne nie, dans la tradition, qu'autrui est le Temps (ce que je viens de rappeler en exposant mes souvenirs). Personne, non plus, ne nie que l'essence est, à chaque fois, c'est à dire à chaque fois que la nécessité surgit de la poser, ce qu'autrui dépose dans l'histoire de lui-même en tant qu'il s'oppose à autrui. L'autre concept, si l'on peut dire, celui d'ess
ance, est une vraie blague, car quoi de différent s'instaure avec ce petit
a là d'avec l'être ? Pourquoi faut-il dédoubler le concept antique ? Freud est sa théorie du désir n'est pas loin, on l'aura compris.
Sinon pour débouter, je dis ça à la volée, le concept d'être de sa position souveraine dans le combat des âmes dans l'Histoire ? Qui dit que le désir n'est pas l'organe principal de l'être ? Faut-il remonter à l'Etre-Dieu pour rendre ce désir intelligible ? Je ne le pense pas, contrairement à Levinas. Ses majuscules sont des majuscules théologiques, je le crains, mais je n'en ai pas fini avec lui, et nous y reviendrons.
Au total quand-même : oui, l'être nous advient par autrui, mais cette parousie n'est pas à refaire selon le rythme qu'indique le «totalitarisme» levinassien, car cela signifierait un arrachement à l'histoire qui ressortit d'un idéalisme au moins aussi délirant, même s'il est magnifique, que celui de Berkeley. Au fond, Levinas pourrait bien ne figurer qu'un retour massif à cet idéalisme-là, dénaturé par le doute cartésien et son semi-réalisme. On sait bien que les Anglo-Saxons ont toujours été les meilleurs lecteurs du Talmud, voyez Milton.
Mardi, le 22 septembre 1998
Il faut en finir avec les obs-cu-ri-tés ! Et les obscurantismes ! Qu'est-ce-qu'un Dire qui ne se montre pas dans un Dit ? C'est très exactement un non-Dit, c'est à dire une catégorie de l'Inconscient. Théologiquement, c'est le Désir de Dieu, ou son Regard ou sa Volonté ou tout ce que vous voudrez. Ce que Lévinas suggère en douce, c'est la cécité absolue comme condition du créé : ce qui est créé ne peut pas avoir d'yeux, car les yeux appartiennent à la dimension de la création. Autrement dit : la fameuse proximité d'Autrui se joue dans la cécité et son destin se définit finalement dans une ligne de la Table des Lois. Le fait qu'il faille un Tiers pour que le Dire devienne Dit et pour rendre possible la socialité, c'est une terrible banalité qui nous replace devant ce dilemme : tuer ou aimer. Tant de bruit pour si peu de choses ? Notre histoire n'a-t-elle pas mieux travaillé que cela ? La Shoah ? Certes, mais le concept d'Autrui n'offre aucun gilet pare-balles métaphysique. Lévinas devrait relire la Passion Christique au sens hégélien ou historique. Il verrait alors que les hommes sont souvent tentés de se jouer le «Père pourquoi m'as-tu abandonné?», parce que cette tentation fait partie de la structure du destin. Oui, Lévinas, tout Lévinas circule entre ces deux mêmes : le Père et la Raison. La horde primitive et la République. Voilà peut-être pourquoi il s'en prend si vivement au Même.
Mais on peut encore descendre dans le questionnement. Le Même ou «la totalité» forment le «déchet» de l'être. Si j'ai bien compris. OK. Mais pourquoi et comment voulons-nous et pouvons-nous nous retrancher de ce déchet ? Réponse : il n'est pas question de vouloir quoi que ce soit. Dans ce composite ontologique lévinassien, Autrui est un absolu fantasmatique qui n'existe (n'ek-siste) que derrière le buisson ardent du Mont Sinaï. Les «autres» Autrui(s) ne sont que des figurants dont le Visage masque un autre Même, Iavéh. C'est donc de Sa Volonté qu'il s'agit. Quant au Pouvoir, il réside dans la disjonction que seul Lui peut effectuer entre l'ek- et le -sister. Or, nous avons mis plus de deux mille ans à les joindre, ces deux-là. Faire droit à Lévinas reviendrait simplement à rayer l'oeuvre accomplie et à cesser d'oeuvrer.
Pourquoi pas ? Mais alors il faut le dire. Tiens tiens, Dire !
N'y-a-t-il pas là deux mondes qui s'affrontent depuis toujours ? Caïn et Abel, le constructeur et le joueur de flûte ? Le nazisme a bien été une construction, et une construction monstrueuse, une érection maudite. Mais cette erreur d'architecture doit-elle condamner tout le reste ? C'est un peu comme les enjeux politiques actuels : sous le prétexte que le Communisme aurait ignominieusement échoué, ce qui exprimé ainsi est tout simplement faux, faut-il condamner toute morale sociale de solidarité et tout projet commun ? Faut-il rejeter à l'enfer le communisme lui-même comme idéal humain ? Au nom de quoi ? Au nom d'une poésie qui voudrait que l'humanité soit une magnifique pyramide immobile coiffée par un fantasme ?
Vendredi, le 25 septembre 1998
Il y a des ondes qui travaillent en moi depuis quelques jours. Elles me disent qu'il y a de la matière à écrire pour me libérer un peu plus. C'est la première fois que je sens à quel point l'écriture n'est rien d'autre qu'une libération. On sent monter une révolte à propos d'une question, elle s'organise en mots et dès lors veut sortir dans un texte. Quand c'est fait, je sens qu'un espace est déblayé, qu'un nouveau vide se crée ou une surface tout simplement propre. Non pas qu'une vérité vient de s'ajouter à une autre, ni qu'une accumulation vient de se faire dans un débat ou une élaboration, mais c'est d'une sorte d'hygiène qu'il s'agit, comme si je voulais rester propre de mes propres cogitations, m'en nettoyer pour ne pas mourir subitement dans un habit qui ne me plairait pas ! Il est toujours pesant de rester dans une «opinion», c'est sans doute pour cela que Platon a inventé cette catégorie. Mais il dissimule, ce faisant, que toute cogitation est de nature doxique, (dans ce contexte je pourrais dire toxique..) et que toute expression aliène le penser dans une signification, qui n'est pas moins qu'une chose, qui en est plutôt le modèle. Il faut donc brosser, laver, lessiver et ne jamais laisser dessécher la peau de l'âme.
Mais du coup, j'ai perdu le sujet que je voulais à tout prix développer ici. Tant pis, cela me reviendra.
Mais encore un aparté. Le journal Le Monde publie ces derniers jours, ce qui ressemble à une série sur les philosophes du moment, ou, disons, les grands intellectuels. Jean Luc Marion, Georges Steiner, des gens qui ne font pas de bruit dans les média, comme Derrida ou Bourdieu, mais qui font un autre chemin, aristocratique et efficace quoique douteux. Pour Marion les choses sont plutôt claires, j'avais lu son oeuvre principale sur la Donation, qui est son concept ontologique. Rien que le mot suffit à me le rendre suspect, mais il suffit de signaler que Marion est parfaitement catholique. Steiner, c'est autre chose. Ce n'est pas un philosophe à proprement parler, plutôt un dilettante des pensées et des littératures. Rien d'étonnant, c'est un fils de banquier «éclairé». Steiner est donc, comme Walter Benjamin, un de ces «fils de famille» dans lequel on investit à perte et à vie pour qu'il «orne» intellectuellement l'oeuvre paternelle. D'où évidemment une ambiguïté qui existe aussi à un certain degré chez Benjamin, c'est à dire une liberté du goût qui transcende tout effort conceptuel. Steiner, qui est Juif, circule entre la passion pour le style et l'indignation contre les penseurs qui ne prennent pas la mesure des grandes barbaries. Je me souviens l'avoir vu, sur un plateau de télévision (sur lequel, il est vrai, il avait été très difficile de le mener, il avait même fallu le filmer dans son repaire genevois) s'en prendre à Heidegger, à l'époque où l'affaire Farias avait éclaté.
Mercredi, le 30 Septembre 1998
Levinas, cet homme écrit de si belles choses ! Ecoutez : «L'essence ne se traduit pas seulement, elle se temporalise dans l'énoncé prédicatif» (in «Autrement qu'être ou Au-delà de l'Essence» Libre de Poche Biblio, page 69).
Il faut d'abord traduire, car Levinas ne fait aucune démagogie, il ne recherche aucune lisibilité immédiate, il faut vraiment faire du chemin avant et avec lui pour seulement continuer à lire...
Donc : Ce passage figure dans le chapitre consacré au langage. Levinas semble vouloir dire que les mots - les «énoncés prédicatifs», aussi bien les verbes que les substantifs - ne servent pas seulement à donner les significations des «essences», à les traduire pour en quelque sorte les doubler dans l'espace du langage, de la communication et des échanges, mais, et c'est vertigineux, les mots fabriquent, tissent, font passer le temps ! A vrai dire, Levinas nous mène un peu en bateau sur le thème de l'oeuvre d'art, car cette phrase que nous avons extraite, précède tout un développement sur l'oeuvre d'art, développement qui doit beaucoup à «L'origine de l'Oeuvre d'Art» de Heidegger (in Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard). Dans l'oeuvre d'art, le mot, mais aussi toutes les autres formes de signifiants artistiques, couleurs, formes, architecture, sons etc...temporalise l'existence. En elles résonnent, comme le dit Levinas l'essence des choses.
Souvenons-nous que pour Levinas, l'essence signifie en réalité ess
ance, c'est à dire le fait d'être. Il est étrange que ce philosophe se sente obligé de reprendre ce concept pour désigner (mais il est vrai que rien, chez Levinas, ne se contente de désigner...) l'être ou le fait d'être. Dans mon Troisième Entretien je tente d'aborder cette question en disant notamment que la notion d'ester (en droit ou en tant que dieu) peut rendre compte du caractère transitif de l'être. Levinas semble renvoyer cette transitivité au seul langage, lui-même résidu du Dire, notion qu'il oppose au Dit, lieu ou siège du langage.
Mais d'un autre côté ce Dit, lui-même résidu du Dire, c'est à dire ce qui s'est pétrifié en quelque sorte dans les relations sociales, ne peut en aucun cas contenir l'essence. Ce miracle n'a lieu que dans l'oeuvre d'art. D'où une foule de questions intéressantes : l'oeuvre d'art est-elle un paradigme de toute oeuvre ? C'est à dire la réalité est-elle construite elle-même toute entière comme une oeuvre d'art plus ou moins réussie, plus ou moins «temporalisante» ? Ou bien, ce soupçon toujours : cette oeuvre d'art n'est-elle pas celle de dieu, qui comme dans Berkley rêve le monde et son spectacle ? Car si le langage résonne de l'essence, c'est qu'il fait partie de son effectuation. Alors, entièrement, même dans le plus petit mot, ou bien seulement dans les grands poèmes, comme se contente de le dire Heidegger ?
Il faut dire que la notion de Dire lévinassienne est difficile à digérer car elle nous échappe conceptuellement, il n'y a pas de concept proprement dit pour désigner ce Dire. Il s'agit d'une sorte de pulsion originelle, sans paroles, sans forme, entièrement portée par le désir et l'amour, et qui se décompose dès qu'elle entre dans le Dit. Le Dire propulse mais n'accompagne pas ce qu'il propulse, il reste en-deçà d'une barre dont on a bien du mal à discerner les contours.
Il y a quelques années, j'avais longuement jonglé avec cette idée follement idéaliste que la réalité existe par la pensée. Que s'il advenait que la pensée disparaisse, le monde disparaîtrait avec elle, non pas par absence de témoin, mais en tant que tel. Autrement dit le monde aurait besoin d'être pensé en permanence afin seulement de continuer à être et à changer dans le temps. Dans une perspective kantienne une telle idée n'est pas folle, mais nous ne sommes en rien kantien, car notre idée est que c'est précisément la pensée autour des noumènes, et non pas celles autour de la science des objets, qui alimente cette «création continuée» de notre univers.
Avec sa temporalisation par le langage, Levinas ne dit pas grand chose d'autre. Temporaliser c'est accomplir et la subjectivité et l'objectivité. C'est vivre dans ce monde-ci, qui se décline en passé, présent et futur, en matière et en esprit, en bien et en mal, même si cette représentation reste naïve par rapport aux somptueux tableaux de Levinas, des tableaux qui, comme ceux de Descartes, proviennent tous de la collection personnelle de Iahvé.
Moi je ne veux pas de cet art-là. Je ne veux pas entendre parler de Iahvé, et Levinas sent bien que ses lecteurs n'aiment pas ça, car il tente en permanence d'inventer un athéisme de carnaval pour se mettre à l'abri de l'accusation de théologie cachée.
D'un autre côté, je sens bien que Levinas sait dire les choses, mieux que d'autres. Il sait, par exemple, faire partager ce que l'on peut traduire par «jouissance du réel», par manducation de l'être. Il sait faire comprendre comme moi-même je n'y arrive pas, comment la relation à la réalité devient, par la contemplation pensée ou la pensée contemplative, autre chose qu'une relation, autre chose qu'une différence. Comment l'intransitivité apparente du penser se transforme en corporéïsation du spirituel, en ek-sistence. Ex-ister signifie ne pas être tout à fait soi ni tout à fait autre, mais être parvenu dans l'entre-deux qui n'est ni un vide, ni un plein, ni rien qui tienne du vide ou du plein. Le détour par l'oeuvre d'art est, bien sûr, assez facile pour faire comprendre cet état second dans lequel vous plonge un beau tableau ou une belle symphonie, un état où les bords de votre corps s'estompent et pénètrent dans un dehors jusque-là considéré comme pure altérité, comme pure extériorité, hostile et bruyante, sound and fury.
Je serais satisfait lorsque j'aurais eu le sentiment d'avoir réussi, à ma manière, à faire comprendre que cet état second de la contemplation artistique est en réalité l'état premier et primordial de tout être. Cet état, bien vécu dans l'enfance, se dissout pour la plupart d'entre nous. Il se reconquiert cependant, dans l'itinéraire de la vie, dans ce qu'on appelle trop négligemment le vieillissement ou la survie. Mais seul l'exercice de sa question finit par nous rapprocher du mystère de l'étant, quand nous finissons par comprendre que ce mystère est le coeur même du plaisir d'être. L'étant en sait aussi peu sur lui-même que nous...
Jeudi, le 1er Octobre 1998
Mais c'est parce que le problème n'est pas le savoir, ni de soi ni d'autre chose, il est celui de la réussite. On pourrait se représenter le fait de vivre un peu comme la promenade de Dante sur les bords escarpés de l'Enfer. Cet Enfer n'est pas, comme le laisse supposer les catéchismes vulgaires, ce qui menace dans l'avenir, c'est ce qui est là, au bord de notre chemin, aux bords de tous les chemins de tous les êtres qui émergent dans ce qui a vision de l'escarpement de la route. Il faut réussir à se tenir au milieu du chemin, ignorer tous les vertiges qui tapissent le parcours. L'étant tout entier, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à saisir, l'étant tout entier se trouve dans cette même position d'échec ou de réussite possible : la temporalité n'est pas plus exclusivement humaine que tout le reste, les êtres coappartiennent à l'étant dans sa totalité. Anaximandre, nous y reviendrons encore souvent, dit que «les être se paient les uns aux autres le prix de leur injustice». Quels êtres ? Les hommes ? Certainement pas seulement les hommes. Qu'est-ce-que l'injustice dont il parle ? Laissons de côté, pour l'instant, la traduction difficile de Heidegger. L'injustice, c'est à l'évidence le fait pour un groupe d'êtres de paraître, alors qu'un autre groupe n'est pas encore apparu, ou bien qu'il est déjà reparti. L'injustice est dans l'apparaître, dans le passage sur le chemin dont nous parlons plus haut, car cet apparaître occupe la scène, exactement comme dans notre vie de tous les jours, où l'on gagne parce qu'on réussi mieux que d'autres à apparaître. En fait l'injustice est la manifestation elle-même. Celle-ci a toujours lieu au dépens de l'autre. Il faudrait comprendre et admettre que le spectacle auquel nous assistons se déroule aux dépens d'un autre spectacle qui pourrait tout aussi bien avoir lieu. Derrière la scène attendent d'autres acteurs, d'autres décors, d'autres dramaturgies et d'autres destins, et tous ceux-là poussent, pressent, crient, se saisissent de tout ce qu'ils peuvent pour tirer, pousser hors du champ, tout ce qui les empêche eux-mêmes m'y d'y être. C'est ce qu'on appelle la dimension agonistique de l'existence : pousse-toi que je mette, car c'est moi le meilleur. Comme si, comme si la réalité avait un besoin fondamental de se bonifier en permanence, d'être toujours la meilleure réalité et non pas le fruit du hasard ou d'un doux passage de vent.
Ce qu'il faut donc finalement aussi apercevoir, c'est que la réalité EST toujours la meilleure possible, et c'est ce que Leibniz avait fabuleusement compris. Elle ne peut jamais, tant qu'elle est, tant qu'elle este le ciel et la terre au point qu'elle nous agresse en permanence, être moins bien, faiblir ou se dégrader :
sa perfection est son point même d'apparition. Sans cette perfection ce texte n'existerait pas, ni tout le reste.
La critique de Voltaire part d'un malentendu : il ne comprend pas que sa propre démarche appartient à ce qui rend possible l'apparition du monde qu'il décrit. Sa dénonciation des injustices et du tragique des catastrophes appartient à la démarche de perfectionnement de la réalité, elle est le défi lui-même qui se propose de pousser les horreurs hors de la scène, en supposant qu'une autre martingale pourrait se trouver là, au même endroit, meilleure et moralement admissible. Voltaire lui-même est le trait de la réalité voltairienne. Ainsi sommes-nous tenus de travailler à la perfection du monde, il n'est pas question, dans la méditation ou dans la contemplation, de se contenter de digérer cet univers qui nous serait donné tel quel. Il nous incombe, exactement comme il incombe aux milliards de gènes existants de travailler à la formation du monde qui vient, de faire accoucher la réalité que nous choisissons avec tous les risques inhérents au choix, à la décision et son accomplissement. La pensée tient ici le premier rôle, car avant de procéder aux choix fondamentaux, c'est elle qui peut déblayer le terrain pour dire quoi, quel monde a été installé par nos pères, dans quelle sens il faut tout d'abord agir pour ne pas se trouver en porte-à-faux avec les origines. La réalité qui nous entoure est et n'est pas tout à fait la nôtre, elle est une parturition permanente, faite des décisions et des luttes antérieures et de notre action : on ne peut jamais prendre ce monde pour un simple chantier vide qu'il suffirait de remplir par des projets. C'est l'erreur de la pensée «impériale» du monde que de faire «table rase» au nom d'une idée géniale et d'une grande force. Cela risque aussi d'être l'erreur de la pensée technicienne, dès lors qu'elle déciderait de se doter d'un projet global à propos de l'étant.
La question se pose d'ailleurs de savoir si le Technique, à l'instar de ce qu'en pense Heidegger, n'est pas déjà allé si loin qu'il doit maintenant assumer sa propre manifestation jusqu'au bout, avec une obligation absolue de réussite proportionnelle à la puissance d'échec qu'elle contient. Je n'aime pas spéculer sur le néant issu d'une bêtise humaine, car cela me paraît désormais bien trop naïf. Le néant lui-même est un animal domestique de la pensée, et pas autre chose. Le seul néant intéressant, me semble-t-il, est le néant vécu par les hommes malheureux, qui demeurent aveugles sur le chemin escarpé, au point de rester paralysés et de ne jamais parvenir dans les régions où finissent par cesser les vertiges parce que ces régions sont devenues familières, qu'elles appartiennent au promeneur comme lui appartiennent ses sensations les plus intimes, comme lui sont propres ses parents, sa langue, ses goûts et ses plaisirs.
En ce qui concerne la responsabilité Levinas a totalement raison. Nous sommes des êtres de responsabilité parce que la réalité est nôtre, et que nous ne pouvons en déléguer la création à quiconque. Lorsque nous prenons conscience d'un événement ou d'une réalité semblable à celles que dénonçait Voltaire en son temps, et dieu sait si nos écrans et nos journaux fourmillent d'horreurs en tout genre, nous sommes mis en demeure d'agir à partir du moment où nous estimons que ce que nous constatons ne correspond plus à notre réalité. Nous pouvons rester passifs et prendre le risque de laisser se répandre un monde que nous réprouvons. Le nazisme a été un cas de figure d'une réalité qui a pu se glisser entre les mailles de la vigilance et du sens de la responsabilité des hommes du début de ce siècle.
Morale ? Mais bien entendu ! IL n'y a de philosophie que morale. Je viens d'entendre cette considération sur France-Culture et je m'empresse d'y souscrire autant que je le puis. Dans ce que l'on pourrait, si on est gentil avec moi, nommer ma thèse philosophique, ce point de vue va de soi. L'immanentisme de mon point de vue, que j'entrevoie d'une certaine manière plus intégral que celui de Spinoza de par la soustraction que je fais de dieu, nous investit volens nolens d'une responsabilité absolue. Cet absolu ne se laisse constater que dans le caractère aveuglément fatal du «tu dois» inhérent à tout ce que nous faisons. Même le pire, disait Spinoza, certes, mais cela ne nous dédouane en rien du meilleur et de l'obligation de meilleur.
Mes proches s'étonnent souvent de mes dons de voyance politique. Il se trouve, en effet, que depuis une vingtaine d'années, c'est à dire exactement depuis que je me suis mis à voter, je ne me suis que très rarement - et presque volontairement - trompé sur l'issue d'un scrutin. Ce «don» n'est rien d'autre que ma sensibilité créatrice de ce qui se passe dans la réalité : je vis le réel social - principalement européen - dans un champ de perception plus vaste que mes amis parce que j'ai labouré ce champ et que je continue de le faire de
l'intérieur ! C'est un peu comme si en moi le scrutin avait lieu sur le mode du microcosme. De même pour les prévisions ayant trait à l'histoire du développement de l'extrême-droite dans le monde. Là aussi je ne me suis guère trompé, et je pense qu'on peut le vérifier ici même, dans mes Antémémoires. Cela tient aussi à un combat personnel qui se livre dans l'ombre et qui avait déjà commencé bien avant qu'apparaissent les personnages comme Le Pen. Il y a une part de la réalité qui reste toujours cachée, c'est celle qui prépare ce qui va arriver. Mais il y a une autre partie qui reste tout aussi cachée parce que les hommes ne pourraient pas soutenir sa présence. Par exemple, il est évident pour tous les Français que Le Pen ment comme il respire et que les actions qu'il prévoit d'accomplir s'il parvient à s'emparer du pouvoir, n'ont rien à voir avec ce qu'il promet aujourd'hui. Tout le monde sait par une anticipation qui va de soi mais qui n'ose pas s'exprimer, que Le Pen est un bandit sur le mode des Empereurs maudits de l'histoire romaine. Si comme certains d'entre-eux il lui suffisait de tuer l'actuel souverain, il n'hésiterait pas une seconde. Tout le monde sait aussi, mais je trouve étrange qu'on ne le dise pas plus fréquemment, que Le Pen veut prendre le pouvoir pour détruire la démocratie et la République. Mais toutes ces choses-là, on peut les savoir de plusieurs manières : on peut les subodorer parce qu'on vous l'a dit, c'est faible. On peut le savoir par l'expérience et par le souci de toute une vie : ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie avec toutes ses atrocités finales, le terrorisme de l'OAS et tout ce que cela implique de pur cynisme et de cruauté aveugle, ceux-là ne se font aucune illusion sur le Front National. L'un des aspects dangereux des procès Papon et Touvier, aura été qu'on a pu
douter des horreurs qui ont eu lieu sous Pétain, il aura fallu répéter - et en soi cette répétition n'a pas été négative - les découvertes faites en 1945 de ce à quoi ont pu se livrer des Français au nom d'ambitions aussi triviales et cyniques que celles qui ont osé réémerger dans les années quatre-vingt sous les auspices du Front National.
Bref. Il y a une intimité qui s'installe avec la réalité, qui n'est pas seulement un savoir cumulatif. Le souci du réel installe entre la conscience et lui une coexistence qui n'est pas un simple voisinage, mais qui est un Mitleben, une symbiose de plus en plus forte. Au bout il y a ce phénomène extraordinaire mais vrai, d'une conscience planétaire dont l'acuité visuelle recouvre tous les phénomènes les plus vastes et les plus complexes. Hegel se vantait d'avoir «presque tout lu», moi je pense qu'on peut aussi tout vivre, et temporellement dans tous les sens.
Jeudi, le 8 octobre 1998
La fatigue ou la forme physique, ce sont la plupart du temps des abstractions ou encore des mots pour des autres..Pourtant, ces derniers temps j'affronte quelque chose comme la vraie fatigue. Des limites, quoi. Mais cela n'a aucun intérêt, pourquoi perds-je mon temps à constater des choses pareilles et à les faire lire à d'autres ? Peut-être pour marquer une date ? Plus précisément qu'avec des chiffres ?
Quoiqu'il en soit, cette fatigue ne m'empêche pas de ressentir autour de moi un phénomène bien déprimant d'affadissement des comportements. J'ai comme l'impression que tout devient pâteux, que plus rien n'a de contour net, clair, coupant, que tout le monde laisse se passer quelque chose, quoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a une dimension héroïque de l'existence qui disparaît à toute vitesse. On pourrait dire que l'homme faiblit devant l'obligation d'être homme, qu'il voudrait se trouver de plus en plus de moyens et d'excuses pour pouvoir cesser de l'être entièrement, avec tous les droits et tous les devoirs de cet être qu'il a si péniblement formé tout au long d'une histoire si douloureuse et si difficile. D'un coup, d'un seul, on dirait qu'il veut crever l'enveloppe de cette humanité et la laisser s'écouler dans les égouts du présent. Ce soir je ne suis pas en état d'en dire plus, mais j'y reviendrai, car les choses sont, hélas, trop claires !
Vendredi, le 9 octobre 1998
Bien claires en effet : hier soir j'ai pris une décision morale. L'une de ces décisions qui sont d'abord une révélation : tous les hommes qui renoncent au savoir et à l'action qui en découle sont des fripouilles. Cette formule qui peut paraître à l'emporte-pièce vise en fait une armée de gens, disséminés à travers le monde, qui tentent depuis des siècles de donner à l'économie un statut transcendant. Ils tentent de nous faire croire que les phénomènes économiques sont aléatoires ! C'est une insulte tellement énorme qu'elle disparaît derrière elle-même. Aléatoires, la misère ? Aléatoire, l'exploitation quotidienne des armées de salariés du monde entier ? Aléatoire les inégalités hurlantes gérées par les multinationales ? Aléatoire quand la multinationale Lever paye ses OS Hollandais cinq mille dollars par mois, et ses OS Sudafricains cinq cents ? Aléatoires quand l'enfant pakistanais ramasse un dollar par jour pour travailler douze heures dans les ateliers d'Adidas ? Quand Suharto ou Mobutu puisent dans les caisses de leurs état les fortunes de leurs dynasties ? Aléatoires quand les joueurs de roulette financière font mille fois la culbute d'un argent qu'ils n'ont même jamais montré à personne ?
Plus sérieusement : les pères fouettards de l'économie libérale vont bien devoir cesser de jouer au plus fin avec les peuples. Du temps d'Adam Smith il était facile d'inventer des fables pour enfants et de les répandre parmi ceux qui ne demandaient qu'à croire toute ces salades de marchés magiques, car les autres ne savaient même pas lire. Aujourd'hui il en va autrement. Bientôt les peuples vont tout simplement cesser de croire qu'il y a des mécanismes aveugles et incontrôlables qui vont excuser toutes les erreurs de gestion, de gouvernement, la pérennité scandaleuse des injustices, de l'indignité et du n'importe quoi dans lequel on a plongé l'existence humaine. L'homme se répartit désormais entre ceux qui risquent chaque semaines quelques centaines de francs au PMU et ceux qui risquent les milliards des autres (notamment des retraités dont ils gèrent les capitaux) pour se remplir les poches, ou au pire faire la grimace lorsque leur placement s'envole en fumée. On voudrait nous faire croire qu'il y a des impondérables dans la gestion économique ? Mais c'est absurde, parfaitement absurde. Chaque agent économique sait, à tout moment, exactement où il en est et où il va. Il sait si ses choix sont sains ou s'il joue des jeux de hasard, et son banquier aussi. Mais si le banquier devient complice, alors nous sommes face à la délinquance et non pas aux aléas du marché. Et l'échec de la planification soviétique n'est pas une preuve du contraire, car cette planification a souffert exactement des mêmes maux que l'économie bourgeoise, à savoir le vol, la corruption et le détournement constant et massif des richesses produites par le peuple.
C'est fou ce que j'écris ? Demandez au éleveurs de porc s'ils sont fous. Demandez leur pourquoi ils ne se fient pas aux lois du marché. Demandez leur pourquoi ils n'acceptent pas les conséquences de leurs mauvais investissements, pourquoi ils se considéreraient comme des agents économiques tellement exceptionnels que le gouvernement, quel qu'il soit, doit courir à leur secours. Pourquoi sont-ils si insolents ? Quelle entreprise privée descend dans la rue et casse les préfectures parce qu'elle fait faillite ? Pas facile la réponse ? Si, fastoche : les paysans, on les vole depuis le début du siècle. Depuis le début du siècle on a stérilisé leurs prix au profit de l'industrie, on a manipulé le marché au bénéfice d'un secteur dans lequel on les prie à présent d'entrer, qu'ils le veuillent ou non. Mais les paysans étaient hier les chéris des Empires et des Républiques de Droite, ces hommes ne vont pas se laisser faire comme de vulgaires salariés de l'industrie. Ils ne peuvent pas admettre, et on les comprend, que tous leurs sacrifices aboutissent à du cochon à cinq franc le kilo, alors qu'ils ont été priés d'en dépenser quinze pour le produire.
Lisez les grands journaux mondiaux de l'économie et vous pourrez constater que les hommes de cette «science» que prétend paradoxalement être l'économie, s'expriment comme de vulgaires gourous de secte. Ce sont des fripouilles qui ne font que trahir leurs activités délictueuses quotidiennes : le vol.
Samedi, le 10 octobre 1998
En considérant les atermoiements frileux de la politique de Jospin, je n'ai qu'une question qui me taraude : quel est le secret cruel et brutal auquel le pouvoir vous initie ? Imaginez que vous gagnez les élections. Comme Schröder il y a trois jours, il semble qu'à un certain moment la Vérité, avec un grand V, vous apparaisse. Ce que vous aviez eu la faiblesse de prendre pour le pouvoir, c'est en fait le contraire : vous n'avez aucune marge de manoeuvre, vous êtes faits comme un rat, vous n'avez pas le pouvoir, c'est le pouvoir qui vous a ! Parfois je me représente les choses de la manière suivante : Jospin entre à Matignon, et la première chose qui l'attend, c'est un coup de téléphone :
- Bonjour, Monsieur le Premier Ministre, je vous rappelle ce que je vous avais dit pendant la campagne, histoire de vous rafraîchir la mémoire :
pas de folie. Votre état nous doit tellement d'argent que je peux vous mettre en faillite demain matin.
Et on imagine le requin de la haute finance internationale, qui ajoute pour bien se faire comprendre : - « et vous savez, j'ai X milliards de francs que je peux jeter sur le marché en cinq minutes, vous pourriez fermer votre boutique.
Les choses peuvent-elles se présenter ainsi et si la réponse est oui, pourquoi aucun Jospin n'en fait-il l'aveu ? Pourquoi aucun Jospin, car Juppé était aussi dans cette situation et je ne pense pas que son interlocuteur ait été plus poli avec lui qu'avec les socialistes (je me souviens bien de l'arrogance de Madelin, belle preuve de l'existence d'un tel chantage dont il était sans doute le messager), pourquoi donc aucun de ces élus du peuple n'a-t-il le courage de dénoncer des secrets si dangereux ? Pourquoi gardent-ils pour eux la vérité de la situation ? La réponse habituelle est que c'est le seul moyen de conserver le pouvoir, d'abord pour une raison inhérente au chantage lui-même, et ensuite parce qu'ils pensent en général que les citoyens ne sont pas en mesure de partager de tels secrets, ils en deviendraient eux-mêmes dangereux, et le gouvernement serait alors pris entre deux feux !
Je me souviens du général Ortega, leader des Sandinistes du Nicaragua. A l'époque où ils dirigeait le pays sans partage - sinon sans la guerre fomentée et alimentée par le Pentagone - Ortega avait pour philosophie politique de tout dire à son peuple, comme Castro. Lorsque ses services secrets avaient découvert un complot dirigé de loin par Washington, Ortega faisait un grand discours en dévoilant toutes les ficelles du complot, en faisant fi du secret dont tous les états entourent leurs opérations, qu'ils soient agresseurs ou agressés. Cette transparence ne l'a certes pas maintenu au pouvoir comme Fidel Castro, qui vit sur une île, ne l'oublions pas, mais Ortega a pu poursuivre sa carrière politique dans un pays où la violence a encore duré longtemps et où ses adversaires avaient, entre-temps, pris le pouvoir. Cela signifie qu'il avait quand-même réussi à changer la donne fondamentale de la politique de son pays, de telle manière qu'il est devenu inattaquable, et dieu sait si on a essayé de le dégommer. Ortega est l'un de ces hommes politiques qui a su se rendre invincible grâce au bouclier de la vérité. Sans doute ses vérités étaient-elles souvent des ignorances ou des erreurs, mais une ignorance partagée sincèrement devient la vérité d'une relation d'un homme avec le peuple, et cela est bien plus important que l'efficacité d'un mode de gouvernement. Au demeurant, la démocratie exige un tel partage, et il est inadmissible que les élites (socialistes !) de ce pays continuent de se taire et d'ajuster constamment leur discours aux aspérités les plus médiocres de la réalité quotidienne. Juppé est tombé, non pas parce qu'il manquait de talent ou de sincère désir de bien faire son travail de gestionnaire, mais à cause de son arrogance de tout-sachant. Le secret est la maladie obsidionale des sociétés capitalistes, mais le développement de la culture ne laissera pas indéfiniment cette névrose désespérer les citoyens. La politique n'est pas seulement un travail pénible et risqué, c'est aussi un jeu, c'est le jeu même de l'existence en société. La question est donc de savoir si le suffrage universel doit simplement désigner les nouveaux joueurs, ou bien si on élit des maîtres de jeu afin qu'ils fassent jouer les peuples, c'est à dire qu'ils les associent réellement à la souveraineté.
Ce texte provient d'une discussion que nous avons eu hier soir avec Edouard, de passage à Strasbourg. Nous parlions du problème des retraites, et très justement Edouard disait penser que lorsque le système actuel des retraites par répartition a été inventé, on n'a pas pu ne pas envisager que les variables conjoncturelles seraient appelées à bouger considérablement. Que, si les trente glorieuses ont été des années où il y a eu plus de cotisants que de retraités, et donc d'immenses excédents de cotisations placées dans l'économie, il était parfaitement prévisible que les données allaient s'inverser et qu'il faudrait alors faire donner les réserves. Edouard pense très sincèrement, mais avec une touche de cynisme anticipatif du genre «si on nous a trompé ou volé, alors il faudra descendre dans la rue», que le système a été pensé en fonction de toutes les conjonctures, et que s'il défaille, c'est en raison d'une malhonnêteté quelconque dans le dispositif. Ce qui est vrai, quand on pense à la gabegie qu'a entraîné la gestion paritaire de ce magot.
Mais plus : même si on admettait que c'est toute la structure qui désormais change et interdit à termes le maintien d'un système de répartition, cela ne serait encore que le signal pour une transformation politique de ce qui se situe en amont du système lui-même, c'est à dire une modification des termes de la redistribution des richesses.
Ce qui me fascine et me scandalise, c'est le fondement politique et philosophique du libéralisme qui veut en finir avec les mécanismes de solidarité comme la retraite par répartition. Ce fondement dit simplement, sagesse des nations et connerie en diable, chacun pour soi et le marché pour nous tous. Mais encore : chaque acteur de la société apparaît avec certaines qualités, certains pouvoirs et les exerce comme il veut, avec la plus grande libéralité. Plus il en a, des pouvoirs et des qualités, plus le système le protège aux dépens des autres. Il n'y a aucune finalité dans le fait même qu'on privilégie les forts, cette finalité il faut la chercher dans une idéologie quasi religieuse d'une nature qui se fait elle-même mieux que personne. C'est délirant, mais c'est ainsi que pensent les ultra-libéraux : le marché (lisez la nature) ne peut pas faire autre chose que le Bien ! Sur l'analogie du struggle for life que l'on peut, soit-disant, observer dans la nature entre animaux ou végétaux, les hommes doivent laisser se former naturellement le meilleur des mondes naturellement possibles. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec Leibniz, même si Voltaire a cru bon de le comprendre ainsi. Cela n'a rien à voir, car la monadologie repose déjà sur une métaphysique de la volonté et non pas d'une passivité conservatrice qui se contente de laisser passer la Volonté divine.
D'ailleurs, et j'en finirai avec ce sujet, la retraite solidaire est l'accomplissement même de la volonté collective de fonder matériellement la notion d'homme, d'humain et d'humanisme. Comment pourrait-on envisager seulement d'exhiber une notion essentielle, universelle et éternelle qui serait soumise à une entéléchie transcendante, c'est à dire à une pulsion de croissance ou de décroissance dont la volonté humaine serait elle-même absente ? C'est la volonté qui fonde l'humain et non pas quelque accident transcendant et d'origine inconnue. Si donc les libéraux veulent à toute force imposer leurs idées, ils doivent abandonner toute prétention à l'humain et lui substituer autre chose. Mais quoi ? Gageons qu'ils ne demandent pas mieux que de se débarrasser de cette idée. Un certain Hitler avait décidé de remodeler totalement l'idée de Mensch, on a vu ce que cela a donné.
Lundi, le 12 octobre 1998
Il se joue une drôle de partie en ce moment dans notre capitale, dont on peut espérer qu'il ne s'agisse que de l'une des moultes tentatives de l'hydre d'extrême-droite de prendre pied dans ce qu'on a coutume d'appeler le monde de la culture. Il y a toujours la crainte que ce ne soit le début d'un trend plus profond, quelque chose comme la réponse superstructurelle à des mouvements de fonds réellement fascisants. Charlie-Hebdo rappelait récemment que des sondages révèlent qu'un Européen sur trois est raciste ! Voilà qui laisse à réfléchir à propos des succès de librairie comme Houellbeck, dont les analyses du Monde (qui sont ma seule référence, mais étant donné leur pluralité et leur qualité, je prends) montrent bien qu'il s'agit plus que d'une négligence des éditeurs, plutôt une adhésion du monde marchand qui a fomenté le succès en librairie et qui révèle plusieurs choses à la fois :
- que ce monde marchand trouve le style «Céline moins le talent» tout à fait juteux, et donc qu'il existe un public spontanément prêt à suivre les Guillaume Durand et autres thuriféraires.
- que la marchandise elle-même trouve ses clients plutôt facilement, ce qui signifie à tout le moins un contenu démagogique, et donc proche des contenus latents, racisme, cynisme, apolitisme de droite (comme je dis toujours), ordurisme et scatologisme et j'en passe.
- que les lecteurs des éditions coupables apprécient tout cela au point de le vendre dans les comités et de parier sur la camelote.
- que le système, et c'est cela peut-être le plus grave, est parfaitement rodé qui va de la décision des éditeurs aux rayons de la FNAC, c'est à dire que ça marche : n'importe quel texte peut ainsi devenir un must du jour dont on a besoin pour repasser le vernis culturel sur les ongles de son bavardage social. Il s'agit là rien moins que de la naissance d'une forme mercantile de la
propagande : les gens vont désormais acheter le bourrage de crâne dont autrefois on les bombardait à grand frais. Il est vrai qu'ils achètent n'importe quoi.
Lorsque le pipi - caca - prout prend le relais de la vraie discipline littéraire, alors il y a quelque chose de pourri dans le royaume.
Mais ce n'est pas tout, je crois avoir parlé récemment dans ce journal, du surprenant article signé entre autres Régis Debray et Blandine Kriegel (ah celle-là !) paru dans Le Monde il y a plusieurs semaines déjà. Cet article révélait une surprenante conjonction d'opinions sur les mesures de salut public à prendre pour sauver la République. Imaginez, si vous ne l'avez pas lu, une aréopage de fesse-Mathieu découvrant le laxisme - style «mais que fait la Police ?» - des pouvoirs publics et la mollesse des citoyens face à leurs devoirs. Bref, un galimatias qu'on aurait davantage cru destiné à Figaro Magazine qu'au très sérieux -quoique- Monde. Or, que viens-je d'apprendre ? Que Régis Debray a collaboré à un numéro de la revue Krisis (ou Crisis, je ne sais plus et ne veux pas le savoir) torchon de la nouvelle droite et satellite du Front National. Fermez le ban !
Voilà qui est vraiment inquiétant et qui laisse soupçonner un pourrissement des âmes en apparence les plus fermement trempées. Dans un ouvrage non publié sur ce site, j'avais comparé Guy Debord et Régis Debray, comme deux représentants symptomatiques des générations de la gauche perdue des années d'après-guerre. Debord m'y apparaît comme une sorte de Retz contemporain, à la fois conscient des vrais enjeux de la civilisation et pris en étau entre un démocratisme absolu et son sens aristocratique. Le résultat aura été le destin de son Internationale qui n'a été que l'histoire d'une série continue de purges plus staliniennes dans leurs contenus et dans leurs formes que celles de Moscou. Il manquait à Debord ce sont disposait Retz dans le contexte de la Fronde, c'est à dire un humanisme qui lui donnait plus que le simple entregent de sa caste, un véritable charisme qui séduisait autant les princes que les marchands de Paris. Debray, c'est tout autre chose. En relisant ce que j'avais écrit, j e découvre que je l'avais comparé à La Fayette. Rien moins ! Ceux qui connaissent le personnage et son action avant et pendant la Révolution, comprendront cette comparaison. Je voudrais seulement ajouter une conclusion qu'à l'époque je n'avais pas tiré : Debray s'est tout autant trompé sur son histoire que sur lui-même. Ce qui l'a sauvé, paradoxalement, c'est son esprit suicidaire, celui qu'une grande partie de la toute petite Gauche intellectuelle de cette époque partageait avec lui. Mais cet esprit du Vincere o Muerte ne faisait que cacher, pour tous ces jeunes, le désarroi moral et proprement intellectuel de la gauche européenne minée par les guerres coloniales, le stalinisme qui s'en faisait le complice et une droite qui ne faisait au fond rien d'autre qu'imiter en soft le maréchalisme des années de plomb. Quoi d'étonnant alors de voir ce même Debray flirter avec le fascisme tant son désarroi a encore grandi depuis cette époque. Il ne suffit pas de s'enfermer dans un discours psychorigide sur la République dans lequel vous a enfermé la ruse d'un grand homme du nom de Mitterrand pour rester à l'écoute et garder le sens du mouvement de l'histoire. Debord avait ce génie, de se réveiller tous les matins devant un monde neuf dont il reniflait le mouvement et dont il se mettait à balayer, selon ses moyens, les personnages qui ne convenaient plus à ce qu'il concevait à ce moment-là. Evidemment, le monde ainsi modelé restera jusqu'au bout onirique, mais les utopies ont plus d'importance que quelques balles perdues dans des sierras dont tout le monde se fout.
Mardi, le 13 octobre 1998
Mai 68 n'en finit plus de pondre des sous-produits. Aujourd'hui c'est une nouvelle grève des lycéens. Ce matin j'ai dit à mon fils - « faire grève pour mieux travailler, j'aurais honte» - il était tout à fait de mon avis, mais comme il est dans la phase sophistique à outrance, il m'a dit que le non-travail de la grève valait bien une grève et mieux que tout travail en tant que tel. Je n'avais qu'à m'incliner.
Plaisanterie à part, Mai 68 ne finit effectivement pas de m'épater, mais dans le bon sens du terme. En réalité, nous avons à cette époque-là, déchiré un voile
pratique, ou inventé un formidable mode d'emploi de la démocratie, celui de la révolte permanente, l'occupation de la rue. Nous avons inventé la visibilité de la colère des masses, une visibilité simplement destinée à compenser l'hypocrisie, les retards et les trahisons de la démocratie représentative. En fait, chaque manifestation fonctionne comme une menace ou un avertissement de ce qui pourrait suivre les emblématiques défilés. Tout cela est finalement une subtile synthèse de notre histoire de France. Du temps d'Hugo, les rues de Paris étaient le théâtre de sanglantes batailles que les urbanistes à la Haussmann ont rapidement rendus pratiquement impossibles, sinon à sens unique : Champs Elysées, disposez les canons : Feu ! Puis les syndicats ont transformé la grève en une arme assez redoutable pour arracher aux princes de non-négligeables avantages. Mai 68 a retrouvé la bataille de rue, symboliquement, et la grève. Bien sûr, chaque fois que ce mécanisme se déclenche la République se tasse sur elle-même en attendant l'issue du conflit, car aujourd'hui cette méthode est également devenue l'arme de ses ennemis. Que ce soit les Républicains, comme en Mai 68, qui manifestent, ou non, les ennemis de la démocratie républicaine trouvent toujours à exploiter ces mouvements, que ce soit politiquement ou encore à travers des usagers mécontents ou artificiellement présentés comme mécontents. Lors de la grande grève de la SNCF en 95, le RPR avait failli se ridiculiser en fomentant une association des usagers, mais les temps avaient changé et le parti gaulliste n'a pas trouvé assez de membres pour que cet organisme soit présentable dans les médias. Ce ratage a d'ailleurs eu une grande importance dans l'évaluation que le gouvernement de droite a alors fait de cette grève.
Que dire du point de vue de la morale politique ? Faut-il contester un comportement qui veut subvertir en quelque sorte le parlementarisme et faire pression sur l'Exécutif directement ? Je ne le pense pas, car dans notre société, l'aristocratie d'argent entretient une relation beaucoup plus étroite et plus constante avec l'exécutif, elle MANIFESTE toute l'année sa présence et sa volonté. On pourrait donc tout simplement dire que si le patronat s'invite en permanence aux tables des Ministres, le peuple lui a bien le droit de s'inviter dans ses propres rues !
---------------------
Réflexions sur l'Afrique. Quelques portes ouvertes enfoncées pour voir si c'est toujours comme avant...
Le mot colonial est toujours associé à ce continent-là, l'Afrique, alors que non seulement l'Afrique n'a jamais été une colonie en tant que continent, comme l'Amérique du Nord par exemple, mais qu'aucune partie de son territoire n'a eu ce statut. Bien sûr l'exception qui confirme cette règle, c'est l'Afrique du Sud, où quelques Hollandais têtus ont cru pouvoir coloniser à la grecque et se faire une nouvelle patrie, projet qu'ils ont en partie seulement, réalisé. Tout de suite à propos des Hollandais, il est curieux de constater que d'autres sujets des Pays-Bas qui ont conquis (quel autre notion utiliser ici ?) l'Indonésie, ne se sont pas du tout comportés de la même manière, mais plutôt comme les «colons» des nombreux pays africains, qui n'ont jamais été des colons.
L'Afrique n'a jamais été une colonie, mais toujours seulement une zone d'hégémonies économiques de diverses nationalités européennes et islamiques. A l'exception de quelques peuples antiques originaires du Yemen et d'Arabie qui ont occupé longtemps la Corne de l'Afrique au point d'y métisser la population de manière spectaculaire, et des Musulmans qui ont réellement colonisé Zanzibar, aucun peuple n'a occupé l'Afrique pour y vivre et y fonder la continuité de sa propre Cité, c'est à dire n'a fondé de colonie comme le firent les Grecs, les Romains ou les Phéniciens.
Lorsque j'ai découvert cette curiosité et cette contradiction, je me suis immédiatement posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle jamais été l'Amérique de l'Europe, pourquoi l'Afrique n'est-elle pas devenue un territoire de conquête pour des masses d'Européens. La réponse n'était pas bien difficile, j'ai vécu trois ans au Gabon, et un jour j'ai appris qu'au dix-neuvième siècle, les autochtones appelaient leur pays, le tombeau des blancs. Ma propre famille a largement contribué à ce qu'on a faussement appelé la colonisation. Notamment de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de Madagascar. J'ai donc tôt appris que les conditions de vie en Afrique étaient difficiles et que le vrai statut des Européens sur ce continent était en fait un statut d'aventurier, vaguement protégé par une soldatesque d'état mise en place par d'incertaines Républiques et surtout par l'Etat Français de Pétain, grand «civilisateur» de ces «belles colonies». Pour aller «aux colonies» il fallait donc du courage, une bonne santé et de la chance.
Mais cela n'expliquait pas tout, car le climat tropical ou équatorial règne aussi en Floride et dans tout le sud des Etats-Unis. Ces régions sont frappées chaque année par des calamités sans fins, et pourtant il y a là une population européenne aussi enracinée depuis trois siècles que les Bavarois en Bavière. De même pour le Brésil, encore plus proche de l'Afrique par ses caractéristiques climatiques et ses paysages. Tous les pays amazoniens - Brésil / Chili / Pérou /Equateur / Colombie / Bolivie - ont été réellement colonisés, par les Espagnols et par les Portugais.
D'ailleurs, ces mêmes Portugais du Brésil ont tenté, à une époque lointaine ( Dix-Sept et Dix-Huitième siècle) de coloniser l'Angola, territoire sous hégémonie économique portugaise, mais ça n'a pas marché, malgré leur expérience et leur argent.
Autre explication, à part la population dont on a fait l'une des marchandises les plus profitables des siècles passés, les esclaves, le continent africain est absolument pauvre. Malgré ses forêts fantastiques, la couche de terre est mince et de si mauvaise qualité que toutes nos méthodes agricoles échouent. Au Sénégal, les Français ont cru pouvoir installer des exploitations intensives de culture de l'arachide : le résultat ce sont des millions d'hectares de terre stériles pour des décennies. L'élevage intensif, lui, détruit le sol et accélère la désertification. Au total, l'ONU a calculé très exactement qu'un hectare de forêt de chasse rapportait plus de nourriture que plusieurs hectares de terre agricole. Là encore l'Afrique australe fait exception et contient quelques bonnes terres qui ont en effet retenu les Boers, lors de leurs treks successifs.
Au total la première réponse à la question de savoir pourquoi l'Europe n'a pas fait en Afrique ce qu'elle a si bien et si horriblement accompli dans les Amériques, est que ce continent est trop pauvre pour avoir donné lieu à une «colonisation de peuplement». Ce dernier néologisme est en réalité un pléonasme, car il n'existe aucune colonisation qui ne soit de peuplement. Toutes les autres formes d'asservissement ou d'occupation de territoires étrangers doivent s'appeler autrement. Les Portugais se plaisent à souligner aujourd'hui que leurs «ex-colonies», l'Angola, le Mozambique, le Cap Vert, Sao-Tomé-Principe et la Guinée-Bissau sont les pays où il y a le plus de mulâtres, preuve, selon certains, que la colonisation portugaise a été une sincère colonisation de peuplement. Faux, l'histoire détruit elle-même cette belle légende, car à partir du dix-septième siècle, le Portugal devenait peu à peu incapable d'entretenir un lien régulier avec ses territoires, condamnant ses sujets exilés à s'installer volens nolens sur place et satisfaire vaille que vaille tous leurs besoins humains. C'est l'isolement des «colons» qui les a contraints à prendre des femmes sur place. Mais dès que la conjoncture et le progrès technique a permis à Lisbonne de reprendre le projet d'une exploitation économique en règle de ses pseudo-colonies, tout est rentré dans l'ordre jusqu'à la révolte africaine. Ce qui dans ces colonies est remarquable, au contraire, c'est que l'ancienneté de la présence portugaise n'a rien changé au statut futur des occupants. Si en Zambie et au Zimbabwe (les anciennes Rhodésie) il y a aujourd'hui encore quelques anciens colons britanniques, les Portugais ont pratiquement tous abandonné leurs anciennes possessions, du moins en tant qu'exploitants directs du pays.
En gros, l'Afrique est toujours restée un rêve pour l'Europe, un rêve aussi pour les Etatsuniens qui, eux, portaient un autre regard sur ce continent, un regard plus scientifiquement économique. Pauvre en apparence, l'Afrique est sans doute la plus riche des terres du monde, il suffit de gratter le sol et d'explorer le fond des mers qui l'entourent.
Mercredi, le 14 octobre 1998
Pas une colonie donc, plutôt un espace d'hégémonies économiques, de chasses gardées françaises, britanniques, belges, portugaises, allemandes et même espagnoles. Seuls ces mêmes Hollandais dont nous parlions hier ne se sont pas aventurés en Afrique, mais ont cru pouvoir en faire une seconde Hollande quelque part entre le Cap et la province du Natal. Etrange peuple, car il a su parfaitement imiter les autres nations européennes dans la gestion des sept mille îles de l'Archipel indonésien. Qui écrira l'histoire terrible de cette «colonisation»-là ?
Je dis tout de suite que cette première explication ne me satisfait pas. Mais je vais m'y tenir le plus longtemps possible, et au moins jusqu'à ce que je trouve d'autres arguments. Pour l'instant je vais examiner ce qu'implique cette différence entre une véritable colonie et cette forme bizarre d'occupation de territoire. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, très exactement dans les différences d'intensité de la détermination avec laquelle les occupants tentaient d'éviter de fonder une véritable colonie que vont se structurer des politiques qui vont aboutir à des conséquences remarquablement différentes au-delà des indépendances relatives, intervenues à peu près toutes dans la même décennie Cinquante-Soixante.
Après le tournant de 1885, après que les grandes puissances se furent partagé le continent sur une table berlinoise, chaque nation va mettre en batterie une forme de ce qu'on appellera si faussement colonisation. Même les Portugais, qui sont pourtant les plus anciens occupants, vont structurer, étatiser, réglementer et en somme asseoir leur souveraineté là où jusque alors ils ne faisaient que trafiquer des esclaves et des marchandises de toutes sortes, en s'appuyant sur les structures tribales et politiques existantes. On ignore volontairement, ignorance proprement coloniale ou impérialiste, que l'Afrique n'était pas seulement constituée par des matières premières, des hommes et un climat, mais qu'il a existé toujours des sociétés africaines constituées et en évolution, bref, que l'Afrique a aussi une Histoire.
Entre 1885 et en gros 196O, c'est à dire pendant soixante-quinze ans, chaque zone sera l'objet d'une alchimie sociale et politique particulière qui va révéler, d'une certaine manière, l'âme réelle de ces peuples qui ont prétendu s'emparer de la terre et des peuples africains. De cette alchimie, j'ai l'air de me répéter un peu mais cela me semble nécessaire, sortiront les nations africaines indépendantes et leurs destins respectifs.
Ainsi, la France, pays étonnamment naïf, reste celui qui prend sa tâche le plus au sérieux, qui va jusqu'à mimer une réelle installation, mieux, une duplication de la République à l'échelle de ses diverse zones d'influence. L'après-Berlin, c'est aussi, en Afrique, la ruée vers l'intérieur du continent. Jusque-là, l'Afrique c'était avant tout un espace côtier, d'abord un relais vers l'Asie jusqu'au percement du Canal de Suez, puis une grappe de ports de départ des vaisseaux chargés de «charbon», les esclaves à destination des Amériques : la fausse colonisation servait à assurer la vraie ! Petite digression : certains historiens estiment à plus de Trois Cent millions d'hommes et de femmes, victimes directes et indirectes de l'esclavagisme. Des millions de personnes qui représentent à ces époques-là la crème du continent, les hommes et les femmes les plus forts, les plus sains et les plus «utiles» outre-Atlantique... On peut mesurer le degré d'épuisement démographique qu'a représenté l'esclavage et méditer sur le temps qu'il aura fallu et qu'il faudra sans doute encore pour «guérir» l'Afrique de cette sorte-là de génocide.
La France républicaine et égalitaire va mettre en place une structure administrative et sociale républicaine et égalitaire, toutes proportions gardées. L'africanisation des cadres prendra encore beaucoup de temps, moins cependant que ne prendra le même processus dans les territoires belges ou portugais, plus, au contraire, que dans les territoires britanniques qui sont les premiers à encourager l'autonomie administrative, expériences indienne, australienne et canadienne oblige. Mais à la grande différence des Anglais, les Français vont former des cadres territoriaux africains sur un tout autre modèle : ils vont le faire sans tenir compte de la multiplicité des ethnies, du moins sans privilégier l'une ou l'autre tribu en leur accordant un pouvoir politique particulier sur les autres. Le principe égalitaire va dominer dans la formation des cadres politiques qui vont devoir assumer la gestion de ces indépendances précipitées par l'action politique des Américains avant et après les deux guerres mondiales. L'une des rares conséquences dramatiques de cette politique, fut paradoxalement le destin de l'ex-Dahomey, l'actuel Benin, dont les populations particulièrement actives et astucieuses ont longtemps prédominé dans les promotions d'étudiants d'Afrique Occidentale Française. Résultat, les Dahoméens ont trop essaimé dans la zone AOF et se sont vus, plut tard, légèrement pogromisés dans les nouveaux pays indépendants voisins.
Autre digression : on oublie, ou on ignore trop souvent le rôle joué par les Américains en Afrique dès le Dix-Neuvième siècle. S'étant contentés d'être les clients du charbon africain pendant plus de trois cents ans, et en ayant récolté les conséquences sous la forme d'un peuplement noir source d'intenses problèmes politiques (puisqu'il sert de casus belli à la seule guerre civile américaine), les Américains vont développer une politique africaine originale. Ils vont rêver à une terre de retour, et pour ce faire, contribuer à l'évangélisation du continent noir, histoire de repérer les lieux comme le Libéria, où l'on pourrait un jour renvoyer tous les descendants de ces cargaisons de charbon. Par la suite, ces «missions» diplomatico-religieuses vont se transformer en missions d'agitation politique indépendantiste. Au Congo ex-belge, le Zaïre entre-temps redevenu République du Congo, les Américains ont fondé des sectes chrétiennes dites «syncrétiques» - dont la fameuse secte de Simon Kimbangu, père spirituelle de l'indépendance congolaise - destinées avant tout à semer la bonne parole de la révolte anti-coloniale. Nous reparlerons des Américains ultérieurement, car leur rôle ne s'est pas arrêté là car ils ont toujours gardé une «longue» main commerciale et diplomatique sur toutes les affaires africaines.
La méthode française de gestion des territoires «coloniaux» donnera des indépendances relativement douces. Il est remarquable que la plupart des territoires occupés par la France sont restés indemnes de ce qu'on a nommé partout ailleurs les génocides tribaux. Le plus célèbre et le plus coûteux en vies humaines aura été la guerre du Nigéria, la fameuse guerre du Biafra qui a tué plus d'un million de personnes. Pour retrouver ces chiffres, il faudra attendre les guerres civiles angolaise et mozambicaine. Reste que presque tous les territoires occupés par la Grande-Bretagne ont connu, après l'indépendance ou pendant leur conquête politique, des massacres inconnus dans les ex-colonies françaises. Certains territoires administrés par la France connaîtront certes des troubles, le Tchad en particulier, qui va focaliser l'actualité dans les années soixante-dix et quatre-vingt, mais ces troubles sont largement des sous-produits de la combinaison de la guerre froide et du nationalisme arabe. Dans la Corne de l'Afrique ce sont exactement les mêmes données qui prévalent, quant à la Guinée de Sékou Touré, c'est là l'avatar le plus caricatural de la guerre froide continuée sur le continent africain.
Or de tous les territoires sous domination britannique, il n'en est guère que quelques uns qui n'ont pas encore sacrifié à ces terribles conséquences du racisme administratif des Anglais. Au Nigéria comme ailleurs, les Britanniques ont mené une politique de division tribale. Ces divisions se sont bien entendu maintenues au-delà des indépendances, provoquant à distance des contrecoups politiques sanglants : Nigeria, Ouganda, Sierra-Leone, Kenya, Soudan, autant de pays qui ont connu et connaissent encore aujourd'hui le martyr de guerres civiles sans fin.
Les Belges ont procédé autrement. Une donnée suffit : le premier universitaire congolais a été diplômé en 1958, deux ans avant l'indépendance du pays. Tout occupés qu'ils étaient à exploiter les énormes richesses minières du Congo, Bruxelles et Anvers ne songeaient guère qu'au salut éternel de ses Africains et faisaient rimer colonisation avec évangélisation. Or le pire de cette farce, c'est que la Belgique n'avait à offrir comme missionnaires que la frange quasi analphabète du paysannat flamand pauvre dont les enfants n'avaient, à cette époque, aucun avenir économique. La Wallonie a trusté le PNB belge jusque dans les années soixante-dix. Si la métropole a donc réellement fait des efforts pour développer le Congo, l'industrialiser et même le doter d'infrastructures qui mettront assez longtemps à disparaître sous l'incurie de Mobutu, elle n'a rien fait pour éduquer les Congolais en vue de la gestion future de leur propre pays. Ceci explique en grande partie cela.
Pour ma part, je ne considère absolument pas l'éducation européenne comme une panacée, ni même comme supérieure à quelque pratique traditionnelle que ce soit. Le problème est que les formes qu'avaient prises les diverses hégémonies économiques européennes en Afrique, apportaient avec elles la contrainte de la poursuite de la gestion de ces structures mises en place de manière tout à fait aléatoires (Berlin 1885) et dans des perspectives centrées sur les choix de civilisation européens, c'est à dire sur l'économie et le principe hégémonique lui-même. Le piège se refermait sur des femmes et des hommes qui n'en pouvaient mais.
La Belgique symbolise peut-être le mieux ce refus de coloniser réellement l'Afrique. Les massacres qui ont suivi la décolonisation du Rwanda et du Burundi resteront la conséquence la plus tragique du «péché» belge, des conséquences dont on n'a de loin pas encore vu la fin. De Kigali à Bujumbura, les Belges ont inventé une Race de souverains, les Tutsis, de soit-disant guerriers qui pourraient bien, dans les décennies qui viennent, faire parler d'eux de manière de plus en plus constante et désagréable. Ils ont déjà commencé autour du futur Empire des Grands-Lacs. Sur les modèle des Britanniques, mais avec l'application et la méthode industrielle dont ils avaient le secret, les Belges ont cru pouvoir fabriquer une élite tribale sur le modèle de la race supérieure, concept alors très en vogue dans l'Europe du Nord ! Le mot génocide relie très bien la réalité ignoble de la Shoah avec celle des massacres de 1994, les deux tragédies ont la même origine, les thèses racistes et leur mise en application politique et sociale. Attention, les Tutsis sont les premières victimes de ce marché de dupe, puisqu'ils ont payé les premiers le prix fort du cadeau empoisonné que leur ont fait les Belges. Je ne peux pas prendre partie pour ou contre eux, ni dans le passé ni dans le présent ni dans l'avenir, même s'ils tombaient définitivement dans le mirage dressé pour eux par l'ancien colonisateur, mirage qui en faisait des hommes supérieurs. Aujourd'hui on sait que la société des Grands Lacs, les Tutsis-Hutus, était une société relativement organique, dans laquelle les castes n'étaient pas simplement divisées en Tutsis et en Hutus, mais imbriquées selon une structure mixte très complexe et très délicate. Trop délicate pour les paysans du Plat-Pays. Voyez comment la brutalité et l'ignorance inscrivent dans la réalité des faits qui vont se transformer en de nouvelles réalités tout à fait différentes. Bientôt on va épiloguer sur la brutalité des Tutsis dans cette Afrique Centrale débonnaire, on va craindre les visées hégémoniques de ces minorités aujourd'hui acculées au désespoir et qui n'ont au fond pas d'autre choix que de faire ce qu'ils font : attaquer pour ne pas être massacrés.
A titre exotique, citons ces autres pratiques «coloniales» qui ont suivi la réorganisation territoriale de 1885. Mozambique, Angola, deux vastes et riches territoires contrôlés par Lisbonne. Pendant quelques décennies, l'Age d'Or, l'Angola a été le paradis des latifundistes. Pays sans difficultés géologiques ou climatiques particulières, ses vastes et magnifiques provinces étaient couvertes de grandes propriétés et plantations qui ont quelque peu rendu de prospérité à une métropole qui s'enfonçait dans le sous-développement. Ernst Jünger en fait une description évocatrice dans ses carnets, y ayant fait de longs séjours sur l'invitation de propriétaires allemands, Junkers et autres réfugiés douteux qui avaient fui l'Allemagne après chacune des deux guerres. L'écrivain décrit à merveille l'ambiance qui règne en Angola à la veille de la guerre d'indépendance et le sort réservé alors aux populations africaines. Or celles-ci avaient encore de la chance comparées à leurs voisins mozambicains.
Si l'on naissait au fond de la brousse du légendaire Monomotapa, l'on naissait damné. On commençait sa vie comme quasi esclave du village peuplé de fantômes car les hommes étaient systématiquement raflés, chargés dans les moyens de transports les plus divers, type Auschwitz, et expédiés vers les mines d'Afrique du Sud. Là ils travaillaient cinq, dix ans, autant que leur constitution le permettait, leur salaire étant versé directement au gouvernement portugais. En fin de «contrat», on les renvoyait mourir dans leur brousse, où on ne se privait pas de leur extorquer des impôts par les moyens les plus sordides, notamment la fameuse torture de la cuillère trouée dont on frappait les mains, voleuses par définition. Ce système fut perfectionné sous l'action conjuguée de Salazar et de Verwoerd, les deux tristes héros de la colonisation et de cette forme particulière du racisme , l'Apartheid. Souvent je me suis demandé comment les populations de ces pays ont pu continuer de se multiplier au point d'entamer de nouveaux massacres au lendemain même de leur libération ! Mais ce mystère appartient à ce qui reste en-dehors de la conceptualité européenne, la fertilité démographique et culturelle du continent africain est un phénomène d'une telle importance pour l'avenir de toute notre civilisation, qu'il mérite bien qu'on reste quelque peu interloqué et que l'on hésite à conclure trop vite.
Les différences qui ont marqué les formes politiques et administratives de l'occupation européenne de l'Afrique expliquent, certes, un grand nombre de problèmes actuels de l'Afrique. Ce sont des explications que l'on évacue d'ailleurs un peu vite. Mais elles sont loin de tout expliquer. Car il y a des domaines où cette colonisation se ressemble d'une zone à l'autre, d'une nationalité à l'autre : ceux de l'exploitation économique et de l'imposition par la force d'existences d'avance prolétarisées dans les structures agricoles et industrielles de cette exploitation. L'Europe a mis deux mille ans à intégrer le modèle de l'esclave antique, c'est à dire d'accepter le travail comme lieu commun du destin. L'Afrique n'en est qu'à son premier ou tout au plus son second siècle d'expérience de cette condition nouvelle de leur humanité. Oh bien sûr, les esprits cyniques diront que les Africains ont eu des cours de rattrapage de l'autre côté de l'Atlantique ! Mais ces Africains-là sont restés là-bas et représentent d'ailleurs l'espoir des deux continents américains, tant ils ont conservé de vitalité malgré, à cause de ?, leur épouvantable misère.
Depuis que je végète dans les ruelles de notre triste civilisation, je n'ai connu qu'un grand événement, c'est le Jazz et ses diverses continuations. La musique de quelques SDF à la peau noire, nés esclaves dans des plantations de blancs, voilà ce qui constitue aujourd'hui le grain culturel de nos propres enfants. On aura beau régénérer sans arrêt par de nouvelles interprétations la musique dite «classique», on n'arrêtera pas ce flot puissant et vital qui secoue toute la planète et tous les peuples qui l'habitent. Le rythme ternaire a gagné la plus grande de toutes les guerres civilisatrices, sans que nous ne nous apercevions d'où venait cette force titanesque. Lorsqu'on contemple un masque africain ou même seulement l'un de ces objets quotidiens dits traditionnels, on sent toute cette puissance latente, puissance inquiétante par la paix même qu'elle nous lance à la figure, la paix d'une conciliation avec la mort dont nous n'avons jamais osé rêver.
Quelques savants, quelques ethnologues, quelques artistes comme Michel Leiris ont effleurés la vérité. Je me souviens avoir lu un beau livre qui n'était pas de Margaret Mead ou de Claude Lévy-Strauss, mais d'une obscure ethnologue britannique des années quarante dont le nom m'échappe pour l'instant. Ce livre s'appelait «Return to laughter», retour au rire. Il décrivait avec une minutie extrêmement honnête une dimension de la vie africaine authentique qui a échappé depuis à tous les Balandier et Clastres du monde. Nulle part je n'ai retrouvé cette vérité profonde que j'ai pu moi-même expérimenter au fond de la brousse gabonaise, cette vérité que les Africains ont un sens puissant de la contingence de la vie et refusent avec orgueil de la prendre au sérieux sous le prétexte de l'au-delà. Ce que j'ai compris de leurs comportements quotidiens qui n'attirent que les quolibets de nos colonisateurs passés et présents, c'est le refus de soumettre leur existence aux règles tragiques qui dénaturent notre propre vie depuis si longtemps, ici en Europe. Le rire, voilà la dimension du da-sein africain, ce rire qui s'éteint pacifiquement dans le masque. Le masque recueille à lui tout seul la dimension tragique de la vie, il accomplit ainsi plus que ce dont nous avons nous-mêmes chargé l'oeuvre d'art. Le masque établit une barrière entre la vérité et nous plutôt qu'une passerelle parce que l'homme africain n'a pas besoin de cette passerelle, il vit
dans l'élément de la vérité, n'ayant jamais créé comme nous les fictions qui lui aurait permis d'en déroger. Voilà qui laisse poindre d'autres développements possibles sur les définitions de la conscience et de l'inconscient. Inconscient comme l'endroit où se stockent par la force des choses les morceaux de vérités refoulés, les vérités tout simplement non vécues parce que barrées par des fantasmes collectifs. On me rétorquera que toutes les sociétés structurent des fantasmes, et sans doute est-ce vrai, mais il y a des différences qualitatives essentielles entre des fantasmes collectifs répressifs, comme celui du péché originel et les représentations simples du devenir des âmes après la mort. Les Africains n'ont pas découvert la «vie éternelle» avec les religions européennes, ils possédaient cette dimension depuis sans doute bien avant nous dans une arithmétique simple qui procédait de la question de savoir où allaient les âmes. Et comme la qualité dominante des Africains est cette simplicité sans détours et sans falbalas, ils ont postulé que les âmes continuaient de vivre au milieu d'eux. De là, plus besoin de construire des pyramides ou de vastes tombeaux, de là cette idée que les ancêtres entraient dans le coeur même du monde, de la matière, pour y régner définitivement, pour accéder à ce qui leur resta refusé pendant toute leur existence bruyante mais riante.
Je me souviendrai toujours de ces «fronts studieux» dans mon lycée de brousse, jeunes Gabonais à peine alphabétisés en Français et déjà contraints de penser et d'écrire dans les matières littéraires et philosophiques européennes ! Que croyez-vous qu'il en advint de cette situation en apparence surréaliste ? Des miracles, je me suis rendu compte que ces esprits étaient avant tout propres, simples, sans détours, sans méta-discours à dissiper, et que cette simplicité leur permettait de recevoir les grandes questions de la philosophie beaucoup plus facilement que leurs homologues européens. La question de la langue elle-même était subvertie par un génie direct, un accès sans problème particulier au questionnement ontologique. Le Jazz et le masque rejoignaient les farces grecques lancées avec la même innocence et qui devaient aboutir à tout à fait autre chose.
Voici six longues pages écrites sur l'Afrique, je m'en excuse, mais je dois confesser que ce continent est une partie de mon âme, la plus passionnée, celle qui m'a donné le plus de courage pour continuer de vivre parce qu'elle était simplement là, amarrée à quelques encablures de Marseille, avec toute son histoire si absolument unique et si absolument décriée et défigurée que je ne pouvais pas en faire moins et je continuerai d'en faire dès que l'occasion se présentera et que j'aurai, une nouvelle fois, regroupé mes idées à son sujet.
Cependant, encore un mot : il me semble qu'il y va pour l'Afrique d'aujourd'hui comme pour notre bonne vieille Europe qui ne fait que commencer à se relever des deux grandes guerres que j'appelle toujours les catastrophes du siècle. L'Afrique ne s'est pas encore relevée des deux cauchemars qui ont marqué ses quatre derniers siècles. SIECLES et non pas quelques années ! Il faut méditer soigneusement cette incroyable vitalité qui a permis aux Africains de survivre à tout cela : trois siècles pleins de chasse à l'homme et d'esclavage intra et extra muros, plus un bon siècle de «colonisation» sans plus de pitié. Je n'oublierai jamais ce film, tourné clandestinement en 1950 dans le nord de la Côte d'Ivoire - il s'intitule d'ailleurs Afrique 50 - par René Vautier, cinéaste engagé et héros de la guerre d'Algérie qu'il a été pratiquement le seul à filmer côté rebels. Dans Afrique 50, on découvre horrifié que la France massacrait allègrement, brûlait les villages qui avaient l'outrecuidance de se révolter contre cette administration que je décris plus haut avec, peut-être, un rien trop de bienveillance. Qu'on ne s'y trompe pas, les Nations civilisées se comportaient comme des sauvages en plein milieu du vingtième siècle, laissant les citoyens des métropoles dans la plus grande ignorance des événements qui ensanglantaient alors ces braves «colonies».
L'Afrique est donc en train de se réveiller, pas aussi vite que l'auraient désiré les grands leaders d'hier comme Nkwame Nkrumah ou Sékou Touré, Mandela ou Lumumba. La prodigieuse carrière de Nelson Mandela a quelque chose de mystérieux pour qui l'étudie d'assez près. Elle montre non seulement le degré de résistance que l'Afrique sait montrer face à la puissance aveugle et barbare, mais encore l'intelligence avec laquelle l'homme africain sait attendre son heure, rire sous les tortures, pardonner pour gagner. A bien y réfléchir, qu'est-ce qui différencie Mandela de quelqu'un comme Boèce ? Une seule chose, c'est que Boèce a succombé à ses tortures, mais pas Mandela. Mystère ! Qui a arrêté le bras des racistes de Prétoria ? Les ancêtres rigolent derrière les masques.
Jeudi, le 15 octobre 1998
Repris à zéro la lecture de Levinas. «Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence». Quel titre ! Toujours le même sentiment, je reste scandalisé par le culot de ce professeur de philosophie. Mardi dernier, j'avais pratiquement décidé d'abandonner Levinas, un texte de Simon Critchley m'avait confirmé dans le sentiment qu'il y avait une problématique proprement psychanalytique sous les tentatives de Levinas, un Trauma dit ce commentateur américain et perspicace. J'ai donc eu l'impression d'avoir été floué dans ce qu'on pourrait nommer le travail de la tradition, la taille de la pierre philosophale provenant des millénaires et qui n'a pas besoin d'être distrait par des événements historiques, même s'ils sont de la dimension de la Shoah. Question grave, et qui ne cesse d'alimenter les discussions philosophiques, de savoir quel statut donner à la Shoah, simple massacre, simple volonté d'anéantissement semblable à celle d'un Tamerlan ou d'un Gengis Khan, ou bien césure historique et aveu flagrant de l'inanité de notre Occident, Juif, Chrétien et Grec ? Je ne voudrais pas traiter de cette question ici et maintenant, je n'en ai ni le droit ni le courage. En revanche, la question de savoir si la pensée de Levinas - i.e. ses écrits, même s'il dévalorise lui-même ce qu'il appelle le Dit - n'est pas entièrement déterminée par cet événement. Non pas le génocide lui-même, puisque le philosophe ne pouvait pas encore y faire référence lorsqu'il a lancé les fondements de son «système» dans les années Trente, mais le phénomène du racisme, qui, si l'on réfléchit bien, ne peut guère conduire à autre chose qu'au génocide. Le nazisme n'a fait qu'ajouter l'horreur industrielle à une conduite au fond logique avec elle-même, et j'en profite pour renforcer, si je peux, ici, toute légitimation philosophique-morale nécessaire des lois anti - racistes. Bien sûr que l'on ne saurait être assez sévère avec le racisme, précisément parce que le racisme n'a pas d'autre contenu et perspective que la négation d'autrui et le crime de sang, le meurtre. Le racisme devrait être puni à l'instar de la tentative de meurtre ou de la complicité active ou passive d'un assassinat, rien de moins. Fin de la digression, si l'on peut appeler cela une digression...
Levinas donc. Citons : «Si la transcendance a un sens, elle ne peut signifier que le fait, pour
l'événement d'être - pour l'
esse -, pour l'
essence, de passer à l'autre de l'être
.
Je crois qu'il faut passer sur le malentendu être/essence, que Levinas tente à plusieurs reprises de dissiper, et admettre tout simplement sa définition à lui, même si ce compromis peut paraître déjà boiteux. Il y a confusion, en effet, entre l'essence comme quiddité et l'essence comme ce que Levinas appellerait la «signifiance de l'être», et que nous appelons tout simplement l'être. Cette imprécision a des racines historiques. Il suffit de remonter au Moyen-Age, où les Scholastiques renvoyaient massivement l'être à l'essence : la substantivation de l'être ( en Dieu notamment) est le produit naturel d'un compromis logique entre un infinitif et un substantif qui ne signifient, originairement, pas du tout la même chose. Il faut se souvenir que le problème des Scholastiques n'était pas Etre / Essence, mais Etre / Existence, problématique qui renvoie à un tout autre domaine que le binôme Etre / Essence. Restons encore un peu sur ce problème : Levinas fait mine de renvoyer Essence à Existence, en fait. Il dit expressément qu'il faudrait en réalité écrire ess
ance et non pas essence, ce qui veut bien dire quelque chose comme un esse actif, le fait pour l'être d'être. On ne comprend d'ailleurs pas, si l'on circule dans les significations modernes, c'est à dire Heideggeriennes, de l'être, et c'est le cas de Levinas, pourquoi ne pas utiliser tout simplement le mot être ? Pourquoi Levinas est-il allé chercher le mot essence ?
Retour à la citation. «Si la transcendance a un sens,» : cette proposition subordonnée est extrêmement intéressante, car elle pose une alternative pour ainsi dire basique, fondamentale : la transcendance a-t-elle un sens ou non ? Autrement dit, existe-t-elle ou pas ? Y-a-t-il transcendance ou n'y-a-t-il pas transcendance ? Tout le livre dépend de cette question, à laquelle Levinas se garde bien de répondre : toute la pensée de Levinas est comme suspendue à cette inconnue, à la réduction de ce «si» initial. Car on se rend bien compte, plus tard, après d'autres lectures de Levinas, que Levinas s'en prend avant tout à l'Immanence, avant tout à Parménide, avant tout à ce qui réduit toute possibilité de la transcendance, LA transcendance absolue, et non pas seulement la transcendance du statut, par exemple, de la conscience ou des contenus transcendantaux. Difficile : la philosophie traditionnelle, avant Levinas, a toujours posé la transcendance comme la différence entre la conscience et l'objet, le fait que tantôt la conscience, tantôt l'objet, se haussaient dans la position transcendantale, le mouvement de balancier se trouvant parfaitement décrit dans la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel. Après Levinas, la transcendance ce n'est plus du tout cela, c'est devenu quelque chose d'aussi radical que la mort, au sens où la mort est l'impureté absolue au milieu du vivant. La transcendance levinassienne résonne en dernière analyse comme l'autre de tout, l'autre de l'être, l'autre de la Raison, l'autre de l'Histoire, l'autre du présent lui-même. Etre / Raison / Histoire / Présent n'étant que le déchet du Dire à l'origine. Levinas ne va pas chercher l'origine chez les Grecs, comme Heidegger, il la cherche hic et nunc, dans la proximité de la transcendance. Car la transcendance, nous y sommes immergés comme dans l'immanence elle-même, elle nous côtoie en permanence par la présence d'Autrui. Autrui, pourquoi la majuscule ?
«Si la transcendance a un sens» : si la proximité d'Autrui a un sens, c'est à dire s'il se passe dans cette proximité ce que Levinas revendique qu'il se passe. J'avoue n'avoir pas encore bien compris quoi. La Responsabilité. Tout devrait être dans ce mot. Cherchons. La Responsabilité c'est ce qui me saisit dans la proximité d'Autrui. OK. La transcendance c'est le «fait» de la responsabilité, l'événement de la proximité et de sa conséquence, accueillis par moi, ou pas. Question : si pas, dois-je alors classer le Dit, l'Histoire, la Raison, l'Etre, etc... parmi les, disons, «produits» de cette négation, de ce refus, de ce «péché» ? Ou bien, sinon, quel est le statut réel du Dit, Histoire etc... On pourrait parfois appeler la philosophie de Levinas, la déchétique de l'histoire de la pensée, la science des déchets, au sens qu'en définitive il n'y a que des déchets. Tout ce qui n'est pas déchet reste ...transcendant. Et hop.
Retour à la première phrase. «Si la transcendance a un sens, elle ne peut signifier que le fait... de «passer». La transcendance est un «passage». Un passage d'où à où, ou de quoi à quoi ? Un passage de l'événement d'être, de l'esse, de l'essence, à «l'autre de l'être». Tout le système est là, dans cette phrase, et aussi tout le mystère.
Question bête : pourquoi Levinas ne dit-il pas tout simplement le passage «de l'être» à l'autre de l'être ? Pourquoi se croit-il obligé de dire «l'événement d'être» ? Cherche-t-il seulement à préciser que l'être dont il parle n'est pas le substantif de la Scholastique, n'est pas
un Etre, ou bien fait-il allusion à l'Ereignis de Heidegger, l'événement de l'être, c'est à dire déjà à une interprétation déterminée de l'être ? Sans doute, mais cela ne va pas de soi.
Car l'être comme événement, Ereignis, est la transcendance même, et à ce titre n'a nul besoin de se voir soumis à une définition de cette transcendance qui dépendrait, en un cercle infernal, du sens de l'être lui-même.
Vendredi, le 16 octobre 1998
C'est un peu pompeux, tout ça, comme Levinas dans l'ensemble. Poursuivons malgré tout.
Donc il y a un doute sur la transcendance, c'est déjà ça. C'est le côté séduisant de Levinas, une incroyable insolence par rapport à la tradition, pire que Kierkegaard, il vous envoie tout bouler, encore que dans un style très prudent, si...., comme si ce qu'il pensait et écrivait pouvait en réalité et en parfaite conscience, être totalement faux, sans que cela n'entame sa Foi. Classique.
Si la transcendance a un sens, s'il y a transcendance (?), cette existence de la transcendance ne peut consister qu'en un passage. Intéressante vision de la transcendance : on n'est plus dans un schéma rigide d'une réalité séparée, hors d'atteinte, régnante sur le reste de ce que la conscience peut, elle, atteindre. Au contraire, c'est la conscience elle-même qui se transcende en «passant» dans l'autre de l'être. Et sans doute y-a-t-il là une autre confusion, entre être et conscience, comme si les deux étaient parfaitement la même chose. Ailleurs Levinas le dit sans ambages, la conscience c'est bien un sous-produit du langage et du Dit, c'est à dire l'un de ces déchets du Dire - et de son échec ? - au fond l'élément de l'être, ou, disons, que l'être est l'élément, l'atmosphère dans laquelle respire la conscience, seulement la conscience. Seulement l'être, seulement la conscience !
Mais alors comment la conscience, la pauvrette, peut-elle faire cet effort gigantesque de sortir d'elle-même pour entrer dans une autre dimension, transcendante ? Pour passer ? Ou bien, y-a-t-il quelque part un passeur ? Comme on peut le voir, on n'est pas loin de la psychanalyse et de ses «passes».
Passer : ce mot pèse très lourd. Il contient une sorte de synthèse spatio-temporelle, changement de topos qui est en même temps écoulement de temps. Ecoulement de temps qui est, en réalité, seulement changement de lieu. Passer à «l'autre de l'être», c'est changer de lieu, de milieu, ou peut-être sortir de tout milieu, sortir de ce qui fomente milieu, être, immanence, cohésion du tout dont chacun de nos destins n'est qu'une mystérieuse partie. Il y a là, me semble-t-il, la même révolte que celle de Kierkeggard, une révolte contre le dispositif mis en place par la métaphysique, contre une forteresse construite par les hommes contre le fantasme d'un Royaume divin. Fantasme ou
nostalgie ? Là est toute la question : K et L ne seraient-ils que des Romantiques attardés dans un refus d'assumer le technique ? Il faudrait continuer d'interroger l'Ereignis lévinassien pour s'approcher d'une réponse, car le technique est, qu'on le veuille ou non, l'âme de l'être-événement, ou, autrement dit, il n'y a pas d'Ereignis hors de l'assomption du technique.
Etant entendu que l'Ereignis de Levinas n'est que le négatif, ou, disons, le facticiel (?).Il écrit d'ailleurs quelques lignes plus bas : - «Et que peut signifier ici le
fait de passer, lequel, aboutissant à l'autre de l'être, ne pourrait au cours de ce passage que défaire sa facticité ?» - Dans l'édition que je possède, le mot fait est bien imprimé en italique. Une insistance un peu incongrue et qui pose problème si l'on veut bien se souvenir de la phénoménalité essentielle des «faits» dans la Tradition. Défaisant sa facticité, il abandonne aussi sa phénoménalité, il se déshabille en somme, il arrache les oripeaux des apparences, pour passer où ? Dans l'autre de l'être chez qui il «aboutit». Ici chaque mot compte, car aboutir n'est pas neutre. Aboutir implique un itinéraire long et coûteux en énergie destinale. Le passage, que l'on aurait pu imaginer instantané ou même formant la réalité vraie de l'ek-sister en permanence, s'avère être un aboutissement, quelque chose comme le terme d'une... dialectique... ascendante ?
Alors quel est le sens de la transcendance ? Lisons plus loin, page 14 (Ed.Poche) - «L'énoncé de l'
autre de l'être - de l'autrement qu'être - prétend énoncer une différence au-delà de celle qui sépare l'être du néant : précisément la différence de l'
au-delà, la différence de la transcendance.» - : Autre / au-delà / transcendance.
Je vais m'arrêter là pour le moment, avec ce soupçon : il n'y a, à mon sens, de transcendance que dans la jouissance - cela n'échappe nullement à Levinas et il le laisse entendre plus d'une fois ailleurs - et à ce titre, et nous retrouvons Kierkegaard, il y a passage et toute la mécanique lévinassienne fonctionne à merveille. Question : pourquoi faut-il donner une dimension proprement ontologique à ce passage-là ? S'en sert-on comme d'un paradigme qui n'a son intérêt qu'une fois étendu à l'infini, ou bien veut-on l'annuler au profit d'une eschatologie inconnue, inconnaissable et pour laquelle je m'anéantis devant Autrui ? N'y-a-t-il pas chez Levinas un danger permanent de «passer», en réalité, dans la bouche de Baal, dans le sacrifice à l'idole ? Alors que je suppose, un peu vite peut-être, que tout son dispositif ne vise qu'à subvertir l'idolâtrie de l'être. Retour donc, en cette fin de parcours (de passage !) à la question du début de ce commentaire, retour à la question de la place de la Shoah dans la méditation de Levinas avec cette question redoutable : qui était aux commandes des chambres à gaz ? Iahvé ou Baal ?
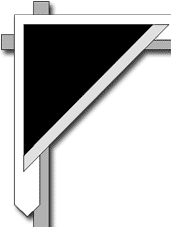




![]()