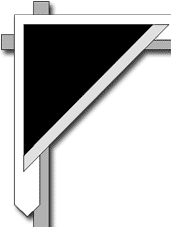
|


Samedi 10 janvier 2004
La bergerie de l'Être.
Heidegger avait certes ses raisons pour enfermer l'être dans cette bergerie dont il présente l'homme comme le gestionnaire obligé de par son apanage langagier. Il n'est pas innocent que le philosophe accusé d'avoir fricoté avec les nazis, ce qui dans un certain sens ne fait aucun doute, se soit cru obligé, le moment venu, de rendre sa dignité transcendante à l'être que son histoire immédiate avait tant ravalé au rang d'animal. Encore faut-il toujours préciser que l'animalité dont on parle ici est celle que fantasme l'opinion depuis tant de siècles, et non pas notre propre conception (notre propre ignorance) de ce qu'est un animal. C'est dans ses plaidoyers de dénazification théorique - que ce soit dans la plaquette qui traite de l'humanisme ou encore dans l'interview publiée à titre posthume qu'il avait donné au Spiegel - que l'on trouve cette mise au point dont on sent bien qu'elle lui est somme arrachée contre son gré. Plus tard, il ne parlera plus guère de sa bergerie, s'étant installé définitivement dans ce qui n'est qu'une exclusivité apparente de l'homme, à savoir la parole. Il ne lui avait pas échappé qu'il y a longtemps que les poètes ont su lire et entendre les paroles des étants autres que l'animal humain. Au demeurant, son édifice philosophique et poétique s'achève sur ce qu'il y a de moins humain dans l'univers, à savoir le silence.
Son erreur aura été bénigne mais embarrassante. Il a longuement développé son idée des " envois " de l'être, plantant un décors historique de la détresse de l'oubli de l'être (un génétif double qui implique aussi que l'Être lui-même s'oublie) et où, malgré cet oubli ou à travers cette nuit, certains personnages recouvrent " historialement " la vue ontologique, se retrouvent face à la question initiale et tentent d'y répondre, parfois de la manière la plus alambiquée et la plus obscure, voir Kant ou Hegel. Voir le maître de Heidegger, Husserl lui-même. Ces hommes auraient, chacun selon sa guise - mais que recouvre ce mot ? - redécouvert la question fondamentale résumé par Leibniz dans son fameux : pourquoi y-a-t-il de l'être plutôt que pas ?
La geste de la bergerie a pourtant un sens historique, une direction par laquelle il se passe quelque chose de nouveau à chaque nouvel envoi et qui se cumule en un résultat. Nous le savons, ce processus, puisqu'il faut l'appeler ainsi faute d'une autre expression, aboutit à la subjectité, c'est à dire en quelque sorte au transfert de la substance en l'homme en tant que sujet. Si on peut imaginer le monde avant Descartes, il faudrait pouvoir le représenter pour ainsi dire en morceaux, en diverses parties substantielles telles que la science encore aujourd'hui nous le présente : le monde minéral, végétal, animal et humain. Il faudrait encore ajouter divin. Or cette hétérogénéité n'est pas encore hiérarchisée, elle se contente d'énumérer ce qu'il y a autour de nous, les hommes, et ce qu'il y a autour de nous en tant que réalité intangible. Ce qui change dans le règne de la subjectité, c'est que finalement tout s'ordonne autour et en vue de l'homme, ce que l'opinion commune désigne comme la domination de l'être humain sur le reste de l'univers. Désormais rien d'autre que l'Homme n'est plus assuré de sa réalité ni de sa pérennité. L'homme a repris en lui toute la responsabilité de l'être des autres choses que lui : il s'est posé comme le créateur continu de ce qui est. C'est en critiquant ce résultat, un fait incontestable, que Heidegger en est venu lui-même à son propre " envoi ", qui au résultat n'aura pas été autre chose qu'un respectueux mais stérile pas en arrière. C'est l'expression dont il se sert lui-même pour caractériser son propre dialogue avec l'Histoire de la Philosophie.
Peut-être pas si stérile que cela. Car cette histoire " historiale " aura également eu pour résultat d'attribuer à l'homme une position d'entière solitude vis à vis de la question de l'être : cette question aura fini par lui échoir totalement au point de devenir son destin. Là encore on peut s'interroger sur la finalité originelle de la décision des hommes de cesser de nomadiser, et ce faisant, de partager le sens de l'étantité du monde avec les autres étants. Tous les nomades ont toujours laissé aux autres étants, au ciel , aux paysages, aux arbres, aux animaux, une place dans leurs panthéons. On peut supposer qu'il s'agit là d'une délégation de pouvoir, pour ainsi dire d'un accord diplomatique avec les éléments qui composaient leur monde. Cette attitude écologique avant la lettre - mais qui n'a rien à voir avec notre écologie sinon avec le souci qui la mine - faisait de ces éléments naturels les ambassadeurs ou les coadjuteurs des humains par rapport à cette question de l'être. Même dans les pré-civilisations sédentaires, les empires grecs et romains, ces éléments jouaient encore un rôle au moins divinatoire dans les affaires humaines. Les haruspices romains ne faisaient pas autre chose que d'interroger l'état de l'étant en tant que tel, son faste ou son néfaste, à partir de ce que pouvait montrer les éléments qu'ils interrogeaient, que ce soient les astres, les oiseaux dans leur vol ou la couleur de leurs excréments. La religion, puis la science, les deux puissances historiales qui ont institué l'Homme comme sujet absolu, ont chacune à sa manière anéanti cette coopération ou ce partage, l'agriculture en s'industrialisant parachève ce divorce. Le mythe de l'Eden illustre la rupture qui s'installe entre l'homme et la nature. La science a transformé le monde en objet, miroir du seul sujet, et elle adresse désormais ses questions à la seule autorité qu'elle reconnaît, à savoir les structures transcendantales de la raison " pure ".
Bien sûr, cette solitude est intenable, elle dispose toute la charge de l'angoisse ontologique sur les fragiles épaules d'un être qui n'a jusqu'à présent prouvé sa supériorité que dans son pouvoir de destruction et de mutilation. Et cette constatation suffit à elle seule à expliquer les absurdités des affairements humains. Albert Camus a profondément tort, ce n'est pas le monde ni la vie qui sont absurdes parce qu'ils sont condamnés à la disparition, l'absurdité est exactement ce qu'inventent les humains à chaque minute pour échapper à la question de leur être et de l'être en général. Mais pourquoi donc ? Mon propos ici n'est pas de répondre à cette question. Il est vraisemblable que la question du sens de l'être n'est pas en elle-même porteuse d'angoisse, mais qu'au contraire cette angoisse naît très exactement de son refoulement. Le plus grave dans tout cela est que c'est sans doute la civilisation elle-même qui a opéré ce refoulement dans une stratégie volontairement orientée vers l'angoisse, mère de tous les crimes et de toutes les résignations. Cette stratégie porte précisément le nom d'Histoire. Disneyland du divertissement pascalien.
C'est donc un complet retournement de point de vue qu'il s'agit d'opérer. La consignation de l'être porte en elle le risque d'avoir été une véritable consignation dans son sens le plus péjoratif, dans son sens de la privation de liberté tel qu'on l'utilise encore dans les armées. Il faut essayer de comprendre comment l'Histoire a pris son essor à partir de la mise sous tutelle de l'être, une tutelle caractérisé par Heidegger comme l'emprise du concept. La différence ontico - ontologique, c'est à dire cette sorte de divorce entre l'étant et l'être, est le résultat de cette mise sous tutelle de l'être comme concept. Mais ne nous y trompons pas, cette tutelle est un mirage, l'homme n'a, en tant que ce qu'il s'imagine être lui-même, rien gagné d'autre à cette opération que de pouvoir s'exhiber comme sujet face à un monde - objet. D'où la nécessité de l'Histoire comme eschatologie de cette différence, comme besoin quasi militaire corrélatif à ce défi qu'il nous est impossible de qualifier. Les Cultures des différentes civilisations, à l'exception remarquable des peuples nomades, ont accumulé les réponses à la question du pourquoi. La plus banale et la plus répétitive reste la tragique, celle d'une chute fantasmatique de l'être humain hors de la symbiose divine, hors de son appartenance essentielle à l'être.(1)
Tout cela ne tient évidemment pas debout. Il faudra tout reprendre à zéro, tenter de remonter à l'aurore de cette différence qui semble avoir engagé l'espèce humaine dans la folle aventure de sa propre destruction. Bergers de l'être nous le sommes encore dans quelques poèmes, d'où le retrait hautain de Martin Heidegger vers le seul commentaire de ces œuvres qui restent pour la plupart soustraits à l'horizon des multitudes. Dans ces textes parle encore une invisible coappartenance des choses et des hommes dont le secret se trouve dans l'évidence obscurcie de l'être universel.
Spinoza a été le grand illustrateur de cette coappartenance, plus puissante et qui transcende de son absolu toute notion de mouvement du temps, d'évolution et d'histoire, que ce soit celle de la pensée ou celle des actions humaines. Ne dit-il pas presque cyniquement au début du Livre 3 de son Ethique : - " …et je considérerai les actions et les appétits humains de même que s'il était question de lignes, de plans ou de corps " (2). Autrement dit, les hommes auront bien pu, à l'intérieur de leur destin, œuvrer à leur propre malheur et à leur propre déclin - mais ici on se méfie de suivre aveuglément le sentiment collectif d'une crise dont on connaît le caractère structurel de notre civilisation aussi loin que remonte notre mémoire ; Heidegger lui-même a souvent hésité entre une condamnation sans appel de la place qu'ont pris les hommes par rapport à l'étant, et le doute qui toujours lui parlait de la proximité d'un autre résultat qu'une pure et simple apocalypse technique.
Notes.
1 - Le Bouddhisme aura été la seule culture à comprendre en profondeur la portée de l'événement de la différence, sans s'aveugler dans un feuilleton patriarcal où l'être substantivé devient en réalité un autre homme fantasmatique caché dans l'au-delà. La forme de son eschatologie, cependant, rejoint toutes les autres formes de salut sous la forme du forfait. Le désir d'interrompre le cycle des réincarnations constitue en réalité le refus de soutenir l'épreuve de la différence et de s'évader d'un destin dont nous ne sommes pas les seuls maîtres.
2 - Spinoza : L'Ethique Collection Idée NRF 1970 page 146
Mardi 13 janvier 2004
L'horreur étatique.
L'aveuglement historique en est arrivé à un point critique. Aveuglement signifie ici éloignement de la ou des finalités fondamentales de l'existence de l'être humain. L'Oubli de l'Être, la formule de Heidegger, se traduit par une perversion totale du rôle des institutions sociales et en résumé celui de l'Etat. Cette perversion se présente comme un véritable renversement des finalités de ses fonctions, mais aussi comme une stérilisation absolue. L'Etat ne produit plus rien. Car il est censé produire, et non pas simplement gérer, gestion qui représente cette finalité perverse produit de l'inversion de ces finalités. Nous avons en fait réalisé l'Etat hégélien, c'est à dire l'instrument abstrait de la souveraineté, en réalité l'être lui-même descendu sur terre sous la forme de l'Histoire et dont la finalité réside dans le seul fait d'être. Assis sur la rationalité théologique, c'est à dire sur un fondement divin indiscutable, cet Etat règne sous n'importe quelle forme, c'est à dire dans n'importe quelle utopie qu'elle a fini par éterniser sous la forme particulière de l'économie libérale bourgeoise. L'idéal du libéralisme économique actuel n'est que la forme de cette impasse des relations humaines dans la forme de l'échange marchand, véritable abstraction vide de la relation d'altérité.
Alors en quel sens l'Etat est-il censé produire quelque chose ? On ne peut répondre à cette question que si on précise que cet Etat est ou doit être un Etat démocratique, ce qui n'est pas aujourd'hui contesté puisque la grande majorité des Etats mondiaux se sont définitivement, semble-t-il, placés sous cette forme politique. Comprenons-nous bien : aujourd'hui la notion d'Etat est étroitement liée à celle de Démocratie, et les états qui rejettent encore la forme démocratique se retrouvent pratiquement dans une situation d'exclusion, de bannissement et sous la menace d'intervention comme celle qui vient de frapper l'Irak. Or toute la problématique de la productivité ou de la créativité d'un Etat réside précisément dans sa forme démocratique, c'est à dire dans ce qui doit se concevoir comme une mécanique productive d'utopies en série. Nous l'avons déjà longuement expliqué ici, notamment dans notre commentaire sur Œdipe et dans ceux qui concernaient la démocratie athénienne, mais il faut y revenir sous une forme peut-être plus simple.
La Démocratie peut se concevoir comme un concours permanent entre des utopies qui se succèdent et dont le peuple juge la production par ses suffrages qui confirment ou rejettent le travail accompli. Comme l'Etat moderne a fini par s'identifier avec l'Etat divin, sous la forme de la prédominance absolue de la gestion économique, la seule utopie qui subsiste comme critère de la productivité de l'Etat s'appelle la croissance économique. C'est à peu près comme si on se contentait de juger le destin d'un individu sur sa capacité à grandir en laissant de côté tous les autres aspects de la vie. La croissance est devenu l'essence abstraite du progrès de l'humanité, alors que l'on ne connaît cette croissance que sous la forme de chiffres abstraits dont on ne mesure même pas le sens par rapport aux relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Par exemple si la croissance d'un pays est accentuée par la production massive d'armements qui ne font que servir à détruire une autre partie de la planète, on ne la distingue jamais d'une croissance qui repose sur la production de biens de consommation ou de biens culturels. Les chiffres exercent une dictature parfaitement aveugle.
Ce n'est pas un hasard, mais quand-même il est étrange que je m'attelle à une telle analyse au moment et au jour même où d'une part la Recherche Scientifique lance un ultime appel à l'Etat parce qu'elle est dans une situation dramatique, et que de l'autre les responsables de l'Education et de la Culture protestent de plus en plus violemment contre le sort que l'Etat chiraquien réserve à cette éducation et à cette culture. Nous avons pu constater en 2003 que le gouvernement de droite a excellemment résisté à tous les dangers qu'ont suscité des réformes économiques dures qui remettent en question bon nombre d'acquis sociaux comme la retraite ou les 35 heures. Comme si ces questions n'intéressaient pas réellement les citoyens. En revanche, le gouvernement n'a pas fini d'entendre parler du statut des intermittents du spectacle et des coupes claires dans les budgets de la culture ou de la recherche. Comme en Mai 68, l'entrée en fission du corps social prévisible n'aura pas pour cause déterminante la situation économique du pays, alors extrêmement prospère, mais bel et bien l'oubli terrifiant dans lequel se complaisent les décideurs actuels des soucis fondamentaux des citoyens.
Et pour cause. Alors que cette fission sociale devient de plus en plus prévisible, les commentaires vont bon train sur la ou les formes qu'elle va prendre, et on entend même le mot révolution, d'autant qu'on enregistre au plan politique une montée régulière des extrémismes dont la révolution était jadis le mot d'ordre. Parmi les commentaires que j'ai pu surprendre la semaine dernière, j'ai entendu rappeler le fameux éditorial de Pierre Viansson-Ponté dans Le Monde, quelques semaines avant Mai 68 et qui portait ce titre désormais historique : " La France s'ennuie ". Hé bien, la France semble être le pays européen où l'ennui métaphysique surgit le plus souvent et le plus régulièrement depuis toujours. Je dis métaphysique car il est impossible de qualifier autrement l'ennui dont parlait le journaliste du Monde. Parler de mélancolie ou de nostalgie ne changerait rien à l'affaire, car il faudrait encore qualifier chacune de ces pathologie psychosociologiques et on parviendrait au même résultat.
Nous parlerons donc d'ennui métaphysique. Il y a quelques pays dans notre occident qui ont participé au travail ou à la création métaphysique, c'est à dire qui ont mis au centre de leur intérêt la réflexion sur le sens de la vie. En fait toutes les sociétés humaines sont nées pour ainsi dire en vertu de cette réflexion, mais quelques-uns seulement comme la Grèce, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou encore la Hollande, ont poussé les feux de ce travail avec suffisamment de régularité et de force, il faudrait dire de la rigueur, pour atteindre enfin certaines limites de cette métaphysique. Ce qui est remarquable dans cette longue histoire, c'est la place et le rôle déterminant de la démocratie par rapport à ce résultat. Dans la Grèce antique, la qualité de cette démocratie fut à ce point parfaite que l'on atteignit presque d'emblée ce résultat, mais de même que la démocratie européenne fut longtemps menacée par toutes sortes de totalitarismes, de même les Grecs étaient-ils seuls au milieu d'un monde hostile à leur conception de la vie et à leur pratique politique. Au total, il se produisit donc un recul, voire une véritable occultation de ce résultat. On entra pour deux mille ans dans la religion de l'existence, c'est à dire dans une vie sociale dans laquelle ne comptait que le fait de rester ensemble, de souder les communautés par des croyances où l'imagination et les passions avaient plus de place que la raison. Lentement cependant, le principe démocratique ressurgit au cœur même des monarchies dont certaines sont encore vivante.
C'est dans une Grande Bretagne monarchique que renaquit par hasard le souci de la démocratie, hasard qui n'était rien d'autre que la volonté de faire vivre côte à côte plusieurs croyances religieuses qui s'étaient au cours du temps, détachées du tronc commun du Christianisme romain. Mais c'est en France, comme le dit si bien Marx, que le coq Gaulois entonna le véritable chant de la révolution démocratique pour tous les peuples. Ce chant séduisit d'un seul coup toute une nichée de penseurs allemands dont le travail fit avancer de pas de géants la réflexion métaphysique. De cette révolution française avait surgi une notion que ces penseurs d'une Germanie encore féodale mirent définitivement au centre de leur souci, la notion de liberté. Les Grecs ne s'étaient pas attardés sur cette notion pour une raison simple, c'est qu'ils étaient des hommes libres et ne pouvaient donc pas concevoir qu'il y eût sujet à discussion autour de cette idée, encore que les initiateurs de la démocratie, les Démocrites et les Epicures, avaient pris bien soin de placer cette liberté au fondement de leurs systèmes de pensée. Mais hélas, l'Allemagne n'en voulût point, de la liberté, et les idéalistes comme Kant, Hegel, Fichte ou Schelling qui s'étaient rués sur cette notion pour construire une véritable philosophie de l'existence, échouèrent tout près du but. De plus, l'absence de démocratie était si vive Outre-Rhin que cet échec se transforma en une véritable débâcle de la liberté qui dût à nouveau franchir le Rhin en sens inverse.
Là, dans une France en proie au bouillonnement politique mais où Napoléon avait codifié avec une habileté diabolique les pratiques sociales, inoculant en douceur le virus de la liberté sous les dehors de l'absolutisme le plus dur, la démocratie repris le dessus et avec elle le souci métaphysique. Ce siècle, à la fois éclairé et obscurci par le romantisme, vit naître le rationalisme et le personnalisme, deux philosophies qui se complétaient et donnait enfin à la liberté son vrai terrain, l'individu. Il fallût trois Républiques pour asseoir les institutions et consolider les fondations constitutionnelles de la démocratie, et à chaque suffrage une nouvelle utopie venait ajouter des idées destinées à apaiser définitivement la société française et à la sortir du cheminement aléatoire et biscornue qu'elle avait entrepris à partir de 1815. Je passe les ultimes et sanglants remous qui secouèrent cruellement l'Europe entre 1914 et 1945, mettant en danger de mort tout le travail accompli pendant ce siècle si fertile en rebondissement. Je les passe, sans oublier de noter que tout ce sang et toute cette violence produisirent un effet catastrophique pire que la disparition de la démocratie, ils faillirent mettre un terme à cette pensée si intimement liée à la démocratie. Il ne restait qu'un mince fil d'Ariane pour sauver l'objet de la démocratie, et ce faisant, la démocratie elle-même.
Martin Heidegger fut l'homme qui distingua ce fil au cœur même du pays où s'effondraient toutes les valeurs durement acquises. Il nous montra un chemin, qui, disait-il, ne menait nulle part sinon à l'origine, et la France se trouva être tout naturellement le terrain où l'écoute de son message trouva le plus d'écho. Moment dramatique où se rencontrèrent les plus éminents représentants du rationalisme français imbus d'idéalisme et de liberté pour fertiliser une démocratie renaissante qui avait perdu de vue son objet, la métaphysique. Jean-Paul Sartre éclaira pendant plusieurs décades un pays dominé par les soucis économiques et son passé d'empire, entraînant dans son utopie un grand homme comme le général De Gaulle, seulement beau-frère, dirais-je, de la décolonisation. Mais il ne survécu pas longtemps à cet échec apparent de la liberté en acte que représenta en 1968 la révolte des étudiants. Apparent, car la démocratie qui survécu à cette révolte dû tenir compte de ce que ce geste politique d'apparence antidémocratique pouvait vouloir signifier. L'Etat avait, à cette époque, déjà perdu la puissance de l'utopie, mais avait su écouter en tant que démocratie républicaine, la revendication de liberté qui se profilait dans les fumées de gaz lacrymogène. La France continua son chemin dans une nouvelle dimension morale d'où avait disparu des contraintes superflues et surtout un style d'existence qui avait fait son temps au-delà de ses propres limites.
Entre-temps la démocratie devient le jouet d'un phénomène ambivalent et dont la nouveauté est sujet de doute et de discussion sans fin, la mondialisation. Pour faire court, il suffit de dire que la mondialisation est un mot - masque. Ce mot recouvre une réalité terrifiante dans sa simplicité : l'utopie démocratique étouffée par le marché, ou bien le marché devenu l'utopie unique de la planète ! Vu ainsi, cela ne paraît pas d'une nouveauté extraordinaire, rien de scandaleux dans cette victoire finale du capitalisme que personne, même pas Attac, ne remet en cause. Mais vu de l'angle de la liberté des utopies dans la démocratie, on reste atterré face à ce Monopoly infernal. Les Grecs pensaient la démocratie comme le moyen de donner à chacun sa chance de répondre à la question de l'Être, d'apporter sa vision de l'être-là humain, quitte à se tromper, quitte à se ridiculiser, quitte même à faire des dégâts. La liberté de penser, de représenter et d'exprimer est l'âme de la démocratie. Cette dernière n'est pas la liberté de réglementer le marché pour ou contre la pauvreté, la pauvreté ne gisant pas là où on la trouve aujourd'hui. Oui, c'est une étrange coïncidence que d'avoir passé la matinée à entendre parler de la crise de la Recherche et de la Culture, crise dont l'opinion se fout apparemment totalement, mais je dis bien apparemment, car les mois qui viennent vont nous réserver bien des surprises. L'intermittence du spectacle risque bien de se muer en intermittence du pouvoir politique. Il serait temps.
Samedi 17 janvier 2004
La pauvreté.
Être pauvre c'est ne rien avoir, être en manque d'avoir. Un manque d'avoir met en danger l'Être lorsqu'il affecte les nécessités fondamentales de la vie. Mais peut-on réellement dire une telle chose ? L'extrême pauvreté peut mettre en danger UN être, certes, mais que signifie UN être ? UN être est une expression religieuse, la rescendance du terme Être à la dimension de l'individu, c'est à dire la descente du transcendant de l'Être à la hauteur de l'étant individuel. Mais en toute rigueur on ne peut pas se servir de cette expression sans courir le risque de substantiver ce qui demeure absolument un verbe et de surcroît un verbe conjugué à l'infinitif. La rescendance n'est pas ici conçue comme un simple abaissement mais bien comme un changement d'essence, de nature. Cette rescendance est en fait une tricherie linguistique car l'expression " un être " n'a littéralement pas de sens et toute l'histoire de la philosophie pourrait se représenter comme le débat entre le concept d'être comme unité d'une espèce et le concept d'individu.
La pauvreté n'implique pas seulement un manque, elle va avec l'inégalité puisqu'il ne peut exister de pauvreté sans richesse. La pauvreté est logiquement liée à la richesse comme son opposé. C'est pourquoi il est fondamental de ne pas dire " un être est pauvre ", mais de s'en tenir à un individu ou à une classe d'individus. Stricto sensu donc, on ne peut pas dire qu'un être est pauvre, car l'être même de l'individu se confond nécessairement avec l'Être lui-même, c'est à dire avec tout à fait autre chose que la réalité individuée, en fait avec son contraire, l'UN. C'est donc à l'intérieur de l'Être que se joue un déséquilibre entre pauvreté et richesse : l'Être se distribue entre pauvreté et richesse. Mais comment cela ? Pour répondre à cette question, on peut se servir de la notion de persistance dans l'Être, et affirmer que la pauvreté consiste en un affaiblissement dans ce que Spinoza appelle le conatus, à savoir la puissance ou le désir de persister dans l'Être. La richesse au contraire, serait alors le pouvoir abstrait de se défaire du souci de persister dans l'Être.
Mais que signifie à son tour l'idée de la persistance dans l'Être ? A raz de terre, persister dans l'Être peut signifier simplement vivre, rester un être vivant au lieu de rejoindre la matière par dissolution relative à la mort. Mais comme nous l'avons vu, on ne peut pas parler d'être vivant, il faut vraiment mettre un terme à cet abus de langage et dire " rester un individu vivant ", c'est à dire une partie vivante de l'Être. Mais alors qu'est-ce qui fait la richesse ou la pauvreté par rapport à l'Être ? La puissance du conatus n'est-elle rien d'autre que par exemple la bonne santé ou la fortune ? Être en bonne santé ou être possesseur de biens sont-ils des conditions absolues de l'efficacité du conatus, du désir de persister dans l'Être ? Cela paraît évident, sauf à constater que personne ne sait de quoi il parle lorsqu'il dit " persister dans l'Être " puisque nous avons vu qu'il n'y a pas de relations entre l'individu et l'Être qui indique que la mort de l'individu impliquerait la mort de l'Être. La mort de l'individu ne met pas fin à l'Être, mais à la participation sous une certaine forme, la forme vivante, à l'Être de celui qui passe. Il faudrait, en effet, dire plus exactement une transformation de la forme de participation à l'Être puisque l'individu décédé conserve une certaine forme qui ne cesse de se transformer par la décomposition et la transformation des composantes du corps. Car la disparition ou la mort n'est pas une néantisation de l'individu, même si on le brûle, mais une transformation de son être à l'Être, un changement de sa forme qui demeure malgré tout une partie de ce qui existe. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres et nous-mêmes à un certain degré, respectons le corps et l'accompagnons dans la mort et n'admettons pas une pure et simple disparition. A la richesse ou à la pauvreté appartient donc aussi le pouvoir de faire durer l'appartenance du corps mort à l'Être.
Ainsi on sort progressivement de l'acception banale de la pauvreté ou de la richesse puisqu'elle peut aussi bien concerner un mort qu'un vivant. Bien sûr, le désir de conserver à l'individu mort une participation plus ou moins ostensible à l'Être - la monumentalité des cimetières mesure cette ostension - est un désir qui n'appartient plus à l'individu passé, mais à ceux qui gèrent son cadavre, encore que ce dernier prépare souvent lui-même son séjour parmi les morts et que sa pauvreté ou sa richesse peuvent déterminer cette ostension, et ainsi révéler la part de croyance de l'individu à la nécessité de rester présent sous cette forme pour une raison ou une autre. On pourrait peut-être avancer l'idée que toute la civilisation égyptienne s'est construite sur le désir de richesse, mais d'une richesse destinée à investir le royaume des morts : un pharaon devait s'enrichir afin de préparer son séjour dans ce royaume. Jacques Attali affirme quelque part que toute cette civilisation était centrée sur ce souci fondamental, non pas de vivre dans l'ostension vivante, mais dans l'ostension du mort, dans la célébration de la forme ultime que les Egyptiens riches pouvaient ou pensaient pouvoir donner au corps mort. Mais de cette manière, il apparaît que l'on ne mourrait pour ainsi dire pas, que le corps mort continuait non seulement d'appartenir à l'Être, comme nous le disions plus haut, mais au contraire atteignait enfin la vraie forme de l'appartenance à l'Être, la forme éternelle et intangible. Illusion que l'histoire dissipera tristement et dans un malaise que la science refoulera sans la comprendre.
Hölderlin écrit dans l'un de ses fragments énigmatiques ceci : " Pour ce qui nous concerne, (bei uns) tout ce concentre autour du spirituel, nous sommes devenus pauvres afin de nous enrichir. (um reich zu werden) "(1). Pour le poète allemand c'est donc l'Esprit qui donne la mesure de la richesse et de la pauvreté puisque pour nous, les hommes vivants, c'est l'Esprit qui représente le souci principal. Reste donc à déterminer ce qu'est ce spirituel dont il parle et vers quoi nous avons aujourd'hui tenté de mener le lecteur par une analyse très sommaire, mais qui montre que la pauvreté n'est pas un phénomène qui appartient exclusivement au vivant, mais concerne aussi le mort, l'inerte et ce qui advient bien après que la richesse ou la pauvreté ait déterminé l'individu de son vivant . L'Être tel que nous en parlons a donc bien à voir avec l'Esprit, et cette relation est le sujet principal de ma méditation. Le texte cité en note m'a été prêté par un ami et je n'ai fait que le parcourir pour en évaluer toutes les difficultés, et elles sont immenses. J'ai donc décidé de prendre le thème de la pauvreté à bras le corps avant-même d'avoir bien compris l'intention de Martin Heidegger elle-même. Cette chronique n'est donc que la toute première partie de cette analyse qui me permettra à la fois d'enrichir ma méditation ontologique et de préciser mes positions par rapport à Heidegger.
Notes
1 - Cité par Martin Heidegger dans un texte inédit intitulé " La Pauvreté " et sur lequel nous reviendrons très bientôt. Cette traduction rapide du texte de Hölderlin est de nous. Nous tâcherons de l'améliorer dans un futur proche
Jeudi 22 janvier 2004
L'ETRANGE SUCCES DE ON E ON.
Depuis le 7 janvier de cette année, nos statistiques explosent et la moyenne du nombre de visiteurs se situe désormais chaque jour autour de 250, celui du nombre de pages vues dépasse les 400 et les chiffres sont en constante et quotidienne augmentation. Depuis sa création en 1996, ce site a connu une moyenne de fréquentation d'environ 20 visites par jour, ce dont j'avais toutes les raisons de me féliciter en raison de l'aridité des thèmes et la difficulté de lecture que propose On e On. En l'an 2000, On e On a été radicalement transformé par le talent de Martine dont le site est relié au mien et nous avons adopté un système d'observation statistique plus précis. La moyenne de fréquentation s'est établi alors autour de 30 visiteurs par jour, ce qui m'apparaissait comme un progrès substantiel. Les résultats que nous enregistrons donc depuis la date mentionnée plus haut nous étonnent donc au plus haut point, d'autant que nous n'avons procédé à aucune campagne publicitaire, moyen facile de se procurer des illusions sur la nature réelle du succès d'un site Internet.
Ces résultats sont pour nous l'occasion de rappeler les principes de On e On. Notre site est un site totalement libre : non seulement nous nous arrogeons une totale liberté de pensée et d'expression, dans les limites de la décence et du respect des Droits de l'Homme, mais nous accordons en retour le droit d'expression à qui le demande, dans les mêmes conditions. A ce sujet nous remarquons que l'augmentation vertigineuse de nos chiffres de fréquentation n'entraîne que très peu de dialogue, et nous le regrettons d'autant plus que On e On est désormais devenu une tribune qui possède un véritable lectorat. Le deuxième principe de notre site est la totale gratuité de son utilisation, principe qui repose sur l'idée fermement défendue d'une impossibilité morale de donner un prix à la pensée ou de faire payer un produit culturel qui ne veut dépendre d'aucune condition financière ou publicitaire. Le copyright est pour nous un hold-up moral sur l'Être qui, lui, ne demande rien pour nous donner la conscience et la vie.
Il est vrai que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur l'avenir, et ce qui nous arrive en ce moment nous prouve que On e On possède un tel avenir, et, même si ce n'est en aucun cas notre souhait ni le but de notre stratégie, un avenir de croissance. Or, pour l'instant Wanadoo nous offre gratuitement un espace de 100 Mb pour un site qui approche les 60 Mb et dont les ambitions sont grandes dans le domaine du multimédia. Ce cadeau va donc s'avérer rapidement très insuffisant et nous allons nous trouver dans l'obligation de louer de l'espace, ce que nos revenus modestes ne nous permettent pas. Nous caressons par ailleurs le projet de faire traduire On e On en Anglais, opération coûteuse et hors de notre portée. Je rappelle que Martine Meyer, que je viens d'épouser, est institutrice, et moi-même journaliste au chômage. C'est la raison pour laquelle nous avons installé depuis un an une fenêtre publicitaire dont chaque clic enregistre à notre actif la somme fabuleuse de 0,07 Euro. Nous avons pris toutes les précautions afin que cette fenêtre ne conduise pas à des sites condamnables pour une raison ou une autre. Notre peu de goût pour la pornographie nous a même conduit à refuser cette manne facile et juteuse.
Je conclurai cette chronique particulière en commençant par remercier tous ceux qui, en provenance de tous les pays francophones et même de contrées où l'on ne parle pas le Français, viennent fidèlement nous rendre visite en les invitant à se manifester davantage quelle que soit l'opinion qu'ils nourrissent à l'égard de notre site. Nous apprécions les critiques et détestons les flatteries ou les félicitations car le sens de On e On est d'enrichir la pensée et la culture de notre monde, un monde qui semble demander grâce face à son exploitation aveugle et anarchique. Votre aide et vos critiques ne pourraient donc que renforcer cet enrichissement et donner à On e On une dimension de dialogue qui lui manque. Dans cette perspective nous allons bientôt créer un Forum où un tel dialogue pourra s'installer, si le succès de notre site s'avère être autre chose qu'un feu de paille. Il va de soi qu'un tel projet ne sera possible que si nous parvenons à le financer, un forum étant par définition destiné à prendre rapidement beaucoup de cet espace Internet dont nous allons très rapidement avoir besoin. Nous nous permettons donc de vous rappeler qu'en passant sur On e On n'oubliez pas de cliquer au bon endroit, les petits ruisseaux font les grands fleuves, et On e On ne veut pas mourir asphyxié.
Martine Meyer et Paul Kobisch
Mardi 27 janvier 2004
Seulement un mot pour confirmer le trend ascendant de On e On. Aujourd'hui la moyenne est passée à 500 pages consultées et plus de 300 visiteurs quotidiens. Le mystère s'épaissit. Merci de nous renseigner sur ce qui vous a mis sur la piste de notre site.
Jeudi 29 janvier 2004
BLAIR - HUTTON : l'arrivée de Big Brother.
Je n'en crois ni mes yeux ni mes oreilles et pour la première fois je suis pris d'une mortelle inquiétude. Hier soir la BBC était le foyer d'un cyclone jamais vu dans ce pays dont on vante tant le caractère débonnairement et scrupuleusement démocratique : un Lord, désigné par le gouvernement vient de blanchir ce dernier aux dépens d'une institution considérée comme sacrée, non seulement en Grande Bretagne, mais dans le monde entier. La BBC avait résisté aux attaques furieuses de Madame Thatcher, et elle risque aujourd'hui de tomber sous la vindicte d'un Premier Ministre travailliste !! J'en reste comme deux ronds de flan, bien que je ne me sois pas fait d'illusion sur l'issue de cette pseudo-enquête menée par un féodal de haut rang, un seigneur qui n'a de compte à rendre à personne, sans mandat légal ou constitutionnel, l'une de ces preuves, s'il en fallait, que le Royaume Uni n'est pas une démocratie, mais une véritable monarchie où en dernier ressort ce sont les Pairs qui décident et non pas les électeurs. Qui va me contredire ?
Mais à Downing Street on s'en fout : on a gagné comme au foot. Après le soit-disant suicide du savant David Kelly, Tony Blair avait chargé l'un de ces Pairs du Royaume, dont on avait au préalable fait une publicité intense sur ses qualités de probité et d'objectivité (à l'anglaise), d'enquêter sur les causes de ce suicide. Hier Lord Hutton a rendu son verdict sans le rendre. Il condamne en effet la BBC pour de multiples manquements à la déontologie du journalisme, sans oser la mettre en cause dans la mort du savant. Cette mort, de même que le sujet fondamental de toute l'histoire, à savoir les justifications de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne passent à l'as : le rapport s'acharne exclusivement sur le fonctionnement (sic) de la plus prestigieuse entreprise de presse du monde. Fonctionnement ! Vous vous rendez compte ? Mais que vise-t-on lorsqu'on accuse le " fonctionnement " ? Une seule chose : la chasse au sorcière, c'est à dire à se débarrasser des hommes qui ont couvert ce " fonctionnement ". Le ménage a été si bien et si vite fait que ce matin déjà, le plateau de la World-BBC se partageait déjà entre deux journalistes dont celle que nous connaissons tous depuis longtemps et une nouvelle, scrutée avec inquiétude par la première. Bref, les balais, eux, fonctionnent déjà, et on peut supposer, à moins d'une crise politique d'envergure, qu'ils fonctionneront jusqu'à plus soif. L'opposition, qui désormais concerne aussi bien les amis travaillistes que les autres et qui se définira désormais comme " ceux qui se révoltent contre la décision britannique d'entrer en guerre contre l'Irak " va perdre, au moins dans le plus grand vecteur médiatique du Commonwealth le droit à la parole. On a déjà pu sentir ce mutisme hier soir, malgré l'intervention courageuse de quelques personnalités lucides.
Il faut bien comprendre ce qui vient de se passer de l'autre côté de la Manche. Un journaliste de la BBC avait pris contact avec le savant physicien qui avait dirigé pendant plusieurs années une équipe qui a enquêté sur la présence en Irak d'armes de destruction massive. Ce Monsieur, le Dr David Kelly, dont nous parlions plus haut au passé puisqu'il aurait mis fin à ses jours (je note en passant que tous les journalistes qui en ont parlé hier soir, on tous utilisé le conditionnel : qui se serait suicidé, ce qui comprend une lourde charge de soupçon sur la vérité de sa mort), aurait déclaré à ce journaliste, Andrew Gilligan, que le gouvernement avait, comme ils disent " sexed up " le rapport des services secrets afin de convaincre la Chambre des Députés de l'urgence et de la véritable légitimité d'une attaque immédiate de l'Irak. Au centre de l'argumentation du savant, le fait que Tony Blair avait déclaré devant les Représentants que Saddam Hussein était en mesure d'agresser le monde occidental avec des armes chimiques en moins de quarante-cinq minutes.
Alors comment est-il possible, maintenant que l'on sait que cette menace était un pur mensonge destiné à l'opinion mondiale, d'attaquer un journaliste et son entreprise sur le fait qu'il ait révélé la conviction objective de ce savant ? De la manière suivante : on se fout de la vérité ou de la non-vérité du casus belli, ce qui importe est de savoir si monsieur Tony Blair était ou non de bonne foi lorsqu'il a fait toutes ces fausses prévisions et affirmations sur la puissance de Saddam Hussein. C'est incroyable, le rapport Hutton, la décision régalienne de ce féodal aux ordres de la Reine, stigmatise le journaliste et son entreprise pour avoir laissé entendre que le Premier Ministre aurait menti, alors qu'il a été clairement établi que son chargé de communication, un certain Campbell, avait rédigé le texte lu à la Chambre en choisissant les termes les plus inquiétants, fort éloignés du contenu réel des rapports des services, le mensonge lui-même, quoi. Tony Blair a donc pris sur lui de présenter ce rapport gélatineux et borderline, comme on dit là-bas, afin de semer la panique dans son propre pays et le mener vers la décision de guerre dont on connaît désormais le déroulement ridicule ainsi que la fausseté absolue des causes invoquées. D'ailleurs si les Français, les Allemands et les Russes ont refusé leur concours, c'est seulement parce que leurs services secrets savaient parfaitement la vérité sur les armes de destruction massive, aussi bien que les services américains ou britanniques. Ce dont il est donc question ici, c'est de la justification de la complicité du gouvernement Blair avec celui de Georges W. Bush, et de rien d'autre. La BBC, pendant toute la durée du conflit, jusqu'à cette date fatale du 28 janvier 2004, a régulièrement rendu compte du décalage entre les faits et la réalité : voilà ce que le gouvernement Blair n'a pas pu supporter, d'autant qu'en Amérique le même scénario se déroule à propos du casus belli et qu'une Commission ad-hoc est en train de régler son compte à Bush lui-même.
Nous voici donc dans les deux pays à un tournant destinal : la Commission Kay aura-t-elle la force et le pouvoir d'aller aussi loin que la commission qui naguère avait décidé de l'Impeachment de Nixon, Lord Hutton et son rapport suffiront-t-ils à mettre à genou le colosse BBC ? Je me souviens d'avoir déjà critiqué vertement dans un texte précédant, l'existence ou la persistance de l'existence de la Chambre des Lords comme vestige intolérable du Moyen-Âge inquisitorial. Un Britannique m'avait répondu avec arrogance que j'étais un petit Français qui ne comprenait rien à l'histoire symbolique de son pays et que j'aurais dû savoir que cette Chambre des Lords n'était plus qu'une décoration historique et un joyaux original de la Tradition de l'Angleterre. Bravo pour la valeur symbolique d'un personnel politique qui liquide en quelques centaines de page une entreprise de presse admirée par le monde entier. Cette remarque nous aide à comprendre aussi ceci : Blair est aux abois pour oser réveiller ainsi un tableau de maître qui aurait dû rester ce joyaux de la Tradition et ne jamais revenir sur le terrain de l'action politique. Preuve insigne donc de faiblesse, preuve dont j'espère que les autres médias, également visés par la catastrophe qui vient d'avoir lieu, vont abondamment faire l'analyse.
J'ai vu hier soir et ce matin à la BBC le principal coupable de toute cette gabegie, à savoir le Chargé de Communication Allistair Campbell, qui avait démissionné de son poste au moment du scandale Kelly. Atterrant d'arrogance et d'agressivité, ce robot de la politique qui prétend avoir été journaliste, en rajoute des louches contre la BBC et bave de volonté de vengeance. Autre signe que la situation demeure dangereuse pour tout le monde, et surtout pour Blair. Je n'ai donc pas lieu, peut-être, d'alimenter ainsi mon inquiétude, mais un je ne sais quoi de totalement irrationnel, aussi irrationnel que ce qui vient de se passer à Londres, me dit que j'ai tort de sous-estimer la puissance de feu d'un clan décidé à en découdre avec la démocratie à n'importe quel prix. Ce qui se passe me convainc aussi que loin d'une auto-critique sur la décision de guerre, les gouvernements américains et britanniques sont bien décidés à pousser leurs misérables pions jusqu'au bout. Toutes mes prévisions vont donc se confirmer : l'Europe va s'isoler dans un protectionnisme de plus en plus fructueux pour elle-même et la scission entre le monde Anglo-Saxon et l'occident latin, germanique et russo-orthodoxe va s'approfondir aux dépens du premier, engagé dans une spirale terrifiante de guerres civiles dont il a déjà parsemé le monde musulman, et bientôt le monde extrême-oriental. Le bon Chirac, passez moi cette expression paradoxale, a vite compris qu'il fallait foncer dans la faille et prendre un numéro d'attente devant les bureaux du futur gouvernement Hussein, à Pékin. Question : reste-t-il une chance pour que les élections en Amérique changent la face sinistre de cet avenir ? Merci d'avance à celui qui nous donnera une réponse.
Samedi 31 janvier 2004
Le Moi de la prière.
Je cherchais depuis plusieurs jours un moyen de parler de moi. Difficile de parler de soi, vous ne pouvez pas vous imaginer, sauf à en avoir fait l'expérience littéraire, comme le moi est inextricable, comme il est quasiment impossible de repérer quelque chose comme un noyau stable de soi, un ensemble de catégories ou de qualités qui identifient résolument et sans conteste la personne que l'on est, mais pire encore la personne telle que l'on apparaît aux autres. Et voici l'occasion offerte sur un plateau par Michel Cazenave, alias Cazenaze, le mystique à la voix de velours endeuillée qui, le samedi matin prétend nous parler de l'Être. En effet, ce matin il a choisi de parler du phénomène de la prière. Prière, je ne sais pas comment en parler autrement que d'un phénomène, sinon d'un acte ou d'un rituel, mais ce que j'ai retenu avant de couper la radio et de me mettre à écrire ce texte, c'est l'affirmation massivement jetée sur les ondes d'une " nécessité " propre à l'homme de prier. Je ne veux pas en entendre davantage, et pour la bonne raison que je ne connais rien de tel qu'une " nécessité " de prier.
Voilà donc un bon angle d'aperception de moi-même : je suis un être, un individu qui n'a jamais subi ou souffert ou encore seulement perçu la nécessité de prier. Enfant, la prière était un devoir, que dis-je, une obligation reçue de l'extérieur : il fallait prier sans même savoir ce que signifiait cet acte absurde qui n'avait aucun interlocuteur visible, aucun objet, aucune motivation autre que le commandement insolemment imposé à l'enfant que j'étais. Au plus fort de ma Foi, car je reconnais ici même être passé par une phase mystique, où le thème de la pureté avait trouvé quelque chose comme un espace psychique en moi, ce qu'on appelle l'âme. Jusque-là mon âme était un fantasme importé par le langage familial et religieux, et pendant la brève période où j'ai pour ainsi dire communié avec l'Esprit religieux, il me semble qu'en fait je découvrais mon propre esprit, sous la forme du mot âme. Ce qui me permet d'ailleurs aujourd'hui d'en user sans le renier et même de considérer ce mot comme l'un des plus beaux de tout le vocabulaire humain. Une remarque cependant, le mot âme me paraît merveilleux en Français, au contraire du mot anima, son origine latine, ou encore son ancêtre grec psychè, sonorités différentes cependant du mot allemand die Seele, dont la forme se rapproche étrangement du signifiant français âme.
Or cette âme n'a jamais fait l'expérience du besoin de la prière. Je n'ai jamais compris la prière de mon point de vue, c'est à dire du point de vue de ma sensibilité, de mon désir ou de ma passion. D'ailleurs la logique du rite catholique aurait plutôt comme conséquence logique de considérer la prière comme une punition, comme faisant partie du châtiment qu'exige le péché. Chaque confession est suivie, quelle que soit la gravité des fautes avouées, par l'obligation d'effectuer des litanies plus ou moins longues d'Ave et de Pater, formes parfaites de la prière. Je ne parle même pas des contenus de ces prières, qui, pour n'avoir pratiquement jamais varié depuis l'Antiquité, c'est à dire une époque où une partie de la société chrétienne, les clercs, considéraient l'autre partie, les laïcs, comme de quasi idiots, manquant des plus élémentaires connaissances doctrinales ou théologiques et qu'il fallait donc dresser à l'instar de robots, exactement comme on m'a élevé lorsque j'étais enfant. Souvent il m'arrive encore de franchement rigoler en évoquant la suite de mot de l'Ave dont je ne comprenais strictement rien : " le fruit de vos entrailles " était pour moi un pur signifiant magique, une formule aussi vide de sens qu'un abracadabra de magie noire.
Cette absence de besoin de prière me paraît tout à fait logique, dans la mesure où le religieux fonctionne dans un cercle vicieux. Il devrait, en effet, partir de la révélation de l'existence de Dieu et donc pour ainsi dire imposer naturellement la prière comme si Dieu était l'équivalent du père biologique, alors que l'Eglise Catholique prétend imposer la prière comme parvis de la Foi, c'est à dire comme moyen de parvenir à la croyance en Dieu. Les prières courantes ne sont d'ailleurs en général que des affirmations vides d'une telle croyance, ou une réaffirmation, comme si le rite était destiné à confirmer ou à entretenir une conviction et non pas à demander quelque chose à quelqu'un. Or, prier c'est avant tout demander, à moins que je n'ai rien compris de ma propre langue. Alors nous nous trouvons devant une sorte de fouillis de significations diverses de la prière qui en font n'importe quoi, pourvu que l'on prie. Et je crois que c'est ce que les musulmans ou les religions d'extrême - orient ont fort bien compris, le rite de l'égrènement des chapelets de toutes sortes ne prétendant à rien d'autre qu'à une gestuelle rituelle vide de sens, seulement la preuve d'une attention portée au spirituel au milieu des autres actes de la vie quotidienne. C'est ainsi que l'on peut voir des Arabes confortablement installés sur une terrasse de café, discutant des dernières nouvelles ou même lisant un journal tout en égrenant leur chapelet de petites boules d'ambre ou de je ne sais quoi. Comme les moines tibétains font tourner leurs crécelles, résidu d'un ancien rite de protection contre les esprits mauvais que le bruit des crécelles est censé maintenir à distance. Les rhombes africaines doivent avoir un sens comparables auquel on ajoute la fonction d'effrayer les jeunes initiés en leur faisant croire qu'il s'agit du bruit terrifiant des esprits eux-mêmes.
Partir de l'absence d'un besoin de prière, affirmé de manière si arrogante, me paraît donc être un bon point de départ pour parler de moi, car je pense que derrière cette absence se profilent d'autres attitudes et d'autres qualités ou attributs psychiques qui me sont propres. Mais avant d'en arriver à ces attributs mystérieux et si difficiles à déceler, il faut tenter de qualifier, en parlant des autres, les finalités de la prière, le but de cette activité dont je n'éprouve aucun besoin : il s'agit bien d'un besoin qui me fait défaut, or le besoin est quand-même une qualité où un registre psychique fondamental. J'ai aussi des besoins, encore que cette manière de m'exprimer me pose pas mal de problèmes, nous y reviendrons. Mais oui, j'ai besoin de boire, de manger, de soigner mes douleurs, et à ce sujet, j'avoue que depuis de nombreuses années, ce besoin particulier qui consiste à me tenir à distance de la douleur le plus possible, a pris le dessus sur la plupart des autres besoins tout simplement parce que depuis mon enfance la douleur physique est l'une des données majeures de ma vie psychique. Au point d'avoir relégué au second plan la plupart des autres besoins naturellement attribués à l'animal humain : je n'ai pratiquement plus aucune ambition proprement gastronomique, mes besoins sexuels ont disparu depuis longtemps en tant que besoin et depuis plusieurs décennies ma libido souffre davantage de sa satisfaction que d'un manque éventuel. Je dois préciser à ce sujet que je n'ai jamais considéré le sexe comme un besoin, je dirais même plutôt ressenti comme tel. Longtemps le sexe a été la souffrance de mon adolescence, souffrance comme manque et comme compensation à un amour ou à une pureté impossible. Par la suite il est devenu une obligation conventionnelle de la vie de couple.
A ce sujet, et puisque nous sommes dans le besoin, je dois dire que le seul besoin repérable qui m'apparaît comme propre, sans pour autant prétendre qu'il me soit singulier, est celui de ne pas vivre seul, et également, à une certaine époque, il me paraissait évident comme conséquence de mon existence, de transmettre la vie à des enfants. J'avais pourtant des milliers de raisons intellectuelles, politiques et littéraires de nature à remettre en question la procréation, or jamais je n'ai envisagé de quitter cette vie sans l'avoir transmise à des enfants. Dont acte. Je n'ai nullement l'intention de ratiociner à ce sujet ni de cherche à justifier ce besoin particulier, encore que je n'ai jamais vécu cela comme un besoin mais plutôt comme une étape naturelle de mon existence (à une époque, d'ailleurs, où mon existence m'apparaissait encore comme nécessairement rythmée par des étapes, les étapes que je voyais franchies autour de moi par ma parentèle ; aujourd'hui il n'en va plus de même au sens où ce rythme a disparu comme structure de la perspective ou de l'avenir, la vieillesse n'expliquant pas tout de cette disparition, mais plutôt la décomposition du monde qui m'entoure et qui a lui-même renoncé à tout rythme et à tout rite au profit d'un fonctionnement mécanique et commercial). Je dois aussi ajouter que la naissance et la croissance de mes deux enfants aura été pour moi l'un de mes rares bonheurs sans phrases, une joie sans mélange, même si l'angoisse - et là je me trouve dans un paradoxe extraordinaire et qu'il faudrait que je médite longuement - est demeurée une autre dimension de ma relation à mes enfants. La vie m'a donné, en gros, deux choses qui se ressemblent et qui forment une sorte de récompense sans prix pour toutes les souffrances qu'elle constitue principalement, ce sont ces deux enfants et le monde lui-même. La simple perception du monde me donne une joie intense, et plus l'âge s'abat sur moi, plus cette joie est limpide, simplement là et me fait penser au dernier regard qu'il me sera, un jour, donné de porter sur ce qui m'entoure, ce qui m'entourera ce jour-là. Et donc de l'immense curiosité de connaître la suite.
Pas besoin de prière. Pas besoin parce que pas d'intelligence de la chose. Je ne comprends pas du tout le sens de la prière pour autant que je n'attends rien de rien. Vous allez me dire que si l'un de mes enfants tombait brutalement malade, je me mettrai à prier pour son salut ? Certainement pas. Pour deux raisons : la première étant que je ne saurais pas qui prier, sauf peut-être les médecins, la seconde étant que bien loin de me disposer de manière passive par rapport à la maladie éventuelle de mon enfant, je me joindrai de toutes mes forces à son combat pour la guérison, sans passer par un appel à un fatum quelconque. Alors se pose néanmoins une question quant à ce supposé " besoin " de prière. D'une certaine manière, la prière peut s'identifier à un rite. La prière des Juifs, par exemple, acte qui s'accompagne de toute une série d'actions précises et réglementées, est en fait le commencement de la Kashrout quotidienne, c'est à dire du déroulement rituel du temps juif selon la Alaha, c'est à dire l'ensemble des lois qui forme l'existence " kasher ". Je dis juif, mais je pourrais, en certains cas, parler du rite bouddhique, tibétains, voire tout simplement chrétien ou protestant, avec cette nuance que le rite juif n'admet aucune liberté. Cela ne signifie nullement que le Juif n'est pas libre, mais cela signifie qu'il n'est pas libre par rapport aux rites, et que la Kashrout, c'est à dire l'ensemble de l'observance stricte des lois, est une sorte de cadre rituel vide mais absolument nécessaire au maintien de l'identité juive. Le peuple juif ne se reconnaît que dans le cadre rituélique de la Kashrout, même si, comme dans toutes les religions, il existe des variantes d'intensité dans l'observance des lois. L'un des phénomènes les plus curieux aujourd'hui, est la querelle quasi universelle qui opposent les membres d'une même famille juive, querelle dont l'origine est à rechercher dans le rajeunissement de la piété lié aux événements qui ont marqué le destin des Juifs depuis un siècle. Il est de plus en plus fréquent que des enfants d'une famille de Juifs dits " assimilés ", c'est à dire de Juifs qui ne respectent plus que le stricte minimum de la Kashrout, un peu comme les Chrétiens d'aujourd'hui se contentent d'aller à la messe de Pâques, se dressent contre leur famille pour les contraindre à reprendre le chemin de la stricte observance. Dans l'Islam se produit le même phénomène, l'intifada étant une illustration du fait que ce sont les jeunes qui reprennent le flambeau d'un Jihad fantasmatique, les anciens s'étant depuis longtemps assoupis dans un vie profane et occidentalisée. D'où l'imbécillité de l'affirmation selon laquelle ce sont les parents qui envoient de force les enfants comme bouclier. Mais ces réactions me paraissent de nature strictement historiques et donc passagères, le trend ou la tendance générale demeurant celle des parents, peu soucieux de rituel et davantage tourné vers la gestion matérielle de l'existence.
Pas besoin de prière, pas besoin de rites ? Je ne le pense pas, et une grande part de la souffrance qui obère mon existence provient précisément d'une absence de rites liée à la disparition de la foi. Car il faut bien comprendre que la ritualisation de l'existence fonctionne comme une régulation dont le bienfait est permanent : le rite indique en permanence la direction à suivre. Une existence parfaitement ritualisée est une existence parfaitement rythmée, c'est à dire dont les césures sont calculées sur une base expérimentale extrêmement vaste, ancienne et efficace. Une journée rituellement accomplie se présente comme un abri tout fait : la temporalité s'inscrit dans le rite comme sens certes vide, mais comme sens et direction. L'accomplissement scrupuleux des lois, ritualisées et sans cesse commentée par rapport au présent (c'est ce que fait le Talmud), représente un champ existentiel presque parfait, dépourvu de toute angoisse au sens où il donne réponse à tout, où il répond de tout. Mon problème personnel n'est pas que je me sois obstinément refusé à tout rite, mais que le rite auquel j'appartenais pour ainsi dire biologiquement, était déjà à ma naissance en voie de décomposition. En tant que dégradation du Judaïsme, le catholicisme avait déjà perdu une grande partie de la force des pratiques talmudiques et on peut gager que les querelles internes à la Chrétienté ont pour cause l'imprécision crasse dans laquelle la théologie des Pères de l'Eglise a laissé le rite. Même l'Eglise Orthodoxe s'en sort mieux parce qu'elle a compris d'emblée l'importance du rite ou sa prééminence sur le rôle qu'elle pourrait exercer dans la vie sociale et politique.
Tout le reste me paraît secondaire. Beaucoup de ceux qui me connaissent se sont laissés leurrer par mon histoire, histoire qui peut bien me faire passer pour un aventurier. Or, je ne suis ou n'ai été un aventurier qu'à mon corps défendant. J'ai en quelque sorte précédé les conséquences prévisibles de la destruction ou de la déconstruction du Rite occidental et de sa transformation rationaliste : car le rite, en occident, s'est transformé dès l'aube en catégories logiques, catégories que seul Spinoza a su rendre à leurs dimensions rituéliques en parvenant à transférer l'ensemble de la nécessité rituelle dans celle d'une morale qui ne dépend jamais d'une réalité cléricale mais d'une place que chaque existence occupe en Dieu, le Dieu de Spinoza. La morale de Spinoza fonctionne exactement comme une Kashrout dont l'objectif n'est pas un bonheur illusoire dans un monde de l'au-delà, mais bien l'absence des souffrances intolérables qu'offre le monde vécu dans l'ignorance et dans le vice. Aucune morale, sauf peut-être celle de certains idéalistes français du Dix-Neuvième siècle, n'a plus atteint, après Spinoza, ce degré d'efficacité qui fait que tous les philosophes s'en sont abondamment nourris en payant rarement sinon jamais leur dette à son égard. Or, et j'y reviendrai dans une chronique ultérieur, l'absence de base rituélique me jeta dans un désarroi décisif d'où il me devint à la fois impossible de distinguer pour guider mes choix ce qui restait de bon dans les rites qui subsistaient ici ou là, mais même de cultiver la morale qui, de l'Ethique de Spinoza aux textes de Bergson me fascinaient déjà, cultiver signifiant ici en entreprendre une pratique totalement athée et dégagée de la hantise d'une dépendance idéologique sous-jacente à certaines formes d'expression de l'un comme de l'autre.
Dimanche 15 février 2004
Le Moi de la peur.
La terreur a été une dimension écrasante de mon enfance. Elle domine ma vie psychique dans une parenthèse d'environ une décennie qui s'étend entre la mort de mon père, j'avais alors 5 ans, et l'âge où j'ai perdu brutalement une foi qui s'était formée tant bien que mal à l'intérieur de cette condition affective magistrale qu'était la peur. Cette peur avait deux sources : la religion et mes relations avec ma mère, étant entendu que c'est ma mère qui est aussi la source ou la cause de mon formatage religieux. On pourrait dire d'une certaine manière que la religion a agi comme auxiliaire parental ou comme instance de remplacement de mon père dont ma mère s'est servie, je dirais sans la moindre compassion pour la fragile conscience que j'étais alors. Lorsque je dis ma mère, il faut bien entendu que j'analyse cette mère, prise elle-même dans cette lessiveuse monstrueuse que représente le rite et la doctrine catholique, en n'omettant pas de préciser que la séduction esthétique fait intégralement partie de la scène sur laquelle se déroule cette enfance. Le catholicisme n'a survécu si longtemps dans notre sphère occidentale que grâce à cette géniale alliance du sabre et du goupillon, alliance qu'il ne faudrait pas traduire trivialement par l'addition de la force et de l'adoration, mais plutôt par la synthèse entre le terrible et le beau, entre la terreur et la beauté. Nous voici tout proches de la thèse kantienne sur le sublime, véritable et seule origine possible de la foi, c'est à dire de l'existence de Dieu.
Faut-il illustrer ce double conditionnement de mon existence d'enfant ? Je le pense pour la seule raison que ce conditionnement, hier général, a pratiquement disparu de la pratique sociale. Il s'agit donc d'un témoignage réellement historique concernant la paideia, l'éducation des enfants dans cet occident européen d'après la Deuxième Guerre Mondiale, quelles que soient les circonstances particulières de mon cas personnel, parmi lesquelles il faut signaler la nature du décès de mon père, à savoir le suicide. Le fait que mon père se soit donné la mort sous mes yeux n'entrera cependant dans le jeu de ma formation psychique que bien plus tard, lorsque la vérité de ce décès viendra ternir, à mes yeux, la personne morale de ma mère et contribuer, sans doute, à la rupture brutale de confiance ontologique que représente la naissance de mon athéisme. Cette rupture de confiance s'accompagne d'un autre événement psychique d'importance, je dirais d'importance équivalente, à savoir la fin de mon état de terreur. Cette synchronie n'est pas difficile à comprendre puisque ma peur dépendait essentiellement de ma relation fantasmatique avec l'au-delà, c'est à dire avec ma mort. Pendant une décennie environ, j'ai vécu dans un cauchemar ritualisé par le déroulement des faits et gestes quotidiens. De ce fait je ne peux pas prétendre avoir vécu en permanence dans ce cauchemar, mais chacune de ses manifestations était paroxystique : le moment du sommeil, par exemple, était pour moi l'entrée dans le tunnel de la mort. Je ne sais pas pour quelle raison, sinon peut-être à cause de la prégnance inconsciente du thème de la mort issue du suicide paternel, mais la nuit était pour moi le temps horrifiant d'une mort possible et d'une mort en état de péché mortel. Il s'agissait donc en réalité d'une double mort, puisque ma mort n'était qu'un passage certain vers l'Enfer, condamnation savamment distillée par l'esthétique sadique de mon église et de son catéchisme. L'autre partie de ma terreur provenait tout simplement du fait que ma mère, totalement impuissante à gérer l'absence de mon père, perdit progressivement le calme nécessaire à une vigilance maternelle efficace. Se croyant sans doute chargée de remplacer elle-même mon père, elle se mit à m'éduquer à la manière d'un dressage, dressage d'autant plus nécessaire que nous étions trois frères d'une grande turbulence. Les deux sources de ma terreur étaient donc l'Enfer de Dante et le fouet maternel, le martinet disait-on à l'époque, la violence étant ce que je hais le plus au monde, quel qu'en soit la cause ou la finalité invoquée.
Or, comme je l'ai rapidement signalé plus haut, la peur n'était pas la seule dimension de cette vie psychique, il y régnait aussi la beauté et l'amour de la beauté. D'abord la beauté de ma mère, double vivant de la beauté Mariale placardée dans tous les lieux du culte et dans l'imagerie religieuse, mais aussi celle de l'église catholique donc, qui a entouré mon existence " culturelle " d'une impressionnante scénographie digne des plus grands artistes. De six à quatorze ans, j'ai régulièrement servi la messe dans deux lieux différents par leurs dimensions et leur enjeu idéologique, mais qui ainsi se complétaient pour faire un monde où la solennité s'alliait à la beauté discrète et jouissive. D'un côté je servais dans la grande église de ma paroisse, sorte de cathédrale de taille moyenne qui donnait une ampleur métaphysique à cette sorte de méditation automatique qui vous y saisit. De l'autre, je servais d'auxiliaire à un vieux prêtre-missionnaire d'une grande douceur qui célébrait la messe dans la petite chapelle de la clinique religieuse où j'étais né. Dans ce petit refuge d'un Christ pour malades, les Sœurs faisaient preuve d'un talent proche du génie en chantant un répertoire qui allait de la liturgie d'avant Vatican II aux œuvres que nous considérons aujourd'hui comme quasi profanes de Monteverdi, Haendel ou même Cimarosa . Par ailleurs, sans doute informées de mon infortune de jeune orphelin, elles mettaient un amour et une générosité toute raffinée à m'entourer de leur affection et à me montrer leur gratitude pour le sacrifice que je faisais ce jour-là de quelques heures de sommeil. Je regrette encore aujourd'hui bien plus leur ravissante musique que les pâtisseries qu'elle empilaient sur mon assiette dans la petite conciergerie où l'on recevait aussi les SDF de l'époque. Au total, je dois reconnaître que ma mère a eu le sens de l'organisation de mon existence sur laquelle planait le traumatisme de la mort paternelle, car mes frères semblaient totalement étrangers à ces pratiques qui me rapprochaient, que dis-je, me maintenaient assez délicieusement dans les jupes de maman.
Peur et amour, amour et peur, voilà les éléments ontologiques de ma relation au monde pendant mon enfance, si bien qu'un jour, les relations s'étant considérablement tendus entre ma mère et moi, pour les raisons que j'ai invoquées plus haut, j'ai massivement transféré cet amour pour maman sur une amourette qui durera dans la stérilité la plus complète pendant dix ans et qui concernait une jeune voisine, à peine plus jeune que moi mais d'une beauté que je n'ai pu comparer à ce jour qu'à celle de la Béatrice de Dante. N'étant ni aimé de retour, ni de la même classe sociale et religieuse, cet amour était par avance condamné, j'étais forclos de ce qui avait pris la place de toute la force de ma passion et de mon admiration pour la vie et le monde. Cela n'empêchait pas la terreur de poursuivre sa douloureuse besogne jusqu'à mon divorce brutal avec Dieu, divorce auquel ont contribué efficacement les Bons Pères Jésuites de Saint Clément, collège fameux installé au cœur de la vieille ville de Metz et dont il ne reste aujourd'hui que la vielle chapelle baroque, classée monument historique. Je terminerai là cette illustration non sans ajouter que c'est dans ce collège digne des fantasmes du divin Marquis, que je fis l'expérience de l'anamnèse qui me rendit la vérité sur le décès de mon père et me sépara, peut-être dans la logique de ce souvenir, de la croyance en l'autre Père, l'éternel.
Ce qui suivit cette enfance et cette adolescence ambivalente et tourmentée, ce fut la formation d'une personnalité profondément rebelle à tout discours impliquant le recours à une croyance. A vingt ans j'étais déjà devenu tout simplement rationaliste, d'autant que ma soif mystique loin d'être étanchée me conduisit rapidement à des lectures cardinales dont Bergson fut par hasard le premier mais qui fut suivi de tous les grands classiques à commencer par Nietzsche et Marx. Rebelle aux discours, mais aussi rebelle aux actes dont j'étais devenu le juge dans une histoire où la République se souilla pour longtemps dans les guerres coloniales et les pratiques tout droit sorties de la terreur nazie qui venait de ravager l'Europe et le monde. Plus tard, bien plus tard, l'heure arriva pour moi de fonder une famille, projet qui me hantait tout naturellement depuis cette enfance dont la première partie, celle que j'ai encore partagée avec mon père, demeurait à côté de tout ce qui suivit comme une sorte de réserve de bonheur total, modèle d'une humanité possible pour laquelle je ne cesserai jamais de me battre. Je dus me compromette avec ce monde, accepter disons des compromis provisoires sous forme de signatures de contrats de travail, et donc des droits et des devoirs qui y étaient rattachés. Et j'y parvins malgré de dures souffrances morales et malgré un état de guerre permanent dont je viens à peine de sortir, si, si j'en suis réellement sorti, ce qui est loin d'être certain.
J'en viens à présent, et pour finir, à la raison de cette autobiographie surprenante qui suit celle de mes relations avec la prière, et qui, à bien des égards représente une sorte de répétition d'éléments déjà versés dans cette méditation multiforme qu'est cette chronique. J'en viens à la comparaison que je souhaitais suggérer avec l'éducation actuelle, éducation dont demeurent absentes toutes les dimensions qui m'ont pour ainsi dire fait : la terreur, la beauté et le rite. Ma compagne est institutrice en classe de maternelle, et son travail quotidien est devenu un cauchemar. En quelques années le caractère et le comportement des enfants s'est transformé de manière spectaculaire, au point de confirmer in vivo ce que j'analysais dans mes chroniques des années quatre-vingt-dix : les enfants sont en train de devenir les bourreaux de leurs parents, et indirectement de toutes les personnes qui sont chargées de leur éducation. L'animalité prend le dessus sur un être historique de plusieurs millions d'années, l'homme. La peur a pris, dans son histoire, des formes multiples, plus ou moins proche de cette animalité définie par les prêtres comme être dépourvu d'âme. Celle qui, cependant, a presque réussi à s'imposer comme loi universelle du refoulement aura été la religieuse, la peur qui fit trembler les rois avant les manants parce que les rois comprenaient son enjeu cependant que le serf était traité comme l'animal dont on dressait progressivement les contours. Et nous voici au point de rencontre. D'un côté une société peu ou prou encore dressée selon les anciens attributs de la peur - aujourd'hui la perspective de la retraite occupe tout le souci des hommes qui ont passé la trentaine et attendent la fin de la torture du travail aliéné. De l'autre, chez eux, à la maison, dans leur propre domicile, croissent des animaux sans peur parce que leurs parents n'ont jamais eu conscience du rôle que cette peur a joué dans leur propre existence et ne savent plus par quel moyen inspirer à leurs enfants cette terreur créatrice de surmoi. Les plus intelligents d'entre eux, mais ils sont si peu, ont pris la métaphore de l'animalité à la lettre, et enseigné catégoriquement à leur progéniture les limites de leur espace, ils ont balisé leur territoire tant dans le comportement et les relations que dans l'usage des objets et de l'espace commun. Ceux-là ont inconsciemment, ou peut-être parfois parce qu'ils étaient devenus des personnes, compris que pour l'enfant, l'impératif catégorique ne se manifeste que par la langue du Père.
Pas de peur, pas de beauté, pas de rite. Les millénaires qui viennent de s'écouler ont également subordonné la beauté et le rite à la peur : l'art et la liturgie furent le monopole de la Religion jusqu'à ce qu'un jour il fallût annoncer la mort de Dieu, la mort de la figure qui autorisait le beau et imposait le rite. A l'absence de peur de nos enfants, qui désormais poussent comme de la mauvaise herbe, s'ajoutent donc le mépris du beau ou son ignorance et le rejet de tout rite considéré comme crime contre l'aventure, cette illusion dont l'occident a tenté de faire une finalité ontologique sans même comprendre pourquoi. Le nazisme, tel que le décrit avec tant de génie Primo Lévi, a pour ainsi dire inauguré cette époque de l'animalité. Il a montré comment opérer la mutation de l'homme en animal par saturation de son sens de la mort, en développant une esthétique absolue de la laideur et en détruisant tout sens de l'avenir immédiat, c'est à dire de toute confiance dans un rite. Lorsqu'un détenu se réveillait au petit jour, il ne savait jamais s'il serait encore en vie pour manger la soupe de six heures. Beaucoup parmi les survivants furent ceux qui devancèrent leurs bourreaux dans l'exécution de cette politique quotidienne ou alors certains qui comprirent qu'on pouvait aussi aider le Nazi à mettre en scène un rituel faux, destiné à tromper le troupeau d'animaux. Ils formèrent donc des orchestres qui donnaient le ton et le rythme à ce qui ne pouvait avoir ni l'un ni l'autre.
Cette inauguration avait le mérite de montrer presque d'un seul coup, en quelques mois, ce qui allait plus tard devenir un processus souterrain, plus ou moins rapide, avec des retours en force de " l'esprit bourgeois " selon Jünger, c'est à dire l'esprit d'un monde qu'il fallait détruire de fond en comble pour installer la nouvelle Figure du Travailleur. Jusque il y a encore quelques années seulement, l'esprit des peuples d'Europe étaient encore ajustés sur cette nécessité qu'il y a de poser des bornes à la lubricité humaine et de maintenir, coûte que coûte, dans la conscience de l'enfant, les icônes du mal, les signifiants de l'interdit. Le tragique se révèle ici de la manière suivante : il fallait sortir de la terreur, et Mai68 en fut l'occasion historique, mais cette sortie comportait un danger majeur, celui de la perte de tous les repères qui pouvaient justifier la violence sociale : cette perte est une sorte de gambit du mal qui conduit directement au fascisme, terreur abstraite, pure déchaînement de la puissance vide que contient l'Être. Oui, c'est vrai, la substantivation de l'Être comportait un avantage indéniable, celui de donner une identité ou une personnalité à cette puissance. La mort de Dieu, cette destruction ou devenir obsolescent d'un jouet, enlevait à l'imaginaire de l'être sans langage, de l'enfant - et tout d'abord de cet enfant que reste l'impossible adulte - un motif poétique de la terreur nécessaire à l'existence sociétale. Si cette peur doit disparaître comme je l'affirme plus haut, c'est que le sociétal en tant que tel est devenu un obstacle au projet technique sous-tendu par la question de l'Être et que l'adulte arrive, dans l'histoire, enfin à son état d'adulte. A ce constat il faut immédiatement corréler la disparition de l'enfant en tant qu'apprenti de l'état d'adulte : l'homme naît désormais adulte, comme c'était en fait le cas autrefois. D'où un sentiment puissant de légitimité dans la pratique même de la violence qu'il adopte envers les adultes. Il ne faudrait pas se contenter d'analyser la violence urbaine comme des crises d'adaptation économiques ou ethniques, voire religieuses, mais bien comprendre le dénuement spirituel dans lequel se passe aujourd'hui l'enfance. L'individualité consumériste est une pièce à deux faces : d'un côté elle intériorise les valeurs en les détachant de la communauté, de l'autre elle livre au hasard de la naissance l'apport de ces mêmes valeurs, reproduisant ainsi une dichotomie de classes spirituelle mais encore plus dangereuse si c'est possible que la dichotomie en classe de possédants et en classe de prolétaires.
Mardi 30 mars 2004
Lettre du Raffa-Rhinland, Mulhouse.
C'est une mauvaise plaisanterie de Ruquier à propos de l'Alsace dernier bastion de la droite, mais elle vaut son pesant d'or (du Rhin), alors pourquoi s'en priver ? N'est-ce pas ? Bref, voici des mois que je me tais, fatigué, souffrant tous les jours dans mon corps et donc dans mon âme, fatigué de me répéter, fatigué aussi de transformer mon silence jouissif en paroles pour les autres, paroles aussi hélas pour moi-même, cette pisse de l'esprit formée par des mots, incarcérée dans des phrases, des signifiants pour la plupart orphelins de signifiés.
Mais voici que le pays dont je suis citoyen semble se réveiller pour prendre la parole, d'aucuns disent se dresser pour infliger au gouvernement une terrible semonce. Bon, je ne vais pas vous infliger à mon tour un cours de politologie comme il en pleut depuis quarante-huit heures, ultime auto-défense du pouvoir, de tous les pouvoirs passés, présents et à venir. Ah, mes amis, quelle dégelée de mots pour emprisonner un " événement ", un changement dans le train-train de la survie quotidienne, un petit aiguillage qui dysfonctionne ou semble vouloir faire dérailler le train de l'état, une élection qui tourne mal, très mal, encore plus mal que les tenants du pouvoir n'ont pu se le figurer, encore qu'il faudrait aller y voir de plus près dans la conscience des ubus en cravate qui nous gouvernent. Or, il y a toujours eu dans ma vie des moments où il a fallu s'aligner en rang d'oignon de la citoyenneté pour tout simplement exercer cette fonction à moi dévolue par la portion d'histoire dans laquelle il m'est arrivé de naître. Il aura fallu, il y a 45 ans, déserter les rangs de l'armée de mon peuple pour protester contre une guerre coloniale et barbare. Il aura fallu que j'aille me ridiculiser sur une barricade débile en Mai68, après avoir échoué à convaincre mes collègues de l'époque de rester sobres et de s'abstenir d'imiter sans motifs réels les étudiants de Paris. Enfin il a fallu que je me prenne au jeu lorsque la France se mit à voir la vie en rose socialiste , allant, mais si, jusqu'à prendre ma carte au PS, heureusement avant l'élection qui venait confirmer mon pressentiment inattendu mais bien concret. J'ai ainsi échappé à l'accusation probable de Martien, du nom de ceux qui se sont découverts Résistants un certain mois de Mars 1945.
C'est dire si mon intervention d'aujourd'hui se range dans une lignée de comportements sans doute aussi aberrants les uns que les autres, mais qui touchaient tous au devenir des structures radicales de ma République et de ma démocratie dont je n'ai jamais pensé pouvoir me désolidariser d'une manière ou d'une autre, bien que n'ayant voté pour la première fois qu'à l'âge de quarante ans. Autrement dit c'est le devoir, quand il faut y aller, il faut y aller, faute de quoi il se livrerait en moi un débat sur lequel je ne possède aucun pouvoir de contrôle : admirable conséquence de mes humanités, celles que j'ai encore eu le privilège d'acquérir précisément dans une république encore à peu près digne de ce nom. Il faut dire que c'était après la guerre, et qu'à cette époque un certain Général " félon " et comme moi, déserteur, avait découvert qu'il n'y avait pas d'autre choix que de reconstruire une République, même s'il a fallu la confectionner à ses dimensions un peu mégalomanes. En résumé, il existe en moi une confrontation qui cesse rarement, entre un citoyen sourcilleux des blessures que reçoit de temps en temps sa République, et un homme de l'esprit qui sait bien qu'il ne saurait le rester qu'au prix d'un certain dévouement dans les moments où culmine le danger.
La distance intellectuelle, cependant, est une médaille à deux revers. Elle permet de concevoir les événements dans un présent qui s'ouvre sur l'éternité, en même temps qu'elle se voit bien contrainte, avec un certain dégoût, de se salir les mains dans la bagarre des opinions et celle des allégeances. Quitte à reprendre, si la suite le permet, la distance radicale de la pensée fraîche et libre qui prend le soleil sur la plage de la question de l'Être depuis que celle-ci a surgi enfin d'une culture certaine mais affectée des fêlures et des morcellements en mosaïque que nous laisse le passage par l'Ecole. Tout le monde n'est pas fille ou fils de patricien, assez riche et assez prévoyant pour donner à ses enfants un Epictète ou un Sénèque pour les initier à l'humain dans une envergure correspondante à cette République qui porte le projet de la communauté.
Vous allez penser, in petto, que j'exagère en comparant ce qui s'est passé ces deux derniers dimanches aux événements que j'ai cités un peu plus haut, et vous aurez peut-être raison. La raison d'ailleurs pour laquelle je me suis remis à écrire ici à nouveau est précisément de juger si le jeu de tout ce tintamarre en vaut la peine. Tant pis pour moi si la réponse s'avérait négative, c'en serait autant pour moi et confirmerait mon propre déclin, déclin qui n'a aucune raison propre de se différencier du destin déclinant, selon certains, de notre être-là ensemble autour de la figure de la république démocratique franco-européenne. Alors allons-y, et tentons l'impossible, à savoir penser ce qui vient de se passer, autrement qu'en bégayant quelques lieux communs qui ne gagnent rien à se dissimuler derrière un langage amphigourique décoré de mille chiffres et de millions de carottes humaines, ces sondages carrément comparables à la chasse au pétrole.
Que c'est-il passé pendant ces quelques jours qui semblent avoir enflammé le pays, une France qui certes ne dormait pas tout à fait, mais qui ne laissait entrevoir d'aucune façon un tel coup de colère démocratique ? La première chose qui m'a surpris, malgré l'inconscience générale dans laquelle nous exerçons tous notre devoir de citoyen, est le caractère encore impeccable du processus qui a abouti à cette explosion. Un compatriote, interrogé à la télévision en a fait la remarque d'une manière un peu emphatique en disant son étonnement de voir encore de nos jours une élection se dérouler avec une telle précision et une telle loyauté républicaine. Il faut le dire, et même le répéter afin de se pénétrer de cette vérité qui pourrait bien un jour changer elle aussi, la procédure et les protocoles de votation, comme disent les Belges, sont quasiment parfaits et indiscutablement démocratiques. Il y aura bien quelques réclamations ici et là dans les jours qui viennent, mais pour l'ensemble et l'essentiel de ce qui a produit ce résultat, il y a une véritable correspondance entre ce que nos concitoyens ont porté aux urnes et ce qui en est sorti avec l'assentiment de tous, y compris notre Ministre de l'Intérieur, provisoirement rangé dans le camp des vaincus. Alors il se pose évidemment une question pour ainsi dire subsidiaire : ce résultat du suffrage des Français n'est-il pas aussi directement la cause de cette qualité démocratique ? Autrement dit, car il y a ici paradoxe pas si simple à entendre, est-ce que la force de la protestation populaire ne s'est pas aussi traduite par une vigilance quasi maternelle lors des opérations de vote ? Je suis persuadé, pour avoir scruté en son temps la fameuse élection de François Mitterrand, que le soin pris par les autorités communales redouble d'attention lorsque les enjeux sont vitaux. Pas question de " bourrer des urnes " dans la plus petite commune de France lorsque le peuple se sent menacé comme il l'a laissé entendre ces deux derniers dimanches si noirs pour le parti au pouvoir. N'allez pas me faire un fromage pour le soupçon que je semble porter ainsi sur le déroulement habituel des élections françaises, mais lorsqu'on connaît par exemple la réalité du suffrage universel dans des régions comme la Corse ou encore au cœur même de la Capitale, on peut assouplir son opinion sur l'honnêteté moyenne d'un scrutin dans notre pays. Pour enrichir un peu cette remarque, j'ajouterai que les partis n'ont pas dérogé à leur devoir et qu'il n'a pas manqué beaucoup de scrutateurs vigilants et intraitables, on a compté et bien recompté les voix du pour et du contre.
Première remarque, remarque qui n'entre pas dans le ronron des commentaires politologiques et qui paraît même un peu saugrenue tant il " va se soi " que la France n'est pas encore une république bananière. Soit, mais elle l'est à tant d'autres égards qu'elle aurait pu aussi, cette fois, le devenir dans cette cérémonie sacrée du suffrage, étant donnée l'importance politique apparente de cet événement rituel mais singulier par la conjoncture. Vous avez retenu le mot apparente et à juste titre. Je poserai donc en deuxième partie la question de savoir si ce vote a autant d'importance que le bruit fait autour le laisse supposer, encore que tout le monde a remarqué que les médias couramment considérés comme porte-voix de la droite - par exemple TF1 - a fait remarquablement court en cette soirée, et n'a pas modifié son programme sous prétexte que la terre politique a tremblé comme jamais depuis quelques décennies. Sans doute fallait-il banaliser artificiellement une élection après-tout seulement régionale, alors que personne, mais alors personne, n'a eu le culot de refuser de voir dans les résultats un événement de dimension nationale. Pour rappel, une élection législative ne coupe pas l'antenne avant une heure fort avancée de la nuit. La question demeure.
Si donc certains médias ont fait court, c'est qu'ils pensaient que leur sobriété planifiée allait produire des effets quelque part dans la conscience des citoyens et qu'ils cherchaient ainsi à minimiser le poids réel de ce revers cinglant pour les décideurs élus il y a deux ans. Cela tendrait à prouver que les élections régionales et cantonales ont été, cette fois, des élections tout à fait essentielles pour analyser le présent politique. Dans les discussions qui eurent lieu tard dans la nuit et pendant tout ce lundi encore brûlant de la déflagration, personne n'a songé à douter un seul instant du caractère extraordinaire et " climaxique " (du mot climax, qui signifie en quelque sorte le sommet de la catastrophe ou encore le dénouement dans le cadre d'une intrigue), en un mot traumatisant pour la réalité politique du pays. Alors y-a-t-il eu un trauma, ou encore quelque chose comme la révélation brutale d'une vérité cachée que seule pouvait exhiber le suffrage universel ? Je pense que oui, même si on peut ici ou là soupçonner un réflexe de Panurge, mais à des niveaux imperceptibles a priori, ce qui signifie qu'il y a eu une maturation préalable à la décision des électeurs et que ce réflexe panurgique n'aura été rien d'autre que le lent travail des discussions de comptoir ou de fumoirs d'entreprises. Mais cela ne nous regarde que pour autant que nous avons toujours fait mine d'ignorer qu'il y a une autre vie de citoyen que celle qui se déroule pendant les quelques instants pendant lesquels on glisse un bulletin dans une enveloppe avant de la laisser tomber avec gourmandise dans l'urne. La théorie s'était donc faite dans les masses avant ces deux dimanches surprenants, et d'ailleurs dès ce matin les langues se sont mises à se délier pour affirmer hautement que tous les états-majors politiques savaient depuis deux mois au moins que le gouvernement allait se faire censurer sévèrement par le peuple, même si l'on attendait au grand jamais un tremblement de terre aussi dévastateur pour la droite.
Cette analyse un peu rapide je le confesse, nous permet cependant de prévoir bien d'autres choses dans le futur, et nos décideurs seraient bien inspirés de lire ces quelques lignes, car ce qui a apparu dans ce suffrage est aussi ce qui risque d'apparaître dans la rue et dans les entreprises si le pouvoir, comme je le pense, n'a pas la moindre intention de changer quoi que ce soit au cours de ses réformes et à ses méthodes pour les faire passer. Là aussi la cause est dans la conséquence et réciproquement : comme disait Marx, la taupe travaille sous la terre de la réalité sociale et ne se montre que lorsque son œuvre est achevée, lorsque sa pensée a atteint le territoire de la décision pratique : les élections régionales et cantonales ont été des décision pratiques, fruit d'un travail rationnel et sérieux sur des sentiments, des peurs, des raisonnements et des perspectives concrètes dont les réformes déjà entreprises et légitimées par la Loi portent déjà des conséquences visibles à court, moyen et long terme pour tous les citoyens concernés par ces réformes. Qui voudrait pousser le ridicule jusqu'à prétendre que ceux qui ont voté pour la droite ont aussi voté pour des réformes dont ils seraient les victimes ? Non, ceux qui ont voté pour ces réformes ne sont pas, selon toutes les idéologies avouées de cette même droite libérale et égoïste par définition, menacés par elles et sont même appelés à tirer profit de ces lois que d'aucuns considèrent comme iniques et, de l'aveu même de quelques caciques de la droite comme " injustes ".
Injuste, voilà le mot-limite de la soirée d'hier, le mot au-delà duquel personne n'a voulu s'aventurer, ni à droite ni à gauche, et pour cause. Juste, injuste, ces notions demeurent tout sauf précises. Elles sont vagues et ne font référence directement à rien d'autre qu'à une valeur qu'on peut répartir n'importe comment dans l'horizon ou dans le cadre de ce qu'a accompli le gouvernement dit Raffarin depuis son accession au pouvoir. Etrange mutisme, extraordinaire discrétion de la part des plus vindicatifs opposants à cette politique réformatrice ! Madame Buffet ou Monsieur Mamère, de loin les plus francs dans cette langue de bois généralisée, même ces militants de la justice n'ont pas osé en dire plus, aller au cœur de cette " injustice " qu'ils dénoncent et qui pourtant est bien là puisque les Français ne l'on pas envoyé dire à leurs dirigeants actuels. Tenez, Madame Buffet n'a pas eu peur de désigner les Français qui allaient demain se réveiller avec une gueule de bois à cause de telle ou telle suppression de tel ou tel acquis social, mais, mais jamais l'essentiel, jamais l'essence de l'injustice appliquée à la réalité des réformes, pourquoi ?
Mais prenons-donc la place de ces prétendues voix de l'opinion publique, prenons la parole à leur place pour caractériser de manière précise l'injustice fondamentale de la plupart des réformes entreprises par monsieur Raffarin sous les ordres de son maître. L'injustice n'est pas dans les nouvelles inégalités que produiraient plus tard les conséquences des nouvelles lois sur la retraite, la protection sociale, le droit du travail etc… L'injustice a DEJA EU LIEU dans la trahison du Contrat Social implicite à tous ces domaines de la vie des salariés et des Français en général. Comment peut-on faire des lois rétroactive à propos de contrats qui portent sur le destin d'une personne et qu'elle a signé déjà depuis dix, vingt, trente voire quarante années de vie et de travail ? Les fonctionnaires qui ont choisi, voici vingt ans par exemple, de devenir postier ou enseignant parce qu'ils considéraient que la sécurité de l'emploi valait bien une relative faiblesse de la rémunération et des ambitions de carrière carrément limitées ? Les salariés ont tous signé des contrats, parfois symboliques certes, mais ils se sont intégrés à la vie sociale sous certaines conditions qu'ils ont accepté en connaissance de cause, notamment les garanties que leurs offraient le Code du Droit du Travail ? Alors de quel Droit, de quelle justice républicaine ou constitutionnelle le gouvernement s'arroge-t-il le droit de modifier en cours de route ces destins librement consentis et des engagement signés par les DEUX PARTENAIRES concernés ? L'injustice, elle est là, dans la trahison de l'exercice de la liberté républicaine, que ce soit dans la fonction publique ou dans l'entreprise privée : les réformes ne peuvent pas porter sur les actifs de la vie présente, tout au plus peuvent -elles concerner les futurs entrants dans la vie active, car il y a un droit effectif pour l'exécutif et le législatif à décider du futur. Autrement dit, car semble-t-il tout cela n'est pas facile à comprendre, un salarié qui a signé pour telles et telles conditions de sa vie, ne peut pas se voir du jour au lendemain frustré d'une partie de ces conditions sous prétexte de réformes qui doivent, pour la plupart porter leurs fruits à long terme. Comment peut-on justifier les coupes claires dans les retraites par des conséquences attendues dans vingt-cinq ans ? J'ai autour de moi des dizaines d'amis qui pensaient pouvoir prendre leur retraite dans deux ou trois ans, résultat : on leur apprend brutalement qu'il n'en serait rien et qu'ils auront à travailler deux, trois voire quatre années de plus que prévus et signés dans un lointain contrat, issu d'une lointaine mais réelle décision de faire tel métier dans telles conditions avec l'accord et l'engagement de l'entreprise de respecter ces désirs choisis en fonction des clauses contractuelles de leur vie. C'est comme si votre banque venait modifier votre taux d'intérêt signé en fixe et le transformer en variable sous prétexte que la conjoncture ne permet plus d'assurer un taux fixe. Ce n'est pas une injustice, c'est un délit, voire un crime économique et social.
Et voici aussi ce que même la Gauche n'ose ou n'a pas osé dire parce qu'elle s'apprête à empocher les bénéfices de ces délits de l'actuel gouvernement, la tentation étant trop grande de voir réglés des problèmes difficiles par des lois iniques votées par un gouvernement de l'autre bord qui n'hésiterait pas à en faire, bien entendu, autant sans états d'âme. Cela, Messieurs de l'actuel Parti Socialiste, s'appellerait du recel si, parvenus au pouvoir vous ne changez pas radicalement les réformes dans le sens du respect des engagements pris en début de carrière. Combien de ces réformes le gouvernement Jospin n'a-t-il pas repris à son compte parce qu'il pouvait toujours les attribuer à l'opposition + l'Europe + la conjoncture etc… Voilà la raison de son échec car le travail de la taupe se fait malgré la futile illusion de pouvoir manipuler l'opinion par l'intermédiaire des médias. Quel imbécile penserait qu'un ouvrier licencié la veille trouverait le matin une oreille complaisante pour les explications du Ministre sur la conjoncture internationale et autres balivernes ? Personne. Les Faits sont têtus, disait l'autre, mais les faits atteignent les acteurs dans leur vie et dans leurs perspectives et aucun discours ne pourra jamais remplacer le fait qui donne la forme au destin d'un homme qui de surcroît se pense libre, se pensait libre lorsqu'il a fait les choix fondamentaux pour sa vie d'adulte.
Ceux qui m'ont déjà lu me connaissent du point de vue pour lequel je plaide ici, rien n'a changé dans ma façon de considérer ces prétendues réformes qui, en réalité, démolissent des vies entières au nom d'une " gouvernance " proprement criminelle et sans scrupules. Il semble que quelques citoyens aient enfin pris conscience de cette trahison au point de mobiliser la justice pour défendre et reprendre ce qu'on veut leur arracher par des lois, voire des décrets et des ordonnances qui ne requièrent même pas de discussion à la Chambre des Députés. Nous voilà revenus au temps des Lettres de Cachet, nous seront bientôt revenus au temps de la prise de la Bastille. Un dernier mot pour aujourd'hui, ces lettres de Cachet sont pour bientôt car ce que l'on entend ce matin, mardi 30 mars 2004, laisse entendre que le Premier Ministre qui a si magistralement conduit la majorité à sa perte et les Français dans la rigole, va se succéder à lui-même, suprême insulte à ce peuple qui lui a non seulement signifié son désamour et sa colère, mais l'a également jugé définitivement incompétent et méchant.
Dimanche 4 avril 2004
La mort du corps.
J'entends parler de la mort. De ma mort. Dans les couloirs des secteurs spécialisés courent des bruits contradictoires qui sont forgés pour ne pas laisser transpirer la vérité. Alors c'est dans le style des explications contournées et embarrassées qu'il faut sentir qu'on parle de votre dernier souffle. Mais j'ai de la chance, mon médecin traitant, comme on dit curieusement, est un homme, pas une nouille de bénitier consensuel. Il m'a donc parlé sans détours et j'ai senti passer le souffle de l'instrument de la faucheuse, et même si le doute semble encore ébrécher le fil de la lame, c'est bien mon âme que ce souffle a fait frémir. La mienne.
Quand le philosophe parle de la mort, il parle toujours de celle des autres, même lorsqu'il en dit les choses les plus sublimes. Qu'en est-il dans son for intérieur lorsqu'on lui annonce l'irréparable ? A vrai dire, je ne sais pas. Quelque chose se brise qui renvoie dans le ridicule tous les propos lénifiants que l'on a pu tenir sur cet événement définitif, terminal, sur ce départ pour nulle part dont toute absence de foi vous prive même de curiosité. Tout ce que l'imagination vous offre, c'est l'image d'une nuit qui tombe brutalement sur le monde, sur l'Être, sur une chose à laquelle vous apparteniez et qui va vous abandonner. La mort de Socrate, j'avoue que depuis hier je ne la comprends plus, du moins pas très différemment que celle d'un " martyr " islamiste ou chrétien. Ou alors comme le suicide qui veut précéder le moment fatal qu'autre chose vous impose, donner à votre disparition une dernière illusion de participation, se donner au fond le sentiment de partir avec, non pas de disparaître dans le néant, mais d'entreprendre un voyage planifié, connaissant d'avance son but et le salut qu'il dissimule aux mal-voyants. Ou alors encore un déterminant encore plus retors : donner un sens au non-sens absolu, un sens pour les autres, pour ceux qui restent. Mais tout ça est du pareil au même et parle de la même chose, de l'oubli de soi dans l'affrontement de la mort.
Foutaises. Mais dans ces moments brûlants du rapport avec le corps, se joue aussi la question de la lutte. Vais-je me lancer à " corps perdu " dans le combat contre la maladie qui, elle, a reçu ses instructions temporelles, ses paramètres et ses normes rythmiques ? Ou bien vais-je simplement attendre en recherchant le confort et l'absence de douleur ? Hier, la question ne se serait pas posée car la machine médicale ne m'aurait pas offert le choix. Aujourd'hui le cynisme de la nouvelle gouvernance ouvre toutes les perspectives, y compris celle de refuser toute thérapie dans la position dite des " soins palliatifs ". Que pallient ces soins ? Etrange expression ! En réalité, je n'en sais pas encore assez long sur mon état réel pour tenter de chercher une réponse à cette question et je suis persuadé que le vrai combat va être celui que je vais devoir mener contre le mensonge et la manipulation permanente des professionnels de santé.
Mon corps a eu, lui, une étrange réaction à cette information morbide : il a cessé de souffrir. Depuis des années ce corps n'a jamais cessé de se battre contre cet ennemi qui s'appelle douleur, que dis-je, je ne me souviens plus d'une époque sans douleur, ou plutôt si, celle que m'avait offert l'océan, il y a de cela plus de trente ans. J'en ai parlé ailleurs et j'en ai même, je crois, donné les raisons que je pouvais distinguer. Mais cela n'a pas duré et dès que mon histoire a repris le chemin de la terre ferme, c'est mon corps qui recommençait à regimber, comme si ce corps ne voulait pas de la terre, de la vie ? Et pourtant j'ai tenu longtemps ainsi, dans une position sociale intenable, où il fallait souffrir et le montrer sans que cet étalage ne compromette la simple survie. Il aura fallu avancer tout le temps contre le vent, contre les vents et, je dois le dire, contre les hommes. Je peux et dois même considérer que j'ai eu de la chance, car j'ai toujours rencontré des médecins affectueux. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire cette relation étrange entre quelqu'un qui sait ce dont vous souffrez, qui n'a pas le droit de tout vous dire et qui vous soutient quand-même et vous aide à passer des caps difficiles.
Je viens d'apprendre que l'APA, l'association pour l'autobiographie, a choisi le corps comme thème de sa future rencontre à Aix où je n'irai pas, à cause de mon corps ! Etrange coïncidence mais qui ne m'étonne qu'à moitié car j'ai toujours su que mon destin n'était pas délié du destin de l'Être. Si la mort m'attend, j'ai cette consolation d'y pouvoir distinguer une familiarité avec le futur de l'Être lui-même, c'est peut-être cela qui explique la mort de Socrate ? Le pire, le pire de ce que je ressens aujourd'hui, ne me concerne pas du tout. Ce dont je souffre c'est de la perspective d'abandonner quelques personnes qui ont besoin de moi, qui ont appris à vivre avec moi et même réappris et que je meurs d'abandonner, ultime et terrible souffrance morale. Mais les jeux ne sont pas encore faits, et sans doute cette ultime douleur me donnera-t-elle le courage de retarder le plus possible le passage du Styx qu'Epicure m'a depuis longtemps appris à ne pas craindre. Ici encore Socrate, donnant le sens pour les autres. Décidément…
Lundi 5 avril 2004
Bercy, Mission impossible.
Une petite spéculation politique de temps en temps, ça remonte le moral, surtout lorsqu'elle est amusante comme devrait l'être tout calcul portant sur l'avenir de Nicolas Sarkozy. Curieuse carrière que celle de ce descendant de Magyars, ces hommes tout en acier et en intelligence de l'espace. L'histoire classique place toujours la France comme le premier état unifié par un long travail de princes se succédant depuis Philippe Le Bel, penchés tous sur la même tâche de tisser leur état hexagonal. Or, il existait, avant notre grand pays, une autre nation dont on pourrait dire qu'elle naquit unifiée sua sponte, j'ai nommé la Hongrie. Naissance dont la parturition fut pourtant bien plus difficile que celle de la France, passant souvent sous des jougs étrangers, ce qui à quoi nous échappâmes malgré la perfidie des uns et la brutalités des autres. Non, l'unité hongroise résidait ailleurs que dans les définitions politiques ou territoriales, quoique le fait que la moitié du pays ne soit qu'une vaste plaine donne à ce pays une géométrie d'office unitaire. Mais l'unité la plus importante est sans doute l'unité linguistique, une homogénéité culturelle qui permit au double système de l'oligarchie et des Magyars, la noblesse, de traverser les siècles sans trop d'encombres, sautant même par-dessus le plus redoutable de tous les obstacles que fut le communisme satellitaire.
De notre histoire de France il subsiste aujourd'hui une caste de décideurs et de grands propriétaires de plus en plus réduite et de plus en plus dépendante des autres grandes puissances, une classe moyenne de très grande qualité quoi qu'on en dise et une France d'en-bas dont personne ne connaît la définition exacte sinon qu'elle doit concerner les " gens " qui peinent à boucler les fins de mois, enrichissent les banques presque automatiquement et dont certains finissent dans la catégorie médiatiquement paramétrée comme SDF. Ce tableau sommaire de notre société rappelle étrangement celui de la France qui précède la Révolution de 1789, c'est dire la stabilité de sa composition si on accepte des variations dont la situation actuelle illustre la position la plus basse, étant donné que ce tableau ne traduit rien de la richesse réelle du pays ni de sa position dans le monde. La France est sans doute, avec la Chine, le pays le plus sédentarisé du monde, à peine agacée par quatre années d'occupation nazie, pendant lesquelles les bonnes bouteilles et les lingots d'or dormaient à trois pieds sous terre dans nos vastes campagnes, une réalité dont l'origine peut se situer déjà avant la conquête romaine, mais si on tient absolument à respecter les illusions de l'histoire nationale, alors on fixera cette origine au moins aux environs des huit et neuvième siècles. C'est en gardant à l'esprit cette image de cette vieille France à la " force tranquille " que l'on peut juger du destin chaotique de la petite Hongrie, refuge de quelques tribus nordiques que les Romains appelaient les Pannoniens, espace sans beaucoup de relief mais à la terre grasse et si juteuse qu'elle garnissait encore les tables des grands de l'ex-URSS il y a à peine quinze ans. C'est au cinquième siècle que quelques nomades venus on pense de Finlande et de plus haut encore, investirent cet espace qui ne devint réellement la Hongrie que quinze siècles plus tard, après la chute du mur, à peu de choses près. Mutatis mutandis, je dirais que la Hongrie aura été notre Liban européen.
Je m'explique. ( c'est long comme introduction pour une pissette sur Sarkozy, mais il faut ce qu'il faut pour bien analyser les réalités profondes). Pourquoi le Liban ? Précisément parce qu'entre les Romains, les Austro-Bavarois, les Balkans Ottomans et les autres, les Turcs et la Russie communiste, le destin de la Hongrie se divisera en deux strates sociologiques : les Hongrois de l'intérieur et ceux de l'extérieur, une diaspora dont notre ministre semble être un remarquable exemplaire. La stabilité destinale de la Hongrie se jouera entre des nationaux qui feront le boulot d'être Hongrois sur place, c'est à dire presque jamais, et ceux qui vont parcourir le monde pour faire fortune et surtout placer la leur dans les places sûres et profitables. Londres, Paris, Bruxelles ou Bâle et plus tard l'Amérique, deviendront donc de petites colonies de l'aristocratie hongroise venue déposer ses avoirs dans les banques et jouir des dividendes tout en gardant avec la patrie des relations épisodiques mais sans failles sur le long terme. Dans les années trente, mais encore de nos jours, les barons, les comtes et les vicomtes d'une ancienne Hongrie presque imaginaire, dansent et se livrent aux commerces nobles des Antiquités, de l'Assurance et de l'Expertise, sachant cependant se reclasser régulièrement dans les niches les plus distinguées du progrès technique et politique, y compris l'ENA, même si le tempérament spontanément artistique de ce peuple énigmatique et souriant ne l'engage que rarement dans le cambouis des réalités sordides. Un chapeau garni d'une plume de faisan, un costume très proche de la culotte de cuir bavaroise et une grappe de gros raisins noirs à la main, voilà le Hongrois des coteaux couverts de vignes. Dans les lobbies des grands hôtels du monde, vous leur verrez le même chapeau légèrement affiné au goût cosmopolite du bon chapelier sans patrie, au-dessus d'un smoking toujours parfait et parfaitement anonyme. Mais la physionomie ne trompe pas, les méplats osseux de leurs femmes délicieusement charnelles et le sourire hospitalier d'une humanité de faux sédentaires stoppés dans la grande plaine par les armées romaines mais animés au plus profond d'eux-mêmes de la nostalgie des grandes chevauchée nomades. Nés pour la guerre et la razzia, les Magyars ont fait une halte européenne qui ne s'est que partiellement figée pour l'éternité des historiens, les fougueux cavaliers continuent leurs aventures dans le grand monde du monde mondialisé.
Voici le tableau qui entoure le berceau de notre beau Nicolas, car, on ne peut pas nier qu'il soit beau, qu'il " porte " beau comme on disait si bien au siècle dernier. Il porte beau comme notre Président, et voici déjà le premier hic à ce portrait si séduisant, déjà le doute se glisse : serait-il plus beau que Jacques Chirac ? Plus intelligent, personne n'en doute, encore qu'il faille ici distinguer de quelle intelligence on parle, car il faudrait alors trouver des nuances entre la ruse des serpents et celle des mangoustes, leurs ennemis les plus féroces, et à ce jeu, il n'est pas sûr que notre Nicolas soit de taille à cromwelliser son souverain sans risquer de se faire croquer d'une lippée brève mais gourmande. D'autant plus qu'il vient, le beau Magyar, de se mettre dans de sales draps, enfin disons que la mangouste ou le serpent, comme on voudra, lui a porté le premier coup, et quel coup ! Au lendemain de cette rigolade que furent les deux tours des Régionales, tout le monde voyait un Raffarin carbonisé, déjà dans les poubelles de l'histoire (enfin, disons de la série 5ème République), et qui voit-on ressurgir tel le phénix de la Primature ? Le même Raffarin, chargé cette fois d'en finir avec lui-même lors des prochaines élections européennes, mais avant cela de carboniser notre vaillant chevalier à demi-tartare en le plaçant dans le piège le plus délicat et le plus radical qui soit, Bercy. Sarkosy, Ministre de l'Economie et des Finances me paraît être une contradictio in hominis, une contradiction dans l'homme. Faut-il en conclure hâtivement que le Président de la République a placé là son ennemi mortel précisément parce que Bercy est devenu vraiment ingérable ?
A écouter tous les économistes et tous les sociologues reconnus, les autres demeurent inaudibles, la situation financière de notre pays est proche de l'abîme. La dette, toujours la fameuse dette, serait prête à nous dévorer d'un coup de dent si les Français d'en-bas, du milieu et d'en-haut persistaient à ne pas vouloir revenir de leur rêve des trente glorieuses. Vous savez ce que je pense de ce mythe moderne de trente années de bonheur français, trente années que j'ai vécu dans la déréliction la plus complète et sans qu'une seule fois un titre de journal ne m'informe de mon bonheur. Que les usines tournassent et que les " veaux " achetassent ne confortaient en rien mon existence de jeune homme né au début de la guerre et qui cherchait d'abord un sens à l'existence, sens perdu avec la foi dans un lointain collège de Jésuites. Bref, les Français doivent impérativement accepter de se serrer la ceinture, autrement dit d'accepter demain, demain matin, ce qu'ils ont manifesté vouloir refuser mordicus lors de ces dernières élections. Bon, mon cher Sarko, tu as bien joué sur la harpe de la sécurité policière et judiciaire et ta com a été brillante, quelles que soient les approximations statistiques dont tu l'auras nourrie. Bref, tu as montré que tu " en avais " face à un peuple déboussolé par une campagne de terreur médiatique dont on reparlera encore longtemps et qu'on prétend avoir été à l'origine de la chute de Jospin, erreur d'appréciation qui ne finira jamais de m'étonner. La vérité de cet échec imprévu provenait au contraire d'un excès d'optimisme de la part de la Gauche et des Français eux-mêmes, optimisme justifié mais pas au point de laisser les petites gauches parasites lui ravir le pour cent et demi fatal. C'est la générosité de Jospin qui l'aura abattu, incapable de faire de l'ombre à une candidate MRG qui lui a raflé quatre pour cent et qui lui offrait même de retirer sa candidature ! Mais vous aurez remarqué comme moi que le discours orthodoxe aujourd'hui, même à gauche, est de reconnaître qu'on (la Gauche) a été mauvais et qu'on a été sanctionné, oubliant de faire l'addition de toutes les gauches qui se sont présentées lors de ce maudit premier tour. Etrange ritournelle des campagnes électorales commençantes, et commençantes dans des conditions imprévues, comme d'habitude. Hier chez Karl Zero, Strauss-Kahn a prétendu avoir su que la Gauche allait gagner, - " mais pas avec de tels résultats " ! Faudrait-il dire que le métier de politique ou de politicien réside tout entier dans sa faculté de prévoir au moins cela ? Sont-ils donc réellement aussi mauvais que cela ?
Revenons à notre Hongrois bien-aimé, qui pourrait bien subir le dédoublement du sobriquet dont fut victime Louis XV le Bien-aimé en Louis XV le haï, a l'issu de ses premières performances dans le grand vaisseau qui longe la Seine et qui décide in fine des choses de la vie des ministères dont les Français attendent un demi-tour gauche. C'est désormais Nicolas Sarkozy qui va faire rédiger les fameuses lettres de cadrages, ces billets qui donnent à chaque ministre l'envergure financière exacte de son action. Alors on pourra avoir autant de Borloo et de Fillon qu'on voudra ici et là, si le petit Nicolas ne parvenait pas mieux à redresser la barre que ne le fit son prédécesseur pourtant compétent, il serait contraint de cadrer ses lettres au plus serré et donc de condamner à la paralysie la politique définie par le Président lui-même au lendemain de la gifle électorale. Alors se posent deux questions : Chirac joue-t-il Sarko pour réellement sauver sa politique libérale, quitte à s'en désolidariser en fin de mandat pour trahison de sa vision ? Ou bien le sacrifie-t-il délibérément, sachant qu'il n'irait pas très loin dans les mesures nécessaires à un retour à l'équilibre des finances de la France ? Il faut noter en passant qu'il vient de placer à Beauvau un personnage qui n'est pas n'importe qui mais son plus fidèle lieutenant depuis bientôt deux décennies. Dominique de Villepin emporte-t-il dans sa poche des ordres du Château impératifs ? Si impératifs que plus jamais aucune chienlit ne viendra troubler l'ordre public, au risque de faire parler la poudre ? Aurions-nous écopés d'un triumvirat appelé à devenir une sorte de Comité de Salut Public de droite, on aura tout vu dans notre beau pays, qui n'hésitera pas à poursuivre en la renforçant la politique répressive et mutique des gouvernements Raff I et II ? Je ne suis pas loin de le penser, et la figure de proue d'insolente arrogance du Magyar de service est loin d'avoir perdu la partie : il est le premier homme d'état français à avoir réussi à faire peur à ce peuple insouciant et incapable d'imaginer un retour à des Restaurations dures, blanches et rouges comme le sang. C'est qu'il n'est pas tout à fait français, regardez la houppette de sa chevelure soigneusement gominée, ne vous fait-elle pas penser à cette plume frontale qui ornait le casoar des officiers Magyar dans leur chevauchées furieuses contre l'occupant ottoman ? Décidément, Jacques Chirac a toujours une solution de rechange dans sa poche, quitte à prendre des risques personnels comme celui qui consiste à s'allier pour le pire avec le pire de ses adversaires politiques. On verra rapidement si mes prévisions ont quelque pertinence, ce que je suis loin d'espérer, croyez-moi, mais je vois cette évolution se produire depuis si longtemps dans l'inconscient de la droite, c'est à dire dans l'extrême-droite, que je ne vois pas d'autre issue qu'un nouveau durcissement qui nous rapprochera un peu plus d'une véritable guerre civile.
Je viens d'assister par écran Télé interposé à la prestation obligé de Raf III à la Chambre. Tout colle avec ce que vous venez de lire si vous en avez eu la patience, autrement dit on continue en accentuant la pression et en crachant à la figure de l'opposition qui le lui a bien rendu, bravo Hollande. Jusqu'à présent tu me paraissais un peu fade et sans relief, aujourd'hui tu es sorti magnifiquement de tes gonds et c'était beau. Cela ne signifie pas encore que tu saches où tu vas et on le sent encore bien trop, trop sur la défensive et pas assez métaphysiquement insolent. Demande moi des cours, je te ferai un prix.. Bravo quand-même !
Samedi 10 avril 2004
Chirac :"Pas de quartiers".
La politique est toujours un scénario. Lorsqu'il arrive qu'elle en manque, le Prince est mort, politiquement voire physiquement. La question de notre avenir commun, qui recouvre aussi celui de chacun de nous, commence toujours ou doit commencer par celle de l'identité de ce scénario : dans quelle stratégie sommes-nous entraînés, dans quelle tactique errons-nous en nous heurtant bien souvent à de surprenants obstacles ? Il faut donc tirer un trait définitif sur une image statique de la démocratie occidentale, sorte de gestion tranquille des fins et des moyens destinés à conserver la force de la démocratie ainsi que la possibilité pour les citoyens de survivre à tous les coups du sort et à toutes les évolutions du monde qui l'entoure, du moins tant que cette démocratie ne sera pas unifiée au plan du monde, de cette planète, mot qui entre de plus en plus massivement dans les discours, les propositions les plus anodines et surtout les arguments les plus pernicieux destinés à donner cours forcé au scénario qui se dissimule toujours derrière la scène. Planétaire, la réalité serait devenue planétaire et nous-mêmes ne sommes plus que des unités planétaires de la stratégie du plus fort, de celui qui conduit les affaires de la " planète " en faisant descendre les effets de son pouvoir selon une échelle dont chacun s'évertue à conquérir celle qui est la plus proche de ce dernier.
Bon. Ca, c'est la généralité, nous ne sommes pas ici pour faire de la théorie philosophique et politique, mais pour tenter d'entrer dans le jeu de celui qui conduit ces affaires théâtrales dans la zone du monde qui porte encore le nom de France. Je dis cela parce que si vous vous souvenez de l'une de mes anciennes chroniques, l'une des plus drôles je dois dire, si je me souviens bien, et qui disait en clair que le monde se partagera bientôt en entités qui pourraient bien porter des noms comme Coca-Cola, Michelin, Monsanto ou encore, peut-être encore, Vivendi etc… -" Où vas-tu mon cher ami, dans cet immense Boeing 770 ? " -" Oh je retourne à Seattle, la capitale du Boeing " - . Ces transformations sémantiques ou linguistiques prendront peut-être un certain temps, et peut-être ne sont-elles pas forcément admises dans le cours du destin mondial, qui sait ? Pour l'instant la stratégie que l'on peut discerner nous y conduit tout droit, et je suis certain que peu de gens, peu de ces gens d'en-bas ou du milieu ou du haut, l'ignorent. Mais, dans l'échelle et les rouages de ce mécanisme qui semble si implacable, il y a des zones plus ou moins rebelles à cette idée de transformation radicale du sens de la politique et du sens aussi de ce qui fait que les hommes vient ensemble. Ne cherchez pas trop à comprendre le sens exact de ces propositions, lisez et tâcher de tirer de cette lecture un sentiment plutôt qu'un savoir qui n'existe pas, qui n'existe nulle part, surtout pas dans les commentaires quotidiennement ennuyeux de nos savants de la radio et de la télévision, voire de ces papiers noircis à l'encre électronique de nos nouvelles rotatives. Dans cette échelle il y a la France aujourd'hui " guidée ", aujourd'hui sous la tutelle d'un état devenu monolithique par un hasard que l'on pourra qualifier comme on voudra selon le camp dans lequel on pense se trouver. Car il faut toujours préciser que la plupart des acteurs de notre démocratie pensent la plupart du temps se trouver là où ils ne sont en aucun cas. Prenez l'exemple d'un certain Bayrou, qui, lui ne sait même pas où il se trouve, jouant encore des scénarii qui remonte à Machiavel et qui parle d'un Prince et d'un pouvoir sans contenu autre que lui-même. Le pouvoir de pouvoir.
Par les mêmes hasards s'empilant les uns sur les autres, il se trouve que cette machine si puissante par l'espace qu'elle occupe dans tous les rouages de l'état, c'est un homme qui possède tout le pouvoir, je dis bien : tout le pouvoir. Ce matin les journaux étaient pleins de l'événement qui doit bouleverser le Maghreb et peut-être changer la face du destin d'un pays qui fut longtemps une de nos colonies les plus prospères et source de grande richesse pour notre propre pays, à savoir les élections algériennes. Petite anecdote amusante en passant, le candidat qu'on soupçonne de vouloir se succéder à lui-même par tous les moyens qu'on attribue en général aux despotes, a été, un temps, mon patron. Dans les années 62-63, j'ai été un petit, tout petit rouage de son ministère de la Jeunesse et des Sports, ministère que les historiens considèrent aujourd'hui comme le plus important du gouvernement de Ben Bella, puisqu'il était le nœud où se tramait son renversement, le coup d'état de Boumedienne, ami de longue date de l'actuel président de la République Algérienne. Fallait-il mettre une majuscule à algérienne ? Je n'en sais rien, mais comme cela figure ainsi dans les titres des journaux, je vais humblement en faire autant, note en passant. Sentiment, n'oubliez pas, pas savoir, il n'y a pas de savoir en politique, il n'y a d'ailleurs pas de savoir du tout nulle part, et il y a eu quelques sages comme Pyrrhon pour décliner cette vérité (hi hi) sur tous les tons, mais des bons, tons. Mais pourquoi, allez-vous protester légitimement, l'auteur nous dérive-t-il vers ce lointain morceau d'Afrique alors que nous parlons de la France ? Quand-même, nous nous fichons des scénarii imaginés par un Bouteflika pour conserver son pouvoir, et nous ne nous passionnons que pour celui qui nous est directement destiné, à savoir le pouvoir qu'exerce un certain Chirac depuis déjà deux ans, si l'on ne compte pas les 7 ans qui ont précédé, sous prétexte que les socialistes se sont emparés du pouvoir exécutif à la faveur d'une erreur de tactique qu'aurait été la dissolution de 1995. Je dis aurait été car je me méfie des évidences et préfère toujours me fier aux effets à long terme de décisions qui paraissent trop évidemment négatives ou positives sur le moment. La question reste donc ouverte de savoir si la dissolution a été une erreur ou une manœuvre extrêmement subtile et qui produit aujourd'hui tous ses effets ? Qu'en pensez-vous ?
L'affirmation ainsi jetée dans la marre éclabousse toutes nos certitudes. Après tout, si on considère le présent comme un résultat d'une stratégie à long terme, Jacques Chirac a tout gagné, il a, comme on dit, raflé la mise après l'avoir centuplée. Cette manœuvre, je la laisse aux méditatifs politologues, qui sont encore loin, à l'heure qu'il est de se douter d'une pareille intelligence de la part de cet homme considéré pour le moins comme un personnage aux compétences limitées et surtout dépourvues de toute vue à long terme. Ce qu'on lui reconnaît volontiers en revanche, c'est une habileté tactique à toute épreuve, au point de faire de lui l'homme qui a dénoué Mai68, ce qui pourrait bien être vrai, mais aussi le tueur politique d'une bonne moitié des effectifs du monde politique, qu'ils appartiennent à l'adversaire ou à ses propres armées. Chirac passe pour beaucoup d'observateurs pour une sorte de demeuré veinard, possesseur de la fameuse " baraka " dont jouissait l'ex-dictateur Hassan II mais sur un tout autre plan. Ce qu'il faut désormais regarder de beaucoup plus près, c'est le plan, le scénario que ce monstre désormais incontournable, même au plan mondial -c'est dire- mitonne depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense en général et en particulier.
Ce scénario pourrait porter le nom de vengeance, car s'il y a une vérité que l'on peut avancer sans crainte de se tromper, c'est que Chirac ne travaille que pour lui, énorme révélation pour tous ceux qui comme moi ont longtemps été persuadé qu'il s'agit d'une pantin fabriqué par deux personnages de l'ombre dont j'ai longuement parlé dans plusieurs de mes chroniques et qui semblent avoir totalement disparu de l'horizon politique français. Je ne les citerai même pas ici, tant ils ont perdu toute l'importance qu'on leur attribuait au temps où Chirac faisait ses premières armes dans la varappe politique. Vengeance, mais quelle vengeance ?
Ici devrait s'interposer une analyse précise des relations qui ont existé ou qui auraient dû exister entre le personnage dont nous parlons et son mentor, ou celui qui a été considéré peut-être à tort comme tel, nous parlons du général De Gaulle. Mais nous ferons bref pour autant que les jugements de De Gaulle sur Chirac que nous connaissons sont rares et rarement flatteurs. De Gaulle n'avait que très peu d'estime pour celui qui prétendait prendre sa suite dans l'histoire de la Cinquième République, et on pourrait s'arrêter là et affirmer tout simplement que la vengeance n'a pour autre objet que ce mépris dont a souffert le petit Chirac dans les langes de la politique, alors qu'il n'était rien, rien d'autre qu'un pantin choisi pour des raisons sans doute d'une trivialité humiliante, trivialité qui entre dans la causalité de sa haine personnelle contre la camarilla politique française. Chirac n'a sans doute jamais autant haï un homme que pendant sa première Primature dans le gouvernement de Giscard D'Estaing. La vengeance qui guiderait donc son action encore aujourd'hui viserait donc dans l'ordre, le grand homme de l'Histoire contemporaine, De Gaulle en personne, et celui qui représente la bourgeoisie noblionnante classique depuis que Napoléon a bouleversé définitivement l'ordre du Who'sWho de l'aristocratie de sang plus ou moins bleu, le ridicule ex-Président de la Région Auvergne et ex-Président de la République, poste dont il s'est saisi à la Pyrrhus pour le rendre aussitôt que la démocratie a pu en juger, Valéry Giscard d'Estaing.
Bien sûr, ces deux personnages ne sont que des paradigmes qui valent pour nous lumière dans le fouillis affectif qui suit les entourages de ces deux personnages et les ensembles de forces de pouvoir qu'elles possèdent encore aujourd'hui. Retour à un Bayrou qui ne représente guère autre chose, et à son corps défendant, que les reliquats d'une bourgeoisie de notables qui firent les quelques beaux jours de la collaboration pétainiste. L'UDF a été et demeure malgré ses tentatives de se refaire une beauté, cette armée de branquignols qui ont tenté de s'opposer au gaullisme avec le sourire dents blanches haleine fraîches de quelques modernisants chrétiens-démocrates comme Servan-Schreiber ou même Gaudin. L'Alsace est et demeure le terrain le plus intéressant pour les analystes sérieux et désireux de comprendre cette Fronde-là, car l'Alsace, contrairement à ce qu'on vain peuple de journalistes pense, est un désert du gaullisme et c'est bien l'UDF sous ses formes les plus surréalistes - pensez au Socialisme de l'ancien Maire de Mulhouse, Emile Muller - qui tient le manche parfois sous le masque du RPF, de l'UNR, du RPR et aujourd'hui de l'inénarrable UMP. Cette Alsace représente bien plus qu'une exception française, elle est le modèle réel de ce qui reste du gaullisme, ou plutôt de son essence profonde, de ce que le gaullisme a toujours été, c'est à dire un non-parti, une cour plus ou moins versaillisée par un De Gaulle autocrate absolu, certainement plus absolu que ne le fut Louis lui-même.
L'objet de la haine, et donc aussi de l'ambition de Chirac, s'appelle donc le gaullisme, c'est à dire cette monarchie masquée par la guerre, élément qui manque cruellement à un homme qui ne songe qu'à parvenir à ce sommet historique qu'atteignirent que quelques Français, ceux qui ont fait notre Nation, de gré ou de force, la plupart du temps de force. Remarque importante car le déclin et la fin du général se situe exactement à cette époque-clé où il aurait fallu faire appel à la force pour conserver le pouvoir intact, Mai68, ce moment-clé également pour la carrière de Chirac qui prit alors le parti de la trahison de son modèle en refusant la politique de la force derrière l'intelligence machiavélique mais loyale de Georges Pompidou, le seul personnage qui avait la carrure spirituelle pour reprendre le flambeau des ambitions du général sans se salir à chaque pas par des compromissions dont Chirac faisait alors le moteur de sa carrière, conseillé en cela par des complices de l'ombre, eux-mêmes guidés par la haine du Grand Homme qui dominait tout, la politique et le rôle que la France était appelée à jouer dans les décennies à venir. Quelle paradoxe, mais quel paradoxe éclairant pour ceux qui demeurent perplexe devant les événements qui ont conduit à la formation de l'UMP, cette formation abstraite et effrayante de monstruosité structurelle : nulle formation politique française aujourd'hui ne contient autant de contradiction internes que l'UMP. Ce n'est ni un parti, ni une coterie, ni une Cour, ni un nid de comploteurs contre la République, ce n'est rien, c'est le vide stratégique, pratique et théorique, voulu par Chirac exactement comme ce que Louis préparait dans sa retraite versaillaise du temps de la Fronde. Mais Louis, lui, préparait une Cour, chose qui plairait sans doute à Chirac et qui paraît assez évidente à tous les analystes de la politique présente, et parvint à son objectif, ce qui changea la face de la France en préparant la grande Révolution qui donnerait pour des siècles à la France un statut unique, aussi puissant et aussi mystérieux que celui de la Chine. Cause première de la haine culturelle que nous vouent la plupart des pays avec lesquels nous créons ce qui porte le nom d'Europe. Hé oui, il ne faut pas se leurrer ou se voiler la face, nous les Français sommes seuls dans cet espace, condamnés à périr ou à vaincre, c'est à dire à imposer notre modèle contre lequel il n'en existe qu'un seul, celui qui se condense sous le label dont le négatif s'impose progressivement au monde entier, celui de l'ultralibéralisme, véritable cancer d'une démocratie dévoyée depuis l'échec de Cromwell et de la Réforme protestante dont les peuples de l'Europe centrale avait fait leur idéal sans taches.
Au résultat, nous avons un homme condamné à se servir de n'importe quel instrument pour parvenir à ses fins. Et moi qui a longtemps cru que ce grand Jacques était un vrai Jacques, vous savez, ces paysans qui portaient tous le nom de Jacques au point que leurs révoltes s'appelaient les Jacqueries, bouffées de violence sans lendemains mais marquées par des bains de sang que rien n'interdit de comparer à nos génocides contemporains du style Rwandais ou Tchétchènes. Non, Jacques est (ou est devenu par la force des choses, par exemple par sa légèreté morale dans l'usage de l'argent ?) un tyran en herbe, mais une herbe déjà desséché par tant d'échecs partiels qu'elle fait fonction de réalité définitive : Chirac ne sera jamais autre chose qu'un tyran en herbe, sauf à me tromper si radicalement qu'en réalité le scénario est déjà tellement avancée dans son élaboration que les événements sont appelés à se précipiter, ce que je pense vraiment : demain pourrait commencer, très vite et dans la surprise médiatique générale, le Pas de Quartiers chiraquien, une attitude que personne d'autre que quelques esprits avertis ou complices ne sont capables d'imaginer.
Que se passe-t-il réellement ? La France est-elle vraiment dans l'état dans lequel la presse a l'habitude de nous la présenter ? Un pays au bord de la faillite, de la pauvreté réelle - ce q u'il faut toujours traduire par le refus des banques (des grandes banques) d'accepter de faire crédit à l'état - un pays en cessation de payement ? Je n'en crois pas un mot, car qu'on le veuille ou non, le degré d'endettement du gouvernement reste bien en-deçà de ce dont on avait l'habitude avant que l'Europe n'impose à tous le fameux Pacte de Maastricht. Il est sans doute vrai que les divers secteurs de l'Exécutif n'ont plus les mêmes facilités de tirer des Douzièmes sur l'année à venir que dans le temps, manière de pouvoir continuer à fonctionner en l'absence d'argent dans les coffres. Mais globalement Bercy conserve certainement sa force d'attraction sur les banques internationales tout simplement parce que la France est un client solvable, il suffit de penser au sommes vertigineuses que Paris verse chaque année en intérêt à ces mêmes banques, qui sans ces intérêts cesseraient de faire des profits. Allons, toute cette représentation médiatique de notre " pauvreté " est totalement bidon, nous sommes et resterons, comme au temps des Louis, un pays riche qui s'est servi du temps, des siècles mêmes les uns après les autres, comme vaste accumulation de biens telle que peu de nations au monde, excepté peut-être les pays scandinaves, ne l'ont fait et n'on pu le faire. Le Royaume Uni est un autre exemple de cette richesse devenu subliminale, car il faut bien comprendre qu'il s'agit de puissance de crédit et non pas de lingots d'or, même si nous possédons l'une des plus grandes montagnes d'or du monde, ce qui n'a plus guère de sens, sauf lorsque, comme aujourd'hui, les grandes monnaies comme le dollar commencent vraiment à entrer dans des périodes de crise. Le Franc français, désormais noyé dans l'Euro, mais cette immersion n'est qu'apparente car les vrais comptes se font toujours dans les anciennes monnaies ( voyez Berlusconi se foutant publiquement de la monnaie européenne tout simplement par démagogie, sachant que les Italiens comme les Français ou les Allemands continuent de compter dans leur monnaies anciennes parce que la valeur des choses ne peut pas encore correspondre à cette nouvelle monnaie commune. Il faut avoir le courage de noter ici que cela signifie que la bataille de l'Euro n'est pas encore terminée et que les coups que les Américains ne cessent de nous porter à la baisse ou à la hausse continuent de fragiliser le corps financiers organique formé par l'assemblage des monnaies anciennes.
Bref, notre crise actuelle n'est pas une crise réelle au sens d'une catastrophe de nature à nous mettre hors d'état d'honorer nos dettes à terme normal. C'est une crise politique dans tous les sens de ce terme, une crise qui oppose les ambitions d'un seul homme à toute une nation, un homme qui a décidé de se servir des exigences ultralibérales des grandes banques, y compris pour commencer des Institutions dites internationales de la finance mondiale, dominée structurellement et politiquement par les Etats-Unis. Le Fonds Monétaire International, je ne le répéterai jamais assez, est structurellement la chose des Américains, tout simplement parce qu'ils possèdent la majorité absolue au conseil d'administration de ce qui n'est rien d'autre qu'une banque comme les autres. J'ajoute que le principe démocratique qui régie ces institutions pourraient inverser le cours des choses, car si l'Europe réussissait à prendre les voix des dizaines de petits pays que Washington achète chaque année en dollars sonnants et trébuchants (voilà le seule et unique corruption qui affecte en profondeur le monde et les relations politiques - exemple l'attitude de certains pays européens lors de la crise irakienne, qui s'est demandé au nom de quels intérêts ou de quel esprit de lumière la Pologne ou l'Espagne ont pris le parti d'aller guerroyer en Irak ? Elles l'ont fait parce qu'elle sont endettées jusqu'au coup en dollars, dollars généreusement distribués par les Américains il y a déjà très longtemps, c'est à dire dès que la conjoncture de la guerre froide s'est brutalement inversée. C'est exactement le même procédé que Washington a utilisé à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale en déversant des tombeaux de dollars sur l'Allemagne et le Japon, faisant de ces deux pays les futures locomotives de l'économie mondiale et les plus sûrs alliés de l'Amérique et de sa politique. Chirac a choisi ce genre de trahison et les visites que Chirac rend à Bush sont les vrais grands moments de sa politique étrangère, mais, s'agit-il encore d'une politique étrangère ou de la confirmation régulière de l'allégeance de la droite française au géant d'outre-Atlantique ? Nos relations avec la capitale américaine se résument en deux faces : d'un côté un anti-américanisme de façade, bien mis en valeur avec le talent français dans l'opinion publique et sur la base de décision apparemment vertigineuses comme celle de refuser d'aller au casse-pipe en Irak, et de l'autre les séances de tête-à tête Bush-Chirac où les deux hommes se réassurent réciproquement de la bonne marche de leurs plans à moyen et long terme.
Alors ? Quel est ce scénario ? Il est et demeure simple depuis l'exemple mis en chantier par l'ennemi personnel de Chirac, qui au fond n'a plus qu'à imiter ce que Valéry Giscard d'Estaing avait largement entamé, à savoir la tiermondisation de la France, la transformation de l'Europe qui doit sortir de son statut de grande puissance et structurer ses peuples comme de simples salariés dominés par le grand DRH américain. Chirac nous trahit, tout simplement, il nous donne aux Américains pour garder son pouvoir personnel et pas seulement pour le garder mais pour en faire un événement historique tel que personne encore, à part le fou que je suis, n'oserait encore l'imaginer : nous allons, nous risquons d'avoir à moyen terme en face de nous un Papachirac ou un Papajacques comme d'autres ont eu leur PapaDoc ou leur BabyDoc. Suis-je assez clair ? Si vous hésitez encore à me croire, ou à commencer au moins de réfléchir dans les termes que je vous propose, alors répondez à cette question terrifiante : comment peut-on expliquer historiquement qu'un délinquant de la taille de Chirac, dont les détournements de fortunes immenses n'ont pas seulement servi les intérêts de son parti mais d'abord ceux de sa propre jouissance, continue de trôner au Château, de servir d'exemple à la jeunesse française et à tous les corps constitués de notre République ? Oui, il faut désormais le reconnaître, nous avons une sorte de Louis XV à l'Elysée, un Roi qui fait ce qu'il veut, quand il le veut et comme il le veut, ayant eu la chance de surcroît de découvrir des personnages aussi dénués de scrupules que lui, jouant pour ou contre lui, ce qui est indifférent en termes politiques, mais qui possède ce génie de la double face du républicain servant en réalité le despotisme dont il a lui-même une ambition aussi féroce que le grand Jacques auquel il s'est allié par opportunisme. Il y a là, d'ailleurs, un vrai duel tel qu'on en voyait dans les siècles passés, un duel au couteau où on ne cherche pas à réparer une atteinte à l'honneur, met à mettre l'adversaire définitivement en pièces, à le tuer.
Au résultat, la réalité telle qu'elle continue de se dérouler partout dans les arcanes de la République, mais je pense qu'on ne peut plus parler de République, il faut avoir le courage de reconnaître que notre république est morte, morte depuis longtemps déjà, au point que les soins d'urgences, les soins intensifs que lui ont prodiguée quelques représentants de la Gauche elle-même désorientée parce qu'elle refuse d'admettre le diagnostic que j'avance. Jospin a très bien travaillé, il a fait en sorte que même hors du jeu, Chirac ne peut pas avancer au rythme qu'il souhaiterait, le rythme que lui impose les banques par sourires bushiens interposés. Chaque fois que Chirac se retrouve dans le salon ovale, Bush lui dit en souriant jaune : " ça traîne, Jacques, qu'est-ce que tu fous ? Wall-Street en a marre de tes atermoiements, il faut foncer, les Fonds de Pension attendent, nous en avons marre de ne pas pouvoir nous servir de l'argent de tes Français de merde, alors grouille-toi ou il t'arrivera bientôt des choses désagréables du genre de celles que tu as déjà connues par le passé et que nos services sont prêts à déclencher du jour au lendemain. Tu sais bien qu'on a pas besoin du Canard Enchaîné pour te mettre dans la merde, ce dossier que tu vois là peut te liquider en vingt-quatre heures ". Tout cela avec le sourire du Parrain le plus vulgaire de la planète, un parrain que les Américains découvrent tous les jours un peu plus en compagnie de sa négresse de service dont l'esthétique corporelle rassemble toutes les tentatives de séduction et tous les traits de la laideur morale la plus patente. Rice, elle s'appelle riz, comme celui qui a précédé les GI's qui ont glissé sur la peau de banane de la Somalie et qui sont en train de subir le même sort en Irak.
Il faut par conséquent s'attendre à ce que le gouvernement Raffarin III applique exactement la même politique que les précédents en durcissant encore, si c'est possible, les contenus et le rythme des " Réformes " qui doivent faire enfin refluer tout notre argent vers les comptes des grandes banques. Nos cotisations, les millions d'Euros que les salariés français et européens versent chaque mois à des institutions censés nous garantir notre santé, notre probable chômage et même l'Education de nos enfants, ces cotisations n'iront plus consolider ce qui fait la richesse sociale de notre pays, mais enrichir comme au casino les dividendes de sociétés de gangsters qui écument déjà les trois-quart des pays du monde de la même manière. Il faudra donc détruire tout le socle de garantie républicain auquel nous devons notre véritable richesse, celle de l'assurance d'un destin paisible, d'une vie d'où la souffrance est contenue sinon totalement éradiquée et d'une mort en harmonie avec cette vie à laquelle nous sommes parvenus à nous hisser malgré deux terribles guerres qui auraient pu et dû détruire toutes les structures rationnelles de la vie sociale. Pensez-y, ouvrez vos yeux et regardez autour de vous : vous pouvez encore voir partout des personnes d'un certain age, bien mises et la mine encore sereine. Vous pouvez encore visiter des maisons de retraite où les femmes et les hommes sont traités en femmes et en hommes, mais dépêchez-vous, elles vont fermer, disparaître, du moins pour ceux dont les revenus se situent en-dessous de ce que gagne aujourd'hui le cadre supérieur dont le salaire font rêver les subalternes. Si Chirac parvient à ses fins, nous deviendrons un pays du Tiers-Monde, tout simplement, c'est à dire que nous entrerons dans le monde que l'Amérique est en train d'homogénéiser pour en faire une vaste entreprise possédant tous les pouvoirs sur toutes les richesses qui gisent sur et sous la terre, poussent en forêts, s'ébattent dans les flots des océans et sifflent encore sur nos toits printaniers, mais surtout tous les pouvoirs sur toi et moi, sur nous. Nous ne deviendrons jamais les citoyens du monde mais les sujets de l'entreprise Amérique ou de l'entreprise qui par essence ne pourra même pas porter de nom, le nom étant ce qui identifie un sujet qui existe. Nous deviendrons les coca-coliens de l'univers, événement prophétisé par cette bande dessinée où l'on peut voir écrit en grand sur la Lune le nom de cette boisson qui deviendra le sang de notre corps historique. J'arrête de délirer mais pas avant de vous avoir prévenus, préparer les mouchoirs mouillés, les manches de pioche et les casques de motards que nous portions il y a une trentaine d'années dans les rues de notre République en danger. Cette fois, il faudra peut-être y ajouter l'équivalent de gilet pare-balles, car il ne fera pas de quartiers, cette fois.
Lundi 12 avril 2004
Annexe au texte qui précède.
Le portrait, si on peut appeler cela un portrait, de Jacques Chirac, diffuse un malaise logique que l'on ne peut comprendre qu'à l'étudier dans son contexte, toujours le contexte ! Les penseurs du politique ont, en effet, pris l'habitude depuis Marx et bien d'autres à commencer par Durkheim, à penser le politique comme un phénomène global et largement indépendant de la volonté humaine, ce qui tire un trait sur toute la politologie d'Aristote et de Machiavel, science jusque-là pour ainsi dire régulatrice de toute notre culture politique. Ce que j'ai écrit hier sur Chirac peut donc paraître d'une immense naïveté, comme si l'avenir de la France pouvait résider dans les sentiments, les affects et en définitive la volonté d'un homme identifié sous le nom propre de Chirac. Alors que le monde est lui-même en proie, dit-on, de mouvements historiques qui ne font de la France, voire de l'Europe qu'une bouchée insignifiante ! Que dire alors d'un homme, un homme seul, non seulement une unité sociologique, mais une solitude qui reproduit l'image classique de la position du despote qui ne survit que grâce à sa capacité à opposer entre eux les forces mêmes qui le soutiennent. Autrement dit il y a là un problème de logique historique assez classique finalement, mais qui prend une forme brûlante puisqu'elle détermine notre présent, notre destin immédiat. On pourrait alors traiter cette difficulté en posant une question simple : pourquoi le destin d'un Chirac peut-il peser sur le destin plus vaste de l'Europe, voire, puisque aujourd'hui, comme nous l'avons souligné hier, tout se conçoit au plan du planétaire, du monde entier ?
Le véritable politique ferait-il un retour brutal et tonitruant sur la scène feutrée d'un monde où la silhouette fluette et ridicule d'un Bush fait plus rire que pleurer alors même qu'il décide de la plupart des horreurs qui se manifestent ici et là à travers la planète. Ce n'est pas seulement le regard chauvin d'un Français (à moitié français comme moi, il faut le dire et le préciser) qui fait de Chirac un monstre comparable à la statue du Commandeur, mais je pense sincèrement que la stature de Chirac vaut largement celle de Bush dans la conscience de tous les hommes de cette planète, dans la condition sine qua non que ces hommes pensent le politique au lieu de simplement le subir ou le nier. Cette stature imposante, on peut déjà tout simplement la constater lorsque les deux hommes sont photographiés ensemble, debout ou assis l'un à côté de l'autre. Prenez un autre exemple, Blair ou Schröder, Aznar ou Juncker (qui c'est çui-là ?), et vous ne sauriez nier que Chirac prend le pas sur tous les hôtes que Bush reçoit dans ses terres, et, finalement sur Bush lui-même. Etrange phénomène encore intensifié par la décision scandaleuse dans le contexte politique du vingt et unième siècle de ne pas se soumettre au plan anti-Saddam Hussein du grand patron du monde ! Lorsque les deux hommes se virent pour la première fois après que Chirac et Schröder eurent pris leur décision sacrilège, on a constaté que Bush ne voulu même pas serrer la main de notre Président, ce qui est une manière de plouc, je dis ça pour ne pas s'appesantir sur le caractère diplomatiquement invraisemblable de ce geste honteux pour la démocratie mondiale (si si, analysez scrupuleusement et vous verrez qu'une poignée de main peut décider de la démocratie, il suffit de se souvenir des traitements qu'infligeait Hitler à ses invités tchèques ou polonais). Et pourtant c'est l'image de Chirac qui dominait très nettement sur celle d'un petit bureaucrate du Sud cowboyesque qui s'imposa dans le couloir ou le salon de l'ONU où se déroulait cette petite scène qui ne fit pourtant de loin pas tout le bruit qu'elle aurait dû faire. Réaction qui montre que même les médias eurent, ce jour-là, peur de ce qu'ils montraient au monde entier. Si l'on refait les comptes de cette journée, on pourrait faire des comparaisons, et imaginer un instant Louis XIV lui-même tourner le dos à un souverain de passage, par exemple Pierre le Grand, souverain certes d'un immense pays, mais véritable nain politique en face d'un Louis qui dominait réellement le Monde de cette époque, si l'on accepte de rester dans une dualité planétaire qui n'est pas prête de disparaître et qui donne à la Chine un statut particulier et unique. La Chine a été, est et restera sans doute pour longtemps encore, le seul pays qui échappe à toute comparaison possible dans tous les termes imaginables d'une telle comparaison. C'est simplement pour rappeler que pour l'Empereur Ming de l'époque, Louis n'était qu'un petit paysan lointain à moitié analphabète et d'une grossièreté ontologique qui faisait rire la Cour de Pékin même en présence des représentants les plus éminents de cette France qui paradait de l'autre côté du monde. Bref, ce que l'on représente est toujours, presque toujours plus important que ce que l'on est, et Bush, qui voulut ce jour-là humilier ce petit Européen insolent fut pris à son propre piège et perdit sans doute une grande partie de son prestige international pour le seul plaisir de caresser le sentiment anti-français traditionnel de ses Américains.
Sur le moment même cet épisode n'a pas été vraiment analysé, suffisamment soupesé dans le contexte d'une veille de guerre dont le cours est loin d'être achevé alors que le Président américain a déjà déclaré la victoire depuis plus d'un an. Si bien qu'on ne vit pas du tout ce qui allait réellement se passer, ni sur le terrain même du conflit, ni dans les équilibres politiques mondiaux qui étaient tout bonnement en train de changer radicalement de sens : on peut dire que la non-poignée de main Bush-Chirac fut l'heure H d'un retournement de situation gravissime pour l'avenir de l'Amérique, peut-être cet sorte d'instant où une époque prend fin, où tout bascule pour accoucher d'une nouvelle réalité, comme le dit si bien la phrase de Hegel que je cite souvent avec plaisir mais dont je vous ferai grâce aujourd'hui. Car il faut bien prendre conscience des faits : d'un côté on put constater brutalement le divorce patent entre deux puissances pour ainsi dire d'une même famille, de l'autre on pu prendre conscience de la valeur politique d'une personnalité, on put assister à la naissance d'un homme politique qui, jusque-là, passait plutôt pour un play-boy de la réalité historique présente. Ce jour-là Chirac changea de statut pour le monde entier, car n'oublions pas que si le grand Jacques est l'objet de quolibets quotidiens dans son propre pays, au moins d'une ironie qui gagne même son propre clan, il demeure pour nos voisins les plus proches un homme d'état comme un autre, mais un homme d'état qui commande aux destinées de l'un des plus grands pays de l'Europe de demain. Double, triple naissance dont l'impétrant lui-même n'était pas vraiment conscient, tant cet individu ne fonctionne (pardon pour ce terme insultant) qu'au réflexe, qu'à l'action immédiate dont la portée n'est jamais soupesée autrement qu'à partir des données " immédiates de la conscience " comme dirait Bergson. Chirac est tout le contraire d'un Clemenceau ou d'un Talleyrand, artistes du politique, araignées besogneuses de leur présent et d'un lointain avenir dont ils avaient déjà une idée.
Chirac n'a aucune idée, et c'est ce qui le sauve, c'est ce qui fait toute l'efficacité de sa tactique et de sa stratégie : c'est l'homme de la surprise, se surprenant sans doute lui-même de certaines décisions absurdes comme celle de la dissolution qui parut alors si catastrophique pour le commun des mortels, commun des mortels et moins communs qui n'ont jamais cessé un instant de qualifier cette dissolution comme faute politique majeure, contrairement à ce que je suis sans doute l'un des seuls à penser. Chirac n'est pas assez idiot pour avoir pu penser un seul instant qu'il pouvait ramasser la mise en mettant en jeu d'un seul coup tout le capital de pouvoir démocratique qu'il possédait. Je perdrai un jour le temps qu'il faudra pour montrer pourquoi cette dissolution fut une bénédiction pour la carrière de l'actuel Président de la République, mais il suffit, me semble-t-il de jeter un coup d'œil sur tout ce qui a suivi pour se voir contraint d'admettre qu'il devait, quelque part, avoir eu raison de renvoyer chez eux et au chômage politique sa propre armée alors qu'elle dominait absolument la scène. Pourrait-on aller jusqu'à refaire toute une analyse de la carrière de Chirac en partant exclusivement de ce qui a toujours passé pour ses erreurs ? Un politique qui avance en reculant ? Ce n'est ni exclu ni nouveau dans l'histoire que nous connaissons, je pense notamment à l'un des héros romains que j'ai toujours admiré et qui pourtant ne passe même pas pour tel sauf chez un Plutarque et encore, à savoir Fabius, étrange homonyme d'un autre Fabius qui n'est pas loin de faire une carrière étrangement parallèle à celle de Chirac, et dont nous entendrons encore longtemps parler, mais là, il y a des éléments hétérogènes difficiles à démêler et des réalités incontournables lorsqu'on a affaire à un peuple aussi chauvin et vaniteux que celui qui forme la nouvelle Gaule. De Gaulle ! Renaissance de la Gaule, banalité qu'on a trop longtemps méprisée dans les analyses et les synthèses savantes de nos observateurs. Mais tout viendra en son temps, pourvu qu'il ne soit pas trop tard en un temps qui se prétend réel.
Pas de quartiers. Que peut bien signifier cette sombre prévision dans le contexte que je viens de retracer. En dernier ressort quelque chose d'assez simple, en fait le fond du caractère d'un homme qui a réussi à se hisser à la position d'autocrate, ce qui est un véritable exploit dans un monde où le mot démocratie détermine l'alpha et l'oméga de toute procédure qui prétend avoir une place dans la cohérence du mouvement mondial. Au fond, nous avons découvert ici l'un des secrets de la réussite Chiraquienne : cet homme se sert de la démocratie pour l'étrangler, ancienne recette qui marche toujours à condition d'en connaître les ressorts et d'avoir le courage de prendre tous les risques qu'elle exige. Il me vient à l'esprit un grand nom de l'histoire dont le comportement correspond trait pour trait à celui de Chirac, ce nom est César, auquel on pourrait même ajouter Néron, deux despotes qui furent les empereurs les plus populaires de leur époque, une popularité que ne pouvait abattre que le tranchant d'une lame bien affûtée et bien dirigée. La politique de Chirac s'appelle donc tout bonnement le culot, et c'est peut-être ce qui le distingue des deux personnages auxquels je viens de faire allusion. Notre Président de la République est sans doute l'un de nos monarques les plus culottés que nous ayons connus et je suis assez persuadé qu'à l'instar de Napoléon ou du général De Gaulle lui-même, Chirac n'est pas un pleutre et qu'il possède un courage physique réel, ce qui est la marque suprême des grands hommes, quoi qu'on en dise et qu'on en pense.
Et c'est sur cette remarque que nous parvenons au cœur de l'annexe que nous estimions nécessaire pour bien comprendre le personnage et ce qui nous attend de sa part s'il se trouvait que sa carrière se trouve compromise par les réactions souvent vives de nos concitoyens. Il reste trois ans à Chirac pour accomplir, il faut bien prendre conscience de cette conjoncture, les travaux d'Hercule qui peuvent sauver sa figure historique. J'ai presque toujours été convaincu et je l'ai souvent exprimé dans cette chronique, que Chirac n'avait aucune conscience historique et qu'il se fichait éperdument de ce que les manuels diraient de lui dans les siècles à venir (si ce genre de littérature n'est pas condamnée à disparaître, ce qui me paraît assez fatal). Hé bien, je commence à croire que je me suis toujours trompé, et que l'ambition de cet homme " fabriqué " par un petit clan de Machiavels à la solde de De Gaulle, est d'une envergure bien plus ample que qui que ce que soit ne le pense. Or tout le destin de ce pays, notre destin, a toujours dépendu de la nature des ambitions de son souverain. Dans la mesure où il semble devenu évident que Chirac possède tous les pouvoirs, y compris celui de trahir la Constitution quand et où bon lui semble, notre destin est entré dans une dépendance directe de cette question : QUI est Chirac ? La fameuse injonction de Nietzsche : " Deviens qui tu es " nous donne le cadre de la question, car Chirac, comme nous tous, DEVIENT quelqu'un. Qui ? C'est le véritable mystère dont dépendent les événements qui vont marquer les semaines et les mois à venir. Ce que j'ai essayé de faire passer dans ce texte sans doute un peu surprenant, c'est le fait que Chirac a réussi largement à identifier sa carrière à celle de notre République. Cet homme a réussi en grande partie à se défaire des paramètres politiques de l'existence de n'importe quel souverain aujourd'hui, ce qui signifie qu'il a atteint une solitude pratique et théorique qui lui permet de faire n'importe quel choix, d'opter pour n'importe quelle politique et de changer quand il le voudra de politique, quels que soient les conditions, les fameuses " conditions réelles " de l'exercice du pouvoir.
Chirac n'est ni un Bonaparte, ni un Boulanger, et c'est cela qui est important. Il est un animal politique assez pur, très proche de la définition aristotélicienne de l'homme, constat assez rassurant d'un certain côté car cette qualité lui conserve une plasticité pratique et théorique qui le préserve de tout engagement fixe et de toute rigidité morale qui devrait le conduire mécaniquement vers les objectifs qui caractérisent sa famille politique d'origine. Dans les faits, Chirac s'est débarrassé de l'encombrant devoir de se faire la réplique du Général De Gaulle, et ce faisant il a réinventé un style de gouvernement qui avait totalement disparu de notre histoire. Je ne le pense ni prisonnier des " deux cents familles ", ni dépendant du courant massif du néolibéralisme qui ravage la planète, pas plus qu'inféodé à quelque Baron que ce soit. Curieusement, Chirac est devenu la planche de salut de presque tout le monde, il a détruit tout ce dualisme idéologique qui mange le discours et la pensée politique depuis des décennies, depuis la mort politique de celui qui reste malgré tout son mentor, cet homme qui se hissa dans les sommets de l'Histoire contemporaine par le moyen des deux péchés mortels de la citoyenneté banale, la désertion et la désobéissance. Chirac désertera et désobéira, et ce futur fera toute l'originalité de sa vie et de son parcours, il aura tout fait à l'envers, méthode qui créé la surprise fatale à ses adversaires au fur et à mesure que l' anarchie apparente de sa démarche se manifeste de plus en plus ouvertement. Oui, Chirac est devenu un personnage fascinant et les Guignols ne s'y sont pas trompés dans les années quatre-vingt lorsqu'ils décidèrent de faire sa carrière médiatique et de gommer sa principale imperfection qui était son mésusage de la télévision. Il faisait peur, il ne fait plus peur. Il irrite, provoque la colère et l'amertume, le scandale quotidien et même souvent la honte d'être français. Mais il sait aussi faire le contraire au point de créer une confusion qui est plus qu'une évolution anormale de l'opinion publique, mais peut-être la véritable nature ou l'essence de ce peuple celte, profondément sceptique mais d'un scepticisme gai et convivial, convivial comme Chirac sait l'être, ou plutôt comme il l'est toujours, pour n'importe qui, ses adversaires comme ses amis. Pas de quartiers pour ceux qui ne vont pas entrer dans cette fête libérale, d'un libéralisme nouveau et qui préfigure peut-être une vision rien moins que géniale de l'être-là du citoyen de demain. Il n'est pas indifférent que l'analphabète de Corrèze soit un amateur de poésie chinoise : il n'y a pas de source plus pure d'humanité que cette poésie et nous serons certainement un jour époustouflé par le produit de la culture de cette poésie chez un " plouc " qui n'est pas loin de ressembler comme un frère à celui qui est devenu le seul héros français restant, à savoir Astérix flanqué de son Obélix à demi-idiot, d'une immense générosité mais d'une gloutonnerie cosmique, le grand défaut de ces Gaulois, et le plus dangereux.
Dimanche 18 avril 2004
Le mensonge de la conscience.
Je ne suis pas sensible à la colère, et il faut me frapper durement et avec entêtement pour me faire sortir de mes gonds. Cela dit, mes courroux sont terribles, ou l'ont été car je pense que mon âge, mais peut-être me trompé-je, me met à l'abri de ces terrifiantes manifestations qui ont si souvent, hélas, sidéré tous ceux qui les ont vécus. Or il existe aussi un courroux spirituel qui couve en-deçà ou au-delà de tous les comportements visibles ou tangibles et qui ne trouve aucun objet immédiat d'application. Cette colère morale je la possède comme une sorte de réflexe intérieur stocké une fois pour toutes et qui, lorsqu'elle se manifeste ne fait de mal qu'à moi-même. Il en va ainsi du débat sur la conscience et sur tout ce qui s'articule autour de sa compréhension, de son concept et des mouvements qui peuvent la décrire. Ma colère éclate alors désespérément, avec la certitude d'une vacuité et d'une inutilité qui ne peut me conduire qu'à la décrire ou à l'écrire ici dans cette chronique où je peux, pour ainsi dire, m'analyser moi-même sans faire de mal à qui que ce soit. C'est la grande liberté de la théorie, lieu où personne ne peut vous museler, même si, par la suite, il se peut que votre insolence vous vaille de graves ennuis. L'exercice de la liberté de " conscience " est le plus dangereux de tous les comportements car il heurte de front précisément les courroux intérieurs des autres, et malheureusement la plupart de ces autres ne sont pas capables de limiter l'expression de leurs sentiments à la critique spirituelle ou intellectuelle, et ne se privent pas d'exercer à l'occasion et si leur position le leur permet, des actions de répression ou de punition qui peuvent aller jusqu'à ce qui est arrivé à des grands poètes comme Villon ou Boèce. Boèce a donné sa vie sous la torture pour avoir choisi de dire et de répéter le fond de sa pensée.
Donc je vais parler du courroux qui saisit mon esprit lorsque j'entends parler de la naissance de la conscience, de la " conscientisation " de l'être humain, de l'affirmation absurde et totalitaire que l'on peut apporter la conscience à autrui. Cette affirmation me rend fou de colère en mon for intérieur, et lorsque l'occasion m'en est offerte je n'hésite pas un seul instant à l'exprimer de toutes les manières possibles qui vont de la courtoise discussion jusqu'au cri de colère et de négation de ce que l'on ose prononcer devant moi. Combien de fois me suis-je exposé au danger en réfutant sans appel la fameuse notion de conscientisation chère à tous les staliniens ou léninistes du monde, ces hommes qui pensent que sans les " formateurs " et sans " l'organisation ", les hommes demeurent des bêtes idiotes et inconscientes de leur véritable état, de la nature et des qualités de leur existence. Bien entendu, la notion d'éducation bourgeoise ne dépare pas du même préjugé et repose le plus souvent sur la même idée que l'homme n'a pas d'autre conscience que celle qu'on lui greffe par le moyen de l'Ecole ou de la famille. Alors que, bien entendu, il s'agisse toujours, non pas de formation ou d'éclosion de la conscience, mais de dressage pur et simple des générations destinées à répéter à conserver et transmettre les valeurs qui ont fait et préservé les intérêts de du clan, ou de la Nation. Dans les deux " camps " historiques du conservatisme et du progressisme il y a un objet commun qui est précisément cette idée que le petit de l'homme est dépourvu de toute conscience réelle du monde et qu'il faut la lui inculquer, quelle expression !, lui inculquer la réalité. Lui inculquer la réalité, car ce n'est de rien de moins qu'il s'agit : vous montrer comment sont les choses, la vérité de ce qui se présente comme un simple étant, comme un simple objet de votre perception. D'où ces cours stupides et mensongers sur la différence entre la sensation et la perception, cette dernière étant censée être le produit d'une élaboration conceptuelle des sensations par le moyen de la culture et de l'enseignement, de l'exercice imposé par les maîtres.
Ni Dieu ni maître, voilà ce que pensent beaucoup d'entre-nous, en oubliant souvent de préciser que les maîtres ne sont pas forcément des despotes qui décident de tout, mais souvent seulement de simples instituteurs, de simples formateurs qui débitent eux-mêmes comme des ânes des vérités qu'ils n'ont jamais eu l'idée de critiquer. D'ailleurs je dois faire un aveu : j'ai longtemps cru que ma conscience rebelle était née grâce à des entretiens et des lectures dont je n'étais en rien le sujet, j'ai longtemps été dupe de cette idée qu'un jour ma conscience a " pris ", qu'elle passait d'un statut de virtualité à celle de réalité rationnelle et qu'à un certain moment, quelqu'un m'avait mis sur le droit chemin de la vérité. Je suis né dans une famille déchirée dans le pire moment de l'histoire de notre pays, celui où il fallait choisir entre la résistance et la collaboration, et malheureusement c'est logiquement le second clan qui a survécu et pris en main mon éducation condamnée dès lors à la bigoterie et à la réaction la plus traditionnelle en ce pays d'Alsace voué aux curés depuis la nuit des temps. Mon père m'a abandonné au moment le plus urgent dans la vie d'un enfant et je fus livré pieds et poings liés à ces hommes de Dieu et à leurs vaticinations ridicules et mensongères. Lorsque donc les longues discussions que j'eu le privilège de pouvoir entretenir avec un ami formé autrement que moi m'ouvrirent les yeux sur une autre réalité, celle de la lutte des classes, j'ai bien eu cette impression que ma conscience était en train de naître et que toute ma vie passée n'avait été qu'un parcours d'aveugle dans un monde formaté sur le mensonge religieux et réactionnaire. Tout le développement qui suivit, et dont la première étape fut une formation rigoureuse au marxisme, me parut alors logiquement correspondre avec ce que Lénine disait de cette conscientisation des hommes, naissant pour ainsi dire privés de conscience autonome et de liberté spirituelle. Je devenais un " cadre " disponible pour tout " parti " qui militerait en faveur de cette idée de la Révolution salvatrice du genre humain.
Il me fallut de longues années pour en revenir, pour comprendre que la théorie marxiste fonctionnait de la même manière que les théories adverses, théories évidemment diluées dans la réalité sociale, économique et politique, la théorie était devenue un autre maître dans mon esprit, un maître qui fit certes de moi un grand " dialecticien ", mais d'une dialectique étroitement engagée dans un carcan théorique dont je n'étais alors plus " conscient " du tout. Par bonheur il y a dans mon caractère une qualité qui me permit de ne jamais m'engager entièrement dans l'action qui découlait de cette théorie, et les sensations que me procuraient les contacts avec le monde politique qui représentait cette thèse me préservèrent d'un tel engagement. Ce que je pouvais percevoir de ces organisations me rebutait par son évidente hypocrisie pratique, le fossé qui séparait leurs grandes idées et l'application pratique, la praxis concrète des hommes " organisés ". Mon dégoût était tel qu'en définitive je n'ai jamais figuré sur aucune liste de membre de ceci ou de cela. Jamais. Et on ne me le pardonna jamais. Jamais. Plus tard je m'inscrivis au parti socialiste, quelques mois avant le grand chambardement de 1981, mais cette initiative était intellectuellement contrôlée et n'avait qu'un but tactique et stratégique qui ne parut nécessaire à ce moment-là, comme il le fut d'ailleurs pour des millions de Français qui décidèrent alors de ce débarrasser de cette droite qui régnait pratiquement depuis la Libération. Je veux insister sur ce fait, mon adhésion a été un geste ou une option vraiment politique au sens que je sentais pour la première fois la possibilité d'un changement dans la Cité et que ce changement était nécessaire. Pour être conforme ou logique avec moi-même je crus nécessaire d'aller jusqu'à devenir membre du Parti qui prônait ce changement, mais je n'ai jamais alimenté la moindre ambition politique personnelle ni le sentiment que ce Parti représentait alors le salut définitif du pays. Disons que mon geste fut conjoncturel au même titre que peut l'être une décision de voter blanc plutôt que rouge ou noir. Il n'y avait là aucun problème de " conscience ".
Et d'ailleurs le triomphe fragile de Mitterrand me confirmait dans l'idée qu'on ne pouvait pas manipuler médiatiquement les consciences des citoyens, que la conscience avait une vie propre que seule la violence pouvait faire vaciller, dans la mesure où l'homme est un animal dominé par la peur. La seule véritable " conscientisation " ne pouvait donc provenir que de la menace ou de la peur de l'avenir et jamais d'une formation reposant sur un savoir de la vérité théorique de l'ordre du monde et de son salut. J'avais donc depuis bien longtemps abandonné cette idée absurde qu'on pouvait enseigner la conscience, la former en direction de la vérité autrement qu'en la laissant libre d'être ce qu'elle est en chacun de nous dès notre naissance. Après avoir avalé avec rage et une sorte de gloutonnerie tout le marxisme ainsi que ses origines proches et lointaines, hégélianisme et humanisme, je me suis un jour retrouvé vide, privé de tout repère spirituel, de tout fondement intellectuel qui pouvait me donner des assurances sur mon action et sur mon destin. Après avoir " pris conscience " de l'escroquerie des organisations et des écoles, à commencer par la grande école de l'Université, je demeurai comme stupide, saisi par une sorte d'angoisse ontologique infinie qui me plongeait dans une souffrance que l'alcool et la vie débridée ne parvenait qu'à grand peine à limiter au point de me conserver quelque goût pour la vie. Ce tournant fut décisif car il me ramenait aux origines, à mes origines et à mon évolution depuis les rencontres qui avaient donné un tour théorique unique et totalitaire à mes pensées. Je me souvins alors de mon enfance et de ce que ma conscience me disait avant qu'elle ne fut ornée de dialectiques artistiques et philosophiques de toutes sortes. Et cette enfance était une enfance de l'étonnement et de la sensation permanente du mystère de ce qui existait. La découverte et la lecture de Martin Heidegger vint donner de la chair à cette anamnèse, incarner théoriquement l'état dans lequel je me trouvais avant de rencontrer les conscientisateurs de tout poil. Je me retrouvais seul avec ma liberté de recevoir le monde à ma manière et de prendre les décisions pratiques qui s'harmonisaient avec cette liberté. Il me fallut deux décennies pour commencer à comprendre le message théorique de Martin Heidegger, c'est à dire à aller jusqu'au point où je finis par déceler chez ce grand homme le même instinct de formateur, de dialecticien chargé par la Tradition hégélienne de conserver le monde dans un état E qui n'était pas le mien, qui n'était pas celui que ma conscience libre me livrait dans le temps et l'espace de mon existence. Mais ces longues expériences théoriques et pratiques - car je n'ai jamais accepté de laisser diverger mes actes et mes pensées - me mettaient pour ainsi dire à l'abri d'un nouveau Credo, d'une nouvelle croyance, et je ne devins jamais un " heideggerien " pur et dur, ce qui m'était largement facilité par l'honnêteté manifeste du grand homme lui-même qui n'a jamais demandé à quiconque de le devenir.
Mais ma blessure était refermée et aux environs de mes quarante ans je découvris qu'il me restait à prendre la vie, l'existence, à bras le corps, libre de tout préjugé et de toute tradition fallacieuse, sans pour autant rejeter sans discernement ce que me livrait le passé, la véritable Tradition, le discours secret et inaudible qui traverse le temps des hommes et le leur propre, le temps de la conscience, unique " chose " qui nous permette de nous distinguer des autres objets du monde, et en même temps de nous en rapprocher essentiellement en nous enseignant le respect pour ce monde présent de sa présence dans notre esprit. La présence devenait ainsi le grand objet de mon interrogation. Le " pourquoi " de mon enfance regardant le ciel nocturne était revenu au premier plan de mon travail spirituel et conceptuel et tout le reste me parut alors d'une vanité et d'une vacuité repoussante et triviale. L'homme de l'occident, l'homme du " miracle grec ", de l'incarnation divine et du Concile de Nicée m'apparurent alors dans toute leur nullité passagère et infiniment petite dans le destin de l'Homme en tant que tel. L'Histoire cessa pour moi de commencer avec la naissance de l'agriculture et de la Cité mais longtemps avant, même Lucy s'inscrivait déjà dans mon esprit dans une Tradition beaucoup plus ancienne et beaucoup plus essentielle, dans la dimension fondamentale de l'Être, cette dimension dont nous avons perdu tous les repères au point de nous livrer à une destruction systématique de la réalité, à une invasion humanoïde de l'étant et de l'univers et de devenir ainsi les futurs monstres qu'une autre civilisation pourrait rencontrer dans un coin de l'univers si le temps nous est donné d'un jour le parcourir. Mais il me semble que le seul but certain que les hommes d'aujourd'hui aient placé en tête du menu de leur être-là soit le néant. D'où cette certitude moderne et ridicule de l'absurdité de l'existence et cette rage de sentir n'importe quoi et n'importe comment pourvu que ça bouscule, que ça " éclate " le corps dans la volonté de puissance abstraite ou l'hédonisme rageur de la marchandise. En tout cela, le monde refait mon propre parcours, il a abandonné le bonheur enfantin du pourquoi, car le pourquoi n'est pas une question comme une autre, c'est un bonheur sémantique, le bonheur de l'émerveillement d'une altérité mystérieuse, de la certitude d'une autre présence dans la présence du monde, d'une présence qui nous aime comme nous aimons la beauté de l'univers. Que se passera-t-il alors, lorsque nous aurons détruit cette altérité, cette autre manière d'être que nous offrait la Nature, la Physis des Grecs, cette mère que nous prétendons connaître et changer à notre image, alors que nous la conduisons vers l'échafaud de notre bêtise.
Mercredi 21 avril 2004
La République en danger.
Monsieur Raffarin tombe le masque. Il est devenu évident que son maître lui a " gardé sa confiance " pour le " finir " d'ici les prochaines élections (européennes). Il est resté à Matignon pour boire la coupe jusqu'à la lie, c'est à dire à noyer le peuple français dans la boue de la politique libérale et liquider la République. Son insolence face aux présidents de région trahit clairement son statut de chien de garde de la politique des " Réformes ", réformes qui valent pour autant de trahisons des principes de notre Constitution et des valeurs de notre pays. Certains s'étonnent et pensent que les Français sont dupes de cette manœuvre qui consiste à préparer le terrain pour faire passer en force pendant l'été des plages les lois les plus iniques depuis celles qu'introduisit le Maréchal Pétain et dont une grande partie a encore toute sa puissance de nuisance (autofinancement des Services Publics, Loi de 1941). C'est d'ailleurs en s'appuyant sur ces lois jamais abolies ou jamais amendées comme elles auraient dû l'être, que le Premier Ministre peut se permettre de s'abriter derrière la logomachie du fonctionnement normal de la démocratie. Question en passant : qui, depuis Mendés France, a connu un " fonctionnement normal " de cette démocratie ?
Je suis assez convaincu que tout était assez bien calculé, y compris la défaite cuisante des régionales, défaite qui permet à Matignon de faire supporter par les Régions tous les problèmes financiers que l'état (de droite) s'est rendu incapable de gérer, de faire nommer à Bercy le Magyar du gouvernement, homme de décision sinon de compétence, et de faire prendre les décisions cardinales qui devront remanier entièrement notre norme républicaine pendant les trois ans qui vont précéder l'élection présidentielle. A partir de Juillet 2004, la France, si elle n'a pas explosé, va entrer dans une période de glaciation et de régression sociale sans précédent. Le moment venu, Chirac et son entourage pourront réitérer le coup d'état de 1940 et régenter la France qui sera devenue elle-même, entre-temps, une simple région de l'Europe. Reste l'explosion prévisible du peuple français, et malheureusement la possibilité d'une guerre civile qui fera directement suite à celle qui opposa les régions girondines à celles qui restèrent fidèles à la Convention.
Tout cela paraît caricatural et ne laisse pas de l'être. Mais ce schéma a le mérite de la clarté et représente ce à quoi il faut s'attendre, de quelque bord que l'on soit. L'échec de Jospin en Avril 2002 est le plus grave événement que notre pays ait connu depuis la Libération et les échéances seront de plus en plus courtes et de plus en plus brutales. Ce texte, qui n'est qu'un début, a pour seul objet de contribuer à réveiller les forces sociales qui ont des responsabilités et vers lesquels le peuple se tournera en premier, avant de former ses propres responsables et de renvoyer dans leurs foyers tous ceux qui auront fermé les yeux, à commencer par les syndicalistes, sur l'urgence d'une contre-attaque qui n'a que trop tardé. S'il reste une issue pour la paix sociale, nous le devrons à une poignée de saltimbanques, de chercheurs et de médecins qui ont déjà pris conscience de la gravité des choses de la République (Res Publica) pour penser, c'est à dire agir.
Lundi 3 Mai 2004
Djalâl Ud Din Rûmi et Hegel.
" J'ai regardé vers le haut, et j'ai vu dans toutes les étendues une seule chose,
Vers le bas, et j'ai vu dans toutes les écumes des vagues une seule chose.
J'ai regardé dans le cœur, c'était une mer, une étendue de mondes,
Pleine de mille rêves, j'ai vu dans tous les rêves une seule chose.
Air, feu, terre et eau sont fondus en une seule chose
Dans la crainte, en sorte que contre toi n'ose se cabrer une seule chose.
Des cœurs de toute vie entre Terre et Ciel
A t'adresser adoration que ne tarde une seule chose.
Encore que le Soleil ne soit qu'une parcelle de ton éclat,
Ma lumière et la tienne ne sont originairement qu'une seule chose.
Encore que poussière à tes pieds soit le Ciel qui gire ;
Une seule chose sont pourtant et ton être et le mien.
Le Ciel devient poussière, Ciel devient la poussière,
Et une seule et même chose demeure mon essence et la tienne.
Comment des paroles de vie, qui vont à travers le Ciel,
Viennent-elles au repos dans l'écrin resserré du cœur ?
Comment les rayons du soleil, pour resplendir plus lumineusement,
Se cachent-ils dans les frêles enveloppes des pierres précieuses ?
Comment ose, nourrie de vase terreuse et de fange aquatique,
Se former la transfiguration de la roseraie ?
Comment ce que suça, comme une gouttelette, la coquille sans voix
Devint-il, comme éclat de la perle, le délice du rayon solaire ?
Cœur, que tu nages dans les ondes, que tu flamboies dans le brasier,
Flot et brasier sont une seule eau ; ne sois que ta pureté.
Je te dis comment d'argile l'homme est formé :
C'est que Dieu dans l'argile fit passer le souffle de l'amour.
Je te dis pourquoi les cieux ne cessent de girer :
C'est que le Trône de Dieu les fait pleins du reflet de l'amour.
Je te dis pourquoi soufflent les brises du matin :
C'est pour passer sans cesse de feuille en feuille à travers la roseraie de l'amour.
Je te dis pourquoi la nuit revêt son voile :
C'est pour initier le monde à une tente nuptiale d'amour.
Je puis te dire toutes les énigmes de la Création :
C'est que de toute énigme l'unique solution est l'amour.
Mourir met fin sans doute à la peine de vivre,
La vie pourtant frémit d'effroi devant la mort.
Ainsi frémit d'effroi devant l'amour un cœur,
Comme s'il était menacé de mourir.
Car, où s'éveille l'amour, là meurt
Le Je, le ténébreux despote.
Toi, laisse-le mourir dans la nuit
Et respire librement à la première lumière du matin !1
Hegel ferme pour ainsi dire son Encyclopédie sur ce merveilleux poème qu'il plante au beau milieu de l'une de ses Auseinandersetzungen, de l'une de ses " explications " au sens de querelles, avec le panthéisme. Dans la note qu'il fait suivre, le philosophe écrit cette phrase incroyable, je la cite toujours dans la traduction de Maurice de Gandillac : "Dans cette poésie prenant son essor au-dessus de l'extérieur et du sensible, qui reconnaîtra la prosaïque représentation qu'on se fait de ce qu'on appelle le panthéisme et qui bien plutôt réduit le divin à l'extérieur et au sensible ? ". Hegel est visiblement secoué par la beauté du texte et on se demande pourquoi il prend le risque d'un tel commentaire : " prenant son essor au-dessus de l'extérieur et du sensible " ? Comment peut-il dire cela d'un texte qui précisément est entièrement immergé dans l'intérieur et le sensible ? " Cœur…ne sois que ta pureté " : existe-t-il une intériorité plus intérieure ? Mais, à qui et à quoi s'adresse l'ensemble du poème, même lorsqu'il est, en passant dans le médian, question de Dieu ? Sinon aux sens, littéralement offerts aux tourments du sublime et sans lesquels ces vers n'auraient aucun sens, ne sauraient appartenir à ce domaine que les hommes appellent le beau. " C'est que Dieu dans l'argile…. ", dans la matière la plus primaire, la plus matière de toutes les matières.
Je soupçonne en fait Hegel de ne pas comprendre le message fantastique que nous adresse ce poète Rûmi, c'est à dire en Arabe : Chrétien…Je ne sais pas grand chose sur Djalâl Ud Dîn dit Rûmi, seulement qu'il vécut en Iran au Treizième siècle, siècle béni chez les " Mahométans " qui nous préservèrent Aristote en lui insufflant, sans doute, ce que Hegel nomme mysticisme et que nous préférons réduire à l'idée d'apoptéïa, de sagesse créatrice de divin ou plutôt de relation miraculeuse avec ce divin que se partage l'Être et le cœur humain. Le poète nous porte à tous les angles par lesquels nous pouvons appréhender l'Être, ses formes qui se fondent dans " une seule chose ", l'amour, certes, mais un amour qui abolit la différence, qui saisit l'Être dans sa Forme Heureuse, dans le bonheur de sa Forme Une, dans l'éther amniotique dans lequel les étants rassemblés forment cet Amour qui se réfléchit dans le miroir du philosophe et du poète. Le panthéisme ? Pourquoi confronter ce poème à ce débat analytique trivial sur la nature de Dieu ? Les explications contournées du grand Homme de Berlin montrent mieux que tout le malaise bien kantien qui entoure cette révélation factuelle et sans concept de la Physis qui se fiche bien d'être un moyen-terme entre le Sujet et l'Esprit. Quel Esprit ? Quel Sujet ? Quelles déterminités conceptuelles structurent cette pièce d'amour et de beauté ? Répondez, Hegel !
Jeudi 6 Mai 2004
Autres remarques sur Hegel.
Le maître-mot, le concept devrait-on dire, du philosophe officiel de la Cour de Berlin, était le " re-penser ". Pris comme véritable penser, ce re-penser, Hegel le définit ainsi " le penser est essentiellement la négation de quelque chose qui-se-trouve-présent de façon immédiate " (Trad : Maurice de Gandillac). Ainsi le re-penser est une sorte de digestion du présent puisque, comme pour appuyer sur le négatif que représenterait ce rideau tiré sur le présent, il compare le re-penser à la manducation qui, en mangeant, " nie " les aliments pour être ce qu'il est, à savoir manducation.
Première remarque à propos de cette définition, l'étrange composition de l'expression " qui-se-trouve-présent ". Les tirets qui unissent les quatre mots sont repris du texte allemand, je suppose du moins que Gandillac ne s'est pas permis d'ajouter une forme aussi étrange pour son plaisir. Cette forme graphique me surprend, simplement. Elle semble avoir un but précis, mais lequel ? Dire simplement " quelque chose qui se trouve présent " aurait-il moins de force ou de pertinence que cette chaîne artificielle ? Suggère-t-elle quelque chose d'autre que la simple signification d'une chose présente par et en soi devant celui qui pense ? Je précise au passage que dans l'espace ou dans l'époque modernes de la philosophie, c'est à dire ceux qui furent inaugurés par Descartes, penser ne se réfère pas seulement à une opération abstraite de l'entendement ou de l'esprit, mais comprend aussi les fonctions triviales de la psyché, à savoir : sentir, imaginer, percevoir, vouloir, etc… Il y avait donc, pour Hegel une certaine nécessité à introduire une différence entre son penser à lui, le re-penser, et l'idée générale d'un penser impur. Et en fait, il semble bien que les tirets soient eux-mêmes déjà le produit du re-penser, c'est à dire de ce penser qui a choisi de prendre son essor dans l'élément de sa propre abstraction, celui de la logique.
Que produisent, en effet, ces tirets comme effet sémantique ? Ils semblent du moins pour nous, rendre ou donner à la présence de ce quelque chose isolé à priori, une cohérence qui dépasse le caractère d'isolat de la chose. Autrement dit, on se trouve d'emblée dans la présence en tant que présence parce que la chose isolée se-trouve-présent. Le quelque chose, ici la neutralité de la chose n'est pas non plus innocente, car Hegel aurait tout aussi bien pu écrire " une chose ", un objet quelconque, chose et objet qui forment en réalité les idées logiques du rapport entre le penser et son autre. Mais la neutralité semble avoir la même fonction que les tirets de l'expression, à savoir noyer l'objet dans quelque chose d'énigmatique, mais dans une énigme invisible, pour ainsi dire dissimulée dans le tissu phraséologique du texte. Hegel invente a priori un mystère dont il va à posteriori demander au re-penser de rendre compte. Il procède ici (dans son Encyclopédie) comme il l'avait fait dans la Phénoménologie de l'Esprit, mais à l'envers. On se souvient, dans les deux premiers chapitres du texte, que, confronté à la relation de la conscience à la présence en tant que telle, Hegel s'empresse de se réfugier dans un exemple concret : le ici et le maintenant, illustrés l'un par le face à face avec un arbre, l'autre avec l'heure de midi. Cette manœuvre rend seule possible le mouvement qui dissout l'immédiateté des deux objets, en leur conférant une sorte de monopole provisoire de la présence. C'est ici l'analyse qui contraint le philosophe à trancher dans le vif de la présence, comme pour une sorte d'autopsie, et d'en extraire des parties qui n'ont pas plus de valeur de présence que ce qui à cet instant et plus tard, les entoure.
Deux méthodes opposées et identiques dans leur essence. C'est qu'entre la Phénoménologie et l'Encyclopédie, du temps s'est écoulé et le philosophe peut désormais " résumer " sa pensée, le travail de l'analyse conceptuelle ayant été fait dans la Phénoménologie (et à nouveau reconnu d'ailleurs dans l'Encyclopédie, ce qui interdit, a priori, de penser qu'il y a des ruptures ou des fêlures dans le vaste système hégélien). Mais nous ne sommes pas satisfaits pour autant, car nous trouvons dans chacun des cas une manipulation qui permet au logicien soit de passer la présence au scalpel de la Logique, c'est le cas dans la Phénoménologie, soit de représenter une anomalie graphique pour présenter ce dont il ne peut pas parler in situ, à savoir la présence en tant que présence, concept qui ne doit figurer qu'au résultat du travail de la conscience (de la Philosophie en réalité) et non pas dès son contact, dès sa " primo-infection " par l'immédiateté. Or, dans l'un comme dans l'autre, le présent est là, auprès de la conscience dès le départ et quelles que soient les médiations dont se sert le philosophe pour décrypter le procès qui paraît s'entamer comme re-penser ce présent. Autrement conclu : le présent est toujours déjà re-pensé, avant que la plus achevée des machineries logiques ou catégorielles ne s'en prenne à lui. Et c'est ce que Hegel ne peut en aucun cas reconnaître puisque le présent en tant que présent ne peut s'atteindre que comme savoir absolu, comme longue histoire du Travail de l'Esprit qui s'incarne dans le Sujet.
Dans le paragraphe 68 de la même Encyclopédie, nous retrouvons cette étrange graphisme dans un contexte tout à fait différent. Comme je ne dispose hélas pas du texte allemand, je suis obligé de m'en référer à la traduction de M. de Gandillac. Dans ce paragraphe, il est question du savoir portant sur Dieu et le divin, Hegel dit ceci " Mais ensuite, au-delà de l'expérience, lorsqu'on envisage pour lui-même ce savoir immédiat, dans la mesure où il est savoir portant sur Dieu et le divin, une telle conscience est universellement décrite comme acte-de-dépassement du sensible, du fini, et aussi des désirs et inclinations immédiates du cœur naturel-acte-de-dépassement qui avance dans la croyance en Dieu et le divin et y trouve sa fin, en sorte que cette croyance et un savoir immédiat attestation du vrai, mais on n'en pas moins pour présupposition et condition ce processus de médiation ". Je présente ici le texte tel qu'il figure dans l'édition NRF déjà mentionnée. Par deux fois nous retrouvons cette liaison étrange par tirets successifs de mots qui n'auraient en réalité aucun besoin de cet amalgame formel. Et pourtant, la question est grave, car ici Hegel se trouve au centre de tout son système, au cœur dynamique de la dialectique et de son rapport avec le savoir immédiat lui-même, et le " dépassement " de ce savoir. Dans la deuxième formule s'ajoute un mot à l'ensemble, celui de naturel, alors que l'ultime concept qui clôt le paragraphe est celui de médiation. Que veut dire Hegel dans ce paragraphe qui porte sur l'essentiel, la croyance en Dieu ? Ceci : s'il est vrai qu'il existe quelque part une connaissance a priori ou immédiate, un savoir immédiat de Dieu et du divin, il faut, pour que ce savoir soit, qu'il porte sur un objet positif, que l'on présuppose comme condition un " processus de médiation ", autrement dit la culture et l'enseignement. L'astuce, ici, des tirets, nous ramène à nouveau dans cet entre-deux hégélien du naturel et du conceptuel, où l'acte de dépassement est formellement présenté comme 1 : naturel, 2 : médiatisé ou, comme il s'exprime alors " dépassé " (aufgehoben, j'imagine, ce qui signifie, comme on le sait, à la fois conservé et nié. Les tirets ont donc une fonction sémantique nécessaire car ils " naturalisent " le procès, le long processus par lequel la croyance immédiate est médiatisé dans la culture et l'enseignement, c'est à dire l'acquisition longue et douloureuse du concept de Dieu et du divin. Conclusion étrange : le travail du dépassement (naturel-acte-de-dépassement) est naturel, donc la culture et l'enseignement ne sont que des outils de la nature mis au service de la nature humaine afin qu'elle parvienne à la croyance vraie, la croyance immédiate n'étant de ce fait qu'une croyance vaine et sans objet.
Dieu, la nature, le savoir : dans ce livre où Spinoza est invoqué à plusieurs reprises sans pour autant valoir un traitement égal à celui de Kant, Hegel nous livre une vision réellement panthéistique de la relation à Dieu, puisque c'est Dieu qui commande via la nature, le dépassement de la croyance immédiate par la culture et l'enseignement. Au fond, tout est en Dieu et l'homme historique n'a qu'à continuer à être historique, c'est à dire à accomplir la geste de la nature, médiation absolue entre le savoir non-vrai de la présence et le savoir médiatisé par le savoir absolu descendant du ciel dans les " présuppositions et conditions " de la médiation.
Mardi 18 Mai 2004
La Conscience, encore et toujours.
Le seul doute qui me taraude depuis quelques temps à propos de la conscience est quelque chose de terrible : la conscience est-elle historique ? Je m'explique, car tout ce que j'ai pu écrire ici ou là, surtout ici sur ce site qui contient l'essentiel de ce qui passe par ma tête, je n'ai pas la prétention de " penser ", est fondé sur le contraire. Jusqu'à présent, jusque dans le présent et déjà dans tous les présents qui furent les miens depuis que j'ai vu le ciel pour la première fois comme un grand mystère, la conscience a été pour moi mon seul bien et un bien que j'attribuai spontanément à tous les autres, à tous les hommes du présent, du passé et du futur. Il est vrai que c'est bien plus tard, dans l'âge de la maturité qu'il m'a parut de plus en plus évident et nécessaire qu'il fallait insister sur le fait que la conscience n'avait rien d'historique. Au fur et à mesure que j'engouffrais davantage de culture humaniste, de connaissance des textes anciens et de l'histoire des hommes de l'occident et d'ailleurs, il me devenait de plus en plus évident, de plus en plus parfaitement certain, au sens d'une certitude aussi forte que celle du cogito cartésien (qui d'ailleurs reprend cette même certitude de la neutralité de la conscience par rapport aux changements et aux mouvements du temps : le bon sens est la chose la mieux partagée parmi les hommes etc…). Or, depuis quelques semaines, vous avez pu le constater, je suis remonté sur le ring philosophique où je m'explique pour la nième fois avec le Grand Philosophe de la Conscience, W.F. Hegel, l'homme qui a prétendu nous donner une Science de la Conscience, une science !
Et pas n'importe quelle science, la Science de l'Expérience de la Conscience, sous-titre de la Phénoménologie de l'Esprit, l'œuvre de Hegel qui fait à la fois sa véritable gloire et qui en réalité de présente plutôt comme son point faible au regard de la Grande Logique dont le contenu est définitivement théologique. On sait, pour faire vite, que Hegel est LE penseur de l'Histoire. Evidemment son Histoire n'est pas l'historiographie des faits et gestes humains du passé, elle est l'histoire de la philosophie, ou plutôt elle est une histoire philosophique qui fait cercle entre un Dieu (ou un Esprit, encore qu'il faille rester prudent quant à une telle identification) qui se lance dans la tourmente de la Nature pour se retrouver dans le Savoir Absolu à partir des figures successives de la pensée philosophique née de la Révélation. Autrement dit, Dieu s'incarne dans la Nature, descend dans les choses ou dans l'apparition des choses pour, en quelque sorte donner une leçon à l'homme, une leçon d'amour (qui s'oppose à la leçon de pure justice du Dieu des Juifs) et le ramener ainsi à lui par la négation des déterminités de ces mêmes choses : les choses s'évanouissent dans l'identification de l'identité et de la différence pour s'absoudre dans la Science accomplie de la Conscience. Bon Dieu, je comprends que ce n'est pas facile à comprendre, mais comment aligner de pareilles bouffonneries à travers l'obscurité dont elles émanent. Allez donc lire seulement quelques lignes du vrai maître de la pensée hégélienne, à savoir Jacob Boehme, et revenez me dire si vous avez fait tilt ou bien si vous avez eu une réaction de saine révolte contre cette " nuit dans laquelle toutes les vaches sont noires " qui fait le tissu de ses sermons, nuit que Hegel ose retourner contre son ancien ami intime Schelling. Bref, une science de l'évolution de la conscience, évolution qui a lieu dans l'ontogénétique et dans le phylogénétique, à savoir dans le destin individuel et dans le destin collectif. Les lecteurs de Hegel auront tous, sans exception, achoppé tout d'abord sur un mot : l'absolu, et comme vous venez de le lire, il faut aussi comprendre cet absolu non pas seulement comme ce qui passe depuis la nuit de la pensée pour la vérité vraie, indiscutable, apodictique comme on dit, mais pour Hegel d'abord pour ce qui absout, pardonne aux étants d'être, réconcilie la conscience avec elle-même dans le déchirement le plus " absolu " de la négativité. Le péché de la conscience à propos ou pour lequel il est besoin d'une telle absolution, pourrait être comparé à l'ubris humaine pour l'agon. Explication : le désir humain du sang, celui de la compétition violente dont l'accuse toute la philosophie occidentale et dont la figure antique peut se retrouver jusque dans la folie footbalistique de nos temps, ce désir est un péché absolu, LE péché de la différence et de sa culture dans la grande Histoire de l'Être humain, le péché de la négation non dialectique, de la négation absolue et mortelle, celle qui " fait " histoire.
Mais revenons à la conscience et à son expérience. La dialectique est, comme dit Heidegger, un retournement de la conscience : elle se retourne comme se retourne le sujet de la Phénoménologie de Hegel pour se rendre compte que ce qu'il a vu d'un côté de son corps, n'est plus de l'autre, ou encore qu'en regardant sa montre à midi, il se rend compte que le temps n'est plus ce qu'il était le matin même. Selon Hegel, la conscience VEUT saisir la vérité de l'apparition de l'apparaître, c'est à dire saisir les choses dans leur mouvement de surgir ou de surrection dans l'horizon du regard. Bien. J'ai le droit, de mon côté de me demander ce qui a changé dans mon regard entre mes premiers étonnements face à la nature et l'effet que produit sur moi, aujourd'hui, le regard de ma conscience sur le monde. La comparaison peut alors s'exprimer ainsi : lorsque enfant je m'interrogeais sur l'origine et sur le sens de l'infini qui s'étendait dans le ciel nocturne je ne conceptualisais certes pas l'apparoir de l'Être. Je ne me posais pas spontanément la question de Leibniz disant : pourquoi tout cela est-il plutôt que de ne pas être ? Et pourtant, mon étonnement ne portait pas sur les taches de la lune - comme ce fut le cas pour Dante lorsqu'il aborda sa montée vers le Paradis -, elle ne se demandait pas non plus de quel métal ou de quelle matière était faits ces astres que je parcourais du regard. En bref, ce n'étaient pas les objets étalés devant moi qui éveillait ma curiosité et mon angoisse, mais bien leur être-là, leur présence. Que ce souci, à cette époque, se soit déjà entaché de la question de l'origine, provenait directement du créationnisme dont ont me rabattait déjà les oreilles à l'école et au catéchisme : quel enfant pense spontanément à la provenance temporelle des choses qui l'entourent ? Mais cette idée n'était qu'une façon parmi d'autres d'habiller mon angoisse fondamentale, et cette angoisse portait déjà sur le sens de ce qui m'entourait. Ce que je veux signifier en précisant cela, c'est que loin d'être piégé dans une relation d'immédiateté avec les objets que j'observais, mon esprit cherchait déjà à comprendre tout autre chose que la vérité intrinsèque des astres ou du vide stellaire, mais bel et bien leur sens par rapport à moi.
Ce que je dois reconnaître comme différence avec mon appréhension présente de ce qui est présent autour de moi, c'est le sentiment de la distance qui me séparait des objets qui fascinaient mes yeux. Aujourd'hui je n'ai plus besoin de m'adresser au ciel ou à l'horizon sans fin d'un océan pour sentir cette émotion spécifique qui ne fait ni chaud ni froid, qui n'est ni rude ni douce, qui ne sent rien et ne fait aucun bruit, il suffit que je regarde devant moi : le trottinement du curseur de mon ordinateur me fait le même effet que les lointaines sphères célestes de mon enfance. Ce serait donc plutôt le contraire qui se serait opéré depuis cette lointaine époque, à savoir qu'au lieu d'être frappé par l'immédiat et le proche, il me fallait encore pour toucher ma conscience que l'objet se perde dans l'immensité, que je sente ma nullité quantitative par rapport à l'infini, bref que je sois déjà perdu non pas par l'erreur de perception ou de calcul, mais par la présence du vide sans fin. Oui, c'est le vide sidéral qui me sidérait et non pas les objets qui se trouvaient ou ne se trouvaient pas à leur place. Hegel procède au fond comme les empiristes, c'est à dire par la méthode des essais et des erreurs : devant moi je vois la maison, et si je me retourne, je vois un arbre et non plus une maison. Hegel retranscrit cela ainsi, la vérité de la maison s'est changée en erreur de l'arbre, et cette erreur est le négatif qui me renvoie à moi-même et à la position de ma conscience par rapport à l'étant. La conscience de soi s'ouvrirait donc ainsi, dans l'expérience qu'elle fait de ses erreurs dans le va-et-vient qu'elle opère dans l'espace et le temps. La vérité passe sans cesse d'un camp dans l'autre jusqu'à ce que la conscience se saisisse enfin comme le seul lieu de l'apparition du monde dans le concept de l'apparition ou de la parousie. Dans d'autres chroniques, déjà anciennes, j'ai critiqué cette mécanique caricaturale qui n'a lieu que dans la démonstration hégélienne qui, de surcroît s'en prend ainsi dans la phase le plus brute ou la plus primitive de sa description, à l'intuition ontologique de Parménide. Selon Hegel, le sentiment de l'Être et de l'Un de l'Être sont les sentiments les plus " pauvres " et les plus vide de vérité. Le fondement, certes, et un fondement qui contient déjà le fameux " Être auprès de soi ", mais qui n'a pas encore entrepris le chemin qui mène au concept de cet Être. Or, je me pose une question simple, très simple : pour quelle raison me retournerais-je ? Pour quelle raison ma conscience subirait-elle une pulsion quelconque en direction de ce qui trouve ailleurs que ce qu'elle contemple déjà ? La spéculation qui ordonne pour ainsi dire à la conscience de se retourner est bien de la spéculation, une mise en scène destinée à piéger la conscience, alors même que vous et moi savons pertinemment que la conscience sait D'AVANCE que derrière elle il n'y a PAS la même chose que devant. Le négatif n'est ainsi qu'une simulation de négatif, une pure fiction qui doit produire une re-présentation qui, en réalité est déjà et toujours une présentation, un simple panoramique du sujet se tournant dans le présent en sa présence.
Soit, aujourd'hui il m'arrive que les formes, qui sont les formes de l'Être, quelles qu'elles soient, celle d'une maison, d'une femme, d'un autobus ou d'un ciel nuageux, se brouillent un peu à cause de la fatigue. La concentration sur soi, sur ses douleurs et les positions plus ou moins adéquates du corps et de l'esprit, installent parfois un temps de latence entre la saisie immédiate liée aux soucis en question et le laisser-s'installer des formes apparaissantes ou de l'apparaître des formes. Mais la jouissance n'en est que plus parfaite, au sens de la pacification absolue de la relation de conscience avec le présent multiforme. Aujourd'hui ma conscience fonctionne comme un instrument d'optique qui me permet de focaliser la Forme du tout, de laisser être les formes, les déterminités qui m'entourent pour ne faire plus qu'une image, une image toujours parfaitement belle, parfaitement enivrante dans sa variation spatiale et temporelle. Cette femme qui parle s'est installée dans le tableau que constitue la rangée de sièges de l'autobus et ses intonations, ses mots, ses cheveux et les formes de son corps s'exhalent dans une aura de beauté spontanée qui ne nécessite nul retournement, nul travail de perception, nul arrangement de coiffure métaphysique. Elle, et ce qui l'entoure, sont là, dans mon regard qui prend ce que lui donne ce présent. La porte du véhicule s'ouvre, et je descend sur un nouveau tableau du présent, et ma marche vers mon domicile est comme une valse qu'exécute mon âme dans le plus riche apparat et dans la plus grande splendeur naturelle. Ma lunette ontologique se ferme sur l'Être en chaque forme et sur l'Un des formes qui s'assemblent dans mon regard. La Paix règne ici sans partage, même si le visage des choses veulent signifier tout autre chose que la paix, même si le présent formel montre du doigt les pires blessures du temps et de la négligence humaine. Andy Warhol avait compris cela dans la continuité de la critique dadaïste de l'art, et encore mieux ceux qui ont exploité la veine sans fin de l'hyper-réalisme, lointain descendant du trompe-l'œil des déçus de la Réforme. Oui, le Catholicisme intelligent avait pressenti vaguement qu'il fallait donner de la beauté sous la forme simple des choses, sous leur représentation en double de la présence. Malheureusement pour lui, ce sont les Réformés des Pays-Bas qui ont réalisé totalement ce projet en rejetant la niaiserie du Sujet représenté.
Mais nous, nous n'avons plus besoin des peintres, nous avons le pinceau dans l'œil, nous avons la pellicule sensible dans l'âme et nous avons la conscience qui sans se lasser développe les prises de vue. Oh certes, la réussite des Néerlandais du Grand Siècle nous réjouit parce qu'elle se rapproche de notre propre triomphe et nous leur rendons hommage, mais notre appareillage a sur leurs œuvres l'avantage de nous être adapté à chacun de nous en sa singularité et il est parfois dur et angoissant d'entrer par le canal de l'œuvre d'art dans l'âme tourmentée de ces visionnaires. C'est pourquoi je ne tiens jamais très longtemps dans un Musée d'art, car c'en est trop de présents présentés dans leur condensation subjective, et quand je retrouve la sortie, je retourne dans mon œuvre d'art à moi, dans le rayon unique de ma conscience. Et puis il y a le temps et l'enchevêtrement des instantanés pris dans la discontinuité. Comme sur le fameux tableau de Vélasquez si bellement décrit par Foucault, nous nous retrouvons dans la position du peintre qui regarde le peintre dans une mise en abîme vertigineuse qui nous amène dans les vagues du temps jusqu'à notre propre vision de la divinité du présent. Mais ce parcours est comme la culture, il est même la culture, cet autre mélange des images du passé et de celles que nous vivons trop souvent hélas comme des réalités et non pour ce qu'elles sont, à savoir les motifs du tissu de notre être. Alors je me console de mon doute concernant l'âge de la conscience et il me revient à l'esprit cette découverte que je fis un jour en écrivant ici même, le fait éblouissant d'évidence que le temps, lui, n'a pas d'âge.
Samedi 22 Mai 2004
Le pétrole et la libido.
Depuis fort longtemps un intuition me porte à cette comparaison entre la forme brute de l'énergie qu'est la matière fossile nommée pétrole et la forme divinement invisible du désir ou de l'énergie érotique. Pourquoi ?
Qu'est-ce qui porte l'homme au questionnement, à la question, presque à la question au sens médiéval de la torture ? Une seule chose, nous en avons déjà convenus, la peur. C'est donc la peur qui me tourne aujourd'hui vers cette double vision sur ces éléments si essentiels dans notre univers, dans l'univers présent. Le pétrole est stocké dans l'écorce terrestre sous forme de nappes ou de roches gorgées de naphte, et l'homme prélève chaque jour dans ce stock, sans trop se poser de question sur sa pérennité. Il faut bien le dire, et beaucoup ne s'en privent pas, nous nous empiffrons de cette énergie dite non- renouvelable, sans penser que le niveau des nappes diminuent chaque jour, et il faut des guerres ici et là de plus en plus cruelles pour donner à ce festin son prix de plus en plus élevé et la perspective d'un devenir de cette matière aussi précieuse que celles de quelques objets ou de quelques aliments réservées aujourd'hui à quelques nababs qui semblent issir d'un autre temps. L'autre énergie, le désir érotique ou la libido, nous ne savons pas trop où elle est stockée, et c'est sans doute une chance inouïe. Il y a bien quelques marchands du Temple qui tentent de creuser des puits de désir dans la pornographie industrielle, mais cette exploitation s'use comme toute exploitation, et le produit vieillit comme tous les produits.
Pourtant, je ne puis m'empêcher d'avoir des craintes, chaque jour alimentée précisément par cette exploitation de plus en plus universelle de l'image pornographique, de cette impudeur industrielle qui finit par rejaillir sur la publicité la plus triviale dont l'objet peut aussi bien n'être qu'un fromage ou une automobile. Il y a de plus en plus de pornographie dans les publicité en général, et cela non pas parce qu'elles se servent de la femme pour allécher le chaland, mais en tant que telle, parce qu'elle, la publicité, se comporte exactement comme une catin, exhibant ses appâts pour faire naître les pulsions libidinales du spectateur. La question devient donc la suivante : le stock de libido sexuelle ou simplement d'énergie désirante vis à vis de la marchandise, ce stock est-il indéfiniment auto-reproducteur, ou bien, et c'est là ma crainte et presque ma certitude, cette quantité est-elle aussi déterminée et aussi limitée que celle des matières fossiles qui nous servent de source d'énergie ? La réponse à cette question se trouve pratiquement dans la question elle-même, dans la mesure où nous considérons l'un et l'autre éléments en jeu comme des objets, comme ressortissant du domaine objectal et donc d'une relation sujet-objet dans laquelle les uns pensent être les maîtres du jeu, d'autres que nous courons à la catastrophe.
Il y a pourtant une différence peut-être éclairante entre le destin du pétrole et celui du désir. Prenons ce terme pour raccourcir notre débat. En effet, le pétrole, bien que fruit d'un processus temporel de décomposition des diverses formes de carbone, exige pour son renouvellement des périodes tellement longues qu'il serait vain de penser qu'on pourrait éviter qu'un jour nous ne touchions le fond du baril. Par ailleurs, la vie enseigne à tout un chacun que le désir n'est pas non plus inépuisable, du moins si on le mesure selon l'âge de la personne désirante. Le désir, la libido sexuelle ou l'ubris de consommation diminuent avec le temps dans la vie de chacun d'entre-nous. Mais on nous répondra que le problème n'est pas important puisque les générations se renouvellent, renouvelant ainsi le stock de libido. C'est à voir. C'est à voir car un phénomène universel semble perturber en permanence le marché des objets désirés, une perturbation qui va dans le sens d'un constant rajeunissement des " cibles " du marché. Les " cœurs de cible " du marketing sont incontestablement de plus en plus jeunes, et cela explique peut-être ceci, à savoir que le désir pris globalement, c'est à dire dans une génération entière, faiblit à tous les étages de la vie, et que pour compenser chaque perte, il faut viser chaque fois plus bas dans l'échelle des âges : parce que le désir finit par se réfugier dans les années les plus fraîches de la vie. Il faut donc considérer le " stock " libidinal humain non pas comme une quantité invariable du fait du renouvellement des générations, mais comme une denrée qui se raréfie dans l'histoire, dans la mesure où le mouvement du marché indique que les forces en jeu dans l'âge adulte diminuent à tel point qu'il faudra peut-être un jour se contenter d'investir dans la consommation des plus jeunes pour survivre. Autrement dit, nous assistons à une baisse universelle de ce que Aristote nommait Energéïa, l'essence même de l'Être de l'étant. Il s'agit donc d'une leçon d'ontologie. Le désir ou la libido sont des équivalents de l'énergéïa, à savoir de l'Être qui veut ou ne veut pas persister dans son Être : nous assistons donc à une véritable usure de l'Être, le monde veut de moins en moins être, il veut dispar(être). Le nazisme aura été une expérience prémonitoire de cette volonté de néantisation du monde, mais revenons-en à la simplicité de notre destin de tous les jours.
Voilà, aujourd'hui il existe encore des objets du désir collectif. Par exemple le voyage est devenu la marchandise par excellence, l'objet pour lequel on se sacrifie dans une quotidienneté douloureuse et humiliante. La perspective d'un coup d'avion vers les îles efface d'un coup tous les revers de l'existence, et même si cette aventure est d'une poignante durée, même si " l'aventure " s'avère en définitive n'être qu'une escroquerie de plus, sept jours à tourner en rond dans un hôtel minable où les différences sociales s'affichent exactement comme au travail, on préfère se voiler la face et se contenter du bénéfice publicitaire que l'on pourra tirer après, c'est à dire le pouvoir de frimer sur le thème de l'exotisme et du " j'ai été là ". Mais les comptes des tour opérateurs et des compagnies d'aviation montrent déjà que la grande époque des " nouvelles frontières " est passée. Le voyage s'est désespérément banalisé et à moins d'avoir les moyens d'organiser sa propre expédition, il n'existe plus que comme une récréation que n'importe quel pékin peut se payer. Le voyage comme marchandise a déjà tué le voyage, d'autant que la conscience ne peut pas tolérer trop longtemps les situations où elle se retrouve témoin de formes d'exploitation et d'humiliation humaines encore bien pires que celles que l'on vit soi-même. Nous dirons donc que tout objet de désir qui prend la forme d'une marchandise se vide de facto de sa force d'attraction. Le traitement de la richesse naturelle qui s'appelle pétrole, c'est à dire cet arrachement aveugle de la matière à la terre et sa transformation en équivalent général est le paradigme ou le modèle de ce qui arrive au désir ou à la libido : on l'arrache au cœur de l'être humain sous la forme indéterminée d'équivalent général. Au résultat, tous les objets du désir se transforment en équivalent général, perdant ainsi leurs qualités propres, c'est à dire ce qui est le moteur du désir. Lorsque tout sera devenu marchandise, le moteur s'arrêtera inéluctablement, car rien ne peut conserver sa force d'attraction dès lors qu'une force aveugle quelconque l'a privé de sa singularité. La pornographie est précisément ce fait qui consiste à enlever aux individus qui sont présentés la singularité de leur situation et de leur personnage, ce qu'ils désirent secrètement cacher parce que se sont les éléments intimes de leur destin : elle universalise ou standardise l'érotisme et le fait passer dans la catégorie de la marchandise. Le sexe est traité comme une savonnette, c'est à dire soumis à des catégories déterminées, à un concept qui ferme toutes les issues pour une aventure indéfinie. Ces catégories sont livrées à la publicité et deviennent des critères qui excluent par ailleurs tous les acteurs érotiques, tous les désirants, qui ne conviennent pas à ces critères ou qui n'entrent pas dans les paramètres du sexe-marchandise. Ce qui ne manque pas de se répercuter sur l'ensemble de la vie érotique de l'humanité, chaque individu se voyant interpellé et sommé de livrer ces critères et ces catégories pour se voir admis au " fonctionnement " libidinal ainsi défini.
Mardi 1er juin 2004
Martin Heidegger et le pont de Mostar.
Dans quelques jours, le 12 juin je crois, quelques penseurs vont se réunir à Strasbourg en " Parlement des Philosophes " pour parler de Martin Heidegger. Je suis tenté de me rendre à cette réunion à laquelle des penseurs comme Jacques Derrida vont prendre part, mais j'hésite encore. Je crains qu'une fois de plus l'événementiel de la vie du grand homme ne prenne le pas sur son œuvre et sa pensée et qu'un humanisme de plus en plus malmené, de plus en plus saturé et meurtri par une inflation malsaine ne rende cette assemblée une fois de plus totalement stérile. J'avais assisté, il y a presque vingt ans à une émission de télévision portant sur le philosophe allemand, une émission de la toute première chaîne culturelle française, la 7 et qui s'appelait Océaniques. J'en suis sorti meurtri par les insanités qui fusèrent des gradins du studio, de la bouche de certains " nouveaux philosophes " français comme de celle de Georges Steiner, propos qui furent alors la conséquence de la publication d'un torchon sur le passé " nazi " de Heidegger, écrit par un Chilien du nom de Farias. J'avais fourni au producteur de l'émission le seul film tourné par la télévision allemande sur le philosophe que je m'étais procuré grâce à quelques amitiés que j'entretenais à Baden-Baden, et je l'ai bien amèrement regretté. C'est pourquoi je ne me rendrai sans doute pas à Strasbourg le 12 juin prochain.
Que cela ne m'empêche pas de porter ma contribution, par avance, à ce débat dont je redoute tant les dérives prévisibles. Je voudrais en effet rappeler à ces Messieurs une seule petite chose à propos du penseur de la Forêt Noire, une chose qui risque fort de n'être même pas signalée tant seront sans doute prioritaires les avis et la critique des spécialistes, et, comme je le crains, les vociférations de haine de ceux qui sont toujours les premiers à jeter la pierre et à distinguer la paille dans l'œil de leur prochain. Cette chose ne concerne évidemment pas le passé historique de Martin Heidegger et le comportement qui lui a valu à la fois la vengeance des nazis eux-mêmes et la haine sans limites de nos " nouveaux humanistes ".
Cette chose, un mot dont Heidegger fit le sujet de l'un de ses cours les plus brillants, c'est tout simplement ce que ce penseur a fait. J'entends d'ici la thématique de la clôture dans laquelle Heidegger lui-même serait resté pris, le long étalage de son échec final et je ne suis pas loin de penser que les " députés " philosophes auront à cœur de réduire ce génie à des dimensions très humaines, qu'ils le rangeront dans le catalogue des philosophes de l'histoire occidentale à une place aussi médiocre que la leur propre avec la prétention d'en être les juges théoriques et moraux. Grand bien leur fasse, mais en ce monde tout demeure incertain, et il se peut que je me trompe du tout au tout. J'en formule sincèrement l'espoir.
Quoiqu'il en soit, je veux dire ici une seule chose au sujet de Martin Heidegger dont il ne se passe pas un jour sans que j'en lise une ou cent pages, un peu comme un bréviaire tant il se dégage de lumière de la moindre de ses propositions. Je souhaiterais qu'à Strasbourg il se trouve un philosophe ou simplement un homme qui prenne la peine de rappeler l'essentiel de ce qu'a fait Heidegger et qui n'est pas rien, à savoir réveiller la conscience européenne d'un sommeil de plus de deux millénaires et demi. A Mostar, petite ville historique de Bosnie Herzégovine, il y avait un pont célèbre pour son antiquité et sa beauté, j'en possède encore une photographie extraordinaire, prise par ma compagne il y a de cela plus de trente ans. Ce pont a été détruit pendant l'horrible guerre civile qui a déchiré la Yougoslavie et la vision de ces ruines est sans doute l'une des plus dantesque du siècle dernier. Ce simple pont en ruine m'a donné de vrais frissons d'angoisse, alors qu'en général les ruines de guerre me paraissent toujours plus belles que les villes d'aujourd'hui, je pense notamment à ces images de Kaboul ou de Somalie, où la destruction systématique et prolongée a produit de véritables chefs d'œuvre architecturaux et urbains. Mystère de la néantisation des ambitions ridicules des humains ? Impression de la puissance du feu et de la violence, profondément incrustée dans les blocs de maisons affalées les unes contre les autres et percées de mille ouvertures incongrues ? Bref, ce pont de Mostar sera ou est déjà reconstruit, pierre par pierre, car à l'instar des églises et des Opéras de l'ex-RDA, le symbole est trop fort, on ne peut pas laisser la modernité recouvrir cette monumentalité là, même si la reconstruction ne rendra jamais à Mostar le pont qui reliait traditionnellement la ville musulmane au quartier serbe, pour la raison simple que les Musulmans et les Serbes ne seront plus jamais ensemble comme ils le furent sous la houlette de Tito.
La chose que fit Martin Heidegger ressemble à ce pont, sauf que le pont qu'il construisit ne reliait pas deux quartiers d'une petite ville, mais deux époques de la pensée occidentale, deux époques distantes, comme je le dis plus haut, de plus de deux millénaires et demi. C'est évidemment le sens de ce lien qui est essentiel, et ce sens s'appelle ou pourrait s'appeler le Rappel de l'Être. Dans le double génitif de cette expression on peut penser le philosophe comme l'instrument du rappel de l'Être comme on peut simplement vouloir signifier que Heidegger nous a remis sur le chemin de la question de l'Être, un chemin abandonné par la métaphysique depuis Parménide. Les heideggériens orthodoxes vont eux-mêmes se récrier : mais non ! Heidegger lui-même n'a jamais prétendu qu'il y avait le vide entre Parménide et nous, que l'Oubli de l'Être (double génitif aussi) est ce que les Grecs eux-mêmes ont programmé par l'entame de cette métaphysique et l'enfouissement de l'impensé de l'Être dans les entrailles de l'ontothéologie. Et ils auront sans doute raison. Ils auront raison mais ce qu'ils ne diront pas dès lors qu'ils auront proféré cette accusation, c'est que c'est Heidegger lui-même qui leur a enseigné tout cela, c'est le philosophe de Fribourg en Brisgau qui leur a dessiné le schéma du destin de l'occident métaphysique et qui leur a parlé, pour la première fois depuis qu'existe quelque chose comme la philosophie, la notion même d'oubli de l'Être.
Et il ne fait aucun doute que Martin Heidegger a lui-même déjà reconstruit en partie le pont qui sépare ces époques si lointaines en apparence, réhabilitant sans relâche les penseurs en qui il voyait des Envois ou des Guises de l'Être en son oubli. C'est lui qui a repris à nouveaux frais l'analyse des Méditations de Descartes, de la Critique de la Raison Pure de Kant, de la Monadologie de Leibniz ou encore de la Logique de Hegel, et sans lui, personne, et surtout pas son propre maître Edmond Husserl, n'aurait replacé la pensée sur la voie de la question de l'Être comme il l'a fait. Il a échoué ? Certainement, mais tous les philosophes échouent, par essence. Par essence le travail de la pensée " ne mène à rien " et fait rire les servantes aux dépens des astronomes et des métaphysiciens ! Et pourtant, si notre civilisation a encore une petite chance de survivre à sa propre horreur, si tout esprit n'a pas encore déserté ce monde, c'est certainement, c'est avec certitude, une certitude absolue que nous et nos enfants le devrons à Martin Heidegger.
Moi-même, je ne suis pas un inconditionnel de la pensée de Heidegger, au sens où j'estime modestement, c'est à dire de l'humble point de vue auquel je me trouve de par mon destin, que le philosophe soit-disant " nazi ", s'est leurré sur l'importance des Grecs. Heidegger a toujours fui l'anthropologie, considérant cette science comme une science quelconque, comme l'une de ces sciences servantes de la technique et vouées à l'arraisonnement brutal de la planète. Et pourtant, plus d'un demi-siècle avant le premier écologiste, avant le premier militant vert, Martin Heidegger avait déjà tout dit sur les dangers dont la terre était menacés, des dangers qu'il ne pouvait même pas encore mesurer à l'époque où il les prophétisait. Et pourtant, sa pensée me paraît profondément anthropologique, c'est à dire centrée sur cet " entre-deux " comme il disait, qui sépare Dieu de la Raison. Homme, temporalité, existence ou dasein, berger de l'Être, toutes ces expressions et la fine trame de sa théorie historique et historiale forment en réalité le diagnostic d'un anthropologue et non pas d'un philosophe du transcendantal comme il se pensait sans doute lui-même. Humaniste, il le fut malgré sa carte au Parti Nazi, mais dans une dimension que l'esprit de plus en plus étroit de nos contemporains risque de ne jamais rejoindre, de ne jamais atteindre, laissant ainsi notre monde à l'abandon comme il l'est sans espoir. Il me suffit de constater à quel point les écologistes ont dès la naissance de leur " mouvement " abandonné la dimension de la poésie pour sentir monter mon angoisse de citoyen, d'habitant de la planète, de père de deux enfants qui vont vivre ce monde rendu aux puissances déchaînées et conjuguées de l'industrie et du capitalisme. Martin Heidegger est mort en 1976. Je vivais alors au Gabon et n'ai pu me rendre à ses obsèques, ce que j'ai regretté encore plus amèrement que de n'avoir pas tenté de lui rendre visite lorsque je vivais encore à Strasbourg dans les années soixante et que mes professeurs allaient de temps en temps lui rendre hommage. Je ne me sentais pas, à cette époque, à la hauteur d'une telle rencontre, et j'ai bien fait car je ne comprenais rien à ses livres fascinants. Quand je pense qu'il m'aura fallu des lustres pour commencer à voir quelques lueurs dans son texte, je pense au chemin que nos enfants ont encore à faire pour parvenir à une compréhension alphabétique des éléments les plus simples de la pensée. Feront-ils l'effort pour seulement en prendre le chemin ? Peut-être, si nos Professeurs et si nos spécialistes de la philosophie laissent une chance à l'œuvre de Martin Heidegger de s'affirmer dans les écoles et dans les universités d'Europe et du monde. Mais je crains que l'heure du Professeur de Fribourg en Brisgau soit passée malgré l'effort des Français et leur engouement pour sa pensée.
Note.
J'ai échoué, comme tous les autres. En faisant vite, en pliant le temps de ma démonstration ou en escamotant les infinitésimaux, c'est à dire les bavures du temps pensé, j'ai laissé de côté des arguments qui plaideraient pour l'existence d'un autre fil de la pensée de l'Être que l'on peut distinguer le long de l'histoire de la pensée mais qui, n'ayant pas la " vedette ", passe toujours inaperçu. Entre Parménide et Heidegger il n'y a pas seulement des géants qui errent en aveugles autour de la question de l'Être, il y a aussi des penseurs qui y sont allés et qui y vont encore franchement. D'abord on ne peut pas écarter d'un trait de plume les mystiques de la théologie négative, de Maître Eckart à Kierkegaard et Lévinas. On ne peut pas oublier d'un trait de plume les idéalistes absolus comme Spinoza ou Berkley, voire Malebranche sous prétexte d'onto-théologie, et encore moins les rationalistes (que je qualifierais aussi de mystiques) français du Dix-Neuvième comme Renouvier ou Hamelin. Si nulle part le concept de question de l'Être ne figure dans le souci textuel de ces penseurs, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils n'ont jamais fait autre chose qu'élaborer cette même question de l'Être, et, pour les derniers que j'ai cité, dans une proximité bien plus grande que l'on ne veut généralement le reconnaître avec la logique historiale heideggerienne. L'idéalisme français a même fait plus que tous les autres, et peut-être que Heidegger lui-même, car il a rétabli dans ses droits la réalité grecque de la République, geste dans lequel la pensée et l'action redeviennent enfin réellement identiques. Le " miracle " grec s'est DÉJA reproduit.
Jeudi 3 juin 2004
Le désir secret des patrons.
Un long et hallucinant article du Canard Enchaîné décrit cette semaine le développement à grande vitesse du harcèlement dans les entreprises, traitement dont j'ai eu personnellement à connaître et à souffrir pendant de longues années, et ce dans une chaîne de télévision dite culturelle, franco-allemande, européenne et humaniste. Mais je ne vais pas m'appesantir sur mon cas ni même sur les méthodes indignes dont se servent les patrons aujourd'hui pour " gérer " le personnel et se débarrasser des " brebis galleuses " à moindre coût. Non, je veux simplement rappeler une analyse que j'ai faite il y a longtemps déjà sur le destin non -économique du capitalisme et sur les véritables conséquences sociologiques et morales du libéralisme sauvage qui se développe, lui, comme une pandémie ravageuse et mondiale. Marx l'avait prophétisé dans ses Grundrisse, une sorte d'Introduction du Capital qui conserve encore quelque chose du jeune Marx scandalisé par le comportement du capitalisme européen du début du dix-neuvième siècle : il dit en substance que lorsque le capitalisme aura assis son pouvoir sur le monde entier, il tombera le masque et ne cachera pas plus longtemps le cynisme et la cruauté de ses véritables objectifs.
L'enjeu est terrifiant et paradoxal. Paradoxal parce qu'il nie le caractère économique de la stratégie du capitalisme et surtout son but affirmé en tant que domination purement économique. Il est temps de mettre fin à un mythe théorique qui encombre les manuels et la didactique de nos écoles, petites et grandes : la fin du politique n'est qu'un leurre, à savoir que le dépérissement de l'état qui est un phénomène observable n'a pas pour objet le remplacement du politique par l'économique, mais bien le transfert du politique de l'état dans les entreprises. Par ailleurs, il faut cesser de penser le désir de la réussite sociale comme une simple quête de pouvoir d'achat supérieur, de passion pour le pouvoir de l'argent ou de désir d'appartenir à une aristocratie mondiale connue sous le sobriquet de " Jet-Set ". Il faut même exclure désormais, c'est à dire au vu des faits, l'ambition exclusivement liée au pouvoir, le désir abstrait d'exercer la souveraineté et de jouir du plaisir d'être le timonier ou le maître du destin des masses. Il faut descendre bien plus bas, en-dessous de la ceinture comme on dit, et de mettre à fréquenter la tourbe des lieux maudits tels que le divin Marquis les a décrits et lui-même fréquentés.
Le harcèlement dans les entreprises a longtemps été limité au secteur des relations homme-femme, et jusqu'à ces dernières années on ne parlait en général que de harcèlement sexuel et d'abus de position en vue de satisfaire des pulsions libidinales. Depuis plusieurs décennies, maintenant, il faut réviser cette limitation sectorielle du harcèlement et il faut constater que le sadisme, la cruauté mentale et la simple méchanceté font partie des plaisirs des décideurs en tout genre. J'ai bien conscience de me répéter, mais c'est toujours pareil, si on ne se répète pas, on oublie ou on ouvre la porte à l'oubli pour ceux qui lisent ce genre de chronique ; de plus, ce que j'avais dit il y a des années se confirme chaque jour plus massivement, les tribunaux de Prud'hommes et même les Tribunaux d'Instance sont surchargés de plaignants qui ont encore l'espoir que le système judiciaire peut leur porter secours, alors que les puissants du jour ont déjà préparé les modifications de la Loi qui permettront des débordements encore plus terrifiants que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais pour les détails je vous renvoie à l'article du Canard Enchaîné, car ce qui me fait faire retour à ce sujet ne concerne pas seulement quelques milliers de salariés aujourd'hui saisis de fureur ou de dépression, encore sous le coup du caractère scandaleux du comportement des dirigeants de leur entreprise, cela concerne tous les travailleurs présents et à venir, surtout à venir, car ce qui s'installe ainsi dans l'économie, c'est le règne du despotisme oriental le plus trivial, la sauvagerie à l'état pur, le retour à la barbarie.
Mais si vous me lisez depuis quelques temps déjà, vous savez que la barbarie n'est pas pour moi un phénomène social ancien, surtout pas antique, mais une invention très récente, datant exactement du nazisme : le nazisme a réalisé les fantasmes d'une humanité parvenue aux degrés les plus bas et les plus indignes du mal moral. Le capitalisme n'est ni un phénomène naturel portant presque automatiquement le progrès technique et moral, ni une machine aveugle de fabrication d'une ruche absurde et dénuée de toute boussole métaphysique et morale. Le capitalisme est le développement de la barbarie, développement qui n'a fait que commencer avec l'exploitation de l'homme par l'homme sous la forme du salariat, état social qui ne constitue que la rationalisation de l'esclavage et non pas la libération de l'individu. Il faut dont bien comprendre que ce qui commence aujourd'hui dans les entreprises (et qui a déjà lieu depuis des décennies dans les entreprises américaines, voyez la vulgarité sadique et le cynisme qui transpire dans la culture de masse des Etats-Unis) est une nouvelle rationalisation du statut de salarié qui aura pour conséquence de faire empirer encore davantage les conditions d'existence des nouveaux esclaves. En bref, et je ne vais pas tartiner sur ce sujet qui me révulse, les véritables enjeux de l'exploitation capitalistique vont apparaître sous leur forme réelle, concrète, le pouvoir absolu d'un individu sur des masses, le pouvoir de son désir, de ses passions et de ses perversions. Pour finir je ne vais pas y aller par quatre chemin, mais notre société est déjà un goulag, et je suis sûr que la majorité des salariés vivent aujourd'hui dans le malaise permanent, même ceux qui se croient encore protégés par l'état qui se montre chaque jour davantage soumis aux impératifs et aux passions hégémoniques du patronat. Le goulag, ce n'est pas encore Auschwitz, c'est vrai. Mais la logique qui va de l'un à l'autre est en marche et aucune illusion légitimaire ou droit-de-l'hommiste ne changera rien à l'évolution qui conduira l'homme dans les derniers cercles de l'Enfer. C'est pourquoi les socialistes, eux-mêmes tentés par les passions négatives du pouvoir, n'ont plus le choix s'ils veulent encore jouer un rôle dans l'histoire. Ils devront cesser de se voiler la face devant la vérité de ce qui se passe dans la société et trouver quelque part le courage de se mobiliser sincèrement pour organiser la résistance face à ce danger. Encore un mot : pendant l'occupation, la Résistance s'est organisé face à la barbarie nazie. Pendant la guerre d'Algérie, une Résistance s'est organisée parce que l'armée française était en train d'en venir aux méthodes nazies et non pas pour des raisons hautement politiques. La prochaine résistance n'aura pas d'autre cause que la future barbarie qui s'étale déjà dans les milliers de dossiers qui encombrent les tribunaux.
Lundi 14 juin 2004
L'Europe, ou de l'antériorité de sa réalité sur son concept.
Souvenez-vous, dans cette chronique l'Europe a reçu son concept, elle est ouverture. Malheureusement ce concept ne sera concept qu'à partir du moment où la conscience de soi de l'Europe cessera de se réduire à ma propre conscience et à ma propre représentation. Or, ce qui vient de se passer, c'est à dire ce désordre croissant issu d'élections aux résultats et aux paramètres pratiquement illisibles, montre qu'on est loin de la conscience collective d'un concept. Il reste que la réalité de ce désordre ne fait rien d'autre que de confirmer la réalité du concept dont je persiste à faire l'essence de ce nouvel espace du monde qui a tellement de mal à se définir comme l'Europe. En fait, l'essence de cette réalité que révèle le scrutin de ces derniers jours, ou l'essentiel des faits qui s'accumulent d'un bout à l'autre de cet espace, est le désordre et l'impuissance à trouver des catégories classiques qui puissent entrer dans les analyses également classiques de la souveraineté et du politique : l'Europe s'auto-paralyse. Ce n'est pas très joli du point du vue du style, mais c'est la réalité qui laisse la porte grande ouverte à la formation de la conscience de soi conceptuelle ou de la conscience de soi qui soit en mesure de former le concept qui corresponde à la seule possibilité pour l'Europe. Car ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que l'Europe ne pourra jamais se constituer sur le modèle d'aucun système politique existant et qu'elle est condamnée à innover faute de se trouver immédiatement dans des relations de dépendance formelles qui la figerait aussi immédiatement dans une idéologie et donc dans des alliances concrètes dont elle ne peut pas vouloir. Les contradictions internes de cette Europe en gestation lui interdisent de faire du nouveau avec de l'ancien et de verser en douce un vin déjà vieux dans de nouvelles bouteilles.
En gros, les " things at stake ", comme disent les Anglo-saxons, c'est à dire le cœur du problème, se présente apparemment comme un choix entre des formes existantes de souveraineté. Fédéralisme, confédéralisme, Europe des Nations, Etats-Unis d'Europe, etc…, comme dit Monsieur Bayrou : les citoyens veulent savoir où on va. François Bayrou illustre ainsi la position la plus réactionnaire que l'on puisse avoir vis à vis du futur de l'Europe, il veut non pas se poser en créateur d'une Europe qui se distingue radicalement de toutes les autres formes politiques mais en répétiteur ou prosélyte d'une forme dans laquelle il a fait sa carrière, en l'occurrence ce " centrisme " qui n'est plus, dans son essence, que le souvenir d'un marais où ont grouillé pendant la Révolution Française une masse d' agioteurs et de traîtres plus opportunistes les uns que les autres. Il est amusant d'ailleurs, de constater que cette provenance si peu ragoûtante puisse aujourd'hui s'afficher avec autant de force, de sincérité naïve et de bonne conscience qui ferait se tordre de rire les Girondins de la grande époque du Marais. Au total, tout le monde est paralysé, y compris les électeurs, électeurs qui demeurent parfaitement perplexes mais très conscients au plan national de ce qui les sépare de leurs adversaires, ce qui sépare leur doxa de celle des autres. Alexandre Adler exprime ce matin la situation d'une manière rustique mais qui ne manque pas de bon sens en affirmant que ces élections confirment une poussée de gauche dans l'ensemble de l'aire européenne. Cette poussée de gauche n'est évidemment pas tout simplement un poussée de la forme socialisante existante ici et là, mais seulement l'expression d'une opposition paralysante par rapport au capitalisme ultra-libéral qui semble avoir pris le pouvoir depuis longtemps à Bruxelles et à Strasbourg. L'Europe dite " sociale " est un mythe, l'expression d'un concept qui n'existe pas encore mais qui s'esquisse déjà sous les hardes d'une idéologie dont l'essence est, depuis son origine, de s'opposer aux forces réelles de la réalité capitaliste libérale qui régit le monde depuis les Grecs.
Or le social ne sera pas, et ne peut pas être, ni le concept lui-même, ni même la catégorie ou l'attribut principal qui puisse former le concept que nous cherchons, que tout le monde cherche. Car il faut le répéter avant de poursuivre : le grand problème des institutions actuelles (en acte) de l'Europe contemporaine est l'absence de concept, de définition de cette utopie qui s'appelle Europe, et que Heidegger appellerait l'Hespérie ou tout simplement l'Occident. Lui-même, Heidegger, n'avait rien trouvé d'autre pour parler de l'Europe que le mot ou l'idée de " dialogue entre les nations ", ce qui est déjà un grand pas en avant puisque j'ai entendu ce matin l'un de ces politologues proposer d'arrêter le fonctionnement de ces institutions pendant un ou deux ans et de discuter du sens de cette Europe mystérieuse. Mais c'est insuffisant, car on ne peut pas postuler d'une simple discussion qu'elle soit la garantie de la production certaine d'un concept, du concept cherché. A l'instant, un dame exprime cela très bien sur France-Culture, en rappelant que les institutions européennes forment une véritable tour de Babel, lieu par excellence de l'impossibilité de toute discussion, et donc de l'absence maximum de chance de trouver le concept en question.
Or le sens des événements de ces journées qui tournent autour de la constitution de la nouvelle Assemblée européenne n'est rien d'autre que la présence soudaine et forte de ce concept tant désiré. J'avais défini l'Europe comme pure ouverture, comme lieu de la destruction du lieu en tant que territoire soumis à une souveraineté quelconque et comme entame d'un changement ou d'une transformation mondiale du politique. La véritable anarchie intellectuelle qui régit la réalité actuelle des institutions et des relations politiques internes à l'espace européen, ce désordre qui paralyse aujourd'hui tous ceux qui calculent - en particulier ceux qui cherchent à dessiner le camembert des sièges du Parlement - n'est rien d'autre que cette ouverture elle-même, c'est le refus concret de choisir dans le spectre des offres politiques traditionnelles. C'est le refus de la tradition politique en tant que telle, la sortie de l'histoire de cette tradition et la volonté d'inventer une praxis politique radicalement neuve. En fait, pour ceux qui connaissent mes thèses sur le retour du nomadisme, l'Europe est la réalité chargée de gérer ce retour à la liberté du nomadisme dans le contexte de toutes les formes d'excès qui d'un côté pousse à une accélération catastrophique du phénomène (le libéralisme sauvage des possesseurs du Capital) ou de l'autre met tout en œuvre pour empêcher cette évolution naturelle et nécessaire. L'Europe, au fond, sera ou ne sera pas l'instrument de régulation de ce passage du statut de l'individu d'un état de dépendance réciproque qui porte le nom prétentieux de " société " à une position de liberté réelle d'existence dans un mouvement qui laissera loin derrière lui l'ancienne notion de liberté de circulation. C'est pourquoi le seul concept qui puisse rendre compte du cadre d'élaboration d'une Constitution et des institutions de la future Europe est et demeure celui d'ouverture. C'est pourquoi l'Europe est et doit demeurer un simple dynamique de déconstruction progressive des formes archaïques d'existence sociale et politique des êtres humains et ne pas se poser en nouvelle puissance territoriale opposée ou non aux autres volontés hégémoniques.
Aussi conclurai-je en disant que nous avons vécu hier un progrès considérable dans ce qui est proprement destinal dans l'existence de l'Europe. Vous me direz qu'il ne s'agit jamais que d'une répétition qui est devenue familière, mais l'élargissement (qui hier encore n'était qu'une vague possibilité et qui s'est imposée dans la logique même du concept d'ouverture) a introduit une nouvelle dimension dans la force paralysante des formes archaïques qui voudraient s'imposer malgré tout à la réalité européenne. Dans la perspective qu'ouvre cette nouvelle dimension, il y a désormais devant nous le problème turc, de même que celui des pays du pourtour méditerranéen qu'il ne faudrait surtout pas éluder d'un haussement d'épaule. Je prends le pari que les pays auxquels je fais ici allusion, rejoindrons le Palais de Strasbourg bien avant que nos " peuples " si récalcitrants à toute ouverture n'aient eu le temps de dire ouf. La raison, ou la cause objective en sont simples : ou bien nous, les Européens de l'ouverture, continuerons de nous ouvrir au monde, une logique que nous ont, par une ruse de l'histoire, imposé les nomades américains, ou bien ces mêmes Américains viendront nous brouter la laine sur le dos de notre espace, dos qui ne cesse de s'agrandir comme on l'a vu depuis que nous sommes passés de quinze à vingt-cinq.
Lundi 27 septembre 2004
AVIS A MES LECTEURS
Certains d'entre-vous se sont aperçu que j'ai pour ainsi dire cessé de nourrir ce site. Ce n'est
hélas que trop vrai. Mais que ceux-i ses rassurent, cette situation est provisoire. Je sui en effet
en train de tout revoir, c'est à dire à mettre tous mes doutes en perspectives et à lire et relire le
fond le plus nécessaire de ma culture, ce qui représente un grand travail. De plus je ne me permettrais
plus, dans ces circonstances de pontifier sur des sujets que je n'ai plus le sentiment de dominer.
Pour alourdir mes contraintes, j'ai même décidé de me présenter à l'agrégation de philosophie, manière
de choisir un champ que je serai obligé de labourer, nolens volens. Peut-être interviendrai-je quand-même
de temps en temps, mais pas dans l'immédiat. Que cette parenthèse ne vous empêche pas de vous adresser
à moi si vous en ressentez le désir ou le besoin. Bonne vacances et à bientôt !
Jeudi 30 septembre 2004
De l'existence de Dieu.
Mon récent avertissement n'aura pas servi à grand chose, mais bof, il fallait bien que je donne quelques informations sur la panne apparente de OneON. Aussi vais-je repartir sur les chapeaux de roues comme l'indique le titre de ce texte : l'existence de Dieu. Il se trouve que ma principale activité en ce moment soit la lecture et la relecture de quelques textes cardinaux dont ceux de Kant, de Descartes et surtout de Spinoza. Or j'en ai été contraint, cet après-midi même à en revenir au Proslogion de Saint Anselme, tant cette question de Dieu commençait à me donner de l'urticaire. Spinoza, qui est ma relecture principale, ne me donne aucun souci concernant Dieu, car son Dieu est très particulier et n'a rien à voir, quoi qu'il tente de suggérer dans son petit traité sur la philosophie de Descartes. En fait, le Dieu de Spinoza n'a rien à voir avec le Dieu qui fait le gras de la controverse métaphysique de ces deux derniers millénaires. Or c'est celui-là qui m'intéresse, et les tons émus et émouvants d'Anselme de Cantorbéry n'y vont pas de main morte pour vous renvoyer dans les sentiments flamboyants de votre enfance et de votre adolescence, cet âge ou Dieu est revêtu de l'évidence maternelle et donc d'une certitude qui n'a rien à voir ni avec la raison ni avec l'entendement. Tous les enfants élevés par des mères chrétiennes sincères, et de surcroît en délicatesse avec le Ciel pour des raisons très sérieuses, tous ces enfants sont forcément mystiques à un moment ou à un autre, question d'amour, de partage et de sublimation.
Or, en lisant et relisant toutes ces preuves ontologiques et non ontologiques, il m'est venu un question toute naturelle, question que Spinoza ne s'est certainement pas épargné, sinon il n'aurait pas commencé par parler de la Cause de Soi, mais de Dieu lui-même en toute lettre, et cette question est la suivante : comment la notion de Dieu peut-elle naître dans l'Entendement ? Les différentes preuves de son existence reposent en général sur la solidarité interne des attributs d'un concept. Par exemple le fait que les trois angles d'un triangle forment un angle de deux droits, ou en décrivant pour un cercle l'obligation logique de contenir tel ou tel quadrilatère. On peut aussi faire appel à la perfection des choses de la nature, ce qui amuse et éblouit beaucoup les enfants, mais ce que personne n'explique clairement, c'est que ces objets, le triangle, les cercles, les animaux et les plantes et les beautés naturelles ont tous une existence réelle, peuvent avoir une existence réelle, elles peuvent exister " realiter " et non pas seulement " modaliter " ou " formaliter ". Or il n'en va pas du tout de même de Dieu : il n'existe aucun Dieu réel, aucun modèle " realiter " ne peut se présenter d'une manière ou d'une autre en notre présence. Et qu'on ne vienne pas me dire que les abstractions des mathématiques ou de la géométrie ont ce même défaut, car ces abstractions sont bien des abs-tractions, c'est à dire des condensés ou des schématisations d'objets réels dans l'entendement.
Mais quel est le raisonnement fondamental ? Il est le suivant : le concept de Dieu renferme la perfection absolue, il est cette perfection. Or peut-on imaginer la perfection sans l'existence ? Réponse : non, conclusion : Dieu doit forcément exister. Pourquoi pas, mais je demande d'où me vient le concept de Dieu lui-même ? Le concept de triangle, je sais d'où il me vient, de même que celui de cercle ou encore de beauté ou de laideur, mais Dieu, connaît pas, a priori. C'est ma maman qui m'a dit un jour en me montrant le jardin de pépé : regarde la création du Bon Dieu ! Comme c'est beau. Et c'est parti !.. Mais si, à l'instar de Descartes je m'enfonce dans le doute absolu, je me rends compte que ce Dieu créateur m'est parvenu dans l'esprit par le biais de l'opinion de ma mère, puis de celle des curés etc…Mais en moi, pas de génération spontanée de concept de Dieu. Alors les mères ont toutes le réflexe de Spinoza, elles disent en regardant la nature : tu vois, mon petit, la Cause de tout cela, c'est Dieu. La Cause ? Qu'est-ce que c'est la cause ? Alors, petit à petit, on vous inculque la mécanique de la création et tout le reste, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune autre explication de ce mot Dieu qui vient comme un cheveu sur la soupe de la jeune conscience. C'est habile, comme Spinoza, dont le Dieu, finalement, n'a rien à voir avec celui des religions, mais alors rien du tout, et avec celui de Descartes encore moins qu'avec tous les autres. D'où ce soupçon de ma part, mais ce n'est qu'un soupçon, Spinoza a tenté, avec plus ou moins de succès, de stopper net ce qu'on appelle la Révolution copernicienne, celle du Sujet et de l'Esprit. En vain, finalement, sauf que son échec nous a donné Nietzsche et, hélas aussi, le Vingtième Siècle et ses horreurs. Pour vous dire à quel point Spinoza était visionnaire, je ne peux résister au bonheur de vous en citer un passage tout simplement fantastique ; écoutez ça : " - Toutes les lois qui peuvent être transgressées sont des lois humaines pour cette raison que si, en tout
ce que les hommes décrètent, il ont en vue leur bien-être, il ne s'ensuit pas que la Nature entière doive aussi s'en bien trouver, mais au contraire, elles peuvent tendre à la destruction de beaucoup d'autres choses "- !
Voilà une réfutation définitive de l'Homme Maître et Possesseur de la Nature. Voilà une contestation radicale de la subjectité ou de la subjectivité comme valeur absolue du destin de l'univers, voilà le dynamitage de toutes les sottises idéalistes, romantiques et rationalistes qui ont suivi le siècle de Descartes et celui de Kant, l'homme qui a mis la dernière main à cette légitimation de la domination de l'homme par sa science légitime des phénomènes, par sa science estampillée par le Dieu de Descartes, par le Bon Génie qui ne saurait tromper la bête humaine. Alors reste quand-même une question : d'où provient cette fumisterie de concept de Dieu ? Avant Spinoza, il faut remonter à Parménide pour retrouver une notion de la nature qui corresponde à celle d'un Être équivalent à quelque chose comme Dieu, un dieu immanent, Un, dont la seule question posée par Plotin était de savoir si c'était Dieu qui précédait l'UN ou si Dieu émanait de l'UN. Question intéressante car elle indique un tournant, un moment où il y a un passage entre quelque chose qui s'appelle l'UN et ce personnage fumeux qui porte le nom curieux de Dieu. On ne va pas remonter étymologiquement aux aurores du mot, cela ne nous rapporterait pas grand chose, mais ce qui nous intéresse, c'est que la naissance de ce mot va de pair avec la contestation de l'UN : le monde UN, c'est à dire le monde sans limites, sans frontières, sans particularités privatives, sans propriétés privatives, sans brisures autres que les montagnes et les océans, ce monde devient morcelé par la naissance de la Cité, par le développement de l'homme sédentaire, homme qui a besoin de garantir et de pacifier nécessairement son existence faite d'accès hégémoniques et de rapines permanentes. Et pour cela, il faut un maître absolu. Il ne suffit pas d'un tyran puissant, aussi puissant qu'on puisse l'imaginer, il faut un Père total, une Volonté Totale, une Puissance Totale, une référence Totale, une Loi Totale. Il faut du total. L'UN doit céder la place au total ou à la totalité qui n'est plus que la somme saignante à tous ses joints des parcelles de l'UN. L'ennui, et j'en finirai là, c'est qu'il ne suffit pas d'inventer un Dieu pour en finir avec l'UN, ni avec l'Être. C'est ce que Heidegger a flairé dans le fumier théologique dans lequel il a fait ses études, et c'est là-dessus que ce construira la révolution philosophique que Spinoza a raté pour n'en avoir pas voulu. Trop égoïste, Spinoza…
|

|
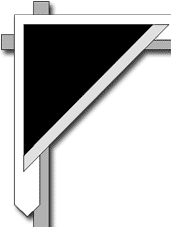




![]()