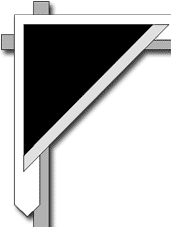Strasbourg le 8 Juin 1993
INTRODUCTION
Difficile de dire si un texte pareil a quelque chose à faire sur le Web. Mais il s'agit ici en fait de la même question que de savoir s'il est pertinent de l'éditer. La différence est qu'il n'existe pas d'autre jury pour en décider que moi-même. Pas mal, non ? Il s'agit donc d'une forme nouvelle d'exercice de la liberté de pensée et d'expression, ce qui est bien l'une des possibilités essentielles qu'offre Internet. Pourquoi la refuser ? Je ne méprise pas le filtre que constitue l'institution de l'édition, il évite bien des déconvenues au public trop naïf, mais si la technique m'offre la chance de contourner la tyrannie du commerce, j'ai toutes les raisons de la saisir.
Ce texte est un Journal, au sens libre du terme. Il me sert avant tout à me libérer de ce que je pense, ou de ce qui me pense. Une manière de laisser passer ce qui a pris forme conceptuelle dans mon esprit et de le déposer dans des mots. Je l'ai commencé en Juin 1993 et toutes les dates correspondent très exactement aux textes. Il continuera d'être enrichi, au hasard de mon inspiration et de mon désir d'écrire. Je présente d'avance toutes mes excuses pour les défauts formels et les quelques fautes d'orthographe qui auraient passé la rampe de la censure personnelle.
Strasbourg le 28 Juillet 1997
---------------------
11 Juin 93
Orage sur tous les fronts. Hier soir Myrie et moi regardions, silencieux, les éclairs sabrer la nuit, toutes lumières éteintes. Qui nous connaît , sait. Norbert, qui était passé la veille et qui a été reçu un peu comme un chien dans un jeu de quilles, avait finalement raison, le torchon brûle. A nouveau. Je ne sais pas s'il existe des cycles aussi dans la relation à autrui, mais c'est tout comme. Cette nouvelle querelle a commencé il y a longtemps, ça se sent venir à de petits malentendus de détails qui surgissent ici ou là. Il y a comme un mouvement irrépressible qui progresse insensiblement vers l'éclat. Je le vois chez elle, mais je le sens aussi en moi, c'est sûr.
Il faut dire que la Stimmung à ARTE n'est pas plus sereine. La naïveté n'a pas de bornes, et en particulier la mienne. A FR3 j'étouffais sous une pierre tombale, j'étais simplement devenu "voix blanche" - dans mon sentiment évidemment - , maintenant, et il fallait s'y attendre, tout recommence. Différence de niveau : au lieu de me censurer sur des petites affaires locales, je parle comme tout le monde des "grands problèmes". Combien de temps soutiendrai-je cette position ? Combien d'années peut-on se mentir à soi-même en toute conscience sous prétexte d'attendre la bonne occasion ? ou celui de glisser des métaphores et des allusions ? Tous les soirs je me pends moi-même comme traître, avec la même naïveté, sans doute.
En fait il faudrait faire tout un travail d'archéologie de ce travail de journaliste, voir par exemple comment se sont inscrits dans la pratique les mises en scène textuelle de l'information télévisée. Dans le style allemand on sent particulièrement bien le côté "technique apprise et impérative". Quand un reportage commence par " Beyrouth :.... on sait que les Allemands ont imposé comme priorité la situation spatiale ou géographique d'un fait. En France on privilégie l'aspect émotionnel, on commence par " 200 morts dans un attentat à Beyrouth.... Mais tout ça ne reflète plus que de la routine, une mécanique qui se croit bien huilée et qui s'effondrera inéluctablement car elle est creuse, creuse comme tout bavardage social. Le tout c'est donc de savoir s'il est possible de sortir du bavardage social. Mon mépris pour le roman dit la même chose, jusques et y compris Kafka ou Dostoievski. Même Debord est un bavard.
Est-ce-que j'ai envie de savoir ce qui se passe avec Miri ? J'en doute. Les choses se passent de toute façon ailleurs. Rarement j'ai eu autant l'impression d'une fatalité sur l'humeur, sur ma propre humeur. En regardant en arrière je vois seulement une petite différence ; dans le temps mes accès de révolte s'enflammaient d'un coup et produisaient immédiatement de grands changements. Maintenant j'ai l'impression que je ne crois plus moi-même à rien de ce qui provient de l'humeur par toutes sortes de canaux rationnels et d'arguments patents. Le pretexte reste cependant toujours le même : le territoire. Miri n'a jamais mis de gants pour asseoir son pouvoir et cette attitude ne me déplait pas foncièrement, tant que j'en perçois les finalités - et sans doute pour autant que j'y entre... - mais il arrive parfois comme si un éloignement progressif rende de plus en plus obscur les objectifs réels qu'elle se fixe. Je sens cela à travers des petits revirements d'humeur sur tel ou tel projet. De l'enthousiasme pour tel projet, ce fut le cas pour le voyage aux Antilles, elle passe à une désaffection dont je ne comprends pas tout de suite la cause. Et puis il arrive un moment où je me représente tout simplement que rien de ce qu'elle désire ou fasse n'est dirigé vers moi, mais vers ses propres passions - ce qui est légitime - mais aussi ses angoisses, ce qui l'est beaucoup moins, car alors je me demande ce que je viens faire là-dedans. La place qu'on prend pour autrui est d'abord conditionnée par cet efficace-là : dans quelle mesure peut-on agir sur la peur de l'autre, dans quelle mesure peut-on la réduire ? Quand on se sent impuissant dans cette tâche, alors croissent certainement les tendances agressives.
Tout ce que je constate c'est la tension partout. La situation bosniaque est peut-être tout simplement la fleur ou le paradigme réel de ce que sont devenues les relations entre les hommes. A Sarajevo on peut collectionner les symboles de cette nouvelle anarchie sociale. D'un côté on meurt, on souffre de blessures de toute sortes, de l'autre on va à la messe, on élit des Miss, on va chez le coiffeur et le soir en boîte.
Atteints par les vagues de tension ? de proche en proche, de discours en discours ? d'images en images ? Bien sûr, j'ai toujours pensé que les états d'âme individuels sont des indicateurs plus sûrs que les statistiques conjoncturelles ou l'information.
Il y a donc quelque chose de vrai dans la façon française de traiter l'actualité, mais cela n'est ni dit ni su. Les sujets ambiance, style micro-trottoir après une inondation, pourraient en dire beaucoup s'il y avait quelque part un dire, et pas seulement une simple photo... En fait le journaliste devrait savoir commenter l'expression des gens et laisser tomber les soit-disant faits. Tant qu'à faire.
Les faits d'hier. On a vu la Bosnie, Balladur, Delors, des inondations et tuti quanti. On a vécu tout à fait autre chose : c'est la schizophrénie quotidienne dans laquelle il faut bien s'y retrouver, retrouver qu'il s'agit en fait, de la même chose. On est loin des récits historiques linéaires ou structurels des formes de souveraineté et de leur évolution. Aujourd'hui il faut essayer de comprendre par quel bout je suis concerné par la nouvelle raie de Bill Clinton. Mais non plus concerné à la Retz, par causalité directe ou indirecte, concern(ement) veut dire ici identification. Comme ils disent, j'ai quelque part un problème de raie. On ne peut pas le voir puisque je ne suis pas Clinton, mais comme la Bosnie, je porte en moi ce problème esthético-politique et il produit ses effets, sur Miri par exemple...
Déphasage : hier soir encore une visite devenue surprise, Jean-Michel Kanner. Curieux, je n'ai jamais senti de sa part la moindre désaffection malgré ses irrégularités. Véritable amitié. Il fait tout pour ne pas m'exploiter, je fais tout pour ne pas tenir compte de la transparence qui marque nos conversations. Prudence toute stoïque, à mon âge il serait temps.
12 Juin 1993
Curieuse journée. La tension persiste, en douceur, par vagues plus ou moins avortées. ARTE : c'est le tour de S, une femme qui trompe son monde. Douceur affectée, le pire de tout ce qui peut se concevoir, elle se meut comme un serpent et ne frappe qu'à coup sûr. Elle fait aussi des erreurs mais elle bénéficie d'une étrange protection.
Le Pape à mon menu. Il craque à l'image, vieilli et visiblement fatigué. L'Opus Dei s'est payé des dizaines de minutes de télé espagnole, on mise gros pour, sans doute pas grand chose. L'infaillible a planifié sa visite en Espagne pour le lendemain des élections, il a du penser qu'il rencontrerait le remplaçant de Felipe Gonzales, c'est raté.
13 Juin 1993
Dimanche matin. Je ne sais pas ce que j'ai rêvé mais cela a abouti à une sorte de résumé semi-conscient sur l'universalité de la mort. Il m'est apparu aux alentours de mon réveil, que la mort ne frappait pas seulement les êtres vivants. Il est vrai que j'avais déjà posé, dans le 2ème Entretien, que tout était phusique, ce qui voulait dire que toute chose de la nature ou de la culture était partie de la Physis, et à ce titre passible des mêmes sanctions, dont la mort. Mais ce matin il m'est apparu plus clairement que, par exemple, il n'y a pas "d'oeuvres immortelles". Avant d'entendre Beethoven, l'homme a écouté des crin-crin vieux de plusieurs siècles puis les a jetés. Avant ces crin-crin il écoutait des harpes à main ou des lyres, et avant encore des bout de bois entrechoqués : chacune de ces formes a disparu, quoiqu'il soit fort probable que chacune d'entre-elle ait provoqué le même sentiment d'éternité que Beethoven.
Autre domaine, et il en a été question hier soir lors d'une visite de Ferdinand, la pensée : là aussi il faudra sans doute apprendre à manier l'idée que, non seulement les produits de la pensée sont mortels, mais encore la forme de ce que nous concevons sous le nom de penser : il est probable, et pour moi certain, que la manifestation ontologique est déjà entrain de prendre une autre forme que l'affairement intellectuel ou poétique : esprit, poésie, philosophie, science (aussi) sont formes passagères de la parousie ou d'autre chose, car le parousique est encore un concept de la spéculation. On peut peut-être imaginer que l'attitude épistémologique - celle du savoir ou de la "recherche" - est liée à un Dasein passif, à une position dans le site illustrée par le doublet nature/culture ou sujet/objet. Si le site devenait , par exemple, culture/culture, l'attitude sachante n'aurait plus de sens. Il faudra, alors, sans cesse, poser ; c'est déjà le credo universel de la marchandise. Un tel évènement pourrait avoir lieu sous la forme de l'image.
15 Juin 1993
A ne pas prendre au pied de la lettre. Ce qui précède.
Grande révolution à la cuisine : les chattes ont hérité du progrès. Une niche princière et une nouvelle litière. Circé s'est à peine aperçu du changement, elle s'est comme moulée dans ce nouveau confort déssiné par des ingénieurs pour la gente féline. Pour Mouschka les choses sont plus difficiles. Chatte de race, elle semble plus attachée à l'ordre du passé, d'autant plus que dans le remue-ménage que tout cela provoque, c'est leur relation entre elles qui surgit dans un nouveau contexte. En prenant les nouvelles places sans histoire, Circé confirme une sorte de curieuse dominance, déjà constatée plus d'une fois. Etant une sorte de mère-adoptive pour Circé, Mouschka fait toujours mine de céder devant la batârde. Une bien curieuse économie, partage naturel qui provoque une sorte de pitié chez les uns et les autres, alors qu'il s'agit visiblement d'un parfait partage du même rôle. Ces deux animaux se complètent curieusement, comme si elles devaient, indépendamment de toute nécessité jouer deux rôles différents et dont l'opposition est en fait complémentarité.
Le plus drôle, evidemment, c'est notre spéculation anthropomorphique à leur propos et notre manière de vivre à leur place la révolution de leurs conditions d'existence. Spéculation à laquelle elle ne doivent pas rester insensibles. Les animaux domestiques doivent, avant tout être un pretexte à introduire la possibilité d'un récit permanent sur le monde, c'est un liant sans doute très précieux. On peut ainsi raconter l'existence des bêtes, y percevoir une ou des logiques diachroniques dont nous devons terriblement manquer nous-mêmes. Et pourtant tout indique que leur comportement est inamoviblement synchronique. D'où l'émotion, et l'indignation, quand cela devient trop visible.
D'où ce corrélat : si nous ne sommes pas très différents de ces gentilles petites bêtes, il convient effectivement, bravo Freud, de distinguer d'abord la structure et la place dans la constellation. La psychanalyse pourrait ainsi devenir un instrument de gouvernement. C'est déjà sans doute le cas, si l'on tient compte de ce que nombre de décisions politiques sont prises en fonction, non pas des actions humaines elles-mêmes et de leur intentionnalité, mais de ce qui en reste sous forme du caca général, l'argent.
Il est donc intéressant de scruter l'histoire des décisions politiques : l'aménagement de l'espace de nos félins c'est une décision de cet ordre. Cela faisait plusieurs jours, voire des semaines que j'étais angoissé par ce problème, sans parler des années passées à contourner par tous les moyens psychiques et physiques, l'insupportable présence "matérielle" de ces chattes.
Cette présence est un problème que je ne peux pas catégoriser ailleurs que dans les séquelles. En rencontrant Miri, j'ai repris ces animaux à la volée comme beaucoup d'autres choses, une reprise qui représente un évènement d'une complexité qui ne m'est apparu que par la suite, parce que ces animaux vivent. Or le vivant finit toujours par se reconnaître. Je n'ai pas échappé à cette reconnaissance quoiqu'il me paraisse évident que les bêtes elles-mêmes soient restées bien plus fidèles à la constellation d'origine que moi. Il suffit de voir que lorsque Marek, l'ex-mari de Miri, passe la porte de la cuisine, les animaux domestiques deviennent les animaux Marektiques. Pour ma part je ne me défend de l'intégration affective que par une rationnalisation contemplative qui ne fait qu'ajouter à mon souçis pour les chattes. Un certain passé de Miri devient ainsi l'objet de tous mes soins et de mes angoisses, au point que, saisi d'effroi à l'idée apparemment égoïste que la garde des chattes pendant les vacances pourrait me gâcher les miennes, j'ai mis en place des garde-fou imaginaires. Inutiles même, puisque la question est dans la garde et non pas dans le confort des chattes.
C'est ce qu'on appelle la ruse de l'histoire : face à tel problème les hommes adoptent telle réponse pour se rendre compte plus tard que leur réponse était adaptée, en fait, à un tout autre problème. Mais je n'étais pas tellement dupe. Le confort des chattes c'est aussi celui de ceux qui les soignent, et mon souçi était bien de faciliter la garde par un assainissement de la situation et de l'hygiène de l'espace culinaire-félin (!).
Hé oui ! Circé et Mouschka vivent exclusivement dans la cuisine, association de deux domaines sensibles qui n'ont pas la même valeur de temporalité pour moi : les chattes proviennent d'une branche du passé, ma relation avec la cuisine d'une autre. C'est délicat..
19 Juin 1993
La Fronde = Mai 68. Tout lecteur de Retz, témoin des "évènements" de 68, ne peut qu'être frappé par la similitude. Il est vrai que le cardinal s'emploie surtout à décortiquer les mécanismes de manipulation des uns et des autres, aussi bien des acteurs de la Fronde, c'est à dire la noblesse , que du peuple de Paris, trop souvent ignoré des historiens lorsqu'ils abordent cette époque. Il me semble, cependant, que la similitude va beaucoup plus loin qu'une description de la psychologie "éternelle" des masses et de leurs meneurs.
La Fronde m'apparaît, de même que Mai 68, comme une rupture aussi profonde que ce que l'on se représente sous le concept de révolution copernicienne : trois cardinaux mettent fin à un millénaire, Retz lui-même est un personnage en tout point de même valeur et de même effet que Richelieu et Mazarin dont il réalise à son propre insu les objectifs. Sa révolte et son action parachève l'oeuvre destructrice des Eminences car il agit selon les mêmes canons, ceux de la politique moderne, dite encore Realpolitik. La noblesse est alors comme une cour d'enfants qui jouent sous la houlette des hommes en robe pourpre. Mais cet état infantile appartient à leur nature même, celle des hommes d'honneur, dont l'existence ne se compromet que dans le jeu des passions. Richelieu et Mazarin les forceront à se compromettre, ou à "déroger", pour leurs intérêts. C'est une phase de la rationnalisation technique de l'étant social. Comparé au présent, l'action des cardinaux représente le passage de la corruption comme éthique à la corruption comme moyen de gouvernement et de mise en chantier de l'étant à exploiter. Colbert dira : "il faut multiplier les Français à l'instar des boeufs afin de pourvoir aux besoins de nos manufactures".
Les "besoins des manufactures" restent aujourd'hui encore le nerf du regain de la croisade contre la corruption, l'étant technique ne tolère plus d'échanges liés aux passions autres que le besoin bestial. Une étape de plus vers le communisme naturel auquel personne n'échappera puisque c'est le capitalisme lui-même qui en prépare les fondements pratiques et donc théoriques.
Mai 68 est une Fronde . Les quelques promoteurs du mouvement que l'on peut distinguer, à commencer par les situationnistes, sont idéologiquement reliés directement au ludisme infantile de la féodalité ancienne. Ce que l'on a coutume de classer dans l'anarchisme de droite est une résurgence ou la permanence ambigüe de cet esprit féodal, dominé par la religion de la passion. D'où d'incroyables parallélismes entre, d'un côté, des monstres dits d'extrême-droite comme une Joseph de Maistre, De Bonald, ou plus près de nous un Micberth , et de l'autre, quelqu'un comme Guy Debord, marxiste grand teint et lecteur, s'il en fût, du cardinal de Retz et de sa descendance. Pareil pour Vaneighem dont les Traités sont de véritables manuels pour apprentis-seigneurs.
Comment en suis-je venu à rencontrer ces gens ? Juillet 1964, Bâle : Je viens de débarquer à Genève en provenance d'Alger, en compagnie de Jean (Montcharmont), et pendant qu'il va au Festival de Jazz d'Antibes voir Albert Ayler, je reste en Suisse, n'ayant aucune envie de refaire un séjour clandestin en France. A cette époque je suis déserteur, condamné à trois ans de prison, et je ne suis pas encore décidé à négocier mon retour avec le gouvernement De Gaulle.
Le séjour commence très mal, Jean oublie de m'envoyer de l'argent de France, je reste huit jours pleins sans manger : il m'en veut encore aujourd'hui !! Après une ultime nuit passée dans les buissons d'une autoroute toute neuve, je manque me faire ramasser par des policiers suisses en civil à la gare de Bâle où je suis venu me réchauffer; par bonheur je les reconnais, ils m'avaient arrêté deux ans auparavent pour une fausse interdiction de séjour, je leur saute au cou, on pactise et je passe mon chemin. Quelques heures plus tard arrive le cortège : Jean, Richard, Théo, et dans la sacoche de Théo les six ou sept premiers numéros de l'Internationale Situationniste. Le temps de restaurer un estomac réduit à la taille d'un petit pois et je saute sur la lecture des IS. Il est vrai que j'avais déjà lu et relu le numéro 1, que Jean m'avait prêté à Saïda, j'attendais avec beaucoup d'impatience les autres. Je passai la nuit à dévorer la récolte. C'est un moment important. Ma formation "théorique" est encore toute marxienne, jeune Marx. Pour la pratique je suis un Tiers-Mondiste rigoureux , la notion de prolétariat, alors au centre des divergences des gauches, définit pour moi autant les "ouvriers" de l'industrie (théorie Stalinienne) que les paysans ou autres classes exploitées (théorie cubaine-chinoise) . Mais je reste sur ma faim depuis que j'ai rompu avec tout militantisme. Une rupture que je dois à mon dégout pour le théoricisme éclairé des cadres de parti, en vogue dans tous les groupes de la gauche : le Léninisme - entendez par là le principe de l'organisation révolutionnaire dirigée par des "formateurs" ou des éleveurs de conscience - m'a toujours paru suspect et totalement hypocrîte. Paradoxe : les textes de Debord, Vaneigheim , Jorn etc... sont à la limite du lisible. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, et seul un habitué de Marx peut avoir cette patience. Je me souviens que Le Monde lui-même avait salué la "bonne tenue littéraire" de l'IS, mais il s'agissait en fait de tout sauf d'une "tenue" !...
Or le style situationniste ne trompe pas, du moins l'écriture propre à Debord lui-même. Il s'agit de "grand style", injecté jusque dans la moindre notule, les plus mauvais textes restant les analyses à velléité théorique. Le grand style c'est ici une volonté féroce d'agir directement par le langage, de jouer directement sur la donne historique, sans disposer de la moindre "division". Les seigneurs de l'esprit pouvaient, et jusqu'à un certain point ils l'ont prouvé, faire et défaire des empires intellectuels. Combien de cuistres sont spirituellement morts sous les traits mortels de Debord, de Lefèvre à Morin, les cadavres culturels ne se comptent plus. Bref, les situationnistes ont fait leur Fronde. Comme les Condé , les Retz et les Beaufort , ils ont voulu se mettre en travers de la fatalité du "réel rationnel". Leur anti-stalinisme n'était pas moins explosif que leur critique de la société capitaliste de consommation, c'est pourquoi ils n'épargnaient ni les éminences de la culture officielles, ni les petits marchands de lutte de classe, de la variante PC jusqu'aux troskystes les plus débridés.
Cette lecture fut une libération pour moi. Elle indiquait une autre voie possible, même si la première illusion fut de croire que le groupe de situs lui-même constituait un point de départ pratique. En réalité, la pratique situationniste, la politique qui faisait et défaisait le groupe concentrait tous les défauts conjugués des manipulations bourgeoises et staliniennes, en fait la logique des Frondeurs ou des Révolutionnaires de 89, condamnés à se déchirer d'autant plus impitoyablement eux-mêmes que chacun était condamné, par la théorie, à jouer le seul jeu de ses passions. Le pamphlet publié par une des victimes de la purge sanglante des années 66-68 porte bien son titre : "l'Unique et sa propriété", rappel stirnérien entièrement dirigé contre Guy Debord. Lorsqu'en 1971, ce dernier dissoudra l'IS, il utilisera des arguments très en-deçà de sa véritable compréhension du phénomène. En réalité Guy Debord n'avait aucune raison d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit, il avait changé radicalement de stratégie, et cette stratégie, enfin, reconnaissait qu'il fallait exclure toute forme d'organisation. Le seigneur n'a besoin de personne, premier requisit de l'homme joueur.
Mon illusion fut de courte durée. Ma rencontre avec Debord, un de ces Parisiens à sociabilité malpropre, tout mélange de spontanéité et de reflexivité manipulatrice , bref jésuite, puis une expérience ridicule avec le groupe de Strasbourg m'a fait prendre de la marge et éviter de figurer dans les charettes de la place de Grève et dans l'histoire du "situationnisme".
Constante de ma vie. Je ne figurerai nulle part. Par excès de lucidité ? par manque de "lubricité", comme le prétendait Théo ?
Les deux sans doute, mais surtout une impuissance à reconstruire une amitié. Les Frondeurs ont survécu pour la plupart grâce à l'amitié. Mais, une amitié se contruit-elle ? Problème redoutable pour les situationnistes comme pour les frondeurs. Tant que la nature sert de fondement à un groupement social, telle la noblesse qui s'était forgée dans l'immense lubricité du 16ème siècle, dans la paillardise bagarreuse et festive, l'amitié peut souder le groupe dans l'adversité pendant un certain temps, pour une dernière fête comme la Fronde elle-même.
En ce sens aussi Mai 68 fut la fin des amitiés de la jeune classe bourgeoise-féodale, on avait assez rigolé, il fallait enterrer cette vie de patachon en beauté, aller au feu le verre de champagne à la main, nous allions tous mourir sur le champ de bataille du travail !!!!! Les sociologues disaient gravement "du travail manquant", crétins analphabètes, incapables de lire ce que nous écrivions alors sur les murs des usines, dans le style : Nous ne travaillerons jamais ! Pour ma part c'est à cette époque que je formulai mon compromis avec les maîtres-chanteurs du tripalium. Je me disais : ils veulent que je travaille ? Hé bien soit, ils n'auront de moi que cette merde là, je garderai pour moi tout le reste. Perdu pour perdu, leur châtiment sera inscrit dans mon propre travail, et pas seulement sous la forme de la perte, mais sous celle de ce qu'apporte le travail en tant que tel. Voir Jünger.
Mai 68 réalise donc aussi le projet technique : il est textuellement le suicide des cosaques, mais nous ne nous jettions pas, alors, dans le guet-apens des rouges, nous sombrions fièrement devant la marchandise. Le produit des manufactures de Colbert avait gagné, il ne restait qu'à disparaître dignement. C'est pourquoi tout discours rétrospectif sur Mai 68 ne peut être qu'une imposture. Nous sommes morts et les morts sont muets.
Fronde et Mai 68 communiquent par d'autres canaux. Le maître-mot des soixanthuitards , dignes de ce nom, était la réification, vieux concept de Lucaks, abondamment repris par l'aile marxiste de l'Internationale Situationniste. Or, cette réification est une expression métaphysique qui recouvre, d'une certaine manière, celle , cartésienne , de res extensa. La réification est, en bref, la réduction des relations humaines en relations de marchandises, la catégorie marchandise homogénéise le social, l'homme lui-même étant devenu, par le salariat, marchandise. La res extensa, elle, se présente comme une autre forme d'homogénéisation du réel, de disqualification des étants. La res extensa est tout simplement l'espace séccable à l'infini, c'est l'univers, selon Descartes. Un univers, et c'est là qu'on est tout près de la Fronde, dont les Cardinaux appliquent le schème au territoire national : la France n'est plus le conglomérat de souverainetés qualifiées par leur seigneur et par les mille relations de vassalité ou de suzeraineté dans lesquelles il peut jouer, mais l'espace homogène de la souveraineté royale. Le pré-quarré c'est l'horreur, ou le vide, de la res extensa appliquée en politique.
Quand certains font remonter le totalitarisme à la Terreur, ils font fausse route, car le sang est une qualité étrangère à la totalité. En réalité le totalitarisme est dans le genre de la totalité qu'indique le monarchique, étendu, en tant qu'absolue souveraineté, à tant et tant de kilomètres carrés. La prémonition se trouve d'ailleurs déjà dans Louis XI qui est contraint d'infliger à ceux qui se mettent en travers de son ébauche d'état total, des traitements peu différents de ceux qui font toute l'horreur des camps de la mort.
Encore un mot sur le Grand siècle : ce qui suivit la Fronde, c'est à dire le règne du Roi Soleil, fut sans doute la plus grande épreuve que jamais vécurent les Français. Tragédie hallucinante, où l'application méthodique du schème de l'état-total monarchique, déboisait forêts et populations dans la même indifférence et avec la même bonne conscience. La dette qui se creusait alors entre la monarchie et le peuple ne pouvait qu'aboutir à la banqueroute de 1789.
21 Juin 1993
Rien. Mon corps qui parle. Le médecin impuissant. Cela aura-t-il une fin ?
22 Juin 1993
L'inceste au menu de France-Culture. Thème admirable pour travailler sur la mauvaise foi. Le même socio-bio-généticien (!) déclare sans rire que deux rats frère et soeur, mis dans une même cage, copulent. Mais, ajoute-t-il, on ne peut rien conclure parce qu'ils sont en état de captivité, l'expérience peut fausser le résultat. Dix minutes plus tard, le même savant démontre la généticité de l'interdit de l'inceste en décrivant deux guêpes frères et soeurs (en captivité) qui, elles, évitent de copuler...Ca se termine par un jargonnement sans fin sur la double origine innée et acquise de l'interdit. Au passage on affirme que l'inceste aboutit à des catastrophes dans les éspèces, sans préciser quel type de catastrophe.
Et si l'on abandonnait, une fois pour toute, dans ce débat, le point de vue dit scientifique, ou expérimental ? Que peut dire le sujet là-dessus ? Moi, par exemple ? Et là encore en faisant le distingo entre ce que je "sais" et ce que je sens ou intuitionne.
Je "sais" un certain nombre de choses fort contradictoires. La première est que les peuples non-occidentaux que j'ai pu fréquenter, en Afrique notamment, pratiquent l'inceste à grande échelle, alors même que l'inceste figure comme le seul interdit commun. Nous avons le "péché originel", les Fang ou les Baoulé ont l'inceste. La pratique directe de l'inceste est évidemment totalement cachée, mais le principe du mariage endogamique, défini comme ayant lieu exclusivement à l'intérieur de l'ethnie renvoie finalement à une forme inévitable d'inceste. D'où d'ailleurs des maladies "ethniques" comme la drépanocytose. Le fait que les ethnies se partagent en clans pour permettre une exogamie de façade, ne change rien à une consanguinité forcée.
D'autre part il est avéré que, comme dans le cas de la drépanocytose, des maladies génétiques - par exemple l'hémophilie - se transmettent par consanguinité, et peuvent donc affecter toute une lignée. Mais là encore il n'y a rien d'automatique, le gène de l'hémophilie peut être récessif dans tel cas, dominant dans un autre, il se manifeste ou ne se manifeste pas. La seule certitude est que dans tel capital génétique il est présent sous la forme active ou sous la forme dormante. Si tel n'était pas le cas, tous les Romanov, ainsi que toutes les individus des familles européennes alliées, seraient hémophiles.
Plus intéressant sans doute est ce je me représente moi-même de l'inceste, en tant que j'expérimente l'état d'être vivant soumis à sa problématique. Là, il y a une sorte de paradoxe diachronique : autant mon expérience d'enfant montre un rejet très fort de tout comportement incestueux, par comparaison par exemple avec celui de mes frères, autant mes convictions d'adulte, s'inscrivent toutes en faux contre cet interdit. Conviction n'est pas comportement, certes, et il ne laisse pas d'être patent que je ne pratique aucune forme d'inceste.
Ce n'est pas preuve de forfanterie théorique. L'on confond trop souvent , dans le débat sur l'inceste, l'acte incestueux lui-même avec la situation pratique morale. Il est ainsi notoire que la justice a toujours le plus grand mal à distinguer, dans un cas d'inceste, le degré de responsabilité juridique des coupables, et n'intervient, en réalité, que sur des cas d'inceste comprenant des mineurs. Que signifie un interdit social limité à la minorité de l'un ou de l'autre des partenaires ? Il signifie très clairement que l'inceste existe rarement dissocié de la violence ou de l'influence. Le père ou la mère peuvent exercer l'un ou l'autre sur leur enfant, se plaçant ainsi sur un tout autre terrain que celui de l'interdit biblique de la copulation incestueuse, et l'on ne distingue plus , alors, l'inceste du viol pur et simple. Voilà, pour ce qui me concerne, l'élément naturel qui me tient, naturellement, à distance de ma propre fille. Pas plus qu'il ne me viendrait à l'occurence désirante de violer qui que ce soit, il ne me travaille en désir l'idée de toucher ma fille.
25 Juin 1993
Le roman comme succédané. Longue discussion avec Marc Nassivera. Le dix-neuvième siècle a inventé le roman comme Nestlé le Nescafé, boisson de campagne pour armée américaine. A prendre n'importe où et dans n'importe quelles conditions pour plâtrer les manques à vivre ou / et les manques à rêver.
Aujourd'hui, le roman est nu. L'industrialisation de l'écriture a exhibé les paramètres nécessaires du succès littéraire : contrefaçons en tout genre selon un mode réglé sur l'équation sociale dominante. Pareil pour le septième art dont le néo-réalisme italien n'est une exception que là où il ne tombe pas lui-même, comme un Hugo ou un Zola par exemple, dans un engagement politique. Dans la peinture, au demeurant, il se passe quelque chose de semblable, si la réalisation d'une toile est socialement intégrée comme artisanat, elle n'intéresse que le mécène ou l'historien. Le peintre ne réussit que là où il commande à ce qu'il voit et lui seul, évènement qui n'intéresse qu'à distance et par hasard. On peut tenter de comparer des Flamands et constater qu'à côté des paysages, des natures mortes ou des scènes anonymes, il existe toute la série des hommes en noir, sans aucun intérêt artistique. Ces portraits appartiennent totalement à la réalité du 17ème siècle, la réalité politique et sociale. Ils ne peuvent nous toucher qu'en sus d'un savoir et d'une culture historique spécialisée. Pour ce qui est de la représentation religieuse des quattro et cinquecento les résultats sont plus hétérogènes car le visible se présente de manière inattendue là où l'invisible est programmé légalement et massivement. Ce qui est considéré comme décoratif dans un tableau du Tintoret, est en général bien plus génial que l'objet même de la toile. Même exception pour un peintre idéologique comme Goya.
27 Juin
Curieux. Miri ne comprend pas vraiment ce point de vue. Elle m'accuse , si je comprends bien, et Dieu sait que c'est une vieille accusation, d'idéologie immédiatiste, vieux spontanéisme anti-représentation. Cela même qui provoquait notre ironie dans les années soixante. En clair, je ne serais pas capable de concevoir l'existence par "déplacement" dans la dimension de la représentation.
Cela a-t-il un sens ? cela correspond-il au vieux procès platonicien qui traverse, sous la forme de la représentation, tout les deux millénaires qui viennent de s'écouler ?
Cherchons sous un autre angle. Celui du goût. Il fut un temps où je dévorais le roman comme n'importe quel critique stipendié pour noircir chaque semaine une page du Monde ou du Figaro, mais avec, en plus, la jouissance - immédiate ! -
et sans la nécessité d'en tirer mon viatique mensuel. Oui, je peux dire que j'ai tiré des romans que j'ai lus, tout ce que je vois bien que l'on tire de l'écriture, une fois qu'on est passé de l'autre côté du monde des signes graphiques. Le problème n'est précisément pas là, dans le graphe, il est très exactement dans la quantité et la qualité de jouissance que je pouvais alors tirer d'un roman. En général forte identification, émotions liées au suspens du développement de l'action, que ce soit dans un polar ou dans Lucien Leuwen. Cette sorte de précipitation qui provoque une existence parallèle, au demeurant aussi jouissive qu'un bon spectacle, un passe-temps au sens de exister le temps, aussi fort que nimporte quelle autre activité. Avec, quand même, toujours la conscience de n'être pas là, mais dans les pages d'un livre, presqu'en faute. Dans mon enfance, il est vrai, lire restait une activité méprisée, tu temps perdu pour des adultes qui ne pouvaient comprendre tout le parti qu'on en pourrait tirer, plus tard, pour les mêmes objectifs qu'eux-mêmes s'étaient posés, savoir la réussite sociale. Nous luttions d'autant plus pour lire, avaler livre sur livre, manière aussi d'échapper à l'ambiance terriblement vide des années 5O pour des adolescents nés dans le "roman" de la guerre.
Bref, j'ai donné. Et puis, avec les années et, justement, un déplacement du goût, le roman a fini par me tomber des mains. La lecture devenait autre chose, elle continuait, d'une certaine manière, de porter en elle le mystère du déchiffrement propre à la construction d'une intrigue, mais elle cessait d'apporter les réponses à l'issue d'un voyage convenu, ou devenu répétitif. Les lectures philosophiques étaient devenu mon activité romanesque. Bien sûr, ce fut d'abord un travail bien plus redoutable - quoiqu'un texte comme celui de Nietzsche se laisse assez immédiatement aborder, sans un arsenal conceptuel trop élaboré, il fut mon livre de chevet de mes dix-huit ans - car il s'inscrit dans une taxonomie conceptuelle dont on ne fait pas l'économie. La philosophie est tout à fait comparable aux sciences en ce qu'elle procède par combinaison et fondation théorématique de concepts. Il y a, certes, un écueil inévitable, c'est celui de la traduction. Heidegger a parfaitement démontré à quel point la latinisation du grec a rendu la langue de Platon et d'Aristote tout simplement inintelligible.
Autre problème, celui des transistions non-apparentes entre des systèmes qui intègrent des doctrines, par exemple le cartésianisme par Kant, et qui passent à une nouvelle conceptualisation. Le tout dans une autre langue. A cet égard, le tout premier texte d'Heidegger sur l'interprétation phénoménologique d'Aristote, révèle à quel point une pensée doit se placer dans son être-là dans le monde avant de pouvoir prétendre éclairer la pensée du passé. Ce qui signifie qu'étudier tout de go Aristote ou Kant n'a de sens que dans un combat de pensée avec le présent, ou, comme il le suggérera plus tard, avec l'aide du préalable d'une compréhension effective et non seulement implicite de la question philosophique première qu'est la question de l'être.
Ma condamnation du roman est donc d'abord affaire de jouissance trahie par l'inéluctable caractère répétitif de toute intrigue close. Joyce peut bien tenter de conserver à son texte un caractère aporétique, il demeure fermé, clos par l'évidence de la manipulation elle-même. Pareil pour le nouveau roman. Il veut, naïvement lancé sur les traces de Sartre, donner à l'écriture la force de la perception, transposer la complexité de l'équation existentielle en des constructions de langage qui échappent, en apparence, aux canons romanesques.
Il renforce cette prétention des auteurs de romans à la parturition d'une réalité déplacée, comme dirait Miri, mais qui sent en fait son pensum, aussi inextricable dans sa jouissance que dans l'exercice que pourrait constituer sa lecture. Un exemple classique, le Faustus de Mann, jeu qui devient tout à coup insupportable entre une initiation mantique à l'histoire contemporaine et une fantasmagorie de personnages qui ne font que mettre en scène des visions du monde.
Reste que toute littérature n'égale pas roman. Une autobiographie ou une chronique de St Simon est tout autre chose. Quelle que soit la part subjective de ces genres, ils se présentent véritablement comme une communication de témoignages et à la fois comme une vision d'époque. Là encore on entre dans une aventure de déchiffrement ouverte de l'histoire ou de la civilisation. Les outils conceptuels existent là aussi, mais ils ne transparaissent que dans la saisie du message subjectif : la sensibilité de Retz, par exemple, s'analyse fort bien à partir de la distribution dans son texte, des différents domaines abordés par son récit. Malgré sa visible tentation de s'étendre sur son libertinage personnel, il en dit relativement peu de choses, il préfère défendre sa mémoire en illustrant son talent et sa bonne foi dans le rôle qu'il joue dans la Fronde. Il n'en demeure pas moins qu'un Cardinal parle de sang froid de ses fredaines érotiques, signe des temps où la dévotion était, pour la caste aristocratique, un simple instrument de pouvoir. Le Tartufe aussi, me dira-t-on, fait cette démonstration. Certes, mais il manque au Tartufe d'être la chose même, ou plutôt à Molière d'être prince : aujourd'hui comme au 17ème siècle on peut accuser la calotte ou la médecine, or un procès ne se règle pas sur une scène, mais dans un tribunal. Eternelle confusion, confusion antique : je suis persuadé que la tragédie grecque n'avait pas d'autres fondements que l'ennui d'une race d'anciens cavaliers nomades, avides de se donner l'illusion des anciens exploits.
La mort. La mort au coin de la rue. La mort à chaque rencontre, mais seulement comme principe de départ de la relation, pas comme fatalité. Voilà comment je me représente la condition nomade véritable : le rencontré est ennemi par la réalité du non-communiqué des intentions réciproques. Au détour de la rue je tombe sur l'autre, et à ce moment là il est ma mort possible et rien d'autre. D'où la priorité du silence dans la rencontre nomade, car il n'existe pas de médiation. Le signe ne peut naître qu'après le silence, quand la mort est passée comme principe, c'est à dire lorsqu'elle a été reconnue comme élément de la rencontre. Le signe lui-même, cultivé autarciquement comme menace de mort, doit être purifié par le silence ou sans doute seulement masqué - comme pour la tragédie antique - avant de pouvoir opérer comme report de mort, comme trêve. D'où la vraie législation, la seule loi oubliée, celle de la parole nue, sans jurisprudence et sans capitalisation scripturaire : sans droit romain. Le Jus séparé du Fas, c'est la loi séparée de la circonstance, c'est un discours déjà présent dans toute rencontre, un discours inscrit d'abord dans le territoire comme propriété ou comme imperium. En réalité, AUTRE propriété du sujet rencontré, prédicat surajoutée à l'homme nu comme une couleur inapparente. D'où il découle que tout imperium est volonté d'établir un signe mortel qu'aucun silence ne peut atténuer : la propriété privée est une sémantique accumulative de mort, le sédentaire qui a donné les nations ne pouvait qu'aboutir à des cataclysmes. Le fameux Gestell c'est peut-être d'abord cela, la fixation dans le sol du principe de mort, la décharge municipale des dangers. Par cette fixation l'homme peut se dégager de son souci , se détourner de son être à la mort et inventer la fuite permanente par inscription totémique.
Imaginons le Jus et le Fas non séparés. Cela signifie que la circonstance fait le droit et vice-versa : il n'y a pas de moyen terme entre la situation et le règlement de la situation, pas d'élément transcendant disant le droit en telle ou telle circonstance. La seule transcendance est, non pas, comme le présuppose la thèse de Hobbes - déjà déterminée par la séparation du droit et de la circonstance - c'est à dire le droit du plus fort, c'est la force du plus droit. Etrange et paradoxal retournement, mais pas si étrange que cela si l'on délivre, une fois pour toute, l'être humain de sa dépendance des outre-mondes et donc de sa faute originelle.
Ce mythe, d'ailleurs, n'a rien de vain, car il doit véhiculer dans la structure religieuse, cette évidence de la mort présente en toute véritable altérité.
Il va de soi que pour seulement pouvoir prendre en considération une thèse de cette ordre, il convient de savoir jongler avec les millénaires, en même temps qu' accepter toute théorisation comme aléatoire. C'est une des grandes contradictions du pragmatisme anglo-saxon, que d'avoir intégré cette dimension de l'aléatoire, tout en établissant des fondations dogmatiques aussi fortes que celles de Hobbes.
Le Léviathan est bien une approche très exacte de la condition sociale en ce qu'il reconnaît la mort, ou l'agression universelle comme terme principiel de toute relation. Mais Hobbes reste incapable de se distancier par rapport aux règles du jeu qui ont force de loi à son époque : il ne sait pas jouer avec les millénaires, autrement qu'en référence au Livre. Il ne peut donc pas saisir cela même qui fait que le social est possible sans faire appel au mythe fondateur de la suprématie du mal. Il ne peut pas comprendre que la mort qu'il fictionne n'est que symbolique. Sans doute est-ce parce que sa psychologie reste profondément ethnocentrique, et s'il avait pu avoir accès aux descriptions ethnologiques des 19 et 20 ème siècle, il aurait eu ample matière à perplexité. Et encore. La psychologie Hobbesienne est un échantillon très classé, dont le périmètre expérimental ne dépasse pas la City de Londres. Il est probable qu'à son époque il eût pu faire des observations très différentes dans le Pays de Galles ou l'Irlande toute proche : le paradoxe historique reste que le seul véritable Léviathan se construit au même moment de l'autre côté du Channel, chez Louis, alors que l'unité britannique reste une fiction encore aujourd'hui.
"
Mais,écrit Hobbes,
l'invention la plus noble et la plus profitable de toutes, ce fut celle de la PAROLE, consistant en des dénominations ou appellations et dans leur mise en relation, invention grâce à laquelle les hommes enregistrent leurs pensées,les rappellent quand elles sont passées et aussi se les déclarent l'un à l'autre, pour leur utilité naturelle et pour communiquer entre eux, et sans laquelle il n'y aurait pas eu parmi les hommes plus de République, de société, de contrat et de paix que parmi leslions, les ours et les loups."
Analysons un peu. La parole comme invention ne se conçoit que dans le cadre biblique d'un dieu qui donne la parole, ce que Hobbes dira d'ailleurs quelques lignes plus loin. Or, pour nous, la parole nous semble bien plus devoir sa genèse à une histoire du signe vocal, à une accumulation primitive de capital sémantique phonique. Il y a une phonogénèse parallèle à la philogénèse elle-même. La neutralité originelle des cordes vocales d'un enfant et la malléabilité qui en découle ne trompe pas à ce sujet, un enfant peut être élevé dans n'importe quelle langue, quelle que soit son origine génétique. C'est au moins la preuve que la parole, en tant que telle, ne lui est pas donnée de manière innée mais qu'elle se développe ontogénétiquement par rapport à une faculté physiologique certes innée, même si elle aussi procède inévitablement d'un développement.
Vient ensuite l'idée que la parole "enregistre" les pensées. Il ne se trouve sans doute plus personne aujourd'hui, pour avancer l'idée qu'il existe une pensée sans mots : id est sans parole. Dans la foulée, l' "utilité naturelle" de la pensée n'existe que pour autant que la parole elle-même soit "naturelle". Le plus important, cependant, c'est la conclusion de cette grande phrase : sans parole point de République, de contrat et de paix, ou du moins pas plus que parmi les lions, les ours et les loups. Il saute aux yeux que dans le contexte biblique, cela fonctionne très bien, le babélisme est la conséquence du péché. Avant Babel, il faut imaginer une langue universelle, transparente et sans passage par l'acquisition, car un tel passage laisserait forcément comme conséquence une déformation, déperdition, interprétation qui ruinerait immédiatement l'universalité de la parole.
Si, au contraire, on prend la parole comme le véritable fauteur de violence, précisément parce qu'elle est lié au particulier, alors on peut se persuader que le premier danger de toute rencontre est dans un échange hâtif et non ritualisé par autre chose, de mots "mis en relation". C'est donc bien le silence et non la parole qui garantit immédiatement la paix, ou du moins de la mort sans phrase. Ironie des expressions, mais le phrasé n'est, textuellement, qu'une suite déterminée de sons, autrement dit la phrase est d'abord séquence rythmique. On est tout près du rite.
En sautant dans les siècles et dans l'espace, on constate par exemple, que quelqu'un comme Bismarck, Hobbesien s'il en fût, saisit intuitivement que la cohésion sociale destinée à cimenter les fondement du Léviathan Willhelmien n'est pas exclusivement la relation de force. Bismarck invente la relation de solidarité sociale. Ce nouvel élément n'est pas un effet de la cohésion issue de la force impériale, mais une nécessité politique destinée à faire pièce à la persistance dans les classes aristocratiques de règles ludiques préjudiciables à la constitution d'un empire homogène. Autrement dit, Bismarck a eu besoin de fabriquer une clientèle populaire et bourgeoise pour contrer une aristocratie de plus en plus réticente à prendre le chemin de l'unification, source de limitation pour leurs propres privilèges, ou source de dérogation. Pour le chancelier, il s'agit d'ailleurs d'une trahison de son propre clan au nom d'une vision romaine du domaine impérial. Mutatis mutandis, Bismarck réalise, en quelques années, tout le processus, ou presque, mené à bien par Richelieu, Mazarin et Louis XIV. La Fronde allemande durera du coup beaucoup plus longtemps. Elle ne cessera définitivement que dans l'échec "positif" du complot de Juin 1944 contre Hitler.
Rome avait déjà été contrainte de transiger de cette manière, panem et circenses sont la préfiguration de la sécurité sociale allemande. Mais cette dernière est un progrès considérable par rapport à l'évergétisme romain. Le système social bismarckien ne fait pas appel à la libéralité des nobles mais à une libéralité générale : il fait une entorse à la définition négative de l'esse humain en y postulant une part de bonté naturelle ou nécessaire, ce qui revient au même. Nous en avons hérité un bébé fort encombrant : l'état-providence, contre-modèle du Léviathan.
La critique des empires, entamée depuis longtemps par les Rousseauistes-socialistes pour des raisons idéologiques et aujourd'hui par les libéraux pour des raisons objectives, devra, face à ce qui est devenu le projet commun, la mondialisation, clairement affronter cette question sous peine de paralysie juridique, déjà visible dans les débats de fonds sur les moyens de faire respecter les Droits de l'Homme.
A cet égard, deux écoles s'affrontent déjà depuis de longues années. La première reste classique dans sa démarche. Amnesty International table sur les engagements législatifs propres à chaque nation, sans promulguer un quelconque droit universel imposable par une entité transcendante telle que l'ONU. Cette attitude très anglo-saxonne par son pragmatisme scrupuleux, un pragmatisme qui fait le fond théorique de la rédaction de toutes les Chartes des Droits de l'Homme depuis 1945 - celle de l'ONU et celle du Conseil de l'Europe - mène tout droit à l'impasse. Il ne peut, au mieux, que s'autoriser d'un indignation perpétuelle sans l'assurance d'aucun progrès dans l'application des Lois particulières à chaque nation. L'autre réinvente une sorte d'évergétisme universel : l'aide humanitaire, qui implique inexorablement l'ingérence politique.
En réalité le problème de cette forme de législation est qu'elle demeure fictive pour ceux-là même qui la promeuvent comme modèle. L'application ou le respect des Droits de l'Homme, dont la fondation métaphysique reste à faire, souffre de l'universalité de leur définition. Cette universalité, aujourd'hui au centre du débat politique international, postule un être humain inexistant dans la réalité, c'est à dire un être non inscrit dans une souveraineté territoriale. Le paradoxe va même très loin : au lieu même d'où sont prescrits ces droits, se génère, en ce moment même, des mécanismes de plus en plus restrictifs, destinés à empêcher que des hommes désirant changer d'inscription territoriale puisse le faire. L'Allemagne, puis la France, légifèrent sur la citoyenneté selon le mode protectionniste, oubliant de la main droite ce que fait la main gauche en Somalie ou dans les assemblées internationales. Extravagance apocalyptique dans ses conséquences, car le malthusianisme xénophobe ne pourra, dans les semaines qui viennent, exercer son oeuvre sans dissoudre le seul socle que possédaient encore les Droits de l'Homme, à savoir la force de leur expression originelle. Cette force est celle de la Révolution française, un événement d'une telle ampleur qu'il autorise depuis deux siècles, l'usage de l'expression Droits de l'Homme et, comme on peut le voir, certaines actions qui se revendiquent de ces droits. Or, il se trouve que la République, issue de la Révolution, reste la seule trace de cet événement.
4 Juillet 1993
Pas terminé ce qui précède. Je n'ai plus le temps de développer un acte dans ses ultimes conséquences. Cela signifie d'abord que je n'ai plus le temps de me disposer à l'acte : la préparation de l'acte fait partie de ses conséquences. C'est même le plus important. Entrer dans une disposition à l'acte est le privilège suprême, l'expression gagner du temps ne peut pas avoir un autre sens. Se préparer à développer une intuition par écrit ou se mettre à la disposition de l'amour, c'est toujours pareil, il faut avoir le temps de se laisser entrer dans une vacance où le Soi devient fertile. Mais, comment revendiquer cela dans un monde qui s'est transformé en un vaste marché de Babylone ?
Hier, j'ai lu de longues pages du Financial Times. Bill Clinton, le nouveau président américain a donné une conférence de presse "new style", décontrac... Sur des colonnes et des colonnes il n'a été question que d'économie. Le tournant de cette "histoire" est atteint, je crois. Le commerce et ses conséquences est en passe de devenir la mécanique ou la danse instinctuelle des hommes-abeilles, le rythme décisif où va s'engouffrer tout le mouvement humain et toute lumière rationnelle. Or, ce rythme est hostile à toute vacance, à tout don de Soi à la liberté, mère des actes. Mon âme se brise lorsque je dois penser cette cruauté imbécile. Au fur et à mesure que l'on intègre la loi du rendement, on transfère toute sa liberté - la liberté est, comme le temps dont on dispose dans l'existence, une quantité - hé - dans la préparation au travail, dans le travail du travail. Subtile translation du plaisir d'être, de la jouissance de soi : il y a contrainte à jouir, là même où se définit le contraire de la jouissance. Il est vrai que j'ai toujours pensé, comme tout le monde, que l'existence la plus "rusée" est celle de l'ouvrier. Lui seul dispose réellement de DEUX existences distinctes. La fiction de Marx selon laquelle sa deuxième vie, celle pendant laquelle il ne produit pas, est entièrement consacrée à la reconstitution de sa force de travail, est une pure abstraction. La preuve en est que cette forme d'existence disparaît comme les autres, aujourd'hui s'instaure le règne du souci permanent. Celui qui produit encore sous la forme prolétarienne vit dans la hantise de perdre son travail, les autres s'angoissent de ne pas "créer", ou de ne pas se "réaliser". Dans tous les cas, le Soi disparaît.
Autre lecture dans le même journal, l'interview de Sidnan Gaudhuri, un lettreux indien de 95 ans qui vit à Londres. Il a fait sa pelote sur le dos de l'idée de décadence de l'occident, tout en crachant de façon arrogante sur les hommes de son propre pays. Redoutable mélange de culture hybride, de frustration triomphalement écrasée par la réussite sociale ( "je suis le journaliste le mieux payé d'Inde"...) et d'écolochieries de grand restaurant, style "y-a-pu d'bonne bouffe". Répugnant et inquiétant, pas une trace d'ironie dans la chute du journaliste qui l'interroge : en sortant, le vieux lui barre la route en disant -" ne soyez jamais un homme ordinaire, vous avez devant vous un homme extraordinaire" - et le baveux de conclure : -" il n'y avait rien à redire" -. Au fond, il existe déjà, c'est effrayant, des hommes accomplis de la nouvelle ruche, qui sont déjà centenaires et ont déjà vécu une vie de blaireau marchand de tapis, avec le piment de la conscience de soi. Au fond la modernité c'est ça, servitude ignorante + conscience de soi. Avec ça on peut remplir des colonnes de journaux ou des émissions à la télé et mourir avec la Légion de Commandeur. Etonnant destin d'un concept hégélien, ou destin somme toute logique puisque Hegel est l'un des architectes de notre Temps, le "Selbstbewusstsein" c'est bien le piège le plus con dans lequel soient tombés les Philistins.
5 Juillet 1993
Seiters et Pasqua : deux ministres de l'Intérieur, deux styles et deux idées de la politique. Le premier démissionne pour une bavure des services secrets au cours de l'arrestation de Grams, membre de la bande à Baader, tué à bout portant. Vengeance classique entre des chasseurs et du gibier qui se connaissent bien et qui règlent leurs comptes sans intermédiaires. N'empêche, Pasqua s'offusque de ce qu'on l'accuse d'avoir téléguidé froidement la mort de HB, l'Homme-bombe de Neuilly, ce que j'avais désigné, en son temps ,comme l'application de la peine de mort sans jugement. La France est moche, je me sens de plus en plus boche.
6 Juillet 1993
Ecole de Commerce. Quel symptôme ridicule. Du Molière : les hommes doivent apprendre à commercer ! Apprendre, au fond, à être ensemble, différence fondamentale avec la religion, qui relie sans rien demander à personne. Mais quand même, quelle cécité ! C'est qu'en réalité les écoles en question ont pour but d'enseigner le contraire du commerce entre êtres. Le négoce n'est qu'un prétexte pour démanteler les restes d'empathie sociale, bénéfice durement acquis par l'histoire ! Je n'aime pas la sociologie, ni les raisonnements qui portent sur des vastes ensembles humains, on tombe trop vite dans l'idéologie. Mais il faut bien reconnaître que ce qui s'organise concrètement et discursivement fait de la sociologie comme la Banque de France établit des taux. On n'a plus le moindre choix de s'y soustraire. Contre-attaquer. Mais comment le faire et sur quel terrain ? Sans doute est-il inutile de le faire, car la ruse de l'histoire donnera forcément à ce développement un tout autre sens. Il faut donc réfléchir, toujours réfléchir.
La réflexion demande théorie. Il faudrait, par exemple, postuler une sorte de loi de la thermodynamique des relations humaines : comme l'énergie, la quantité globale d'empathie sociale ne change pas, seules ses formes sont modifiées : dans quel sens ?
___________
Depuis mon enfance j'ai toujours admiré l'art d'allumer un feu. Aujourd'hui tout paraît se jouer constamment dans la réussite de ce geste : chaque jour on rassemble un tas de brindilles et la presse claque son briquet; Ca prend ou ça ne prend pas. Tous font ça, des gouvernements jusqu'aux associations de protection des libellules. Il faut que le feu de l'opinion prenne, on pense en général que les flammes feront le reste. Mais il est rare qu'un vrai feu prenne vraiment ; lorsqu'on constate l'existence d'un incendie, c'est qu'il est venu tout seul, sans brindilles et, à ce moment là, on peut mettre tout le petit bois qu'on veut il est presque impossible de faire démarrer le feu qui mette fin au massacre.
Raison majeure pour se méfier de tout scandale. Dans ce genre là, il y a toujours beaucoup plus de fumée que de feu.
Vacances ce soir. Beaucoup de pain sur la planche pour en faire le repos bienfaisant que nous en attendons tous.
Au travail !
7 Juillet 1993
Changement de dernière heure concernant la stratégie de voyage en Bretagne. Toujours à la dernière minute s'affirment les véritables souverainetés, il ne faut jamais être pressé de décider de la fortune ou de l'infortune d'une stratégie. Mon malheur veut que je ne contienne une once de machiavélisme, sinon j'aurais bien souvent pu manoeuvrer en fonction de l'échec d'une stratégie ...pour être sûr de gagner. Bref, il faut y aller, se reposer. A dans trois semaines.
Samedi 1er août 1993 (recopie au retour de vacances)
Samedi 9 juillet
Les voyages forment la jeunesse et déforment les vieux. Il existe un exécrable tropisme de l'intelligence. Il fait des ravages lorsqu'on se déplace de manière soudaine et inconsidérée. Autrefois un voyage se calculait presque mathématiquement, au nombre de tartines près. Aujourd'hui on veut se donner de l'air et des airs pour "spontanéiser" la route. Résultat, il suffit de quelques centaines de kilomètres pour que surgissent de nos nappes phréatiques mentales des mètres cubes de boue fossiles. Le pétrole issu de la décomposition des conflits passés, pollution dès lors inévitable.
Plus que jamais j'ai présent à l'esprit la comparaison de Leiris entre l'écriture et la tauromachie. La tempête a été forte et ses effets ravageurs sur moi. La prostration est l'antichambre de beaucoup d'endroits sordides. Le plus important c'est de comprendre. Commettre et réagir à une gaffe.
D'abord identifier la gaffe : est-elle dans l'expression d'une banalité qui joue de malheur dans une structure, est-elle le fait de repérer cette structure elle-même ? Une fois de plus, tout est dans la musique et le phrasé. Qui maîtrise ces deux éléments est en sécurité. Miri m'accuse, par exemple, d'avoir répondu en aboyant. Il est vrai que je suis parfois affligé d'un crescendo vocal ambigu. Eus-je contrôlé le ton de ma réponse, nous ne nous eussions peut-être pas déchirés comme nous l'avons fait.
10 Juillet 1993
Avons atteint les grands fonds où les grands monstres marins se contemplent, immobiles, prêts à porter le coup fatal à la moindre inattention ou faux mouvement. Ce n'est pas la première fois. La nouveauté est, cette fois, dans la précision du langage utilisé pour y arriver. Au fur et à mesure que j'avance en âge, je me sens de plus en plus le devoir de parler net à autrui, de larguer toute diplomatie, i.e. tout mensonge. Evidemment on ne peut faire pareille avancée ou tenir pareille gageure que lorsqu'être et volonté entrent en une certaine coïncidence.
On peut, je peux dire les choses autrement, à la Jünger. Il y a des moments où l'on vit la nécessité presque aveugle de défendre un morceau de territoire, en l'occurrence un morceau de soi. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut comprendre la stratégie : dans la guerre préclassique, l'art de Clausewitz, l'attaque ou la défense d'un site équivaut toujours à l'attaque ou à la défense d'une partie du corps du souverain. La guerre moderne, déjà présente dans les stratégies d'un Richelieu ou d'un Turenne, a effacé la personne du souverain en ses parties pour ne laisser qu'un espace abstrait, en réalité lui-même souverain : en devenant une carte, le territoire devient le Roi, mais le roi lui-même perd son corps. La mort de Louis XVI n'est que l'écho lointain d'un événement qui eu lieu plusieurs siècles avant la Révolution.
Cette perversion de la terre est aussi ce qui a rendu la guerre et la paix impossibles. Une impossibilité déjà inhérente au dispositif Vauban lui-même, en 14-18 comme pendant l'autre guerre, les fortifications n'ont pas joué le moindre rôle. Elles avaient été construites dans l'esprit de l'exhibition du corps souverain, mais dans un plan spatial qui vidait l'esprit de sa substance. La guerre légitime n'est pas mesurable à notre idée des droits de l'homme, comme le prétendent aujourd'hui certains bureaucrates du Vatican, mais à la légitimité de la loi du jeu, maquillée par les prêtres en consubstantialité du monarchique et du divin. Or il faut aussi tenter de saisir la nature intime de la loi du jeu si souvent invoquée par les chroniqueurs médiévaux ou modernes comme Retz .
Le jeu est suspension des autres lois : du sang et du divin. Au temps de la féodalité, cela signifiait qu'en état de jeu pouvait se produire une redistribution des cartes de la souveraineté : changement de relations de suzeraineté, création de nouvelles souverainetés, le manant avait sa chance. Le jeu d'échec rappelle clairement cette possibilité d'accéder au rang royal, on pourrait même dire au sang royal puisque le jeu permet la prise de la Dame.
Tout cela est à prendre avec beaucoup de nuances, car il s'agit toujours de restes : les règles médiévales ou même antiques de la chevalerie sont des subsistances de la loi orale nomade. Dans celle-ci ne se jouaient pas seulement le défi agonal ou la compétition systématique. En principe même, on peut postuler que l'état de guerre était l'exception, après épuisement des possibilités rituelles. Ce qui a trompé Rousseau sur la bonté "naturelle" de l'être humain est précisément l'observation du phénomène courant de la rencontre (l'histoire de la poissonnière) couplée avec la conviction de l'identité essentielle, théologale des êtres humains. Cette croyance impliquait l'identification, origine de la pitié. Il n'y a évidemment ni bonté ni méchanceté "naturelle" à l'homme, mais bonté et méchanceté sont des conséquences de l'infraction ou de l'absence aux rites. Voir Confucius.
Rite n'est pas à prendre ici seulement au sens de protocole établi et régissant les relations humaines, mais dans son sens de préalable cérémonial à toute rencontre. Il faut faire l'effort de s'imaginer la rencontre avec autrui comme la rencontre avec un souverain : la différence avec le cartésianisme politique et la loi du jeu est que l'espace moderne comptabilise une fois pour toute les emprises territoriales. La souveraineté n'est plus du tout le problème général de la rencontre ou de la relation humaine, elle est une affaire d'extension spatiale sous seing public. Richelieu, Mazarin et même Retz se battent pour l'Etat, pour une notion qui deviendra nation. Mais chez les uns comme chez l'autre, il reste quelques coudées franches entre les emprises territoriales et les sentiments : la politique conserve encore quelques visages. Au dix-neuvième siècle les visages ne serviront plus qu'à remplir une carte géographique pour illustrer cette ignoble notion de "population", concept tout juste bon à décrire le mode d'existence des poux ou, à cette même époque, les peuples "indigènes"...
Mercredi 12 Août 1993
Je reprendrai ce thème plus tard. Dimanche, je suis tombé dans ce qu'on appelle une embuscade politique. Deux larrons du PS, des rocardiens pur sucre, pénètrent mon bureau d'ARTE. L'un d'eux est un collègue maison dont j'avais vaguement entendu parler et que j'avais eu au téléphone une fois ou l'autre. Ils entrent et le deuxième prend prétexte de la présence sur ma table de mon porte-clés PS pour s'interroger, en apparence, sur l' audace qui consiste à exhiber mon appartenance politique à l'heure qu'il est. En réalité, le but était de me tâter sur ce qui restait de mes motivations et projets politiques socialistes. (belle formulation)
Naïf comme je suis, je fonce tête baissé. En fait j'en profite pour affiner le discours que je tiens en réserve pour les camarades qui se risqueraient à me demander des comptes. En gros : je ne peux pas continuer d'élaborer et de faire circuler des idées qui ne peuvent avoir cours là où prioritairement on gère. C'était le problème au plan national avant les élections, aujourd'hui c'est le problème à Strasbourg où le PS continue de gérer. Je fais le bilan de mes interventions, rappelle que depuis 1980 je prône pour le parti un rôle de laboratoire de la démocratie, que le centralisme démocratique en vigueur me fatigue et que je n'ai pas les gênes nécessaires à l'intrigue et aux amitiés politiques. Viennent ensuite quelques considérations sur la politique intérieure et l'Europe quand j'apprends que le deuxième personnage présent, qui n'avait soufflé mot jusque là, faisait partie du Comité Directeur National. Il aura fallu que Miri me décille elle-même les yeux pour que je comprenne, en fin de soirée, que je m'étais fait eu par un missi-dominici en tournée des popotes. Bof, il ne l'emportera pas en paradis, monsieur Christophe Clergeot.
Sujet intéressant, les amitiés politiques. On devient ami sur des bases idéologiques : cela semble une énormité, et pourtant c'est ce qui a cimenté aussi bien l'ex et puissant PC que la plupart des partis politiques. Norbert me casse assez les pieds avec l'évocation de son amitié pour untel et untel, les retours d'ascenseur obligatoires etc.. etc...
Au fond la République s'est mise à singer l'aristocratie pré-richelienne, quelle rigolade tragique. D'autant que les grands réseaux "d'amis" vivent la plupart, depuis toujours, à Paris. Le Jacobinisme culturel et politique m'exténue complètement. Quand France-cul donne une longue émission sur les anciens du PC et leurs débats avec l'appareil, il s'agit dix fois sur dix des familles de Pantin ou du Bd St Germain : je n'ai jamais entendu un mot sur les familles politiques de Nantes ou de Bordeaux. Même la décentralisation n'a pas levé cette hypothèque, ou, disons, cette étalage de la non-existence de la vie politique en province. Il en va de même, faut-il le souligner, pour tout ce qui est culturel : l'émission de radio la plus ridicule s'appelle "le Pays d'ici". Inutile d'analyser ce logo, il parle de lui-même. Il y a le "pays", et puis il y a "ici", décrochage qui reproduit le décrochage technique qu'il faut pour qu'on entendent les protagonistes d'un ici qui se dépêchent d'exister pour quelques minutes nationales...
Du temps de Retz, les choses étaient quand même différentes, autant pour ce qui concerne l'amitié que par rapport à ce fossé qui fait de Paris une forteresse totalitaire. Le cardinal lui-même fut, si je me souviens bien, sauvé par le fils de son pire ennemi au nom de l'honneur. Mieux, Retz a tour à tour soutenu et combattu ses propres amis, sans pour autant que ses initiatives ne lui aliènent ses amitiés ou ne lui procurent quelque bénéfice supplémentaire. La plupart du temps les bénéfices s'obtenaient de l'ennemi et non pas des amis.
Il y a donc un danger extraordinaire à vouloir mélanger l'amitié et l'idéologie, car cette confusion rend l'une et l'autre parfaitement vaines. On dira, le combat cimente l'amitié. Je ne le crois pas, je pense même le contraire, parce que le danger porte toujours au soupçon et que rien ne résiste au soupçon. L'amitié est donc quelque chose qu'on ne peut apprivoiser sous aucun prétexte, elle participe d'une rencontre qui s'est faite selon des règles rituelles mystérieuses, où la prudence intellectuelle permet soudain le plain-pied des êtres. La guerre ou la politique ne sont pas des espaces où de telles rencontres puissent avoir lieu, ou du moins être favorisées.
Quant à la France du 17ème, elle n'était alors qu'une vaste salle d'opération où la monarchie tentait la greffe du coeur unique, Paris. Mais les souverainetés étaient réellement multiples, il y avait du jeu entre le Palais-Royal et Machecoul, St Germain et Toul ou Charleville. La Fronde fut l'une des premières réactions de rejet du greffon, Louis XI avait déjà eu affaire à certains grands féodaux, elle sera suivie de la Gironde et même de la tentative de la Constitution de 1793, puis aujourd'hui de la décentralisation. Elle vient trop tard, la France n'a plus besoin de se déconcentrer, elle doit au contraire s'arque bouter afin de demeurer en état de devenir une "région" d'Europe. Tout le reste est nostalgie.
Vendredi 19 Août 1993
Black Friday. Je n'ai pas voulu, il y a une semaine, trop disséquer cette affaire du fumeur britannique mort d'un infarctus par refus de soins. J'avais tort. En évoquant cette sinistre histoire aujourd'hui, je suis obligé d'halluciner en écoutant les commentaires de Miri. Démence passagère ou reflet des phantasmes collectifs ? En tout cas il m'est bien douloureux d'entendre ma compagne plaider pour la légitimité d'une telle saloperie. Les idées foireuses d'Anie sur la nécessité de légiférer sur la vertu...en vertu des chiffres. St Just disait qu'il fallait contraindre l'homme à la liberté, mais il n'a jamais confondu liberté et vertu. Cette confusion là est très exactement celle qui justifie les dispositifs nazis ou staliniens. Question : avions-nous raison, il y a trente ans, de penser que les hommes étaient entrain de bâtir un immense camp de concentration ? Je commence à le penser, à vrai dire je l'ai toujours cru. Autre question : que faire ? Face à une conviction aussi forte, que reste-t-il à faire ? La seule réponse qui me passe par la tête hic et nunc c'est de l'ignorer. Pour ma part j'ai eu ma ration de souffrances physiques et morales pour m'être imaginé qu'il y avait un combat possible contre cette peste.
Au fond j'ai toujours eu raison dans ce que j'ai choisi, à chaque tournant de mon existence, de faire : fuir, beau jeu de mots qui colle très bien à la situation. Par mépris, ne pas se commettre une seconde de plus avec une situation où la pourriture vous gagne à plein nez.
Des maisons, des immeubles, des magasins, des rues et des champs de betteraves, qu'ai-je à voir avec tous les petits espoirs de durer un peu plus qui se cachent sous les pavés et les portes qui suintent la peur ? L'homme a besoin de solitude. S'il lui arrivait le malheur de ne pas la trouver un jour, c'est toute l'humanité qui est fichue.
Mardi 23 Août 1993
Retour de Paris après un nouveau climax dû à la tension cancérophobique. J'attends pour dix - onze heures le verdict final du médecin qui vérifie le diagnostic foireux d'un interne pervers. Myrie est sur les dents depuis la semaine dernière et cela produit des tropismes insoupçonnables. Moi-même j'y répond avec une brutalité du désespoir sans comprendre pourquoi.
Il faut dire à notre décharge que nous ne savons pas, ni l'un ni l'autre, sur quel pied marcher. D'un côté nous préparons un futur qui porte sur vingt ans, de l'autre nous élevons des digues à vingt-quatre heures en vue du pire. Comment ne pas trébucher à chaque pas ?
A un certain endroit de cette double démarche, ou de ce double calcul, il doit y avoir un recoupement. Je crois m'en être rapproché hier soir en dégageant un concept pour le rêve qui alimente nos veillées d'humains vaquants. Je m'explique. Le rêve qui prend corps, c'est l'acquisition d'un voilier, prétexte de vacances moins idiotes, mais aussi d'une retraite réelle, qui, au fond, se propose l'inverse de la cessation complète d'activité en prévoyant enfin une action. Une action qui referme la vie, somme toute très logiquement, sur la vie personnelle. Agir pour soi est le droit acquis par le prix payé aux autres pendant des dizaines d'années.
Restait à en préciser le concept. Ce n'est qu'une ébauche, mais ça me paraît coller : il faut que nous nous orientions vers l'autonomie, autre mot pour solitude plénière. Le voilier en lui-même, c'est déjà l'autonomie par rapport aux relations de dépendances qu'impliquent la vie sédentaire. Mais on est encore loin de l'autonomie, même sur un croiseur de luxe, capable de tourner autour du monde sans problèmes. Energie, ravitaillement, resourcements culturels, par tous les fils on reste sous haute tension, même dans les quarantièmes rugissants.
On a donc le choix entre un retour à la simplicité végétative. Mouiller dans quelque paradis du Pacifique et distiller ce qui reste à survivre sous le soleil et dans le babil des Alizés en mangeant de l'arbre à pain et des corossols. Très peu pour moi, pour nous. Après tout, l'autonomie est à l'ordre du jour de la technologie, il faut jouer cette carte avec prévoyance, détermination et travailler pour ne pas se fourvoyer dans un écolo-retour à l'imaginaire. Ma toute première fugue en Grèce en 1960 m'a enseigné, une fois pour toute, que la nostalgie écologique est une tragique fumisterie.
Expérience intéressante qui se déroule en deux parties. 196O : voyage à travers toute la Grèce, sans argent, sans moyens de circulation, la faim, une certaine peur archaïque du soleil qui se couche, et puis une réussite quand même étonnante, je m'adapte complètement à cette vie, retourne à un rythme préhistorique de survie. Le sol redevient mon lit de tout les jours, la nourriture et son manque font l'aventure du temps, je "communie" avec la beauté du monde. Athènes casse tout ça, l'épuisement soudain, aussi, causé par l'impréparation pour un anachorétisme non programmé. Bref, les trois mois passés à nomadiser sont à double face, je retrouve d'un côté ce que je cherchais, sans le savoir, le bonheur de l'errance qu'autorise le bassin méditerranéen, tel que l'antiquité le profile dans les textes poétiques. De l'autre je tombe dans une Grèce qui a liquidé l'antiquité et qui me replonge dans les paramètres de survie sédentaires. Retour à la case départ.
Partie II : 1962. Je reviens en Grèce, par hasard, en touriste et en voiture. Renversement de la situation. Les "lieux" magiques de mon bonheur, découverts à la faveur de l'errance sans garde-fou, ont disparus, ou sont en voie de disparition. Les plans de "développement" ont modifié, en deux ans, les décors les plus mystérieusement adéquats à l'humain. Là où je contemplais pendant des heures la mer de Corinthe, sorte de joyau d'un bleu Klein nimbé de montagne roses-pourpres, sans me lasser et sans même songer à me glisser dans l'eau, là il y a maintenant une décharge puante, à côté d'une usine crachant poussière. Là où la vallée s'ouvrait sur des cailloutis blancs et désertiques, bordées par les falaises couronnées de petits pins et des grands cèdres qui cachent les monastères inaccessibles, là il y a maintenant - deux ans après mon premier passage - d'immenses champs de maïs américain ou de blé nouvelle façon Tiers-Monde sorti des laboratoires de la Cargill Inc.
Autrement dit, l'espace que j'avais frôlé, où pouvait, somme toute, se réaliser un retour à une forme symbiotique pré-néolithique de survie, cet espace se dérobait semaine après semaine. Aujourd'hui, je n'ose plus aller en Grèce, une véritable peur, car si on peut, sans doute, supporter la vision de la dégradation elle-même, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à accepter une mutation si grande qu'elle ne permet plus de retrouver sa propre image, enfouie quelque part dans les strates du paysage qui a été aimé. Ne plus retrouver trace des objets d'un amour passé est une sorte d'orphelinat inutilement douloureux .
Cette anecdote doit montrer qu'il faut chercher dans une autre direction. Ne plus s'attacher à ce qui "subsiste" d'un état antérieur de possible équilibre homme-nature. Cette forme d'écologisme est vouée à l'échec où à la passivité paresseuse et sans passion. Je n'irai plus en Grèce en me contentant d'y chercher ma propre dimension archaïque - ce qui est certes gratifiant lorsqu'on y parvient - mais en y apportant en même temps ce que j'y cherche : la solitude assise sur soi, l'amour du bleu Klein de toute chose et de toute attitude humaine, du rose-pourpre qu'il faudra deviner au-delà des nuages de poussière d'une histoire démente mais inéluctable comme la pousse des cèdres et des pins.
Ce concept d'autonomie, il faut l'habiller. Il faut lui mettre les tissus protecteurs, la substance qui autorise le survivre, mais aussi l'idée qui en forme l'entéléchie : la beauté de la fleur, pour nous, ce qu'il faut en faire.
Techniquement, on peut travailler dans plusieurs directions. Conçu comme autonome, un bâtiment - même de marine - peut devenir une usine douce, productrice d'énergie. Panneaux solaires. Un laboratoire d'hydroponiques de bases, il faudrait concevoir des caissons clos, producteurs des végétaux indispensables, le classique bocal à soja des chinois est un modèle à rationaliser. Un central de liaisons par satellites, par où coule la culture. Pas question de se contenter des symphonies de coucher de soleil tous les soirs et des discussions de pontons.
Spirituellement, une telle disposition peut aller à l'essentiel. Il permet de prendre toute la distance qu'il faut pour rendre au monde sa nature de tableau vivant, de voile chatoyant de l'être. On devrait se trouver là dans les conditions idéales pour écrire Parménide 2 000. Enfin, ne rêvons pas trop.
-----------
Myrie n'a pas tenu. Ce matin, encore pas de diagnostic. Elle explose, s'habille et fonce à l'hôpital. Je sais qu'elle reviendra avec rien, soulagée mais en colère contre moi, responsable de tout. Méditons.
Je sais que mon corps se dérobe constamment. Depuis mon enfance j'ai appris à connaître cet ensemble d'organes et d'os comme personne, peut-être même pas comme les médecins eux-mêmes. A chaque nouvelle maladie se formait une nouvelle image de l'intérieur jusqu'à former une anatomie complète, comme une carte de géographie. Il y a, sans doute, chez les gens, la même opacité ou clarté dans l'appréhension de l'espace externe que de celui qui constitue ce qu'il y a sous la peau. Myrie s'y connaît pratiquement aussi peu en clinique qu'en géographie terrestre, signe d'une bonne santé.
Il se dérobe quand même à chaque tentative pour élucider le mal qui m'a saisi alors que j'avais vingt ans. Mais de plus en plus, ce n'est plus l'organe qui se dérobe en tant que tel, mais sa place dans un jeu plus vaste, celui de mon destin ou, ce qui m'a toujours semblé pareil, mon appétence à rester vivant. Le doute m'a toujours rongé, sans doute depuis le suicide de mon père. Dans la première phase il s'exprimait par des maladies infantiles à répétition, comme si le moteur refusait de partir, parce qu'en fait j'ignorais l'événement dans sa teneur réelle. Puis, quand j'ai su, la maladie est devenue l'interrogation quotidienne, le moment d'arrêt de la machine. Tous les malades jouent la surprise quand ils "tombent" malade, en réalité beaucoup d'entre eux s'y attendent comme à des entractes de théâtre. Ca vient, on finit, avec l'habitude, par prendre ses dispositions, celles qu'on connaît bien. On finit même par oublier comment pourrait être une existence non dominée par l'état de maladie, paradis perdu ?
Jeudi 27 Août 1993
Discussion dense comme d'habitude, hier, avec Kanner. L'occasion de lui répéter que je ne m'intéresse pas du tout à l'homme. Je ne sais pas s'il est scandalisé, il fait mine d'être intrigué ou incrédule, estimant que l'homme est le centre de toute réflexion ou de tout souci. En réalité mon opinion est largement réactive. L'Homme a été placé sous microscope par le 18ème siècle, et ce qu'on désigne communément sous le nom d'humain est un monstre dont on a perdu les proportions par rapport à l'étant dans son ensemble. L'homme n'est ni plus ni moins intéressant qu'autre chose, l'intérêt lui-même pour quoi que ce soit n'est qu'apparemment seulement de l'humain. En fait les regards traversent êtres et choses en une sorte de solidarité curieuse : On se regarde, d'une étonnement réciproque, car tout est étonnant.
Dimanche 30 Août 1993
L'école n'est rien d'autre que l'apprentissage de la distinction, en son sens le plus plat : il faut - pourquoi ? - que l'homme se distingue. Par l'habileté, l'art ou le mensonge, peu importe, même le snobisme est une manière de justifier son oxygène. C'est pourquoi , sans doute, on dit : être à " l'école des hommes". Que cette distinction s'affirme ou non comme supériorité, là n'est pas la question. Il y a de moins en moins de crétins qui passent leur temps à prêcher l'unicité transcendante de l'homme, fort heureusement, même si d'un autre côté ceux qui tuent au nom d'Allah semblent se reproduire comme des lapins malfaisants.
Lundi, 6 Septembre 1993
Encore gaffé. Ne jamais dire la vérité. Le dire du vrai entraîne toujours l'étalage du vrai dans toute son extension dans le temps. Je veux dire qu'en disant une seule chose vraie, on dit tout le vrai ensemble. Opération dangereuse de toute manière, car le vrai dans sa totalité comporte le bon et le mauvais du vrai, c'est à dire ce qui dans la vérité nous convient et le reste. Qu'ai-je dit ? Seulement avoir ressenti qu'une page se tournait dans ma vie quotidienne. Pendant longtemps le paysage professionnel , le temps passé à mon travail, offraient toujours une sorte de distraction par rapport aux tumultes de la vie familiale. Je me sentais globalement mieux ailleurs, parce que les états d'âme étaient plus constants, même si d'un autre côté tout était fait pour me déplaire là où je devais travailler. Tout d'un coup, je ressens au fond de moi-même que les choses ont changé. J'ai hâte de rentrer. Voilà ce qu'il ne fallait pas dire. Il ne fallait pas dire que notre appartement m'était devenu chaud, que mon coeur avait pris, là, là où pas plus qu'ailleurs je n'avais de raisons de me sentir particulièrement bien. Il s'était passé quelque chose que j'aurais du taire. Tant pis pour moi. Le pire est sans doute que cette nouvelle gaffe révèle que le dire est suspect, je veux dire que ce que moi je dis se mesure à la même aune que ce que dit monsieur tout le monde, du baratin. Cela dévalorise cruellement, pour moi-même, tout ce qui sort de ma bouche. La vérité s'insinue comme mensonge, le coeur n'a plus voix au chapitre, jamais. Cela doit figurer dans les mythologies, je suppose. Ah ce manque de culture !
Lundi 13 Septembre 1993
Il pleut. L'eau tombe doucement du ciel comme la vie qui se pose. L'oeil avisé, ou l'âme apaisée, je ne sais, finit par
voir l'existence, le temps, se mouvoir physiquement dans les choses. Je crois que ma passion pour l'océan part de cette sensation première que le balancement est la position naturelle de l'être. Je ne pense pas que l'on ai
découvert la roue, le cheval, le dromadaire ou le bateau. Ce sont des enfants qui ont troussé, voici des millénaires des jouets pour se balancer. La marche habituelle est d'une totale grossièreté. Le Gestell du corps est une machine rudimentaire et mal finie. Des os qui impriment toujours des hoquets plus que des mouvements à un paquet de muscles beaucoup plus mal disposés que ne le laissent croire les émerveillements bibliques dont on matraque la jeunesse naïve.
Non, la réalité est mouvante. Mais cette banalité, régulièrement exhibée par des philosophes qui parlent de tout autre chose, est une vérité physique palpable. Le mot vérité est scandaleusement faible pour la description, il est d'ailleurs conçu pour
éviter la simplicité. Il introduit une duplicité dans les choses, le possible du vrai et celui du faux, une ambiguïté qui paralyse l'être. La problématique du vrai est un avatar de la sédentarisation des corps, ou peut-être une sorte de métabolisme spirituel qui produit, dans l'âme, un succédané de balancement.
Le vingtième siècle a redécouvert le
SWING, le mouvement spirituel qui correspond réellement à celui de l'être. Chaque jour, les arts dits martiaux font des adeptes parce qu'ils précèdent la philosophie de la vérité, circonstance qui les rend plus crédibles, et peut-être plus efficaces parce qu'ils sont fondés sur le mouvement du corps lui-même. Or, la Chine est la patrie de l'immobilité, ces exercices corporels singent des mouvements "intérieurs", ceux de l'âme conçue comme le tout des affects, sentiments et raisonnements. Les prêtres asiatiques ont réalisé exactement la même opération que les philosophes occidentaux, intérioriser la mouvance physique de l'univers. Ils ignoraient, comme les Grecs, qu'à terme, l'homme est convoqué par le séjour dans l'infini, son incrustation sur terre sera de courte durée par rapport à ses spéculations astronomiques. Il faudra bien qu'il envisage de rompre avec les fixations rhumatisantes de son corps et de son âme.
Voilà de quoi modifier mes propres perspectives théoriques sur le mobile, l'immobile et la circulation sans frein des hommes et des choses. Dans mon Entretien j'avais intuitivement saisi que l'immobile était la condition du réflexif, la pensée est faite de stop-and-go - une idée que j'ai rencontré pour la première fois dans la métaphysique de Chambon. Or, mon admiration pour le parménidien, l'UN immobile, m'avait entraîné à surestimer la position réelle de l'immobilité. Je n'avais pas saisi, en même temps, que l'immobilité n'est qu'un état abstrait, la vraie transcendance ou le vrai transcendantal.
Sur un pont de navire le réel corporel réintègre le réel de l'existence. Une souffrance est abolie, celle qui résulte de l'immense "péché" qui a consisté à s'inspirer de l'arbre, de l'arbre intuitionné comme repos. Le repos de la mort : voici élucidé un grand chapitre de la Bible. N'a-t-elle pas, elle-même, compris que quelque chose clochait dans le montage pour envoyer, quelques chapitres plus loin Noé sur les flots déchaînés, pour sauver l'humanité ? Les questions sur les éléments des pré socratiques sont les plus précieuses parce qu'elles communiquent encore avec le mystère du mouvement et du repos. A cette époque les écoles s'affrontaient sur la suprématie de l'eau ou de la terre, du feu et de l'air. Aristote a compris de quoi il était question avec son
energeia, il a raison, en fin de course, d'identifier logiquement mouvement et repos, mais il craque quand même en plaçant l'immobile à la source, comme l'arbre. Il aurait fallu qu'il brise la dualité de l'intellection et du faire, du nous et de la praxis, pour redécouvrir, à temps, que l'intellection elle-même est mouvance.
Il faut quand même expliquer l'eau qui tombe en gouttes, l'eau qui apparaît comme une matière qui enveloppe et macule les choses en les attaquant sournoisement de surcroît. Or, l'eau n'est rien de tout cela. L'eau dont il est question lorsqu'on s'énerve à son propos, sous la pluie par exemple, cette eau-là n'est qu'une infime sécrétion marginale de l'Eau. L'Eau est, en réalité, un manteau épais et élastique sous la quille des navires, une véritable terre-bis. On peut intuitionner ce qu'est l'eau lorsqu'on marche tout d'un coup sur l'herbe d'une tourbière ou sur le sol spongieux d'un pré inondé. Il restera, et je le ferai plus tard, à décrire quelle nouvelle relation à l'être s'inaugure dès que l'on confie son corps à l'incertitude positionnelle qui fait la loi de la surface des océans.
Mardi 14 Septembre 1993
J'ai entendu un bruit : on faisait la paix là-bas, au Proche-Orient. Tout une tragédie promise à l'éternité qui est précipitée dans une chasse d'eau ? Un drame qui devait encore tenir en haleine l'humanité entière pendant des décennies essuyé comme une nappe de cuisine ? Qui pourrait le croire ? Et pourtant il y a du vraisemblant, là-dedans. Après tout, la guerre des Palestiniens contre les Juifs était l'une des dernières guerre, elle sera donc l'une des dernières paix. Dans ces moments-là je ressens tout le poids de mon sale boulot de journaliste. Il y a là un événement plein de mystères, un retournement de situation si grotesque quand on pense aux éternités de haine qui continueront de sous-jacer encore pendant des millénaires, que l'on ferait mieux de se taire. Mais non. Il faut comprendre, il faut avoir compris, il faut expliquer, argumenter de telle sorte que le bruit inattendu finisse le plus vite par appartenir aux bruits de tous les jours. Les hommes n'ont plus aucune foi. Ils sont devenus impuissants à goûter aux miracles. Là-bas, quelques hommes prodigieux ponctuent d'un trait de plume le combat des géants. Alors on dit, on est obligé de dire que ce trait cache de plus grands dangers, on doit dire que rien ne s'est passé qui n'eût du se passer, que ce qui s'est passé peut très bien se passer de ceux qui le font passer. On voit ces hommes rapetisser à vue d'oeil, redevenir aussi nuls que le quotidien des horreurs les mettait en scène.
Mercredi 16 Septembre 1993
Retour à l'océan : c'est le seul véritable tout. Il accepte toutes les métaphores, mais aussi l'intelligence de tous les phénomènes. La surface de l'eau est comme l'esprit capable d'envelopper toute chose au plus près. Contrairement au vent, l'eau n'est pas handicapée par une direction, même dans un courant, elle continue de prendre les formes, d'emprunter ou de mimer, comme on voudra, l'être formel des étants qui s'y baignent. Sans doute un pratiquant de vol à voile ira me contredire, peu importe, il a sans doute raison sur ce point. Mais il y a une autre différence, l'eau reste, dans le mouvement, le lieu possible d'une permanence. Lorsqu'on vole, il faut, un jour ou l'autre atterrir, il y a une cassure brutale entre l'évolution aérienne et la position au sol : les oiseaux sont très différents des poissons, ils n'ont jamais cette allure parfaite, finie et dont on ne décèle nulle part un quelque chose qui cloche. Comme si le milieu aquatique était le milieu de la parfaite liberté d'évolution, en tous les sens du terme. Prenez les êtres volants, ils ont tous quelque chose de monstrueux, d'imparfaits, le divorce si bien décrit pas Beaudelaire entre l'Albatros qui plane et celui qui marche en dit assez là-dessus.
Enfin, le liquide. L'état des matières qui domine dans la constitution de la planète est l'état liquide. L'eau est fidèle à cette dominante. Curieux, autrefois j'aimais me savoir les pieds sur du précambrien, le plus ancien sol de la Terre. Il y avait là un sentiment de sécurité et de repos de loin supérieur à tout calcaire ou à toute forme de grès traîtreusement sableux. Mais ce sentiment n'avait pas le même usage. Il était une expérience du temps, quatre milliards d'années sous les pieds, une éternité nourrissante d'émerveillement constant. Sur mer, cette expérience est différente, le temps est présent non comme idée mais comme mouvement. Apprivoiser la navigation, c'est apprivoiser le temps, à la condition qu'on libère son embarcation de la servitude des caps.
Samedi 19 Septembre 1993
Les jours ne sont plus séparés les uns des autres. J'écris comme ça vient. La moitié du texte précédant a été écrite hier le 18. Quelle importance ! Ce qui domine est le sujet. Sans doute je reviendrai sur ce texte, l'ordinateur permet tout. Comme la pensée elle-même peut se permettre de suivre des voies totalement intemporelle.
Aujourd'hui je voudrais parler du GATT. Un sujet sur lequel je travaille tous les jours, à mon bureau de journaliste, là-bas à ARTE. Le GATT c'est événement de cette fin de siècle, une étrange guerre où se mélangent agriculture, industrie, culture et télévision. Je suis un peu surpris de voir les amateurs de "grande culture" se mettre à s'affairer autour de ce qui se passe dans la vidéasterie mondiale. La télévision peut-elle offrir de la "grande culture" ? J'en doute, même ARTE ne peut pas faire une chose pareille. Tout au plus peut-on évoquer, sur un tel canal quelque chose comme la nostalgie d'un comportement devenu impossible. La télévision comme vecteur de culture n'existe pas encore. Pour l'instant il s'agit de machines à diffuser des sous-produits du cinéma, à diffuser des messages et des films, le tout à sens unique, comme l'entend le grand capitalisme producteur de marchandises, vendues et consommées. La télévision doit in-former, donner la forme qui convient au marché des objets vendus sur le marché.
Comme outil de culture, la télévision devrait devenir un événement permanent d'échanges, une place publique cathodique, une agora contemporaine. Mais cela s'appellerait liberté. Quelle cécité dans ce monde superficiel : confondre les productions cinématographiques avec l'identité ! confondre identité et part de marché ! Les Européens ne sont pas sortis de leur léninisme de bazar, sous-élitisme de Troisième République : il faut toujours que les moutons soient bien gardés par les mêmes élites qui se cooptent.
Mardi 28 Septembre 1993
Seize ou dix-septième séjour à l'hôpital, je ne sais plus les compter, cinquième intervention chirurgicale sur mon corps. Je n'ai jamais mis les pieds sur un champ de bataille, mais la vie a fait de moi un homme de douleur et de blessures.
Vendredi 1er Octobre 1993
Pas le temps de développer, mardi dernier. Je voulais seulement suggérer que c'était pure illusion que de croire à la paix civile comme Rédemption des âmes et des corps. Souvent il m'arrive de penser, quelle horreur, que les Serbes et les Croates tentaient de réinventer, en désespoir de cause, la joie du vrai polemos, le jeu des enfants d'Héraclite. Que signifient alors tous les affairements "humanitaires" et les discours pacifistes de l'occident ? Ces gens s'en foutent et il n'y a plus que les journalistes qui parviennent à glaner sur une petite partie du terrain, des relents de "malheur civil", la famine, les maladies et toute la kyrielle de maux qui accompagnent l'anarchie des guerres. Ils tentent de ramasser ce qui nous ressemble et ce qui nous fait peur, chez nous.
Aurais-je abandonné mon propre pacifisme qui m'a valu tant de galères dans ma vie, pour quoi j'ai fait tant d'impasses à long termes ? non. Mais la paix n'est pas , comme on dirait, ce qu'un vain peuple pense. Le problème, à mon sens, est que l'alternative guerre ou paix doit changer de nature. Ce qui est effrayant, c'est le fossé qu'il y a entre ce qui a été compris, dans notre histoire, de l'inanité de la destruction matérielle des êtres et des biens, et ce qui continue d'alimenter les passions contemporaines. On a saisi depuis longtemps que l'angoisse existentielle était de loin plus redoutable que les massacres à la tronçonneuse, que le destin de l'humanité était de loin plus vital que tous les gains terrestres et immédiats. On fait comme si rien ne s'était passé. L'histoire de l'Europe n'est rien d'autre qu'une vaste Aufklärung, elle est passée, elle a eu lieu et a produit ses conséquences irréversibles. Et pourtant on fait toujours mine de tout recommencer à zéro. On dit maintenant, qu'en fait, l'Aufklärung ce n'a jamais été qu'une phase de la bagarre entre souverainetés religieuses et souverainetés princières, entre le Pape et l'Empereur. Une phase de transition entre l'abandon d'un principe pour un autre : l'abandon de la servilité spirituelle pour la servilité marchande. Si cela était vrai on aurait raison de penser que les philosophes du 18 ème siècle ont été les programmateurs d'Auschwitz. Mais cela ne tient pas compte de la vérité qui est que le programme des philosophes n'a jamais été accepté et réalisé par personne, ou alors dans des variantes tellement perverses qu'elles ont produit le contraire de ce à quoi les Lumières ouvraient réellement.
Ma douleur c'est ma solitude, l'impossible partage et l'impossible combat en commun contre l'imbécillité générale. Je pourrais être plus modeste et parler d'incommunicabilité. Voilà qui était bon pour les années soixante et une autre forme de cinéma. Je prophétise un tout autre combat qui ne fait que commencer, celui des esprits cruels, sans pitié pour l'expression, sans pitié pour la transhumance des humains ici-bas, quelque chose, hé oui, comme la guerre des nouveaux "philosophes" de Nietzsche. Dans l'anthropologique, de tels penseurs vont faire du bruit, mais finiront sans doute comme martyrs, et ça sera reparti.
Mardi 5 Octobre 1993
Grosse lecture. Cette fois il faut thésauriser avec opportunisme. La saga des Habsbourg, par un certain Jean Bérenger. Très gros travail. Passionnant seulement par la dimension panoramique qu'il donne des dix derniers siècles européens. Cette histoire de la dynastie qui a dominé l'Empire Germanique est révélatrice : confrontés avec la multiplicité de ce que nous appelons aujourd'hui, des "nationalités" et aussi des castes, c'est tout naturellement que les princes autrichiens eurent vocation à "fédérer", symboliquement seulement, le monde germanique morcelé politiquement et socialement. En réalité l'Autriche-Hongrie était une zone tampon entre l'Europe des nantis et les Turcs. D'où aucun investissement sérieux et tout un jeu de basse flatterie consistant à enorgueillir une famille d'Empereurs bidons dénués de pouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Négus de l'Empire Chrétien. Il aura suffit que la puissance finisse quand même par faire son chemin grâce au capitalisme (libéralisme) pour que les Habsbourg nous précipitent dans la première guerre mondiale, par pure nullité politique. 14-18 aura été le produit de l'arrogance des grandes puissances face à la Mitteleuropa. Aujourd'hui le conflit de l'ex-Yougoslavie nous le rappelle cruellement.
Dans la première moitié du dix-neuvième siècle, il se passe en Autriche exactement la même chose qu'aujourd'hui : on licencie massivement. La machine à vapeur prend chaque jour des milliers d'emplois. Mon propre arrière-grand-père a du figurer parmi les artisans tisserands brutalement congédiés. Son fils sera fonctionnaire des chemins de fer. Comment les hommes du vingtième siècle peuvent-ils nous rejouer cette comédie ? Qui ne savait pas que les robots allaient nous liquider nos postes de travail ? La réalité est qu'il faut USER les situations jusqu'au bout, et à ce bout, il semble bien que nous y soyons. La machine à vapeur c'était brutal et net, catastrophique. Pour nous les choses sont une peu différentes, il y a d'un côté les robots et de l'autre de la main d'oeuvre presque gratuite dans les pays du Tiers-Monde. La situation se transforme en impasse quand les robots sont gérés par des ouvriers qui ne coûtent presque rien. A terme, qui va acheter les biens de consommation ? Voilà ce qui angoisse les penseurs de l'économie.
Cherchons. Il n'y a qu'une réponse : le capitalisme doit retrouver, mondialement, la situation du 19ème où les biens de consommation des masses n'avaient pas d'autre finalité que le renouvellement de la force de travail. Cela permettrait l'ouverture d'immenses marchés de produits d'ersatz, des produits de première nécessité, des millions de petites voitures pour permettre à des milliards de Chinois d'aller fabriquer des petites voitures dans les banlieues lointaines. Les produits de luxe n'auront plus d'existence économique, mais seulement politique. Car il faudra bien gérer les hommes politiquement, il faudra bien trouver des Eltsine et des Pinochet, prêts à lancer les troupes sur les foules. On sera loin du communisme.
Samedi 9 Octobre 1993
Mon coeur bave à la poupe. Pourquoi ? Il me manque l'immédiateté de la vie. Je me fatigue d'un report jamais assimilé pour faire vie, d'une existence non taillée sur la mesure commune des épargnes collectives de jouissance ou d'histoire. Je me suis fatigué de la mort reportée. Et pourtant, tout cela n'est peut-être, et même certainement, qu'un effet de langage, pis, un effet de discours. Garder le silence, rester secret, sont des nécessités vitales. Chaque fois qu'il faut se livrer, on se détruit un peu plus. Tout ce qu'on accepte, du fond d'un fond de soi-même, tout peut continuer, à condition qu'il soit fait silence. Il faut taire le plus que l'on peut tout ce qui fait désir. Si l'un de ces objets voit le jour de la parole, alors tout tombe en cendres. Les projets sont comme une fuite vers un point dont il ne faut pas détourner les yeux, faute de se voir changer en statue de sel. Projets ? Quels projets ?
Le projet est déjà une dissection, une vivisection du futur. Certes. Mais une attente est aussi projet. Effleurer, c'est tout ce qu'on peut faire dans le cas d'une attente. Que de malentendus à propos de ces confusions entre projets, attente, épargne, survie et mort. Sans doute notre "civilisation" meurt-elle de cela, le report non des objets du désir mais de leur confusion, de leur dépérissement consécutif à leur dissection discursive. Jean disait toujours, il avait lu Ducasse, qu'il fallait tomber sur les choses comme des anges. Pourquoi ne tombons-nous pas comme des anges sur la Russie pour lui donner ce dont elle a besoin. Parce que nous ne sommes pas des anges.
En rien. On a voulu faire le coup en Somalie. Mais personne ne sait donner. Savoir donner en Somalie, c'était d'abord savoir qu'on ne pourrait pas y recevoir n'importe comment, sans le projet de rendre, la possibilité de payer. On a attribué à ces peuples notre propre nature. Notre propre sentiment de lucre.
Mercredi 20 Octobre 1993
Les journées sont de plus en plus dures. Depuis mon opération je m'étais laissé aller à oublier le boulot. La reprise est vicieuse car elle se présente sous ses aspects théoriques d'impossibilité existentielle, d'incompatibilité de NOTRE nature humaine avec les formes du salariat. En tant que progrès, le salariat appartient au passé. Il est devenu la forme mortelle, avant la lettre, du rapport social. Je dis avant la lettre parce qu'il se trouve que dans le même moment la majorité se bat pour devenir salariée ou pour le rester. Il faut que j'analyse maintenant avec précision ce qu'implique théoriquement le salariat, c'est à dire selon le destin contemporain. Je retrouverai avec certitude ma critique de la théorie de la plus-value marxienne, c'est à dire celle de la valeur d'échange et d'usage en tant que telle. Bonaldi nous dit, au moins une fois par jour, que tel objet est parfaitement inutile, donc tout à fait indispensable, c'est dans cette direction qu'il va falloir analyser. Sans parler du temps et de la reprise en compte aveugle de la notion cartésienne du temps par Marx. Il faut arriver à la notion d'un temps pluriel. En mettant un s à temps, on a voulu verrouiller cette possibilité, mais c'est un verrou formel. Bref, je crève, il faut en sortir vite, comme d'un camp de concentration, à n'importe quel prix.
Samedi 4 Décembre 1993
Ce que j'avais à écrire ces dernières semaines, je l'ai couché dans le texte qui porte le nom de Frall.Doc. Un Nième essai sur mon destin franco-allemand. C'est, je le crains, une ébauche de plus, mais ce qui m'éloigne une fois de plus d'une élaboration de ce thème, c'est l'impudence de Martin Graaf. Cet Alsacien parallèle tartine comme il respire. Il me pompe l'air. Sans doute pas par son talent, mais par une sorte de tactique du lièvre qui se met devant. Ca me rappelle mon enfance, où il m'est arrivé une fois ou l'autre de me faire devancer au dernier moment par une brute, car, habituellement je suis particulièrement agile. J'ai toujours réussi à me glisser à la première place sans qu'il y paraisse, par prudence, par minutie, prévoyance, simple flair. J'ai toujours eu beaucoup de flair, mais je ne suis pas vraiment un chien de chasse. Je ne tiens pas la distance. La présence d'autrui dans la piste que j'étudie me décourage. Et puis, surtout, je ne peux plus me résoudre à traiter un thème "d'actualité". Déjà j'ai beaucoup de mal à supporter ce que moi-même j'écris ou prononce, alors si un autre se met à traiter des mêmes choses, c'est une catastrophe. Bref, je ne sais pas ce que deviendra Frall.Doc. Sans doute un Nachlass comme tout le reste.
Lundi le 7 Février 1994
Ca y est. J'ai quand même réussi à achever, comme faire se peut, mon Frall.Doc. IL porte un titre ronflant, mais juste : L'EMPIRE DE L'UNION. Myrie joue certainement un rôle important dans ma constance à avoir mené ce projet à bien. C'est devenu très curieux, mais j'ai parfois l'impression de relire mes écrits à travers ses yeux. Il a suffi qu'elle me dise, hier, que les trente-deux premières pages lui avaient plu pour que je les relise moi-même avec quelque délectation. Pourtant je n'aime pas beaucoup ce texte, il m'a un peu trop "échappé" des doigts malgré un travail non négligeable. Je n'ai pas encore trouvé l'homogénéité qu'il faudrait, et pourtant Myrie affirme que ça se lit précisément par le bout du style. On s'y fait, elle ajoute. Je ne sais pas quoi penser.
Pensé-je encore? Je me le demande aussi, tellement je suis absorbé physiquement par le travail du 8 1/2. Le gallon que j'ai pris commence déjà à peser. Il faut maintenant que j'assume le rôle qu'il est vrai que j'ai brigué. Cela signifie qu'il faut que je fasse quelque chose de ce 8 1/2, quelque chose de différent, et surtout d'utile. Mon vieux rêve d'inventer un marteau ! Le 8 1/2 comme marteau de l'actualité, la simplicité au service de ce qui manque, la liberté et l'honnêteté. Y aurait-il encore une chance pour qu'un tel instrument voit le jour ? Chi lo sa ?
Frall.Doc terminé, je vais peut-être passer à autre chose, ou rester quelque temps avec toi, oh ma mémoire ! Mais il faudrait que je sois plus fidèle, vrai chroniqueur de mes journées et de mon temps. Qui le fera à ma place ?
Pour demain, ou après, cette citation de mémoire : celui qui accepte de vivre asservi finit toujours par glorifier la servitude.
Samedi 5 Mars 1994
Aujourd'hui, le titre de ce journal prend tout son sens. Nous revenons du stage Linski en Corse. Une étape sans doute importante pour tout le monde, tant ce stage aura soulevé d'énergies de toutes sortes, bonnes et mauvaises, tant il est vrai aussi que la force des être vivants est parfaitement amorale. Encore plus amorale lorsqu'elle perd ses repaires quotidiens, ses digues construites avec peine par le temps et l'usure des trop-plein de cette énergie. Usure ou économie - Aufhebung est ici mieux venu, car le concept allemand respecte l'idée de conservation dans la perte - mises en place par le politique.
Bref, Myrie est enfin initiée à la voile. Pas seulement des rudiments, mais bel et bien la conduite d'un navire "dont le mode de propulsion principal est la voile". Si je me réfère à un temps pas si lointain, deux ou trois ans, ce résultat est un miracle. Pour qui connaît Myriam, une telle aventure vaut mutation. Je me souviens que la première dimension que j'avais ressentie au début de ma relation, était l'inertie. Ce n'était pas fait pour me déplaire car il se cache toujours une grande force derrière les gens dont l'apparence est passive. Entre-temps j'avais pu me rendre compte de ce que cachaient ces apparences. Derrière son calme légendaire et immédiatement perçu par qui la rencontre, se cache une sorte de déchaînement qui, parfois, ne connaît plus aucune limite, ne se connaît plus de moment de sédation, même si des accalmies successives viennent détendre des situations devenues intenables. Je ne pense pas avoir été et être le seul à vivre ces sortes d'ordalies sauvages, mais il se trouve que seuls ceux qui comptent dans la vie de Myriam ont droit à ces fast-holocaustes où j'ai parfois l'impression de pouvoir manquer subitement de vie.
Pourtant le stage aura été une parenthèse de calme et de tendresse. Même le mal de mer ou la migraine n'ont jamais ridé sérieusement le surface de nos relations. La tempête est venue après, tout de suite, à peine débarqués à Antibes. Auto-programmé par moi-même par ce stupide rendez-vous avec mon horrible tante ? Je ne sais et ne le pense pas, même si ma famille a toujours été, pour moi, une raison de trembler, surtout quand il s'agit de l'exhiber à mes proches. Non, je ne pense pas que la Marthe porte quelque responsabilité que ce soit dans la Saint Valentin qui a suivi. Je suis convaincu que le stage comportait une sorte de piège à couples. Mon expérience passée de la mer ne me trompe pas. A bord d'un navire exposé au danger de la mer, tout lien autre que celui qui détermine la sécurité se dissout. Dans tout couple. J'avais déjà souvent pu mesurer à quel point l'instinct de sécurité domine l'ensemble des éléments psychiques féminins, jusques et compris les aspirations à la liberté féministe. La raison pour laquelle la plupart des militantes féministes
finissent presque toujours par devenir homosexuelle est peut-être là : la sécurité obtenue par la situation de couple à tout prix, que l'on procrée ou pas. Or, la sécurité à bord était assurée par un autre que moi : notre couple n'avait plus son sens le plus profond. En d'autres termes, lorsque nous avons débarqué à Antibes au bout du stage, tout, ou presque, était à refaire entre nous. Littéralement : je n'existais plus. Le moindre désagrément pouvant être porté à ma charge m'était attribué avec toute sa force et en l'absence de toute consensualité préalablement établie. Je suis devenu une "loque", une absence d'homme, l'ombre ridicule du maître de bord. Quel vertige !
Comment sortir de ce piège ? La vie a du charme parce qu'elle réserve toujours des surprises de ce genre. Il faudra donc assurer. Question : qu'aurais-je fait si, en y réfléchissant, j'avais calculé ce résultat, parfaitement prévisible ? Machiavel n'aurait pas eu de réponse. Peut-être seulement Racine. De toute manière je n'aurais rien changé, volontairement, au cours des choses car il est impératif pour moi que les lois produisent leurs effets. Et si, comme j'en suis convaincu, on peut remonter au mort -comme au bridge- il y a une forte chance qu'il demeure possible de faire le deuil de cette "disparition". La seule crainte que je nourrisse me concerne : il faudra que je réprime, sans doute, l'autre loi, celle de la vengeance, et je ne sais pas si j'en suis capable. Tant de souffrances sont-elles donc fatales ? Inévitables ? Comment vais-je trouver en moi l'autre homme bafoué, humilié, torturé. Où vais-je le trouver ? Il faut que je le trouve, sinon la vendetta tombera, sans prévenir. Le mieux serait que Myriam m'y aide, mais... il faudrait que j'existe à nouveau, et je ne suis pas prêt à faire le singe pour prendre à nouveau l'apparence humaine.
Vendredi 11 Mars 1994
Rêve : pour la première fois j'ai vu le Faucheur. D'abord sous forme d'un voilier qui semblait vouloir me menacer, mais en vain. Puis les pions du rêve se sont transformés en chevaux. C'est là que j'ai aperçu la Mort, visage féminin penché le long de son cheval. J'ai vu ce qu'est un rictus, sorte de demi-lune de lèvres serrées en sourire qui s'étire vers l'infini. Ma réaction a été l'indignation. Je me vois, à pied, courir sus à la Mort montée sur un coursier qui finit par me charger. Fin du rêve. Aucune sensation de cauchemar.
Mercredi 23 Mars 1994
Dans une semaine le 99ème anniversaire de Jünger. Ne pas oublier. Devenir oublieux est le pire signe de décrépitude morale.
Deux mondes sont en voie de s'affronter de plus en plus durement. En gros les anglo-saxons et les autres. De plus en plus clairement, le libéralisme smithien se donne comme critère absolu. La lecture du Financial Times est éclairante sur ce point, les démocraties du continent sont vilipendées suavement pour leurs politiques "sociales". Le cynisme est le style général d'articles hypocritement "factuels", mais bien documentés : le chiffre est roi, même s'il change tous les jours. Cela n'empêche pas ce journal de droite de faire sa politique ouvertement.
Lundi 9 Avril 1994
Les questions "fondamentales" affluent, ces derniers temps. Comme certains vents qui reviennent par saison. On dirait que le moi se creuse vers des fonds reposant, re-posant les bonnes questions. Celles-ci portent tout le reste. J'ai parfois le sentiment que s'il m'arrivait d'effacer cette interrogation de mes neurones, ce serait comme la perte de mon lest. D'un instant à l'autre je pourrais alors me livrer à n'importe quel hasard de vie ou de mort, un infarctus par exemple. Etrange. Hier un imbécile a joué au macho devant moi, sur l'autoroute, déclenchant un pataquès dont je me serais bien passé. Il avait l'air d'un vieux con alsacien, comme il en existe des milliers, et, en poursuivant ma route, j'ai eu la certitude qu'il allait payer sa connerie par son corps. M'étonnerait pas qu'il soit en soins intensifs à l'heure qu'il est, ce guerrier de R 19, même pas entraîné pour un cheval de foire.
Pas de quoi soulever les questions ontologiques. Et pourtant. De plus en plus, j'ai la sensation que la question de l'être est entrain de se souder à celle de la logique historique. Dans ma représentation. Le renouveau de mon intérêt pour la Chine et la culture chinoise passe par là. Au fond, si l'humain n'est pas forcément le milieu idéal ou unique pour traiter de l'ontologie, il ne l'est pas moins que le reste. D'où ma curiosité pour les sonorités étranges de la langue chinoise. Entendre Monsieur Yin, c'est comme contempler mes avocats ou mon néflier, les courbes mystérieuses des feuilles, leur galbe insignifiant et pourtant plus beau que tout Michel Ange. Je cultive peut-être la fausse idée selon laquelle tout ce que je découvre de nouveau et d'inconnu dans le domaine anthropologique a le caractère de la réalité minérale-végétale. Quoiqu'il en soit, j'en goûte toutes les beautés. Et à ce sujet, il faut bien dire que les prononciations rugueuses du chinois ne sont pas belles, au sens de Vinci, mais dans ce sens précis qui m'éveille au mystère du sens de l'étant.
Mardi 17 Mai 1994
Ruanda. Curieux comme même un massacre devient un thème récurrent dans une existence comme la mienne. On pouvait se croire au-delà de certaines barbaries, après ce qui a pris le nom pompeux de Shoa. Non. Quoique, le Ruanda -et le Burundi- ça me connaissait depuis longtemps. Cette histoire étrange de deux moitiés de peuple qui s'entre-tuent à ma connaissance exactement depuis que le colonisateur belge s'est officiellement retiré du pouvoir politique, sinon économique et culturel. Je dis avec prudence à ma connaissance, car rien ne me semble connu qui puisse attester du contraire. J'ai jadis bien connu un de ces Tutsis aristocratiques, très cultivé, un peu arrogant mais très bridé par un catholicisme à la belge. Le colonisateur était prévoyant. Les élites tutsies étaient élevées dans les collèges de bon pères. Pas comme les Hutus qui avaient tout juste droit à une catéchèse d'analphabètes flamands. Les Belges ont été, de tous les colonisateurs, les plus immobiles et les plus opportunistes. Pour écrémer les pays nègres il ne fallait toucher à rien, pour n'avoir pas à faire la police. Trop cher. Il suffit de relire Conrad. "Au coeur des ténèbres" préfigure toute la tragédie - mais faut-il appeler cela une tragédie ? - du Congo-Zaïre d'aujourd'hui.
Parfois, j'ai l'impression que ces peuples nous rejouent quelque chose pour nous éloigner définitivement. La Somalie - toute la Corne de l'Afrique - l'Ouganda, ces massacres récents, tout cela ressemble à une effroyable pièce de théâtre destinée à chasser l'incongruité blanche. Notre connerie. Je pense souvent à la beauté invraisemblable de ces peuples, redécouverte par Léni Riefensthal pour un cercle d'initiés, et ça me rappelle le beau livre de Leiris, Afrique Fantôme où le pseudo ethnologue, pas dupe, creuse à chaque page la tombe de la cuistrerie classificatoire et hypocrite. Aussi cette histoire fabuleuse qui se passe précisément lorsque Griaule traverse la boucle du Niger en pillant gentiment tout ce qu'il peut.
Ecoutez : un jour, Gérard Vauthier, qui filmait l'Afrique dans les années cinquante parle avec un vieux Dogon qui n'en finissait pas de rigoler. Motif, il se souvient du passage de Griaule. Ah Ah Ah ! qu'est-ce qu'on a rigolé ! La troupe de l'ethnologue était repérée des semaines à l'avance, grâce au téléphone arabe des administrations coloniales, et quand il était annoncé, tout le monde se frottait les mains. Vite on planquait tout ce qui ressemblait de près ou de loin à des produits manufacturés, on ressortait toutes les vieilleries remplacées depuis la guerre 14 par des objets aussi triviaux que des bassines Made In France ou des couverts de Solingen. Disposés harmonieusement au fond des cases noircies par la fumée, les vieux bols en demi calebasse, les divers bouts de bois qui avaient fait office de service de bouche du temps des vieux, étaient ré exhumés et échangé contre du neuf, au prix fort. A cette époque, la science ne comptait pas. Même Leiris, qui reniflait la supercherie partout, avait été dupe et s'indignait du "pillage" sacrilège de l'Ethnographie en marche...
Pire. J'ai froid en pensant qu'au fond, Tutsis et Hutus se comportent exactement comme les Indiens post-colombiens : plus rien à foutre de l'existence devant la puissance totalitaire de la connerie occidentale. Puisqu'elle pénètre jusque dans nos propres fibres. Les images qui nous parviennent du Ruanda, comme celles qui venaient de Somalie sont toutes pareilles : des beaux garçons hilares tirant comme des fous avec des mitrailleuses kalachnivkiennes. Ou bien, des cadavres qui s'entassent dans une clairière ou dans le fond d'une chute d'eau...Poudovkine qui filme les cadets du Tsar montant à la mort en buvant du champagne, fauchés par les mitrailleuses des rouges.
Journée longue et pleine de diversité. Etrange sensation tellement elle est devenue rare. Ce matin j'ai pensé au Ruanda, ce soir j'ai encore vu de ces images, non pas insoutenables, mais qui remplissent, quiconque les regarde, de honte. La figure du nègre dans le spectacle prend sa dimension tragique, et alimente mes journaux. Comment faire autrement ? Comment me dérober ? Comment dénoncer sans énoncer ce que commande le happening mondial ? Je l'ai bien voulu cela, montrer au monde où battait son coeur, plutôt même simplement le sentir, mais ça, ce n'est plus possible quand il faut, le soir venu, montrer et commenter.
Mercredi 18 Mai 1994
Mes nuits se raccourcissent de nouveau, à cause de la douleur. Il y a toujours une image flottante dans ma tête, celle d'une existence idéale. Idéale au sens de "rigoureusement conforme à ce que je suis", or, je ne parviens pas à réduire les marges. Il subsiste une sorte de chaos journalier où tout peut arriver. Sur des périodes plus longues, où s'installe une certaine régularité, un certain "ordre", c'est ma "santé" qui décroche sans prévenir. Pas vraiment la santé, mais les symptômes : il est clair, par conséquent, que les symptômes viennent corriger périodiquement ce qui n'est pas rigoureux. Ou protester contre un mauvais "cours"... C'est une manière de voir la place du symptôme, car il n'est pas sûr qu'il s'agisse de correction ni qu'il y ait une relation entre le cours de ma vie présente et l'occurrence des symptômes. Bref, c'est le bordel. D'un autre côté je peux bien me représenter ou me remémorer les vies les plus "régulières" par les quelles on a tenté de me formater. Par exemple mon grand-père, mes grands-oncles, mais en réalité je ne sais rien de précis sur l'ordre interne de ces vies. Du dehors elles apparaissaient aussi ordonnées qu'aujourd'hui la mienne, mais que sais-je de la réalité de ces ordres apparents ? Le plus kantien d'entre eux, Joseph, frère cadet de mon grand-père Emile, vivait comme une horloge entre son usine de liqueurs, son quatre pièces mulhousien et ses bols de soupe au goût rituel que lui cuisinait, décades après décades, sa Madeleine si vigilante et que nous aimions tous sans barguigner. Et pourtant Joseph avait un "passé" complètement hirsute. En 1914, il avait dans les trente-cinq ans, le bel âge pour aller se faire démolir à Verdun ou Brest-Litovsk. Calmement, je me l'imagine ainsi puisque je ne connais que cette image calme de Joseph, calmement il suit son corps d'armée, la Marine de Guillaume jusqu'à Narvik. Là, il rend son tablier, se glisse de l'autre côté, combat avec les Anglais, puis rentre en Alsace, vivre le reste de ses jours avec son frère Emile et sa soeur Julie. Comme si de rien ! Je me souviens bien, cette bouche fine et large, toujours souriante, le regard en coin, malicieux dans un visage aussi carré que celui d'Emile, la nuque aussi raide, à la Bismarck, ce qui donnait, sans doute, cette extrême mobilité à ses yeux rieurs.
Cette trajectoire me fascine parce que pendant la guerre d'Algérie, une guerre coloniale et française, j'ai fait comme lui. J'ai calmement déserté, vaguement collaboré avec les rebelles car ce n'était pas facile, mais mon retour n'a toujours pas eu lieu au sens de celui de Joseph. C'est toujours le bordel autour de ma personne, comme si mon corps contenait de la dynamite, comme si je faisais peur, en tout cas j'agace. Bref, je ne m'appelle pas Biringer comme lui, mais d'un nom évidemment insupportable et si peu alsacien. Et puis, surtout, je n'ai plus de clan autour de moi, ils sont tous partis. La force des Emile et des Joseph, c'était leur clan. Nous, nous avons à assumer les destins historiques dans la solitude, même rétrospectivement : je raconte de moins en moins mes "aventures", car elles paraissent surréalistes. Comment pourrait-on comprendre comment des choix politiques aussi lourds puisse s'opérer dans la solitude de l'individualité ? Emile et Joseph, au fond, avaient fait chacun ce qu'une partie des Alsaciens avaient l'habitude de faire : les uns ceci, les autres cela, et puis après on se retrouvait autour d'un verre de Riesling. Mais c'était "les" uns et "les" autres, jamais un seul. Et cela remonte à la plus haute Antiquité : les Mésiens, les tribus Celtes ou Germaniques, les Illyriens ou Panoniens, c'était toujours comme Emile ou Joseph : pour ou contre Rome, mais jamais seul. On touche ainsi à la nature du siècle. La prolétarisation a prolétarisé les destins : l'individu ne bénéficie plus d'aucun "capital" social, répondant de ses choix.
Jeudi 19 Mai 1994
La métaphysique ne passe plus. J'en glisse donc un peu dans ce journal. On en retiendra ce qu'on voudra.
Constat : les religions ont discrédité l'au-delà. La mort comme passage dans autre chose - néant ou quoi ou qu'est-ce - est bien toujours le phénomène qui obsède, mais l'anthropo-athéisme, c'est à dire la religion masquée, a censuré tout discours le concernant. Même les pratiques qui dérivent de représentations rigoureuses des relations entre l'étant et le néant ont expulsé le motif originel. Les manipulations corporelles extrême-orientales - les "arts martiaux" - ne gèrent plus, aujourd'hui, que la situation du corps dans son présent vivant. Elles ne miment même plus celle du corps mort, comme le suggère les épreuves des yogi, ou, plus proche de nous, l'épreuve quotidienne du lit-cercueil des moines chartreux.
On peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une situation théorique nouvelle. Est-ce la vérité ? Les hommes sont-ils en train d'abandonner ou de rejeter leur souci principal, ou bien en a-t-il, en réalité, toujours été de même ? Je penche pour la deuxième solution, même si nos sciences historiques ont longtemps affirmé que les grands mouvements des peuples ont toujours eu pour fondement des oppositions de croyances. Universalité gréco-romaine contre individualisme barbare, monothéisme chrétien versus Islam, St Augustin versus St Thomas d'Aquin, Jansénius versus Loyola, le tout versus Réformés etc... Il devait y avoir, entre les porte-drapeaux de ces mouvements et les peuples, le même décalage qu'entre la réflexion des experts financiers des marchés aujourd'hui, et l'opinion publique aujourd'hui, un abîme.
Beaucoup d'historiens s'échinent à montrer que les oppositions susmentionnées n'étaient que des apparences, et que le vrai moteur a toujours été l'économie. Cela est une pure plaisanterie qui ne fait que refléter l'impérialisme intellectuel des décideurs du temps présent. Même Karl Marx n'a pas dit cela. Il faut remettre, de temps en temps, les pendules à l'heure. Il faut cesser d'accuser le marxisme d'avoir enfermé l'homme dans l'économie. Le marxisme a plutôt été une sorte d'eschatologie athée de l'humanité, la théorie du salut sans Dieu. On peut même être sûr que Marx n'a jamais pensé en termes de salut, mais seulement de dignitas romaine; qu'il a tenté de théoriser la victoire finale et fatale de l'universalisme humain des gréco-romains : "Je suis homme, et rien d'humain ne m'est étranger". Au-delà de la réduction technique de l'homme, de sa réification ou aliénation dans l'abstraction du temps industriel, Marx anticipe la nécessité d'une libération de l'être individuel : ce qu'il faut comprendre alors, ce n'est pas le message militant, mais la prophétie scientifique de quelque chose d'inéluctable.
Or c'est précisément ce côté inéluctable qui fait de la théorie de Marx autre chose qu'une anthropologie morale. En résumé : l'homme est
condamné (par l'évolution historique du capitalisme) à la liberté et à la dignité, et après ? La question reste ouverte, jamais Marx ne plante de décor édénique post-capitalistique, tout au plus propose-t-il quelques maximes éthiques pour la période "historique". Ses disciples ne seront pas aussi sobres. Althusser avait saisi une partie de cette simplicité.
Le "marxisme", ainsi compris, montre bien l'inanité du seul point de vue anthropologique. C'est d'ailleurs cette inanité qui sépare radicalement la culture occidentale de la chinoise. La lutte imaginée par Marx (et surtout Engels) de l'homme
contre la nature, une lutte qui ne fait que reprendre le mythe grec de Prométhé, est le contraire de l'harmonie cosmique, "écologiste" avant la lettre, des anciens chinois. Rien d'étonnant donc que, reprise telle quelle par les communistes chinois, la doctrine marxiste n'ai fini par se retourner exclusivement contre la "nature humaine". Celle-ci représente la seule concession que font les Chinois à l'aléatoire puisque c'est d'elle que dépend le bon déroulement des événements naturels en général. On pourrait donc interpréter le maoïsme comme la sanction permanente du non respect des rites naturels. L'auto-flagellation de toute une culture qui se renie.
L'harmonie du cosmos est bien liée à l'harmonie des actions humaines, mais jamais dans le sens d'une conquête ou d'une agression. D'où un fossé à mon sens infranchissable entre la pensée (c'est à dire le langage) chinoise et la technique. La Chine, faute de se mettre comme Taïwan, par exemple, à un double langage, la langue vernaculaire et l'anglais, restera aussi stérile (du point de vue de son "développement" technique) que les pays arabes.
Mardi 24 Mai 1994
Premier accident professionnel hier, une rupture d'antenne due au retard du 8 1/2. Motif apparent : Cannes et les résultats tardifs + un gros travail sur les présidentielles allemandes qui tombaient le même jour. En fait "on" me fait travailler en sous-effectif systématiquement, sous divers prétextes. Hier j'ai payé les pots cassés. Il va encore falloir se battre. Et découvrir, sans parano, ce que tout cela dissimule. ARTE bruit de mille discours alarmistes sur le fossé qui se creuse entre Français et Allemands. Possible. Après tout on ne suit nulle part ailleurs mieux que dans un tel média, l'évolution des rapports entre ces deux nations. Elles se gâtent d'un point de vue politique général, cette décomposition ne peut que se refléter chez nous. Mais je reste confiant dans les pesanteurs de projets verrouillés comme ARTE. Les intrigues personnelles ou même politiques ne peuvent pas venir si facilement à bout d'une structure aussi diabolique : le Traité qui fonde ARTE est si délicatement rédigé qu'en cas de crise, c'est tout ou rien, crise diplomatique et politique : impensable dans les quelques années à venir.
Je vis, malgré tout, une assez grande déception professionnelle. Je retrouve progressivement dans l'appareil d'ARTE, la même arrogance parisienne qu'à FR3, la même coupure entre créateurs et administrateurs. Bref, aucune synergie interne comme celle qui est évidente dans une boite comme Canal Plus. Il existe des cénacles parisiens et allemands qui décident d'un programme qui nous tombe dessus comme si nous n'étions que des consommateurs passifs. Bref, c'est une politique "départementalisée", nulle, sans mouvement collectif, sans communication interne. Pas beaucoup d'avenir en termes de succès, on risque d'être condamnés à rester un bidule politico-culturel. Bof...Pourtant le personnel est plein de bonne volonté. Il y a des verrous partout.
Vendredi 27 Mai 1994
Entrain de relire L'Idiot. Bouleversé. C'est une expérience extraordinaire que de relire les textes qui vous ont formé. Non seulement formé, mais encore donné une idée de la formation elle-même par la littérature. Je préfère le mot "information", au sens d'Aristote, proche du sens de sculpture.
Voici de quoi il s'agit. Il y a déjà une vingtaine d'année, je me suis mis à professer, moi qui ne suis rien en littérature et qui me suis même mis à renier la fiction il y a longtemps déjà, qu'il existait deux catégories d'écrivains (dans l'histoire du roman).
La première est descriptive. Elle se sert de l'alchimie des mots et de la syntaxe pour décoller de la réalité une sorte de calque. Deux exemples me paraissent représenter parfaitement cette catégorie : Flaubert et Balzac. Leur manière de fictionner est purement journalistique. Pour Balzac, cela me paraît particulièrement évident, n'importe quel journaliste d'aujourd'hui écrit à la Balzac, lorsqu'il a quelque talent. Pour Flaubert les choses sont plus complexes. Il créé des personnages à la fois totalement réalistes et totalement aléatoires. En effet, ils sont réalistes par leur description psychologique, le hasard n'entrant en scène que dans leur mise en scène. L'effet du Flaubertisme est donc de type, dirais-je, kaléidoscopique : les bouts de verre mélangés sont bien réels et inaltérables, seule change leur disposition. Au résultat, rien ne peut se mouvoir réellement chez le lecteur. Celui-ci reste un voyeur, un spectateur lui-même inaltéré par ce qu'il lit, ou voit en lisant. Bovary ou Pécuchet sont des reconstitutions psychologiques presque "naturalistes", cliniques. Leur exactitude pourra même intéresser la Science ou la philosophie psychologisante. Rien d'étonnant que Sartre consacre quelques milliers de pages à Flaubert.
Il en va tout autrement de la seconde catégorie d'auteurs, ceux qui, selon ma théorie, ont modifié historiquement "l'âme humaine". Telle était ma première formulation de cette intuition. Deux écrivains m'apparurent immédiatement comme les représentants de cette tendance : Stendhal et Dostoïevski (dans le monde russe, Tolstoï appartient évidemment à la première catégorie). L'un comme l'autre me paraissent avoir inauguré en littérature ce qui était la fonction ou l'efficace supposé des traités et manuels de Morale. Même le poème de Boëce, quelle qu'en puisse être la beauté formelle, il reste un catéchisme stoïcien destiné à transformer l'âme, à l'élever au-dessus de sa contingence justement purement psychologique au sens contemporain du terme. Encore faut-il remarquer que le but régulier de ce genre de traité est moins de transformer l'âme que de la maintenir dans certaines limites, de la soumettre à certains canons éthiques qui la mettent à l'abri des passions. Il convient de lui permettre de faire la "traversée" de l'existence en préservant sa nature plutôt qu'en la modifiant : platonisme impérialiste qui traverse toute la philosophie morale des deux millénaires qui viennent de s'écouler.
D'où l'intérêt d'une littérature qui reprend à nouveaux frais, sans le savoir sans doute, le projet de sculpter un nouvel homme, de forger une âme inconnue, de servir littéralement et littérairement de parturition à un homme nouveau. Au demeurant, cette sorte d'effet littéraire n'est pas lui-même une nouveauté à l'époque des deux exemples que je cite. Le Roman chevaleresque, la Saga ou le Mythe ont sans doute produit des effets similaires, d'où très vraisemblablement leur statut "décalé" par rapport au corpus philosophique et théologique dominant. Il est étonnant de constater comment les deux dimensions littéraires se mélangent totalement dans certaines oeuvres de Thomas Mann comme "L'Elu", stigmate d'une histoire où sont requis de la manière la plus démente, la plus nécessaire, à la fois la conservation de l'homme disons académique, et à la fois l'apparition de l'homme démiurge (ou Titan de Jünger). Cette opposition se retrouve intégralement dans le Faustus où la passion est refoulée dans le même mouvement qui l'aspire, ou vice-versa. La passion, chez Mann, n'aboutit jamais, préfiguration de l'échec des manipulations forcées et forcenées de la nature humaine par le fascisme. L'aboutissement étant précisément cette mutation de l'homme tant recherchée à partir du dix-neuvième siècle, pour des causes tantôt parfaitement claires, tantôt totalement obscures.
Stendhal donc, ou Dostoïevski, ou comment la littérature réussit là où échoue la catéchèse philosophico-religieuse gréco-judéo-chrétienne. Ce n'est que la première étape : le prince Muichkine est a priori déjà la perfection morale, Julien Sorel également. Les personnages partent d'une position morale acquise, d'une "bonté" naturelle au sens de Rousseau, bonté qui se retrouvera de manière universelle dans tous les personnages de ces deux auteurs, sans reste. De Rogogine à Raskolnikov, il y a sainteté naturelle et spontanée. Leurs crimes sont purement allégoriques, leur haine seulement la face cachée de leur amour quasi christique pour autrui, mieux : pour la vie.
Stendhal et son alter-ego russe, luttent de toute leur force contre la tendance générale de leur siècle. Celle-ci consiste à multiplier les personnalités d'un même individu, à inventer une multiplicité de psychés coexistants en un même homme. L'inconscient de Freud est en filiation directe avec les tentatives plus ou moins fumeuses de Maine de Biran à Taine et Binet qui consistaient à faire éclater la psyché. On voulait montrer qu'il y avait plusieurs âmes en un seul homme, spiritisme avant la lettre, vieux relents de chamanisme que ne méprisera pas un Bergson. Stendhal montre au contraire que, quelles que soient les conditions extérieures et quelles que soient les forces des pulsions passionnelles, l'âme reste inaltérable dans son individualité. Quand la tête de Sorel roulera sous le couperet de la guillotine, le lecteur peut avoir le surprise de constater que son jugement du personnage, c'est à dire en réalité la force avec laquelle il s'est identifié à lui, n'a pas changé d'un cheveu depuis la première page du livre. Dostoïevski n'hésitera pas à torturer comportements, déclarations et pensées de ses personnages : ils ne s'altèrent jamais dans le processus d'identification du lecteur. Il en va tout autrement, faut-il le souligner, à propos de Emma ou de Rastignac, ou encore des multiples premiers et seconds rôles du cinéma proustien. Non seulement ils sont immédiatement campés dans une "objectivité" déterminée par un scénario psychologique, mais ils se "décomposent" - zerfallen - dans un rythme dramatique propre à ce qu'est censé contenir ce scénario, ou, disons le rondement, ce "diagnostic".
C'est que justement, ni Stendhal, ni Dostoïevski, ne posent de diagnostic préalable. Dans l'abord de chaque personnage, il y a tout ce qui peut donner lieu à tel jugement et à son contraire. C'est là le génie propre à ces deux auteurs. Ils n'inventent ni bons, ni mauvais héros. Dans l'Idiot, le bon est malade. Donc douteux. Le méchant est sain et fort, russe, donc humainement fiable. Il s'agit là, en fait, de littérature métaphysique, exactement comme il existe de la peinture ou d'autres arts métaphysiques. Ou, disons-le, il ne peut s'appliquer l'attribut d'artistique que là où il y a métaphysique. Encore autrement, et peut-être plus justement : c'est la volonté ou le regard métaphysique qui donne nécessairement l'Art. Pour autant que cette métaphysique garde ses distances par rapport aux canons onto-théologiques qui ont prétendu eux-mêmes faire un sort à l'esthétique en tant que détermination de l'Art, du Beau, du Sublime et de que sais-je encore.
Qu'est-ce à dire ? Et en quoi cette littérature "métaphysique" est-elle propre à transformer l'âme humaine ?
Primo, le regard métaphysique déshabille le monde en fonction non pas de ses attributs esthétiques (perceptifs) ou objectifs (scientifiques), mais en fonction de son "étantité". Le regard métaphysique est constatif : il se contente de prendre acte de la réalité en tant que la seule chose étante, donc bonne. Dostoïevski, on le sent en lisant, est parfois dépassé par le nombre de choses à prendre en comte
en même temps. Ses "mises en scène" sont à tableaux simultanés, se bousculent dans les flux du temps qui s'est emparé de ses personnages dès la première page. C'est une course à laquelle se livre l'écrivain, une course destinée à rattraper sans cesse des situations qui sont hors d'elles-mêmes à peine esquissées. Lui, l'écrivain, tente, phrase après phrase, de rester auprès de ses personnages, dans ses personnages. Il veut leur rendre justice au fur et à mesure que les condamnent les flux temporels de situations intérieures et extérieures. Il résiste avec eux à toute déréliction absolue, à tout forme de pourrissement ou de disqualification du statut d'homme : c'est ainsi qu'il, l'auteur, créé ce statut. Il l'affirme dans la pérennité qu'il dessine contre vents et marées. Comme un peintre, contraint seconde après seconde, à prendre en compte le plus infime changement dans ce qu'il perçoit et qu'il peint, dans les flux de sa vision et ceux du dehors. Rien, il ne peut rien "abandonner" de ce dehors sans souffrir. Le génie des auteurs dont il est question ici, est d'avoir su faire partager leur propre souffrance à devoir abandonner, ne fût-ce que momentanément, tel ou tel de ces êtres humains, tels dans ce temps-ci, tels dans cet autre, bons toujours.
Ce n'est pas un hasard si le thème de la compassion chez Dostoïevski recoupe la théorie de la pitié chez Rousseau. L'impuissance de Jean-Jacques provient de ce qu'il concède la possibilité historique de modifications elles-mêmes métaphysiques de la condition humaine, modifications qui portent atteinte à l'être de l'homme, qui l'entament. Rien de tel chez le Russe : rien n'entame l'être de l'homme, car rien n'entame l'être tout court, rien ne peut entamer l'être. Loin de concourir à la dégradation de l'homme, les passions le font exister dans une dimension qui le met aux prises avec le seul devoir de résister au néant. Le Prince Muichkine ne s'absente que dans l'épilepsie, le haut-mal (!). La mort ne cesse de rôder à travers toute l'oeuvre de Dostoïevski, mais elle ne compte littéralement pas. Elle sert uniquement de balise à ce qui est, de limite de l'étant et du non-étant, du bien et du mal.
Comment tout cela peut-il avoir transformé l'âme ou la psyché humaine d'un siècle à l'autre ? Evidemment, transformation peut s'entendre de multiple manières. Un : changement total, radical, nouvel état, nouvel étant humain, nouvelle manière d'être, nouvel être : cela n'a guère de sens car il faudrait posséder le modèle ancien pour comparer ; l'autre littérature montre bien qu'il n'y en a pas. Deux : le rétablissement de l'homme dans sa dignité passée, dans son caractère divin de héros (héraut) de l'être, les nouveaux philosophes de Nietzsche, en quelque sorte. La comparaison tombe très bien, car c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est à dire non pas d'une opération prétendument démiurgique de recréation de la nature humaine, mais de retour éternel du même. L'homme de la littérature Stendhalienne ou Dostoïevskienne revient aux sources de son être dans l'être, c'est à dire au savoir de son appartenance à l'être par cela même qui semble l'en exclure, à savoir les passions et l'histoire. Le message de Nietzsche peut d'ailleurs aussi s'interpréter ainsi : l'homme n'accède à son humanité que par l'exercice total de ses passions et par la confiance aveugle en l'efficacité de ses sens. Les nouveaux philosophes sont ceux qui auront démasqué les mensonges des "morales" collectives et enseigné l'assomption de l'individualité dans toutes ses conséquences. Cette assomption, Muichkine le montre, passe par un usage de fait d'une humanité morale sui generis, double pléonasme : l'humain est humain car moral et tout ce qui est moral sui generis est humain.
Reste la dernière question : l'Histoire. Je pensais bien, au début de ce commentaire, que c'est la lecture de L'Idiot qui modifie l'âme, réforme les consciences. En réalité, il ne s'agit pas d'une réforme ni d'une modification, mais de la faculté de l'âme d'accéder par identification à ses contenus réels. Alors qu'un travail millénaire d'identification par catéchèse et pédagogie pense avoir formé l'homme des Droits de l'Homme, c'est une vulgaire oeuvre de fiction, le roman, qui fait la preuve de son existence. Car c'est son existence qui est rendue possible.
En très gros, la Morale gréco-judéo-chrétienne n'est pas tant vilipendée par le 19ème siècle à cause de son contenu qu'à cause de son échec. Moines médiévaux, Jansénistes ou Jésuites, tous les "bergers" de toute religion ou de toute morale laïque, tous ont échoué par manque de génie. Ce qui a sauvé la doctrine pendant si longtemps n'étaient que les exemples épars de "vies" exceptionnelles, celles des saints et surtout le conte à dormir debout de ce prince Muichkine de l'an Zéro qui s'appelait Christ. Dostoïevski réussi l'opération fantastique de rendre la vertu ordinaire, d'en faire le milieu "naturel" (de la société la plus décomposée du monde, la plus douteuse), le
point de départ et d'arrivée de toute situation. La vertu est un commun dénominateur qui va de soi, les vices mêmes ne sont que des moyens pour l'exprimer, le crime, une invention fantasmatique de la conscience malheureuse. L'Idiot
est notre conscience, notre âme. Et pourtant son parcours romanesque n'est ni une dialectique ascendante ni surtout la peinture d'un nouveau saint. Le Prince ne "sauve" pas la société qui l'entoure, il "sauve" le lecteur en le réinstallant dans son universalité de droit, dans la vertu initiale de l'être. Ce dernier peut se choisir n'importe quel personnage, de Lebedev à Rogogine, il ne trouvera que des Saints ! L'existence devient affaire de beauté, ou de goût, la vertu ou l'idiotie sont le substratum de l'humain, quel qu'il soit.
Reste un mystère. Le retour du même : quel même ? Où l'homme s'est-il vécu dans la dimension princière de Muichkine ? Quand ? Dans l'âme de Dostoïevski, sans doute seulement.
Dimanche 29 Mai 1994
S'habituer au malheur, c'est s'exposer à ce que le malheur s'habitue à vous. Tout ce que me dit cette longue journée de travail.
Lundi 30 Mai 1994
Pourquoi écrire aujourd'hui ? Je n'ai strictement rien à dire. J'écoute d'une oreille distraite Myrie et Anne qui gwatchent sur les fêtes des mères. Epuisé par des heures de boulot inutiles. Résultat proche du désastre. Les jours passent ainsi, il faudrait que je puisse annuler ce processus en écrivant. L'écriture annule toute vacuité. Je le sens en ce moment même, mais l'effort ? Où chercher les forces psychiques pour se croire assez fort pour continuer d'écrire maintenant ? Y-a-t-il vraiment épuisement des "forces de travail" ? Au fond ce concept est peut-être totalement débile, aussi débile que la temporalisation astronomique des activités humaines. Pourtant je sais qu'il y a des limites, mais de quel ordre sont-elles ?
Vendredi 10 Juin 1994
Je reviens sur Dosto. Je veux envoyer ce texte à Jünger pour notation, et à le relire, je vois bien qu'il est bâclé. Disons, pas fini. Il y a eu, à nouveau, une "poussée de fièvre", cet état bien connu des fibres de mon corps, avant la retombée dans l'apathie fonctionnelle du quotidien. Parfois la fièvre retombe, mais je continue d'écrire et ça n'a presque plus de sens.
Bref, le retour du même et le Prince. Ce qu'il fallait dire, c'est que ce retour du même est création littéraire de non-littéraire, d'étant non-littéraire. C'est ce que je n'avais sans doute pas assez bien exprimé au début de mon analyse. Dostoïevski refait pour ainsi dire, non pas l'idée humaine, mais directement l'âme. La lecture de son oeuvre correspond à une sorte de lavage plus qu'historique, un retour à un homme qui n'existe dans aucune tradition philosophique, mythologique ou littéraire. Quelqu'un comme l'homme que l'on pourrait fantasmer d'avant le néolithique, à la Rousseau mais sans la camisole de force des Lumières.
Ce qui est remarquable dans les situations décrites, c'est le décalage permanent entre les dialogues et le sens de l'action. Les discours les plus élaborés des personnages sont en fait composés de silence. La discrépance entre la logique des discours et l'action est totale, comme si l'auteur peignait une situation où les choses vont leur train au milieu d'une floraison anarchique et tout à fait naturelle (phusique) des phrases, des idées et des interpellations.
Partout règne l'incertitude. Le Prince lui-même est un composite de l'homme dostoïevskien et de l'homme ancien. Cet homme est en porte à faux constant avec ce qui s'énonce, se réalise et évolue autour de lui au nom d'un Capharnaüm semblable au flux des vagues de l'océan, désordonnées mais cycliques et provenant de toutes les latitudes et de toutes les longitudes de la tradition, du passé, des coutumes et des caractères humains. La maladie l'a partiellement purifié, là-bas en Suisse, espace de la paix des morts, mais cette purification redevient nécessaire dans le flot de la décomposition russe, c'est à dire humaine.
Il s'agit là, sans doute, de la dimension autobiographique de Dosto. Ses propres doutes resurgissent dans les crises d'épilepsie que lui-même connaît bien, la maladie comme refuge de l'âme incapable d'assumer l'histoire des hommes, le parcours d'un Dieu égaré dans le monde humain. Le psychotique s'absente de la dimension d'un réel devenu insupportable ou ... tellement décalé qu'il devient insignifiant.
Dostoïevski est le Beethoven de la littérature : son oeuvre est symphonique. Elle fait surgir les flux et les reflux de l'être comme son accomplissement permanent : c'est dans l'éclipse de l'ordre, du bien, de la beauté, de la santé et de la paix intérieure et sociale que se tient le lieu de la persistance de l'être. Le génie consiste donc bien dans l'orchestration globale de ces flux et de ces reflux. Ainsi se créé de l'étant. L'Idiot n'est plus une représentation au sens classique de reconstruction conceptuelle ou imaginaire, il est une re-présent-tification du présent, recréation de Présence, pure démiurgie artistique dont on ne perçoit plus, aujourd'hui, la possibilité lointaine que dans la peinture ou l'architecture.
Création littéraire de non-littéraire : forge d'une espèce nouvelle d'hommes, à l'instar du trouble texte de Nietzsche. Piège, au fond, pour tout l'acquis politique ou historique des traditions achetées par l'intrigue. Plus profondément : une peinture à un seul couteau du fonctionnement même de l'intrigue fluctuante de l'être lui-même. Nous, nous sommes impuissants à nous hisser à la hauteur de vue de telles vagues. Pris comme des brindilles dans le cyclone des jours qui passent, nous ne voyons jamais que la lame qui nous menace, nous ne saisissons que par ces "passeurs de l'être" la météorologie cosmique, celle-là même qui nous alimente en vie.
Et alors ? Alors de nouvelles générations de lecteurs de Dostoïevski, futurs résistants à la cristallisation technique des étants, éternel retour au pivot brahmanique, au Tao des anarques de Jünger, aux hommes porteurs de semelles de vent. Ainsi seulement, et par cette écriture seulement, se justifie le roman. Avant Muichkine il y eût Sorel, mais aussi, et surtout Quichotte, cet autre idiot d'un monde qui se recomposait dans sa propre pourriture.
L'écriture permet tout, en apparence. Mais elle contraint aussi à tout. Aussi, ne dois-je pas vouloir m'évader d'une question : que faire avec cette découverte d'une orchestration possible de la symphonie de l'être ? Si ma démonstration vaut, alors il faut aller plus loin. La direction d'orchestre est devenue un art, même une discipline à caractère artisanal, au sens où il s'agit d'un métier manuel. En tant que Furtwangler de la plume, Dostoïevski démontre qu'il est possible de déchiffrer la réalité, c'est ce à quoi s'affairent philosophes et hommes de sciences; mais l'écrivain russe va plus loin en mettant ce déchiffrement en musique, en lui donnant une
réalité nouvelle. Par contraste avec Balzac, le texte russe ne se contente pas de représenter fidèlement la société russe selon ses propres canons de lecture : Dostoïevski ne se contente pas de réécrire les gazettes en les intimisant.
Il intimise un monde beaucoup plus vaste, celui du temps qui précisément abolit, au fur et à mesure de leur apparition, les épisodes dont se saisissent les journaux. Il n'y a pas, ici, une opération de gonflage, d'étalage d'un épisode sur tant et tant de pages. Il y a compréhension globale de l'inanité de ce sur quoi semble buter, à chaque heure, les désirs, les espoirs, la volonté et les angoisses humaines. En revanche, les pages de l'Idiot, par exemple, exhibent le temps plein de la conscience en exercice, celle du héros certes, mais surtout celle du lecteur. Le temps est la lecture elle-même, suprême réussite littéraire. Faites l'expérience, le suspens ne peut pas provenir, chez Dostoïevski, du déroulement même de l'intrigue, car il ne se déroule rien. On tourne plutôt en rond, exactement comme dans la vie, et le miracle vient de ce que cette ritournelle devient un autre monde, plus juste, plus beau, plus humain au sens de ce que nous avons ramassé en deux mille ans de croyances en l'être humain. Et c'est de cette promenade dans ce monde-là que provient notre admiration, notre attachement passionné au texte. Celui-ci ne nous trahit que par le mot fin.
La question est donc de savoir si cette trahison est définitive, comme celle des romans à l'eau de rose. Si, comme pour le reste de la littérature romanesque, le seul moyen de prolonger l'oeuvre est de la commenter comme on le fait ici, de la soumettre à la critique et d'en dresser le monument académique. Ou bien, ou bien si cette trahison n'est qu'apparente et que l'efficace de l'écriture de Dostoïevski ne réside pas, en réalité, dans ce qu'il abandonne au lecteur, ce qu'il lui offre en supplément, lorsqu'il referme le livre. Maintenant que j'y pense, je suis frappé par la ressemblance qu'il y a entre l'expérience du L.S.D. et la lecture de l'Idiot.
Quelle ressemblance ? L'affaire des contenus de mémoire. L'expérience du L.S.D. permet de découvrir la contingence absolue des contenus mnésiques d'origine culturelle. Lorsque l'effet du produit commence à se dissiper, on assiste à une sorte de retour des "acquis" théoriques, des idées qui charpentent notre "vision du monde". Ce spectacle est particulièrement lamentable et angoissant à vivre, parce qu'il révèle le fossé qui sépare une partie du sujet que nous sommes à ce moment-là, de ce qui s'est déposé comme représentations prétendument conscientisantes (ou structurantes). Or, l'expérience de ce retour des démons, démontre à qui le soutient sans broncher, que le "sujet" qui voit, n'a que peu à faire avec tous ces contenus embarqués au cours de l'existence. On ne peut évidemment rien affirmer sur ce que serait l'expérience du retour sans les acquisitions préalables ; il reste cependant qu'une nouvelle dimension s'introduit au cours de cette retombée dans l'Entonnoir de Bergson d'objets devenus parfaitement incongrus, seulement pour s'être baladés pendant quelques heures dans une extériorité qu'il reste au demeurant à définir.
Sauf dans le cas de l'Idiot, où l'extérieur est là, sous la forme du héros-écrivain. Pour ma part, l'impossibilité objective du roman réside précisément dans l'onirisme de l'écriture : tout sort de la conscience de l'écrivain, tout comme un rêve est constitué par une seule et même conscience ( ou comme on voudra l'appeler ). La "mise en scène" romanesque ne "communique" que par des effets d'identification linguistique toujours approximatifs. La fausse extériorité de l'écrit n'autorise jamais qu'à une critique toujours aléatoire, le plus souvent violente. Lire un roman et "en parler" , c'est réaliser la même opération intellectuelle qu'interpréter les rêves du voisin.
Mardi 14 Juin 1994
Fonction utilitaire. J'aimerais que, de temps en temps, un regard se tourne vers moi. Seulement un regard. Celui de maman ? Même et surtout pas, celui-là est trop répandu autour de moi. Je n'ai pas besoin de vigilance. D'amour ? Qu'est-ce-que c'est ?
Non, j'ai besoin d'un regard, de temps en temps. Comme si j'avais besoin de quelque chose comme une attestation d'existence, un certificat de Da Sein. Il y a une quarantaine d'année, un peintre m'avait un jour déclaré, après m'avoir considéré d'un oeil professionnel, que je ne pourrai jamais constituer un sujet pour lui. J'étais, disait-il, trop parfait. Pas de forme qui permette à son crayon d'accrocher, aucune de ces imperfections qui font l'objet de la peinture.
De qui détourne-t-on son regard ? Les réponses sont nombreuses et peu réjouissantes.
Dimanche 26 Juin 1994
J'ai 53 ans. Je n'ai encore rien fait. Je ne commencerai pas ce soir.
Mardi 28 Juin 1994
Les trois propositions du 26 ont fait grand bruit. Dépression, paranoïa, mégalomanie et toutes ces sortes de choses. En attendant, le temps s'écoule sans que j'ai réussi à satisfaire ce vieux désir de léguer un marteau à la postérité. ¨Pas assez de passion ? Sans doute. La passion offre à l'homme la dose d'aveuglement nécessaire pour qu'il accepte de réaliser. Sans doute ne faut-il pas confondre réaliser et se réaliser : deux perspectives qui séparent radicalement gauche et droite, bien et mal etc...
Mes perspectives politiques sont à présent claires pour moi. A contre-courant de ce qui s'énonce ici et là, mais radicalement : l'homme est le seul sujet de toute politique. Pas plus que l'écologie, l'économie ne peut devenir un interlocuteur de la politique, sous quelque forme que ce soit. Le lois du marché ne sont pas des sujets du politique.
En politique, il faut donc oeuvrer pour augmenter toutes les protections et tous les privilèges du citoyen au maximum. Le libéralisme des anglo-saxons n'est qu'un désir de retour à la barbarie, désir permanent et qui n'a rien d'original. Les anglo-saxons sont les Germains du vingt et unième siècle.
Jeudi 5 Juillet 1994
Alexi vient de passer le bac sous la même condition que moi-même en 1960. Hallucinant. Comment tout cela va-t-il se poursuivre ? Via Golgothae .
Relu en vitesse la Guerre des Gaules. Bonne remise en selle. Roboratif compte-rendu de l'une des principale fondations de notre "humanisme". La Réalpolitik ne date décidément pas de Bismarck. Mais, j'ai beau chercher, je ne trouve pas la motivation des Romains. Simple prédation sans doute. On n'admire donc, lisez Montesquieu, que l'art et la force de caractère des prédateurs, et bien sûr, leur efficacité. A bien lire, il faut bien reconnaître que, dans l'affaire, le prédateur est le barbare. Il extermine une civilisation "indignée" et désespérée. Vercingétorix assume le suicide collectif face à la brutalité animale. Les soldats de la "Ville" avaient d'ailleurs tout fondé sur l'art de la barbarie en écrasant les cités soi-disant concurrentes, Latines ou Etrusques. Curieux comme il semble aller de soi que Rome ne serait que le moment d'un développement "naturel", alors qu'il s'agit bien d'une monstruosité certainement aussi ignoble que le Nazisme, une de ces sortes d'accident de l'histoire de l'amibe humaine. Comment ce modèle a-t-il pu triompher dans les esprits révolutionnaires du 18 ème siècle ? Seulement sans doute pour des motifs de survie politique et militaire. Je me souviens des intuitions d'enfance à propos de Rome, l'horreur. Et puis le même sentiment m'a submergé en visitant le Colisée puis 5ème Avenue, deux autres Auschwitz dans ma mémoire. Serais-je profondément incapable d'assumer la grandeur ? Ce qu'au fond l'on me reproche ici et là. Mais quelle grandeur ? Tarquin/Hitler ?
La grandeur, c'est tout.
OK. A tchao, bonsoir.
Samedi 16 Juillet 1994
A Guernesey j'ai vu un bateau nommé "Kaos". Voilà une idée qu'il faut creuser vraiment. La creuser, ou plutôt la retrouver. J'ai toujours considéré que la grande pensée d' Héraclite fut celle du chaos, en rien antinomique à l'Un de Parménide. Il est vrai qu'Héraclite la tenait d'Anaximandre.
Mais, quel intérêt ? Tout le monde, aujourd'hui, se "chaotise" peu ou prou. Les mathématiciens, les informaticiens, les artistes et les physiciens travaillent sur la théorie du "fractal". Mais tout cela n'a pas encore son sens réel. Le sens du retour à la pensée du chaos est beaucoup plus redoutable à prendre en compte lorsqu'on le met en perspective avec la pensée de la Loi et son règne, aujourd'hui, sur la plus petite partie du comport humain. Sans doute, d'ailleurs, pense-t-on aujourd'hui le chaos en terme de loi, d'axiome et de rendement industriel. Certainement pas dans ses ultimes conséquences négatrices de lois, de légalité ou de droit en général.
Les Droits de l'homme ne se comprennent pas sans l'Esprit des Lois, ni sans la conviction scientifique d'une vérité formée par des lois. Cela va très loin, jusque dans l'indignation, dans l'affect humanitaire, dans l'évidence d'un aspect sacré de la "personne humaine". La grande loi de l'ère chrétienne est l'amour. Que devient cette loi dans le chaos ?
Souvent je me suis appliqué à tâcher de comprendre la possibilité, la simple possibilité des exemples d'inhumanité passés. Comment penser les massacres des guerres romaines, ceux de Tamerlan ou d'Hitler ? Comment permettre à nos sensibilités humanitaires de regarder en face les anéantissements coloniaux sur tous les continents où peuvent se jeter les yeux ? Comment comprendre l'esclavage ?
En passant : il ne suffit jamais de décrire et d'insuffler l'indignation ou la honte. Il faut essayer de toucher au réel de ce passé tenu pour si affreux. La théorie du chaos contient en elle des milliards de mégatonnes d'énergie de destruction de toute cette sensiblerie. Avant qu'elle ne prenne force de loi, il faut donc bien se décider à ouvrir les yeux et faire les comptes.
Déjà, en Extrême-Orient, des voix puissantes s'élèvent pour ridiculiser l'occident humanitaire. A Rangoon il passe pour normal d'exploiter des enfants. Id est : user un corps de jeune humain par le travail forcé, quitte à le priver de toute jouissance et à raccourcir sa vie. L'impératif catégorique n'a plus ou pas, force de Loi. Ni dans la praxis, bientôt plus dans la théorie. (à suivre)
Vendredi 22 Juillet 1994
Il semble qu'un jour il faille reconnaître les siens et les autres. En toute chose, les gens, les animaux, les fleurs et les roches. Une comptabilité réelle doit un jour se manifester dans le regard, tout simplement. Et là, il ne faut pas trembler, il faut accepter ce qui s'est inscrit malgré soi dans un réel qui est devenu "son monde". Il faut payer ses créances, ou risquer sa peau.
Cela me rappelle le message d'un homme de la trentaine qui s'était suicidé en laissant pour tout message : "je m'en vais, je ne tiens pas à payer mes factures". L'étant se forme aux actifs et aux passifs de sa propre existence et se révèle d'un coup. Pour qui sait observer, il doit devenir à chaque jour plus patent comment l'attend son fatum. Disons qu'il doit, à un moment donné se rendre compte de la vitesse à laquelle il rejoint son but, quel qu'il soit. Les poètes expriment ce genre d'intuition sans, la plupart du temps, en saisir la vérité profonde. Le spleen reste vague, informe et indécis entre un mal de vivre présent et une angoisse de la mort. Jamais je n'ai lu cette voyance de l'harmonie directe qui s'accomplit sous nos yeux
dans le temps et dans l'espace. Mais cette harmonie n'est pas un reflet de quelque harmonie pré ou postétablie. Il s'agit d'un courant qui emporte en formant selon la mémoire : NOUS SAVONS TOUT. Nous savons ce qui nous attend, rien qu'en contemplant de près les objets et les êtres qui nous entourent. Il suffit de voir, ou peut-être de savoir. Dans le temps et l'espace signifie que tout est lisible dans la continuité de notre passé : le présent condense les courants de vie et de mort qui convergent vers nous, d'au-delà de notre propre naissance et de la portion de vie qui nous a déjà été concédé.
Plus précis. Tout remonte pour qui sait goûter l'air du présent. Tout remonte comme une moire des actes bons et mauvais, jouis ou révulsés par la conscience présente dans un autre temps. Aussi, tout nous accompagne dans notre destin. A bord d'un voilier cela est particulièrement remarquable. Le vent, les vagues et le mouvement disent en permanence notre relation intime au tout. A ce moment, même le simple marin, non poète ou non voyant, sait que tout dépend de lui et qu'il dépend de tout. Tremble-t-il pour une lacune - elle peut être morale ou technique - il fonce vers le naufrage. Il faut se sentir totalement innocent pour se lancer dans l'aventure.
Actif et passif : les choses sont victimes de nos passifs et prennent jouissance de nos actifs. Ainsi des enfants. Il n'y a rien d'aveugle dans les chemins du temps, pas un Oedipe trompé par je ne sais quelle Pythie. Il n'y a que du su, du su qui s'accumule dans la mémoire et qui forme les objets, tels qu'ils sont pour nous, tels aussi qu'ils sont parfois imperceptibles pour les autres ou tout simplement invisibles.
Une raison de se méfier de son "environnement". Une raison pour finir toujours par se retirer dans l'anonyme du nu. Ah ! une chambre toute nue, toute blanche, un simple lit et une table rustique ! Le rien est une nostalgie de l'oubli du temps passé, des impressions de fautes, d'erreurs, de saleté voire d'ignominie qui nous taraudent de l'intérieur du présent. Mais que la nudité soit enfin conquise ne change rien, on ne fait alors que révéler la nudité de la volonté du nu, une sorte d'obscénité qui ne sert à rien, ni pour autrui, ni pour soi-même. On ne peut pas se débarrasser du fardeau à si bon prix. Il vaut mieux, et le savent les anciens, soigner son dos et son âme pour rendre à ce qu'on traîne avec soi un autre air. Car rien n'est jamais joué.
L'existentialisme avait laissé entendre qu'il y avait toujours possibilité de rémission, de choix, de changement de l'être. Mais cette théorie repose hélas sur l'idée d'une subjectivité séparé du monde, l'éternel cogito qui regarde le monde en témoin. Or, le tout avance et reflue avec le tout. Lorsque mon coeur est triste trop longtemps, je vois bien que mes plantes souffrent, je vois bien la poussière recouvrir insidieusement les murs et les meubles, les pièces de mon appartement prendre la gîte bien familière des mauvais temps. Non, nous ne somme pas les témoins de notre temps. Nous en sommes le tissu, et avec nous le monde lui-même, tissu de notre être.
Dimanche 23 Juillet 1994
(Suite du 16 Juillet) Le chaos.
On est donc près du fil de la lame. Au bord du rouleau compresseur qui pourrait d'un coup ruiner deux siècles de discours, certes hypocrites, mais porteurs d'espérance pour les mal-nés. La théorie du chaos vient à point pour appuyer la revendication "théorique" d'extrême-droite. Si l'étant est "fractal", si le temps et l'espace ne sont pas régis par des lois fixes, l'âme ne peut pas prétendre à un autre statut. Aucun dieu sauveur à l'horizon. Nous sommes cuits.
Sauf à considérer le côté lui-même libérateur de la théorie du chaos. Pour l'humanité cette idée pourrait signifier l'indépendance monadique de l'individu - en fait ce qui se met en route depuis l'explosion technique - la solitude assumée sur le mode divin, du divin. Le divin est un paradigme puissant, le modèle antique d'une humanité qui se trouve. Notre ère a commencé avec la notion de l'Apeiron dûment assumée, l'histoire pourrait enfin commencer avec un chaos libéré par les forces de l'industrie et le courage.
Samedi 6 Août 1994
A propos d'histoire. Secret de la monarchie : modèle humain. L'humanisme et ses dérivés juridiques - Droits de l'Homme etc... - ont mis fin à des sociétés dont "l'humanité" est calquée sur le souverain royal. Le monarque est le paradigme de toute humanité, son histoire quotidienne, le modèle de toute histoire quotidienne du royaume. Lorsque "cela" s'accomplit de telle façon chez le Roi, il convient d'en prendre exemple, quel que soit le caractère particulier du souverain. Les Huns prenaient exemple sur Attila, les Britanniques d'aujourd'hui suivent le feuilleton des princes et princesses afin d'en prendre de la graine. Surtout d'y trouver une garantie de la légitimité de leurs propres choix. Le divorce de Charles est un chef d'oeuvre de communication et vaudra sans doute plus de sympathie à la famille royale qu'une stricte application des codes victoriens.
Dans ces relations entre souverains et peuples, (en fait, quel que soit le souverain, même prétendu démocratique ou républicain) il doit y avoir des récurrences inattendues : l'un doit imiter l'autre
et vice et versa.
Faut-il mépriser les peuples qui s'ordonnent sur leurs monarques ? On le peut, à la condition de prendre pour référence la République telle qu'elle est définie par les Conventionnels de la Montagne : la Constitution est l'arme de la liberté. Toute arme de liberté est arme de l'aventure. Or, l'aventure s'oppose à l'imitation et elle est individuelle. L'homme assume une solitude dont la monarchie le débarrasse. Voilà ce que sont les Anglais et tous les peuples non républicains, des pleutres. Une lâcheté qui se nourrit de la symbiose animale et du soulagement de voir là-haut ce dérouler les mêmes petitesses qu'ici-bas. Pour défendre cette médiocrité collective, collectivisme dont on ne parle jamais, on est prêt à tous les courages.
Le malaise français actuel provient de l'isolement de plus en plus absolu de son modèle. Pour l'instant rien n'indique que Mitterrand a réussi sa mission européenne d'exporter la République.
Samedi, 13 Août 1994
JOURNAL DE BORD ORIGINAL ECRIT SUR LE VOILIER "NADINE" SUIVI DE COMMENTAIRES.
Passé la nuit chez Françoise (+Dorothée et Nathalie).
Pris possession de "Nadine", Gibsea 372 chez Pupel. Bonne impression générale. Sentiment de sécurité.
Chaud. Nuit difficile.
Je découvre une réalité familiale fort proche de ce qu'on pourrait considérer comme le "main stream" social, le Français moyen, aux prises avec tous les problèmes du siècle : couple - mon frère et ma belle-soeur vivent séparés, mais sans divorce formel - Françoise cache une vie solitaire sous les dehors de son ancienne vie de barmaid, dans les boites de la Côte d'Azur. Bof, désespoir caché avec sa fille un peu handicapée. Fascinée à heure fixe devant l'écran de la télé et la tête bourrée de projets directement antinomiques à ses capacités physiques. Nathalie perd la vue et veut faire de la photographie. Adorable malgré tout, elle veut remonter un courant imaginaire dans une famille qui n'a jamais songé qu'à remonter le long des flux d'argent Mais tout cela respire quand même une certaine "viabilité", certaines " normes" restent inscrites. J'ai revu la vieille table du bureau de mon père, de l'Empire trônant dans un capharnaüm qui va de l'art nègre à la table de salle à manger alsacienne de mon grand-père. On sent un monde brisé qui ne veut pas sombrer tout à fait. Dans une même pièce on trouve un ancien Paris, celui de Napoléon, l'autre Napoléon alsacien, le grand-père, les rogatons "artistiques" des nègres qu'on a soigné comme le ferait Schweitzer, un mode vie à base de grandes surfaces Casino et de programmes de TF1. Quel bordel de vie. Ressemblons-nous à cela ? Dans des rayonnages de bibliothèques, il y a même Saint-Simon, oeuvres complètes en édition de luxe. Il y a dans la tête de mon frère des ambitions refoulées avec soin. Beaucoup de soin, un défaut contracté au contact de la famille Biringer. Je ne comprend rien, mais je vais revoir ce frère douloureux dans quelques semaines, à l'occasion du 8O ème anniversaire de l'oncle Paul, le plus jeune Alsacien de cette famille Picasso.
Dimanche 14 Août 1994
Continuons la prise en main de "Nadine". Longues explications sur l'amarrage du bateau. Réglons problème de l'auto !
13 heures : arrivée de Françoise, Dorothée et Nathalie pour une sortie en direction de St Tropez. Vent Force 2-3. Sortons tout. Cap 220, vent debout. Très beau.
Incident de point d'écoute : le noeud du point d'écoute se prend dans le curseur de la barre d'écoute qui est très mal réglé , oubli de ma part. On affale et on repart. Demi-tour vers la rade de Fréjus. Plus de vent. Moteur et rentrée au port difficile, je ne connais pas les réactions de "Nadine" en marche arrière. C'est une cata mais ça passe. Belle journée. Faisons connaissance avec les Edouards. Décidons de partir le lendemain pour la Corse.
L'incident du point d'écoute est profondément humiliant. J'ai l'impression de ne rien connaître à la voile. Il arrivera la même chose plus tard à Calvi avec le curseur de la barre d'écoute de grand-voile, mal réglé également à cause des nombreux chocs essuyés par ma tête sur la bôme que je suis incapable d'éviter en remontant du carré. La voile est un véritable métier, sans doute le dernier (ou le premier ?) que j'apprendrai véritablement et totalement. Sans cette maîtrise il ne peut pas y avoir de vrai plaisir, c'est à dire de véritable communion avec la vague et le vent. On ne peut pas faire ressortir dans la matière les flux tumultueux de l'âme ni recevoir en retour le salut spirituel de l'univers. Ce serait dommage, il faut travailler
Lundi 15 Août 1994
Préparatifs de départ fixé vers 15-16 heures. Météo prévoit un vent de force 2 à 4. Ce qu'il nous faut mais il ne sera pas au RDV de la traversée.
Départ 16 h. Doublons le Cap du Lion. Réglons voile sur vent debout. Obligés de prendre un cap 90° au lieu du 119 prévu. Vers 17 h 3O Iles de Lérins, plus de vent. Moteur, cap 120, mer d'huile, glumide.
Lucas s'éclate à la barre de 18 à 20 h, puis se couche crevé.
Nuit sans histoire. La Med = autoroute de voiliers. 2 Dauphins vers 2 h du matin. Un voilier nous salue vers 3 h, il passe à deux encablures.
Même phénomène que lors de notre aventure en Avril. Aucune crainte, aucune angoisse, malgré cette "glumidité", sorte d'ambiance surréaliste parce qu'inconnue sur terre. Imaginez un lac fait d'huile, une brume qui n'en est pas une, une sorte de halo blafard sur l'horizon, une chaleur moite et un bruit de moteur qu'on finit par ne plus entendre. Le silence en plus, donc. Des heures de barre passent sans le dire. On va, comme dans la vie quotidienne, sans savoir où ni comment, dans un feutrement du réel en vérité difficile à supporter.
Mardi 16 Août 1994
Myriam me rejoint sur le pont au lever du jour. Rectifions le cap après mûre réflexion, nous avons dérivé vers le Nord. Cap 127 (puis 134 pour finir 141 devant Calvi).
Arrivée-cata à Calvi. Des dizaines de bateaux qui vont et qui viennent, je panique intérieurement. Ext : sang froid et décision.
Finalement nous mouillons dans la rade. Soirée dramatique pour moi, je suis au bord de l'épuisement. Le débriefing très fouillé et très intéressant n'y change rien. 3 fois 0,125 Halcyon (comme le Dieu du vent) et ciao.
Je me souviens d'avoir été agacé par le manque de sens poétique des enfants. Indifférence au spectacle de la découverte de la terre. Pourtant la Corse mérite le déplacement. Il n'y a pas eu assez de peur dans tout ça, pas assez de valorisation par la terreur de l'absence. Cette traversée n'est qu'un hors d'oeuvre devenu sans intérêt. Il faut aux hommes de grands déserts pour qu'ils puissent à nouveau savourer la terre ferme. Entre l'idée et la matière il doit en aller de même, le désir de l'un pour l'autre passe par la peur. Maman ! Au secours !
Mercredi 17 Août 1994
L'annexe est comme prévue : un coule à pic. Edouard est arrivé la veille au soir et nous répare tout ça (le moteur). Avitaillement en fuel/essence etc...
Le passage de l' isolement total (le port, la technique, le ravitaillement etc...) à la situation de relative autonomie me comble d'aise. Je commence à respirer. Un énorme steak vient boucher le dernier trou noir de mon angoisse. Pupel est à la mesure de tous ses bateaux, un vieux roublard qui flotte malgré tout.
Une certaine animalité s'installe. Base : la hantise des stocks de survie. Eau, énergie et aliments. Ca fait du bien, on oublie toute une pile de strates inutiles d'autres soucis. La vie se simplifie au fil des "vaches" qui se vident sans qu'on sache pourquoi, ce qu'on finit tout de même par découvrir, tant la question paraît vitale. Alors qu'elle ne l'est pas vraiment : on vit sur des récit de manque qui n'ont pas cours sur le moment. Comme nos prédécesseurs sur "Nadine", nous laisserons des quantités de bouteilles de Volvic intactes à notre arrivée. Mauvaise intendance. Mais aussi anarchie des utilisateurs. Bref, il faut d'abord en passer par le vrai manque pour découvrir l'art de l'intendance. Jeunesse dorée, va.
Jeudi 18 Août 1994
Vent force 4, mauvais temps annoncé. Nuit difficile. Cata à 7 h, Nadine dérape, se paie le voisin qui sauve tout après trois quart d'heure de boulot, plongée comprise. Suite dans le port. Les souvenirs reviennent de comment on a fait
tous les pleins.
Rebelotte pour l'ancrage. Connard, puis quelques heures de paix. Pourvou qué ça doure...
Longues explications avec Lucas qui a vécu les différentes catas comme s'il ne se passait rien.Vers 17 h sérénité retrouvée, je suis mort...de faim et de tout le reste. Vais-je dormir cette nuit ? réponse demain.
Nuit : l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hier soir, Edouard nous a ramené au port, un nouveau mouillage extra, il a tout fait.
Las ! Réveil brutal, nouveau dérapage (le 3ème), panique, lazzis et franche camaraderie. Deux mondes se côtoient dans la plaisance : les marins et les autres. Les autres se prennent pour des marins et rigolent face aux pépins des voisins. Les marins ne réfléchissent pas, ils viennent prêter main-forte. Merci Guénolé et Koukaï (?).
Ces notes ont été hâtivement jetées le lendemain. Entre-temps j'ai compris que les lazzis et l'aide provenaient du même bateau. Nous avons rencontré les "marins" du "Guénolé" le lendemain dans le port de Calvi (Mon dieu comment ai-je pu laisser Nadine seule au mouillage ?!!!!!) et notre enthousiasme à les remercier semblait les coincer. Plus tard dans la conversation il est apparu que l'impression que j'avais eu pendant les événement était juste : ce sont en fait les mêmes qui se foutaient de nous avant de venir nous aider. L'excuse est venue faiblement avec invocation de libations bachiques. Bref, ce qui ressort de tout ça, c'est le mélange qui s'opère dans la psychologie des gens "de mer". Finalement, ce qui compte c'est que le sens du "devoir" prend toujours le dessus. Mon manque de prudence par rapport aux problèmes de mouillage (une question que j'aurais du bosser à fond à partir des données de Nadine, bateau trop lourd pour une ancre et une chaîne beaucoup trop légères) me vaut ces retours de bâton. Mais nous n'avons pas été les seuls à déraper, moralité : quelles que soient les conditions du matériel, il faut tenir compte du vent et s'il le faut, mettre deux ancres, ce qui nous a valu la seule belle journée sans soucis.
Vendredi 19 Août 1994
1ère journée à Calvi sans histoires. L'ancre a tenu. J'ai quand même filé 10 m de chaîne supplémentaire pendant que Myrie, Lucas et Elise faisaient les courses au SuperU. Quand même un petit naufrage avec l'annexe, rescapé par une vedette de mafiosi : panne d'essence ! Edouard et Christian m'ont bouffé un demi-plein !
Retrouvé les Guénolé après une soirée au Santa Maria. Retour au Nadine à minuit sur une mer d'huile. Demain ?
J'ai passé sous silence une expérience troublante. A peine seul sur le bateau, pendant que les autres faisaient leurs courses, un rideau s'est déchiré, un immense plaisir m'a envahi, une sorte de condensé de repos. J'ai bu un verre de bière en écoutant à plein tube le Messie de Heandel. Enivrement léger, léger... Comme si l'épuisement général se résolvait soudain, disparaissait par nécessité pour me permettre d'assumer ce qui allait venir après. Et Dieu sait qu'il a fallu assumer. Equilibre ou économie immanente : les muses me protègent juste ce qu'il faut pour accomplir l'impossible. Parce que le destin ne parle que quand il veut ?
Le courage n'existe pas en tant que valeur personnelle : il est un défi constant à la troisième force, la force invisible, celle qui ne veut pas que les choses arrivent dans un ordre qui n'est pas le sien. Autrement dit, l'audace, c'est défier l'existence même d'un ordre. Le général qui reste indifférent aux balles sur le champ de bataille s'essaye au destin. Après tout si la foudre doit me frapper maintenant, c'est aussi bien. Comment éviter de ce faire accuser, alors, d'avoir une "foi" ? Il y a un moyen poétique, celui de faire état d'une fraternité avec l'univers, ou avec le mouvement de la réalité. On doit être frère de ce qui s'accouche comme évolutions, comme mouvements formateur du réel. La raison poétique est la seule créatrice parce qu'elle partage son savoir avec la matière, elle admet une altérité absurde des choses, une mêmeté d'étance entre des êtres apparemment différents par toutes leurs qualités.
Samedi 20 Août 1994
Nuit sans. Quelques heures le matin dans le cockpit.Les Guénolé ont l'intention de faire Iles Rousses, mais le vent est très fort. Nous faisons (mal) de la voile dans la rade. Faiblesse : pas de coordination par manque de connaissance de base. Autre : le bateau est une vache, il ne remonte pas à moins de 50° et... ne vire même pas ! il y a un lézard. Il faut tout vérifier : les voiles, les curseurs, le safran. Qui va faire tout ça ? Couscous de Lily.
Le lézard était pourtant gros : la barre d'écoute de grand voile avait été légèrement déréglée pour éviter la bôme en sortant du carré, mais le pire était que les palans de l'écoute étaient grippés par le sel ! La bôme ne partait pas assez vite, et le virage ne "prenait" pas. Bateau ankylosé, équipiers ignorants du langage marin et sans bras. Galère. Ah les débuts en voile !
Comme skipper, il faut cesser de déléguer quoi que ce soit. Il faut trouver un moyen pour être dans tous les acteurs à la fois ou bien tout faire soi-même. La voile c'est d'abord un langage. Sa réduction au sifflet est la perfection à condition d'avoir la patience d'apprendre le code. On pourrait alors comparer la conduite d'un bateau à l'opération du cerveau, l'émission de signaux nerveux qui provoque des réactions automatiques. Exaltation des équipes de courses ou de régate où ce mode de fonctionnement opère. Il y a d'un côté des automatismes aveugles, sans intervention du skipper, et puis de temps en temps, le cerveau est contraint d'intervenir. C'est pourquoi le skipper doit rester un "cerveau", ne rien faire de physique, garder toutes ses capacités d'estime et de perception des situations globales. Le cerveau agit en cas d'obstacle. A méditer en fonction des productions dites "intellectuelles"...
Dimanche 21 Août
Fort belle journée. A défaut de voile, nous faisons du plaging sur bateau, ce que les enfants trouvent parfaitement à leur goût. Myrie et moi réalisons tout seuls ce que nous pensons être le mouillage du siècle, allons rechercher les enfants qui ont Calvisé dans l'après-midi. Pris un pot reposant au Café du Port (on prend nos habitudes), musardé le long des pontons et, après retour au Nadine "superbement" ancré, nous finissons la journée sur le Guénolé avec Michel et Martine, charmants. Sujet unique de conversation : le bateau.
Las ! nous dérapons une heure plus tard (ou croyons déraper - tout dérape parfois partout) et nouvelle et cruelle galère. Lucas fait la démonstration de son sens de la mission et nous éclaire avec la torche au milieu des centaines d'embûches qui traînent dans la rade. Myrie et moi accostons et amarrons Nadine à.... la pompe à fuel sur les 2h du matin. Je m'étends dans le carré, proche de l'épuisement total... Mais je ne perçois pas vraiment d'épuisement réel. Si Myrie n'avait pas peur, tout irait mieux.
Je me perds en conjectures sur les raisons de ce refus radical de notre ancre à crocher correctement. Le seul mouillage qui a tenu était celui que nous avions effectué avec 2 ancres, mais quel boulot pour ressortit les deux masses enchevêtrés ! Bof !
La réponse n'était pourtant pas difficile. Notre ancre faisait 12 Kg , le bateau 9 tonnes ! A part la roche, il n'était pas possible de mouiller en toute sécurité avec ce cure-dent. De plus, ces ancres charrues sont vicieuses, elles se retournent avec le fardage et il faut plonger régulièrement pour vérifier si elle tient dans le sable. Bref, les voiliers de locations c'est pas le pied, quand on ne prend pas ses précautions au départ et quand on ne mobilise pas toute son expérience. La marine ne tolère aucune paresse.
Lundi 22 Août
Réveil en fanfare : 7h15. Il n'y a pas de fuel (refrain connu à Calvi : le camion est en route de Bastia), on veut nous faire payer 200 F pour le bout de nuit passé à la panne ELF. On verra....Plus tard : pas payé. Vaguement insulté ! Bof.
Départ 16 h. Cap 301 Fréjus. Vent NE : nul.
C'est beau la Corse. Mais le fonctionnement des ports frise le scandale. Lorsque nous sommes entrés au port à deux heures du matin, les balises verte et rouge étaient éteintes !...En arrivant sur Calvi dix jours avant, nous n'avions pas réussi à voir et identifier le fameux phare à éclat, portant, selon la carte, à 23 milles ! Etait-il branché ? Le temps était parfaitement clair, brume de beau temps, mais pas de brouillard.
Curieuses sensations en Corse. Il doit y avoir un partage occulte entre les points d'atterrissage et les points de ravitaillement. J'ai bien constaté qu'on renvoyait systématiquement des bateaux à moteur vers d'autres ports pour se ravitailler en essence. Pourquoi ? Impossible d'admettre qu'ELF ait construit des citernes trop petites pour contenir à peine pour deux à trois heures de distribution. Même impression quand je vois un ferry embarquer une fois par semaine des milliers de touristes. Pourquoi faire entrer des monstres pareils dans un port aussi étroit que Calvi, alors que Iles Rousse est construit spécialement pour les gros ? Etrange, mais pas incompréhensible. Les 5 ou 10 000 touristes qui embarquent Jeudi, arrivent mercredi soir à Calvi et dépensent leurs derniers sous. C'est, comme le disait Guénolé, le Jackpot. Il faut partager, entre régions, entre clans, entre familles. Il faut le savoir et ne pas se laisser surprendre.
La Corse est un rythme à prendre, et alors tout va bien. Pas fait pour des touristes pressés.
Mardi 23 Août
Nuit de navigation impeccable (voir NAVE) Atterrissage sans faute sur Fréjus à 12 h 3O. Avons recherché l'entrée du port confondu avec celui de ST Raphaël.Une nouveauté perso : le pilotage automatique. Fabuleux. On peut faire de la voile au maximum. Peu de vent. Assez pour hisser et affaler 5 fois, le tout avec bourrage de winch de merde. Je commence à me sentir bien dans mes godasses de voileur.
Arrivée au quai de merde, vent impossible, marche arrière inexistante à la manoeuvre. Dieter Schmitt nous sauve la mise. Longue conversation le soir (il est cameraman à la ZDF !) sur le bateau des Schmitt. Très sympas. (comme les autres).
¨Ponton, repos, eau douce, sécurité, calme, bonheur insupportable. Frictions nécessaires, la psyché a toujours du retard sur le soma. 3 fois 0,125 Boum !
Dieter Schmitt est le propriétaire du Feeling que nous avions loué en Avril et avec lequel nous avions, Myrie et moi, essuyé une tempête géniale sur les cinquante derniers milles entre Fréjus et la Corse. Malgré la fin peu glorieuse de l'aventure, le bateau s'est couché et je me suis fracassé la colonne vertébrale de l'autre côté du carré, nous avions apprécié ce bateau, fonceur et stable. Le knock-down était du à l'inexpérience de Myrie. La 7ème vague qui vient de derrière sans s'annoncer...
Bien dans ma peau de voileur : je ne pensais pas vraiment aimer la voile, plutôt le fait d'être au milieu de l'océan, loin des terres. Or, j'ai pris un plaisir intense à manipuler en même temps les écoutes de génois et de grand-voile, sans me préoccuper du cap, prenant les risée millimètre par millimètre, chargeant au maximum pour prendre toute la vitesse. Il se passe quelque chose d'étrange et de très jouissif dans le silence à peine troublé par les chuchotements de l'étrave. On fait corps avec le mouvement, tout le mouvement, celui de la mer, du vent et de soi-même. On est, pour la première fois, intégré à son propre mouvement, intimement lié au changement. Expérience métaphysique. Il faudra y revenir.
Mercredi 24 Août
Réveil 8h30 : le corps ne répond plus que par soubresauts douloureux. Deux cafés, ça va un peu mieux. Achat de short + débriefing général avec Myriam. Les cordages sont au clair sur le pont de l'existence. Choses à ne pas négliger de refaire autant de fois qu'il est nécessaire : la parole
sert à quelque chose.
Puppel est venu, a vu et vaqué. Il reviendra demain, nous rempochons les 4500 francs de la cata du Feeling. Ce n'est que justice. (Tiens, j'ai mis deux P à Pupel ! allez savoir pourquoi ?)............
Tout va maintenant recommencer. Quoi faire ? Sur le port de Fréjus il y a un bateau qui nous fascine et qui est à vendre. Magie Noire est superbe malgré son cul un peu disgracieux. Ce Belliure 41 est à vendre pour environ 900 000 FF. Où trouver les sous ? Nous allons rêver, pour rien, pendant quelques jours, et puis passer à autre chose, autre bateau, plus abordable. Dans les semaines qui vont venir nous allons passer par tous les stades du cauchemar de la passion marine : plastique ? bois ? alu ? acier ? OUI OUI OUI acier. "Bateau" en est plein d'occases. Allons-y, jusqu'à ce que le vent nous inflige autre chose, quoi ? Sais pas.
Lundi 3 Octobre 1994
C'est l'horreur. Je n'ai rien à dire. Je me sens tout juste agité par quelques petites vaguelettes ridicules. Intuition muette. Je me sens digéré. Par qui ? Serait-ce la fin de quelque chose ou une simple mue ? Ma tête ne produit plus que des schémas de bateaux. Je construis. Voilà sans doute l'explication de ce silence de l'âme. Et pourtant, jamais je n'ai été aussi près de la lumière, du secret de la manducation universelle des êtres par l'être ou dans l'être.
Il y a eu un gros coup de tabac pourtant, long, douloureux et difficile en fin de compte à traverser entièrement. Vichy me poursuivra toute ma vie : toutes les formes de son horreur iront me dénicher où que je sois. Depuis 1946 je n'ai plus de paix à cause de ce bordel historique que fut l'occupation. Mais merde alors, on semble aujourd'hui se hausser sur des échasses morales ridicules et d'une arrogance sans mesure. Pourquoi notre siècle échapperait-il au Mal, aurait-il une vertu particulière pour ne pas être coupable de tout ce dont sont chargés les siècles précédants ? Merde alors. J'ai toujours refusé d'admettre que l'homme soit ceci ou cela. Bon, mauvais, tout ça conte à dormir debout. L'homme est ce que JE suis, et ceci est valable pour chaque homme vivant. DONC : chacun sait à quoi s'en tenir sur lui-même et les autres. S'il fait des faux procès c'est qu'il est lui-même coupable. SEULS CEUX QUI SAVENT PARDONNER ONT UNE CHANCE D'ETRE INNOCENTS. Mais aux yeux de qui ? Merde.
20 Octobre 1994
On a bien avancé. L'étude de la Chine antique nous enseigne beaucoup de choses. On pourrait résumer l'histoire des hommes comme une sorte d'ordonnancement de la pourriture ou de la boue que forment les générations qui se succèdent dans les tombes. Le culte des ancêtres - ce qui nous manque aujourd'hui quasi totalement et qui montre à quel point nous avons perdu le sens de l'humain ou de son rôle, peut-être même l'idée d'un rôle - c'est bien ce lissage du temps humain dans un sens totalement laïque. Au fond les Chinois sont les seuls habitants de la planète à avoir su ruser avec la religion. Pas étonnant qu'un système intellectuel comme le communisme ait pu les enthousiasmer et provoquer ce que nous interprétons a posteriori comme ceci ou comme cela. Les Chinois sont des "hommes entiers", au sens où rien n'a entamé leur orgueil d'être des hommes.
C'est pourquoi il faut toujours à nouveau refonder l'idée des droits de l'homme. Chez nous, en occident elle repose sur de fausses bases, ou du moins insuffisantes. Les chrétiennes. C'est à partir d'une transcendance que s'établit pour les "humanistes", l'idée d'une spécificité et d'une nature sacrée de l'homme. Pour les athées une telle démarche est inutile, ils posent l'homme dans leur espèce sans se poser de questions autres que celles qui se posent naturellement, c'est à dire sans passer par un conte de fées religieux.
La différence aboutit évidemment à une toute autre conception de la barbarie. Les Grecs et les Romains étaient sans doute assez près du sens chinois de la
civilisation, la cassure provient donc bel et bien du Proche-Orient, berceau du monothéisme et de l'avilissement de l'homme de sa condition naturelle. Hier encore, le pape Jean Paul II a lancé ses foudres contre le bouddhisme. Pourquoi le bouddhisme en particulier ? Réponse : il ne s'agit pas d'une religion, mais d'une civilisation, d'un humanisme naturel qui n'a nul besoin de divinité pour fonder l'essence de l'homme.
Le Proche-Orient, région sensible de l'histoire contemporaine. L'une des dernières où coule le sang pour des raisons .....religieuses.
Lundi 14 Novembre 1994
Je sens chaque jour davantage combien il faut que je change ma vision des choses. Changer de vision, sans changer. Sans doute ce changement de vision s'opère -t-il de toute manière, sans que j'ai à m'en préoccuper. Mais cette fois c'est différent. Il faut que je cherche, que je travaille un nouveau point de vue. Et tout ce qui va avec le travail va avec l'homme, ou vice-versa, ce qui va avec l'homme va avec le travail : mon point de vue ou ma vision risque de n'être pas autre chose qu'une nouvelle opinion sur les hommes, c'est sans intérêt.
Pourtant il faudra bien que j'y vienne, que j'élabore les choses, les plus hautes, par le truchement de la question humaine. C'est peut-être de n'avoir jamais vraiment tenté de le faire que je me suis attiré cette sorte de stérilité sociale dont je souffre. ON sait que je suis en communication avec les dieux, on est bien obligé de respecter cela comme on respecte la gent religieuse, mais pas plus.
Mardi 15 Novembre 1994
"Au moment où je vous écris, nos jours s'écoulent". Rancé, cité par Chateaubriand. Or, devant moi une sorte d'éternité. Mon avocatier ne bouge plus depuis des mois, c'est à peine si ses feuilles prennent quelque couleur. Il y a une éternité partout autour de nous, nous sommes dans une éternité, le grand art est de la capturer, ou de la capter, c'est mieux dit. La retourner vers nous. Bernard, le père de Myrie est gravement atteint d'un cancer. Il pourrait tenter cette opération de capter l'éternité, mieux que tout autre car il a déjà compris une partie du problème avec son concept de destin.
Vendredi 16 Décembre 1994
Je reviens à l'histoire de l'Occident. Hier j'ai lu un de ces articles qui fleurissent en ce moment dans la presse allemande, et qui s'adressent aux intellos jadis marxistes. Sans doute sont-ils écrits par des ex-marxos, car on ne peut pas acquérir cette sorte d'intimité avec la théorie qui va jusqu'aux concepts "récents" comme ceux de Lucaks. Or, ces ex-marxos font précisément le ménage des concepts. Entre autre, le concept d'histoire tel que Hegel le lègue à Marx.
Toutes ces histoires ne m'intéressent plus depuis longtemps, car la théorie, une fois pour toute, a sa vie ailleurs que dans les ratiocinations des philosophes ou des obsessionnels de la vie théorique. Pourtant, je suis et reste fasciné par l'ensemble historique que constitue l'occident et quelques aspects de l'originalité de son développement.
Donc je dois écrire pour élaborer un peu les choses.
Un : l'occident a une histoire qui tourne autour de la papauté. Canossa est un mystère qui possède sa puissance d'explication, mieux, le décret papal Venerabilem (1202) éclaire (ou obscurcit, cela dépend du point de vue) le tour que vont prendre les histoires régionales et nationales qui vont désormais constituer, volens nolens, un tout. L'Europe d'aujourd'hui est, sans appel possible, non pas une mosaïque de nations, mais une mosaïque de régions plus ou moins soumises à Venerabilem. Exemple frappant : l'Angleterre, la zone la plus hostile au papisme est aussi la zone la plus opposée à l'idée européenne.
Il y a, derrière l'histoire rapide de l'économie et de la guerre, une histoire plus lente de la maturation de l'athéisme : l'Europe d'aujourd'hui n'en est pas ENCORE au niveau de la Chine des Han !
Cela ne signifie rien en terme de déclin ou de développement. Pourrait plutôt indiquer qu'il reste du chemin à faire hors de toute idée de sinusoïde historique, les hauts et les bas à la Toynbee. L'Europe reste empêtrée dans un infantilisme radical hérité du bassin méditerranéen. En regardant une fois de plus Alexandre Nevski, j'ai été frappé par le mystère qui entoure la relation des Allemands (les nazis) et les envoyés du Pape. Eisenstein est tout à fait honnête. Il ne met rien en scène qui puisse éclairer le spectateur sur la nature de cette relation, hormis la simple complicité, le message communiste athée. Mais sur l'objectif ou l'efficace de cette complicité on ne perçoit rien, aucun message : les religieux sont là, simplement en complément des chevaliers nazis. On pourrait avoir, de la part d'Eisenstein, avoir voulu peindre la logique ou l'identité de la notion de barbarie et de celle de religion, mais ça ne marche pas vraiment. Seule allusion, les prêtres sont choisis avec des physionomies sémites : paradoxe complet par rapport à la situation URSS - nazisme. Ou peut-être subtile allusion à une opposition déjà évoquée par Dostoievski dans l'Idiot, entre la chrétienté orthodoxe et l'autre, la foi innocente et la romanité terroriste en "oubliant" l'origine commune, le monothéisme né en haute-Egypte.
On avance pas très vite sur cette voie. Comment saisir le "charnel" de la communauté des chevaliers et des prêtres. Comment comprendre de quelle manière ils se complètent au point de provoquer Canossa. Peut-être en passant par les théories de Marx et de Nietzsche, mais l'opium des peuples ou les valeurs ne rendent pas compte du "terrain" lui-même, là où ça se passe. Peut-être suis-je fasciné par une image (fausse, aussi fausse alors que celle que présente Eisenstein) de l'ecclésiastique. Le curé de ma paroisse n'a sans doute pas grand chose à voir avec les prêtres du 12 ou 13ème siècle. Cette image suggère une passivité sociale difficilement compatible avec la puissance réelle de la papauté. J'ai pourtant l'expérience des "soldats" du Christ, les Jésuites. Or, justement, Ignace de Loyola a créé son ordre pour compenser une perte de la puissance temporelle qui mettait sur un même rang féodaux et prêtres.
On n'avance pas vite sur ce chemin. On pourrait fantasmer sur l'alliance nécessaire entre force et faiblesse absolue, c'est à dire qu'il n'y aurait pas de puissance ou de pouvoir efficace s'il ne s'accompagne d'une extrême faiblesse, ou de l'exhibition de quelque chose comme son contraire. Cela éclairerait le christianisme sous un jour tout nouveau : il n'a jamais été, n'est et ne sera jamais qu'un outil du pouvoir, ou son envers. La figure du Père telle qu'elle apparaît dans l'Evangile raconte bien quelque chose de ce genre. La Passion illustre, non pas le point zéro (Hölderlin) de l'humain, mais l'acmé de sa volonté de puissance, interfaçant Dieu lui-même.
Cette explication est banale, paraît-il.
Soit. Il reste que pour ma part, cela m'aiderait à négocier ma haine de la charité et de tout ce qui représente ce concept ravageur par les temps qui courent : ONG, Assoces, SOS ceci, SOS cela.
Retour au politique : les Asiatiques ne paraissent pas dupes. Ils amalgament évidemment, à juste titre ou pas, les Droits de l'Homme et Christianisme. That's the question : nos fameux Droits ne sont-ils que l'arme secrète de la bourgeoisie chrétienne arrivant au pouvoir ? Je renvoie à plus haut, au texte sur la Chine. C'est délicat.
Dimanche le 18 Décembre 1994
Il faut que je m'exprime tantôt sur l'Europe. Il faudra que l'un de ces jours-ci je le fasse en exténuant la question : pourquoi plutôt l'Europe que pas, pourquoi les petites nations d'Europe doivent-elles disparaître au profit d'une entité fédérale ou comme on voudra la nommer et la structurer ? D'ici que je réponde à toutes ces questions - je concède qu'elles sont un peu naïves au sens où la réponse est déjà donnée par d'autre facteurs que politiques : l'Europe EST DEJA faite - je m'en vais relire un peu mon Clausewitz, j'en ai besoin.
En tout état de cause et précisément en raison de la dernière remarque, je peux affirmer que la question ne se pose plus de savoir s'il faut choisir ou pas l'Europe fédérale, mais elle est de savoir s'il faut, maintenant, choisir de s'en retirer ou de s'opposer à certaines formalisations comme la monnaie unique et autres fioritures, ces sortes d'estampilles d'une situation au demeurant irréversible.
L'irréversibilité de la situation donne déjà une indication. Le choix que l'on peut faire aujourd'hui est l'alternative suivante : statu quo / épopée. Il serait proprement héroïque de tenter de ne pas confirmer formellement - la politique n'est-elle pas devenue la forme de l'économie ? - notre appartenance à une entité supranationale. Nous appartenons en fait à de multiples entités supranationales. Il n'est que de citer les multinationales et le marché unique européen, ou encore les croisements culturels, la mutation culturelle anglophone qui s'empare sans coup férir de tous les aspects de l'existence spirituelle. Pour l'Europe du Nord tout cela est chose faite. En cela, les derniers venus, les Scandinaves, sont d'emblée les plus européens de tous, les Allemands le sont un peu plus que nous et le seul paradoxe est que ceux qui parlent l'anglo-saxon, les Anglais, le paraissent le moins. Ce point sera donc médité en premier, mais d'abord Clausewitz. Bonsoir.
Lundi 26 Décembre 1994
La page 69 sera peut-être ce qu'on appelle l'une des "bonnes feuilles" de ces mémoires. J'ai, en effet, depuis ce matin, l'intention de cracher un vilain morceau. Thème : la liberté.
La douleur m'ayant une fois de plus réveillé ce matin tôt, j'ai dû écouter mon Culture-Matin quotidien. Le Dr Bougnon, je crois, un personnage suisse proche de Tanner et de toute cette pratique d'une gauche un peu gauche mais toujours très rusée parce que branchée sur le technique toujours le plus avancé.
L'occasion d'en finir avec certains atermoiements. Avec ces suées de trahison qui coulent de la bouche de la plupart de nos militants gauchistes ou humanitaires, à propos de la drogue. Ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres, mais il est parfait.
Je connais un homme qui se bat pour la liberté d'usage du haschich. Bien. Il est très acharné, très courageux et il milite exactement comme l'un de ces pacifistes du début du siècle, allant vieillir dans de beaux ouvrages du style "Les Croix de bois". Le docteur suisse est de cette trempe-là. Beau style et courage, avec une zone-frontière qui passe par la peur des drogues dures, et donc par la reconnaissance d'un certain droit à l'interdit social.
On parle de plus en plus de "dépénalisation" de la consommation de drogue. Et ces discours sont intéressants car ils n'ont aucune raison tactique ou stratégique d'exister, personne ne songe à passer à l'acte. Mais, il faut bien un discours qui laisse percer l'idée d'une liberté qui doit pouvoir s'exercer dans l'usage des drogues autant que dans celui de la parole ou de la "pensée". Bref, il faut donner l'illusion qu'il n'y a pas de tabou autour de la question de la drogue, mais rien que du raisonnable, discutable etc...
Or, il n'en est rien. La plupart des hommes d'Occident et d'Orient vivent sous une oppression permanente, un déni de liberté inimaginable, récent mais impitoyable, celui de consommer certaines substances de la nature, substance naturelles brutes ou élaborées par les arts traditionnels ou savants comme la chimie par exemple.
Peu me chaud la question de savoir comment les sociétés de jadis traitaient cette question : la liberté n'a qu'une histoire, c'est la sienne. Or je dois constater qu'au seuil du 21ème siècle - heureusement que je ne suis pas dupe de ces sortes de considérants de pure rhétorique, chrétienne de surcroît - les hommes s'interdisent mutuellement de cultiver, de commercialiser, de vendre et de consommer de certaines substances, sous certaines formes ou d'autres, produisant certains effets avec aussi peu d'universalité que tout ce qui a pu se déclarer universel c'est à dire scientifique en notre bon langage métaphysique bien classique.
La question morale de l'existence de ce tabou est de première importance. Elle permet de s'interroger sur la "rationalité" ou la "naturalité", ou bien encore sur le mélange des deux, rationalité ou naturalité qui déterminent les comportements de l'animal humain. Le "il va de soi" de l'interdit sur les drogues dures, par exemple, pourrait être classé parmi les instincts qui, à l'instar de celui qui permet aux vaches de trier le bon foin du mauvais, nous conduit à éviter de nous empoisonner. La grande différence pourtant, est que les vaches ne paraissent soumises à aucun interdit social ou judiciaire, mais qu'elles délaissent d'elles-mêmes certaines substances pour d'autres sans se poser de questions. Certains vétérinaires expérimentés me diront que l'intoxication des vaches existe bel et bien. Je ne les contredirai pas puisqu'il apparaît tout aussi bien que l'intoxication par inadvertance touche les êtres humains selon une fréquence très stable dans les statistiques de mortalité. Il meurt environ trois mille Français par an des conséquences de telles inattentions.
Restons nous-mêmes attentifs à notre propos, faute de quoi nous risquons de l'empoisonner.
Nous pouvons donc déjà déblayer une partie du terrain : l'interdit ne s'établit pas comme une fonction naturelle, le propre d'une telle fonction étant qu'elle n'affecte a priori que les individus. Il est encore bien trop tôt pour attribuer aux "fonctions sociales" un caractère naturel, quoi qu'en aient les sociologues ou les idéologues. Au demeurant, l'humanité ne peut, en aucun cas, se voir attribuer des "fonctions globales" de telle ou telle sorte, sans y prédisposer une instance extérieure, c'est à dire sans la priver de sa liberté, au moins de cette manière.
Dans cet ordre d'idées, on pourrait faire référence aux différents textes qui émaillent les structurations de certaines civilisations, ou disons de certains "peuples" (Je ne sais, hélas, toujours pas ce que veut dire ce mot de peuple). La Bible, le Coran, les textes védiques ou les classiques de la Chine démontrent combien les approches sont différentes. Au-delà de cette différence il n'est pas inutile de rappeler que chacune d'elle a donné de puissants mouvements de population. Ces derniers ont frappé l'imagination des historiens au point qu'ils les ont nommés des "civilisations". On ne peut donc pas discriminer tout de go, sans courir le danger de se voir accusé d'un centrisme quelconque.
De tous ces textes qui me restent un tant soit peu en mémoire, l'interdit de substance ne paraît que dans les livres Judéo-islamiques, et encore, il faut distinguer. Là où le Coran interdit toute absorption d'alcool, la Bible reste muette. Seules les interprétations ultérieures comme le Talmud descendent dans le concret des pratiques quotidiennes afin de les codifier.
Pour ce qui est des pratiques religieuses plus mal connues, mais non moins "sociales", qui régissent ou ont régi des "peuples" éloignés comme les Amérindiens ou les Indonésiens, on a également pu constater une codification de l'ingestion de substance. La différence avec les interdits coranique ou talmudique, est que cette codification ne vise jamais une interdiction mais indique le bon usage. Les traditions des Indiens du Mexique par rapport aux différentes substances psychotropes ne constituent pas une législation de leur usage, mais des recettes pour en tirer tel ou tel effet. On peut qualifier ces effets de religieux, pourquoi pas, mais cela ne change que peu de choses par comparaison avec une Loi qui suspend purement et simplement la consommation de telle ou telle substance. Un tel comportement peut même paraître aux antipodes de l'autre, puisqu'il prétend initier au religieux, alors que l'interdit d'alcool, par exemple, a pour effet l'exclusion de celui qui se rend coupable de "l'état religieux" lui-même, ou "état de grâce". On distingue immédiatement une relation intéressante par elle-même, car elle exhibe des approches diamétralement opposées de la question des drogues. L'une barre l'être humain de la grâce, l'autre la lui procure. Question de point de vue. La seule trace qui relierait d'une certaine manière les deux traitements, est simplement le fait du discours général sur la drogue, le fait que la drogue fasse problème ou donne lieu, chez les uns et les autres à souci commun.
Aujourd'hui, les choses se présentent tout à fait différemment. Du moins en apparence. Pourquoi ? Parce que la liberté a reçu un contenu délibérément ouvert sur l'essentiel : l'autonomie du sujet. Une seule limite tempère officiellement cette liberté, autrui. L'impératif catégorique est devenu le "milieu" moral pour ainsi dire indifférencié qui sous-tend à la fois nos législations pénales et civiles et à la fois notre estimation du bien et du mal.
Lundi 9 Janvier 1995
Entame d'une nouvelle année, le journal prend de la bouteille, en temps pur sinon en étoffe !
Le moment de poser quelques questions. J'ai commencé ce midi avec Myrie en demandant s'il ne convenait pas de changer radicalement notre fusil d'épaule. En fait, nous appartenons, elle et moi, à la partie des hommes qui, dans cette "société", mange les plus-values sans en produire. On peut toujours trouver quelque chose comme une utilité "marginale" aux services auxquels nous sommes affectés, elle et moi. Et donc, en termes économiques une valeur d'usage. Moi je produis un journal regardé par quelques pelés tous les soirs, Myrie "soigne" les âmes et tous deux nous contribuons à un peu plus de "stabilité" dans le système ou dans l'équilibre des forces. Mais ce sont précisément les systèmes "équilibrés" qui sont aujourd'hui en question, parce que ces systèmes n'ont, jusqu'à présent jamais joué le jeu honnêtement. Je veux dire par là qu'ils ont toujours alimenté leur propre équilibre par des déséquilibres qui produisaient et continuent de produire ailleurs ce que nous redoutons ici, à savoir misère et injustice.
Or, cette situation commence elle-même à vaciller parce que nos recettes ne sont pas éternellement monopolisables. On ne peut pas éternellement interdire aux pauvres de la planète de faire comme nous, d'accumuler du capital et de produire comme ils l'entendent, c'est à dire comme nos concurrents directs. Je trouve le procès de la contrefaçon très symbolique : pourquoi mettre en accusation des gens qui sont capables de produire les objets qui représentent la même valeur d'usage que les objets "authentiques" ? L'argument de l'imitation falsificatrice est aussi vieux que Platon, il fait toujours autant rire les philosophes. En gros le GATT (devenu entre-temps l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce ! Quel redondance ! Qui peut seulement imaginer qu'on puisse organiser sur le modèle de l'état et de l'institution judiciaire le commerce mondial ! Sinon des gens qui ont en vue l'instauration d'une véritable dictature de la marchandise, et encore d'une certaine marchandise.) se donne des airs de vertu en exploitant un aspect on ne peut plus négligeable de la problématique du marché mondial. L'imitation de Vuiton ou Cartier on s'en bat l'oeil, mais ce battage doit cacher les mécanismes qui se mettent en place et qui donnent à de nouveau directoires tout-puissants les leviers d'un protectionnisme planétaire, destiné non à protéger les nations ou les peuples, mais les TERRITOIRES DES MULTINATIONALES. Je me souviens avoir toujours professé que les nations auront, un jour ou l'autre, toutes le raisons d'être débaptisés au profit des noms des marchandises elles-mêmes, des marques ! Les USA devraient depuis longtemps s'être scindés en deux empires, l'un pourrait s'appeler Coca-Cola et l'autre porterait le nom du concurrent direct. Mais sans doute le privilège de garder le nom générique restera aux nations qui sauront imposer leurs marchandises aux autres.
Je suis retombé insensiblement dans mes fantasmes habituels. Fatigue. A demain.
Mercredi 11 Janvier 1995
Enfance parfois effleurée dans un demi rêve. Pépite de réalité. Récompense.
Il faut cultiver une grande arrogance envers tout ce qui prétend se mesurer à ces moments-là.
Temps creux. Le curseur palpite sous mes yeux et rien n'arrive. Arrive donc !!
Samedi 21 Janvier 1995
Me suis lancé dans un article destiné au FT. Sujet : histoire et nation, ou comment passer à autre chose. Montrer que l'économie et la politique sont -ou ont été - deux instruments d'un même processus de socialisation. Le politique tout seul, fut longtemps le moyen de masquer en permanence la fatalité du social.
Dimanche 28 Janvier 1995
Rien. Trop tard, nous allons acheter un gâteau. Se sucrer l'âme un peu...
Mardi 30 Janvier 1995
France-Culture est à Strasbourg - une fois de plus - et moi je subis une épreuve d'effort aux hospices civils... Parade amoureuse comme avec Jünger. Jutta me téléphone l'autre jour pour m'annoncer qu'elle prépare un sujet sur le grand homme et qu'elle me réserve l'interview ! Preuve de ? Etrange comme les choses que j'aime ou que j'admire ne font que m'effleurer sinon m'éviter. Répétition de l'aventure du père que j'ai adoré ? La réalité se calque-t-elle sur un événement fondateur ? Aucune entrée au Paradis. No trespassing !
Jeudi 2 Février 1995
La vie sans art, ça ne va pas. Pas du tout. D'un autre côté, la vie veut ou ne veut pas d'art. Poule et oeuf : qu'est-ce qui est premier ? La structure "vie" qui aurait comme besoin d'Art ? ou bien, comme le disait Aristote, l'Art n'est-il qu'un "ajout", quand la vie en tant que telle est pleine dans son être, dans son entéléchie ? Alors l'Art se manifeste de lui-même, comme la beauté de la fleur. Ainsi notre existence quotidienne serait comme rythmée par des manifestations soudaine de beauté, entre des périodes désertiques. Par surrections ou résurgences selon une harmonie secrète, puzzle constant pour peu qu'on y prenne garde.
Le besoin d'Art est pourtant le schéma le plus répandu. A tel point que l'homme a fait un artisanat du beau. Pourtant, les civilisations où cet artisanat n'existe pas en tant que tel - les civilisations dites primitives - gèrent ce "besoin" tout à fait différemment. Chez les Fangs, l'artiste n'existe pas, ou plutôt l'art est, comme le bon sens, la chose la mieux partagée du monde. Le talent n'est pas affaire de jugement critique, le talent s'adapte à l'individu, au lieu que l'individu doive faire la preuve de son talent. On ne devient pas griot après une orientation qui dérive d'un jugement social, mais d'abord par l'âge et la nécessité de la permanence de la fonction. En Afrique noire, j'ai souvent eu l'impression que le beau naît de lui-même, collectivement, sans que la question du beau soit posée. En écoutant Beethoven, Simon me disait simplement : - c'est du bruit, Monsieur - et quand, le soir venu, le griot venait jouer son aubade, il s'asseyait avec nous et, muni de deux petites cuillères et d'un verre, s'occupait de la section rythmique.
Moi je le sens. Quand il y a besoin de musique ou de lecture ou de contemplation, c'est toujours la conclusion d'un temps "bon", pour parler vite. J'ai dit : "besoin" de musique etc... Dialectique amusante : lorsque la vie s'épanouit, elle crée le besoin de beauté, le désir, quoi. Peut-être y-a-t-il, pour les "artistes", une sorte d'épanouissement permanent, qu'ils ignorent eux-mêmes, qui leur permet de vivre avec la beauté comme objet tout en subissant la vie la plus quelconque.
Lundi 20 Février 1995
Fat. Le réel m'apparaît ce matin comme une grande fatuité. La rue Sleidan a un air "photographique". L'air humide donne une clarté translucide et leur contour précis aux choses. Des lignes pures d'immeubles verticaux. L'envie de peindre me paraît de cet ordre du fat. Il paraît que je suis déprimé. Il est vrai que je n'ai pas de goût en ce moment, de goût pour rien, lecture, écriture, juste des petites envies.
Le réel est-il fat ? Pourquoi ? L'avons-nous historiquement épuisé dans sa substance pour n'en laisser que le "baroque", vaste jésuiterie millénaire de la conscience apeurée ? La peur, encore.
Fat : la politique aujourd'hui est à pleurer. (ne l'a-t-elle pas toujours été ?) Mais elle contient pourtant des faits parfaitement surréalistes. La scission des gaullistes est un véritable mystère. Question qui se pose aujourd'hui : Balladur a-t-il préparé son coup de longue main ? Ou bien s'est-il saisi, comme on le pense un peu naïvement, de l'opportunité de ces saloperie de sondages ? A mon sens tout cela tient de l'autodestruction, Jospin devrait l'emporter haut la main : l'impossibilité du politique national entraîne l'impossibilité des droites. Pas des gauches, car en réalité ce sont les droites qui ont besoin d'idéologie, pas les gauches. C'est l'une des vérité que l'on va découvrir ces prochaines années.
Simple : la droite a besoin du mensonge pour franchir l'obstacle de la démocratie (du suffrage universel). Au dix-neuvième siècle on ne s'y trompait pas en conservant le cens. Mensonge = idéologie. Curieuse au demeurant : elle prône que l'économie ne peut marcher que par elle-même, ce qui est vraiment creuser la tombe du politique ...et donc des droites. Au fond, la mission des droites est aujourd'hui de liquider le politique. Comment peuvent-elles le faire sans l'appui de la souveraineté ? Contradictio in terminis finibusque.
Je viens de relire le texte qui précède. Etrange retournement, labilité de mes états d'âme ! Merde.
Dimanche 26 Février 1995
Chaque fois que je décide d'écrire je dois ouvrir une perspective. Pour quand vais-je aujourd'hui aligner des...mots ? ou des significations ?... Pour l'époque du vif ? Celle d'après le vif ? Pour le seul moment où je vais passer du vif au non-vif ? Bref. Au fond, je pense qu'écrire est vraiment le processus par lequel on commence à gommer les frontières entre le vif et le non-vif. Plus on écrit, moins on meurt. Cette constatation peut devenir un piège, on peut finir par s'enterrer soi-même avec des mots, sans doute. N'empêche que lorsque tout le monde sera conscient - les gens savent cela d'une manière confuse, ils pensent que l'immortalité réside dans la reconnaissance, ce qui est faux, l'immortalité est dans son soi à soi, c'est une affaire très égoïste comme toutes les affaires, comme tout le reste - de cette possibilité, il se passera quelque chose autour de l'écriture d'aussi important que l'invention de l'alphabet. Passage, usure du procédé ? Il faudra passer à autre chose, qu'il faudra avoir inventé et appris etc...L'informatique ? J'ai plutôt l'impression que l'informatique est le dernier avatar de l'écriture.
Je veux la paix ! Je veux me coucher dans le temps et pas courir entre ses obstacles. Ces années-ci on est devenu fou. On ne fait qu'avancer dans une bousculade générale qui va n'importe où, pourvu qu'on y aille. On a l'impression qu'il y a partout des adjudants du réel qui vous botte le cul pour vous empêcher d'exister. L'existence est devenu un luxe. Etrange retournement de situation. Je vais redevenir ce que ne j'aurais jamais du cesser d'être, totalement rebelle. Peut-être ça m'aidera aussi à comprendre mon fils et ce qu'
est être rebelle ! J'entends encore parler du "savoir" ! Quelle rigolade et quelle naïveté sans nom ! Le savoir, au nom duquel on ne peut que se ridiculiser, nous mène tous à l'abattoir.
Mercredi 1er Mars 1995
Ne pas oublier d'en finir avec le "monde virtuel" et toutes ces inepties. Il faudra énumérer péniblement tous ces changements de comportements à la maison, au travail etc.. décrire complaisamment ces êtres nouveaux "branchés" etc... On le fera plus tard Ciao.
Mercredi 8 Mars 1995
Déjà une semaine ! Il n'y a décidément plus de temps. Il gicle de partout, toutes les durites sont pétées, ça coule de partout dans le vide, le néant inconnu. On se demande à propos du temps la même chose qu'à propos des capitaux : où sont-ils, où vont-ils ?
Autrement dit, que vais-je écrire ? Rien. Les Edouards sont étranges et charmants. Leur maison de Gan est belle, grande et confortable, en harmonie avec des revenus de gens qu'on rencontre dans des ports de plaisance. C'est pas comme nous !!! Mais elle est froide. Il y a quelque chose de glacé dans l'ordre des choses qui révèle que tout ici a une place en fonction d'un événement déterminé et qu'il occupe cette place dans une stratégie d'événements à venir tout aussi déterminés. Chaque livre est estampillé par un "vécu" et toute la place qui reste est réservée à du vécu. Les Edouards sont des viveurs d'un genre moderne. Pas de luxe inutile, pas de "désarroi" dans l'espace. Cela n'a rien de rassurant, bien au contraire. J'ai l'impression que tout est sous pression, comme si le "vécu" était conçu ici pour sortir du néant comme de la chair à saucisse d'un hachoir. Voilà donc les personnes avec lesquelles nous sommes supposés partir faire une transat. Au fond, Edouard me rappelle beaucoup Francis Misbach. La même gentillesse souriante et calme, la même science du voulu planifié et ne s'embarrassant de données aléatoires que pour autant qu'elles pourraient amener un charme supplémentaire à un projet de toute façon calé par tous les bouts. Sans doute ira-t-il transater tout seul avec son copain Michel, j'ai l'impression que nous ne serions qu'un embarras pour lui. Nous le sommes déjà dans la mesure où nous avons réintroduit le problème de la présence de sa femme, ce qui ne fait sans doute pas partie de son scénario.
Une transat ? Sans doute pas ainsi. Ce serait du "déjà vu".
Dimanche le 9 Avril 1995
Nous sommes à deux semaines du rite septennal des présidentielles. J'ai de plus en plus de mal à comprendre cette forme de démocratie. Elle semble fonctionner sur parole dans un système d'où toute confiance a depuis longtemps disparu. Il ne faut pas y croire, mais une telle incrédulité est un piège ou une honte qu'il faut boire. Myriam veut quitter le vieux continent. Comme je la comprends ! Mais hélas, cela part d'une idée erronée selon laquelle il existe des aires humaines de meilleure qualité : la Nouvelle-Zélande ! Je suis sceptique car les choses ne se jouent pas de cette manière.
En gros, notre modèle secret est la République romaine : l'humain se joue dans la transparence (telle qu'elle a été interprétée par les exégètes et non pas telle qu'elle a eu lieu ! voilà le problème). Transparence du courage ou de la lâcheté, de la force ou de la faiblesse, de la production ou de la passivité, de la fidélité au rite ou du "péché". La manière qu'ont les auteurs latins et leur commentateurs européens de camper les "héros" romains est intéressante, mais très littéraire, je crains. Or, cette littérarité-là nous a formés, elle a fixé les objets seconds de notre désir, les buts déviés et simplifiés.
Le freudisme, au moins par l'un des points de vue qu'il permet, peut se définir comme un retour du "punique". Carthage a fonctionné comme le modèle repoussoir de l'occident : capitalistes sans foi ni loi contre la Ville de la moralité. "Découvrir" l'inconscient c'est le reconnaître comme étant. Reconnaître quoique ce soit comme "étant" est une manière de le légitimer plus sûre que n'importe quelle législation. Or, l'inconscient est par définition "l'aveugle", le ressort caché plus ou moins réprimé. Carthage fonctionne comme l'inconscient des Romains, la ville tunisienne peut même être considérée comme faisant partie des conditions essentielles d'apparition ou de naissance de Rome. La Ville s'est formée et définie contre Carthage l'impie.
Avec l'essor du libéralisme on se retrouve tous à Carthage, où se trouve Rome aujourd'hui ? Carthage, donc condamnés historiquement à la défaite. D'où ce sentiment de déclin, de fatalité inévitable.Or, à bien y regarder, Rome n'avait pas plus de chances d'échapper au destin punique : pendant sa deuxième guerre contre Carthage, le système démocratique romain s'est laissé aller à s'endetter en privatisant les moyens de lutte. Ce fut une transgression sans retour possible, sans doute le germe de l'Empire et des tyrannies. On confiait le principe de la survie à des intérêts privés avec des billets à ordre pour le futur. Au lieu de procéder par la contrainte communiste de la réquisition. L'aristocratie romaine n'était guère différente de celle de son ennemi dit "fondateur", elle préféra toujours les riches propriétaires fonciers à la plèbe. Au fond, l'Homme est un plouc.
Il ne reste qu'à continuer dans le rôle d'anarque, seul. La vie ressemble à une continuelle ruée sur un champ de bataille, si on recule d'un pas on est foutu. Le romain n'est plus que cette volonté de se battre régulièrement pour préserver l'ordre du Soi, ou préserver le Soi dans l'ordre qu'il a fini par intégrer. Tite-Live ne fait pas beaucoup de commentaires sur ses personnages, mais ce qui ressort le mieux de ses récits c'est l'opposition entre l'ordre "loyal" et la fourberie. Même si la politique de Fabius - temporiser pour affamer Hannibal - peut être considérée comme une fourberie, cette attitude se justifie toujours par la nécessité de vaincre. Qu' Hannibal soit un grand général lui-même piégé par la politique du panache moral ne justifie pas qu'on s'embarrasse de scrupules. Ploucs.
La campagne électorale française ressemble à tout ça : la nécessité de vaincre ne connaît aucun ridicule. Tout est bon pour "grappiller", le pouvoir est devenu un fond de commerce. Retour à la case départ.
J'ai, pour ma part, toujours eu cette sourde angoisse, le retour à la case départ. Dans l'obscure enfance d'après-guerre la vie était loin de se présenter comme la voie royale du confort pacifique et "humain". Je me souviens de la terreur et de ce sentiment total(itaire) de dépendre de la force physique. Je ne sais si tous les enfants ont cette représentation, mais il ne faisait pas de doute pour moi que la vie serait dominée par les forts et les brutaux. Comme je ne me sentais pas particulièrement courageux, j'ai pris très tôt des chemins de traverses et des résolutions extrêmes : l'échec et le suicide n'était pas seulement programmé pour moi par l'expérience familiale, mais toute la première partie de ma vie a consisté a résoudre ce problème de mon inadéquation aux données concrètes en planifiant une sorte d'évasion permanente. Je ne pouvais pas admettre le règne de la force. Celui-ci était une sorte d'injustice foncière dont le mystère même me révoltait. Parfois je me demande avec un serrement de coeur si mes premières démarches intellectuelles ne représentent pas seulement une sorte de trahison. Trahison qui se répète d'ailleurs plus tard lorsqu'il faudra légitimer réellement le refus de m'intégrer à la logique de la force en désertant. Il ne pouvait pas y avoir d'explication, il ne peut pas y avoir d'explication au fait de se soustraire à l'empire de la guerre. Le pacifisme abstrait est encore le plus sûr, et je ne m'y suis au moins pas trompé, les légitimations politiques viendront bien plus tard.
Qu'avais-je trahi ? Une idée, une opinion que m'avait sans doute instillé la guerre encore toute proche. Mais c'était l'idée première, la plus originaire, la plus précieuse pour moi. Aujourd'hui j'y retourne mais dans une disposition stratégique totalement différente : car entre-temps le combat a changé de visage. Dans le système actuel d'existence bord à bord des individus, l'honneur du combat prend de multiples figures. On mesure le courage et la rectitude des comportements à des enjeux qui dépassent de loin le ruée sur l'ennemi l'épée au poing.
Mercredi le 19 Avril 1995
D'autant plus, pour être raccord avec ce qui précède, que la force est aussi présente dans les choses intellectuelles. Non ? Au fond, il y a le même mystère dans la transmission patrimoniale des nobles des époques dites révolues, qu'il y a de difficultés à comprendre pourquoi les patrimoines intellectuels des classes dirigeantes semblent plus stables. L'éternel discussion sur l'inné et l'acquis, alors qu'il n'y a sans doute que de la force en tant que telle, non encore définie en tant que telle, ou bien non encore comprise telle qu'elle est inscrite dans le texte grec ou chinois ou encore bouddhiste.
Que serait cette force ? Cette force qui donnerait tout ? Depuis la simple subsistance jusqu'au pouvoir absolu ? L'ermite stabilisé dispose-t-il de la même force que le monarque ? Quel est la force de la souveraineté ? Illusion coagulée autour de la peur ? Force de regard, serais-je tenté de dire. Le regard est non pas ce qui découvre, mais ce qui produit. Les yeux, du corps et de l'âme, ne réalise pas un vision mais une création : correspondante à la force. Les Allemands disent Einbildungs
kraft : force d'entourer avec des images ! Ce qui signifie imagination dans la traduction généralement admise, or cette traduction évacue le problème de la notion de force dans ce cas. On en parle comme d'une certaine faculté, non pas d'un degré de savoir imager le monde, ce qui n'est rien moins que de l'habiller, à savoir le fonder dans sa matérialité perçue ! Non ? J'aimerais pouvoir me payer les oeuvres de Berkeley. J'ai un souvenir d'anciennes lectures très impressionnantes, aussi puissantes que Spinoza. Si je me souviens bien, le philosophe anglais voyait le monde comme regard, comme regard de Dieu, auquel l'homme participe plus ou moins. Au fond un idéalisme fort proche de celui de Spinoza et qui ne s'embarrasse pas d'un panthéisme au fond inutile. Le problème de la matière n'est pas intéressant par lui-même, il ne fait que recouvrir celui de la dualité, seul véritable problème philosophique. Ici la force devient participation au regard de Dieu, réplique exacte de la position de l'homme ordinaire face au regard du souverain. Participer au regard (à la vision ou à la pensée) du souverain c'est être du côté de la force. La force est laïque, ici. Elle est simple adéquation à une ligne, une direction.
Myriam va encore me reprocher de fuir au moment où j'allais parler. Parler de ma force, de ma faiblesse insigne. Or le problème est précisément de savoir si l'on a accès au savoir de sa force ou bien si l'homme est condamné au doute. Les candidats à la présidentielle n'auraient pas besoin de sondages s'ils avaient connaissance de leur force réelle. Celle-ci leur indiquerait immédiatement leur degré de participation réelle à la souveraineté. Elle leur dirait si leur "élan" correspond à la ligne du réel, à la politique réelle qui se joue dans les limites territoriales de la nation. Chirac pourrait triompher à l'aveugle, simplement parce que les circonstances politiques ont atteint un degré d'aberration correspondant à une nécessité. Par exemple celle du déclin de la France. Hic et Nunc.
Lundi 8 Mai 1995
Ca y est ! Chirac en a pris pour 7 ans sans qu'on ai eu le temps de souffler. Hier je n'ai même pas pensé à écrire une ligne là-dessus. C'est dire si événement me marque.
Sur le fond cela ne change pas grand chose. Depuis deux ans la droite règne et légifère dans la droite ligne de la droite, Chirac ne peut pas faire pire. Et puis je suis curieux de voir si par hasard nous n'allons pas assister à la naissance d'une figure, qui sait ? Je disais hier soir que Napoléon venait de la Montagne pour devenir Empereur; alors Chirac qui a une formation d'Empereur pourrait bien se hisser du côté de la Montagne pour s'assurer un règne durable. Maintenant qu'il est parvenu à l'Elysée, la seule ambition qui peut lui rester est de faire mieux que Mitterrand, et pour cela tout sera bon.
Seule question importante : peut-il s'en prendre sérieusement à la démocratie, c'est à dire au suffrage universel ? Tout le monde trouve cette idée ridicule, je veux bien, mais l'histoire est faite de véritables surprises et non pas de sondages !
Par ailleurs, le démocratisme de De Gaulle a toujours été de pure façade, pourquoi un homme qui a tous les pouvoirs, aujourd'hui, se gênerait-il ?
Le seul mystère, et le plus important, est la question de savoir si Chirac a vraiment ce qu'on appelle des idées ou, disons, un désir pour un objet de pouvoir. Que veut-il ? Voilà la vraie question. Mitterrand a déçu parce qu'il n'a jamais réussi à afficher un désir bouleversant. Il a fait des choses impalpables, en gestionnaire modeste, en jardinier de la France. Après le jardinier, l'architecte ? Mais pour faire quoi ? J'avoue ne pas voir où ce grand escogriffe veut en venir. Il y avait des choses qui me plaisaient dans ce qu'il disait. Une sorte de conscience assez claire de ce qui manque dans notre société, à savoir du nerf et des espaces de liberté réelle. Mais du constat à l'action "changeant les choses" il y a du boulot. Chirac connaît bien la civilisation chinoise, dit-on ; on verra bien dans quelle tradition il va s'inscrire : les confucéens ou les taoïstes. De Gaulle avait fini dans un état purement formel, Confucius n'aurait pas mieux imaginé, espérons que ce n'est pas l'idéal du mangeur de pommes.
En tout cas, pas question de pleurnicher sur les "acquis sociaux". Peut-être se battre à l'occasion, s'il s'avérait que Chirac n'est vraiment pas autre chose que l'homme d'un lobby, disons, libéral-anarchiste multinational. Enfin, j'attends en vérité une bien plus grande déception : qu'il ne se passe rien. Mais toutes les occasions sont bonnes pour remettre tout sur le tapis. Alors, wait and see.
Dimanche 14 Mai 1995
Charles Taylor, un nom à retenir dans le sournois débat qui oppose depuis quelques siècles l'esprit anglo-saxon - le pragmatisme utilitaire - et l'esprit dit "libéral", héritier de la Révolution Française. Article aujourd'hui dans Le Monde qui m'éclaire au plus haut point sur la tendance des anglo-saxons à encourager en sous-main une certaine forme d'intégrisme. Oh bien sûr, il ne s'agit que de percer les éternels mystères de la "décomposition" des sociétés et de trouver les remèdes miracles pour "alléger" la grande misère du monde ! Quel galimatias ! Pour ce monsieur Taylor, il faudrait tenir compte des "identités" secondaires ( que signifie "tenir compte" ? ) et indépendantes des cultures à vocation universelle. Attaque classique du jacobinisme et de la pensée du siècle des Lumières, ce qui me fait penser que les anglo-saxons n'ont décidément pas grand chose à dire ni à ajouter au débat actuel. Ils ne font que se répéter et ce qui est dangereux, c'est qu'il le font sur tous les registres : ils occupent tout l'espace disponible en appliquant leur recette pragmatique à n'importe quoi. Ils sont prêts à se servir de l'intégrisme le plus obscurantiste (le culte de l'identité régionale) pour faire semblant de s'attaquer à l'ultra-libéralisme des Républicains américains. En gros, protéger la moindre ficelle qui forme communauté pour sauver la cohésion sociale.
Et c'est là que le bât blesse : ces sociologues de merde ne pensent qu'à cette abstraction vide qui se cache derrière ce pseudo concept de cohésion. Cohésion de quoi d'abord ? La société, on sait depuis Marx qu'elle n'existe que dans les analyses délirantes de la société bourgeoise de Hegel et depuis les deux dernières guerres on a acquis la certitude que le vieux avait vraiment raison. Le déchaînement actuel autour des commémorations montre très bien qu'on ne sait plus quoi faire pour conjurer cette vérité que l'homme n'a jamais réussi à former quelque chose comme une société. Monsieur Taylor procède donc ainsi : il nous fait croire que ça a existé, puis il se demande comment préserver ce qui reste de ce fantasme, et sa réponse est un autre fantasme, les identités "marginales". Putain, si les Alsaciens vont pouvoir justifier leur connerie par leur "identité" de merde, il va quand même falloir agir pour échapper à ce tableau.
Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ces vertiges de bêtise ? Sans doute quelque chose de très dangereux, le manque de colonne vertébrale à la culture d'outre- Atlantique, au fond cela même qui menace nos propres contrées, l'absence d'humanités gréco-latines. Car, les Anglais nous tartinent toujours avec la Révolution Française qu'ils n'ont toujours pas digérée, en oubliant que les principes qui ont guidé les législateurs à cette époque étaient pour ainsi dire calqués sur ceux de la République romaine et des conceptions les plus pures des Grecs. Je ne sache pas que les bons penseurs affiliés à Bacon ou à Berkeley renient d'une manière ou d'une autre cette culture-là. Or c'est ce savoir élémentaire-là qui disparaît dans ces opérations de recyclage des lambeaux de cultures "marginales". Mais putain qu'on le dise si on ne veut plus ressembler à l'homme mais à des termites qui ont construit ici plutôt que là leurs termitières.
L'effet Le Pen une conséquence perverse de ce Taylorisme-là ? Très certainement, pour autant qu'il ne s'agisse pas simplement du même résultat de la même culture du vide.
De plus, ces idées-gadget véhiculent un conservatisme puant : elles signifient grosso merdico que si un crétin se sent bien dans son cercle de Cibistes il n'y a qu'à financer la Cibi pour stabiliser au moins ce crétin-là. Au fond, tout arrêter dans l'immobilité des désirs immédiats et dans la pauvreté des finalités imposées pas le marché au lieu d'être imposées par la dynamique de la conscience libérée par la culture. Le sentiment moral n'a jamais été compris sous cette lumière : ce n'est pas un mystère implanté par une divinité, comme le laissent croire Kant et Rousseau, mais c'est le résultat d'une discipline militaire de pensée. La culture n'est pas un ornement de l'esprit mais le moteur qui le met en mouvement une fois pour toutes. L'âme doit être séduite, littéralement séduite par la logique impitoyable de l'universel. Dans l'histoire présente, cette séduction s'opère ou non et l'histoire dépend entièrement de la réalisation de ce préalable à toute humanité. Alors, hein, les amours de coins de rue, dégagez ! Je me sens devenir stalinien pour de bon, mais comment faire autrement devant les vagues de monstruosité qui se profilent devant nous ! Comment la "société" a-t-elle pu tolérer un instant les propos de Le Pen ou des autres crapules politiciennes. Car ce qu'on oublie toujours, par manque de cynisme (autre acquis de la culture gréco-latine), c'est que ces canailles ne poursuivent que des buts personnels, des ambitions engraissées par leurs névroses. Le Pen n'a qu'un seul désir, celui de devenir le tyran de la France et de régler de cette manière son problème personnel devant la mort. Combien de tyrans ont sacrifié des peuples pour se tailler un cercueil sur mesure ! Ah les pyramides et le monothéisme !
Lundi le 15 Mai 1995
Une remarque qui m'intrigue cependant. Un démographe qui analyse les résultats du FN constate que les scores se confirment surtout dans les zones de passage ou de grande circulation comme le Rhône, le Rhin, la côte d'Azur etc...Cette remarque-là ne semble pas absurde car elle recoupe ce qui peut caractériser les banlieues. A savoir que là où l'urbain et le rural sont absents en tant que tels, là où la ville subsiste sous la forme démographique sans pour autant être une ville (c'est toute la problématique de la centration des lieux de "vie") il n'y a pas non plus de campagne. Le problème identitaire ici n'est donc pas celui d'une origine commune, mais celui de la construction d'une communauté vivante avec mémoire, histoire présente et projet. Les banlieue sont sans histoire, exactement comme l'étaient les campagnes au Moyen-Age. Les zones de grande circulation comme les vallées des grands fleuves ont les mêmes caractéristiques : leur population sédentaire est confrontée en permanence au flot des voyageurs et des marchandises. On peut dire que leur substance est continuellement drainée par le mouvement "nomade". Le spectacle du nomadisme contemporain est l'un des mystères de la déréliction sociologique moderne puisqu'il s'agit d'une prescription du futur : les gens savent que leur mode de vie est obsolète, mais en même temps ils y ont tout investi. Ils ne peuvent vivre que sur le mode du dépit. L'exemple le plus frappant est la réaction des riverains des nouveaux modes de transport comme le TGV : il est insupportable de dormir à côté du rêve.
Le lien logique avec le racisme est clair. Il ne s'agit pas d'un racisme "racial", mais d'un racisme sociologique qui peut désigner n'importe qui de sa vindicte.
C'est en cela que le comportement des partisans de Le Pen est très voisin de celui des nazis; il ne fait pas de doute que ce phénomène qui concerne des "zones" de la France d'aujourd'hui peut se retrouver dans une analyse fine de l'Allemagne d'entre les deux guerres. Cette époque est marquée par une redéfinition de l'unité allemande, c'est à dire que l'ancien nomadisme resurgit pour retravailler en profondeur un projet contradictoire, celui de fixer nationalement des habitants confrontés avec la matérialité du futur nomadisme : autoroutes, aéroport etc... On pourrait presque dire que l'Allemagne d'entre les deux guerres est une immense banlieue. Là aussi, le nomadisme "génétique" des Juifs devient tout naturellement le bouc émissaire de l'histoire. Au fond, les Allemands des années vingt tentent avec un certain ridicule d'en finir avec la germanité antique, alors que les Juifs montrent avec éclat que ce projet est absurde, les témoins deviennent gênants.
Pour en revenir à nos Allemands, on pourrait presque penser que le rêve du grand Reich d'Hitler est la démesure d'un peuple qui ne SAIT PAS PENSER LA NATION. Par défaut de révolution et par manque d'expérience. Le système constitutionnel fabriqué après la guerre par les alliés pour l'Allemagne expulse d'ailleurs à nouveau l'Allemagne de son "national" pour le refouler sagement dans ses Länder. Bien vu de la part des anciens adversaires, mais aussi un jeu dangereux.
Mardi 16 Mai 1995
Mouchka est morte hier soir vers six heures. Triste événement. Cette chatte était ce que j'ai vu de meilleur au monde, on aurait dit une sorte de chrétienne primitive tant elle suait la bonté et le manque d'agressivité. Un volonté de toujours être présente pour nous même quand elle était au plus mal. On ne peut pas dire qu'elle ait eu un vie de rêve et pourtant elle n'a jamais manifesté le moindre dépit. Je ne suis pas près d'oublier le miracle de Mulhausen. J'avais prévu, par un savoir intuitif des animaux, que Mouchka, qui avait disparu, ne reviendrait qu'au tout dernier moment. Dont acte in extremis alors que nous allions grimper dans notre 2O5 avec seulement Circé. Toute une parabole à laquelle il faudra encore réfléchir longuement, mais une autre fois.
Mercredi 24 Mai 1995
L'avocat est sauf.
Lundi 29 Mai 1995
Alain Parrau demain à la maison. J'ai presque terminé la lecture de son Ecrire les Camps. Il va falloir que j'en parle ! Qu'en dire ? Alain a toujours choisi la Poésie. Il a donc écrit, en poète pour la Poésie, une sorte de leçon de chose sur la littérature des camps sur les camps et sur je ne sais quoi encore. Bref, le concentrationnaire hic et nunc transparrau (sic!). Le souvenir que j'ai de ce garçon est assez clair. Il est mou et obstiné, donne parfois l'impression de céder sur une question alors qu'il dissimule un désaccord total, se méfier de ses rires. C'est un faux-cul assez charmeur mais stérile à mon avis. Il a repris contact avec moi depuis que je figure au générique du 8 1/2, mais cette époque correspond étrangement avec l'époque où il a commencé à donner ses épreuves à son éditeur.. Sa Thérèse a du le persuader qu'il était bon pour lui de sonner aux anciennes portes. Bof. Mon rapport avec son bouquin reflète assez bien mes rapports avec lui dans les années 8O. D'abord une sorte d'enthousiasme pour une belle apparence de sérieux souffrant, timide et intelligent. Et puis, avec le temps, une impression animale de volonté qui cache son objectif. De même, le livre d'Alain cache son but. Mal. C'est dommage car il est brillant dans la matière, même si la construction pêche gravement. On en parlera sans doute différemment que je ne le pense aujourd'hui. Quien sabe ? Il faut en tout cas que je lui reparle de mon ancien projet télévisuel sur sa poésie et sur sa lâcheté à passer à l'action. Il y a sans doute là-dedans toute son ambiguïté personnelle à propos du poétique...
En revanche je sais le plaisir que je prends à dévorer Verbatim II. On en reparlera...Le reflet de l'exercice du pouvoir est largement suffisant pour enivrer le véritable amateur. Ce qu'écrit donc Attali est sans prix. Il suffit de s'embarquer dans son journal pour sentir son coeur s'oublier dans un rythme littéralement cosmique. La même impression, mais de qualité beaucoup plus fine, que celle qui prévaut devant le déroulement de l'AFP ou de DPA. Sa vanité personnelle est à peine gênante, l'exposé relativement sec est le seul domaine dans lequel ce pied-noir a appris les bonne manières, mais ça ne trompe pas, le personnage principal c'est lui et non pas Mitterrand...
Mardi 30 Mai 1995
Terminé le pensum de Parrau. Perplexe. Je ne comprends pas grand chose au dessein d'ensemble de cet immense "travail". Je sens la problématique personnelle d'Alain - son débat avec la poésie et son "utilité sociale" (ou comme on veut dire) - mais pas de percée théorique sur la question. N'aura-t-il travaillé que pour "payer" ses frasques poétiques ? Ce serait ridicule, autant élaborer poétiquement le "camp" de la vie aliénée sans se poser de question !...Y-a-t-il même quelque part une ou des questions à ronger pour plus tard ? Celle par exemple du rapport entre la littérature et l'engagement politique - question partout présente et jamais posée "littéralement" -, ou encore celle de la valeur du littéraire opposé ...à quoi ? Tout cela ne figure qu'en filigrane, comme on dit, mais ne reçoit aucune réponse qui soit de nature à élargir la question. Alain aurait pu aboutir, par exemple, à la question plus vaste entre Littérature et Mythologie, fonction et évolution de l'une ou de l'autre.
On reste dans un boitillement entre des analyses de textes, certes lumineuses (il faut reconnaître qu'il sait lire) et des énoncés lyriques sur ce qu'il n'arrive pas à théoriser sur une échelle suffisante, à savoir le
pouvoir du poétique ou son essence...Si vous avez envie d'aller y voir, ça s'appelle Ecrire les Camps, Belin 1995. Mais c'est dur...
Toute cette lecture me fait du bien, mais va encore me faire écrire. J'ai l'idée précise de faire une autobiographie circonstanciée de ma désertion. Trois parties.
1) De la décision jusqu'au fait. 2) Le séjour en Europe. 3) L'Algérie et le retour. Le livre d'Alain aura eu le mérite de me souffler un style ou une rigueur d'écriture qui se profile déjà comme le plaisir d'écrire. C'est ce qui manque sans doute le plus dans l'analyse d'Alain, c'est le plaisir des auteurs à écrire, quelles que soient les opinions des uns ou des autres sur la validité, la valeur ou la fonction de leurs écrits. On ne trouve que ce qu'on cherche, c'est là tout le malentendu de la "science"....
Mercredi 31 Mai 1995
Parrau n'a pas résisté à me tirer la barbichette à propos d'Heidegger, mais il a trouvé un calme plutôt plat. Je n'étais pas disposé à m'énerver, il a donc fait chou blanc. La querelle n'est pas sans intérêt car il y a une sorte de mystère pour moi dans l'acharnement sur des broutilles. Je pense que l'attachement aux formes provient de ce que l'on n'a jamais expérimenté le fond : ceux qui reprochent à Heidegger ceci ou cela n'ont, primo : aucune expérience du pouvoir, sinon ils comprendraient qu'Heidegger n'aurait jamais démissionné de son rectorat s'il avait été de mèche avec le pouvoir. Deuxio : ces mêmes bons esprits n'ont jamais souffert dans leurs corps d'aucune manière pour surévaluer à ce point les attitudes symboliques. Ils devraient tous faire un peu de droit pénal pour concevoir à la juste mesure ce qui différencie intention, expression et acte.
Autre intérêt à ce débat, mon attitude. Je n'arrive pas à me scandaliser. Ai-je quelque chose à protéger qui serait de l'ordre de mes "convictions" ? Je ne le pense pas. J'ai bien résumé ce que je pense à ce sujet, hier : Heidegger est l'individu par lequel est passé un événement de pensée qui a coïncidé avec d'immenses événements d'histoire. Comment cette coïncidence serait-elle un simple fait de hasard ? Nous sommes aussi cette histoire, et je crois que la pseudo fidélité d'Heidegger au nazisme n'est rien d'autre que sa fidélité à ce jeu parallèle entre ce qu'il considérait comme un bouleversement de pensée et le destin de l'occident. Il y a sans doute, et je l'ai dit, de l'enflure, une certaine religiosité agaçante dans ces expressions, mais il ne faut s'en prendre qu'à nous-mêmes si nous ne sommes pas capables de garder notre sang froid par rapport à l'histoire contemporaine...Mais comment ? Le seul qui manifeste un tel sang froid serait Jünger, qui a un regard de géologue sur les strates du temps et ses failles soudaines. Et l'éthique, dira-t-on ? Or on oublie la plupart du temps que l'éthique est toujours affaire d'individu et non pas de théorie, de volonté et non pas de logique. L'éthique ne se traite pas au plan des états, mais à celui de chaque être humain qui se retrouve aux prises avec un choix et qui le distingue : encore faut-il distinguer la possibilité, l'existence et la qualité d'un choix. Affaire de culture et d'éducation. Il y a des hommes qui ne savent même pas qu'on peut choisir ! Voilà qui éclaire d'un jour nouveau les mouvements de masses.
Il me reste maintenant à définir le style dans lequel je vais me remettre à écrire. C'est amusant de donner de l'importance à quelque chose. Ecrire est donc important. Allons-y !
Encore un mot sur le problème de la vitesse d'exécution. Beaucoup de destins on dépendu, dépendent et vont dépendre de ce paramètre abstrait, la vitesse d'exécution. On comprend le mieux cette idée lorsqu'on pense à l'état de guerre. Dans ces temps il faut : produire vite, courir vite, recharger vite son arme, etc..et tout cela sans se tromper. En mer aussi lorsque le vent se met à souffler, il faut agir vite et enfiler les actions sans erreurs. L'existence elle-même est un milieu où il faut savoir prendre rapidement un ris, notamment dans les relations avec autrui.
La vitesse est une certaine contrainte à l'aveuglement : pour réaliser vite un mouvement ou un geste, il faut prendre un risque, celui de le rater. Il faut donc précipiter le rythme normal (mais qu'est-ce que la norme dans ce cas ?), introduire un certain tremblement dans ce qui demande, à l'apprentissage du moins, une stabilité, une sérénité qui n'est plus de mise dans l'urgence. Il faut aussi rattraper par une multiplication des gestes les ébauches ratées et les gestes intermédiaires qui échouent. Cet aveuglement devient un nouveau milieu de l'action qui élimine des aspects qui entourent le déroulement normal d'une action. Ainsi la guerre, encore, qui lance en quelque sorte les peuples dans une course de vitesse, autorise aussi l'abandon de toutes une série de comportements sociaux, éthiques ou religieux, au nom de l'efficacité. On "peut" oublier tel aspect de l'existence parce que l'urgence exige de raccourcir le délai qui sépare deux moments vitaux de l'action. S'il faut attaquer Lundi matin, il n'est pas question d'aller à vêpres Dimanche soir ! Les choix aussi doivent se raréfier car le temps manque pour l'hésitation. La vie doit donc s'appauvrir sous l'injonction de la vitesse. Napoléon, et Hannibal avant lui, avaient compris et dû leurs succès à cette décision. Hannibal, en particulier, ne fignolait jamais. Il préférait ne pas achever une action, pourvu qu'elle s'inscrive dans une tactique qui étonne l'adversaire et le déstabilise. Pas étonnant que son principal ennemi ait été le temporisateur Fabius. Le Carthaginois n'aura échoué, en définitive, que par manque de synchronisation avec sa logistique, c'est à dire avec le ravitaillement provenant de Carthage, mais surtout la politique qu'il fallait mettre en oeuvre pour l'obtenir !... Frédéric le Grand admirait avant tout la force de décision et l'application qui doit s'ensuivre pour agir, mais cela ne pouvait fonctionner qu'avec un nombre de paramètres réduit. Dans la guerre technique, il y a trop de réquisits d'ensemble, le décisif sera donc, non pas l'application à l'effectuation d'une seule tâche, mais la capacité à synchroniser de multiples fonctions. Ajoutons qu'en ce qui nous concerne, tout cela n'est pas propre à la seule guerre, mais bien à notre existence elle-même. L'existence, aujourd'hui, ne pourrait plus être intelligée comme elle le fut même par Sartre, dans une position quasi immobile. Aujourd'hui il faut décider au jugé, en équilibre instable et en pleine vitesse. Il faut tirer un trait sur la contemplation, ce qui renvoie celle-ci dans le registre des actes poétiques.
Vendredi le 9 Juin 1995
Ecrire n'est vraiment pas, pour moi, un moyen de ponctuer les grands événements. Je suis propriétaire (sic) d'un bateau de 9 mètres et quelque depuis une semaine. Impossible de donner une dimension littéraire à ce nouveau statut.
Si j'écris aujourd'hui, c'est parce que quelques apophtegmes me trottent dans la tête depuis quelques jours.
Exemple : Il vaut toujours mieux rester fidèle à l'image qu'on donne de soi que de s'entêter à rechercher la perfection. J'ai essayé d'expliquer cette maxime à Myriam et j'ai découvert, ce faisant, qu'elle contient de bonnes occasions de faire preuve de finesse. Mais cela ressemble, hélas, terriblement aux platitudes de La Rochefoucault ou pire encore aux cuistreries de Peirce.
Lecture : Verbatim II suite. Mitterrand apparaît comme un homme "parfait". Il parle la vérité sur toute chose, et quand il ne le fait pas, il ironise ou lance des piques militantes. On lui ressemble tous un peu dans la manière de penser, sauf ce patriotisme qui a largement contribué à lui permettre de séduire suffisamment la droite pour gérer ses cohabitations jusqu'au bout. Mitterrand nationaliste ! Il fallait le faire. Hé bien c'est fait.
Pourrais-je, un jour, me mettre au clair avec cette aventure "de gauche" ? Quels espoirs en 81, pour quel résultat ? Au fond tout s'est plutôt bien passé pour moi. L'arrivée de la gauche a juste suffi à déblayer les obstacles qui m'empêchaient de mettre les pieds dans le service public sans que je ne sois pistonné d'une manière ou d'une autre. Les socialistes de ce même service public m'ont systématiquement pris en grippe, la droite s'est calmée après m'avoir mené la vie dure pendant des années. Au total je suis resté seul et ça marche quand même. A vrai dire je ne nourrissais pas d'espoirs personnels en 81, tout était encore trop confus et je n'avais pas d'ambition politico-médiatique. Je n'attendais pas non plus de miracles au plan politique proprement dit. Je m'étais inscrit en 80 au PS à cause de la politique militariste de Giscard, une politique reprise plus discrètement mais identiquement par Mitterrand... C'est le seul domaine où j'ai vraiment été cocu sur toute la ligne. Pour ce qui a suivi les années 88, c'est surtout Gorbatchev qu'il faut remercier. A ce propos il apparaît aussi, dans le livre d'Attali, que Mitterrand n'a pas eu beaucoup de nez pour juger Gorby, moins en tout cas que Kohl. Avec un tout petit plus de vision, il aurait pu faire de jolis coups avec les soviétiques, mais le vieux était trop encroûté dans les représentations courantes de la Réalpolitik. La vraie générosité reste toujours inaperçue dans les opportunités qu'elle offre.
Samedi 10 Juin 1995
Quelque chose avec les objets. Une fleur c'est une idée. Les choses prennent une autre identité avec les réseaux médiatiques. Elles apparaissent sous un nouveau jour : "leur vrai jour"... A revoir Foucault. La réduction à deux dimensions est une sorte de dynamitage de la raison concrète, on se "rend compte" de la vanité de l'objectivité et de la fumisterie de la "profondeur" / perspective...Il n'y a rien "derrière". L'homme rêve son destin, selon la force de son imagination.
Ame crevée ou esprit ouvert à l'univers ? Qu'est-ce que l'univers ? L'universel ?
Je vois au loin une séfarade à perruque. Etrange image. La femme semble refermée sur elle-même, ronde. Emmitouflée dans ses représentations rassurantes, ou autre chose ? Il faut trouver une réponse à ces questions de différence si criante.
Au travail. Moi, je parle. Comme disent beaucoup : tu parles tu parles, tu ne sais faire que ça. Soit, mais je regarde aussi, et j'ai l'impression que la femme séfarade,
ne regarde pas. Elle ne me parlerait pas, ça c'est sûr. Elle ne pourrait pas "ratiociner" sur tout et sur rien car il n'y a pas de moteur. Elle ne semble pas avoir besoin, de besoins. Il y a comme une automaticité de son comportement, avec un petit air de gaieté permanente, elle regarde le trottoir avec une petit sourire continu, sans hiatus, un petit sourire, tout petit, à peine perceptible, un peu comme si elle parlait quand même à quelqu'un d'absent. Un chuchotement qui s'adresse à un panorama de vie dont elle seule connaît les contours. En fait, ce qui se rapproche le plus de la femme séfarade c'est la femme enceinte, cette béatitude non dissimulable, branchée sur un canal de vie invisible, sur un au-delà de satisfaction auquel personne n'est convié. Sans doute même pas ses proches.
L'intégrisme doit fonctionner sur ce mode. Mais comment intégrer la dimension d'intolérance, de violence ? Judaïsme et Islamisme ont quelque chose de fondamentalement différent, tout en fonctionnant pareil : il n'y a, dans la vie, ou dans l'existence, rien à chercher ailleurs que dans...quoi ? Sa reproduction au calque des perruques et des robes qui tombent sur les chevilles ? Du dos légèrement baissé vers l'avant et du sourire jocondesque ? Il y a peut-être dans le sourire de la femme de Vinci quelque chose de la femme sépharade : rien dans les yeux, tout dans la bouche. Les femmes arabes de stricte obédience ne montrent jamais qu'un oeil - on peut supposer que pour l'autre, le visible, elle sont châtiées quotidiennement. On doit penser que Dieu a puni la femme en lui collant des yeux.
Tout ça est encore très descriptif. Je parle, je parle. Il faut opérer un passage qui permette l'idée. Ame crevée : nous autres occidentaux, aurions mis nos âmes "en perce". D'un côté cela aurait eu pour effet de laisser entrer de la lumière dans ce réduit caché ; de l'autre, si l'on se réfère à la métaphore photographique, la lumière pourrait avoir brûlé l'intérieur de l'âme, et donc l'avoir noircie. Les fous de dieu doivent voir les choses comme ça, d'où l'impossibilité de tout retour en arrière, ou plutôt la fatalité de notre "perte" à leurs yeux. Nous ne sommes pas récupérables.
Bon, donc on en revient à l'idée d'une pureté initiale. Je n'arrive pas à imaginer cette pureté. Ce mot, d'ailleurs, est lui-même un mot "crevé". Plus de contenu depuis mon enfance pour avoir trop servi aux manipulations. Il ne reste que quelques images naturelles, comme une fleur fraîche, une jeune animal ou une eau "pure". L'eau ! Voilà une piste. On sait que les musulmans sont très obsédés par la propreté corporelle, quelque chose d'aussi obsessionnel que l'hygiène à l'américaine. Dans le christianisme, l'eau a été happée par le symbolisme, le baptême est une sorte de toilette initiale - comme pour la plupart des religions - et sert aussi à se purifier avant les cérémonies religieuses. Pour les musulmans c'est beaucoup plus concret : on se lave vraiment avant chaque prière, on se torche avec de l'eau - et non pas du papier - pas question de laisser traîner la moindre crotte. Ca, ça doit donner de l'arrogance ! Quand je me souviens du mépris qu'avaient l'habitude d'afficher nos anciens pour les gens sales ! D'ailleurs le racisme passe toujours par un rejet - ou une simple monstration - d'une supposée saleté. Titre : Le propre et le sale. Dans les camps de concentration tout était sale, mais le lavage ou la purification (illusoires) était l'un des moyens les plus sûr pour survivre psychiquement. Rites, rituels, on n'en sort pas.
Mardi 13 Juin 1995
Le texte qui précède m'a valu une très mauvaise journée. Myriam s'est sentie quasi frustrée devant le portrait de la Sépharade ! Elle semble absolument vouloir que les choses aillent mal entre nous. Eternel. Comme s'il y avait une nécessité naturelle à cette compulsion. Il ne faut pas grand chose, ici-bas, pour se sentir puni.
Mélancolie certaine. Je me sens de plus en plus incapable de mener tout de front. La vie c'est cela : mener une foultitude de choses de front sans se poser de questions. Et surtout en ne perdant aucun temps à recoller les morceaux qui ne cessent de se briser. La nature, pourtant, semble m'avoir doté de cette particularité ou de l'infirmité de ne pouvoir isoler les divers aspects de l'existence, de la perception, des affects et de l'intellection. La souffrance m'est à chaque fois totale, elle englobe tout mon horizon. Résultat, je ne peux pas rendre compte à chaque fois de l'impuissance qui me saisit à cause de cela pour autre chose, sérier les causes et les effets, accorder à ceci cela et à cela ceci. Quand c'est la joie ou un bonheur qui m'envahit, c'est pareil, mais personne ne songe à m'être reconnaissant des retombées qui en jaillissent. Seuls les chagrins et les peines sont "reconnus" dans leurs effets pernicieux sur l'ensemble du comport. Pour vous être comptés en mauvaise part de votre être.
Cessons de gémir à la Chateaubriand. Cela pourrait avoir un côté obscène, non ?
Le romantisme est-il obscène par définition ?
Les Schopenhauer et autre Cioran sont fatigants. Je le sais bien et le proclame haut et fort. Il n'y a rien à sauver de ses plaintes soi-disant métaphysiques sur l'inanité de l'existence. Il y a trois mille ans les Chinois se complaisaient essentiellement à chanter ce désespoir totalitaire sur la brièveté de la vie et la fugacité des instants de délice. Mais les Chinois sont bien de ces peuples qui chauffent leur cuisine avec toute sortes d'épices, qui ont besoin de chocs émotifs et de drogues diverses pour supporter cette vie qu'ils regrettent dès que la vieillesse vient jeter une ombre de mort sur leur avenir. Alors comment soutenir cette contradiction ? Chaque moment que passe quelqu'un comme Cioran dans l'existence est un instant volé à sa propre conscience, volé aux autres mêmes à travers un discours qui exigerait en réalité un suicide immédiat. Qui dégueule la vie doit s'en rayer lui-même au plus vite, faute de passer pour un fou ou devenir un délinquant. On me dira qu'il n'a pas choisi lui-même de venir au monde ! Quel argument de basse cuisine, de chimiste positiviste ! La venue au monde n'exige pas qu'on en célèbre l'incroyable privilège, du moins demande-t-elle qu'on ne s'attarde pas sur les causes de ce miracle et qu'on en fasse procès à ceux qui en sont les auteurs. Il y a d'ailleurs une autre contradiction chez ceux-là qui écrivent pour les autres des "messages" urgents et grandiloquents et qui critiquent radicalement la venue au jour de la vie et l'existence de l'existence. Qu'ont-ils à sauver et comment veulent-ils prétendre à délivrer des messages utiles ? Au moins les cyniques grecs avaient-il de la tenue dans ce domaine. Ils ne prétendaient pas éditer des ouvrages ou des système sur l'infamie de l'existence. Ils se taisaient ou bien se comportaient comme s'ils allaient mourir dans l'instant qui suivait sans s'occuper d'autrui. Autrui ne peut pas avoir de place pour des messages (payants) de ce type. On dira aussi que lire ces pessimistes peut consoler paradoxalement ceux qui n'arrivent pas à ce degré de pessimisme ! Pourquoi pas, après tout, tout est dans la nature. C'est ce tout-là qui manque précisément chez les pessimistes.
Samedi 22 Juillet 1995
Chaque fois que j'ouvre ce fichier, je lis la brève introduction où figure l'engagement de n'écrire que "ce qui m'arrive" !... Il faut, bien entendu, lire : ce qui m'arrive de partout, y compris et d'abord de ma machine à cogiter.
Ma tendance à l'écriture faiblit. Question : serait-ce l'ennui ? Les événements ont-ils soudain été piégés dans un glauque répétitif ? Ou suis-je fatigué de vouloir laisser des choses inutilement noir sur blanc ?
La rencontre à Calvi de Peter et Kay, deux Australiens qui vivent sur leur bateau depuis des années, me suggère qu'une certaine époque (de ma vie) s'achève. Je me sens de plus en plus coincé dans une situation d'impasse, une situation d'où toute vie est progressivement exclue. Myriam a d'ailleurs le même sentiment. Il ne nous arrive plus rien et il devient de plus en plus difficile de goûter la simplicité des choses. Pourtant j'avais réussi ce à quoi parviennent peu d'êtres humains, à savoir jouir de l'imperceptible, de l'invisible qui ente l'étant, prendre à chaque moment l'essence du temps qui passe comme objet du plaisir. Le manque creusé par le mystère de l'être a pris la place de toutes les drogues. Sans doute la mer et mon désir de la prendre pour cadre définitif ont-ils une valeur spécifique. Laquelle ? Mon dégoût du répétitif. Ma rue, les gens, le fonctionnement de la vie quotidienne, tout cela s'est appauvri en-deçà du seuil tolérable et réserve à la contemplation de moins en moins de surprises. On me répliquera que l'océan est encore bien plus monotone. Certes, mais paradoxalement l'Océan apparaît bien plus sérieusement comme un partenaire, ou comme un vrai "autre", tandis que "les gens" sont d'interminables imitations de ce qui s'est toujours déjà vécu depuis des lustres en nous-mêmes.
Partout où je peux, cependant, je cherche les signes d'autres humanités. Ainsi dans l'architecture de ma rue vit toute une micro mythologie passionnante, faite de petites pièces décoratives du début de ce siècle (allemand). Les fers forgés de ma fenêtre me paraissent parfaits, de l'ordre de la perfection. Un vulgaire morceau de fonte recourbé qui dit presque tout sur les rapports entre la culture zoroastrienne, Wagner et le IIIème Reich.
Ah ! ne pas oublier : hier j'ai accédé à un nouveau niveau de compréhension du rapport avec la nourriture. Jusque là il m'était évident que l'agriculture industrielle, par exemple, est totalement impuissante à réaliser la satisfaction du besoin de se nourrir, ses produits sont des succédanés sans pouvoir nutritionnel. (D'où une conclusion parmi d'autres : l'aide alimentaire aux pays pauvres n'en est pas une.)
Cette industrie n'implique pas surtout l'usage de la technologie chimique, mais d'abord la suppression de la manipulation, l'éloignement progressif des mains de l'homme de la surface productrice. Si les viticulteurs sentent intuitivement que la récolte mécanique du raisin ne peut pas remplacer la cueillette manuelle, il n'en va pas de même des autres secteurs agricoles. Là, il y va aussi bien de soi d'alimenter les cochons par des vis sans fin automatiques que d'arroser les kilomètres de maïs avec des machines automotrices.
Or, j'ai découvert hier, en faisant du pain, que le principe moteur d'une agriculture nutritive ne réside pas simplement dans le rapport tactile entre celui qui mange et celui qui produit, mais d'abord dans le rapport lui-même entre celui qui produit et le produit lui-même. Ce n'est pas la manipulation qui est première, mais le vécu d'une histoire à chaque fois particulière entre le mangeur et son alimentation. Un bon cuisinier, pour abréger, est celui qui a suivi la croissance et l'élevage des produits qu'il utilise. Cela se fait dans les restaurants de luxe, sans se savoir comme nécessité théorique. C'est le rapport avec la pâte du pain qui m'a donné l'idée que chaque levée reste aléatoire et que la qualité nutritive découle de cet aléatoire pétri d'expérience, d'amour, d'épisodes affectifs divers et de stoïcisme face aux aléas des choses elles-mêmes. L'exactitude des recettes est aussi ridicule que les nomenclatures naturelles du 17ème siècle. Cela provient essentiellement du fait que la nourriture du corps n'est pas du tout ce que le positivisme a laissé penser. Il faut nourrir la vie et non pas un corps.
Dimanche 23 Juillet 1995
Il faut que je précise ma propre pensée à propos de la terrible question de l'immigration, pour moi-même.
Nomade comme je le suis, de corps et d'esprit, je trouve toute limitation à mes mouvements sur terre intolérable. Pourquoi dénierais-je la liberté d'aller et venir à qui que ce soit ? Et encore : aller et venir ne sont pas tout, il faut y ajouter vivre, travailler ou pas, rester, partir, revenir, jouir et souffrir, fonder famille, élever des enfants, tous les actes de la vie quoi !
Au nom de quoi un homme, une communauté ou un état peuvent-ils légitimement utiliser la force pour empêcher quelqu'un de pénétrer et de tenter de vivre sur un quelconque territoire ? Première réponse : en temps de guerre. L'état de violence entre deux communautés semble justifier de soi de telles limitations, encore que les guerres ont montré que des individus peuvent choisir, le plus souvent à leurs dépens, de changer de camp ou de tenter de s'abstenir de participer aux hostilités et d'échapper ainsi à la logique des nations en guerre.
Deuxième réponse : la protection des richesses des individus, d'une communauté représentée par un état. Cet argument serait bel et bon si la richesse des nations était une réalité stable. Or le capitalisme ne connaît pas de richesse nationale, mieux, la richesse est apatride par définition. Cela implique entre autre, que la richesse peut passer d'une nation à l'autre sans le moindre mouvement de population. L'argument économique s'avère comme le plus démagogique de tous, c'est même un pur mensonge.
Troisième argument : la défense de valeurs communes. On peut légitimement penser qu'une communauté X peut vouloir vivre selon certaines valeurs en les transmettant à sa descendance. C'est d'ailleurs l'argument utilisé massivement par la plupart des pays qui se protègent de l'immigration. Fort mal à propos, car d'une part la force du respect des valeurs d'une communauté s'impose d'elle-même aux étrangers qui désirent y vivre et d'autre part c'est faire un curieux procès à ces mêmes étrangers que de leur dénier le souhait de vivre selon les valeurs qu'offre cette communauté. C'est même un procès qu'on ne peut pas faire du tout.
Il faut bien, aussi, descendre sur terre et avancer les arguments "sales", c'est à dire un mélange des genres économiques et politiques du style : "ils viennent profiter des lois sociales et des revenus qui y sont liés". Certes, mais s'ils le font, c'est qu'ils peuvent le faire en raison précisément de la faiblesse de l'état qui légifère et qui exécute les lois propres aux valeurs politiques de la communauté. En clair, si la sphère économique se réserve le droit de faire bande à part et d'utiliser les étrangers à des fins non conformes aux valeurs nationales, il ne faut pas s'étonner si ces mêmes étrangers ne conçoivent même pas les valeurs qui leurs sont proposées. Encore plus clair : si les étrangers se rendent quotidiennement compte qu'on ne les reçoit sur le territoire national que parce qu'ils acceptent les travaux les plus pénibles, il ne faut pas s'étonner qu'ils y voient une injustice qui réduit à néant les prétentions de cette nation à la défense de la justice. L'esclave ne conçoit l'ambition de prendre la place du maître que sur la base des souffrances que représente son esclavage et non pas par motivation spontanée ou défi personnel.
La défense des valeurs est l'argument passe-partout de cette curieuse race de citoyens qui exigent la consanguinité pour preuve de la nationalité, contradiction dans les termes et pure absurdité.
Vendredi le 28 Juillet 1995
Le plus long mois de l'année, Juillet. Curieux, cette impression provient sans doute de la richesse et de la diversité des moments passés depuis la fin Juin. Y figure même la relecture de Foucault - les mots et les choses, - comment cadrer une telle "réflexion" avec des événements comme la Bosnie ou l'explosion du métro St Michel ? Peut-être avec l'idée qu'il s'installe constamment un malentendu entre la réalité du mouvements des étants avec le texte qui est prononcé sur eux. C'est là qu'il redevient intéressant d'étudier la querelle du nominalisme. Les mots et leur logique peuvent-ils désigner les choses et leur mouvement ?
Fausse querelle sans doute, car le problème n'est jamais de savoir s'il y a une coïncidence entre un discours et la réalité, mais entre un "premier" discours et celui ou ceux qui suivent ! En clair : le monde ne tourne pas autour d'une relation entre les êtres humains et l'étant, mais il tourne à l'intérieur du langage humain. La question n'est jamais de savoir si un concept est aléatoire, mais de constater s'il est assumé par celui qui l'utilise. Assumé dans un contexte où soit il force le sens à ses risques et périls, soit il respecte une convention au risque de se démasquer ou de se tromper publiquement.
Le monde tourne : expression malheureuse et qui risque, elle, d'être mal comprise. Je veux dire que les affaires humaines se règlent en fonction d'une histoire du langage, ontogénétique et phylogénétique. Cela ne signifie pas que la grande affaire serait précisément cette histoire-là, pour autant que la grande affaire ne réside pas dans les affaires humaines, trop humaines. Je ne pense pas que la grande affaire soit humaine. C'est même l'obstination à penser le contraire qui contribue le plus à troubler les affaires humaines.
Lundi 31 Juillet 1995
L'histoire humaine me paraît de plus en plus poussiéreuse, chargée de tonnes de n'importe quoi. Le structuralisme a consacré, avec beaucoup de légèreté, des comportements qui ressortissent plus d'une économie générale de la peur que d'une structure de pensée. A ce titre, le christianisme du 19ème siècle - victorien ou à la Jules Ferry - n'a pas à rougir de ses choix "civilisateurs", à l'intérieur des frontières de l'Europe comme à l'extérieur. Qui ne s'aperçoit pas que les "structures" primitives (tabouisées) ne cohabitent jamais avec des lois ou des règles familières aux Droits de l'Homme, risque de rester aveugle au choix historique (ou historial) qui a été accompli par les Sans-Culottes. La compréhension du tabou comme nature est la porte ouverte au retour à la barbarie.
Poussière : quel intérêt représente pour nous la ressemblance entre les millions de réactions figées et canalisées par les différentes communautés selon des circonstances chaque fois particulières ? Les structures qui se ressemblent montrent bien qu'il ne s'agit de rien de fondamental. Exemple : le mythe du rapt de l'âme par la représentation graphique ou photographique. Que peut-on retenir d'un tel mythe qui ne soit pas simple bavardage sur des soi-disant "modèles" de la pensée. Qu'y a-t-il de miraculeux dans des analogies qui identifient des réactions de superstition ? Il n'y a pas assez de diversité dans la nature des hommes et des paysages pour que les variations puissent être bien grandes. Sans doute les oppositions doctrinales et surtout ecclésiales des différentes religions ont-elles servi de modèle pour laisser croire un temps que les différences puissent être si grandes entre les communautés. Mais on se trompait de terrain en comparant l'incomparable, encore que les "grandes" religions ont également été démasquées pour ce qu'elles n'étaient rien d'autre que la rationalisation technique et politique d'anciennes recettes de sujétion idéologique. C'est le mérite des colonisations que d'avoir fait table rase de ce côté babelien de la société humaine. Ce qui ne nous empêche pas de retrouver là l'horripilante question de l'identité reliée à une nation ou à une région avec ce beau paradoxe : plus on découvre de liens entre les divers comportements humains, plus on s'applique à découper des espaces originaux devant abriter des identités différentes. Le lien que la défense de ces identités entretient avec la politique chaude d'aujourd'hui, montre très bien à quoi servent les structures : la politique unifie, de nos jours, la diversité des motifs de structuration parce qu'elle se concentre enfin sur son unique objet : la peur. Jadis, la politique était ce qui restait toujours caché. Aujourd'hui son surgissement ou son retour nettoie la scène radicalement. Plus question de chercher midi à quatorze heures dans les mobiles humains, il est devenu évident que le motif de la lutte - c'est à dire du risque de périr - traverse toute la pratique sociale. C'est aussi le retour, sans doute, vers une praxis humaine d'un tout autre genre, contenue dans les mythologies et la culture mais rejetée par un détour de l'histoire, l'errance ou le nomadisme radical. Il n'y a pas de hasard dans le fait que le tabou le plus prisé par l'occident ne concerne ni la vie ni l'inceste mais celui de la propriété privée. Son mythe vient d'Océanie, paraît-il, une mode qui a donné lieu à une terrible cosmétique historique dont on ne voit pas comment sortir. C'est même l'un des mythes auxquels il n'est pas question de mégoter la fidélité et la véracité comme on peut le voir à tout ce qui se dit et s'écrit autour de ladite chute du communisme. Il sera donc intéressant d'observer comment l'humanité va négocier le virage vers l'abolition fatale de cette propriété.
C'est ce qui se passe aujourd'hui : l'abandon progressif de la société de dépendance réciproque - c'est la nature même du libéralisme - implique l'abandon de la fixité du capital et de la nécessité de l'accumuler. L'accumulation de richesses n'avait de sens que pour autant qu'il fallait les consacrer à des ensembles humains de plus en plus vastes. Dès lors que l'homme retourne à la gestion solitaire de ses intérêts, il perd les raisons d'entasser les biens. Le mythe de la richesse lui-même est condamné à disparaître, s'il n'a pas déjà totalement disparu. Dans ce qu'on appelle le domaine culturel par exemple, il est évident, me semble-t-il, qu'aucun artiste ou qu'aucun penseur ne saurait, à même les colonnes des journaux ou des écrans médiatiques, revendiquer quelque chose comme une quête de biens matériels. Cette question subsiste pourtant toujours en filigrane de toute exhibition, mais il en va comme si elle n'existait pas : le nouveau sens de l'honneur ne permet pas de faire état de l'instinct d'enrichissement, ou du moins, il ne permet pas de relier la création culturelle et sa motivation à cet instinct sous peine de dévaloriser radicalement le produit.
Plus sournois et plus dangereux pour le mythe, l'affairement actuel autour de la corruption. Il n'est sans doute pas exagéré d'affirmer que ce qui passe aujourd'hui pour de la corruption correspond dans un passé pas si lointain à des pratiques parfaitement compatibles avec la vertu. C'est signe que c'est l'acte même d'enrichissement qui est, cette fois, accusé d'immoralité. C'est en somme la fin de la théorie protestante de la vertu du capitalisme, on ne comprend plus qu'un homme puisse s'enrichir au dépens de la communauté.
Paradoxalement, le libéralisme tente de revaloriser moralement l'enrichissement personnel : signe infaillible de ce que l'accumulation de biens ne jouisse pas d'une grande considération, ou du moins d'une grande légitimité au sein de la représentation générale. L'économie pourrait bien ainsi, rejoindre son statut grec, sa petite place près du foyer domestique qu'elle n'aurait jamais du quitter.
Etrange. Quelques minutes après avoir écrit ces lignes, un long pensum radiophonique avec Elie Cohen. Mon dieu ! Il dit exactement le contraire, ou plutôt il continue envers et contre tout à hurler le refrain développeur sans même se rendre compte (et la journaliste non plus d'ailleurs...) des contradictions invraisemblables qu'il enfile à longueur de propos. Exemple la Chine. Quel pays fantastique, l'avenir du monde, la France incapable de s'attaquer à ces gros morceaux de l'Asie etc...etc...Et puis dans la minute suivante, tous les dangers qui rendent les investissements en Chine extrêmement périlleux sinon mortels : éclatement, contradiction entre les petites Chines prospères et la grande majorité qui ne bouge pas (un scénario qui est aussi vieux que la Chine). Ah ces économistes ! D'un côté la démarche scientifique leur donne une certaine lucidité, de l'autre la défense acharnée de leur spécialité les laisse sourds et aveugles à tout raisonnement qui n'intègre pas l'idéologie théorique économiste.
Samedi le 5 Août 1995
Demain le monde va fêter le cinquantième anniversaire de la bombe d'Hiroshima. Il y a encore une semaine, je voyais venir l'événement avec flegme et indifférence. Pour moi les anniversaires, quels qu'ils soient, sont des non-évènements. On pourrait réfléchir sur ce statut par rapport au véritable événement.
Et puis hier j'ai reçu une avalanche d'images et de sons, documents d'archives, témoignages de toute sorte (survivants, American Legion, politiques etc...), j'ai eu un choc. A St Clément les jésuites nous avaient déjà montré une grande partie de ces documents, notamment l'explosion de Nagasaki. En 1954 c'était un tour de force, mais hier je me suis retrouvé devant ces images que je connaissais déjà mais j'ai été à nouveau saisi par une émotion, une émotion froide, une étrange détermination à foncer. Alors que la veille encore j'avais plutôt une tendance à me distancer par rapport à l'anti-nucléarisme de base, je cultive une grande méfiance envers tout ce qui milite, j'ai subi , hier, un nouveau raz de marée pacifiste. J'ai même suggéré à Etienne - il va faire le journal dans les deux jours à venir - de faire une édition spéciale avec les documents de Reuters. J'ai le sentiment qu'il est très important que l'on remette ces événements en perspective, il faudrait presque que les gens aient l'impression qu'ils les revivent.
Car tout se mêle, la décision de Chirac de remettre ça avec les essais nucléaires, les commémorations au Japon et la guerre en Bosnie qui prend, chaque jour, un tour plus décisif.
Du coup j'ai décidé d'aller interroger un "savant". Maurice Vaïsse est directeur du Centre d'Etudes d'Histoire de la Défense ( Je suppose que ce centre s'occupait jadis de la Guerre et non pas de la Défense...), je vais lui poser quelques questions sur la force historiale de ces deux cataclysmes. Grande surprise hier, en lui téléphonant : j'apprends que l'une de mes idées de base sur le problème de l'armement humain était fausse. J'ai toujours pensé (comme Mitterrand d'ailleurs, qui en a fait un jour la déclaration) que la destruction massive des armes nucléaires était un fait nouveau dans le comportement humain. Or, tel n'est pas le cas. Vaïsse m'a raconté d'un ton malicieux que le Concile de Trente était parvenu à faire détruire quelques stocks de hallebardes et armes diverses en vue d'une paix universelle et chrétienne ! Surprise, mais je ne pense pas que les deux faits soient comparables, justement parce que la décision du Concile a été une décision abstraite, alors que la destruction des missiles et des bombes est plutôt une conséquence logique et obligée des événements politiques et militaires eux-mêmes. Non ?
Quoiqu'il en soit, j'ai l'impression que l'histoire, cette fois, m'interpelle à nouveau. C'est comme si je n'avais pas le droit de rester inerte. Ce qui explique que je vais me déplacer Lundi à Paris. Pour quel résultat ? Peu importe la quantité : il suffit de lancer une forme dans la nature pour qu'elle prolifère, si elle doit proliférer, il suffit qu'il y ait une seule liaison intellectuelle pour que mon message soit fertile. Au fond, j'ai été dans le passé, un militant pacifiste plutôt radical. Si je me plains aujourd'hui du militantisme béat de quelques générations de jeunes Allemands et d'une poignée de Français, je dois avouer que cette plainte s'adresse surtout à ce que je considère comme ma propre naïveté passée et l'incohérence vécue du militantisme de mes vingt ans.
Cela dit, il reste le débat sur le mouvement réel de l'histoire, - ou le non mouvement, bien sûr....- et ma question est simple : sommes-nous entrés, avec Hiroshima, dans une culture de paix. La question tourne autour du rapport entre l'impossibilité de la guerre qu'impose la puissance des armes nucléaires et la subsistance d'un réel articulé sur la volonté de puissance militaire.
Au fond, quelle est la différence entre la pensée politique de Chirac et celle d'un Mitterrand. Peut-être celle-ci : Mitterrand ne pense pas seulement que le verrou nucléaire a définitivement scellé toute possibilité de relancer une guerre à l'échelle mondiale. Il estime que cette annulation de toute stratégie belliciste, a entraîné une conversion de la culture. En gros, les décisions dont accouchaient les champs de bataille, se prennent aujourd'hui à la suite des exercices annuels des entreprises mondiales. Chirac, lui, reste fidèle au philosophème hobbesien : c'est la puissance en tant que telle, c'est à dire militaire, qui continue de déterminer le réel, la souveraineté, la paix elle-même. C'est là qu'il y a un paradoxe absolu, soutenu d'ailleurs par toutes les grandes puissances et qui fait que la paix dériverait de l'esprit guerrier : si vis pacem, para bellum. Mais la question est plus profonde que cela.
Dans ce qu'on peut désigner comme une "culture de guerre", la puissance ne peut pas être un simple instrument de négociations ou une simple circonstance nécessaire. Elle doit être la finalité et son propre objet. Clausewitz est clair à ce sujet : "La guerre est donc un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté". Autrement dit l'exercice de la souveraineté n'est pas, comme le pense Hobbes, l'utilisation de la force pour autre chose (la gloire de Dieu), mais bien l'exercice de la force comme absolu se réalisant lui-même. C'est la puissance divine qui reçoit une identité particulière. La recherche de la force n'est pas la recherche d'une garantie pour des valeurs, mais d'une garantie pour la domination pure et simple, quel que soient les masques utilisés pour dissimuler cette vérité blessante. Les états devaient alors être revus par les théoriciens comme de simple gangs, et la Mafia comme un état parmi d'autres, utilisant des méthodes qui lui sont propres...
Plus profondément encore, la culture de guerre est la vie se jouissant comme pure puissance destructrice. Dans un tel contexte, la dissuasion ne change rien à l'affaire. La paix obtenue par la dissuasion est une paix armée comme une autre, c'est à dire un calcul permanent du rapport de force qui détermine, en définitive, le degré de souveraineté des uns et des autres. Si la théorie de la dissuasion était à l'abri de tout soupçon, il faudrait comprendre pourquoi la guerre de 14-18 a éclaté, alors que les forces en présence étaient quasiment égales et que tout le monde le savait à dix fusils près. Il faudrait aussi réviser les idées qui tendent à faire penser que l'homme a été surpris par le technique sur les champs de bataille de Verdun par exemple.
La décision du Concile de Trente est donc bien une décision essentielle, même et surtout si elle est abstraite et détachée de toute circonstance stratégique. C'est la volonté pure qui peut s'imposer comme "nouvelle culture" et rien d'autre.
Dimanche 6 Août 1995
Peut-il y avoir plus que des questions sans réponses à propos d'Hiroshima ? Cela m'étonnerait. Le schéma d'opposition s'articule très clairement : les bombardements étaient inutiles/sans les bombardements on perdait encore des dizaines de milliers de vies. Dans le raisonnement sur l'inutilité de la bombe, il est surprenant de constater combien les pacifistes sont généreux en vies humaines alors qu'en règle générale ils contestent même la perte d'une seule vie !
A les écouter on aurait pu sacrifier une cinquantaine de milliers de soldats américains de plus !!! Plutôt que des milliers de Japonais : rien à voir avec les lois de la guerre.
Raymond Aron raisonne excellemment sur les relations entre diplomatie et guerre. Il oublie peut-être une éventualité : celle de la perte d'efficace de la guerre. Avec le nucléaire, la guerre pourrait bien être devenu un instrument secondaire destiné à des intérêts secondaires, c'est à dire des conflits régionaux. On devait s'ennuyer ferme dans les chancelleries américaines et soviétiques du temps de la guerre froide, de la paix terreur.
La paix terreur, cependant, peut-elle être le terrain de la croissance d'une culture de paix ? Qu'est-ce que la "culture de paix" ? Est-ce autre chose qu'une charmante idée ? Cette culture est-elle semblable, au contraire, à la laïcité, c'est à dire à une valeur qui persiste à se définir contre et qui ne trouve pas ses propres marques ? Clausewitz pensait que la guerre était un jeu. La dimension ludique de l'homme peut être une dimension conforme à l'impératif catégorique, or l'atome interdit en apparence totalement de mettre en parallèle guerre et jeu. D'abord parce que les puissance atomiques sont nées de manière aléatoire et ensuite parce que la machine nucléaire a les plus grandes chances de s'adapter encore moins bien aux impératifs politiques que les grandes armées de la première et de la deuxième guerre mondiale. Conséquence : la guerre n'est plus un jeu que là où elle ne met pas la toute-puissance de ses possibilités destructrices en ligne.
Le simplisme de l'opinion publique à propos d'Hiroshima est précieux. Il indique la simplicité de la question, le fait que la vie est un événement individuel et à ce titre aussi sacré que les intérêts d'un continent. Hiroshima était un bombardement de populations civiles (protégées par les conventions du jeu de la guerre). Il ne trouve grâce devant le tribunal de la conscience humaine que dans une relation avec les atrocités condensées au cours de la seconde guerre mondiale. Coventry, Leipzig, Dresde, Hiroshima, Nagasaki et tous les bombardements de population civile sont passibles de tribunaux internationaux, ce dont personne jamais n'a soufflé mot. Les nucléaires n'en sont, aujourd'hui, que davantage condamnés par la conscience mondiale : ils cumulent l'illégalité et l'horreur technologique.
Mardi le 8 Août 1995
Elle est resté trois semaines. La bouteille de Volvic que nous avions emporté de Cogolin au retour des vacances de Juillet est encore dans le couloir, sur la petite table basse, sans raison. Une occasion peut-être excellente pour argumenter métaphysiquement sur la résistance du réel.
Voyons. Cette bouteille est posée là, dans un là qui n'est en rien le sien. Ni pour elle-même, ni pour l'usage de personne. Elle semble condenser un tout autre problème, pour l'éclaircissement duquel il faudrait sans doute une longue analyse qui ne nous intéresse guère. Ce qui m'intéresse c'est sa résistance en tant qu'objet, en tant que non-être fonctionnel qui subsiste envers et contre toute logique. Cet objet révèle ainsi la présence concrète d'un faisceau de causes d'inertie. C'est encore psychologique, mais c'est concret : le conflit qui a troublé au plus haut point ce voyage de retour, la chaleur et l'orage qui ont symbolisé la tension énorme du retour. Cette tension est littéralement devenu la force qui a maintenu cette bouteille à cette place illogique pendant si longtemps. Autre remarque intéressante : là où le rituel et la manie font défaut, le comportement laisse se révéler et persister des vérités sous leur forme objective, concrète, non critiquable a posteriori.
Lundi 28 Août 1995
Nous sommes rentrés de Cogolin via Privas. Cette fois c'est la même chose, mais pour causes contraires : les affaires vont sans doute traîner longtemps dans le couloir (j'avais écrit "vouloir", amusant, non?) à cause de la nostalgie de ces quelques jours somptueux sur Petit a. Notre bateau prend de plus en plus la place d'une personne. Une sorte de revanche métaphysique sur la désertification de l'existence si exclusivement définie en termes de "relations humaines". L'objet, le dur objet en plastique - il faut le souligner - prend la place des faux espoirs. Ainsi, il y a peut-être un moyen d'approcher de la notion de propriété privée, sans passer par un privatif spatial ou ad valorem, sans surtout l'immersion dans une philosophie de l'avoir. Paul, Myriam et Petit a, une famille qui se met à exister. Pas facile d'ailleurs. Il faut apprivoiser l'objet Petit a. Le bateau ne se laisse pas traiter n'importe comment. Quoique. Je suis assez émerveillé de voir avec quelle bonté Petit a nous a épargné les accidents ou les pannes stupides au mauvais moment. Je sens que ma relation privilégiée avec les choses techniques va trouver son épanouissement avec cet engin motorisé, ma relation souterraine avec les moteurs et les carrosseries qui me fait glisser rapidement le long des autoroutes. Petit a nous pardonne bien des choses car nous sommes des débutants, il faut le confesser. Mais là encore j'aurais une tendance à me considérer comme un éternel débutant, une manière plus raffinée de goûter à l'existence. Le côté professionnel de la vie est bien le plus frustrant, d'abord parce qu'il exclut tout dialogue et surtout parce qu'il éteint toute surprise. Le "pro" ne laisse par ailleurs, aucune initiative à ce qui est autre. Dans la maîtrise il maîtrise en maître, la position la plus ridicule qui existe. La méthode des essais et des erreurs n'est pas une attitude épistémologique mais de la poésie pratique, la poésie qui a du marquer les temps où les mots étaient absents. La même, au fond que celle de ma grand-mère jouant avec la laine, le coton et son jardin. Il s'agissait, bien entendu, là aussi, de produire en reproduisant, éterniser des savoir-faire, mais en y intégrant des facteurs allogènes au technique proprement dit. La qualité - la provenance - des matériaux, qui changeait constamment. Les saisons et la vie de la terre qui allaient leur propre chemin, si bien que le produit final n'était jamais un standard, mais un objet pour lui-même, presqu'un être.
C'est sans doute la raison pour laquelle il est difficile de concevoir aujourd'hui la notion de poiésis aristotélicienne. Le produire grec était un produire presque biologique, la série n'était envisageable pour les Grecs que dans l'agriculture, modèle de notre industrie, la multiplication à l'identique de la semence.
Dimanche le 17 Septembre 1995
Page 99 ! Ce texte traîne dans mon PC. On se demande pourquoi. Quelquefois je me rue sur le clavier pour décharger quelque chose, parfois je me dis qu'il existe et qu'il faut que je le nourrisse, quoi que j'en aie.
C'est le cas aujourd'hui, autant dire que je n'ai rien de particulier à développer ni grand chose dont j'aie à faire le récit. Alors au fond c'est peut-être la meilleure situation pour des "mémoires", raconter comme c'est annoncé au début..
Ce 17 Septembre possède quelques arrière-plans intéressants. Nos relations avec Edouard et Odile prennent tournure. Très curieux comme développement. Nous allons sans doute partager Petit a avec eux, le bateau se présente comme la médiation. Nous avions déjà essayé de cultiver cette rencontre qui remonte à l'été 94 ; nous nous sommes même déplacés jusqu'à Pau pour les rencontrer, le projet était alors de faire une traversée de l'Atlantique. Ce fut un échec, sans doute parce que primo Odile n'avait pas vraiment envie de refaire ce voyage, secundo parce que Edouard s'était plus ou moins engagé avec un autre copain qui ne nous revenait pas spécialement. Puis, plus rien pendant de long mois, comme si tout s'était effondré, si la relation était morte du premier coup de froid. Vient ensuite l'achat de Petit a. Myriam et moi suivions, sans le savoir, les mêmes sentiers psychologiques : le bateau était à peine inscrit à notre nom qu'il nous a semblé tout d'un coup indispensable d'en faire état aux Edouards. Le même jour à la même heure nous avons exprimé ce souhait, et, aussitôt dit, aussitôt fait.
Surprise ! les Edouards avaient aussi entamé leur révolution copernicienne, ils déménageaient. Liquidaient leur situation "d'industriels de la psychiatrie" pour un poste modeste dans un hôpital à Grasse, tout près de Petit a. Notre enchaînement à un objet correspondait pour eux à leur séparation d'avec le leur. Leur commentaires depuis, montrent bien qu'il s'agit pour eux, en fait, d'un retour à une "vie normale". Odile nous a bien décrit l'horreur que constituait l'existence dans un milieux bourgeois provincial style Franju / Chabrol, existence à laquelle ils n'ont finalement pas réussi à s'intégrer au point d'y inscrire leur mort. Cette épreuve me paraît aujourd'hui pour ainsi dire logique. Lorsque nous les avons connus l'an dernier, je n'arrivais pas à les cadrer dans une vie de notables locaux et tout me portait à penser qu'une amitié était possible malgré tout. Mais il faut bien avouer que je ne voyais pas, alors, de médiation possible entre la place qu'ils occupaient dans le décor et la nôtre. Aujourd'hui les choses se présentent tout à fait différemment, on dirait qu'ils se sont "alignés" sur nos positions de salariés moyen-haut de gamme.
Alors, question : où est le moteur de tout ça ? Avons-nous, Myriam et moi, joué un rôle dans cette mutation ? Pourrait-on dire que la sorte de séduction que nous avons opéré sur eux a travaillé ? J'ai coutume de dire qu'aucun homme ne peut vieillir, que seul le réceptacle se déglingue plus ou moins vite. Je crois que c'est le cas d'Edouard, qui s'est dérobé, finalement, à une structure conçue pour le vieillissement. La bourgeoisie c'est bien cela, un ensemble qui planifie la mort en excluant soigneusement toute dépense absolue. On vieillit donc l'apparence par degrés dans l'illusion d'insérer son être dans la mort comme par inadvertance. On introduit le crédit et l'intérêt dans le vivre avec le même esprit spéculatif que celui qui détermine la bourse.
Sinon il faudrait penser que c'est un simple hasard qui nous a fait nous rencontrer chez Puppel. Mais à bien m'en souvenir, cette rencontre avait déjà quelque chose de magique. J'avais à peine aperçu le personnage d'Edouard qu'il m'envahissait déjà par une sorte de familiarité transcendante, il était du genre de personne qu'on a toujours connu. Au point qu'il m'apparut évident qu'il était juif et engagé dans la chose psychologique d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs je ne peux pas simplement attribuer notre rencontre à mon entregent habituel ou à mon audace sociale. Je me souviens très bien qu'il me paraissait alors "important" de prendre langue avec ces gens. Je crois que ce sont des choses dont il faut se souvenir.
Que va tout cela devenir ? Sans doute plus qu'on ne peut aujourd'hui anticiper. A l'heure qu'il est, Myriam et moi sommes plantés dans un programme dual ad libitum. Les mouvements de la socialité nous réservent peut-être des surprises ontologiques décisives. Peut-être aurons-nous droit à l'amitié et n'aurons nous ainsi pas vécu en vain à nous battre contre les moulins à vent de l'aliénation sociale . Un autre phénomène me fait penser qu'il se passe quelque chose dans les soubassements de nos existences, il s'agit d'un certain retour au travail intellectuel. Comme si nous devions nous préparer, bien nous "habiller" pour aller à la messe !
Important. Il y a bien longtemps que j'ai pour ainsi dire renoncé à la théorie. D'une part parce que le discours théorique est parfaitement vain lorsqu'il est détaché de l'action quotidienne, mais surtout parce que la vraie théorie n'est rien d'autre qu'un regard sur ce qui passe en apparaissant. Or, cette théorie n'a nul besoin de partage. Si l'on veut partager le regard théorique, il faut apprendre ou réapprendre à user de la langue. La lalangue forme les trous à travers lesquels peuvent passer des dons de réel, et sans de tels dons il ne se forme ou ne se passe aucune socialité. On reste dans l'échange marchand.
Jusqu'à présent le réel donné passe, chez Edouard, par l'humour et aussi par une certaine tonalité de voix qui ressemble bien à la voix "analytique", mais dont certaines inflexions se dégagent radicalement. On peut dire parfois que la bonté "s'entend". C'est le cas avec lui. Pour Odile, c'est l'angoisse qui affleure dans les prolégomènes, encore une subjectivité de la douleur, mais qui aussi se donne à entendre et à voir. A ce propos j'ai noté que Edouard se replonge également dans le travail intellectuel, sans doute après une longue période désertique, où les choses étaient toujours déjà dites et réglées par le métronome du profit. Un peu comme nous depuis quelques années, avec nos salaires de petits chefs...
Un rêve ? On a le droit de rêver, c'est même le seul droit que nous ayons. Et puis ce sera toujours amusant de relire ces considérations optimistes dans quelques années.
Reste aussi la conjoncture. A 55 ans j'ai appris les accélérations des changements conjoncturels mais aussi l'immobilité réelle sur laquelle elles se donnent l'air d'avoir lieu. Voir Mai 68. Le seul résultat tangible de cette "révolution" fut le départ de De Gaulle, incapable de continuer à supporter une culture qui lui était devenue totalement étrangère. Car ce Mai-là n'était qu'un aboutissement et non pas un départ. Bref, de nos jours il ne faut pas attendre d'aboutissement violent, car depuis 68 tout n'a fait que se développer quantitativement. Le discours sur les fractures c'est du pipeau, la nouveauté n'est pas l'exclusion, mais seulement le discours qui l'évoque continuellement. Il n'y a pas de fracture parce que ce qui compte n'est pas la répartition de telles ou telles choses, de tels ou tels privilèges, mais l'aspiration générale, et celle-ci va aux mêmes choses. Une société qui se propose unanimement les mêmes objets - en l'occurrence de simples marchandises - n'est pas une société duale. Même les intégristes de telle ou telle religion aspirent à des idées-marchandises, c'est à dire à des équivalents généraux de la pensée universellement vendables et consommables. Leur seul problème c'est que leurs productions sont des camelotes éculées qui ont déjà servi mille fois dans la structuration de l'idéologie. Tout ça ne peut plus servir, c'est le petit commerce de l'âme, condamné à faire place aux grandes surfaces de la science !
Cette conjoncture, cependant, doit contenir des ingrédients qui nous intéressent, nous, les Edouards et les Kobisch . Des éléments insociaux au sens du non patent. Les situations concrètes ont des ressemblances : les Edouards font marche arrière par rapport à une accumulation de capital. Cela prouve au moins que quelque part (!) ça craque à l'intérieur de cette pratique dite historiquement universelle. Et que les Edouards donnent l'exemple. Quant à nous, nous avons aussi modifié notre pratique par rapport à l'accumulation abstraite de capital : l'achat de Petit a remet en question notre approche traditionnelle - pour autant qu'elle n'a jamais existé tant nous participons de la condition prolétarienne - et le vecteur, pour parler vite, de notre vieillesse semble plutôt devoir se balancer sur les flots que moisir dans les coffres ou dans les pierres. Ou pire encore produire des intérêts ! La conjoncture qui parle par nos comportements, dit au moins une chose : une certaine classe de la société se désintéresse de la culture de pénurie pour se consacrer ou chercher à se consacrer à autre chose.
Vendredi le 22 Septembre 1995
Avons reçu l'une de ces visites très régulières de N. Je suis frappé par son évolution très régulière vers un total égotisme, si ce néologisme vous dit quelque chose ! Il ne parle plus que de lui-même et de la vie qu'il découvre du haut de son perchoir de miette de pouvoir politique et économique ! Ce n'est pas tellement une surprise pour moi puisque je connais l'homme depuis Mai 68. Il était à cette époque classé parmi les "stals", non pas qu'il fût communiste ou trotskiste avéré (c'est à dire inscrit) mais son comportement et celui de sa petite bande pouvait se définir comme du pur terrorisme intellectuel. Leur principal victime a été R. Chambon, mon ex-prof chargé de la psychologie (au sens métaphysique). Ce pauvre n'avait pas l'habitude de cacher son scepticisme considéré comme réactionnaire. Il a donc payé dans leur imaginaire d'apprentis du bien et du mal. Cet homme là avait une telle hauteur qu'il en a bien ri. Comme il avait un jeune fils, il a vécu avec une tristesse paterne une véritable persécution qui a duré bien au-delà de Mai 68. Bref, je ne règle pas un compte, mais le drôle est que N proclame aujourd'hui son essence profondément réactionnaire sans la moindre pudeur. Mais je crains qu'il ne sache pas encore aujourd'hui ce qu'est la "réaction". Pas assez lu Marx . Il doit penser faire le "bien du monde" à travers l'épanouissement de son moi. Position aristotélicienne si, si elle parlait d'un autre que lui-même. Chez lui il y a construction systématique d'un sujet, arrondissement d'une bulle égoïque d'où il veut devenir inexpugnable avec le temps, si le temps lui en laisse le temps. Il pourrait devenir, s'il ne l'est déjà, dangereux. Je suis trop bon, moi qui ai déjà eu à connaître de son inconsciente propension à la trahison et à son manque de scrupules. Il vient d'ailleurs chez nous pour se défaire de cette tunique de Nessus de culpabilité. Ca va être dur car mon oeil est toujours là, comme celui de Caïn. Il faudrait qu'il changeât de beaucoup pour que je sorte d'un quant à soi très rare dans mon comportement avec autrui. Une forme de courtoisie dont il ne perçoit que rarement l'ironie. Si seulement il ne parlait pas tant de l'amitié...Bof, assez de méchanceté, mais c'est une dette envers la vérité. Et puis, ce qui ne gâte vraiment rien, c'est que Myriam partage tout à fait mon sentiment, même si elle ne voit dans tout ça qu'une fâcheuse évolution de son ami, ce n'est pas son genre de poser l'être.
Journée riche : Kanner est venu. Je ne l'ai pas revu depuis des lustres et ce fut comme s'il était venu la veille. Encore une fois c'est lui qui s'est senti coupable de cette longue absence, alors que moi je ne fais que faire semblant d'être serein depuis qu'il me semblait avéré qu'on ne se reverrait plus ! On se revoit donc
toujours. (J'ai trouvé il y a quelques semaines où j'ai contracté le vice des mots en Italique : Marx, que je relis avec délectation). Et, chaque fois qu'on se voit c'est le même scénario : il me plonge dans une sorte de transe tranquille où je me mets à proférer des phrases et des mots qui me viennent tout seul. Lui, écoute sidéré, des développements paradoxaux, à des années lumières de sa manière de penser, et qui, pourtant, le fascinent. Religieux, je soupçonne qu'il renifle mon passé mystique (lointain, l'enfance après le Père) et que ça rend supportable et donc propres à être écoutés, des propos presque toujours sacrilèges pour un Juif religieux. Drôle de Juif religieux, si éloigné de la solitude mélancolique des barbes surmontés de chapeaux, si proche d'un goy comme moi !
Il doit y avoir quelque chose comme une explosion du désir chez Jean Michel, une explosion qui provoque une sorte de réaction en chaîne et qui modifie à la fois mon intellection personnelle en la créant sua sponte, et ouvre en même temps son écoute à ce qu'il ne peut, en général pas entendre. Homosexualité ? Prosélytisme ? Je ne sais, mais l'expérience de Milton que nous avons fait ensemble n'y est certainement pas pour rien. Quel dommage que cette oeuvre soit interrompue ! En tout cas, parler avec lui est un fait extraordinaire, hors des bavardages communs, toujours au sommet des possibilités d'interprétation des plus hautes abstractions. Il dit toujours - "je ne comprends pas" - puis continue en relançant - " mais alors c'est ..." - l'air de souffrir. Le plus important pour moi, c'est les portes qu'il semble ouvrir à ma propre langue, à ma propre puissance d'expression. Le parfait maïeute. Il a déjà quatre enfants.
Samedi le 23 Septembre 1995
Décidément je rencontre beaucoup de gens.
Dimanche le 24 Septembre 1995
En ce moment. Avant-hier c'était le tour de Theo (Theo Frey, jadis membre du groupe de Guy Debord et dont l'histoire gardera une trace, ce qui est déjà beaucoup mieux que moi, (si ce privilège m'importait d'une manière ou d'une autre)(En tout cas, lui n'est pas conscient de ce fait, ce qui est tout à fait louable, ou alors il le cache bien). Le pauvre Theo interprète très mal son vieillissement, mais toujours selon la théorie : le monde ou "la société" devient irrespirable, automatisée comme le dit Naville, par conséquent tout désir est condamné à l'annulation pure et simple. Le goût pour la vie l'abandonne, dit-il, il ne fait plus que gérer un temps abstrait de survie. Peut-être qu'en se souvenant qu'il disait déjà la même chose il y a trente ans il pourrait relativiser cette déprimante vérité...Mais j'ai toujours plaisir à parler avec lui parce qu'il cultive cette indispensable détachement de l'esprit qui donne une chance au penser.
Ce n'est pas un hasard, si j'ai rencontré Theo. C'est moi qui ai repris contact avec lui pour lui parler des Grundrisse dont j'ai repris la lecture, lecture que j'aimerais faire en commun avec quelques esprits avisés, histoire de la plaquer sur le monde contemporain et de voir par où ça colle et par où ça déborde. Encore un projet qui ne verra sans doute pas le jour, tellement il est difficile d'ajouter un effort à ceux que l'on fait pour survivre à peu près dignement. J'ai d'ailleurs toujours pensé que le luxe de la pensée ou de l'art exigeait une forme d'oisiveté propre aux fils de famille. Le meilleur exemple en est Walter Benjamin ou peut-être même Pic de la Mirandole.
Histoires extraordinaires : hier soir Kanner est venu commenter la Bible à l'intention de Myriam. Motif : l'exégèse du séminaire de Lacan sur le Nom du Père. Comment interpréter l'aventure d'Abraham ? En gros comme la ligne de partage entre deux âges de l'être humain. Cela soulève tellement de questions que je n'ai pas le courage de développer tout ça ici. Pour moi, cependant, le mythe d'Abraham rejoue celui de la chute rédemptrice, au sens où le mythe rend possible de continuer à jouer la vie. Un peu comme les conséquences d'une faillite. Dans l'Eden déjà, l'homme avait fait faillite et avait du payer cher la poursuite de son aventure. Abraham sacrifie sa souveraineté au profit du fils, c'est l'envers de Totem et Tabou.
Vendredi le 28 Septembre 1995
Mes idées progressent dans le domaine de l'économie. Je crois comprendre le monétarisme : l'on n'y cherche nullement la croissance ou la prospérité (ces concepts ne vont pas tarder à disparaître du vocabulaire médiatique) mais l'on y cherche la solution au problème de la baisse tendancielle du taux de profit.
Pour ce faire, il faut bien trouver de nouvelles sources de profits puisque la baisse liée à l'augmentation exponentielle de la productivité ne permet pas de le faire par le moyen de la plus-value : les machines ne peuvent pas fournir du travail humain. La solution immédiate, ou plutôt la réponse immédiate est de chercher qui on peut dépouiller, ou, en termes choisis, comment on peut augmenter la productivité "sociale". Aujourd'hui les choses sont productives ou non. Réponse : tuer le crédit à la consommation. Premier exemple : le désendettement des états. Un état n'est, en réalité, rien d'autre qu'un consommateur. Pas question de laisser aux états la jouissance de capitaux qui devront être réservés, comme par le passé, aux producteurs et aux rentiers du capital. Idem pour les gens de la rue : le crédit coûte cher. Après la deuxième guerre mondiale, il a eu deux avantages : relancer la machine économique et contrecarrer la théorie de la paupérisation. Le capital consentait pour un temps à laisser une certaine partie du profit à l'ensemble des salariés, sous la forme d'un crédit incitateur à l'achat et donc à l'inflation et donc à une perte de l'intérêt de ce même crédit. Le consommateur gagnait de l'argent en s'endettant !
Le principal représentant du communisme écrasé, on peut passer au vif du sujet, dépouiller le prolétaire et le remettre dans la condition de laquelle il n'aurait jamais du sortir. D'où la liquidation impérieuse et impériale de toutes les catégories "d'épargnants" : les petits porteurs d'action et les débiteurs du capital.
Question : qui va consommer les marchandises dans une société paupérisée ? Pragmatique, le capital calcule que 5 milliards de petits consommateurs valent un petit peu plus que 1 milliard de gros consommateurs. C'est à l'évidence un mauvais calcul, les constructeurs automobiles se rendent compte aujourd'hui que seules les grosses voitures offrent des marges intéressantes, celles qui contiennent beaucoup de travail humain, bien sûr. Mais la contrainte est là, il faut prendre ce qui se présente.
Mardi le 3 Octobre 1995
Khaled Kelkal est mort. Abattu par une meute de plusieurs centaines de flics et de bidasses dans les bois près de Lyon. Belle mort, mort à méditer. Je ne crois pas tellement au fanatisme religieux et à ses vertus suicidaires. C'est plutôt un "plus rien à perdre" qui fonctionne, "fort l'honneur", bien sûr. Mais nos médiatiques ont oublié cet ingrédient de l'existence. Ignorance qui est source de bien des malentendus et d'erreurs. Il est curieux que tous les médiatiques affirment que Kelkal est Algérien. Il reste possible qu'il soit de nationalité française, mais cela dérangerait beaucoup. On pourrait évoquer à son sujet le taux de chômage dans le milieu beur, le double de celui qui sévit parmi les "Français de souche". Quelle horreur cette expression. Hier soir j'ai essayé de démontrer pourquoi il n'y avait pas de peuple français : il n'y aucune "Thora" qui unifie les Français. Il y aurait bien la Révolution et la constitution républicaine, mais les bandits ont bien maquillé les textes de manière à le transformer en un simple blanc-seing pour tyran bonapartiste. Vers 1850, Bismarck écrivait d'ailleurs : - Il n'y aura pas d'autre mode de gouvernement en France que le bonapartisme et pour longtemps - comme il avait raison. Chirac illustre à merveille cette tare, quant à Mitterrand il n'a fait qu'éviter les formes du césarisme à la Napoléon. Vieille France : France vieille.
Dimanche 8 Octobre 1995
Je ne croyais pas si bien dire avec Chirac. C'est un plouc. Gardons-nous des jugements à l'emporte-pièce, mais cette fois je ne peux pas laisser, une fois de plus, remonter mon mépris pour ce type sans le formaliser. Hier Myrie et moi avons assisté à un visionnage du voyage de Madame Zhu (que nous appelons désormais Buer, c'est son prénom) et de son mari David. Ce dernier est encore sous le choc d'une véritable commotion affective, c'est un tout autre homme après son tour en Chine, et son commentaire de diapo a été remarquable. L'enthousiasme du jeune homme a totalement compensé son manque de culture et d'outils descriptifs. Nous avons donc eu une image littéralement artistique et en même temps scientifique de ce pays mythique. David a réussi un tour de force peu commun, rapprocher par l'image jusqu'à toucher et sentir avec le nez.
Hé bien, la Chine pue. Première remarque. Deuxièmement, elle me fait l'effet d'un déjà vu d'enfance : il y a toujours le décalage de développement - au fond la France de 1945 ressemblait à la Chine d'aujourd'hui par plus d'un côté - mais mon impression vient d'avantage de la nature même des femmes et des hommes chinois : ils me font l'effet d'
être des enfants, de se comporter comme mes copains et copines des années quarante cinquante. Le côté spontané de David a été féroce, il a tout photographié avec une naïveté sans pitié, et il commente tout sans la moindre pudeur. La famille de Buer habite un infâme taudis de Shanghaï. La crasse et la rouille rongent toutes les surfaces et tous les angles des perspectives qu'offrent les images de maison ou de chambres. Le commentateur décline cruellement l'absence d'eau courante, de toilettes, de place, de simples matelas, nous décrit, photos à l'appui, son martyre chez le barbier, nous montre des villes hallucinantes de laideur, se pâme devant des parcs de loisirs pour prolétariat fatigué et se vautre dans les souvenirs de nourriture sublime dont le seul spectacle me dégoûte enfin de la cuisine chinoise. Enfin arrivé à la campagne - les lieux de pureté, disait Buer - notre David insiste avec vigueur sur les nuages de goudron glauques que laissaient échapper les mini-tracteurs datant de la Campagne des 100 fleurs, toujours avec le même enthousiasme légèrement étonné mais jamais critique. A croire que la merde sentait le jasmin et que les paysages ne faisaient que reproduire les fameux lavis de la collection Cernuschi. Ah non, je n'ai pas vu ces magnifiques montagnes découpées au pinceau et ces rizières en banquettes à paysan accroupi, ces palais d'ivoire et ces bovins immobiles et cornus, tirant, derrière leur longues protubérances, toute la misère du monde. Je n'ai vu que des paysages de train - et là, David n'est pas tendre, hou quel supplice , pas de climatisation, fumeurs invétérés en compartiments non-fumeurs, l'ho-rreur - des grottes de Lourdes en veux-tu en voilà ( incroyable comment le peuple le plus radicalement communisé du monde se retrouve aujourd'hui planté devant des pagodes et des temples à allumer des bougies d'opium du peuple !), et bref, une Chine d'épiciers pauvres, pas d'ouvriers révoltés.
Tout Chirac. Un parvenu de la troisième République, les pires. Un Thatcher français dont le père faisait de l'épicerie en col blanc d'agencier du Crédit Lyonnais. Pourquoi ? Mais c'est un fan de la Chine, chose qui me le rendait jusqu'à présent plutôt sympathique. Il aura fallu ce dessillage magistral, merci David, pour sentir les vraies dimensions de la "civilisation" chinoise. Du coup, je comprends mieux les propos de Norbert, retour de Chine. En fait, le rêve étrange qui le saisit chaque fois qu'il va là-bas, ne me paraît pas être autre chose qu'une sorte d'ambiance anamnétique de sa propre enfance, parce que tout en Chine est fait par et pour des enfants.
Travail sur ma vieille idée de l'impossibilité de vieillir : en Chine cette loi se vérifie autrement que chez nous, elle ne se farde pas, ou plutôt elle s'inscrit ouvertement dans la praxis sociale. Comme si, en Chine, on ne songeait pas à cacher qu'il n'y a aucune différence entre les générations. On peut aussi comprendre alors pourquoi l'Asie tient tant à ne pas se prendre les pieds dans les droits de l'homme et les interdictions de faire travailler notre progéniture....il n'y a pas de "raisons".
Je reviens sur une autre réflexion qui m'est venue il y a quelques jour, avant ce voyage traumatique en Extrême-Orient. Je me voyais dans le Palais de l'Empereur de Chine au moment de l'attaque des barbares. Ils arrivent de partout, massacrent gaiement et s'emparent de la place sans coup férir. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire ? A cause de la nécessité de l'immobilité de l'Empire.
Le scénario est le suivant. Le souverain vit dans le Palais de Lo Yang, ceinturé par huit murs et entouré par sept villes représentant chacune les états ou les corporations du pays. De l'Empereur dépend tout. Mais non pas comme nous avons l'habitude de le concevoir, c'est à dire de par sa volonté délibérée, mais de par la place qu'il occupe dans les rites quotidien et saisonnier. Savoir : se tenir dans l'aîle-Est du Palais au printemps, Ouest en été, etc...L'Empereur produit le temps, et donc tout ce qui fait vivre les hommes, les animaux et le reste de la réalité. La volonté de l'Empereur parfait, c'est donc uniquement le respect scrupuleux, seconde après seconde, du rite de la position. Tout doit donc être fait pour que rien ne vienne perturber le rite afin que l'Empire continue d'exister : si le souverain était empêché de passer à une phase du rite, la réalité serait immédiatement dénaturée.
Donc, les barbares réunissent leurs forces dans le Nord et partent en campagne. Les troupes impériales chargées de la garde des frontières réagissent aussitôt et envoient un messager à Lo Yang. Celui-ci arrive au premier mur et demande à voir d'urgence le préfet de la première ville. Celui-ci écoute le message et réfléchit. Pas possible de transmettre maintenant le message, se dit-il, l'Empereur est sur le point de se rendre à la tour septentrionale pour appeler les vents du Nord afin de chasser la mousson. S'il ne fait pas cela, les inondations vont s'étendre. Je passe la main au préfet de la deuxième ville, il décidera. Le deuxième préfet est confronté au même problème et ainsi de suite. Les dignitaires se rendent bien compte du danger, mais quel est le plus grand danger ? L'attaque des barbares ou la transgression de la marche de l'Empire ? La réponse est évidente. Donc, même au moment où le messager arrive enfin dans l'antichambre royale, on trouve encore un moyen ultime de le faire attendre et de le détourner de rompre, ne fût-ce qu'un instant, la routine de l'Empereur. Au moment où le message parvient enfin, les barbares sont là. Il s'est tout simplement produit une désynchronisation de la gestion métaphysique de l'Empire et de l'action politique, de l'immobilité fondamentalement nécessaire et du mouvement étranger. Le mouvement est toujours étranger à l'Empire, c'est pourquoi l'Empire est toujours condamné à s'écrouler et les souverains à s'exiler et fonder de nouvelles capitales et de nouveaux empires. En réalité, la Chine n'a jamais été aussi heureuse que pendant les campagnes de refondation des empires. Dès que ceux-ci se stabilisaient, commençaient les ennuis.
C'est aussi pourquoi il sera beaucoup plus difficile qu'on ne se l'imagine, de faire sortir la Chine du communisme. Le bréviaire de Mao est avant tout de nature rituelle. Exemple cité par David, hier soir, les populations très modestes de Shanghaï seront plus vite relogés dans les HLM radieux de demain. Motif : ils occupent les quartiers qui seront rasés en premier. La logique communiste est scrupuleusement respectée sans que ce soit la cause première de l'action. On pourrait imaginer que l'on reloge d'abord les riches et qu'on oblige les pauvres à occuper les logements abandonnés par eux. Mais le rite communiste ne serait pas respecté, il va donc se produire une situation où les barbares vont occuper le palais pendant quelque temps. Les dignitaires courent ainsi le danger de voir les crève-la-faim s'enrichir abusivement en cédant leurs nouveaux logements contre des Yuans. Il faut donc intensifier la contrainte du rite d'autant plus durement, au moins jusqu'à ce que la conjoncture permette de le transgresser sans remettre en question le statut des dignitaires du parti. Il ne restera donc qu'à interdire toute transaction immobilière au nom des principes rituels du communisme. Il n'est pas sûr que ce sera suffisant pour contenir les hordes barbares. Or il s'avère que le gouvernement actuel ait déjà pris la mesure du défi en décidant de geler le "denguisme", forme de transgression barbare du rite communiste. A Shanghaï on ne tombera pas dans le piège de monsieur Deng Hsiao Ping, du moins dans l'immédiat.
Encore un mot pour ne pas oublier : l'homme et la place d'où ça parle, à travers lui. Méditation qui devrait apporter des découvertes dans le domaine de l'application des lois de la perspectives à la relation du langage à la spiritualité.
Lundi 9 Octobre 1995
Pourquoi "spiritualité" ? Pourquoi pas tout simplement "vérité" ?
Petit manuel de psychologie occulte : le réel tient l'homme selon une certaine distance. Dans la passion il y a à la fois totale proximité et total éloignement, ce qui est fidèle à la dialectique du Dasein. Cela peut se trouver dans la synthèse érotique, où Eros se mêle aux humeurs du corps, la divinité se joint aux ardeurs du besoin. Quand donc ça parle, il devrait y avoir moyen de déterminer la distance, selon que ça signifiante le divin ou le corporel. Distance de l'Ereignis, évidemment. La voyance serait quelque chose de cet ordre, une lisibilité immédiate de l'écart entre le divin et la pulsion. La pulsion est piégée par le corps, mais elle est aussi d'origine divine, le divin étant le signifiant du trou noir de la pulsion.
Le ça parle est-il toujours repérable ? Toute parole est "ça parle", la politique n'est rien d'autre que la science de la lecture du ça parle, entre autre. Cette science met en perspective les distances qui séparent les sources de la parole et le sujet parlant. Mais en réalité, cette science est pouvoir et non pas savoir construit - c'est là toute l'erreur des lacaniens qui cherchent à construire une science du ça parle - pouvoir qui se trouve en lui-même, ou puissance. En chaque être il y a gamme de puissance et jeu fantasmatique des mélodies de cette puissance. Gnotis eauton ne dit rien d'autre que cela : connaître la gamme par coeur.
En politique simple, il convient donc avant tout de mesurer les distances. Lorsqu'un sujet parle , il parle de plus ou moins loin. On peut dresser un catalogue des distances de sécurité et des distances dangereuses. Plus le ça parle parle de près du corps, plus il est dangereux parce que près de la source ou du relais. De même à l'autre bout, il y a danger extrême à fréquenter du ça parle de grand éloignement. Par exemple Dieu et les islamistes. (fou, non?)
Mercredi 11 Octobre 1995
William Greider. Un nom à retenir dans ma biographie. Ce monsieur est un génie de la synthèse économique. Son livre The secrets of Temple est un chef d'oeuvre de clarté sur les évènements économiques américains de ces trente dernières années. Il constitue de plus une formidable cours d'économie moderne. J'y retourne immédiatement.
Mardi 24 Octobre 1995
Affaire Yves Delègue et Myriam. Un repas chez Francine avec Guy, Emmanuel, Paul Guérin Yves et les dames. Cata totale, mais seulement a postériori. Sur le moment, j'ai cru qu'on s'était bien amusé. Sujet, surgi je ne sais comment (ça ressemble à un piège, il faut que je cherche...) la littérature, ou plus précisémment le roman. Quand on connaît mes thèses iconoclastes sur le roman, on peut mesurer ce que ça peut donner avec Yves, professeur émérite de littérature, Emmanuel, agrégé de philo et élevé dans le derridisme le plus strict et surtout Myriam dont l'existence se nourrit régulièrement ad libitum semble-t-il, de romans. Bref, scandale. Je suis sorti sous les traits, dixit une lettre d'Yves, de Goebbels en personne.
Mais le plus intéressant, ou le plus angoissant comme on veut, c'est l'impression terrible de n'avoir pas été entendu, seulement entendu ! Les reproches qui on plu par la suite portent tous la marque du mal-entendu.
Mercredi 1er Novembre 1995
Toujours une date sinistre.
Qu'est-ce-que le sinistre ? Petite dissertation ?
Sinistre = de gauche ou gauche (du latin senester ?) Les choses de la réalité sont "gauches", elles ne sont pas dans leur assiette, elle débordent de l'harmonie ou la défigurent. Allons plus loin, sinistre = sans ester = sin esse = sans être / le gauche est du moins d'être, ce qui est une manière d'éclairer la monodextrie et la répression des gauchers (et le mythe qui tourne autour d'eux). Extension sur la Gauche politique, au fond, les révolutionnaires français ont accepté une dénomination qui comporte une moins-value sémantique. Mieux valait ça que rien ?
Le moins d'être doit aussi être redéfini. Les philosophes modernes comme Descartes utilisent ce concept couramment : les choses senties ont moins d'être que les choses pensées (en gros et pour aller vite).
Le sinistre n'est pas à sa place et il comporte une dose d'irréel : Novembre, avec ses nuages sombres, sa place indéterminée entre l'automne et l'hiver, sa pluie et son culte des morts, n'appartient pas tout à fait à l'année normale.
Samedi 11 Novembre 1995
Une date forte. Elle me poursuit depuis ma naissance en musique militaire et en retraites aux flambeaux. Il y a longtemps, d'ailleurs, qu'elle m'a rejoint. Mon goût secret pour la guerre s'y est laissé prendre avec, comme dirait Brassens, une petite préférence pour la Grande. Ce goût je me souviens l'avoir eu spontanément, comme tous les enfants, dans les années 45, à courir derrière les régiments et les fanfares. Mais plus sérieusement, j'ai appris à aimer le guerrier entre les murs de ma caserne de Toul. Par comparaison.
Je me souviens. Lorsque le gendarme me dépose devant la porte du 156ème CIT - un régiment du Train - ce qui me frappe tout de suite c'est l'allure des bidasses. Nul. Sâle. Entre je ne sais quoi de civil et d'autre chose indéfinissable. Je devais m'être imaginé une situation tellement autre, que j'ai été littéralement déçu de ce que je trouvais. Mais les jours suivants, l'impression se renforce. Le maitre-mot du quotidien des recrues, c'est tirage au flanc. Moi-même, qui déteste à la fois de me lever le matin et me faire brutaliser d'une manière ou une autre, je trouve ipso facto un moyen pour me soustraire au "décrassage", rite barbare du petit matin, destiné à vider les poumons de ses miasmes accumulés pendant le sommeil, pur sadisme en réalité. Réaction plutôt esthétique en fait. Pas question de paraître "con", pas question de me ridiculiser par des gestes insensés. Car la vérité est que j'ai tout de suite préféré le style militaire (de la vie quotidienne) à celui d'en-dehors des murs. Si bien que je ne demanderai jamais de sortir en permission de minuit avant le jour de ma désertion. Je préfère aussi le style militaire "correct", c'est à dire avec ses plis, son calot bien vissé sur la tête et une certaine raideur de tous les gestes. Cela surprend les officiers, eux-mêmes tentés par le style "fantaisie", à savoir le style de l'imitation du civil : cheveux longs, calot penché presqu'à l'horizontale, chaussures non conformes, le moins de conformité possible en toute chose. Moi, je ne me suis jamais senti aussi conformiste qu'à la caserne. Lorsque j'y entre, je vomis à peu près tout ce qui s'identifie de près ou de loin avec l'acte de guerre. Très vite, je me mets à aimer cette vie encadrée, stylisée, ritualisée. Elle semble être en phase avec la réalité, dureté et compacité. Le civil imité ici, trahit le civil comme lâcheté, pur laisser-aller, dérive immotivée.
En fait, ma haine de la guerre ne disparaît pas. Elle prend de l'allure, de l'angle, du pénétrant. Je deviens un pacifiste militaire. Je sens que la vie exige stratégie et tactique et surtout la lutte contre la violence. Ma décision de déserter se renforce au pas de l'oie et je continue de préparer ma seconde fuite en donnant l'impression d'être, on ne peut mieux intégré. Comment relier mon asocialité foncière avec cette hantise presque morale ? Un adage me vient à l'esprit, celui des paysans alsaciens du Sundgau : pauvre mais propre.
Détour par l'économie. Ce matin je me suis trouvé cette certitude : on ne peut pas transiger avec les choix économiques, c'est ce qui fait la différence entre politique et économie. Exemple : on privatise. Tout ou partie ? En vérité, tout ou rien. Le grand problème du libéralisme dit sauvage, c'est comment piloter aux frontières du privé et du public. C'est à dire que tant qu'il y aura du public - et comment faire autrement - il faudra bien attribuer des richesses à ce secteur : combien ? Combien et comment faudra-t-il alors en prendre au privé ? Eternel problème des impôts. On peut imaginer (mais imaginer seulement je pense) la disparition du public. A la limite supérieure, on trouve une société qui s'autogère sans institutions, un peu comme dans le Far-West, le Colt et le Livre ! Mais cela marche seulement avec l'absence de capital fixe à usage collectif. Comment pourrait-on gérer l'eau potable ou les routes etc... ? Le libéralisme c'est l'idéologie du sauvage, du pré-capitaliste.
Question : comment la concurrence peut-elle coexister avec un secteur public, aussi mince soit-il ? En réalité, même la police doit être privatisée, dans un système privatif. Cela signifierait qu'on arriverait enfin dans ce qui est toujours fantasmé comme primitif, dans le monde de Hobbes où l'homme peut être un loup pour l'homme. Ironie du sort, c'est un Anglo-Saxon qui plante le décors de la nécessité d'un état fort !
Samedi le 18 Novembre 1995
Pas de. Nouvelle devise. Pas de pétrification théorique de l'existence : il y eut le manichéisme, puis la dialectique, puis la théorie de l'inconscient. A chaque fois la tchatch humaine n'a pas pu s'empêcher de pétrifier les conclusions en piliers de temples cultuels. Ca a toujours donné dans le définitif d'une forme arrêtée de la pensée : comme si la pensée pouvait se donner des formes achevées !
Non pas que l'achèvement soit étranger à la pensée. Le concept est bien ce qui permet de passer à autre chose, opération qui indique l'abandon de certaines positions théoriques pour d'autres. Mais le concept lui-même n'est qu'une victoire temporaire, une bouffée d'oxygène à chaque fois conquise pour sortir des doctrines parce que les doctrines ont pour fonction d'étouffer : on ne peut donc pas construire de doctrine avec de vrais concepts. Ceux-ci servent uniquement à faire un saut en arrière devant ce qui se présente comme le piège habituel, le retour invétéré de l'occultisme. L'exercice du concept ou sa discipline est donc l'exercice de la liberté et de l'athéisme théorique.
Attention ! Je ne pose pas ainsi qu'il se construirait dans l'histoire une sorte d'Aufklärung mécanique à l'aide de concepts. Je serais plutôt incliné à penser que les concepts sont de purs moyens de libération. Ceux qui les lancent dans le débat le font à leur manière. Autrement dit, la version théologique a bien pu avoir, en son temps - c'est à dire au temps de sa genèse - sa force de libération d'une emprise de l'obscur. Cette emprise est à chaque fois simple concept devenu culte, c'est à dire pétrifié en doctrine.
Car le doctrinaire est de l'ordre de la communication. Ce qui signifie que le doctrinaire naît à partir du partage du concept ou à partir de son extension dans le discours dominant. Cette extension est toujours en contradiction avec l'objet doctrinaire précédant. D'où une péréquation sémantique ou une perte du contenu désaliénant du concept.
Lundi 20 Novembre 1995
Matinée historique pour moi ou pas ? Je dois voir Sabine Rollberg ce matin. Peut-être un tournant dans ma carrière. Je vois cela tranquillement : ou bien Sabine est sur la voie de ce qu'il faut faire hic et nunc en Europe (avec son Magazine télé) ou bien elle est encore piégée par les apparences du métier spectaculaire. A savoir ceci : si son magazine est un medium destiné à accompagner d'un point de vue critique la parturition difficile de l'Europe, cela peut marcher. Première condition. Deuxième condition : faire des choix politiques clairs. C'est là que le bât blesse à chaque fois qu'une nouvelle émission se prépare. Quelle politique ? L'échec est toujours à la mesure du mensonge qui consiste à dire : pas de politique. On se la joue à la "neutralité" journalistique ! Quelle blague ! Lors même que l'on peut constater tous les jours qu'aucune grande station européenne n'est neutre, on continue de prêcher l'objectivité !!! Je pense qu'elle a compris depuis longtemps que je suis homme à ne pas hésiter à faire de tels choix politiques et à maintenir les caps. Mes relations avec Zwick se sont considérablement dégradé, justement à cause de la clarté de nos choix politiques respectifs. Lui à droite, moi à gauche. Les vrais droite et gauche. Moderato cantabile : mais pour qui sait lire, les choses sont évidentes. Jeudi dernier il s'est en quelque sorte trahi en m'attaquant publiquement sur le thème : le Sri-Lanka et la Tanzanie on s'en fout, ce qu'on veut c'est de la politique française et allemande. Je me suis rendu compte avec un certain retard qu'il mettait en place depuis longtemps des hommes de droite, notamment comme correspondant en Allemagne. Je savais qu'il fréquente exclusivement des hommes politiques de droite, mais cela faisait encore partie, dans mon esprit, de son folklore.
Nous verrons ce matin où se situe vraiment Sabine, car je ne sais pas grand chose sur ses idées réelles. Elle se déclare de gauche, mais...Reste que, politique ou pas, il sera difficile de naviguer à gauche, en l'absence de véritable parti politique de gauche en Europe. On ne peut compter sérieusement ni sur le SPD ni sur les travaillistes britanniques et encore moins sur le PS. Tous ces gens naviguent dans le flou. Les Anglais n'existent que grâce à l'immense fatigue engendrée par le Thatchérisme, mais le Labour ne sait pas encore vraiment ce qu'il va faire.
La seule certitude de gauche, c'est que la seule alternative qui se pose aujourd'hui pour l'Europe et les Européens, c'est de devenir ou pas la grande Suisse du monde, la remarque de Zwick est claire à ce sujet.
Dimanche le 3 Décembre 1995
Dixième jour de grève française : SNCF, EDF etc.. Cette fois ça ressemble de plus en plus à une épreuve forte. Les Français se réveillent, l'un des rares peuples à le faire, ce qui agace tous les autres. A preuve les deux derniers numéros de Time-magazine et de The Economist (Econo -mist), galimatias paternaliste sur le comportement soit-disant archaïque des porteurs de bérêts. En réalité le monde se définit aujourd'hui par rapport à la France de la même manière (mais cette fois préventivement) que lors de toutes les alliances anti-révolutionnaires du 18 et 19ème siècle. L'histoire ne se répète pas, cette fois, ni elle bégaie. Elle invente avec l'aide du peuple le plus inventif du monde. Il y aura bien sûr le poids de son caractère anarchiste de gaulois, mais ces tribus ont mis leurs enfants à la même université, cela change considérablement les choses.
Mardi 19 Décembre 1995
Avant d'avoir senti une chose, on ne l'a pas pensée entièrement.
J'ai le sentiment que depuis un certain temps qu'il faudrait repérer, le souçi de la forme prime entièrement sur celui du fond. Cette affirmation est évidemment difficile à illustrer, voire à prouver. Mais la "construction" du monde humain offre quelques pistes. Par exemple, il paraît évident que tout l'investissement accordé depuis deux siècles au simple fait de circuler est à caractère purement formel. Il ne semble pas y avoir d'aboutissement significatif à tout le réseau mis en place pour permettre aux hommes de franchir les océans et les continents. La guerre est le seul sens objectif de l'aller-vers, et donc la conquête. Or, la situation de non-guerre fait apparaître un certain ridicule de toute la mise en scène industrielle : au point qu'il aura fallu tordre le concept de commerce pour le faire coïncider avec celui de guerre. La "guerre" commerciale prend le relais de la guerre tout court.
La circulation dans un espace exige un certain nombre de préalables. Premièrement il faut que l'espace s'avère ouvert et continu, homogène en quelque sorte. Cette condition est clairement posée sinon démontrée dans le système cartésien : la res extensa est un espace extra partes, c'est à dire infiniment sécable.
Je ne pose pas ainsi une antériorité quelconque entre le phénomène de la circulation et la théorisation de ses conditions. On pourrait dire, avec autant de chance de dire vrai, que le système cartésien est le produit des voyages du 16 et 17ème siècle qu'on pourrait dire l'inverse. Il y a coïncidence, en tout cas.
Deuxième condition : la mobilité comme faculté indéfinie. Il n'est pas évident du tout que la motricité du corps soit le paradigme de toute mobilité, autrement dit, il ne suffit pas de poser le fait de marcher pour que ce fait soit immédiatement réductible à la circulation indéfinie. Le bout du champ d'un paysan du 12ème siècle doit être bien autre chose que la limite de sa propriété, c'est aussi, sans doute une terra incognita qu'il ne suffit de loin pas de simplement franchir d'un pas allègre : on regarde où on met les pieds là où l'espace n'est pas homogène. On a longtemps cru, dit-on (mais il faudrait voir ce que vaut cette affirmation) que la terre s'arrêtait à un certain point de l'océan. Cette représentation peut nous aider à comprendre ce que signifie l'hétérogénéité de l'espace : une réalité non parcourable dans tous ses sens, puisqu'elle n'a qu'un seul sens.
Troisième condition : la faculté d'arrachement à la terre natale. Ce n'est qu'à l'autre bout du processus que l'usage irréfléchi de cette faculté pose ses propres limites : toutes les formes d'irrédentisme se rapportent, en négatif, à l'arrachement initial ou, si l'on préfère au conséquences de la redécouverte du nomadisme.
Au passage, le mystère du nomadisme devrait aussi se clarifier un tant soit peu grâce à cette thèse. On a trop tendance à identifier nos formes de nomadismes modernes au mode d'existence nomade tel qu'il peut se concevoir au néolithique et tel qu'il se découvre encore dans les formes nomadiques résiduelles. Or, je pense qu'on a tord de dire des nomades tziganes ou manouches, par exemple, les "gens du voyage". A moins que - mais qui dissipera le mystère ? - les manouches et consorts ne soient en réalité pas des survivances, mais déjà des imitations de la circulation.
Que pourrait-on dire sur le nomadisme, étant entendu qu'une telle parole aurait valeur de découverte sur le destin des hommes avant le néolithique ? Ceci au moins, c'est que le voyage des nomades n'est pas un déplacement abstrait sur un itinéraire connu à l'avance mais une progression dans un monde qui se découvre comme il est, au fur et à mesure que le nomade avance. Peut-être y-a-t-il aussi chez le nomade une connaissance innée de la réalité comme identique en tous ses points selon des critères restreints. On peut, par exemple, s'interroger longuement sur les raisons qui ont amené les hommes à peupler des régions froides et inhospitalières comme l'Europe. La réponse est dans la série de critères qui les poussaient à avancer d'un point à un autre, densité de la nourriture, de l'eau etc..Faites l'expérience de traverser le Brenner vers un 15 Août, vous passerez de l'Italie toute jaune et sèche vers une Autriche habillée de vert et bruissante de cours d'eau...
A tout le moins pourrait-on donc poser la question des mobiles actuels de voyager à travers le même monde. La circulation se définit à sa limite comme un pur déplacement sans mobiles. Le tourisme s'invente en effet de multiples raisons, mais quelle est la partie existentielle, quelle est le motif absolu sine qua non, sans lequel donc l'existence ne serait plus possible ? Si l'on veut sortir de la représentation d'une humanité qui s'agite d'une manière parfaitement absurde à la surface de la planète, il faut trouver le sens de ce nouveau nomadisme qu'est le voyage touristique. On peut tout de suite, par exemple, estimer que deux raisons au moins poussent les êtres humains à chercher le dépaysement : le déplacement spirituel dans l'histoire du monde. Les visiteurs des pyramides ne font rien d'autre que de remonter le temps. Ici on voyage donc dans le temps, rien à voir avec le nomadisme. L'autre raison est la volonté de se soustraire au choix du site opéré par les aïeux et de s'en retourner vers le soleil, puisque ce voyage n'implique plus le risque de la pénurie alimentaire. Cette fuite est un retour spirituel aussi puisqu'il se définit la plupart du temps comme une dénégation de l'existence menée le reste de l'année. Le rien-faire sur une plage est une sorte de mort rêvée.
Le séjour dans la forme se révèle donc, d'une certaine manière et en partie, comme passage d'un séjour corporel dans un séjour spirituel. En examinant un autre domaine, celui de la communication, on peut peut-être encore avancer sur cette voie.
Plus encore que la circulation, la communication s'avère aujourd'hui comme dominée par ses instruments : le monde se réseaute chaque jour un peu plus de moyens de communications, sans que l'efficace de ces réseaux ne se fassent réellement sentir, ou que le progrès soit immédiatement tangible par tous. Le commerce est, bien entendu, l'explication la plus banale et la plus difficile à contourner. Mais la vérité du "formalisme" de la communication ne surgit nulle part mieux que dans le fait que l'objet présent et massif du commerce d'aujourd'hui est précisément la communication et ses instruments, la communication sans contenu. La télévision ou l'informatique se présente toujours d'abord comme un vide de contenu, comme un divertissement creux et aliénant. La proportion de message fondamentaux véhiculés par ces deux media est infime. Elle peut se comparer concrètement à l'utilisation informatisée des bourses mondiales et à l'importance relative de quelques émetteurs comme ARTE ou CNN si l'on classe l'information dans la catégorie du fondamental. Le processus de mise en place de ces réseaux ressemble à la mise en place d'un dispositif qui devrait, un jour, avoir un sens, plutôt qu'une structure immédiatement perceptible comme gain dans le domaine du besoin ou du désir. Il est clair que le réseau fonctionne déjà à plein pour certaines catégories comme les boursiers évoqués plus haut. Mais l'écrasante majorité des hommes n'aura pas accès à ce maniement total avant, peut-être, quelques décennies. Ce qui montre au moins que pour la majorité le phénomène reste formel. Pour moi, par exemple, Internet reste parfaitement formel, même si je peux bien m'imaginer qu'il faudra que j'y vienne un jour pour des raisons alors vitales. De même je peux, encore aujourd'hui, me déclarer libre de tout liens avec la télévision, une liberté plus assurée, me semble-t-il, que l'informatique. Encore ne faut-il jamais oublier les tyrannies passée et à venir qui exercent volontiers la contrainte au media. Hitler avait fait fabriquer des postes radio pour tous les Allemands, afin que nul n'ignore. Big Brother peut exister et même donner au fond le premier sens à la communication, remplir réellement la forme du réseau comme les chars d'assaut remplissait les réseaux routiers mis en place avant la guerre.
Si le commerce et le libre-échange était réellement l'alpha et l'omega de l'existence, comme le voudrait faire croire le pragmatisme anglo-saxon, alors cette débauche formelle pourrait se comprendre comme parturition du monde. L'économie est bien, comme le disait Hanah Arendt, le métabolisme des sociétés. Il faut donc, de toute manière que se crée l'anatomie et la physiologie correspondante à ce métabolisme se mondialisant. Nous en serions aujourd'hui au même point que les paysans du 19ème siècle voyant des ouvriers construire des voies de chemin de fer, des chemins de fer dont ils n'auront, de leur vivant sans doute, pas le moindre usage. La forme fait vivre l'avenir, elle le dessine et pour qui sait voir, ces formes devrait littéralement permettre de prévoir le monde de demain. Les auteurs de science fiction n'ont jamais rien fait d'autre que de lire ces formes.
Avant de clôre ce chapître, je voudrais encore faire cette remarque, que traditionnellement la forme est forme d'un fond. Ici nous avons voulu indiquer et constater une certaine discrépance. Sans doute est-ce là un travail du temps.
Lundi 1er Janvier 1996
Est-ce une date ? Je l'ignore. Les années en seize ont toutes été des années de transition pour moi, alors...
Schéma préalable de mon ouvrage à venir sur l'Allemagne. Toujours le même sujet de préoccupation : comment comprendre la naissance du nazisme. C'est quand même intéressant dans la mesure où cette "maladie" historique semble toujours nous pendre au nez. Hier, en arrivant à l'aéroport de Francfort, nous sommes tombé sur un graphiti d'ascenseur ainsi libellé : "Die Juden sind gute Männer, aber leider nur für die Gaskammer". Le virus, donc, continue de ramper sous la croûte, il n'est pas inutile de poursuivre un travail de recherche sur sa nature, son origine et son destin.
A priori, il y a deux grands espaces théoriques dans lesquels on peut tenter de cerner l'apparition du phénomène : l'histoire, et ce qui lui est corollaire le développement du technique.
L'histoire parle relativement clair : l'Allemagne a manqué toutes les médiations inhérentes, en gros, à la dialectique du maître et de l'esclave dans le contexte d'une autre carence ou d'un autre retard, celui de l'unification. L'Italie possède en commun avec l'Allemagne justement ce détail de l'unification récente. Il faudra donc s'interroger sur la mécanique psycho-sociologique d'une formation nationale à marche forcée, comme ce fut le cas pour les deux pays en question. Il y a là une sorte de piège historique posé par quelqu'un. Or, il y a bien un mécanisme commun à la subsistance des parcelles allemandes ou italiennes, celui d'une survivance forcée du monarchisme non-parlementaire. Mais dans le cas de l'Allemagne cette survivance part d'un choix interne, c'est Luther qui opte pour la noblesse contre les paysans, renouvelant ainsi pour quatre siècles de plus le bail du féodalisme. En Italie ce sont les puissances européennes qui maintiennent le monarchisme sous leur boisseau, au gré de leurs politiques. Cette différence peut peut-être expliquer la faiblesse du phénomène fasciste italien comparé au nazisme.
Ces ratages ou ces retards fonctionnent comme des ratages ou des retards dans la mécanique dialectique dont il est question plus haut.
Samedi 13 Janvier 1996
Le destin est une affaire solitaire. La mort de Mitterrand nous enseigne peut-être à quel point un homme peut se défendre du destin. Que reste-t-il alors ?
La question aujourd'hui : par quoi l'homme d'aujourd'hui remplace-t-il la terreur atavique qui fit la fortune de toutes les églises ? En lisant le Lucien Febvre sur Luther, je suis frappé par l'intensité des angoisses qui travaillaient en permanence l'homme du Moyen-Age. Il n'y a pas de raison de penser que cette terreur n'était qu'une terreur "cultivée" par l'Eglise, un moyen politique au fond de régler le comportement des sociétés. Cette version des choses heurte à la fois le bon sens et la thèse, pourtant voisine, de la religion comme opium.
Non, la peur est une dimension native, sans doute, de la position humaine. La religion aura été une réponse. Donc, quelle est la réponse qui confère aujourd'hui une si grande insolence à nos masses ?
En me souvenant, je saisis parfaitement cette terreur, une dimension fondamentale de mon enfance : la mort n'était pas alors le néant de l'être, mais un simple passage vers le doublet enfer/paradis. Je me sentais cuit par tous les bouts et là, il faut bien reconnaître que l'église catholique a joué une grand rôle dans l'illustration des peines encourues. Ce qui est remarquable, c'est la force de cette angoisse, une angoisse jeune comme une maladie très redoutable parce qu'elle frappe un être jeune. On peut fantasmer sur un instinct de conservation qui impose une pusillanimité sécuritaire, pourquoi pas. Mais cela ne change rien au problème qui concerne par exemple les terreurs de Luther ou de St Jean de la Croix. Ces adultes n'ont rien d'oisillons fragiles, la peur est pour ainsi dire le milieu psychique absolu qui détermine tout leur parcours.
Mon vieux maître Chambon pensait avec raison sans doute, que la peur était la dimension fondamentale de la psyché et qu'elle déterminait l'ensemble du comportement humain et social. Mais lui avait à faire, en tant que métaphysicien, à l'angoisse de la mort comme néant, il pouvait généraliser et il n'expliquait pas en quoi cette peur s'enracinait, d'où elle se concevait comme angoisse métaphysique. Pour nous, cette peur-là est déjà un produit hautement culturel, un produit psychique achevé, sans doute comparable à l'état dans lequel étaient plongé nos saints, mais sans la naïveté de représentation des conditions.
Mercredi 24 Janvier 1996
Elise, ma fille, revient ! Aujourd'hui. Après un mini-cauchemar style 1986-7. La vie va changer de style et de rythme. J'ai un curieux sentiment d'impuissance à propos des évènements domestiques, comme si tout se décidait ailleurs. Exemple concret du fonctionnement inconscient de la réalité. Tout se fait sans liaisons apparentes entre les sentiments réels, la volonté exprimée sous forme de conditions. Ca se fait, un point c'est tout. Comme d'habitude.
Mon coeur se fait présent, aussi. Rapport ? Certainement, mais pas conscient non plus. La culpabilité travaille en douce sur toute la vie.
Hier : la vie humaine travaille en direction de la réduction de la précarité. La culture, par exemple, est une pantoufle, une sorte de capsule spatiale qui porte les êtres à travers le vide, au-dessus de l'enfer. Revoir Jerôme Bosch. Les Chinois avaient tout entier engouffré la culture dans leurs rites et en sont morts. Mauvaise pointure pour l'existence. La technique est-elle meilleure ? La technique n'est malheureusement qu'une source de rites encore plus terrifiants.
Vendredi 2 Février 1996
Sans doute les Chinois avaient-ils pressenti cela, que les rites techniques seraient encore plus terrifiants, dans leurs conséquences, que les rites dérivés de la "nature", sous-entendu "humaine". Ce serait la raison pour laquelle ils ont mis un terme à leur développement au 15ème siècle, le siècle de notre propre essort ! Et à bien y regarder, les hommes sont, par exemple, entrain de ritualiser le sexe ! qui l'eût cru ? Il ne faut pas être naïf. Le sexe a toujours été un motif de ritualisation. Mais on avait fait tabula rasa avec la répression tout azimut du 19ème siècle. Le sexe était entré, pour quelques décennies, dans l'ère de l'aventure : d'où le roman....
Jeudi le 8 Février 1996
J'écoute un vieux Miles. Et me souviens de l'enthousiasme des années 62-63 pour cette musique. A Alger, Miles était pour ainsi dire un plaisir à part entière. Sa musique faisait une continuelle et absolue liaison entre les moments de travail et berçait les longues lectures. A la fois milieux du temps et pure jouissance. Or, cette musique n'exprime qu'une chose, la mélancolie. La vraie, la rageuse qui proteste de la cocufiation intégrale que représente(rait) la vie, la vengeance du cadeau empoisonné. Miles est comme ça, un amer fielleux.
Alors ? On peut être dupe d'arguments logiques. On peut se tromper sur beaucoup de choses : pas sur le plaisir, ou bien ? C'est à voir, bien entendu. Mais s'il est vrai que la jouissance est ce qu'il y a de plus immédiat, ce qui fait temps sans qu'on dût faire appel à la cogitation, alors Miles correspondait très exactement à une tonalité intérieure, s'harmonisait avec les fibres de mon âme, de telle sorte qu'il en résultait du plaisir.
Par ailleurs Miles "faisait la musique de l'époque", et allait la faire encore pour des lustres. L'harmonie est donc encore plus profonde, c'est une époque (à défaut de trouver un autre mot) dont le coeur bat en harmonie avec la mélancolie. On choisit Miles comme on a choisi Kafka, sans doute, ou Chateaubriand en d'autres temps, ou encore les poètes chinois.
Cette musique est à chier, comme on dit aujourd'hui sans ambages. A peu près aussi emmerdante que les musiques classiques espagnoles qui pleurent sur l'empire perdu. Ca lustre, ça cire les pompes du calendrier, ça pleure la fin du Jazz gai, de l'amour sans définition. Et moi, anticolonialiste pur et dur, je faisais (comme on dit "faire caca") la même chose ? Les porteurs de valise pleuraient en silence le déclin des colonies, cela même qu'il appellaient de tous leurs voeux.
Pas si drôle tout ça. Mais que faire contre la vérité ?
Cela dit, je note quand même qu'aujourd'hui Miles ne me la fait plus. Les tirades déchirantes, c'est fini. Mon âme a du opter pour autre chose, encore qu'il faille être prudent, car rien ne dit qu'on ne finit pas par s'épuiser dans d'aussi grands et longs plaisirs. Pire : ma dérive vers la musique dite "classique" correspond peut-être à encore pire que le béguin pour la mélancolie du vingtième siècle. Mais je ne le pense pas. Il y a plutôt une inversion des valeurs qui fait que Heandel charrie finalement beaucoup plus de vraie joie, de saine recherche du plaisir que nos musiques. C'est d'ailleurs grâce à ce constat qu'on peut comprendre les valeurs de réalité de la religion chrétienne.
Samedi 17 Février 1996
Extra-systoles en série : repos.
Je me désénamoure de Jünger. C'était dans l'air depuis que j'ai omis de lui souhaiter son centième anniversaire (!), mais la lecture, à laquelle je suis enfin parvenu, de son roman Eumeswill, m'ouvre des horizons inaperçus jusqu'à présent. Jünger fait souvent référence à ce livre, le motif m'apparaîr désormais clair : se définir ou, comme on voudra, se justifier devant l'histoire. Eumeswill est avant tout une peinture d'un personnage qui est lui-même, Manuel ou Martin (ce qui n'est pas sans éveiller des soupçons sur sa propre identification avec un autre Martin du 16ème siècle...allemand). Manuel ou Martin l'anarque, concept que l'écrivain développe souvent dans ses carnets mais jamais en profondeur comme dans Eumeswill, fiction d'un pays situé au-delà de l'histoire où l'action pourrait se résumer en une description du double destin d'un tyran et de cet anarque qui le sert. Evident qu'il s'agit de parler des relations de Jünger avec Hitler, et ce, plus de trente ans après la disparition du premier. Pour condenser mes impressions, j'ai l'impression que Jünger a autant de mal à condamner le tyran qu'il (a servi) sert, que d'arrogance pour légitimer la mesure dans laquelle il l'a servi et qui, dans son esprit est loin d'être rien. On apprend, entre autre, dans Eumeswill, que Jünger est fasciné par...Tibère ! L'un des plus immondes césars que Rome ait couvés en son sein.
Entendons-nous bien. La tyrannie semble être un choix politique, comme on choisirait de préférer cette forme historique aux autres. Ce choix implique qu'on assume les horreurs ordinaires de la tyrannie : machiavélisme, cruauté, cynisme etc... et qu'on privilégie l'efficace et le côté techniquement préférable (semble-t-il) de la tyrannie. Jusque là, tout va à peu près et tout irait bien intellectuellement si, si Jünger ne menait pas un double-jeu qui consiste à identifier Hitler à la tyrannie classique -celle dont parle Aristote par exemple- dans cette volonté d'auto-justification sous-jacente. Or, même dans le contexte que peint Jünger, son tyran qu'il appelle Condor, ne ressemble en rien à Hitler. Le résultat est un tour de passe-passe raté. Dommage. Mais je n'ai pas fini le livre, on va bien voir et j'y reviendrai si nécessaire.
Résultat inattendu de cette lecture, une découverte intéressante sur la Shoah. Par déduction, justement, entre la peinture de la tyrannie classique et la réalité des faits du nazisme, il apparaît clairement une différence radicale : la méthode. Je découvre ainsi la raison pour laquelle les Allemands sont non seulement loin du moment où ils oublieront la Shoah, mais sont condamnés à y penser et à s'en angoisser de plus en plus.
En effet, la grande différence entre la tyrannie - ce qu'ils ont tous cru avoir exercé sur le monde pendant les années noires du nazisme - et les méthodes de la Gestapo, c'est l'industrie. Heidegger l'avait, lui, parfaitement compris. Or, et c'est là ma découverte, l'écologisme épidermique des Allemands ne peut en aucun cas les conduire à oublier cet aspect de leur crime : ils souffrent très exactement par quoi ils ont péché le plus violemment, et ne le découvrent qu'aujourd'hui que l'industrie les a privés de leur être -la forêt- et de leur liberté - le plaisir-.
J'ai rouvert ce fichier pour y ajouter quelque chose sur le roman. Je ne lis plus de romans (romanae delendae sunt...), or Eumeswill est un roman. Je vois par là que Jünger attaque par un angle précis : celui des malades, des femmes et des enfants, humanités que je considère comme les clientèles favorites du roman. C'est dire long sur les stratagèmes auxquels est parvenu ce héros de la première guerre mondiale. Sa faiblesse : le roman, exactement ce qui a toujours opposé la Germanie à tous ses voisins, Rome et la latinité, voir Heidegger.
Pour plus tard : les résultats de mes lectures conjointes de la Phéno et de son commentaire par le même Heidegger. C'est fabuleux, mais que peut-on en dire sur les Allemands. Pourquoi les Allemands me hantent-ils ? A cause de mon grand-papa ? Je ne pense pas.
Lundi 19 Février 1996
Il faut que j'écrive plus : je lis trop et il y a un équilibre (à trouver) entre ce qui rentre et ce qui sort, sinon c'est la panne dans tous les secteurs.
Aujourd'hui théorie des Juifs-juifs et des Juifs-chrétiens. Pour une fois Myrie a été attentive à mon exposé. Par exemple : Norbert est un Juif-chrétien alors que Marek est un Juif-juif.
Le propos vient d'une constatation : les Juifs-juifs ne s'inscrivent dans rien, ils semblent au-delà, comme dit Jünger, de la bénédiction et de la malédiction. Pas d'engagement rationnel, tout au plus passionnel. Je dis tout au plus car je soupçonne que certaines formes de la passion sont parfaitement rationnelles, en quel cas elles font partie des simulacres ou des comportements simulés, de gré ou de force, selon.
D'un air amusé, elle a conclu en me classant parmi les Juifs-juifs. Pour flatteur qu'il était, le propos ne pouvait me convenir et je cherchai immédiatement à me sortir de l'impasse, je ne pouvais rater l'occasion. J'ai donc trouvé la vieille malédiction qui me suit depuis les années de Montparnasse, l'époque où une sorte de voyante m'avait, d'un air assez épouvanté, catégorisé comme chevalier teuton. Sur le moment, le diagnostic m'avait frappé parce que j'étais déjà parvenu aux mêmes conclusions. Cela se passait juste après mon passage à la caserne à Toul, avant ma désertion. Ce séjour avait été un véritable piège destinal, dont je n'ai malheureusement pas compris le message, pourtant évident : j'ai eu le coup de foudre pour la vie militaire, immédiatement et sans transition. Pourtant je suis resté trop bête pour trahir mes options "rationnelles" et passer à l'ennemi. La question a toujours été de savoir si mon caractère réfractaire était précisément mon côté militaire (et jamais militant). L'armée a, au fond, toujours été le foyer des êtres qui avaient su découvrir en eux la dimension dérélictive : autant s'intégrer dans une machine "propre" pour aller à la mort, que de ruser avec la fantaisie. A l'époque d'ailleurs, la "fantaisie" était le sport favori des trouffions : porter des cheveux longs fantaisie, des calots fantaisie, bref, ressembler le plus possible à ceux qui vivaient de l'autre côté du mur : les civils. L'horreur. Des années plus tard, Jean Montcharmont (alias Maldoror) m'avait décrit comment il avait procédé en Algérie lorsqu'il était dans les bataillons qui crapahutaient dans le djbel. Il s'était un jour rasé la tête et avait commencé de se mettre dans la peau d'un véritable guerrier, un Rambo avant la lettre. Mais pour lui, sans doute, c'était là un pur jeu de comédien, ce dont il a toujours rêvé.
Non, pour moi c'était sérieux. Lorsque je croisais un officier dans la cour de la caserne, je le saluais toujours avec un tel souçi de la forme que le brave lieutenant ou capitaine se retrouvait tout surpris, parfois pris lui-même au défaut du "fantaisie". On m'a, par la suite, c'est à dire après ma désertion, attribué beaucoup d'intelligence, pensant évidemment qu'en réalité j'avais monté toute une pièce de théatre pour les endormir. C'est très comique. Le fin du fin a été lorsque je suis sorti de prison; là j'ai fait comme Jean, sans savoir qu'il l'avait fait. Je me suis rasé la tête parce qu'il fallait que je retourne dans une nouvelle caserne, et là, l'officier qui devait me caser quelque part a eu comme un coup de foudre pour ce soldat d'allure si pure, et il m'a nommé, sur le champ, son secrétaire particulier. Je n'ai jamais occupé cette fonction, m'étant fait évacuer dès la nuit suivante au Val de Grâce d'où je suis sorti en permission définitive. J'étais resté réfractaire, en me disant cependant plus d'une fois par la suite que rien ne m'aurait interdit, à ce moment-là de faire carrière dans l'armée. Sorte de nostalgie tout à fait authentique. Ce qui m'a toujours retenu, je pense, c'est que l'armée française avait, depuis longtemps intégré le civil en lui-même. Il restait peut-être encore la Légion Etrangère....encore Jünger !!!!!
Tout cela est à méditer au sujet de mon fils Alexi. Il semble bien parti pour des tribulations de même carat. Je risque en fait de rester totalement forclos en tant que père, et pourtant j'aimerais tant l'aider, qu'il aille au moins plus vite que moi !!!!! Décidément, le genre "journal" porte à une certaine répétition, mais après relecture complète, je constate que ce n'est pas si terrible. Etonnant, même.
Mardi le 20 Février 1996
Ces carnets ont déjà quatre ans ! Je les ai donc relus tout au long de la journée et j'ai très envie de me relancer dans la galère de les faire éditer. Question préalable : qui va lire ça ? Resterai-je le seul lecteur réel de ces pages qui s'empilent ? Sans doute, et pourtant il y a encore des gens qui travaillent intérieurement.
Mercredi le 21 Février 1996
Il y a de curieuses lames de fond dans l'existence. Hier j'ai relu. Hier soir j'ai sorti mes cartons de croquis. Il y a quelque temps déjà que j'ai envie de me remettre au dessin et à la peinture. Quel coup au coeur ! N'est-ce-que pur narcissisme de se ressentir à travers des lignes qu'on a élaboré, si difficilement ! Le plus chaud c'est la représentation de Mouschka, je retrouve de l'amour ! De l'amour que je ressens aujourd'hui ! Magie du dessin.
Bref, j'ai envie, besoin de pondre. Que se passe-t-il ? Car d'un autre côté je travaille beaucoup en lecture. Enrichissement ultime ? Enrichissement ? Qu'est-ce ? Lame de fond : le fond, c'est quoi ? Pour l'instant précis, le fond c'est le pouvoir émotionnel de vieux papiers griffonnés. En croquant Mouschka, semble-t-il, j'ai déposé une substance sur le papier, une substance qui produit des effets de chaleur, une sorte de radioactivité affective. Cette radioactivité, je la ressens toujours dans les musée d'art. Au bout d' une heure à peine, je craque; c'est trop. Là c'est l'angoisse qui prend place, comme s'il y avait quelque culpabilité ou danger à en voir de trop. Imaginez ! Vous passez de Rembrandt à Breughel et de Poussin à Van Gogh. Il y a quelques chose d'injuste dans ces festins visuels, j'ai l'impression qu'on ne peut pas condenser dans la vision des oeuvres qui ont elles-mêmes pris tellement de temps et de puissance du voir pour exister. Au fond, le visiteur des musées croit qu'il peut voir plus et plus vite de beauté que chacun des artistes qui a produit. C'est absurde et j'ai parfaitment raison, il y a dans le tourisme culturel quelque chose de profondément délictueux, une perversion qui devrait en dire long sur l'éthique contemporaine. Le mot goberger illustre bien cette frénésie aveugle qui, un jour, se paiera.
En attendant, je vais, pour la xième fois, et avant de reprendre mon carnet de croquis, relire le commentaire d'Heidegger sur l'Introduction à la Phéno. Pauvre Phéno, c'est le texte sans doute le plus orphelin de toute la philosophie occidentale, et pour cause....
Jeudi le 22 Février 1996
Mois riche en notes.
Aujourd'hui c'est au tour de l'eau. Depuis des années je professe en privé que tout aliment végétal n'est qu'une forme de l'eau. Les distinctions entre fruits, légumes, légumineuses etc... n'implique donc, du point de vue diététique que des dosages de formes. Toc. D'où des questions fort intéressantes : un cucurbitacé comme le concombre n'a pas les mêmes qualités digestives qu'un agrume. C'est à dire que le corps ne le reçoit pas de la même manière, ni en même quantité ni dans le même temps, ni dans le même rapport avec le reste de l'alimentation. On balaie évidemment les distinctions vitaminiques, la présence des sucres et autres mystères de la chimie. Il doit donc aussi exister une science de l'usage de ces formes, une science des compatibilités et des incompatibilités, des successions dans le temps - et pas forcément des saisons -, de leur traitement par le feu et les autres moyens de transformation ou de conservation etc... Dans les années soixante, il s'est opéré une évolution désastreuse dans l'art culinaire. Du jour au lendemain on a inventé, sous des prétextes divers - prééminence d'autres plaisirs, hâte d'en finir avec une fonction, inventivité vaniteuse, irrespect et paresse devant la science et la coutume, invention de la convivialité en tant que convivialité, bref adolescence du savoir-vivre - des mets impossibles. Il suffit de citer ce plat devenu un must des rencontres "informelles" : la salade de riz ! Les mânes culinaires de mon clan alsacien se retournent dans leurs tombes en même temps, à chaque fois que cette chose immonde se présente dans mon champ de vision.
La salade de riz est à l'évidence un pur pretexte pour en finir avec la science dont j'ai parlé plus haut, le souçi de réfléchir sur la diversité des formes du végétal et de l'ordre qu'il est pertinent d'y introduire. En même temps on évacue pour de bon les interdits gastronomico-éthiques : plus question d'admettre qu'il faille couper les oignons de telle manière plutôt que d'une autre, inacceptable que telle variété de pomme de terre ne puisse s'envisager comme base d'une purée, évident que n'importe quel morceau de barbaque découpé dans un boeuf est bon pour un pot-au-feu. On ne "blanchit" plus rien, on n'écume plus, on ne dresse plus rien, on mange.
Et pourtant, rien n'interdit de remettre les recettes du passé en cause, à condition de réinventer une base théorique solide. La cuisine dite "nouvelle" est un exemple, au demeurant pas si raté que ça, s'il ne s'y était glissé de ces aberrations dites inventives qui fichent en l'air la meilleure assiette de saumon ou de lièvre. L'autre jour on m'a servi des mandarines avec un râble de lapin grillé ! C'est encore pire que cette crême Chantilly servie avec le hareng-saur de l'autre côté du Rhin, accompagnée de confiture de myrtilles ! Les pauvres Allemands n'y sont pour rien, leurs belles traditions culinaires, car il y en a d'extraordinaires, ont bien souffert au cours de ce siècle.
Dimanche 25 Février 1996
La musique ! Comme exercice de domptage. Voilà ce que j'ai ressenti ces derniers jours à écouter Richter jouer Chopin. Domptage multiple : il faut d'abord dompter avec une précision inouïe les matériaux avec lesquels on fait les instruments. Verticalement et horizontalement, i.e. synchroniquement et diachroniquement. Pour jouer une partition qui date du 17ème siècle il faut une base matérielle commune. La maîtrise de la fabrication des instruments au cours des siècles en dit long sur ce qu'on dénigre sous le nom de culture. Il y a là une continuité dont on ne parlera jamais assez ; elle reflèterait, pourrait-on dire, le long travail du concept dans le temps, la tradition. Ici le domptage est une oeuvre sur le temps. Or, quels sont les activités humaines dont la finalité est aussi ambitieuse et aussi réussie ? La guerre ? Sans doute, à la différence que la guerre a réservé quelques surprises très désagréables à l'humanité. Si on comparait l'exécution de la Symphonie Héroïque au temps de Beethoven et aujourd'hui, on serait forcé de constater des différences très minces, imperceptibles. La même opération sur l'art de la guerre serait instructif. Dans ce cas, l'oeuvre sur le temps deviendrait plutôt l'oeuvre du temps sur l'oeuvre : les hommes dépendent entièrement de facteurs quasi incontrôlables. Les Allemands ont eu de sacrés suprises en 1914, le canon de 50 à tir tendu a fait des ravages totalement inattendus. Leur Grossa Bertha, en revanche, a été d'une efficacité plus que douteuse. La bombe atomique a été une énorme gifle à l'humanité toute entière, un rappel tellement radical qu'il a fait plus pour la "mondialisation" des mentalités que n'importe quelle idéologie. Je ne peux pas imaginer une évolution de la musique aussi importante, une catastrophe, devrait-on dire.
On a cru que le Jazz était cette catastrophe, et aujourd'hui beaucoup de monde ferme les yeux sur la crise de la musique des années 50-60. Une crise à vrai dire peu évidente, à peine visible dans un certain état de délabrement des orchestres ici et là. La période fut aussi féconde, sinon plus, que d'autres, mais le prestige de la musique "classique" semblait entamé. Il n'en était rien, ou presque, le Jazz est devenu lui-même classique.
Il faut ensuite dompter le corps. Corps et instrument : quel miracle. Regardez un orchestre et tremblez. Combien de muscles doivent se soumettre à une mécanique implacable selon une harmonie qui ne pardonne aucun manque. Combien d'esprits et d'oreilles tendus à craquer pendant deux ou trois heures, produisant par les mains, la bouche, les bras et tout le corps des sons qui commandent absolument à tout ce qui, alors, se passe, commandent au temps même. Comment peut-on imaginer, sans angoisses, que des lèvres de chair réussissent à mouler des sons parfaitement, sans hiatus, sans l'ombre d'une erreur ! De la chair molle, douloureuse, si difficile à discipliner ! Que les hommes réussissent cette opération-là, c'est un grand espoir. Le sens en est si profond qu'on ne saurait l'analyser ainsi sur le pouce. Il signifie d'abord l'urgence de la chose : les hommes ne font rien sans l'urgence. La musique est première, elle reste première à tel point qu'une partie de plus en plus importante de la marchandise est devenu de la musique en conserve. Quand nous étions adolescents, nous ironisions en prophétisant la réification de la musique. Nous disions que la publicité allait tantôt s'emparer de Mozart et de Monk. Aujourd'hui c'est chose faite, et malgré le côté agaçant de la chose, ce qui ne fait que traduire notre déformation petite-bourgeoise au fond, c'est une victoire dont les effets ne se feront sentir que dans quelques siècles. Cela signifie entre autre qu'il nous reste des siècles ! Pas mal du tout pour une génération qui attend la fin du monde depuis le programme Manhattan ! La fête de la musique m'a aussi beaucoup fâché, et pourtant ! Dans sa rusticité idéologique, cette initiative politique est sans doute géniale, encore faut-il souligner que Jack Lang n'a pas eu de mal à saisir cet esprit du temps tourné vers la musique comme jamais. Comme jamais sans doute parce que la société n'a jamais été aussi, disons, démocratique : la musique est élitaire par définitition, justement parce qu'elle est d'essence magistrale. Or, jamais, la musique n'a régné comme ces temps-ci, sur tous les coeurs et sur tous les tiroirs-caisse...preuve que l'esprit de l'élite est descendu sur les masses qui font le bonheur des commerçants.
Il faut enfin dompter l'histoire elle-même : c'est de la magie. Oui, il faut qu'un pékin du 20ème siècle trouve quelque part le moyen, le vecteur, la puissance, je ne sais pas comment dire, de jouir historiquement, c'est à dire en décalage par rapport à son temps. Les enfants n'y arrivent pas spontanément, ils restent dans ce que produit le siècle lui-même, mais ils y arrivent par morceaux, par bribes arrachées à leur sens naturel du beau. Mon fils Alexi a été touché immédiatement par Haendel, peut-être en raison de certaines circonstances, mais très sincèrement, au point de m'en demander le CD avec une insistance qui ne trompe pas. Cette jointure-là, entre la sensibilité de l'aristocratie napolitaine du 16ème siècle par exemple, et la nôtre, c'est quelque chose comme un miracle. Le miracle existe donc là : dans la culture, dans la volonté continue de jouer avec nos sens selon une certaine rigueur. C'est de la fabrication de temps. Ainsi peut se comprendre plus simplement, peut-être, le somptueux texte d'Heidegger sur l'origine de l'art.
-----------------------
Dans la soirée. Un combat à mort ? Un combat tout court ? Un fantasme ? Les Jèzes me poursuivent de leurs assiduités masquées. Il y a longtemps que dure ce petit manège. Depuis avant mes exploits néo-militaires, après et encore après. En deux mots, j'appelle ça le service après-vente du collège StClément. Question : qui est le consommateur ? En principe c'est ma maman qui a payé, cher, le collège où j'ai passé de bien mauvais moments de mon existence. On y était payé pour ça, dit-on. Ma maman est morte depuis longtemps, donc il s'agit d'un autre consommateur qui demande des comptes : qui ?
Réfléchissons : si le produit (moi) ne répond pas aux critères exigés par l'éducation des bons pères, il faut tenter d'y remédier. Mais des critères pour qui ou pourquoi ? Pour qui travaillent les jèzes, en réalité ? Le Pape ? Ouais, seulement ouais et de façon très médiate. Leur but immédiat c'est la classe dirigeante -dogme pratique de St Ignace de Loyola : il faut influencer les élites, au besoin il faut en fabriquer de toutes pièces. Dont acte un peu partout dans le monde. C'est ainsi que se transmettra le mieux la Parole etc...- il faut fraiser ce petit monde de futurs énarques et autres en vue d'en faire de bon missi(les) dominici. Le produit est réussi ou pas, mais dans tous les cas il faut le suivre pour, soit rectifier sur le terrain, soit circonvenir les carrières par tous les moyens dont on dispose, et ce n'est pas peu, quoique les choses ne doivent plus être aussi brillantes qu'il y a quarante et quelques années. Il y a trente ans j'ai reçu un jour, en des circonstances particulièrement pointues pour moi, l'un de leur véritables missi dominici, non masqué. Le pauvre, un copain du collège avec lequel je m'étais mortellement brouillé et qui de surcroît a trouvé moyen de se ranger du côté de l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie, ennemi par tous les bouts. Mais grand coeur comme toujours je me suis contenté de l'envoyer courtoisement sur les roses, lui qui venait m'offrir une nouvelle existence, une réinsertion, ha ha. Il semblait d'ailleurs soulagé de me voir refuser, je ne l'ai plus jamais revu sauf en photo, à côté de Raymond Barre dont il était devenu un farouche et très droitier partisan. Ce garçon avait déjà joué un rôle de comédien au collège même, sur ordre des pères, expérience qui lui avait valu mon mépris le plus profond; à cette époque il sentait déjà l'amateur d'expédients à plein nez, homme de sac et de corde chic de choc.
Récemment, les bons pères ont récidivé. Je les gène peut-être, quelque part. Leur missionnaire est plutôt de bon aloi, mais si naïf. A suivre...enfin du roman !...
Mercredi 28 Février 1996
Je me suis rebranché sur Hegel. Travail de Sisyphe d'autant plus dur que l'intellect vieillit (?). Que faire avec Hegel et pourquoi ? Première surprise agréable : le texte allemand est humain. Je comprends enfin, trente ans après ! , des bribes de raisonnement. Il faut dire que la lumineuse clarté des commentaires d'Heidegger n'y sont pas pour rien. Ces commentaires sont d'ailleurs la raison pour laquelle je me remets courageusement à la Phéno !...
Mais encore. La Certitude Sensible est le site de l'ontologie première : le monde, la réalité, sont du présent et du ici, du hic et du nunc. Hegel nous raconte une sorte de fable, une mise en scène de l'homme (de la conscience) dans un décor artificiel qui serait la présence pure. Objectif : démolir le mythe de la présence pure : il n'y a PAS de présence pure : elle est toujours déjà entachée d'autre chose et cette autre chose c'est, me semble-t-il, le mouvement, autrement baptisé MEDIATION ou encore expérience. L'homme expérimente le monde dans un mouvement qui exclut la présence, qui la balaie au fur et à mesure qu'elle afflue. Heidegger, qui est très respectueux du grand esprit, n'ose pas le dire carrément, mais moi je peux bien le dire : Hegel tente en fait de se débarrasser de l'être en l'expulsant progressivement de toutes ses positions. La fameuse Aufhebung n'est rien d'autre que le vinaigre de son système, le formol destiné à conserver ce qu'il annule d'entrée de jeu ou qu'il tue. L'Aufhebung conserve le cadavre de l'Etre. Or, Heidegger insiste sur le fait que, depuis Descartes, le site de l'ontologie est le sujet. Il peut donc d'avance pardonner à Hegel de procéder à une liquidation de l'Etre lié à l'envoi historial de la subjectité. Lui, Heidegger, sauvera - au formol ? - l'Etre dans sa progression -Aufhebung - historique/historiale. Hegel, et avec lui Descartes, Kant et Leibniz, ont bel et bien, à chaque fois, réinstauré l'Etre dans sa prépondérance logique, d'où ils l'expulseront comme crétinerie doxique pour y mettre dieu. Le geste déjà inauguré par Aristote et Platon.
Mais encore. Hegel inaugure, dans et avec le langage, l'histoire du monde comme fonctionnement sans fin, comme mouvement du mort se reproduisant. Sa grande faute logique est de ne pas avoir saisi que le Savoir Absolu est l'équivalent de la mort. Savoir, c'est mourir à la chose sue. Aufheben, c'est sauter par-dessus la substance pour éviter de l'abîmer !.. Nietzsche dit quelque part cette banalité lorsqu'il met en cause l'expression, c'est à dire le langage : pour lui, le fait même de dire une pensée, c'était déjà l'annuler. Le système hégélien reste donc bien un système de fossoyeur. L'Allemagne trouve là un puissant ressort pour son nihilisme. Et Heidegger ? Lui qui s'est retrouvé au milieu du feu nihiliste ? Pourquoi s'est-il mis à commenter Nietzsche justement après s'être brûlé les ailes au Rectorat de Fribourg ?
Mais encore. La dialectique du Maître et de l'Esclave -devenue entre-temps celle du Seigneur et du Valet- illustre magnifiquement cette manière de cocufier la substance, de ne rien faire tenir comme acquis. Mais Hegel use du mot et de l'idée de jouissance : le maître jouit l'objet (le nie absolument en le détruisant) pendant que le serviteur le forme (le nie relativement en le mettant au service de sa négation du maître) etc... Or cette jouissance disparaît en tant que jouissance pour devenir un passage vide (lieu vide, dit la dialectique). Vous êtes d'accord ? N'y-a-t-il pas d'objet-jouissance, c'est à dire pas de cendres après le festin ? Si c'est vrai (qu'il n'y a pas de jouissance), alors la dialectique se casse la gueule elle-même en un pur jeu de mots. Hegel n'a pas pu admettre que l'Etre est jouissance : que le monde est seulement passage dans le jouir de l'Etre. Il admet le fantôme de cette vérité, qui dit : le monde est passage dans le jouir de dieu. En psychanalyse cela pourrait s'énoncer ainsi : le monde est passage dans le jouir de l'autre.
Mais encore. Le destin de l'art, de nos jours, indique que l'étant devient autre chose qu'un concept logique. Avec la jouissance esthétique, l'homme entre de plein pied dans le vrai savoir absolvant. Lacunaire parce que le malentendu subsiste d'une supposée inanité de l'être de l'étant. Kant, le contempteur par excellence, a pourtant fait un geste intellectuel fondamental en liant absolument le beau avec l'au-delà. Car, si le beau : pourquoi pas le reste ?
Si le beau, pourquoi pas le reste ? Bonne et belle question. Le beau n'est-il pas seulement le petit bout de la lorgnette, la partie visible de l'iceberg ? Si l'homme chaussait enfin de bonnes lunettes métaphysiques, ne verrait-il pas que le monde n'est que cela : de la beauté ? Sa terrifiante nostalgie n'est-elle pas la meilleure démonstration ? Pourquoi les poètes chinois perdent-ils leur temps à décrire le vol des oiseaux ou la tonalité d'un jour de pluie ? Voilà la raison qui explique le vers de Vigny sur les vers les plus beaux qui sont les vers les plus tristes. Au fond Hegel aurait sans-doute voulu décrire le Tout, trouver la formule pour rassembler le tout, pour un usage courant : le fast-joui. La Phéno comme recette (ratée) du fast-joui.
Jeudi le 29 Février 1996
Les strates se forment dans ma conscience, comme dans le règne minéral. C'est gênant pour un journaliste, car les évènements prennent un tour si relatif qu'il est difficile de les prendre suffisamment en compte. Assez pour les exploiter comme des informations passibles de ce label. La plus importante partie de mon travail à la rédaction, c'est de convaincre les journalistes que les choses annoncées ne sont pas du tout essentielles. D'une part il y a les informations qui sont le produit de stratégies comprenant des effets d'annonce, ils forment le gros de ce qui vient par les agences, de l'autre les petits évènements fonctionnels, ce qui arrive tous les jours dans la politique, le remue-ménage des "grands" et puis la kyrielle des anniversaires. Choisir dans ce magma n'est pas inintéressant car le choix suppose un discours que, peut-être, quelques uns finissent par percevoir. C'est là tout l'enjeu des carrières.
Les strates entre plusieurs sortes de temps, de vécus diraient certains. Au fond le solide, le dur, inaltérable et en même temps chaud, bouillant, comme le manteau de la planète. Puis les couches intermédiaires, les affects permanents, dont on ne se défait pas à la légère. Non qu'on en a été vraiment victime, mais qui sont ce qu'ils sont car de toute façon il faut y passer. Et puis la surface, la mousse ou l'écume des jours, états de conscience qui peuvent se muer en véritable plaisir lorsqu'on suit bien la partition : le temps se rythme lui-même, avec ses propres baguettes et ses cymbales, ses masques et ses grimaces de rue. Il, le temps, forme des familles de formes qui reviennent tous les jours, des familles de bruits et de sensations. La "certitude sensible" me fait rigoler quand je pense à la vérité de la relation ontologique, celle qui lie réellement la conscience au reste, s'il s'agit d'un lien, car on peut aussi supposer qu'il s'agit d'une création. Ainsi il me paraît évident que cette relation est, d'abord, réussie ou pas. Ce qui ne signifie pas porteuse ou non de vérité (de quoi s'agit-il ?), mais créatrice de bonheur, bonne-heure, bon temps, quoi ! Les bonnes méditations concernent donc, à mon sens, d'abord les modes d'approche de cette relation : tout le contenu de l'éducation devrait être consacré aux différentes recettes pratiques de vivabilité du monde. Avant de devenir le véritable royaume de ma conscience, le monde se présente comme étranger (c'est pratiquement le contraire de la certitude sensible, en faisant remarquer que Hegel lui-même est obligé d'admettre que c'est la relation la plus riche), le monde est un cactus plein de chausse-trappes et de situations non conforme à notre structure immédiate du besoin. L'anarchie de la distribution des bonus et des malus trahit le manque de savoir-faire et non pas un absolu de réalité douloureuse ou je ne sais quoi.
Par la suite, ou avec l'âge, le désordre s'adoucit et l'on commence à distinguer : d'abord le monde lui-même, auquel on reste aveugle si longtemps ! puis son discours ou son murmure qui finit par cimenter les morceaux du temps. La vie commence par un bercement et se termine pareillement. Le mystère reste l'obligation de passer par une phase rugissante, où domine l'oubli de soi-même : les plaisirs forts sont sans doute liés à cet aveuglement parce qu'ils ne sont encore que des idées de plaisirs : encore un renversement des valeurs ! Par la suite le plaisir devient un réel, enté sur le plaisir réel du monde. Car il n'est pas important que le plaisir soit centré sur l'ego, cet ego n'existe que comme
pars inter partes et peut donc aussi bien jouir du plaisir des
partes que de sa seule
pars. Le vieillissement est bien, comme le dit Sartre, l'isolement progressif du moi, mais en même temps ce moi s'étend, se dissout dans la réalité, la subjective. Le sujet de l'ego rejoint le sujet du monde : l'hypokeïmenon. Le savoir absolu ce serait cette réconciliation ou ce jointement qui s'opère inlassablement, comme se jointent les vagues des océans.
--------------
Mes amis d'enfance, mes amis de ma jeunesse ont tous disparu, ou presque. Dolphi est passé ce soir, me rappeler à cette douloureuse réalité. Nous avons parlé de Jean Louis Charvot et de Jean Montcharmont et de Richard Marachin, pourquoi ont-ils disparu ? Disparu de nos vies ?
J'en ai fait longtemps une fatalité. Je me disais, bon, l'autre finit par se manifester, l'étranger finit par surnager dans l'être qu'on avait cru nôtre. C'est faux. Au contraire, aujourd'hui, je pense que la raison fondamentale de l'éclatement de toutes les amitiés de jeunesse c'est la pudeur, une certaine ressource de la nature qui fait que les êtres semblables ne peuvent pas demeurer ensemble. Cela nous protège. Je me souviens, il y a quelques années j'avais rencontré Jean Louis et nous avions parlé. Il parlait la même langue que moi, ou presque. C'était inaudible, inacceptable. La nature rassemble ceux qui se ressemblent. Après, dans leur propre intérêt, il faut parvenir à séparer tous ces semblables, sinon ils sont foutus.
Samedi le 2 Mars 1996
" La certitude immédiate ne s'empare pas de ce qui est vrai, car sa vérité est l'universel; alors qu'elle veut s'emparer du
ceci. En revanche, la perception, elle, prend pour l'universel ce qui, pour elle, est l'étant".
Tous les jours un peu. C'est difficile, l'ambition est grande : entrer dans la tête de Hegel ! Lire un texte ancien, c'est comme chercher de l'or, il faut laver et relaver les boues avant de trouver les pépites. Il y a d'abord une accumulation primitive, puis un saut qualitatif, bientôt tout s'éclaire et on peut relire le tout. Ainsi, dans ce petit paragraphe, que de boue !
La certitude c'est la "Gewissheit". Jusqu'où faut-il remonter pour bien saisir ce concept, et le saisir à l'allemande, dans le gewiss, le sûr/certain/précis/untel etc...Bien entendu, la Gewissheit c'est la première étape du Bewusstsein, de la conscience. On sent tout de suite que la conscience n'est pas quelque chose de simple, mais un objet construit, linguistiquement structuré à partir de Wissen, savoir. On est de plein pied dans une philosophie de la connaissance. On est aussi dans l'ambiguité : le "wiss" de gewiss n'est pas un même savoir que le "wiss" de wissen. Le gewiss est d'abord certitude, c'est à dire une tonalité du savoir; or quelle tonalité peut-on agréer au savoir ? Y-a-t-il des degrés dans le savoir ? Qu'est-ce-qui différencie un savoir certain d'un autre ?
Bonne question, car la problématique de Descartes risque de souffrir : pourquoi a-t-on besoin de certitude, c'est à dire d'une sorte de poinçon authentifiant une chose sue. Car la certitude ne peut pas être plus que cela, un mode d'authentification et de garantie : souçi presque commercial concernant la pensée. Comment peut-on concevoir des savoirs authentiques et des savoirs non-authentiques. Sur le fond, personne n'est dupe. Le savoir non-authentique ou l'opinion ne sont pas des savoirs. Alors que le savoir est une réalité simple : quand j'ai froid, je sais qu'il faut que je me couvre. Je sais aussi que je peux m'illusionner de mille manières, mais quand je m'illusionne, je le sais parfaitement. Si je suis du nombre de ceux qui "croient", je le sais aussi et il découle de cette attitude un certain nombre de conséquences possibles, que je connaîs aussi : tolérance / intolérance, culpabilité /non-culpabilité etc..
Il faut, dit Descartes, poinçonner la science. Ah ! nous y voilà. Mais pourquoi faut-il trouver, pour la science, une garantie dont on se ficherait par ailleurs ? Ou qui, du moins, n'a pas été explicitement requise dans un autre domaine. Le poinçon doit fonctionner comme légitimation de ce qui est produit par le travail intellectuel, car, vraisemblablement, il y a un doute. Quel doute ? Doute sur l'efficacité de la science ? Non, car celle-ci s'est, "entre-temps mise en route d'elle-même" (dira Hegel plus tard). Doute sur la finalité de la science et donc sur un droit d'exercice humain ? Sans doute, puisqu'il sagira avant tout de convoquer Dieu à cet examen. Le poinçon s'avère donc plutôt comme un "droit de savoir", une autorisation qui estampille une pratique jadis considérée comme douteuse, au sens de semi-délictueuse. Les alchimistes finissaient souvent sur des bûchers. Il était, au 17ème siècle, grand temps de "libérer" ce secteur.
Heidegger, lui, estime que Descartes accomplit un renversement de beaucoup plus essentiel : avec le cogito, le savoir passe tout entier du sôté du sujet. Jusque là il traînait un peu à droite à gauche, une fois dans l'étant, une fois dans le sujet, une fois dans la médiation, et la science était une sorte de catalogue de la répartition. Le cogito restructure totalement, en totalité, tous les modes sur lesquels se déclinait le savoir : savoir humain, savoir divin, savoir mondain. Cela ne semble vrai qu'à moitié, puisque Dieu reste dans la course comme "âme" du poinçon, et que la matière elle-même reste présente comme altérité du cogito. Heidegger dira que Hegel parachève l'empire du cogito sur le savoir. Soit. Ce faisant, il reprend bien, en effet, le travail sur la certitude. Ou bien, c'est bien par la problématique sur la certitude que Hegel commence son parcours onto-théïologique (dixit Martin H.), celui du "logos phénoménal de la conscience", ou "comment la conscience phénoménalise l'étant", si j'ai bien compris. Ou, "comment l'étant phénoménal devient étant consciencial pour faire de l'étant l'affaire exclusive de la conscience, de soi".
Pour cela, Hegel part de la certitude, il part du plus haut niveau en disant, prudemment, "sensible". Il ne s'engage pas tout de suite dans un circuit du savoir, mais d'abord dans un domaine, au fond, anatomico-physiologique, celui du sensible : la certitude sensible. C'est là que rien ne va. On ne peut pas confondre le savoir, c'est à dire ce qui toujours déjà est réalisé pour la conscience, avec ce qui ne serait qu'une amorce - ou une figure - d'un mouvement de la conscience. Heidegger le dit : Hegel patauge dans le mouvement comme détermination de l'être, et si l'être est la conscience (ou si la conscience est le seul théatre de l'être), alors elle, la conscience, fonctionne comme une montre suisse, avec un "mouvement".
Mais encore. Sensible (sinnlich). Intéressant : le chapitre II de la Phéno commence par " Die unmittelbare Gewissheit", expression prise comme équivalent de "certitude sensible". Sinnlich et devenu unmittelbar : sensible est devenu immédiat, ha ha ! Joli passage en force, subreptice et non évident, même si à la fin du chapitre précédant, on était bien arrivé à cette confusion du sensible et de l'immédiat.
Le savoir est gradué et visiblement graduel. Dans cette gradation, la première étape est l'immédiat. Soit. C'est quoi l'immédiat ? L'immédiat c'est le sensible répond Hegel (avant qu'on ne lui pose, d'ailleurs, la question ; c'est ça l'immédiateté !). Ce n'est pas rien que de partir d'une détermination ontique pour caractériser l'être : le sensible c'est ce qui se sent par les sens : que vient faire la conscience là-dedans ? La seule "immédiateté" du sensible, c'est le lien entre les afférents et les efférents, mais pas la "présence", caractéristique, elle, de la conscience. Autrement dit, la présence à soi du monde est tout aussi immédiate que le sensible du ceci et du ici. D'ailleurs, les catégories du ceci et de l'ici, n'ont pas grand chose de catégories "sensibles". Ceci comme ici sont des généralités logiques et non pas sensibles, comme chaud, froid, rouge etc...
On comprend alors que Hegel
résume la métaphysique occidentale des gradations ontico-ontologiques. S'il y a de l'immédiat dans l'étant, c'est le sensible, c'est à dire ce produit bâtard de l'agitation des sens. Mais il joue aussi sur un velours linguistique : Sinn signifie aussi bien sens (au sens de vérité), que sentiment ou sensation. Il peut donc distinguer Sinn(nehmung) de Wahrnehmung : prise de sens et prise de vérité, même si ça dit exactement la même chose ! Il y a, quelque part dans l'histoire de la langue allemande, des évènements qui ont croisé les significations. Sinn possède la signification générale de "sens", dont il faut exclure la sous-signification de direction qui, en allemand, se dit Richtung. Dans mon dialecte germanique, l'alsacien, Sinn a la signification toute-puissante de sens au sens de raison : Es hat kein Sinn : c'est insensé. Tout ce qui, en revanche, ressortit du sensible, possède son vocabulaire à chaque fois singulier : je hume, j'entends etc.. Même les perceptions vagues ou confuses possèdent leur mot : Spüren, sentir au sens d'être ému ou simplement d'éprouver.
D'ailleurs, comme le signale très bien Heidegger, les sous-titres des deux premiers chapitres de la Phéno parlent par eux-mêmes : La certitude sensible porte sur le ceci et l'opinion (là aussi il y a un jeu de mots sur meinen, qui veut dire à la fois opiner et à la fois sous-entend apropriation, mein-en, devenir mien), alors que la perception porte sur l'objet et l'illusion.
Ceci et opinion / objet et illusion : chaque fois c'est le même, le ceci n'est qu'opinion, l'objet n'est qu'illusion. Mais quelle est donc la nuance ? Pour nous, Français, la différence entre opinion et illusion réside peut-être dans le fait qu'opiner implique une action de la volonté, alors que s'illusionner n'a pas forcément pour fondement un faire délibéré. Dans la certitude sensible, Hegel dit partout " je désigne l'ici " et "je vise le maintenant" etc...Alors que dans le chapitre suivant sur la perception, il a déjà délégué le vouloir aux catégories elles-mêmes : il dit : la certitude immédiate ne s'approprie pas..., certitude et perception sont devenus sujet. Donc ça colle : la perception illusionne, la perception est devenu sujet de la conscience. Précédemment, pour illustrer la subjectité de la certitude sensible, il a bien fallu dire Je, je vise ceci etc...Le sujet c'était encore moi, comme cela le redeviendra dans le savoir absolu, lorsque Hegel dira : - "La chose est Je".
Mais encore. Opiner chez Hegel signifie : dire ceci, dire maintenant, autrement dit, se
situer dans l'étant. La certitude sensible oriente : elle trace le cap (pour la conscience). Qu'elle tienne ces ici et ces maintenant pour vrais ou non n'est pas directement le résultat du viser du ici et du maintenant. Il n'y a encore rien de faux dans l'acte de viser un ici, le faux ne peut provenir que d'une adjonction de désir véritatif, lequel désir est à rechercher chez le "sacheur absolu", le lecteur ou le philosophe. Et s'il y a du faux dans les ici et les maintenant, ce n'est pas encore du faux dans l'étant, mais seulement du faux dans l'orientation dans l'étant !
C'est bien d'un voyage qu'il s'agit dans la phénoménologie de l'esprit. On l'a dit, c'est le voyage dans l'Histoire. L'esprit s'incarne dans les phénomènes pour faire retour à lui-même, il traverse le miroir. Or, il importe de prendre le bon chemin avant de s'avancer dans les phénomènes, et le bon chemin c'est...la dialectique !
Je risque de me répéter (et de répéter Heidegger) mais tant pis : l'immédiat c'est, avons-nous découvert, le sensible. Or, tout au début, le terme immédiat s'applique au concept de Wissen, savoir.
Texto : si l'objet immédiat de la recherche est le savoir, alors il faut commencer par l'objet immédiat du savoir lui-même etc...Cet objet c'est le sensible, or, on l'a dit, ici et maintenant ne sont pas des Gegenstände, des objets, mais des lieux vides ou direction. Cet objet c'est le sensible ou, ajoute Hegel, l'étant. Donc, il faut commencer par le
savoir de l'étant ! C'est faramineux ! On n'a pas démarré qu'on se trouve déjà dans le savoir de l'étant ! Par rapport auquel il faut se tenir dans un rapport aussi immédiat que les deux autres immédiatetés, celle du savoir comme objet d'étude, et celle de l'étant par rapport au savoir. Pardon ? Qu'est-ce-qu'un savoir immédiat ? Qu'est-ce-que "se tenir dans un rapport d'immédiateté" ?
A priori, on peut penser qu'il s'agit d'un mime. Pour y voir plus clair sur le savoir immédiat, le savoir non-immédiat doit mimer les étapes plus ou moins immédiates du savoir s'ébranlant. Sauf que, primo, le savoir tout court est, par principe, le contraire du savoir immédiat, c'est à dire tota lement inadéquat en tant que mode de saisie, ce qui implique ou provoque le secundo à savoir le sujet sachant qui se casse la gueule à peine entré en scène. Principale ambiguité de tout ça : la confusion toujours nécessaire entre le "nous" de la philosophie et le Je de l'expérience de la conscience. Hegel a disséqué pour lui la conscience, et la recoud pour nous, voilà le problème.
Mardi le 5 Mars 1996
Tabula Smaragdina : à suivre, grand mythe de la Renaissance tardive. Jacob Boehme et toutes ces sortes de choses. Gonflés quand même, ces philosophes de la nature ! Il y a chez eux une manière - qu'on retrouvera chez les Hegel, Fichte et cie - de palper le surréel et même de le disséquer qui est proprement scandaleuse. En fait le siècle des Weltanshauungen ce n'est pas le 19ème, mais bien déjà le 17 et 18ème. Des visions du monde qui restent toutes baignées d'irrationnel et dont seules parfois, les constructions restent séduisantes. Voir aussi Hegel... Mais sans doute faut-il d'abord considérer les conditions dans lequelles ces hommes ont pensé et se sont exprimés. Il suffit pour cela de comparer la force de l'obscurantisme aujourd'hui même avec ce qu'elle pouvait être dans les années 1500 ! De nos jours on pense d'ailleurs un peu vite avoir acquis une totale liberté d'expression : le décor ne finit-il pas par prendre le dessus ? On croit dire ce qu'on pense, parfaitement inconscient de toute la série de compromis intellectuels que l'on a déjà été ammené à faire. Vieille affaire.
L'histoire de la pensée est une constellation qui finit, pour nous, par se souder avec le temps (de la vie), le tout est de savoir ce qui alors se forme et avec quels matériaux. Il ne faudrait jamais cesser de l'alimenter pour ne pas risquer n'importe quel amalgame, mais alors on retarde aussi la levée du tableau final.
Mercredi le 6 Mars 1996
Revenir aux sources. Quelles sources ? Celle qui a déjà donné ? Je veux dire par là, la source intérieure qui a déjà produit, dans ma vie, une certitude dont je n'arrive pas démordre. On pourrait me classer parmi les intégristes de la raison. Tout entier du siècle des Lumières. Hier, j'ai lu cette citation de Luther : " si on consulte la raison on ne croira plus aux mystères " ! Bien vu l'Augustin ! Or le mot important là-dedans, ce n'est pas "mystères", même avec un pluriel , mais bel et bien "croira". La voilà, la fameuse Foi des onto-théologiens. Dans ce cri fanatique on dit plein de choses incroyables et qui ont fait l'Europe moderne (dit-on!). On dit par exemple : "si on consulte la raison". Comme la pythie ? Heureusement Hegel est passé par là pour montrer que la raison ne donne pas de consultations, mais régente, qu'elle appartient au "on" et qu'on y passe vaille que vaille, volens nolens. La haine de la raison c'est une pathologie.
Mais encore. Les sources : j'ai aussi une sorte de foi. Je dis bien une sorte de, car à vrai dire il s'agit plutôt d'un sentiment qui n'a rien à voir avec une croyance ou une adhésion dogmatique ; en réalité une certitude. Un peu comme Maine de Biran pensait que tout pouvait se comprendre à partir de l'effort musculaire, je pense, quant à moi, qu'on ne peut rien comprendre du tout, et que c'est précisément ce rien là qui gouverne tout l'humain. La docte ignorance, ce n'est pas vraiment ça, quoique les Lumières doivent beaucoup à un Nicolas de Cues pour l'extraordinaire leçon de tolérance qu'il nous offre. Comme Montaigne et Erasme, Cues était un diplomate, pas seulement un prêtre, ni seulement un philosophe. Plutôt qu'une docte ignorance qui trouve son salut en dieu, ma certitude porte sur l'inviolabilité ontologique de l'être : la raison ne peut pas faire plus, mais c'est déjà énorme, que de déblayer toutes les fausses croyances et tous les énoncés prétentieux sur le sens de l'être. En fait, le sens de l'être réside tout entier dans sa parfaite opacité, sa résistance à l'investigation. Cette résistance (ce mot pourrait faire un beau titre) absolue - et c'est là le seul absolu digne de ce nom - impose la communauté des hommes parce qu'elle égalise tous les individus. Si la puissance de l'esprit est le bien le plus essentiel, alors son impuissance concrète lui trace des limites, et ces limites sont l'humain. Etrange que l'on ai tant cherché à fonder les Droits de l'Homme sur des égalités futiles, alors que la réponse est là : la seule égalité réelle est notre aveuglement congénital. Cet aveuglement peut se poétiser, comme le fît Spinoza et bien d'autres; il peut sans doute aussi se structurer comme le fît Kant. Kant était le plus proche de cette intuition fondatrice : l'homme génétiquement aveugle de l'être, mais au lieu de prendre cette cécité pour le fondement de la curiosité ontologique, il renverse le tout et fait découler la cécité d'un constat ontologique ! Ce qui est impossible. La structure qu'il découvre montre bien qu'on ne peut rien voir, mais il outrepasse sa capacité d'observation pour en arriver à ce qui est déjà là, au début. Toujours déjà...disait Hegel. L'absolu c'est bien ça, une position oedipienne d'origine. Pas un hasard sans doute, qu'Oedipe soit la figure reprise par Freud, indépendamment du roman familial. L'inconscient c'est aussi une expression poétique de notre position ontologique, c'est aussi -et Lacan n'aurait pas dû se gêner- le Fax de l'être, l'être faxé par le langage.
Lundi le 11 Mars 1996
Il y a un enjeu majeur entre les métaphysiques "continentales" et l'empirico-pragmatisme anglo-saxon : la morale : si pas de lois, pas de vérité, pas de BIEN. On a pu voir que le consensus autour d'un bien supposé n'est pas forcément vrai ou "bien" : le nazisme raciste a finalement perdu la partie, alors question : aurait-il suffi que Hitler triomphe militairement pour valider le racisme ?
Je préfère rester hégélien, jusqu'à un certain point. C'est quoi, rester hégélien ? Pour moi il s'agit de reprendre un flambeau, un pari fait par la tradition. Il est vrai que les systèmes philosophiques de l'Antiquité sont comme les chevaux du tiercé, il y a ceux qui arrivent, ceux qui traînent et les outsiders. Mais le jarret de ces chevaux c'est nous. Il nous incombe de donner de la force à l'un ou à l'autre de ces canassons, parce que deux millénaires l'ont déjà fait avant nous et avec un relatif succès. Hegel sauve le tout, il achète toute la course, comme ça il est sûr de gagner, c'est ce que fait aussi Marx d'un certain point de vue, tellement bien qu'il vaudrait sans doute mieux que les deux finissent par s'accorder.
Le problème, c'est que Hegel n'est plus d'actualité. Il disait lui-même qu'un philosophe peut au mieux "être son temps". OK, mais alors que devient le hégélianisme aujourd'hui ? D'un côté il est réalisé à travers l'état. De l'autre le système lui-même n'a plus aucune crédibilité spirituelle. Il y a un abîme infranchissable entre l'époque de la réalisation de la philosophie dans une Europe qui ignore les possibilités auto-destructrice de l'homme et notre monde de la peur concrète du suicide collectif. On dira que le millénarisme peut revêtir de multiples formes, et que le châtiment divin avait autant de force dissuasive que la bombe. Je ne le pense pas. On ne mesurera jamais assez justement la force de l'optimisme du début du 19ème siècle et l'effet de cet optimisme sur la pensée. En 18O5 il était si facile de penser : Napoléon + la science/Dieu = le salut de l'humanité. Mon traitement de texte ne me permet pas de faire un mathème vraiment propre, veuillez m'excuser !!!Il faut transcrire ainsi : Napoléon plus la science, le tout sur Dieu, égale le salut de l'humanité.
Vendredi le 15 Mars 1996
La fraternité. La fraternité est un idéal, mais aussi une nécessité. La vie humaine s'étend entre cet idéal et cette nécessité. Il existe des fraternités nécessaires : la biologique, le langage et les circonstancielles, fraternité des naufragés ou des soldats etc...Elles ont toutes en commun qu'elles ne demandent aucun effort, elles ne dépendent pas de la volonté. En revanche, les fraternités qui sont idéales sont toutes difficiles : fraternités de pensée, de morale, de combat politique. La fraternité tout court, celle qui s'inscrit dans la devise nationale des Français par exemple, est la plus difficile. Difficile aussi de partager la fraternité dans l'art, mais une fois qu'il s'est constitué une "fratrie" autour d'une oeuvre d'art, alors elle est pratiquement indestructible. Songeons à ce qui s'est construit autour de la musique ou de la peinture.
Or les fraternités nécessaires sont aussi les plus fragiles, ou ne portent parfois que le nom sans en contenir la substance. Les frères biologiques se haïssent bien plus fortement que les frères de race, les frères de race que les frères de combat etc... C'est ce qui explique l'étonnante résistance de la République française. Le serment constitutionnel est plus solide que tous les liens consanguins et dynastiques. L'histoire européenne devrait être reconsidéré à la lumière de ce scandale que fut l'invention (ou la réinvention) de la fraternité nationale. On s'est d'ailleurs empressé de nommer cela "patriotisme", on s'est empressé de mettre le père à la place du frère !...On sait que Valmy ne fut pas une victoire très glorieuse, mais cette victoire n'était pas celle des armes, elle était celle des coeurs. Les ennemis de la France étaient littéralement écoeurés d'être obligés de se battre contre un peuple, chose qui n'était plus arrivée depuis la guerre de Cent Ans et dans un tout autre contexte. Il vient de se publier un livre sur le concept de noblesse. Enfin un historien se permet de donner une autre définition de cette réalité que celle qui se réfère uniquement à la naissance. Monsieur Schalck affirme, et j'ai toujours pensé ainsi, que la noblesse était liée à la vertu et aux armes. La naissance comme critère du noble fait partie, selon lui, et je lui donne encore pleinement raison, à la mise en place de l'absolutisme. La parution d'une théorie comme celle-là peut avoir de multiples causes, dont celle d'une réhabilitation historique des sang bleus, mais quoiqu'il en soit, elle remet les pendules à l'heure et pas seulement celles que l'on pense. La Fronde a été l'un des derniers cris de protestation de cette noblesse-là, suivie un siècle et demi plus tard par la Révolution, elle-même une sorte de résultat du travail de la perversion du concept. Mai 68 aussi fut une revendication de noblesse au plein sens du terme, de noblesse étouffée par la marchandise.
La fraternité est au coeur du partage de la vertu et du courage. Lisez les Romains. Les Gaulois avaient su admettre la grandeur de ces valeurs, au demeurant affichées par celui qui allait les trahir une fois pout toutes !..Ah César !
Dimanche le 24 Mars 1996
Même pour admirer il faut se mettre dans les rangs.
L'existence n'est pas un critère. D'autant plus que le concept lui-même est douteux, parce que simple concept. Toute une nuit de demi-sommeil transcendantal pour atteindre la terre ferme de l'analyse phénoménologique !
Comment peut-on comprendre la question de l'existence, telle que la posait, par exemple, Descartes ? Le monde existe-t-il vraiment ?
Quelle question ! Pour comprendre que cette interrogation ai surgi dans cette forme, il faut partir du point de vue qu'elle a "fini" par surgir, après un long travail scolaire (aujourd'hui on dit scholastique..). Et encore : on sait quels aléas a subi le concept d'existence rien qu'en quelques décennies. Il faut donc étendre cet aléatoire sur plusieurs siècles pour saisir enfin le malentendu dans toute sa dimension. Le monde existe-t-il ? = question stupide, la plupart des penseurs ont découvert une fois ou l'autre que la réponse à cette question ne changeait rien à l'affaire. Aussi Descartes n'a-t-il jamais posé une telle question ni donné, par son cogito, une réponse visant à élucider ce mystère. Cogito sum ne signifie pas : Je pense donc je suis, mais : Je pense, donc je suis sûr de moi. Non pas sûr de mon existence, mais de ma qualification en tant qu'esprit producteur de vérité. On peut tirer cette certitude vers l'idée d'existence en passant par la substance d'Aristote, et c'est bien par ce chemin-là que Descartes a conduit sa méditation.
Dimanche 31 Mars 1996
Il faudrait encore ajouter que cette qualification elle-même n'a rien d'absolu, elle ne traduit que les limites de la vérité produite par le cogito. C'est pourquoi Descartes a eu besoin du label Dieu pour garantir sa pensée. Sans Dieu, sans la fiction de Dieu, pas de construction logique aboutissant à une vérité absolue. Le "savoir absolu" hégélien lui-même, ne fonctionne que grâce à la notion divine, car il ne fait rien d'autre que la synthèse entre le panthéisme de Spinoza et l'agnosticisme de Kant. Kant agnostique ? Je n'ai lu ça nulle part, et pourtant...
Soyons clairs : de quelle vérité est-il ici question ? La scientifique : n'existe pas. La "vérité" scientifique c'est la tâche de Sisyphe; elle appartient bien à la rigueur du cogito mais seulement à celle-là, il ne se cache aucune rigueur supérieure derrière la pensée qui ferait des résultats de la science autre chose que le produit du désir de savoir. De Spinoza à Hégel, le désir devient volonté : le cercle absurde du savoir absolu de la conscience de soi se donne pour le roc sur lequel la volonté peut s'arroger tous les droits. Une manière bien plate de légitimer l'existence. La fatalité (le fatalisme) est bien là, qui se contente de renvoyer le résultat de la recherche au constat initial en le bénissant. Marx a bien vu cela et son démocritisme foncier ne pouvait pas tolérer cette enflûre véritative tyrannique. Il a aussi entrevu derrière ce fatalisme, la trahison de Luther condamnant les hommes à leur présent en légitimant religieusement leur malheur.
Ce Luther était-il un fou ? Tout porte à me le faire croire, un fou dangereux utilisé par les uns et les autres pour une toute autre affaire que la religieuse. Son opposition "stylistique" aux érudits de son siècle montre bien qu'il y a quelque chose de profondément barbare dans son univers mental. Barbare par rapport, bien entendu, et c'est la seule barbarie qui se tienne dans son concept, au monde gréco-romain. Le vrai problème chez Luther n'est pas sa revendication de l'individualité du destin, mais l'identification qu'il fait de l'individu et de sa société, la germanique : la conscience une devient l'état un. La souveraineté quant à sa forme n'a plus aucune importance. Or le malentendu est total, car l'état allemand du 16ème siècle est bien l'état romain; ce que Luther bénit donc comme la réalité incontournable, c'est l'état construit sur une philosophie qu'il vomit et non pas la société germanique dont le mythe traverse son expression. Il donne carte blanche à des seigneurs féodaux dont le pouvoir est calqué sur celui du dieu de la théologie catholique. Ce pouvoir exorbitant, nous le retrouverons dans la période nazi, perversion définitive et résultat final de cette fausse révolte contre le monde judéo-chrétien.
Samedi le 6 Avril 1996
L'oeuvre ne prend sa lisibilité que dans son ensemble. Autrement dit, il n'y a jamais de maturation d'un génie ou pire encore, de "développement". L'oeuvre totale ne fait que donner accès progressivement à ce qui est "toujours déjà là". Cela figure-t-il dans Hegel ? Le style de l'énoncé en tout cas. C'est peut-être tout simplement le fondement premier, l'idée de départ de l'hégélianisme, cette dynamique incroyablement immobile de l'être.
Je pense qu'on a tous envie de penser comme ça. Il est beaucoup plus difficile d'imaginer l'être en mouvement. Le paradoxe est que spontanément il apparaît bien comme tel, l'immobilité est toujours derrière le mouvement. Mais une fois qu'on a épluché l'étant et qu'on est parvenu à cette banquise ontologique, il est difficile de revenir en arrière. Ce retour est sans doute aussi un aspect de la pensée de Hegel, et peut-être a-t-il échoué à introduire un faux mouvement dans la fixité de l'être. Nietzsche s'en tire grâce au cercle, immobile par définition.
J'ai mal au ventre. Tout ça est banal. Peut-être totalement sans intérêt. Pourquoi suis-je polarisé par l'idée qu'il faut que je pense ? Depuis quelques semaines je caresse cette autre idée que le culte de la mort est un vrai culte : l'homme recherche les modes d'accès les plus adéquats à la mort. Je me réserve de définir ailleurs le concept d'adéquation dans ce registre, disons, de chercher à définir. Ce matin je n'en ai pas la moindre idée.
Mais encore : accès adéquat. Derrière cette expression hâtive, il y a quand même l'intuition bouddhique que la mort est une délivrance. La seule chose qui me chagrine dans cette manière de penser le destin, c'est que la délivrance implique une permanence. Il m'est et me reste totalement hors de portée d'attribuer une telle qualité à qui ou quoi que ce soit.
Mardi le 9 Avril 1996
Refection du salon. Affaire sociale. L'occasion quand même d'en finir avec un certain ton baroque. Mais, quelle importance ?...
Sur une piste plus intéressante : la qualité morale de l'homme. Bien sûr, dit comme ça, on se demande quoi. Mais il s'agit en fait du vieux débat entre Hobbes et Rousseau. Pour faire court, aujourd'hui, je dirai : le deuxième a tort à cause des erreurs du premier. En gros, la malédiction portée sur l'homme par ses propres "livres" a toujours été et reste à usage politique. Les castes de prêtres s'en sont amplement servi à travers l'histoire de toute la planète, c'est une constante qui va de la Chine à la Méditerranée, avec, peut-être, une heureuse exception, quoique, chez les Grecs. L'inversion des termes chez Rousseau, la rebellion contre ce jugement, ne pouvait donc qu'être lui aussi politique. Dirons-nous alors que l'homme n'est ni bon ni mauvais ? C'est assez correct, mais je pense avant tout qu'il n'y a rien à dire de tel sur l'homme. L'humanité exige, elle aussi, un apprentissage, un apprentissage qui serait quelque chose comme l'histoire. Or, on pourrait admettre le manichéisme de la morale dans ce cadre-là. Mais il faudra aussi accepter un jour de passer à la phase "professionnelle" de l'humanité, et cesser de jouer avec les "qualités fondamentales" de l'âme humaine.
L'enjeu est important, car avec ces jugements moraux sur l'homme, on vise en fait, et le bouddhisme le montre parfaitement, la qualité de l'être. A commencer par la vie. Et on aboutit à ce paradoxe que la beauté de la nature, origine, nous dit-on de l'idée de dieu, perd ses charmes et sa raison d'être.
Samedi le 20 Avril 1996
Mon coeur bave à la poupe. Pourquoi ? Je ne sais trop. Je sais seulement que je ne peux pas faire ce que je voudrais. Je suis comme ficelé dans un fonctionnement du temps, dans lequel je n'ai pas d'autre place que celle que j'occupe en ce moment. Je me sens lâche, fatigué, incompétent (sic!), nul quoi. Faire chanter l'avenir, voilà qui me manque. Maintenant, chaque minute de la vie compte, chaque minute ratée me crucifie. J'ai peur que la plus précieuse de toutes mes conquêtes ne finisse dans le ruisseau, dissoute dans l'Autre. Mon envie de peindre montre bien que mon appétit pour le réel n'est pas mort, mais je n'y arrive plus. Je m'abîme dans la contemplation de mes visions passées, mes quelques peintures et dessins me sont comme des havres de consolation, les dernières cartouches de jouissance. Dur. Ca passera. En tout cas je suis heureux d'avoir fait cet effort (je me demande parfois comment j'ai fait), j'ignorais que ce serait aussi gratifiant. Oui, des cartouches, pour tenir. Question : Picasso disait que même s'il détruisait une toile après l'avoir peinte, elle aurait quand même produit son effet. C'est du mysticisme ? Bien sûr, moi je me régale d'une manière narcissique, mais au fond, Picasso retire une jouissance narcissique par délégation. Ses oeuvres couvrent le monde, et il le sait. Quel effet cela me ferait-il de savoir mon grand tableau de Mulhausen chez quelqu'un d'autre ? Et puis j'ai envie de faire du Holbein, quelque chose qui se rapprocherait de l'art des îcones. Je vais d'ailleurs m'acheter des feuilles d'or. Crainte : involution vers le décoratif infantile. En même temps Marek m'explique les fondements théologiques de l'art orthodoxe. Le regard de dieu. Pouah !!! L'oeuvre d'art est-elle un point d'ancrage ontologique ? Ca veut dire : y-a-t-il condensation de réalité autour d'un tableau, qui fonctionnerait alors comme un corps mort où l'on peut amarrer son bateau facilement. L'art comme port ontologique. Mouais.
Il faudrait peut-être que je fasse enfin du cinéma, que je me plonge dans l'image. J'y croyais dans le temps, au lieu de bouffer ce que je vois comme des trouffions qui bouffent ce qu'il y a dans la gamelle. Je pourrais réécrire avec une caméra mon second entretien, de l'ontologie en video. On pourrait appeler ça ontovideo.
Il faut que j'arrive à convaincre Myrie de m'acheter une caméra. Après tout, si j'ai raison, et si tout est ontique, s'il n'y a que de l'étantité, il suffit d'appuyer sur le bouton. C'est ce que les photographes ont compris depuis longtemps.
Je vais le faire. Je VAIS le faire. Sur le câble, il y a une chaîne qui ne diffuse que des paysages : ça s'appelle Landscape, de l'interlude non-stop. C'est trop....
Samedi le 27 Avril 1996
Ecrit une lettre au Monde à propos de la vache folle. Le propos est simple : la technique a autorisé l'adjonction de farines animales à l'alimentation des vaches avec le résultat qu'on connaît. Or, on vient d'apprendre qu'Oxford aurait vécu pendant des années avec de l'argent de l'industriel allemand Flick, condamné en 1945 pour complicité d'exploitation de déportés. D'où cette reflexion simple : l'argent d'Auschwitz fonctionne dans la science agronomique anglaise comme le prion étranger qui vient s'agréger au capital génétique humain. Le tout à partir de la remarque d'Heidegger sur la Shoah, selon laquelle la fabrication de cadavres était la même chose que l'agriculture industrielle.
L'intérêt du propos, non développé dans ma lettre, est l'idée que l'argent possède différentes valeurs, différentes "natures" incompatibles avec certains usages. On pourrait montrer ainsi que la valeur de la monnaie qui apparaît sur le marché n'est qu'une valeur fictive, ou, autrement dit, une valeur non universalisable, et de ce fait non mondialisable.
C'est bien le problème fondamental de la mondialisation : les dollars qui proviennent de l'exploitation d'enfants asiatiques ne peuvent pas, stricto sensu, avoir la même qualité que les dollars du marché du travail américain ou européen. Ces dollars ne devraient donc pas avoir la même efficience, le même pouvoir. Dans un cas comme dans l'autre, il y a abus d'usage de valeurs d'échange. Ce qui s'illustre très bien par le problème de l'argent sale. Pourquoi la mafia aurait-elle plus de difficultés à recycler ses capitaux que les patrons de PME chinoises ou malaisiennes ?
Dans le cas des vaches folles, l'argent sale de Monsieur Flick représente la falsification de la finalité de l'agriculture en général. La poursuite de la rentabilité c'est bien cette négation de la finalité particulière de l'agriculture qu'est la nourriture de l'être humain.
Ainsi se révèle aussi le côté pervers de l'universalité supposée de la monnaie et sa complicité souterraine avec le crime.
Samedi 4 Mai 1996
La mort, chef d'oeuvre à la portée de tous. Bernard agonise à Sarrebruck. Myrie et moi avons pour ainsi dire "orchestré" sa fin. A notre arrivée, hier matin, les médecins de l'hôpital du Winterberg ne voulaient rien entendre en matière d'adoucissement des derniers jours de Bernard, pas question de lui donner de la morphine. Pourtant nous étions payés pour savoir combien il souffrait. Mais la souffrance "globale", ce cumul de douleurs corporelles, de mélancolie solitaire dominée par l'angoisse de la mort n'a pas cours dans la médecine hospitalière. Nous ne le leur avons pas envoyé dire !!!! Et puis, après un début de scandale, tout s'est dénoué de soi-même. Le médecin de garde a semblé enfin comprendre à quel stade en était mon beau-père et tout s'est aplani. Le visage contracté par la colère de Bernard s'est détendu d'un coup lors de la première injection de drogue. Quand nous sommes partis, il dormait pratiquement déjà de son dernier sommeil. Je pense à mes huit jours de coma, c'est tout. La mort en ce jardin.
Drieu La Rochelle. Entre deux épisodes de la fin de Bernard, je lis l'autobio du célèbre collabo (faut-il vraiment appeler ainsi ce personnage déplacé dans l'histoire européenne ?) suicidé. Mais quelle âme noire ! Ou plutôt en décomposition permanente. La conscience de Drieu, c'est comme une mouche à merde : une moire orgeuilleuse et flamboyante pour un corps monstrueux, il se croyait tout, ne se croyant rien. Tout dans l'arrogance et le mépris, des autres et de lui-même, une mode, finalement qui a fait l'édition du début de ce siècle. De Proust à Gide et Drieu. Etrange comme ce monde a glosé sur sa décadence ! Drieu ose se demander ce qu'est une décadence sans barbares aux frontières, au moment même où la France se replie frileusement derrière la ligne Maginot ! Sans barbares !
Mais tout ça flaire le jésuite. On sent bien que Drieu n'a de mépris, finalement, que pour sa propre conduite "moralement" inacceptable. Sa débauche est la négation absolue de la droiture de son adolescence de collégien, celle des autres n'est que le reflet de sa propre forfaiture. De ce qui est vécu comme forfaiture, car il n'a ni la santé d'un Gilles de Rais, ni l'enthousiasme de Sade. Sa revendication de la jouissance est grise, amère, et pour tout dire, pourrie. Il est vrai qu'il ne commence son journal que post factum, en 1939 il est déjà vérolé, impuissant et malade de partout. Mais surtout de l'âme. Je n'arrive à le sauver qu'en lui attribuant une sorte d'héroïsme de la spontanéité, ravage final du romantisme. La dimension la plus remarquable de ses états de conscience, c'est une véritable rage d'originalité. Pas question pour lui de se ranger parmi les personnages qui grouillent autour de lui dans la fange d'une histoire en miettes.
Retour à Bernard, dont l'heure avance maintenant rapidement. Hier, dans les derniers moments de lucidité, nous nous regardions tous les trois, Myrie, Bernard et moi. Trois consciences conscientes du drame qui se joue. Trois consciences parfaitement interchangeables : je meure, pas vous; il meurt, pas moi. Les mots en parfaite adéquation avec la réalité, la réalité parfaitement concrète. Terrifiant comme une scène de tragédie, mais en même temps cette universalité nous rapproche totalement, nous délivre en nous dévoilant le tourniquet et sa logique simple. Brel chantait :"au suivant". C'est un peu ça et c'est ce qu'on pouvait percevoir dans l'air ambiant de la chambre d'hôpital. A ce propos, je trouve qu'on dis beaucoup de mal des hôpitaux. Ce n'est pas si mal pour mourir, il suffit de faire sa paix avec les médecins, ce que nous avons finalement réussi à faire. Bernard nous dira peut-être un jour comment il a vécu tout ça. Quant à nous, si nous ne réussissons pas à mourir dans un quelconque naufrage, c'est le sort qui nous attend, il ne faut pas s'y tromper. D'ailleurs c'est le côté pénible de ces accompagnements de derniers instants, il s'agit toujours de SA propre fin.
10h15 : Bernard est mort il y a une heure environ. Du beau travail en termes de prévisions (c'est mon nouveau métier). Timing impeccable, mais il n'aura pas beaucoup profité de la morphine, elle lui aura tout juste permis de bien passer le cap. Trois consciences moins une. J'ai l'impression qu'il est encore vivant, ou bien qu'il ne mourra jamais. C'est le secret des angeli de la morte. L'accompagnement, comme on appelle ça aujourd'hui, brise l'image fatale de la mort, on s'y glisse soi-même, peut-être un jour avec gourmandise, comme Bernard. Quand nous l'avons quitté hier soir, un sourire flottait sur son visage, il avait gagné. Maintenant commence l'autre versant de ce travail, le deuil et la manducation patrimoniale. Bernard, lui, s'en fout et c'est pluss ça que j'approuve. Il a rejoint la simplicité du retour au tout, nous on va continuer à se compliquer l'existence. Trois consciences moins une.
Dimanche 5 Mai 1996
Kanner est passé hier soir, alors que je dînais chez les Flechons. Comment ? Le corps n'est pas veillé ? J'y vais. Bref, Jean-Michel n'y est pas allé, mais visiblement il était écoeuré. Plus tard j'ai réfléchi à ce rite de la veille du corps. C'est normal et j'approuve. Décidément le monde moderne oublie tout à une vitesse barbare. L'humanité se vide d'elle-même. Peut-être ne mourrons-nous plus hommes. Que serons-nous à notre mort ?
L'homme a-t-il été une fiction bourgeoise ? Mais qu'est-ce que le bourgeois, sinon une fiction ? On peut dire le fantasme d'une classe sociale. Mais les classes sociales appartiennent aussi à une fiction théorique artificielle.
Non, j'en tiens pour la conscience. Le monde est conscience et rien d'autre. Y-a-t-il du plus et du moins de conscience ? J'ai toujours pensé que non, comme il n'y a pas de plus ou de moins d'être. Il faut que je comprenne un jour pourquoi on a inventé (et les meilleurs esprits par dessus le marché) cette connerie d'un plus et d'un moins d'être. Aristote ? Avec son Entéléchie ? Mais l'entéléchie, c'est bien, c'est un très beau concept qui n'a rien à voir avec le plus ou le moins d'être : c'est dans l'être que l'entéléchie a lieu, elle-même n'a rien à voir avec la parturition de l'être. C'est évidemment une métaphore : l'entéléchie est
comme la parousie. Autrement dit, la réalité est en elle-même entéléchie permanente, il n'y a pas de réalité plus accomplie qu'une autre. C'est ce qui fait la difficulté de la Phénoménologie de l'Esprit : on ne peut pas charcuter l'état de conscience parce que l'être est un dès le départ. Si le savoir absolu n'est rien d'autre qu'une manière de comprendre pourquoi l'entéléchie est toujours déjà là, alors bravo la Phéno. Mais alors le pensum de Hegel apparaît pour le moins comme un exercice, un entraînement dont la nécessité n'est pas évidente, et pourtant je dois bien reconnaître que le plein-pied avec l'être se conquiert par quelque chose comme l'exercice. Hegel s'était rendu compte que le "salut" s'opérait de lui-même dans la pratique de la réflexion. C'est ce que Heidegger appelle le savoir "absolvant", sans oser aller jusqu'au bout, c'est à dire l'eschatologie pour ainsi dire ontique, matérialiste au sens de l'immanence panthéiste. L'histoire commencerait alors avec la culture de la réflexion, l'exercice de la réconciliation.
Lundi le 6 Mai 1996
Quelle solennité à chaque datation : Lundi le etc...!!! C'est mérité. Chaque jour est un miracle, chaque jour une merveille qui doit porter son nom. Point.
Je songe à un ....roman !!! Oui. Je suis arrivé à la conclusion que l'autobiographie, mon autobiographie, ne passe pas. Ne passera jamais ailleurs que, peut-être, à la curiosité de mes enfants. Et encore ! Donc, roman autobiographique, avec de la fiction et en avant !
Ce journal peut servir d'espace scénique pour le plan. Alors voilà : mon idée est de construire une intrigue quasi policière, d'espionnage-politique-fiction qui réduise mon existence à une fonction récoltée par hasard dans un collège de jésuites.
Première partie : Le maire d'une grande ville est devenu Premier Ministre. La "centrale" jésuite de Chantilly s'affole, car ce personnage me trimbale dans ses bagages, or "on" ne me contrôle plus depuis longtemps, "on" ne connaît que trop bien mon appétit féroce pour les curés. En jeu l'école libre, le financement de quelques milliers d'associations catholiques, mais surtout les impôts fonciers dont l'église est dispensée ainsi que les facilités médiatiques de tout poil. Le livre pourrait s'ouvrir par un attentat raté.
Jeudi le 9 Mai 1996
Bernard est enterré. Troisième cérémonie dans le petit cimetière de Sarrebruck-Forbach. Curieux comme les cimetières juifs sont agréables, sobres et presque beaux. En comparaison de nos espaces couverts de picasseries les plus kitchs les unes que les autres, c'est un rêve. L'ancienneté d'une culture c'est quand même la classe. C'est ça qui fascine les goyim, on est antisémite par pure jalousie, surtout lorsqu'on a un peu de culture. Le dernier domicile doit être beau ou ne pas être, c'est pluss ça que je pense. Il faudra que je songe à me faire transférer ailleurs que dans le pandémonium de Mulhouse, tant pis pour ma cohabitation avec mes parents ! Et que dire du chant du khazen ! L'émotion est dans la règle du chant lui-même, on pouvait avoir l'impression que le chantre en faisait un peu trop dans la condoléance, mais je suis sûr qu'il n'en était rien. Telle inflexion atonale est prescrite, notée dans l'usage et transmise scrupuleusement, même les modifications sont "alahiques". Souplesse du rite judaïque.
Vendredi 10 Mai 1996
Journée riche. Journée de riche : la mort enrichit de beaucoup de manières. Il faut premièrement que je note que j'ai découvert aujourd'hui une chemise à col mao ! J'en cherche depuis tant d'années que je commençait à m'angoisser de ne pas trouver de raisons à ce qu'il ne s'en fabrique plus ! Comment relier ça à la disparition de Bernard ? Parce qu'il vendait des fringues ? Hé hé ! Pourquoi pas, la réalité emploie n'importe quoi pour parler, pour saluer, pour rappeler, sermoner, cajoler, récompenser ou punir, et...faire passer de vie à trépas !!! Une chemise qui met dans cet état ! J'en suis presque fier, moi qui doit souvent ressembler à un monument d'arrogance érémitique, vous voyez comment l'on se trompe ?
Autre plus-value : de longs entretiens avec Théo. Encore une fois, quelle brillante intelligence et quel beau romantisme. S'il n'avait pas des varices terreuses sur l'âme et cette avarice de vie sordide, il serait l'Apollon des hôtes de ce monde. C'est dommage qu'il se soit tant inscrit dans l'universitas au moment où il ne fallait pas ou plus, pas assez de distance avec le murmure général. Aujourd'hui il paye pour ça, car son opposition résolue à l'histoire présente, c'est surtout son opposition à lui-même. Il ne faut jamais s'inscrire qu'en faux ou en filigrane avec l'histoire de son temps.
Théo a fait sa révolution copernicienne, ce qui fait que nous pouvons presqu'enfin nous parler vraiment, avec la plus aiguë des consciences de l'individuation et donc de l'aléatoire de nos échanges. Que c'est doux l'intelligence ! Bref, il laisse tomber avec le capitalimpérialisme pour en venir enfin au technique lui-même, à l'affaire sérieuse. Je dois le revoir ce soir, je vais mesurer le chamin parcouru et peut-être gratter de quoi progresser moi-même. J'aime aussi son détachement pour son passé situationniste. Au fond il est l''un des seuls rescapés de cette bande qui soit un vrai situationniste, refusant de jouer le jeu social tel qu'aujourd'hui les faux historiens de la révolution se le roulent dans leur jargon paternaliste.
Ce que cette rupture veut dire, avec son corollaire d'option pour la poésie, c'est que le révolutionnaire laisse enfin tomber les veilleries eschatologiques, téléologiques dit-il. Un jeu dangereux pour lui qui se dit si divorcé du monde lui-même, mais qui peut s'avérer payant s'il opère bien sa retraite. Nous avons curieusement la même conscience de notre graphitisation culturelle totale, et la même sensation de nous lire nous-mêmes au fur et à mesure que nous parlons. Cette liberté-là vaut toutes les autres. Spinoza. Il m'a dit une chose intéressante à propos de la relation entre théorie et poésie : la poésie comme chemin véritatif parallèle de l'histoire humaine. Là, dans le poïétique (qu'il confond volontiers avec le poétique), se dit le vrai, le téorique restant seulement la mécanique du détour ou du contours. Lacan a bonne mine avec ses mathèmes qui tiennent plus de la poésie sociale de ses relations avec ses ouailles que du traitement de la vérité.
Jeudi le 16 Mai 1996
Il m'agace. Il, c'est Drieu La Rochelle. Tant d'intelligence et de goût au service d'une si grande mauvaise foi ! Son Journal est une révélation importante pour moi, c'est le côté textuel de mon archéologie personnelle. C'est à dire que Drieu écrit au moment même où je nais. Son pavé est un ramassis de fiel. Cette amertume semble avoir deux catégories de raisons. Primo, Drieu est une sorte de Rancé ranci par la débauche et transi vers une vertu fantasmatique. Il faut quand même une forte dose de culot pour confesser avec un rien de frime une vie de gigolo dominée par la paresse et le vice et accuser en même temps la société de son temps d'être dominée par les mêmes tares d'essence "judéo-maçonnique". L'orgueil de ce type est sans limites. D'un côté il s'appuie sur une sorte de garantie de courage personnel qu'il tire de son comportement pendant la guerre de 14-18. De l'autre il tire argument de son impuissance à "régénérer" la société française en brocardant même ses idoles Maurras, La Roques et cie. Son fascisme est intéressant du point de vue historique, car il se révèle bien comme une fleur vénéneuse, surgie du fumier des "Golden Twenties". Une idéologie du dépit. Une simple eschatologie trahie. Mais le pire c'est bien la tartufferie foncière de son attitude en 1940. Se réfugier derrière ses bobos - on saura qu'il souffre d'hémorroïdes - pour excuser sa trouille tardive, mais pas inexplicable car il est très conscient de la supériorité militaire et technique des Allemands.
Je suis donc né dans ce qui produit ce fiel. Mais de quoi s'agit-il ? De l'impuissance, je pense, à réaliser les modèles élitaires du 17ème siècle que le petit Drieu a engrangé dans ses collèges de bons pères : l'intellectualisme juif/maçonnique/normalien etc... qu'il vomit, c'est cela même qui a formé son idéal historique et il en est empêtré jusqu'au cou.
Vice et vertu, voilà son problème non dépassé (nicht aufgehoben) de sous-produit de jésuitière. Il y a, dans ses formules, cette volonté d'écraser la mauvaise conscience dans la fuite en avant : la "caste" a le privilège du vice (celui qu'il s'est lui-même arrogé). Sa critique jésuitique de la plèbe n'est donc qu'un reflexe d'hypocrisie très commun, une tactique ridicule que j'ai décelée très tôt chez mes propres bons pères. Son suicide le sauve-t-il ? Autant que le suicide sauve Hitler, c'est à dire autant qu'une fatalité puisse sauver quoi que ce soit.
Dans ce pandémonium de conscience torturée, il y a quand même des choses qui valent le détour. Son admiration pour Malraux est pleine d'enseignement. Qu'il consacre Céline, Bloy et Bernanos, rien d'étonnant. Même Gide, "le pédéraste", conserve encore un prestige de grand bourgeois malade du vice, mais Malraux fait bizarre dans le décor. On y reviendra.
Bizarre parce que Malraux, non seulement est de gauche, mais il incarnera plus tard une troisième voie entre la gauche et la droite extrême, le gaullisme. A ce propos, deux remarques : Drieu connaît De Gaulle dès Juin 40 : il doit faire partie de la poignée de Français qui ont entendu (ou lu) le fameux discours du 18 Juin. Deuxième remarque : il se plante totalement au sujet du grand Charles. Cela fait partie de ces erreurs stratégiques. Pourtant, côté jugement politique, Drieu est assez fascinant, meilleur cependant en tactique géopolitique qu'en vision à long terme. Il se sauve en multipliant les martingales de possibilités d'alliances entre les uns et les autres. Mais en gros, il mise tout sur Hitler et voit déjà une aryannisation sans problème de l'Europe. Qu'est-ce-que ça veut dire au fait, aryannisation ? Absolument rien sans aucun doute. Mais le flirt avec Malraux en dit long sur les liens entre fascisme et gaullisme. On comprend mieux pourquoi De Gaulle a tellement ménagé certains anciens collabos et mis la FRance sous le boisseau après son retour de 58 ! En réalité la France de 40 c'était bel et bien Uriage, dans toute son extension christo-fasciste. La différence entre De Gaulle et Napoléon, c'est que De Gaulle avait une sorte de foi chrétienne, alors que Napoléon n'a jamais fait que mimer son appartenance à la chrétienté pôur des raisons politiques.
Samedi 25 Mai 1996
Je sens une vrai révolution gronder en moi. Le "libéralisme sauvage" a fini par infester toute la réalité, à tel point qu'il faut bien le prendre en considération. Notre vieil hégélianisme est entrain de périr corps et biens. D'une certaine manière c'est tant mieux, cela signifie peut-être que la poésie reprend certains de ces droits.
Mais cela demande des efforts d'adaptation pervers : moi qui lutte depuis toujours, je me retrouve avec des compagnons de lutte qui sont en réalité mes ennemis ! Il est curieux, en effet, de constater à quel point le plan idéologique général - le discours ambiant - part de la petite réalité, des coeurs particuliers, des corps individuels et non pas, comme le pensent les gens de gauche, d'un état-major politico-intellectuel. Il faut littéralement prendre les choses à l'envers : le désir brut des enfants n'est pas ce qui est manipulé mais ce qui manipule.
Dans nos représentations courantes, le désir des enfants est univoquement animal, et il y a, dans ces représentations, une erreur de paralaxe : nous lisons le désir des enfants unilatéralement, sans faire attention aux effets de récurrence de nos propres désirs sur la capacité d'expression des enfants. Ces effets sont des effets de mimesis de passions qui s'originent chez nous, les adultes, et sont simplement traduits à la manière de...
Le libéralisme, l'éclatement des systèmes communs, la déséspérante quête de liberté à sensations, tout cela est en nous, un peu comme le pensait Empédocle. Hier j'ai lu un article sur la ville nigérianne de Lagos. Cette ville est devenu un théatre de la cruauté, une véritable jungle urbaine. Selon le journaliste, Lagos fonctionne malgré tout et le capitalisme occidental y trouve largement son compte. Cette réalisation peut être considérée comme anticipatrice de ce qui nous attend tous, c'est à dire le retour total à un
nomadisme quotidien. La vie aurait alors rejoint mes cauchemars d'enfance, les contes de féé vécus dans ma rue mulhousienne où régnait la loi du plus fort.
Lundi le 27 Mai 1996
Gouverner c'est accompagner avec plus ou moins de délicatesse. Ca ne peut pas être autre chose. Au fond, c'est de la gestion. La différence entre politique et économie n'est peut-être pas si évidente que ça, à condition de considérer le métabolisme de la réalité dans sa globalité et de ne pas penser naïvement que le politique est purement du ressort de la volonté humaine.
Samedi Premier Juin 1996
En me relisant, j'en arrive à la conclusion que je deviens réac. Qu'en tout cas je change et il faut voir comment. Pour nourrir ma perplexité : Israël où le Likoud vient de remporter, à la surprise générale, les élections générales. Je n'ai pas été surpris. Il y a une semaine j'avais corrigé un film sur Jerusalem et j'ai dit le soir même à Myrie que tout était possible. Ce film montrait les festivités autour du 3ème millénaire de la grande ville christo-arabo-juive. Et le paradoxe qui veut que les trois grandes religions monothéistes qui s'originent ici s'arrachent leur propre berceau commun, ce paradoxe s'exacerbe de jour en jour. Cette fête dure toute l'année et enfile les réjouissances et les provocations en tout genre, cavalcade de carnaval avec costumes bibliques, rappel des époques héroïques, bref toute l'imagerie déclinée sur le mode idolâtresque, au grand bonheur contradictoire et coupable des Juifs orthodoxes. Cette culpabilité assumée me faisait craindre le pire. En voyant des milliers d'enfants israéliens défiler sous cette bannière holywoodienne, je me suis dit que désormais tout était possible. Qu'après avoir entrevu la possibilité d'éviter le pire avec la paix de Pérès, ce peuple se jette une fois de plus dans l'aventure. Je crains qu'il ne le paye cher, mais le destin n'a pas de prix, tant qu'à penser réac...
Changer est intéressant. Ou plutôt, il est intéressant de noter qu'on change, car là encore il ne s'agit vraisemblablement que d'un accompagnement. Encore faut-il voir ce qui change et ce qui ne change pas, c'est là la dialectique elle-même.
Mais encore. L'impression encore qu'on vit une pièce de théatre. Après avoir porté l'estocade aux idéologies, le discours général veut se libéraliser. Pas si facile, car on a appris à théoriser le monde et à penser selon les techniques logocentriques. Qu'à cela ne tienne, il suffit de théoriser le libéralisme ! On tombe alors dans l'économisme absolu : la pensée unique c'est cette soumission au fatum de la globalisation ou mondialisation, théorie purement marxiste ou marxienne. Retour donc à l'idéologie sous les horipeaux du savoir et pour les besoins de la politique.
Dimanche 2 Juin 1996
Un tabou : s'en foutre. Mon enfance : je m'en fiche : une claque; je m'en fous : deux claques. C'est une expression qui fera époque dans les analyses des historiens de l'an quatre mille, et, de ce qu'elle devienne un jour ou non un véritable tabou, à l'instar de l'inceste ou de la drogue, dépendra la qualité du reste de mes jours. Car je me sens comme taillé dans cette expression. Mon impuissance est comme lestée par une indifférence sans fond. Une indifférence qui a fini par rejoindre une sorte de taoïsme assez serein. Je me retrouve assez bien dans la théorie du vide parfait, quoiqu'elle me paraisse encore trop politique et trop absorbée par le destin et la fatalité de la mort. Mon "idéologie" pratique, serait plutôt celle de l'impavidité.
La fourmi aussi est impavide. Or, la tabouisation de l'indifférence va, me semble-t-il, dans le sens de la sacralisation du fonctionnel. L'utilité sociale de l'être humain passera peut-être un jour pour le bien absolu. La prochaine révolution, si les hommes trouvent encore quelque part l'énergie nécessaire pour se remuer, et aussi la méthode, sera celle de l'homme-poète contre l'homme-fonction. Jusqu'à présent, la guerre a permis de faire l'impasse sur ce débat. Bien loin d'avoir quoi que ce soit de naturel (contrairement aux assertions de Hobbes), la violence est plutôt une intruse dans l'existence humaine. Du moins la violence organisée sous forme de guerre, théorisée et transformée en système sociaux. Si les premières guerres qui suivent le néolithiques paraissent cruelles, c'est plutôt l'inexpérience humaine qui est en cause que sa méchanceté. Corollairement, la perfection de la guerre prouve une rationnalisation de cette méchanceté, qui s'incarne le mieux dans les théories bellicistes des religions.
La guerre est un barrage artificiel édifié contre la tentation de l'utile. En cela elle s'identifie au fonctionnel utilitaire et c'est pourquoi j'ai toujours eu des sentiments mélangés à son égard. Il n'est pas miraculeux que le djihad reprenne de plus belle aujourd'hui, alors que le marché est sur le point de dominer les destinées de la ruche humaine. Les Yougoslaves ne m'avaient pas bluffé. Leur sale géguerre était une manière de rompre avec l'ordre établi et de subvertir leur écrasement par les impératifs du marché. Il y a chez les anciens Mèdes et autres Ylliriens, un instinct nomade que Rome n'a jamais réellement vaincu, par pure paresse. D'où une tendance à jouer leur nationalisme sédentaire sur le mode de l'anarchie. Tout ça va se terminer par une fessée traditionnelle pour les gens des Balkans. Ils ont aussi besoin de cela pour rester comme ils sont.
Mais encore. Sentiments mélangés parce que l'âme poétique s'est réfugiée en partie sur la scène de la comédie militaire. J'ai toujours admiré en restant pensif, les tableaux hollandais du dix-septième où l'artiste représente des soldats. Le mercenaire de cette époque est toujours à moitié dépenaillé, et toujours entrain de jouer. Le jeu est l'activité du soldat en temps de paix. On est loin de l'image napoléonienne du soldat-laboureur hypostasiée par les deux dernières guerres. Conscrit, patrie, défense du territoire, de la paix, de la propriété sociale, tout ça est pure fiction. Cette blague n'arrive d'ailleurs à maturité qu'au dix-neuvième, au grand scandale des poètes. La trajectoire de Rimbaud est la plus intéressante. Après avoir folâtré dans les rangs de la légion batave en Indonésie, il déserte, doublant ainsi la mise aventureuse. Mais lorsqu'il s'élance à Paris pour défendre la Commune, il est bloqué net par le dégoût. Il comprend le vice profond de la violence à travers la promiscuité qu'elle engendre. D'où sa décision, sans doute, de se placer en amont des guerres grâce au trafic d'armes, là où le nomadisme joue encore la guerre sur le mode ancien, non fonctionnel.
Je me sens mieux. Mon aventure personnelle, ma relation avec l'armée de la guerre d'Algérie, ma désertion etc..ont toujours gardé pour moi un aspect ambiguë. Je le raconte d'ailleurs plus haut. Cette ambiguïté recoupe exactement mon raisonnement. Par rapport à Rimbaud, cependant, ma perspective était renversée. En 1961, lorsque j'ai déboulé dans la cour de la caserne de Toul, c'est le côté merveilleux qui m'a tout de suite frappé. La vie tracée au cordeau m'est apparue dans toute sa splendeur surréaliste, pure volonté de chimères alignée en rang d'oignons, frottée et repassée de sur-volonté totalement imaginaire. Pour la première fois je pouvais mesurer la puissance débridée de la poésie sociale et tout ce que le rejet du "métabolique" (la vie végétative de l'économie) pouvait cristalliser. L'évidence était pour moi d'autant plus grande que je pouvais percevoir partout le refus du projet fondamental du militaire. Les bidasses, dans leur grande majorité, faisaient absolument tout ce qu'il pouvaient pour ignorer la spécificité de leur position existentielle : il fallait rester un civil dans la caserne, tout faire pour avoir l'air "fantaisie", c'est à dire refuser l'allure martiale et le style de ce qui allait avec la guerre. La promiscuité dérivait directement de là, et à présent je me souviens que cette attitude était exactement celle que j'arborais au Collège St Clément, où j'ai fini par refuser carrément tout compromis communautaire. Les bons pères ne pouvaient évidemment pas tolérer un tel exemple et ils me font rétroactivement pitié, car j'incarnais avec à peine quatre ou cinq ans d'avance, ce qui allait les liquider pendant trois ou quatre bonnes décennies. J'ai l'impression, en passant, qu'ils relèvent un peu la tête ces derniers temps, ce qui s'explique précisément par la reprise du djihad.
Mais encore. En 1954, lorsque j'ai déboulé à St Clément, il y avait un parfait accord entre la société placée à l'extérieur du collège et la structure éducative des jésuites. La deuxième grande guerre était encore chaude, réchauffée par deux nouveaux conflits, Corée et Indochine, et la société n'avait pas encore eu le temps de se démilitariser totalement, de sortir de la structure communautaire du soldat-laboureur. Moi, j'étais un rebelle. J'avais déjà compris l'artifice que constitue les guerres et n'étais pas prêt, en regard de l'absurdité de leurs conséquences à m'en solidariser de quelque manière que ce soit. A la caserne, le divorce avait déjà eu lieu entre l'intérieur de l'armée et sa société. Brel et Brassens avait déjà laminé les certitudes piétistes des Français, et surtout rendu quelque courage à un peuple qui venait de grenouiller dans sa propre histoire comme jamais auparavant. Aussi, est-ce l'aspect héroïque-surréaliste du militaire que j'ai alors choisi de défendre, avant de déserter, car les buts d'une guerre coloniale ne pouvaient alors qu'abaisser tout ça dans un raplapla ultra-fonctionnel, même dans ses errements politiques. Montesquieu dit dans son petit opuscule sur Rome que la guerre civile est hautement bénéfique à une nation. Certes, puisqu'elle est ce qui, en général, fonde une nation. Or, ce qui est remarquable dans cette pensée, c'est la volonté d'introduire la guerre structurellement dans la vie de la nation, comme si elle en avait besoin pour vivre. Ce qui est vrai dans la mesure où la guerre est comme le bandeau qui cache l'inanité des fonctions économiques. L'homme doit se conserver un capital de surréel où puiser la force de fonctionner par ailleurs comme une fourmi. C'est clair ?
Soupçon terrible, refoulé depuis longtemps, la mort du langage. La fonction crée l'organe et tue le langage. Chaque jour qui passe je sens cette menace se concrétiser. La grande tentation du sport qui s'est emparé de la rédaction du 8 1/2, caractérise exactement cette fatigue du langage qui cherche son repos dans les régles du jeu simples et compréhensibles pour tous immédiatement, c'est à dire sans médiation. Le sport est la superstructure culturelle (et cultuelle, voir les J.O.) idéale pour une société lobotomisée par l'économie. Sur ARTE quelques retardés et romantiques ont tenté d'enrichir le langage télévisuel déjà si infirme. Ils n'ont pas compris, malheureusement, que seule une grande liberté formelle et spirituelle peut favoriser le projet de permettre au langage de survivre. De surcroît, les Allemands ne comprennent rien du tout. Leur investissement dans l'économie possède la même puissance initiale et le même aveuglement que leur effort de guerre autrefois. C'est un peuple dépaysé radicalement, il me fait vraiment pitié.
Samedi le 8 Juin 1996
La justice est parfois injuste. I.e. l'immanence de la justice ne frappe pas toujours les vrais coupables, ou plutôt s'en fiche de viser tel ou tel détail. La justice s'occupe, comme la politique, des "grands équilibres" !!!!
Je dois me méfier en particulier de cette remarque, car j'ai tendance à me fier aveuglément au fameux philosophème d'Anaximandre : "Ce dont est ce qui existe est aussi ce vers quoi procède la corruption, selon le nécessaire ; car les êtres se paient les uns aux autres le prix de leur injustice dans l'ordre du temps". Je n'ai pris connaissance de cet aphorisme qu'à l'âge de 18 ans bien sonnés, le découvrant dans un numéro de Témoignage Chrétien. Chrétien ! 7 siècles avant JC, Anaximandre, le présocratique athé, raisonne comme l'évangile. Bien sûr, depuis ce temps Heidegger a donné de cette seule phrase du philosophe du chaos, une toute autre interprétation-traduction, car tout est dans la traduction de ce grec archaïque. Mais les douze et quelques lectures que j'ai faites du texte qui figure dans les Holzwege me paraîssent au fond, révéler la même chose, mais avec cette indifférence qui justement n'est pas inhérente au concept commun de justice et que je redécouvre avec mon propre aphorisme.
Lundi 10 Juin 1996
Encore passé hier des heures dans la maison du mort. L'occasion de réflexions qui n'en finissent pas sur la vanité de l'existence. Si bien que finalement, en contemplant une de ces photos qui ne veulent absolument pas se synchroniser avec la réalité et qui représentait un oncle radieux de vie et de bonheur, j'en suis venu à me demander pourquoi on fait tout ce cinéma, toutes ces pleurnicheries autour de la survie. Puisque la certitude est là de la vanité de toutes ces poses et de toute cette comédie permanente, pourquoi encore en rajouter avec des considérations romantiques ? Je m'attaque là, tout particulièrement, au romantisme. Aussi bien celui des Chinois des premiers empereurs que des crétins écologistes de nos siècles à nous.
Il y a sans doute une réponse : l'éternel recommencement de tout, et tout d'abord de la mauvaise répartition de la force et de la faiblesse, de l'esprit et de la bêtise. Et puis surtout la lâcheté, la volonté cachée de vouloir, au fond, faire mieux que les autres et d'y arriver. L'homme est avant tout un crétin qui s'illusionne presque sans arrêt. Il ne peut pas admettre que le miracle n'existe pas. Si ce n'était pas vrai, il n'y aurait pas tant de croyants dans le monde.
A propos, j'ai hérité des Pensées de Pascal. Ouvrage que je n'ai jamais lu que pas bribes, pour autant que je me souvienne. Et pourtant j'ai l'impression de le connaître par coeur, tant la mélodie et le rythme me sont familiers. Question brutale, que je ne peux pas esquiver et que je ne veux pas esquiver : comment une pensée aussi raffinée a-t-elle pu échouer dans la religion la plus vulgaire et, le fait le plus délicat pour moi, comment se fait-il que je dusse être tout à fait d'accord avec l'essentiel de sa peinture de l'homme pour n'en rejetter que les conclusions ? Autrement dit, comment s'explique pour moi une si forte identification sur des bases aussi fausses ? Je n'ai pas le temps de creuser aujourd'hui, mais il y a là, vraiment, une sorte de style "national", une tonalité culturelle précise, qui va simplement à des conclusions différentes selon leur auteur.
Mardi 11 Juin 1996
Pas de pensées faibles. Du moins pas les écrire. Mais qu'est-ce que la force ? Dire par exemple que la coupe est pleine ? Que j'ai assez vécu ? Que signifie "assez vécu" ? Que signifie avant tout "je" ? Une indication, ce matin : je = une partie du décor. Donc, enlevez-moi ça, dirait-il. Hier, je me suis vu comme une sorte de Montaigne (tel qu'il me vient à l'esprit). Un homme sans qualité, à la Musil, mais dans la précipitation et sans les naissances. Important, les naissances. Elles inclinent le mieux à tel ou tel affect définitif. Ainsi moi, une grande fragilité émotive. Mes colères homériques dissimulent une grande déception du "rien n'est jamais acquis" auprès des miens. A cinquante-cinq ans je me sens encore sans cesse remis en question parce que je ne suis pas Né, c'est cela le vrai travail.
Naître c'est donc avoir acquis un statut dans le néant d'avant la parturition ! De quoi s'interesser à la métempsycose.
Dimanche le 30 Juin 1996
Période stérile. Rien ne me pousse, personne derrière. Pas de démon Azzegeddi. Je suis un Babbalandja orphelin en ce moment. Sans doute une de ces pénibles époques charnières où l'inspiration et le courage se taisent pour laisser de la place à autre chose. Mais quoi d'autre ?
Pourtant l'actualité, elle, ne chôme pas. Mon frère s'est écroulé. A 59 ans il plaque tout ce qu'il lui restait, là-bas en Côte d'Ivoire, pour se mettre à la colle avec son"épouse" en vivant sur le dos de sa fille ! Ca me tue. Les Kobisch c'est pas la gloire. Pas possible d'émerger quelque part tranquillement. Le grand-père était sans doute un type très bien, un de ces Allemands qui ont cru dans les années 1880 qu'à Paris se jouait le salut du monde. Salut politique, moral, esthétique et tutti quanti. Jusqu'en 1915, quand on l'a prié de prendre le chemin d'un camp d'internement ou de se tirer à l'étranger. Ce qu'il a fait, profondément blessé. Mais lui aussi avait quelque chose de fêlé. Pourquoi il épouse une alsacienne ? C'est facile. Pourquoi il ne se fait pas naturaliser ? Mépris. Pourquoi il ne se bat pas pour rester en France et défendre son droit ? Mépris et arrogance. Comme tous ces Allemands. Les Allemands sont des enfants arrogants et cyniques. Leur naïveté est l'objet même de leur sentiment de rage où se condense leur force. Force des faibles. Et mon père ! Se laisser noyer ainsi par l'histoire de sa femme ! Quitter Paris en 1939 ! Pour aller gérer une épicerie à Mulhouse ! Pour faire plaisir au clan de ma mère ! Parfois je me dis que son suicide est un châtiment bien doux pour tant de connerie. Du grand frère Kobisch je ne parle même pas. Il est tombé au champ d'honneur de la bêtise de ses parents. D'abord celle de son père, puis celle bien plus redoutable de sa mère qui voulait de toute force en faire un curé ! Ah malheur ! Et maintenant Philippe. C'est le bouquet. Celui qui ressemblait le plus à cette race de teignes sans scrupules venue des bords du Rhin, prête à coloniser, ramasser, traquer le fric partout où il se trouve et se pavaner tant et plus ! Un clochard, il va devenir.
Et le petit dernier, c'est moi. Coucou !
Dimanche 7 Juillet 1996
Je ne comprends pas grand chose. Fini la théorie et le confort d'écoute du réel. Je suis entrain de sombrer dans une poisse nouvelle. Un peu comme celle d'avant mes vingt-cinq ans. J'ai récemment entrepris d'écrire l'histoire "vraie" de ma désertion pendant la guerre d'Algérie. Pas facile d'écrire vrai. L'idée m'est venue en regardant un xième magazine sur la Résistance. Il fallait, me semble-t-il, s'y prendre tôt pour dire avec exactitude ce qu'on avait cru vivre. Les choses sont terriblement menteuses, car les réalités sont hiérarchisées : en haut il y a la grande victoire, puis viennent les grands vainqueurs et enfin les petits grouillots de la réalité qui ont passé le plus clair de leur temps à se tirer dessus entre eux. Donc, au nom de la grande victoire on se tait sur les bagarres internes, sur les petites bavures de la résistance quotidienne, surtout sur la totale incommunication qui a lieu d'un individu à un autre, dans un monde où les soldats ne sont pas anonymisés dans des régiments. La confiance entre des clandestins est très difficile. Uns fois qu'elle a vacillé, c'est fini. L'homme ne peut pas (ou plus ?) se battre en tant qu'homme, il doit se désintégrer dans une fonction.
Cette décision de "parler" m'est également personnelle : je me suis toujours senti ostracisé tout au long de mon aventure. Au début, on doutait sans raisons de mes motivations.Quand on s'est aperçu de la "pureté" de mes intentions on a dû me tolérer puis on a été soulagé de me voir jouer le traitre alors que la vraie trahison était de leur côté. Aujourd'hui, il y a une poignée d'individus qui "savent" certaines choses et qui laissent des ignorants écrire des histoires entièrement fausses, qui vont faire école. Mais dans tout cela je gêne.
Cette décision de parler est peut-être aussi tout simplement le besoin de revivre cette période libératrice pour moi, fertilisante. Peut-être que l'effet bienfaisant de cette guerre s'estompe et qu'il faut que je me décide à nouveau à revêtir la cotte de maille. Rythme de la vie ? Dans Mardi, Melville fait allusion a cette circularité de l'histoire, c'est un Américain qui ne croit pas tellement à la République et qui trahit un peu le fond de la pensée politique des gens de son pays. Clinton pourrait devenir roi que cela n'étonnerait personne, sauf si on prédisait cet évènement, disons quelques heures avant qu'il ne se produise ! République/Monarchie, guerre/paix, des alternances qu'il faut accepter ? Pourquoi ? Maladie de peau de la terre, disait Nietzsche en parlant de l'humanité. Je ne me sens pas concerné.
Jeudi le 19 Juillet 1996
Je reviens de Brest. Brest 96. Enorme "fête" des anciens gréments, ou plutôt des marins amoureux des vieilles carcasses en bois et complètement masos. En réalité, cette fête est l'amorce d'une parquisation du Finistère. Comme la Royale fond au soleil, il faut trouver des remèdes économiques. Ca c'est une galère....On a déjà Schtroumfoland, Dysneyland, on aura Belemoland...Marx disait que l'histoire se rejoue toujours sous forme de farce. C'est le cas et c'est triste, tout finit par des saucisses-frites.
Entre-temps aussi j'ai commencé mon nouvel ouvrage sur ma désertion. Curieux comme ça marche bien, la mémoire, c'est extraordinaire quand on la met en branle. C'est l'occasion de faire une grande expérience psychique, terra incognita sed fructuosa.
Lundi 22 Juillet 1996
J'ai laissé passer un anniversaire. Il y a cinquante ans, mon père se pendait dans la cave de notre maison. Cinquante ans déjà ! J'avais cinq ans. La vie est une chose sérieuse, et c'est pourquoi je hais les tueurs de toutes catégories, surtout les religieux. Il faut que j'enquête sur les massacres pratiqués par Charlemagne pour "christianiser" la Germanie. Ils auraient été effroyables, parfaitement comparables à la rage aveugle des intégristes musulmans d'aujourd'hui. Hier encore, douze pauvres bougres égorgés dans un bus algérien. Que puis-je faire, quelle violence puis-je moi-même brandir pour mettre fin à cette folie ?
En tout cas mon débat avec la religion sous toutes ses formes se durcit. C'est sans doute pourquoi la harangue de Satan dans le Paradis Perdu de Milton m'a tant séduit. La guerre entre les démons et les anges montrent parfaitement que la guerre est une affaire exclusivement religieuse. Les dieux sont les grands modernisateurs des arsenaux et des stratégies, pendant que les démons n'ont que leur courage pour affronter la modernité divine ! Pauvre Marx, il avait tout faux avec sa superstructure et son infrastructure, même si sa transcription reste exacte quant aux méthodes et à l'histoire : l'économie est en réalité un simple terrain de la logistique des guerres de superstructure. Il est vraisemblable que les deux guerres mondiales, les deux plus effroyables catastrophes humaines de l'histoire connue, proviennent directement de la foi que le monde entier s'est empressé d'ajouter au texte de Marx, par simple idiotie et manque d'imagination.
Mercredi 24 Juillet 1996
Ebauchées devant Myrie et Lucas, mes dernières thèses ont fait scandale. Il paraît inadmissible de donner à la religion autant d'importance. Mon intuition est d'autant plus difficile à défendre que les deux grandes guerre semblent bien échapper à cette analyse. Mais justement (comme nous disions dans notre jeunesse !), l'analyse des chancelleries au 19ème et dans la première moitié du 20ème repose entièrement sur la croyance en une violence constitutive de la société humaine : les contradictions révélées par Marx sont progressivement prises pour argent comptant. Bismarck, puis l'empereur Guillaume, finissent par faire corps avec leur classe sociale contre les autres et ne trouvent de salut que dans la préparation de la guerre à grande échelle. Marx, fondateur de religion ? C'est bien le pire de ce qui est arrivé à son oeuvre.
Mais justement. L'une des structures classiques de la "psycho-sociologie" marxiste tourne autour de l'aliénation. Lukacs lisse ce travail avec son concept de réification, l'homme devient lui-même une marchandise et sa vie psychique et intellectuelle se rationnalise autour du système marchand. Aujourd'hui on peut voir que cette mécanique "extractive" fonctionne indépendamment des analyses de classes. Des "spécialistes" de la "communication" veulent nous persuader que l'homme se vide (s'est vidé) des contenus au profit d'une vectorisation des messages !!! Nous serions devenus de simples instruments de transmission de messages. Nous sommes vides, vidés.
Quelle naïveté ! La logique du plein est confondue avec la logique de l'auto-centré (pour parler vite, Ruyer et Michel Henry sont bien pratiques). Autrement dit, l'appauvrissement de l'être humain (toujours postulée, quoique pour des raisons différentes) se joue aujourd'hui sur le mode de la mise en réseau des individus qui cessent d'être, si je comprends bien, les finalités du système pour n'en être plus que les relais fonctionnels. Une telle idiotie recouvre un indécrotable substantialisme. Le qualitatif de l'interne (de ce qui est censé remplir le sujet) devient du quantitatif dans le raisonnement même qui donne congé au quantitatif ! Autrement dit : il y a du plein et il y a du vide. Il y a de la substance qui est aliénée. Marx lui-même n'aurait pas dit une ânerie pareille. L'aliénation dont il parle est ontologique, elle est négation dynamique (dialectique) d'une apparence de sujet, car ce sujet ne peut pas être sujet dans une préhistoire de l'humanité. Le plein n'est jamais postulé chez Marx, même pas comme résultat. L'aliénation est histoire de la naissance du sujet de l'histoire.
Je parle de cette répétition masquée de la logique marxienne pour souligner que dans les analyses historiques, la classe capitaliste a fait la même projection : toute l'économie politique dite bourgeoise d'aujourd'hui n'est qu'une reprise des découvertes géniales de Marx. Mais cachée. Comme les gouvernements du 19ème siècle, on met tout en place pour contrer l'offensive du prolétariat tout en niant qu'il existe quelque chose comme le prolétariat et qu'en plus il soit animé d'un désir révolutionnaire.
Lundi 29 Juillet 1996
Je fais de la brasse coulée, mais sans avancer, en pataugeant. J'ai l'impression de ne pas revenir du grand scandale que j'ai découvert à ma naissance. Alors j'oscille sans cesse entre deux possibilités : ou bien je ne comprends rien, ou bien je suis secrètement sollicité pour mettre de l'ordre là-dedans ! Or il n'en est pas question. Ma nature divine ne peut pas admettre pareille hypothèse. Je préfère donc, jusqu'à nouvel ordre, opter pour l'explication du bordel. Il y a un bordel total, Héraclitéen, et basta. De temps en temps des poètes inventent une religion qui met en mouvement des masses "zumaines", fait un grand détour par une guerre sans merci, puis ronronne quelques siècles en engraissant des milliers de profiteurs. Ainsi cette religion se découvre elle-même comme mensonge, perd toute crédibilité, opte ouvertement pour la politique car il ne lui reste plus le choix,et finit dans les rubriques astrologiques, sans que d'ailleurs cela n'émeuve qui que ce soit.
Attention. Il y a un point de vue anti-religieux pernicieux : celui qui théorise toujours à nouveau la trahison de la doctrine fondamentale. Chez tous les fondateurs de nouvelles religions, il y a un athéisme de façade qui finit dans le feu du pire des dogmatismes. On a vu ça chez Luther chez qui il y eut une immense tentation d'immanentisme théologique ( à la Bouddha ). Cette manière d'insister sur le fait que tout doit être "intérieur" dévoile une profonde révolte contre la transcendance. D'où aussi la brutalité du reniement et cette sorte de redoublement de la tendance socialement criminelle du religieux : le nazisme est, sans aucun doute possible, une descendance de la Réforme. Le lien est dans la radicalité originelle du rejet luthérien, mais une radicalité trahie. Dans la conscience allemande le reniement protestant - c'est à dire cette conformation en fin de compte à la christiannité générale concoctée déjà par Mélanchton du vivant de Luther - appelait une vengeance historique ou du moins maintenait en suspens toute l'énergie barbare accumulée par le viol catholique de la Germanie. D'ailleurs il est parfaitement logique, scientifiquement mécanique, de voir éclater parallèlement à cet épisode, une guerre sans merci entre les seigneurs théologico-transcendants et les paysants immanents ! C'est clair et sans appel.
Le problème qui subsiste est que les "valeurs" captées par le discours religieux demeurent sous une sorte de monopole théologique. On ne peut, ou on ne veut aujourd'hui rien comprendre aux Droits de l'Homme sans en référer à la législation chrétienne (ou islamique ou autre, peu importe). Comme si l'humain était une invention religieuse, alors que c'est le contraire : le religieux est toujours, sauf peut-être dans le bouddhisme, l'effacement de l'humain, le renvoi de l'humain dans une négation anihilante, le véritable humus du nihilisme. Les "valeurs", au contraire, subsistent toujours contre les religions, elles ne font jamais que limiter les dégats. Contrairement à ce que pouvait penser Nietzsche, les "valeurs" n'ont pas fini par formater l'occident dans une impasse métaphysique. Elles ont bien plutôt déterminé l'éthique de résistance à la barbarie religieuse. Ou bien, toujours à nouveau elles ont manifesté le bon sens radical, le poids spécifique absolu de l'humain. Le droit n'est radicalement pas affaire de charité ou d'obéissance, mais de raison. Il faut comprendre que cette raison n'est pas attachée à la survie biologique de l'humanité, mais à la survie spirituelle du traitement de son mystère. Le cosmos s'interroge à travers nous, il a besoin et nous le ressentons par le bonheur d'exister, de poursuivre sa quête.
Vendredi le 2 Août 1996
De Charette, le lointain descendant du boucher de la Vendée et présent ministre des AE de Chirac, revient d'Alger. Dix heures plus tard on annonce la mort de l'archevêque d'Oran. C'est la réponse du berger à la bergère : terrorisme contre états. Il est étrange de constater l'extrême efficacité des commandos que l'on suppose intégristes. C'est à croire qu'ils sont les maîtres des rues et des campagnes. Je crois pouvoir penser qu'ils sont plus efficaces que les commandos du FLN, et c'est ça qui donne à penser encore plusss. Encore qu'il faille faire la part de la relative faiblesse de l'armée algérienne comparée à la française et de surcroît minée de l'intérieur. Il semble y avoir un réservoir sociologique inépuisable de terroristes et/ou une mécanique imparable de recrutement, tout à fait dans le style du FLN ou du Sentier Lumineux.
J'incline à abandonner la thèse de la guerre de religion en tant que telle, car dans une telle guerre il y a toujours la complicité d'une partie de la bourgeoisie, ce qui ne semble pas être le cas en Algérie. La vérité est peut-être du côté de cet énorme cocufiage colonial que représente l'échec de la nation arabe, combine qui va de pair avec l'impossibilité de décoler économiquement. La guerre civile algérienne est une jacquerie synergisée par le lointain conflit afghan qui n'est d'ailleurs pas terminé.
Ce qui est intéressant à noter à ce propos, c'est que les "Afghans", c'est à dire toute la jeunesse musulmanne qui est allé jouer les Brigades Internationales contre le communisme en Afghanistan se retourne contre le capitalisme avec le même acharnement. Cette confusion est révélatrice d'une identification des buts de guerre : créer un espace islamiste, quel que soit l'occupant de cette zone à libérer. D'ailleurs le colonel Massoud, le modéré tadjik, et même Hekmatyar le supposé intégriste ne font pas l'affaire pour les talibans, ces terroristes qu'on affublent du nom d'étudiant ! Ils doivent céder la place devant la pureté doctrinale et les politiques de compromis avec l'occident capitaliste. Il y a toujours le soupçon de la guerre téléguidée par l'Iran. Le calcul serait le suivant : nous Iraniens nous transigeons encore avec l'occident, européen notamment, mais nous contribuons à créer ailleurs (au Soudan/ Afghanistan/Maghreb etc...) des espaces "libérés" selon toute la rigueur du concept. Plus tard nous récolterons. Géopolitique invérifiable, l'information circule de moins en moins bien. On peut supposer seulement que les USA, qui dirigent toutes leurs attaques contre l'Iran et la Lybie, comprennent mieux le problème, la guerre du Golfe laisse des traces.
J'avoue avoir du mal à me figurer les Algériens qui participent à ces massacres. Quelle déception pour moi de constater qu'au fond je n'ai pas saisi grand chose à un pays où j'ai vécu cinq ans ! Je n'arrive pas à m'imaginer quel type d'Algérien peut se comporter de cette manière. Bien entendu, j'ai toujours pu sentir -et ce depuis les tout premiers jours de la guerre d'Algérie - une tournure et un caractère plutôt sauvage des méthodes de ces Maghrébins. Il y a une correspondance entre les hordes féroces de Massinissa et la barbarie des intégristes, mais cela, c'est une tonalité générale qu'au demeurant je n'ai pas expérimenté beaucoup sur place. Bien sûr aussi que je sais que l'acculturation s'est dévoyée voire arrêtée totalement entre mon dernier séjour en 71 et aujourd'hui. Ce sont des gosses analphabètes qui tranchent les cous.
Enfin nul doute que ce nouvel attentat contre un prélat français ne parvienne enfin à concrétiser la stratégie du GIA : contraindre la France à se mêler à la guerre civile algérienne, Guerre D'Algérie, Acte II. Merde, cette saloperie me poursuivra jusqu'à ma mort.
Mercredi le 21 Août 1996
Hier à France-Culture encore l'émission sur l'Algérie, encore les Lagaillarde et les Delouvrier entrelardés de De Gaulle. Toujours à nouveau les questions sur le machiavélisme du grand Charles : a-t-il suivi ? a-t-il précédé ? Quelle indécision finalement ! Il lui aura fallu quatre ans pour comprendre ou pour manoeuvrer ! C'est une des caractéristiques des états bourgeois de piloter en fonction de grands espaces de temps, ils n'ont pas de souplesse parce qu'ils n'ont pas de moyens de dialogue. La démocratie bourgeoise est inerte en vérité, elle cumule des lois et pis encore : elle gouverne par des modifications constantes de la loi, ce qui est la solution de facilité. Et les pauvres qui nous imitent ! L'Algérie entre autre, dont le théâtre est redevenu celui de la cruauté, la même que dans les années cinquante. Au moins ne peut-on pas accuser aujourd'hui le stalinisme d'être à l'origine "culturelle" de cette cruauté. On ne dira pas que les générations de tueurs algériens sont des satellites ou des enfants du communisme. Leur sauvagerie va puiser bien ailleurs que dans la raison d'état bolchévique.
Plan de Constantine : la contradiction absolue, la preuve que De Gaulle n'y voyait pas clair et la véritable cause des massacres en Algérie. En 1958 il n'y avait pas deux moyens d'en finir avec la rébellion : ou bien la France francisait l'Algérie radicalement, ou bien elle l'abandonnait à son sort, ce qu'elle a fait empiriquement et criminellement par la suite et trop tard. Le Plan de Constantine c'était la structuration matérielle et culturelle d'un état occidental, il correspondait à une volonté d'intégrer le pays à la France, et non pas de le rejeter dans le Tiers-Monde : les générations qui ont bénéficié des routes, des écoles et des hôpitaux de la République française, sont celles-là même qui aujourd'hui sont condamnées à mourir sous les couteaux des islamistes. Lorsqu'il n'y aura plus un seul Algérien parlant et pensant en français, la guerre civile s'arrêtera toute seule, sans que la victoire ne soit forcément du côté des intégristes : l'Algérie aura fait sa catharsis de la culture occidentale dans le sang et pourra reconstruire autre chose, mais quoi ? Quelle tristesse de se sentir devenir Algérie française
maintenant !
Vendredi 23 Août 1996
Pensées ultra-libérales : l'éducation a été une erreur, la nature ne doit pas se confondre avec les choses - celles des leçons de choses - mais avec l'originel, le natif. Or, le natif est soumis au chaotique : tel individu naît exceptionnel, tel autre est une malédiction pour sa communauté. Les grands monarques ont eu beau donner à leur engeance les meilleurs maîtres, cela n'a rien changé dans les décadences des dynasties. Là, déjà, l'éducation a montré son impuissance. Il n'y a donc que deux solutions : Hobbes et Rousseau, si l'on veut éraser le chaos. Avec Hobbes on produit une machine de guerre sociale pourvue d'un souverain lui-même dépendant d'un dieu, et c'est marche ou crève. La garantie divine reste aussi la garantie de la stabilité du système; là se trouve la grande faiblesse du hobbisme car il faut que dieu reste auprès des hommes. L'on connaît son "infidélité". Avec Rousseau on produit une autre machine, la démocratie, celle que nous vivons bon an mal an avec le rêve que l'éducation - celle d'Emile - finisse par "lisser" le chaos social, supprimer les inégalités du natif. à suivre...
Mercredi le 28 août 1996
C'est donc cette éducation-là qui aurait échoué. Avec deux énormes désavantages, celui de ne rien apporter en termes de contenus de l'individu et rien non plus en termes d'égalité, ce qui était le but recherché. Or, il y a un gigantesque malentendu sur l'éducation, un malentendu soigneusement entretenu par les milieux éducatifs eux-mêmes, ceux qui sont censés distribuer la culture et définir en permanence ce qui est et n'est pas de son ressort.
Bien sûr, aujourd'hui le branchement de l'éducation sur l'entreprise n'est plus une intention cachée. Tous les gouvernements ont trouvé le courage de ne plus rougir de la honte du sacrilège et de débiter - lois à l'appui - toutes les platitudes possibles sur les relations entre l'école et l'emploi. Le dix-neuvième siècle n'a pas, il est vrai, été beaucoup plus clair là-dessus. Le positivisme laisse entrevoir des conquêtes qui n'ont rien à voir avec l'idéal républicain de l'enseignement de...la citoyenneté ! Car l'Education dite Nationale ne peut pas avoir d'autre mission que celle de former au seul métier humain, celle de citoyen.
Mardi 10 Septembre 1996
Encore un été qui s'achève. Encore un manque de plus creusé de toute mes forces. Encore une saison en enfer. Il semblerait que la vie soit devenue une série de telles saisons, comme si nous avions été appelés à sculpter des vies en négatif. Au regard de nos existences, celles des martyrs de l'église paraissent bien ternes. Quel intérêt peut bien avoir une existence vouée à une croyance ? N'importe quel chien ne meure-t-il pas pour sa foi
en la vie ? Là où en revanche il n'y a aucun garde-fou, voir Nietzsche bien sûr, là devrait être quelque chose comme la vrai vie, la vie
pas vie .
C'est le côté sériel de tout cela qui est remarquable. On recommence tout sur un rythme imposé du dehors. L'intelligence n'y change plus rien. Jadis, même dans mon temps jeune, il suffisait de rire un bon coup et l'on changeait son fusil d'épaule et son existence de décor. Le sériel répondait à d'autres critères mais était déjà présent ? Certes, mais justement cela indique combien l'existence est affaire de rythme, combien la souveraineté est affaire de tact, le tact de la baguette du chef d'orchestre. Laisser le destin, la réalité, le monde, les autres, je ne sais pas comment appeler cela mieux, laisser être le rythme selon l'extérieur, même celui de son propre désir. Oui, c'est cela, il faut considérer son désir comme extérieur, comme une apparition étrangère à soi-même, mais comme une apparition qu'il faut respecter et suivre, sans considération pour une intériorité fixe ou fixiste d'idées toutes faites. Les idées toutes faites ne sont que le reflet de vies toutes faites. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la politique, car en elle seulement peuvent se mouvoir toutes les idées à la fois, en elle seulement les idées sont toujours à refaire selon un nouveau contexte, à comprendre à nouveau frais.
Ce désir, faut-il le soigner dans l'enfance, déjà ? Faut-il l'éduquer ? Non. C'est idiot de poser ainsi le problème du désir. Le désir lui-même ne se soigne pas, seules les habitudes intériorisées permettent de se déterminer par rapport au désir. Les habitudes sont un jeu : elles représentent très exactement ce que l'individu met en jeu et accepte comme règles dans la gestion du désir. Les habitudes sont choisies et déposées dans un stock psychique où elles manifestent de manière fondamentale ce en quoi j'investis. Depuis ma naissance.
On pourrait contourner Freud, ici. Pourquoi refouler l'idée d'une volonté individuelle dans le choix des habitudes. En tant que jeu, le choix est risqué et se paye lorsqu'il est exorbitant. Pire, il se paye perpétuellement à répétition parce que l'habitude est répétitive et difficile à annuler : la névrose. Ce qui cloche chez Freud, c'est la fiction de modèles universels de désirs, comme si les hommes étaient des objets identiques. Derrière le paradigme d'Oedipe, il y a le grand Objet de la Science. Les ricanements de Lacan se rapportent sans doute d'abord à cette apparente toute-puissance de cette science. Il nous dit de nous écraser devant notre nullité à être différent du moule de Freud, et là il n'a sans doute pas tort. La science, même celle de Lacan, souffre en tout premier lieu de son impuissance à traiter des marges de son empire. Exactement comme Auguste dont les négligences se sont accumulées en conséquences pour ses successeurs.
Marges, justement : j'ai assisté à un spectacle culturel très intéressant. Montesquieu est toujours un plaisir. Cet été j'ai donc relu son Grandeur et Décadence. Puis, de retour à Strasbourg j'ai eu à vérifier quelque chose sur Octave Auguste. J'ai donc lu l'article Auguste, dans l'Encyclopédia Universalis et j'ai eu l'impression de relire Montesquieu ! La thèse du moraliste est passée dans l'interprétation historique comme ça, passez muscade ! Cette thèse, la voici : l'Empire et donc la décadence, sont nés de deux vices fondamentaux : la paix et l'hypocrisie, le grand responsable (ou le grand vicieux) : Auguste. Le bellicisme du dix-septième siècle fait recette dans la théorie contemporraine : car l'idéologie de Charles-Louis de Secondat date bien du siècle de sa naissance et non de celui de son oeuvre. C'est d'ailleurs très curieux que ce catholique qui épouse une protestante et les idées libérales anglaises soit à ce point porté vers l'idéologie de la guerre. Le protestantisme montre ainsi le bout de son nez, Luther pourrait bien n'être qu'une immense nostalgie des conquêtes romaines. Ou bien, de ces relations entre Germains et Romains qui n'ont jamais réussi à vraiment voir le jour : celles de la collaboration guerrière totale. Les Allemands, au fond, souffriront toujours de n'avoir pas été reconnus par les Romains comme des ennemis suffisamment effrayants pour devenir leurs meilleurs alliés. Attila aura faussé le jeu à un point irréversible : celui d'envoyer les redoutables Germains se faire la main sur les Celtes romanisés par César et Auguste, les pacificateurs ! Malentendus en série, mauvaises habitudes de l'histoire, elles vont se répéter à l'infini et même à l'envers, lorsque Hitler proposera à Mussolini de l'intégrer à sa guerre ! Réponse tardive de l'histoire au désir allemand, échec qui prouve combien l'habitude est maîtresse des comportements : le nazisme est tombé dans les mêmes pièges que le Gothisme ou le Vandalisme. La cave à vin de Céline.
Bref, les auteurs de l'Universalis ont quand même du culot ! J'appelle cela de la contrebande d'idées. De l'idéologie pure et simple. Bonjour la science. On a l'impression de se retrouver dans un cours d'histoire de collège jésuite : s'exercer à la guerre, définir un ennemi, se battre avec le monde entier et avec soi-même, se battre, se battre, se battre. Ces libéraux-là sont d'ailleurs de retour, il suffit d'entendre monsieur Madelin. Bientôt on pourra chanter : la Madelin vient nous servir à boire !
Jeudi 12 Septembre 1996
La pensée abstruse du jour : on pourrait retranscrire les faits contemporains dans les réalités du passé, en supposant quelque chose comme l'immuabilité de la nature humaine.
En gros, la pensée dite "de droite" postule une nature immuable de l'homme. Donc, le barbare du cinquième siècle doit avoir son équivalent dans le présent, même si l'on n'enregistre pas intrinsèquement les mêmes faits, c'est à dire même si ces barbares d'aujourd'hui ne peuvent pas se livrer à leur barbarie sous la forme, par exemple, sanguinaire. Il suffirait de trouver des équivalents entre des faits contemporains et des faits du Moyen-Age. Il suffit de trouver des dénominateurs communs à des actions différentes. Par exemple l'humiliation. Au temps de Clovis, l'humiliation était permanente pour ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas affronter la mort dans le combat. L'humiliation en tant que telle est aujourd'hui présente pour toutes les victimes des dénis de justice, du non respect des lois ou de la constitution. Là se trouve une sorte de substratum de la définition d'une civilisation barbare, dans la généralisation de l'anarchie inégalitaire et donc dans l'abaissement de la majorité des individus selon l'arbitraire d'une minorité. Ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est que dans le cas de la Gaule mérovingienne, l'anarchie vient d'un extérieur, d'une conquête, alors que de nos jours elle se développe à l'intérieur même des frontières de la civilisation.
Samedi le 28 Septembre 1996
L'admiration est le sentiment le plus fertile. Elle est le moment de l'effacement du moi qui permet tout, le travail, le sacrifice et l'intelligence. Il doit y avoir une généalogie des objets du désir, ou plutôt un ordre chronologique secret qu'il nous arrive de découvrir, et alors nous admirons. Une fraternité de pensée qui surgit de la découverte d'un texte ou de l'écoute d'une parole. Elle porte alors nos actes comme par magie, mais comme une magie qui coïncide avec la raison des choses, une magie qui se nomme.
Le plus grand reproche que je puis adresser à mes éducateurs, c'est d'avoir brisé un à un, les ébauches de ce sentiment, de ne même pas avoir permis qu'il surgisse pleinement. Ils ont fait cela dans l'aveuglement de l'esprit d'esclavage qui reste encore l'état d'esprit dominant dans le milieu de l'éducation. Même les Jésuites ont manqué cruellement de cette délicatesse, sauf peut-être dans leur manière de nous signifier leur propre admiration pour ceci ou pour celui-là.
Samedi 5 Octobre 1995
Notre problème pour entreprendre de vivre, c'est qu'il nous aura toujours fallu d'abord comprendre comment nos aînés ont pu vivre comme ils l'ont fait. Cela fait une perte de temps irréparable, sans parler des pièges que comportent le chemin qui mène à l'intelligence du phénomène. La barbarie se situe quelque part dans cette zone d'approche d'une tradition qui, traditionnellement, ne va en rien de soi. Elle (la barbarie) est donc bien une nécessité vitale. Elle n'est dangereuse que lorsque la compréhension ne finit pas par se faire et s'identifie alors à la psychose.
Depuis longtemps je me suis rendu comtpe que je ne respecte guère les engagements que je m'étais plus ou moins imposés d'être un "chroniqueur" du temps présent. Je ne parle pas beaucoup de ce temps, mais surtout de ce que devient la compréhension dont je parle plus haut. Mais dans les évènements eux-mêmes, le merveilleux finit par s'estomper et l'histoire présente se banalise. D'ailleurs, à ce propos, je pense qu'il faudra it tenter de séparer la science historique de la chronologie. Le temps n'est tout simplement pas un facteur de l'histoire parce que la causalité est trop souvent en panne pour expliquer ou pour produire les faits, les développements et les miracles. Bien sûr, mon attitude sera jugée parfaitement iconoclaste, puisque ce qui est intéressant pour l'espèce ce n'est pas l'intelligence des phénomènes, mais l'efficacité de la structure explicative. Plus celle-ci est chronologique, plus elle peut enserrer l'ensemble de ce qu'on nomme le passé, rien ne lui échappe par définition et nous pourrions, comme c'est le plan initial, retourner sans grand mal jusqu'aux fameuses "origines". On peut ainsi construire une fourmilière rationnelle du destin humain, même s'il faut aller pour cela jusqu'à un Eden qui ne serait rien de plus que la cellule de la reine.
Vendredi le 11 Octobre 1996
Régionalisme. Le pays basque est peut-être le site d'où l'on peut le mieux comprendre le phénomène du régionalisme, irrédentisme, identité régionale etc...C'est là que le déchirement de la communauté en tant que communauté est le plus palpable. Un exemple : la mort. La tradition basque invite à chaque décès l'ensemble de la communauté à partager le deuil. Famille, voisin, commune, même les animaux et les lieux sont informés de la disparition du défunt. La mort "industrielle" a tué cette tradition - dans ce contexte le mot tradition prend tout son sens puisque traducere signifie "conduire au-delà" - et la communauté qui a vécu de ce type de tradition, se meurt. Question : on a historiquement choisi (on peut contester l'idée de choix, mais cela ne change rien en substance) d'assumer l'individu comme cellule fondamentale de la société, comme monade autonome. Tous les objets du marché, de la vie quotidienne, toute la praxis sociale etc... sont pensés et produits pour l'individu et non pour une communauté fantomatique. Par conséquent, on voit mal comment peut se résoudre ce deuil autrement qu'en se comprennant lui-même comme deuil. C'est ce que j'avais écrit il y a déjà quelques années à propos de la perte du dialecte alsacien, qu'il faut porter sollennellement en terre en le transformant en langue morte et en curiosité de musée. Il faut donc faire son deuil de la communauté et surtout pas brouiller les discours en défendant quelques idéaux jacobins en les confondant avec une défense de la communauté. La cohésion de la nation n'a rien à voir avec une praxis communautaire. C'est ce que les Anglo-saxons ont compris bien avant nous, les aspects charnels de l'ancienne communauté et la jouissance qui y est liée devra être sacrifiée. On ne peut pas tout avoir. Cela n'a rien à voir, non plus avec la forme républicaine, qui a toujours plutôt été plombée par les communautés (voir les imbroglios du droit de succession ou de citoyenneté chez les Romains) que rehaussée. Les tribus ont toujours été les ennemis de la république qui est née de leur fusion-disparition..
Par ailleurs, cette perte de la communauté est le problème fondamental de notre temps. Le passage du système de dépendance réciproque en système de réciprocité indépendante est le véritable objet de l'histoire présente,
volens nolens.
Mardi le 15 Octobre 1996
An ce moment je vis dans les cinq et sixième siècles. Justinien et Theodora, deux personnages clé de notre histoire. Ce sont des clés pour comprendre le mensonge idéologique de notre occident. Parmi les historiens qui ont observé les figures de ces souverains de Byzance, il y a une ligne de fracture très nette. Les historiens qu'on pourrait nommer, pour aller vite, gallo-catholiques, défendent avec un certain acharnement et une grande mauvaise foi, l'oeuvre de Justinien. Les autres, et notamment l'anglo-saxon Gibbon ou le Juif Vidal-Naquet, n'hésitent pas à stigmatiser une tyrannie sanglante dont le principal résultat aura été la ruine de l'empire romain. Raison de tout cela, le rôle éminent joué par Justinien dans deux domaines essentiels pour la "catholicité romaine" : la répression des hérésies et la codification du droit. On ne peut pas jeter aux oubliettes de l'Histoire un couple qui a si bien homogénéisé le christianisme dans le sens de l'orthodoxie, quel qu'en soit le prix payé par les peuples. De même faut-il garder quelque reconnaissance à celui qui a défini la matière ou le support du droit d'une manière aussi magistrale. Bref, comme pour Auguste, dont le règne a pu être totalement magnifié ou totalement vilipendé, la mémoire historique reste, même parmi les historiens qui se disent des scientifiques, une affaire étroitement politique. Lorsque l'on fait de tels constats, on comprend ce que veut dire "agrégation".
En cherchant à en savoir un peu plus sur les Isauriens, peuple qui ressemble aux Kurdes (mais ce ne les sont pas), je suis tombé sur l'atlas archéologique de notre nouvelle encyclopédie. Quel vertige. Rapidement, cette question : comment les peuples ont-ils vécu sans cet espace de mémoire derrière eux ? C'est à dire un espace pas plus vaste que leur tradition orale ?
Jeudi le 31 Octobre 1996
A propos de Bouddha, homme du jour. Pourquoi homme du jour ? La souffrance. Inversion nécessaire des perspectives : la souffrance, autre face du bonheur. Plus facile à atteindre ? Peut-être pas dans sa véritable dimension qui est...la joie. A partir de là, il y a deux manières de définir cette joie. La première consiste à la comprendre comme la vision d'une éternité assurée. Les catholiques des derniers espaces intégristes comme l'Italie du Sud ou l'Amérique Latine, connaissent cette joie dans les fêtes masochistes. La douleur physique est le "petit" prix pour leur grande crédulité. Mais c'était aussi la joie de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix. Ca fonctionnait comme cela : Dieu est la transcendance qui donne le monde comme manque de divin, sous forme de la souffrance. Il fallait donc augmenter le manque pour se rapprocher de Dieu.
L'autre moyen de comprendre la joie comme concommitante de la douleur, c'est le détachement du désir. C'est à dire, la claire conscience que les objets du désir sont de simples représentants du seul désir qui comble, le désir métaphysique. Ce désir donne son objet gratuitement pour qui sait le reconnaître, il est simplement la réalité.
Lundi le 4 Novembre 1996
Le curseur pulse sous mes yeux et, ce soir, rien ne vient. Je voulais parler de moi...Est-ce si difficile ?
Dimanche 10 Novembre 1996
Seules comptent les vraies interrogations, il faut donc les traquer, et ne traquer que celles-là. Par exemple, où est la substance ? Jusqu'où devrai-je reculer pour arriver à la question pure sur ce qui est intangible et éternel ? Il y a, déjà dans l'automaticité de cette écriture et de l'assemblage des mots, quelque chose qui devrait donner des indications.
Par exemple le mot "compter". Qu'est-ce qui compte, qui est-ce qui compte ? Le temps compte et le comptable compte. Le temps compte les jours qui s'écoulent et la mort qui approche.
Donc le temps est le sursis du vivant. Sur-sis, dirait Heidegger. Je ne possède pas l'étymologie de ce curieux concept et c'est dommage. Je m'imagine que "sis" renvoie à sistere, être en place, habiter, "sis 7 rue Wimpheling". En tout cas le substantif vient du verbe surseoir, reporter, décaler vers l'avenir etc...Or ici, le mot sursis a la signification commune de prolonger, étendre l'espace de temps, allonger une période. Sub-sistere (littéralement "habiter au-dessous") donne à l'évidence subsister. Subsister et surseoir seraient donc synonymes ? Interessant. Dans l'économie sémantique de cette comparaison, transparaît l'idée que c'est la mort qui est première par rapport à l'être. Ainsi, subsistance ou sursis illustrent une position en rapport avec la mort ou le non-être. Etre (habiter), c'est sous-être, être au-dessous (ou en-deçà) du non-être. Disons, ce n'est que ça.
Compter, c'est donc mesurer le sursis ? Peut-être. Mais dans quel sens ? S'agit-il de compter en tant que mesure de retardement, de combat d'arrière-garde ? C'est à dire de collectionner les recettes pour prolonger le sursis, cela même qui semble compter universellement si on se réfère à tout l'affairement scientifique et technique des hommes en vue de prolonger leur subsistance ? "Ce qui compte" devient alors le prix de revient de la survie. Or, cette définition exclut le contenu du concept même de sur-vie, de sub-sistance, de sur-sis. On reste résolument en-deçà d'une ligne qui permettrait de comprendre l'ensemble du dispositif sémantique. Il manque donc là la présence du non-être comme composante conceptuelle de l'expression compter. Le non-être n'est présent que comme inflexion poétique de la construction sub- sistere, sous-être, sous-habiter, habiter en-dessous.
Remarque : nous avons depuis longtemps remplacé subsister par survivre. Mais cette modification ne fait pas que rappeler le destin du concept de vie au 19 ème siècle. Elle voile le côté péjoratif du mot subsistance qui devient d'ailleurs un mot qui désigne, aujourd'hui, les objets qui concourent à la survie, plutôt que la survie elle-même.
Subsister c'est donc résolument : sous-vivre, vivre en-dessous. Nous atteignons là un autre sens du mot compter. L'homme compte les jours qui lui restent comme le prisonnier qui marque les jours de sa captivité.
Compter devient ainsi : chercher des questions. On cherche des questions pour marquer les jours de captivité. Fabuleuse découverte. Les marques ne sont que la figure du non-être en creux. Les question sur la "substance" sont des figures du non-être en creux.
Monceau de banalités. Il y a des jours où il vaudrait mieux s'abstenir plutôt que d' écrire n'importe quoi.
Samedi le 16 Novembre 1996
Nique Ton Dieu : l'histoire de la France moderne vient de franchir une étape décisive. Les chanteurs vont maintenant en prison. NTM (Nique Ta Mère) vient de se faire condamner à trois mois de prison ferme et six mois d'interdiction de chanter !!!!! Même du temps de la Marseillaise de Guinsbarre on avait pensé à tout sauf à cela. De Gaulle, le con, avait bien réinventé le crime de lèse-majesté, mais au moins il y avait là une logique du pouvoir vieille comme le pouvoir lui-même, l'un de ses aspects éternels au fond.
Quant à moi, je commence à en avoir marre. Lorsque j'avais vingt ans je ne me sentais pas concerné par la connerie des pouvoirs, je me contentai de me tirer quand il s'avérait qu'on voulait me mêler aux absurdités de la guerre coloniale. Aujourd'hui les choses sont différentes. On ne me demande rien, ou pas grand chose. Même à mon boulot j'ai réussi à défendre mon domaine de dignité, on me respecte en me fichant la paix, enfin! Mais aujourd'hui je vis la réalité sociale de manière différente. Je ne peux plus rester insensible à ce que se passe autour de moi, alors même que ça ne me concerne pas directement. Mon visage est devenu social. Ou bien la société s'est inscrite dans mon visage, on ne peut plus y cracher comme ça n'importe comment.
Je pense qu'il ne s'agit pas d'une transformation purement subjective. Il me semble plutôt que les conditions du pouvoir et les effets de ses crimes ont changé. Le peuple est devenu une réalité. On a si longtemps invoqué le peuple qu'il a fini par accoucher et ça risque de faire mal. On sent bien la multiplication des violences de "solidarité" dans les banlieues, ces ateliers expérimentaux du peuple ! Ma propre banlieusarderie mulhousienne revient à toute allure. La révolution n'est pas loin, mais plus rien à voir avec Mai 68 et c'est tant mieux.
Samedi 23 Novembre 1996
L'ouragan Malraux, annoncé depuis quelques mois, ravage le pays. Comme s'il vivait encore. Les média ont ce fantastique pouvoir de rendre l'existence aux morts.
Ce retour me donne quelques frissons. D'abord il me balance tout d'un coup à la figure que "je" suis fait de pièces malraciennes. Entre autres, songé-je en me consolant, mais il est dur de trouver dans l'évocation du grand homme des idées, des intuitions voire des philosophèmes que l'on croyait à soi. Et de se rappeler cette vérité que toute forme "informe". Quand j'étais prof, je savais déjà qu'il suffisait au fond de dire UNE fois les choses pour qu'elles s'inscrivent à jamais dans la mémoire de ceux qui les entendent. Alors imaginez tout ce que vous pouvez savoir, sans le savoir !!
Hier Myrie m'a adressé la parole avec cet air admiratif qu'elle a parfois, pas assez souvent hélas, pour me dire qu'Attali (Jacques) venait d'écrire un livre qui exposait ma vieille thèse du retour du nomadisme. "-Tu sais, Attali pense comme toi.-" Soit, je savais que ma pensée n'était pas mienne. Qu'elle ne faisait en quelque sorte que transiter par moi. Que la maturation des "théories" n'était pas un phénomène subjectif, mais quelque chose comme le produit d'un Weltgeist, un jeu de dominos intra-réel qui pourrait peut-être fort bien se calculer sur le mode pragmatique ou...religieux. Mais de là à admettre que tout ça
m'a déjà été dit et que toute ma pensée n'est qu'une vaste anamnèse signifiante ! Il y a un pas. Le platonisme n'aurait-il pas été assez suffisemment compris ou compris de manière assez humble ? Sans doute la grandiloquence chrétienne a-t-elle donné à Platon une dimension tout à fait idiote. Dans la traduction comme dans l'interprétation. C'est tout le message d'Heidegger. Mais je ne puis justement pas en dire plus car je ne lis pas le grec, pas assez pour atteindre Platon ou Aristote dans le texte.
Donc toujours aussi ma vieille théorie des ouvertures : le moi est un crible par lequel la volonté décide de laisser passer la pensée ou de la retenir. Une éthique rationnelle pourrait consister en des exercices d'auto-ouverture. Ce mot dit aujourd'hui, très bien ce qu'il veut dire dans de nombreux contextes. Ce qu'on peut le plus sûrement et sans craindre un instant de se tromper reprocher à la bande des fascistes à la Le Pen, c'est la fermeture. L'ouverture est une disposition générale à la vie elle-même. La conséquence de son contraire est claire.
Etant entendu que laisser passer n'est pas une simple autorisation morale ou pratique. Laisser passer doit nécessairement avoir un caractère actif ; une activité qui devrait ressembler à une sorte de règlement de la circulation des formes. Ces formes "arrivent" continuellement d'autour de chacun de nous. Elles se "présentent" dans des flots chaotiques et contradictoires à tous les orifices de notre conscience. Il ne suffit donc pas de se contenter de les laisser passer telles quelles, car telles quelles elles se détruisent ou se dé-forment. Il faut les re-présenter, c'est à dire d'abord les distinguer, puis les immobiliser, puis les stabiliser dans la durée. On constitue ainsi une sorte d'herbier des formes, d'alphabet primitif qui possède ou qui reçoit la puissance de se reconstituer en eidos. En grec, la théorie c'est le passage. Faire de la théorie c'est contempler le passage, mais pour contempler le passage des choses il faut d'abord les distinguer chacune et les poser quelque part, comme la retenue d'une opération arithmétique. Pour la reprendre et l'agréger à la sommation du raisonnement logique. L'eidos, c'est alors l'image finale que l'on peut classer dans un autre herbier qui s'est élaboré entre-temps.
Pas étonnant donc que les mêmes flux puissent donner les mêmes "idées". Attali saisit les choses "comme" je le fais moi, avec les mêmes instruments et la même disposition d'âme. Le fait que j'ai l'impression d'avoir exprimé ces idées le premier est fallacieuse, car Attali n'a fait que les publier et je ne sais rien sur la genèse de ses idées. Le nomadisme est un "objet de pensée" qui me fascine depuis très longtemps, sans doute depuis que je me suis mis en route, mais c'est avant tout une réalité visible pour qui sait lire le passé et le présent. Il est quand même intéressant de noter que nous avons les
mêmes idées. Comme elles ne paraissent pas totalement banales et même un peu neuves, la fraternité intellectuelle est d'autant plus troublante. Avec Attali j'avais déjà noté une mêmeté dans l'approche du temps, mais il avait été accusé d'avoir plagié Jünger, ce qui nous ramène tous les deux à l'un des bras de ces flux signifiants, à l'un de ces paradigmes cachés, tapis au fond du subconscient et prêts à ressurgir au moindre stimulus.
En définitive il vaudrait mieux supprimer toute idée de "propriété intellectuelle", c'est là une des dernières absurdités où nous a conduit le culte de la propriété privée tout court. Il n'est pas absurde de penser que la notion de propriété privée soit une élément de la guerre de l'obscurité contre la pensée. Car, quel meilleur moyen de stériliser le mouvement de la pensée que de la fragmenter en performances subjectives. En faisant ainsi on fabrique des isolats artificiels, ce qui permet ensuite de renvoyer toute découverte à une subjectivité de toute manière suspecte. Et là le serpent se mord la queue : la subjectivité, le véritable résultat de l'opération appropriative, devient le motif du rejet de la valeur.
Dimanche le 24ème jour de Novembre 1996
Je souhaiterais poursuivre la méditation d'hier, me rendant compte de plus en plus nettement que l'écriture est la plus efficace des intellections. On pourrait prendre l'écriture pour une "copie" de ce qui est présent dans la conscience, mais cela paraît faux. Tellement faux qu'il m'arrive, comme à bien d'autres, de penser que l'écriture pense plus vite et autrement que l'esprit. Ou bien et du moins, apporte sa logique, un supplément de rigueur dont la conscience se passe aisément, sauf peut-être dans la conversation. Mais la parole est un troisième mode d'énoncé ou d'élaboration de ce qu'on pense et ce n'est pas le sujet.
Plus loin encore : l'écriture permet une sorte d'accélération logique, elle précède même souvent le phénomène personnel de la compréhension, elle laboure en quelque sorte un sujet automatiquement. L'écriture pourrait être identifiée à un pilotage automatique du raisonnement. La condition évidente : savoir écrire. Ce qui signifie qu'à partir du moment où l'on a atteint la capacité de réaliser l'adéquation entre le pensé et l'écrit, l'écriture commence à prendre des initiatives signifiantes. Intéressant, non ?
Retour donc à la formation des idées. Pour rester fidèle à la ligne théorique définie plus haut, il faut tout de suite convenir de certains caractères de l'idée. La première constatation qu'il faut faire, c'est que, contrairement à ce qui semble aller de soi, une idée ne peut pas revêtir un caractère d'éternité ou d'universalité. Elle ne le peut pas parce qu'il n'existe aucun réceptacle éternel ou universel de l'idée. Temples, cathédrales, universités, laboratoires ou facultés, dictionnaires, glossaires, théories ou systèmes, chacun de ces dépositaires d'idées n'a qu'un temps. Si on oppose à cet argument que l'idée peut bien survivre à tous ses écrins, on est obligé de faire de l'homme lui-même le réceptacle unique de l'idée. L'éternité de l'idée est donc soumise à la fidélité de la transmission de l'idée entre les hommes, à la possibilité d'une répétition fidèle d'une
tradition.
Par ailleurs, ce que nous avons dit de la non-propriété de la pensée implique que la progression du pensé ne peut nulle part s'arrêter sous une forme absolue qui impliquerait, au contraire, la possibilité de conférer une identité subjective à son inventeur. Autrement dit, si une idée pouvait être éternelle, alors il serait juste que son "inventeur" en soit le propriétaire. Pourquoi ? Simplement parce que seule l'éternité et l'universalité confèrent l'objectivité et donc l'objectité qui la sous-tend. Eternelle et universelle, une idée est un objet tout à fait comparable à un trésor découvert par un particulier. Je ne veux pas ici parler du droit qui règle ce genre de découverte, mais je signale que les débats autour de la "vérité", par exemple, comportent tous les aspects essentiellement juridiques du droit d'usage et d'échange de la valeur. Ainsi Heidegger dénie tout droit d'usage au concept de vérité surgi de la traduction du mot Aletheia en Latin puis dans les langues modernes. Il dénonce l'appropriation privative de l'Aletheia par les églises de la métaphysique post-grecque.
Je ne suis pas en train de reprendre les thèses pragmatistes sur l'évolution du savoir qui , elles, sont essentiellement économiques, c'est à dire qu'elles déterminent la valeur de vérité d'une idée d'après son usage réel : est vrai ce qui est utilisé en tant que tel par une majorité significative. Cynisme dont je suis très loin. Je souligne au passage que les pragmatiques sont eux-mêmes piégés par l'éternité du concept de vérité, et ce n'est pas un hasard puisqu'ils sont aussi les premiers thuriféraires de la propriété privée. Pour eux, il y a aussi toujours une vérité, même si cette vérité se transforme au cours de son usage et de son échange. Comme ils travaillent à courte vue la valeur intrinsèque d'éternité ou d'universalité ne leur fait ni chaud ni froid. Les pragmatiques ne pensent pas, ils gèrent le présent. L'objectivité pour eux, n'est que l'adaptation de l'idée à l'état des connaissances scientifiques du présent.
Nous, nous travaillons sur autre chose. Nous travaillons sur l'éternité et l'universalité réelles, sur l'idée elle-même telle qu'elle est conditionnée par ces deux paramètres.
Et nous arrivons ainsi au soupçon d'un processus véritatif, une sorte de mouvement "d'ayant en vue la vérité" qui est lui-même la seule vérité existante. Pour bien nous démarquer des anglo-saxons, il faut préciser que "l'ayant en vue la vérité" n'a pas de fonction régulatrice par elle-même. Elle est une simple béance constante entre les objets du flux extérieur et le sujet. Cette béance a peut-être été le mieux décelée par les tenants de la psychanalyse. Celle-ci garantit non pas l'universalité de la vérité qui doit surgir, mais son absolue singularité. Le nouveau débat qui surgit de là est la promotion logique de la singularité au rang de l'universalité. Et cette discussion-là fait repartir le vrai moteur de la pensée, celui du débat entre l'absolu singulier et l'autre universel logique, celui du multiple. Ce n'est pas par hasard que Guillaume d'Okham entame sa logique par la reconnaissance de l'absolue singularité de toute chose : "après" on peut bien se servir des universaux, mais seulement après.
Mercredi 27 Novembre 1996
Nos grands argentiers veulent créer une monnaie commune aux quinze pays qui constituent l'Europe (future). Fort bien. Les problèmes réels que cela soulève sont immenses et je me demande souvent si les technocrates responsables en sont bien conscients. A les écouter il s'agit d'une sorte de mécano pour lequel il conviendrait tout d'abord de créer une base solide. Les critères de convergence devraient garantir cet aspect du problème, mais à y regarder de plus près ces critères défendent d'abord et par anticipation les monnaies fortes.
Qu'est-ce-qu'une monnaie forte ? Une monnaie forte est une monnaie où se réfugie la richesse lorsqu'elle est oisive et qui, de son refuge, continue de grossir. C'est donc aussi une monnaie convoitée car elle produit plus de richesse en "vieillissant" que les autres.
De quoi se nourrit une monnaie pour bien vieillir ? De profits. Profits industriels et profits financiers, et des profits garantis. Le Deutsch Mark tire sa force essentiellement de la garantie que représente l'état qui l'émet, contrôle sa masse et gère les "fondamentaux" qui le font évoluer. Le Traité de Maastricht établit de tels fondamentaux en préconisant des critères de convergence , c'est à dire des critères économiques qui devraient, à terme, équilibrer (faire converger) toutes les monnaies du panier européen.
Les critères de convergence sont destinés à maintenir la force de la monnaie européenne, même lorsqu'elle aura assimilé les monnaies faibles, une opération où devra se produire, qu'on le veuille ou non, une perequation des valeurs des monnaies. Sauf à ruiner d'un coup un pays entier ou à le laisser en-dehors de l'union monétaire. (à suivre)
Vendredi 29 Novembre 1996
On continue ? Tant pis, on peut aussi tourner la page...
Donc, une monnaie forte ce n'est pas seulement ce que j'ai dit plus haut. C'est aussi une monnaie qui, comparée aux autres, coûte plus cher ! C'est à dire que les mêmes marchandises achetées en DM coûtent relativement plus que les mêmes marchandises achetées à New York en dollars. Exporter des marchandises libellées en monnaie forte est donc plus difficile que le contraire. Les monnaies fortes s'avèrent donc ainsi être aussi des monnaies faibles ?!?! Comment y voir clair ?
Disons ceci : un pays à monnaie forte ne peut envisager de commercer sans problèmes qu'avec un autre pays à monnaie forte, à moins de passer par une troisième monnaie (ce qui est le cas aujourd'hui pour tout le monde grâce au dollar, mais entraîne une dépendance générale de la monnaie américaine qui mène ainsi le jeu mondial). Allemagne et France sont donc des partenaires idéaux, puisque le franc est quasiment intégré à la zone Mark !!! Hé oui, si on annule les marges de fluctuations on fait la même chose que de créer une zone monétaire unitaire. A l'heure qu'il est, le franc français, le florin et le franc belge forment DEJA une monnaie unique.
Mais tout est bien dans le meilleur des mondes, puisque France et Allemagne sont des partenaires commerciaux premiers l'un pour l'autre et ces deux pays à leur tour pour les autres pays européens en dégradé : au final les "forces" relatives des monnaies européennes doivent disparaître du jour au lendemain lorsqu'au marché unique s'ajoutera la monnaie unique : nous aurons alors un vrai marché unique. Aussi les critères de convergences sont-ils plutôt une sorte de tremplin qui va déterminer la valeur de départ du futur Euro (quel nom débile !).
Nouvelle question alors : que viennent faire les déficits budgétaires et les dettes publiques dans cette galère ? Pourquoi faut-il amaigrir les états pour renforcer la stabilité ? Il y a plusieurs réponses possibles :
- Il est évident qu'il faut empêcher un état réputé "volage" (comme l'Italie aux yeux des Allemands) de se laisser aller à des dettes monumentales qui seraient magiquement éffacées au moment de passer à l'Euro. Car ces dettes subsisteraient en tant que dettes pour tout le monde. Cela paraît normal si l'on se rappelle qu'une dette signifie aussi des créances étrangères à la zone Euro, créances qui renforcent les monnaies concurrentes : le DM est actuellement un bon refuge pour la richesse. Cette richesse pourrait bien fuir l'Europe pour se réfugier dans le dollar ou le Yen si l'Euro perdait d'un coup la force du DM. Les Européens ont donc toutes les raisons pour suivre le DM plutôt que l'Escudos ou la Drachme.
Reste que la rigueur budgétaire est une chose, la chimiothérapie autolytique une autre. ( suite ajoutée le 10/12/96) : D'autant que les déficits budgétaires ne représentent plus aucun danger pour personne - ce serait plutôt une aubaine pour les marchés et une source de capital pour l'industrie - tant que les états ne font pas marcher la planche à billet. Or, avec des banques centrales privatisées, plus question pour nos gouvernements de fabriquer de la monnaie de singe pour payer les dettes. (fin de la remarque surajoutée.)
Serrer les cordons de la bourse, certains en souffriront plus que d'autres. Les Hollandais ne vont pas mourir des efforts qu'on va leur demander pour réunir les critères de convergence. C'est qu'il y a toujours eu une cohérence de gestion des finances dans ce pays, malgré un haut degré de protection sociale et une solidarité presqu'inégalée en Europe. En France les choses sont différentes à cause du chaos financier et politique.
Au point de vue financier la méthode française est une méthode par le haut, jacobinisme mental oblige. Cela signifie que dans tous les domaines on traite les grands équilibres à coup de saignées magistrales, au lieu d'intervenir à la base, c'est à dire dans la gestion quotidienne. Exemple : la Sécurité Sociale.
Dimanche 1er Décembre 1996
Le crû et le qu'ouï. Joli titre pour mon prochain ouvrage, non ?
Découvert ce qu'était la culture : une remontée dans la préinscription. Un simple repérage du champ de bataille, du champ de sa propre vie. Qui ne fait pas cette démarche élémentaire ne peut rien revendiquer sur les suites de son parcours. La plus simple des cultures aura déjà toujours été le culte des ancêtres, la lignée dans laquelle on vient se placer malgré soi et à partir de laquelle il faut tenir ou périr. Alors on peut appeller cela aujourd'hui Histoire, philosophie, littérature ou tout ce qu'on veut, il ne s'agit toujours que d'aller voir ce qu'on vient faire dans cette galère à la lumière de ce qui s'y est fait jusque là.
Vendredi 6 Décembre 1996
En train de me taper le pensum de Chevènement sur l'Allemagne et la France. Un vrai mémoire d'Enarque sur de la géopolitique tarte à la crême. Ce brave type est une vraie nouille avec que des grands mots bien au garde à vous, mais qui n'ont plus cours depuis longtemps. République par exemple ! Va-t-on croire encore longtemps à la magie des mots (j'avais écrit ..des morts, joli lapsus). Dès que la République perd son caractère aventureux, de jeu à gagner ou à perdre, c'en est fait d'elle et de son caravansérail de paperasses destinées à la momifier. Il n'y a plus de feu sous la cendre hélas, on ne peut pas réveiller avec des raisonnements les pages calcinées de l'histoire. En réalité, même la République romaine n'a vécu qu'à travers son cortège de guerres, civiles et autres : la République est toujours une réponse, pas une prémisse. La simple renaissance d'un esprit. Esprit es-tu là ?
On verra bien.
Samedi 7 Décembre 1996
Fascinante, la musique des mots ! Toujours Chevènement avec ses options "politiques", ses peuples "politiques" (la France !) et les autres... Une analyse de l'Allemagne où presque chacun peut y retrouver ses petits, sauf, peut-être, les vrais nazis. Je ne comprends pas pourquoi ce livre n'a pas fait le même scandale que celui de ce jeune chercheur américain Goldhager qui prétend que le racisme est inscrit génétiquement dans l'histoire du peuple allemand. Jean Pierre ne dit pas grand chose d'autre, et comment pourrait-on le faire à rester dans la dimension de l' analyse ? Chevènement n'est pas très clair. Sa distinction n'est pas nette entre l'héritage "culturel" protestant-romantique-germanique-völkisch et le rôle de la bourgeoisie whilelmino-weimarienne. Alors, Peuple ou pas Peuple ? Volk oder nicht Volk ? Il signale bien le fait qu'en Allemagne justement il n'y a pas de peuple car de l'autre côté du Rhin c'est aux Allemands du peuple et non aux rois qu'on a régulièrement coupé la tête. Il ferait donc mieux de laisser ses barbares germains au placard. Au début de son pensum il disserte longuement et vaguement sur le concept d'identité nationale, un peu à l'anglaise, en républicain mal à l'aise avec l'irrationnel, mais prêt à faire des concessions du type aristotélicien : ici la politique grecque, là-bas la politique perse. Que signifie ce chassé-croisé de considérations déplacées ? Sans doute estime-t-il avoir besoin de la spécificité française pour fonder sa République. Quelle blague et quel piège. Pour le reste ce n'est pas si mal vu, mais tout ça manque de verdeur, de style, de souffle. Il oublie aussi, tant qu'à analyser, la grande fraternité franque des aristocraties franco-allemande : l'Europe veut se faire par le haut, le haut du pavé !
Mardi le 10 Décembre 1996
Hier soir je suis tombé dans un trou métaphysique. Je me suis sérieusement écorché les articulations de l'âme !! Si si ! Sir Gibbon est grand, et je vais devenir son prophète. Dans son fameux chapître XV, le Grandeur et Décadence de l'Empire romain retrace la naissance de l'Eglise chrétienne. My God ! Il y avait encore tant de place dans les marges de ma crédulité ? Moi qui croyais (sic) que j'avais épuisé toutes les sources de l'athéïsme le plus absolu et le plus irréfrageable, que j'avais atteint un degré encore inconnu d'anéantissement de toute possibilité de même seulement se figurer une transcendance quelconque. Moi qui commençais de nourrir secrètement une sorte de paranoïa, évitant de m'interroger sur la folie générale sinon déjà totalitaire qui m'entoure. Je ne parle même pas des intégrismes qu' on peut encore classer parmi les psychoses. Non, je pense à certains amis qui sont et restent d'effarants croyants ! Sous mon nez ! D'effarants croyants, very respectfull de toute une épopée mythique, reconstruite dans leur esprit sous le label de la "vraie Foi" des chrétiens Primitifs. Une chose est sûre, ils vont souffrir dans les prochains temps, la faute à Gibbon. Car ce rusé sujet très Anglais du dix-huitième siècle, nous a laissé la plus fabuleuse Histoire des premiers chrétiens : de quoi pulvériser en deux ou trois centaines de pages, des millions de fantasme millénaires, à commencer par la plus grosse partie des oeuvres signées par les Pères de l'Eglise. En bref, tout le martyrologue s'écroule, nonobstant les querelles intestines, c'est à dire les guerres de religions entre Chrétiens dissidents et Chrétiens Orthodoxes ( et vice et versa, car ce seront en définitive les armes qui décideront, comme d'habitude, de l'orthodoxie elle-même). Pas plus de Sept Mille Chrétiens n'ont perdu la vie pour leur foi en trois siècles de domination idolâtresque ! Et encore ! La plupart du temps, Pline le Jeune en témoigne abondamment, en suppliant le bourreau de mettre un terme à une vie si ignoble par rapport à une éternité si douce, puisqu'en tant que martyr on entrait directement au Paradis. Une musique qui me rappelle beaucoup ce que récitent aujourdh'ui les Imans et les jeunes cons qui vont se suicider avec des bombes sous le manteau.
Le très ironique Gibbon a bien du mal à découvrir quelque martyr authentique. Et quand il en trouve un, comme St Cyprien, c'est pour se rendre comtpe que le juge romain qui l'a condamné, l'a fait contre son gré, sans comprendre quoi que ce soit au comportement de l'évèque de Carthage et avec des égards qui transforme toute la cérémonie de l'éxécution en quelque comédie holywoodienne avant l'heure. Ah! ben bonjour! la force et la prégnance de mon éducation religieuse. Ah! ben bonjour! le bourrage impitoyable de crânes encore mous, capables de recevoir n'importe quelle monstruosité sans piper pendant toute une vie.
Peut-on imaginer à quel point le martyrologue est devenu un cliché ? A quel point on se trompe à imaginer une pureté originelle à une simple secte dissidente du Judaïsme. Cavalier, Gibbon, au passage : pour mieux faire oublier le manque de scélératesse des empereurs romains, et aussi l'à peu près de tout ce qui se disait en son temps sur l'Eglise primitive, l'historien en rajoute contre les Juifs, tout à fait inutilement. Mais comment pouvait-il faire et écrire ce qu'il a fait et écrit sans offrir un bouc émissaire de choc ? Il aura beau revenir en arrière sur la bonne évolution ultérieure des Juifs, c'est dit c'est dit, ce sont des sauvages, des ennemis injustes et sanglants (sic) d'une administration douce et bienveillante. Il fallait choisir.
Ma propre naïveté me défonce. C'est aussi ce qui doit faire ma force. Seul l'étonnement est porteur d'énergie et inattaquable. J'ai souvent expérimenté cela dans ma vie, exposé aux plus grands dangers, je n'y ai chaque fois échappé que grâce à une innocence invraisemblable, qui a toujours su désarmer mes pires agresseurs. Mais, il est vrai que je suis avant tout un innocent. Peu importe, j'ai du mal à admettre que je sois resté tant d'année dans des représentations aussi fausses que mensongères. Je pensais souvent, à part moi-même, que peut-être mon ignorance ou mon manque d'érudition sur l'Histoire du peuple de JC, m'empêchait pour ainsi dire d'accéder à nouveau à la vraie dimension de la Foi. C'était le contraire. C'est parce qu'il traînait encore tant de connerie dans ma cervelle que j'en arrivais encore à douter un peu de mon athéisme. A la Voltaire, attendons les derniers moments...
Autre aspect qui me fascine, c'est la force pédagogique de la Liturgie catholique! Mon éducation a été une vraie mise en scène des épopées des saints martyrs! A commencer, bien sûr, par le beau chemin de croix de mon église natale, sorte de film d'épouvante avant l'heure ou d'opéra total, où les prières, les chants, les images, les sculptures et les douleurs dans mes membres formaient une performance artistique absolue. Les éléments étaient liées par un art redécouvert et utilisé avec toute sa puissance par un certain Adolf Hitler. Liturgie = rythme temporel + gestuelle gymnique + exercice des arts + texte abscons + odeurs précises et entêtantes + maman. Tout y est, à mettre au four du confessionnal au bon moment, laisser mijoter puis sortir au soleil de la place St Etienne. Bon dieu de bon d'là. Ce n'était que ça. Avec le clinquant des aristocrates des siècles oubliés, peintures, musique, vêtements liturgiques, calices d'or et chandeliers d'argent et toutes ces sortes de choses. Tout un tralala qui marche à la perfection pour provoquer de fausses anamnèses de mensonges longuement mûris dans les grimoires et les salles de catéchisme. Tout ce que je ne voulais pas croire dans les récits ahurissants de la Bible, la sofrologie liturgique me l'enfonçait dans ma sale caboche de kobisch.
Saviez-vous que depuis hier soir je ne veux plus être un "laïque" ? Etrange, non ?
Non, pas étrange. Car la notion de laïque est une notion...chrétienne. Ce sont les premiers Chrétiens qui ont coupé les sociétés en deux parties, les laïques et les clercs. Les moutons et les bergers. Je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un laïque, je suis un homme. Depuis Legendre je savais cela, mais pas d'une manière assez précise, assez terre à terre pour que cette connaissance puisse être simplement efficace dans ma tête. A trop s'en prendre à la "cléricité", on perd de vue que la laïcité n'en est que le pendant. La trahison des clercs est dans leur existence, pas dans leurs actions. Une dernière impression que je vous livre brut de décoffrage : les premiers chrétiens, c'est exactement comme les scientologues d'aujourd'hui. Poursuivis pour détournements de fonds et vaguement suspectés de se foutre du monde, exactement le même topo qu'il y a deux mille ans. Enfin j'apprends que JC avait des frères. Un certain Jude entre-autre, dont un fils a été mis en examen puis relaxé par le jurisconsulte de Marc-Aurèle. Le saviez-vous ? Je ne parle pas du Jacques découvert dans les manuscrits de la Mer Morte. Encore un !
Samedi 14 Décembre 1996
Cette existence doit m'être bien légère pour que je ne me sois aperçu de rien, depuis tout ce temps - cinquante-cinq ans !
Pour que je ne me sois pas aperçu dans ma chair ce que signifie la déréliction humaine. Pour n'avoir jamais vraiment compris l'expression "opium du peuple". Mais ce n'est pas opium du peuple, c'est
peuple de l'opium ! L'homme est un animal drogué par tous les bouts !
Hypothèse : l'homme de la préhistoire usait de toutes les drogues naturelles, les opiums que nous offrent végétation et monde animal. Il s'était fixé autour de ces explications simples de l'étant : il n'y a pas à chercher d'explication, il y à supporter l'étant dans sa cruauté, sa nullité, ses dangers permanents et son manque absolu de poésie.
Vint ensuite un homme qui avait besoin que quelque chose marche
pour lui. Ne voulant plus marcher seul, il voulut peut-être
se faire porter. Tout simplement ! Il fallait détourner les "collaborateurs" des drogues inhibitrices, faute de voir le portage comporter plus de danger que la marche et ses souffrances. Et pour cela il fallait inventer des drogues spirituelles, des implants immatériels qui détournaient les futurs esclaves des drogues qu'il suffisait de cueillir. Il fallait construire une histoire qui tienne debout et permettre en même temps à celui qui la raconte de prendre empire sur son auditoire. L'histoire est bien connue : après la mort il y a encore une vie possible etc....
L'idée fut peut-être alors d' inventer
la mort. Sans la mort comme concept, on ne peut pas susciter d'instinct conceptuel tout court. L'idée de mort devait servir d'abscès de fixation du cours naturel de l'idéation. Une idéation non-conceptuelle à l'origine devenait ainsi une pensée morcelée, articulée par la limite ultime de la mort. Il faut bien voir que cette idée fonctionne comme machine à récurrence du temps : on meurt chaque fois que l'on pense à la mort. On arrête ainsi le temps. C'est la seule réduction phénoménologique compréhensible, c'est une réduction du temps, une véritable réduction. Dans le sens de "réduire à" - et là il faut comprendre que la mort comme idée réduit la vie à la temporalité, message clairement exposé dans Sein Und Zeit - et dans le sens de vaincre, la perception conceptuelle de la mort entraîne le désir de la surmonter.
L'évolution qui suit est simple. Le monde de l'au-delà comme réalité à venir après la mort n'est pas immédiatement nécessaire comme conséquence logique. On peut aussi, et c'est peut-être le secret du polythéisme, transférer sa portion de vie dans un double parallèle, habile manière de piéger la fatalité de la mort. Cette fatalité est encore très relative, comme l'attestent tous les cultes des ancêtres, les momifications, les création de sites de poursuite de la vie sous une autre forme. Une chose a toujours frappé les historiens et quelques penseurs atypiques comme Jünger, c'est que l'homme antique n'a rien de pusillanime face à l'échéance qui l'attend. Il ne se fait aucun cinéma sur la subsistance de son âme ou de sa réincarnation.
Ce qui le sauve, c'est qu' il se sait un reflet du monde des dieux et par conséquent sa disparition ne l'émeut guère parce que son eidolon (lui-même en tant qu'image) n'appartient pas à la réalité, mais à une fiction. Au cours de sa vie, d'ailleurs, son daïmon personnel ne le quitte pas et conduit l'attelage de son destin. Le daïmon, en réalité, possède son identité : lui-même n'est qu'une illustration du daïmon, un masque que le dieu prend pour quelque instants. La vie, le destin, le bien et le mal ne sont pas ses affaires, mais celles d'un démon qui vit ailleurs et qui n'a pas de comptes à rendre à son reflet.
Avec le monothéisme, tout se gâte. C'est le destin personnel qui naît, ligne continue qui va de la naissance à l'éternité à travers l'épreuve du passage sur terre. (Logiquement il y a un hic terrible : comment peut-on attribuer l'éternité à un être qui possède une extrémité : la naissance est un commencement, un point qui détruit toute possibilité d'inclure l'homme dans quelque chose comme l'éternité. Même juridiquement il serait parfaitement injuste (et donc peu divin) de juger un être pour l'éternité à partir d'un temps déterminé, problème logique extrêmement difficile. Du genre de celui qui a conduit Aristote à nier l'infini en disant en Méta. alpha, 2,28 :" Rien d'infini ne peut exister ou alors l'infinité n'est pas infinie".)
Apparemment ce sont les Juifs qui ont opéré le passage entre le polythéisme, la société humaine à responsabilité limitée, et le monothéisme. Mais, comme le postule de manière assez convaincante le Juif Freud lui-même, le monothéisme mosaïque pourrait être d'origine égyptienne. L'Egypte serait la véritable patrie d'origine de la représentation d'un dieu unique, régent du réel et gérant des destins, PDG d'une société à responsabilité totale. Cette thèse paraît plus plausible en regard du type de société au quel correspond l'Egypte antique, une société extrêmement avancée d'agriculteurs, de commerçants et de technocrates très versés dans les sciences. Il paraît au contraire difficile d'imaginer que les tribus juives, composées de bergers nomades, aient eu spontanément le moindre usage d'un outil métaphysique et sociologique aussi perfectionné que le monothéisme. Celui-ci repose sur une société despotique qu'il tend sans doute à reproduire, une société à souverain unique et absolu. Il est difficile d'admettre que le dieu unique soit l'invention de chefs de clans à peine civilisés que la Loi mosaïque aura beaucoup de mal à fédérer. L'hypothèse de Freud est d'autant plus intéressante qu'elle décrit justement le monothéisme comme un secret d'état volé par un grand-prêtre technocrate, obligé de se fier à des hordes d'esclaves pour sauver sa vie et la doctrine-miracle de l'occident. Moïse fuyant l'Egypte emporte la dernière découverte, celle qui vient de naître dans le monde le plus raffiné et le plus développé de son temps.
Une remarque en passant, tarte à la crême qui traîne aujourd'hui dans le moindre opuscule parlant de la Chine : l'occident aurait inventé l'individu, la Chine serait resté communautaire. Une différence tantôt perçue dans l'économie moderne, tantôt dans l'herméneutique comparée de Socrate et de Confucius. Admettons que ce soit vrai; on peut alors souligner combien le modèle individualiste est lié au monothéisme égypto-judéo-chrétien. Il correspond à merveille à l'idée d'un destin unaire, en ligne continue et doté de sa propre responsabilité à travers la loi.
Le débat sur les Droits de l'Homme se comprend également à cette lumière. Si les Chinois sont restés en-deçà de la notion d'individu, un état que le communisme n'a pu qu'encourager, alors on peut admettre qu'ils ne peuvent pas concevoir la problématique des droits de l'homme comme nous le faisons. Que signifie un droit sans individu ? Cela signifie un droit de la collectivité, exclusif de toute considération personnelle qui ne serait pas reliée aux intérêts de la communauté. Aussi, les Chinois n'ont-ils jamais fait le détour par un monothéisme religieux. Les souverains chinois se sont très tôt imposés comme dieux incarnés, comme maîtres du monde et du temps. Le taoisme et les théories du vide ont aussi très tôt éliminé toute velléité de fictionner un au-delà, récupéré à leur manière par les bouddhistes, mais dans une tout autre perspective. Il faudra un jour comparer la métempsychose judéo-chrétienne et la bouddhique. Des finesses qui devraient être très révélatrices. On y viendra.
Le mystère, c'est donc l'invention de la mort. Un mystère qui pourrait aller de pair avec le mystère de l'invention de l'agriculture, la fin du nomadisme et la naissance de l'écriture et des civilisations. Comment passer d'une idéation continue à une idéation logique ? et d'abord que pourrait être une idéation continue ?
Peut-être peut-on s'en faire une idée en comparant deux états de conscience. Le premier à jeun et le second soumis aux effets d'un toxique queconque, l'alcool ou tout autre genre de psychotrope. L'état natif de la conscience (défini historiquement comme état de conscience d'aujourd'hui, bien entendu, car il est impossible de fictionner un état philogénétiquement natif), est l'état logique. Tant dans les perceptions des sens que dans l'idéation pure, si tant est que cela existe, la conscience est toujours articulée, et à cet effet, morcelée. L'existence du langage n'est pas du tout la preuve que ce morcellement a toujours existé, car on ne peut rien dire de langages qu'on ne connaît pas. A cet égard, j'affirme que les théories qui dérivent de l'ethnologie et qui se fondent sur le concept de développement inégal, seront toujours suspectes de reposer sur une idée fausse ou pour le moins hypothétique : celle qui veut que les civilisations dites primitives représentent des segments temporels de développements historiques retardés par des circonstances matérielles ou géographiques. Il serait temps, par exemple, qu'on accepte l'idée, et qu'on en tire toutes les conséquences, selon laquelle les civilisations du néolithique sont nées de manière synchronique d'un bout à l'autre de la planète. Stricto sensu, le structuralisme ne peut pas revendiquer d'avoir atteint une "nature" plus originelle seulement parce qu'il a travaillé sur de tels segments. Rien ne prouve, mais alors rien du tout, que les Nambikwaras ou les Bororos ne participent pas au présent exactement comme nous. Ils se peut qu'ils ne soient exactement rien de plus que nos Nambikwaras vivant ailleurs, comme nous serions leurs blancs venant d'ailleurs. Rien surtout ne prouve que ces tribus indiennes représentent quoi que ce soit d'originel et de comparable à ce que nous fûmes dans une époque reculée de notre histoire.
L'invention de la mort se trouve dans la Genèse et condense, en sa métaphore, toute la nostalgie des judéo-chrétiens pour un supposé état antérieur qu'ils n'hésitent d'ailleurs pas à dater, en ce qui les concerne. Le fruit consommé par Eve - les talmudistes s'esclaffent lorsque les Chrétiens parlent de pomme - c'est la connaissance. La connaissance, à son tour, c'est le moteur de la naissance, à condition de conserver au terme connaissance toute la charge libidinale qu'elle a porté pendant des millénaires avant de devenir l'instrument de la science. La connaissance c'est donc le sexe, l'acte sexuel avec d'étranges conséquences : la procréation, dont la Genèse ne nous dit rien de plus de ce qu'elle aurait été sans le péché originel. Autrement dit, si Eve n'avait pas fauté, nous ne saurions pas comment le couple originel allait se multiplier. Faut-il rappeler que Adam et Eve naissent deux fois dans la Genèse. Une première fois dans Genèse I, 21-28, lorsque Dieu curieusement crée l'Homme mâle et femelle ; et une deuxième fois lorsqu'il tire Eve d'un côte d'Adam (Genèse II, 5-14). Dans la première version, Dieu ne dit rien d'autre que "fructifiez et multipliez-vous". La connaissance, l'acte sexuel, aura lieu grâce au serpent. La mort vient avec la naissance, la mort sera prononcée par Dieu après que nous eûmes pris connaissance de la méthode de procréation
mortelle, l'autre nous restant difinitivement inconnue.
C'est donc dans la sexualité qu'il faut rechercher l'élément mystérieux qui a permis l'invention de la mort. Freud nous est ici d'un grand secours, car il fut sans doute le premier à imaginer les relations sexuelles dans la horde primitive, ou du moins à définir le fantasme de la possession des femmes comme le privilège du patriarche primitif. A ce privilège correspondrait la menace du meurtre du père par ses enfants frustrés. L'inceste Oedipe est inceste en aveugle, autrement dit, au véritable temps d'Oedipe, bien avant celui des Grecs, le patriarche ne pouvait pas être conscient de son acte, ou du moins de sa valeur criminelle. Oedipe est une pauvre victime du progrès moral, il est tombé entre le temps du permissif et celui de l'interdit.
Cela ne nous dit pas encore comment on invente la mort pour en faire un instrument de "civilisation", voire le langage articulé lui-même et son enfant chéri la science.
L'ennui, lorsqu'on tente de comprendre un phénomène qui a eu lieu il y a des millénaires, c'est qu'on ne peut que théoriser selon des universalités abstraites, alors que l'histoire avance par intrusion du singulier. Il est totalement impossible de théoriser un phénomène historique à partir de généralités actuelles. Tout au plus peut-on définir des espaces de possibilités de naissance des phénomènes. Ici nous avons isolé la sexualité comme espace ou comme vecteur possible de la notion de mort ou de la mort comme notion, puisque c'est de cela qu'il s'agit.
Car il faut garder à l'esprit qu'inventer la mort comme concept ne signifie pas forcément inventer la mort comme conscience de la mort, conscience ne recouvrant pas nécessairement, selon nous, un mode conceptuel. Il faudrait un artiste, peut-être, pour décrire le visage d'une mère du mégalithique qui enterre son bébé. Le poète seul peut retrouver la description d'un état différent du deuil qui, de nos jours, accompagne automatiquement la mort. Les rituels du deuil que l'on peut observer encore dans des régions comme la Sicile, permettent de s'approcher de l'idée que le deuil est passé par une phase de ritualisation, c'est à dire par une mise en scène de sentiments inexistants. Le rite (Confucius) est une obligation sociale, un devoir d'état. Il est possible d'imaginer que le rite soit antérieur au sentiment de la perte, du deuil lui-même et que c'est le rite qui a fomenté le sentiment par une sorte de cynésthésie affective. D'ailleurs la mort comme perte implique déjà une relation déterminé avec le mort, relation que l'on ne peut pas fictionner elle-même comme appartenant à la "nature humaine".
Il y a eu du sexe avant qu'il n'y ai eu de la mort. Mais quel sexe ? Sans doute un sexe en excès. Pour nous, l'excès de la sexualité est classée dans une taxinomie des interdits, à commencer par l'inceste. Mais il ne pouvait être question de taxinomie d'interdits dans une humanité privée de concepts. Nous sommes donc obligés d'inventer une histoire, de spéculer sur une comète lointaine qui s'est matérialisée comme "sexe en excès", sans doute suivi de mort ou lié répétitivement à la mort physique. Une sorte d'usure se serait produite, conduisant à la formation d'un trauma après une rupture violente. Ce trauma aurait pu conduire à la formation de l'inconscient, évènement qui sépare pour la première fois le vécu symbiotique (le Paradis perdu) de son reflet conceptuel. Or ce reflet n'est pas immédiatement acceptable, il offense par le fait même qu'il rompt le symbiotique. Il se charge donc d'un malaise absolu immédiatement repoussé dans une extériorité différente de la réalité concrète où il n'avait pas de place. Cette extériorité est l'âme. L'homme s'est déchiré intérieurement de manière à pouvoir loger dans le lieu ainsi formé la vérité (sans doute fausse) d'une sexualité liée nécessairement à la mort. Car il faut souligner que de lier le sexe à la mort a pour première conséquence de stériliser l'espèce. Je n'aime pas parler en termes d'espèce ou de ces sorte de darwineries scientifiques, mais on peut fort bien se mettre dans une situation humaine où se serait produit un évènement dont les conséquences se mettraient soudain à faire barrage à la procréation.
Un simple accident dans la sexualité. Peut-être l'usage d'un psychotrope trop puissant, ce qui expliquerait en même temps la tabouisation progressive dans le néolithique de l'usage des drogues. Le souvenir des ordalies lointaines n'est pas perdu. Il existe toute une littérature et tout un genre artistique qui remet en scène les fêtes bachiques où le sacrifice humain directement lié aux débordements érotiques forme le scénario de base de la tragédie. Au demeurant, le parcours édulcoré d'Oedipe est le modèle parfait d'un vainqueur au combat qui exerce, pour ainsi dire, son droit de cuissage.
Société agricole, sédentarisme, polis, nécessité d'un souverain et de lois, tout s'explique : il faut désormais codifier l'usage de la nature.
Dimanche le 15 Décembre 1996
Retour à la conscience. Nous avons longuement parlé de la conscience "native", l'idée que l'on peut se faire de la conscience normale, celle de tous les jours, celle qui "fonctionne" par elle-même et sans déformations causées par des éléments psychotropes ou des excès pathologiques. Une conscience morcelée, avons-nous souligné, articulée à l'instar du langage et des structures comportementales du type civilisationnelles.
Il faut à présent en venir à l'autre modèle que nous ne faisons que soupçonner sur la base de nos expériences courantes. Car la conscience peut revêtir des formes non-habituelles, des formes paroxistiques ou bien à l'inverse complètement atténuées. Elle peut même, et c'est le cas lors d'une prise de la drogue appelée LSD, échapper totalement au contrôle (bien entendu il est difficile d'employer ce mot en l'occurence, car ce n'est sans doute pas de contrôle qu'il s'agit) du sujet. Bref, la conscience peut subir des déformations qui la conduisent à modifier la structure de l'idéation qui y correspond et les registres sentimentaux, affectifs, intellectuels voire même spirituels, le chamanisme en atteste suffisamment. On peut constater sans aller bien loin, que l'alccolisme imprime au comportement, au psychisme en général et au langage, une obstination, un angle déterminé qu'il est très difficile d'infléchir. Cette obstination, cet angle résolu illustre peut-être une forme de conscience continue, d'où sont exclues les articulations ordinaires, scandées en sous-sol par le motif de la mort. Faut-il rappeler que les drogues ont précisément pour effet de gommer le message permanent de la mort. La consolation, l'opium du peuple, n'a jamais d'autre motif qu'une sorte de retour à une conscience épurée de ce concept devenu un fardeau.
En conclusion provisoire, on pourrait donc dessiner l'histoire des civilisations comme le passage entre les drogues dures et les drogues douces des doctrines religieuses, grâce à l'invention de la mort comme concept. Faut-il en conclure que le langage, la pensée, en somme l'humanité elle-même se définit comme le produit de cet accident ? Je ne le pense pas, car ce qui manifeste l'humanité à notre sens, c'est plutôt le pouvoir de maintenir ouvertes les possibilités elles-mêmes de tels accidents. Autrement dit le mouvement du jeu. Je et jeu sont liés par essence en ce que l'homme a laissé le Je surgir du jeu. Il faut maintenant qu'il assume.
Plus loin j'éspère pouvoir rendre mieux compte de la forme du trauma sexuel, de ce passage entre la répétition ordonnée de la mort et sa prise de conscience conceptuelle. Sans quoi tout cela restera toujours très obscur.
Mercredi 18 Décembre 1996
Youyou, quel mois fertile ! Vite quelques mots ce soir pour marquer d'une pierre blanche ce jour où j'ai enfin trouvé la solution. IL fallait trouver comment habiller la justice avec le nouveau costume "libéralisme". Hé bien c'est fait ! Je vais donc entamer un ouvrage de plus sur cette merveilleuse petite machine. De quoi piéger tous les politiques véreux de notre siècle.
Vendredi 2O décembre 1996
L'année court sur son erre. Encore quelques jours et il faudra passer à quatre-vingt dix sept, moins un = 56 ans, et tout ça dès le début de la nouvelle année. Je suis en train, sur le tard, de commencer à rendre quelques respects à mes propres anniversaires. Il faut bien reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque passe le temps et qu'on le voit passer. Signe de vieillesse ? Peut-être. Je pense à la mort tous les jours. Parfois, parfois seulement, une sourde angoisse m'effleure. Je me vois là, en-bas, étendu pourrissant, à côté de mes géniteurs pourris. Et tout le ciel se renverse de douleur, les étoiles se mettent à filer dans ma tête. Et je dois bouger, mouvoir quelque chose de moi pour échapper à cette pensée. Comme un animal qui tente de fuir la meute. Et ça marche à chaque fois. A chaque fois je me tire d'affaire, l'abîme se dissipe et alors c'est comme si le monde me faisait tout d'un coup un clin d'oeil du genre, c'est bon pour cette fois, mais n'y reviens pas. Accueil inattendu, accueil comme au premier jour peut-être. La pensée de la mort - mais sans doute ne faut-il pas mêler la pensée à cela, il vaudrait mieux dire la figuration ou la représentation - nous fait renaître, comme au premier jour. Et pourtant j'ai connu bien des états de conscience où j'allais sans porter en moi ce fardeau, ou bien, le portant, il ne me gênait guère.
Passons à autre chose. Je pense qu'il est possible de tenir la dragée haute au libéralisme. Cette idéologie possède un atout maître : l'argument de la liberté. On peut aussi dire qu'il possède la liberté comme argument car il n'est pas regardant sur l'exercice de la liberté dans le monde. Le discours général ...
Jeudi 26 Décembre 1996
Touché hier par une lame de fond anti-culture. Une interprétation de la fonction culturelle comme substitut de la condition paléolithique. La fameuse "densité" ou "compacité" de la réalité se serait perdue au cours de la transformation du néolithique. Ce qui peut se comprendre ainsi : le danger permanent de mort par agression ou de faim a faibli et des plages de plus en plus longues d'oisiveté sans souçis (le château bien connu de Frédéric le Grand) se sont installé dans la praxis humaine. Or, la compacité ne se laisse apparamment pas déloger si facilement, d'où la naissance d'activités de substitution comme la guerre et la culture. Je dis apparamment car si cela va de soi d'un point de vue ontologique, il n'en va pas de même dans l'opinion courante. Pour elle, l'oisiveté est partie intégrante du destin (j'avais écrit du "festin"...) humain. Il est vraisemblable que tout le reste découle de la même cause : religions, lois, écriture. Travail des paléontologues : prouver toujours à nouveau que les oeuvres d'art des hommes de Cromagnon et autres Néanderthal représentent des objets de culte et/ou de culture. Mais voilà qui est bien difficile, voire impossible.
Pourquoi ai-je dit "anti-culture" ? Parce que les objets de la culture me paraissent bien surfaits, les uns et les autres. Je veux bien reconnaître qu'ils procèdent d'un mode opératoire plein de mérite, de talents et de génie. Je reconnais ici même que les artistes et les penseurs sauvent la compacité perdue du destin en sublimant en objets particuliers ce qui à l'origine est l'étant universel. Les oeuvres d'art ressemblent en cela à l'or et à sa densité, comparé aux autres métaux. C'est d'ailleurs en cela qu'on peut comprendre la familiarité de l'art avec la vérité : l'art et la culture jouent l'étant dans son essence pour le destin. Le destin n'est plus alors un parcours subjectif ou humain en particulier, il est vraiment le cours de l'univers en un rythme dont Heidegger rend peut-être compte dans son Anaximandre. L'arythmie est la naissance de la culture comme rupture et retrait des dieux. Ce retrait ne se laisse alors plus comprendre que comme évaporation progressive du risque. Il faut que je relise l'Anaximandre, texte absolument fascinant. Il manquait peut-être à Heidegger une vision plus anthropologique, la vision qu'il a en fait abandonné en même temps que la thèse de Sein und Zeit. Le chaos d'Anaximandre se laisse aussi beaucoup mieux apréhender, non pas comme le chaos des mathématiques modernes, mais vraiment comme la rupture elle-même. Si les mathématiques se sont appliqué à lier les éléments chaotiques en plénitude calculable, c'est une simple manière de prendre en compte la nécessité de la compacité originelle.
Le Paradis perdu se trouve ainsi être en réalité un Enfer perdu si on traduit le destin des hommes du paléolithique en termes actuels. Et pourquoi donc alors la tendance générale est-elle au retour de la précarité originelle ? Car compacité = précarité de l'existence. On ne peut pas tout avoir : et la densité sabbatique du vécu et l'absence de risques. Le nazisme a sans doute voulu créer une dimension sabbatique du destin, il avait quelques décennies d'avance sur le libéralisme dit sauvage. Les raisons qui l'on conduit à vouloir faire disparaître les Juifs sont les mêmes que celles qui contraignent un assassin à faire disparaître les traces et surtout les mobiles de son forfait. Ces mobiles étaient la réfutation radicale de toute la culture occidentale, au coeur de laquelle les Juifs avaient joué un rôle central. Le peuple juif constituaient la preuve accablante de la pérennité de cette culture dans laquelle, d'ailleurs, les nazis étaient pris par un véritable double-bind. Ecouter la 9ème de Beethoven à Berlin pendant que les canons russes pilonnaient la banlieue, c'était le déni absolu de leur projet. Hitler lui-même avait déjà tout faux lorsqu'il exaltait le Rienzi de Wagner. La contradiction se comprend d'elle même : le nazisme était l'erradication même de la culture et donc de toute dimension sociale du destin. Or, le nazisme était aussi un nationalisme, chose incompatible. CQFD. Si Hitler avait su s'affubler de la subjectivité de certains empereurs romains et assumer un rôle purement subjectif, sans faire appel à des motifs völkisch, les choses aurait peut-être tourné autrement. Vers la fin, sans doute, il a été contraint à cette position, mais il était depuis longtemps trop tard. Ou bien, autre explication, la subjectivité romaine n'est depuis longtemps plus tenable. Le nazisme n'aura été qu'une lointaine resucée de ce qui passe pour le déclin romain et qui n'est en fait que le coup d'état ontique du Christianisme. On peut aussi considérer le "déclin" romain comme un contre-coup de la révolution néolithique, une tentative de désintégration symbolique de l'oeuvre des premiers romains. Ces derniers ont joué une partition très fine : ils ont procédé à l'installation de la culture par une praxis hautement compacte. On ne peut saisir l'épanouissement de Rome sans les guerres Puniques et sans les guerres civiles. Etant entendu que la formation primitive elle-même de Rome n'est qu'une vaste guerre civile entre tribus italiennes. Montesquieu a une intuition géniale lorsqu'il saisit la dimension formatrice des guerres civiles romaines. Il comprend que la force des Romains provient de leur abandon à l'aléatoire d'une remise en question continuelle du pouvoir. Ce qui en dit, par parenthèse, long sur la génétique de la démocratie républicaine. Et de fait, ce sont les guerres civiles qui aboutissent en un premier temps à la consécration augustinienne, à l'Empire par excellence, et ensuite à cette période dite obscure du déclin et que nous considérons au contraire comme une ère de préparation, de formation et d'essort de l'Empire chrétien. Charles Quint est l'Auguste des Chrétiens, Hitler, leur Dioclétien. Roosevelt leur Constantin.
On pourrait en dire autant des Musulmans. L'Islam fleurit tant qu'il existe des factions rivales. Dès que la sublîme Porte esquisse un semblant d'unification, aidé en cela par la politique des Chrétiens, la véritable puissance de l'Islam s'effondre. Aujourd'hui ça va mieux. L'apparition de nouvelles rivalités entre Chiites et Sunites, entre nations d'obédiences relatives aux anciens clivages, redonne un dynamisme dangereux à la civilisation musulmanne. C'est à méditer pour les occidentaux trop enclins à réfléchir à l'envers selon l'adage romain (césaréen faudrait-il préciser), diviser pour régner. Plus un ensemble est divisé, plus il contient d'énergie rassemblante. C'est la conclusion qu'on peut tirer et qui recoupe admirablement notre fiction sur le paléolithique et le chaos primitif.
Empedocle avait pressenti, ou simplement bien discerné de son temps, ces alternances entre éclatement et fusion. Beaucoup d'historiens glosent aujourd'hui sur cette respiration historique sans comprendre pourquoi le primitif se confond avec l'éclatement, pourquoi par exemple aujourd'hui, le libéralisme sauvage va de pair avec la destruction de l'état, l'anéantissement des frontières et le mépris pour les acquis de sécurité de l'être humain. Le philogénétique n'a pas dit son dernier mot. Une chose s'acquiert ainsi, la certitude que la mémoire humaine n'a rien laissé en chemin depuis le commencement de son aventure.
Enfin disons-le : la question aujourd'hui est de savoir si l'homme peut ou non faire état d'un véritable acquis ontologique qui va dans le sens de sa sécurité et pourquoi il aurait réussi une telle opération ? Corollairement on peut se demander si le risque n'est pas la dimension fondamentale de la compacité ontologique. Si le symbiotique n'a pas comme prix incontournable la perte de contrôle de la survie elle-même. La symbiose bouddhiste, au fond, ne dit rien d'autre si on admet que le Satori n'est qu'une étape de la mort ou sa préfiguration. Une première esquisse de réponse serait précisément la culture : l'homme a payé sa survie de la culture, une pratique qui implique toutes les inégalités imaginables puisqu'elle creuse elle-même l'hétérogénéité du destin. La nostalgie du chaos se révèle bien comme la nostalgie de l'égalité qui règne en enfer.
Samedi 28 décembre 1996
Ce matin je dois tenter de rendre compte de ce concept de compacité. Je pourrais donner à ces pages le titre de "la compacité de l'être", mais ce serait bien trop prétentieux.
C'est quoi, la compacité ?
Dans le désordre : est compact ce qui ne laisse aucun interstice, aucune faille, aucun vide en son propre intérieur. L'être est forcément compact : si je me contente de percevoir le monde, l'être est là, dans une plénitude absolue. Je ne peux jamais dire : tiens, là il y a un vide. Le présent est partout présent avec la même force, la même présence. L'être, c'est la présence, et rien d'autre. Je dis, cela est, tout ça est, le "est" ne se laisse nulle part partager, découper, charcuter comme les phrases, les mots et, peut-être, les idées. Je ne peux même pas dire en regardant le monde : tiens, cela a été ; ou bien encore, tiens, cela va être. Non à chaque fois, tout est à la fois dans une totalité présentielle (aï! voilà les néologismes).
Que faut-il dire de plus ? Ceci, la réalité a, pour ma conscience une compacité qui semble être devenu un critère éthique ou même politique. Lorsque les économistes invoquent les lois de la production, de la consommation, de la circulation de la monnaie et tout ça, que font-ils, sinon illustrer la compacité d'une représentation de la réalité. Ils disent : impossible de tordre les réalités (de la présence), impossible de séparer artificiellement les causes des effets. Impossible de ménager des espaces d'illogisme ou de non-conséquence : la réalité possède une compacité qui ne trouve d'équivalent que dans le diamant le plus pur. Bien sûr, cette compacité et les lois qui la régissent ne sont pas forcément celles qu'imagine tout ce savant monde de rêveurs patentés. Tout pourrait être totalement différent, parfaitement et complètement incompris de tous, vécu et pensé selon des approximations tout à fait ridicules. Ce qu'on a compris vaguement, c'est qu'il y a une cohérence dans le monde, il n'est cependant pas sûr que cette cohérence soit celle d'un faisceau de lois. Pour l'instant on ne peut certifier qu'une seule chose, c'est la compacité ou le caractère unaire (c'est mieux que unique) du monde qui m'entoure.
La non-compacité est donc une idée étrange puisqu'elle ne
peut pas éxister ! Elle est, en effet, une idée. Dans l'idée il semble (il semble..) qu'il existe la possibilité d'une autre constitution du monde. On peut toujours imaginer le contraire de la compacité. Comment cela se passe-t-il ? Par exemple, lorsqu'on construit un objet, on peut craindre que les jointures soient faibles, que les liaisons mécaniques ne soient pas solides. L'objet aura perdu en compacité. Lorsqu'on fait de la littérature, on peut craindre de "délayer", on fait "long", on tire à la ligne, on dissout le Kernmaterial. Lorsqu'un scénario est mal construit, on s'y perd, on languit et la fin ressemble toujours à un cheveu sur la soupe. L'or, et les métaux rares en général, se jugent sur leur "teneur" : 14 carat, 18 carat, 22 carat etc... La compacité porte un vieux nom qui s'est directement transporté dans la morale : c'est la pureté. En ce moment j'écoute le Scherzo de Chopin, mélodie absolument pure, sans reste, directement bue par l'âme, dispensatrice de bonheur brut, compact. Dans les productions artistiques on a imaginé tout un vocabulaire pour indiquer les degrés de cette compacité ; cela va du talent jusqu'au génie, de la beauté simple jusqu'au sublime. A sa manière, l'art imite en effet la nature, si on entend par nature la simple réalité du présentement présent, sans dérapage vers les transitions (les jointements ou jointoiements dirait Heidegger) vers le non-être passé ou le non-être à venir. La décomposition de l'étant en tant que présence ne peut pas se faire ailleurs que dans l'ordre du temps. On peut remarquer à cet égard que le temps est l'étalon absolu de la qualité au sens de pureté. Que l'on prenne l'objet ordinaire, l'oeuvre d'art ou le métal précieux, plus ils sons purs, plus ils "résistent" au temps. La résistance remarquable des monuments de l'Antiquité est dûe à la compacité des matières qui les constituent. Des milliers de villes très célèbres de Mésopotamie ont disparu ou sont devenus de simples villages parce qu'elles avaient été construites avec une matière alors d'avant-garde : la brique légère et friable. De l'Antiquité ne subsiste que quelques matières elles-mêmes compactes, le marbre, l'or et le bronze. Les terres cuites, talents des hommes du néolithique déjà, illustre bien le "compactage" d'une matière par le feu. Rôle et position du feu par rapport à notre sujet, jusqu'au mythe de l'Enfer brûlant qui doit rendre à la compacité ceux qui ont enfreint sa loi. Le châtiement en tant que tel est le prix du "manquement", vide d'une chaîne, hiatus dans un continuum dont la rupture simple est le péché.
Or dans tous ces raisonnements, il y a une contradiction fondamentale. La compacité est la réalité. On peut toujours imaginer autre chose, mais le temps s'écoule dans la camisole de force de la compacité : ce qui est "manqué", ce qui est "faible", fragile, mal fagotté, non-conforme, bâclé, ce qui est "vide", branlant, sans consistance, ce qui ne "fait pas l'affaire", ce qui est raté, les échecs, les "chutes", etc... tout est toujours déjà enfermé dans la compacité. Ce que Hegel voulait peut-être signifier dans son "toujours déjà auprès de l'absolu". Ce qui signifie très clairement que le non-compact fait partie de la compacité. Hölderlin dit quelque part que dans l'étant il n'y a rien "de monarchique". Pensée difficile mais éblouissante et qui nous sort de la signification politique du monarchique, de ce transfert sur l'homme des différences du domaine sensible. Autrement dit, la compacité ne peut pas appartenir à une téléologie, à une morale qui voudrait se fixer comme but une fantasmatique restauration de la compacité originelle. Le temps est en lui-même absolument compact et n'a nul besoin d'un décret divin pour le rester.
Mais le paradigme existe. Compacité, pureté, ces qualités essentielles appartiennent aussi bien au monde matériel qu'au monde pensé. Le platonisme pourrait être considéré comme une vaste distillation de la valeur humaine, la fixation d'un trébuchet ou le bien se pèse à l'aune de sa densité propre, le mal n'étant rien d'autre que l'absence de bien, sa légèreté ! L'idée d'un double subliminal des êtres a l'avantage de poser la fiction d'un poids spécifique absolu de chaque être en sa diversité et en même temps de faire passer la contradiciton de l'hétérogène. Dans le ciel de Platon il n'y a plus d'or ou de diamant, de fer ou de brique, il y a des métaux et des pierres d'égale valeur et d'égal destin, l'éternité.
On fait ainsi retour au temps comme ultime balance de la compacité. Le temps est ce qui offre la compacité dernière des choses en leur présence et en leur disparition. Le non-compact est d'une toute autre nature. Il résulte d'un défaut d'adaptation de l'action à l'être, d'un défaut de jeu. L'être ne peut pas être usiné comme le serait un métal vulgaire, l'être veut être l'objet d'une continuelle partition, interprétée le plus brillamment possible, selon le jeu de sa propre symphonie. L'idée qu'il existe un monde non-compact n'est que ce qui résulte de la variété infinie de l'expression de la présence,
de l'expression de la présence.
31 décembre 1996
Dernier jour, c'est un Mardi, de cette année qui fut sans pitié mais non sans récompenses pour ma patience sans limites, mon invincible immobilité morale qui s'enroule autour de mes hiérarques comme des tentacules inamovibles.
2 Janvier 1997
Triste commencement d'année. Non pas que j'attribue quelque vertu que ce soit à ces moments tant prisés par les gens, ces fêtes que les tentatives faites pour masquer leur caractère absolument païens rendent parfaitement insupportables. Ce sacré diffus est plus douloureux que quoi que ce soit au monde. Diffus comme la lumière du néon, sorte de milieu gélatineux dans lequel il faut se traîner en souffrant les flonflons parfaitement monstrueux que régurgitent les millions de gosiers destinalement satisfaits. Non pas. Mais le temps tourne aussi pour nos destins, et il paraît que les rythmes astronomiques atteignent aussi les nôtres. Ainsi, il se trouve que Miri et moi passons nos "fêtes" à régler nos comptes. Pour moi cette expression se suffit à elle-même. Elle n'a nulle besoin d'être éclaircie. Régler des comptes. Quelle tristesse. Personne n'échappe à cette trivialité, pas même le meilleur d'entre nous. Je le prendrai donc comme une grande leçon de modestie. Salopage pour salopage, cela appartient intimement à une décrépitude beaucoup plus générale, à la haine qui gît peut-être au-dessous de toute chose. J'ai une profonde envie de disparaître de cette scène, sans que je ne trouve nulle part le courage de me fabriquer la figure d'un suicidé. Il y a là-dedans beaucoup trop de prétention. La volonté, hé hé , l'homme n'a jamais inventé de concept plus bête.
Vendredi 10 décembre 1997
Beaucoup. Ca déborde. Normal, je viens d'entamer une biographie géniale de Martin Heidegger, un homme qui ne cessera jamais de m'inspirer, je pense, jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'intrigue. Un livre d'un certain Rüdiger Safransky; Allemand compétent me semble-t-il, en tout cas dans la partie histoire de la philosophie. J'halète d'impatience pour voir comment il traite finalement le grand homme. En tout cas ça commence très bien, avec une évocation très fine - et peut-être aussi très allemande - de l'enfance écolo-Sturm und Drang de Heidegger. Un seul point m'a gêné jusqu'à présent, c'est l'insupportable sentiment aristocratique des intellos allemands, qui fait dire à Safransky que Heidegger avait l'odeur du "petit peuple" face aux bourgeois de son pays de Bade. Jugement en lui-même vulgaire.
Mais tout ça m'a tout de suite donné une idée fantastique. Enfin, aussi fantastique que je peux me l'imaginer, sachant que je vais encore enfoncer des portes ouvertes depuis des siècles. L'idée est la suivante. Imaginons que la "culture" soit vraiment ce qu'en a pensé Marx, c'est à dire en somme l'habit du réel, son chatoiement intime, sa superstructure. Ces couleurs d'ailes de papillon devraient donc également transmettre quelque chose de la Stimmung de l'être, de l'humeur de la réalité.
On pourrait donc inventer une science qui serait la transcription des états d'âme de l'être et repérer ses voltes, et ses développements. Id est la mancie de l'être, l'ontomancie. Ainsi Nietzsche pourrait se lire comme le prophète des deux grandes guerres mondiales (je suis sûr que cette banalité a déjà été proférée, mais peu importe). La nature ultra-sensible de Nietzsche a certainement craqué pendant sa première expérience de la guerre en 1870, lorsqu'il soignait les blessés de Reichshoffen. Cette guerre fut, quoi qu'on en ait dit, une horrible boucherie parce qu'on était dans un entre-deux modalités tactiques, la traditionnelle et l'industrielle, le cheval et le fusil Mauser. Bref, le nihilisme savait de quoi parler, et avait des raisons d'inventer la vie ! Le plus fascinant sera Jünger : le vitaliste de la mort ! Fabuleux retournement poétique du concept, son bellicisme tant redouté aujourd'hui, n'était que l'excès de la protestation vitaliste : la vie se forçant dans la fabrication de la mort, un sport qui allait devenir national quelques décennies plus tard.
Et Heidegger dans tout ça, comme dirait Chancel ? Heidegger en fait, remue la terre de cette tragédie, le temps. Lui aussi vit, travaille, pense, aime et a peur pendant la grande guerre. A laquelle il échappe grâce à son coeur, à son...manque de coeur. Heidegger et Jünger se répondent l'un l'autre dans leurs deux oeuvres si célèbres. Sein und Zeit c'est la symphonie de la temporalité, la foudre théorique qui rentre l'homme dans sa vraie peau, le temps. Finie les ballades dans la transcendance, les promenades dans les fausses éternités. Il faut admettre jusqu'au fond de l'âme que l'au-delà de la vie n'est pas sauvable. Il faut penser - et pour Heidegger penser est le même que vivre - la déréliction comme Verfallenheit. Perdition ? déjection ? chute ? mais pas originel tout ça, présent, bien présent. Dans ses "Orages d'Acier", Jünger dit tout haut ce qui se pense tout bas chez son double badois. Il n'y a de bon temps que du temps vivant. Et quel temps est
le plus vivant ? Celui qui sème la mort et qui en échappe, celui qui joue à trompe-la-mort dans les tranchée, en assumant la folie de ce qui a préparé ça, le technique du Travailleur, le nouveau Titan, la résurrection inattendue du mythe.
Oh Heidegger ne va pas supporter très longtemps l'idée "morale" de la déréliction humaine, de son expulsion de l'au-delà du temps. Il sent bien que ça pue le chrétien, la volonté de salut et tout ça. Et puis, mais je vais attendre ce que va nous dire le biographe, Martin avait la grâce. Il fallait encore, justement, en finir avec Nietzsche, la deuxième grande guerre était le moment idéal. Après ça, le temps allait sortir de l'homme pour se condenser dans la présence.
Autre sujet d'enthousiasme, une discussion avec Kanner. L'une de mes idées favorites sur l'homme naissant serait proprement talmudique : en naissant, l'homme est tout-sachant. Dans le ventre de sa mère il sait déjà tout, il est, este, la Thora, puisque la Thora est le modèle de la création.
La discussion a commencé sur le thème : connaitre son "indice de souveraineté". L'impératif de Socrate n'aurait pas d'autre but que de découvrir une sorte de gène destinal, le niveau de souveraineté naturelle dont chacun hérite mais dont ne tire bénéfice que ceux qui font la démarche de le rechercher. En aveugle, bien entendu, car ce serait trop facile. Encore que, si on réussissait à décoder ante festum tout le contenu des thèmes de la pédagogie, de l'éducation, on y trouverait immédiatement de quoi décoder son propre pouvoir. Mais voilà, le destin oedipien c'est d'abord cette condamnation à en passer par l'ignorance, à commence par l'ignorance de son propre désir.
Je reviendrai sur tout ça, mais il me semble qu'il va falloir que je me dépêche pour tout dire. Dire toute la joie que m'a donné la vie. C'est incroyable, quand j'y pense. J'ai aussi longtemps vécu dans un état d'attente où la vraie vie est toujours celle qui doit un jour arriver, par chance, par acharnement ou par résignation. Quand je pense que je perds parfois mon temps à m'occuper de ma
retraite ! De ce temps fumeux du compromis historique entre des classes sociales fantasmagoriques aux quelles, en réalité, je n'ai jamais appartenu. J'ai fait, sans doute, partie d'un rêve social, ou d'un "plan" ou encore d'une vague projection idéologique ou même dynastique. Mais moi-même ? Qu'ai-je à voir avec la sueur des mineurs du Nord. Hier j'ai vu un de ces incroyables magazines de télévision, fort bien fait au demeurant, sur l'histoire de la mine. Des sortes de moignons d'hommes, silicosés à tant pour cent, à peine propriétaire d'un sabir si difficultueux à pratiquer que la vérité de l'échec de leur révolte sautait aux yeux et aux oreilles. En regardant ces hommes, avec tellement d'amour que je ne pouvais plus en détacher ma conscience, je pressentais tout à fait autre chose que la révolte, en fait. Plutôt une manière de s'excuser d'avoir eu le
privilège de descendre dans la mine. Jünger avait tellement raison ! De père en fils, disaient-ils tous, le travail dans le trou était une charge transmissible, un bien sacré dont on ne comprennait le sens qu'au plus près de la veine de charbon. La veine de charbon ! Quand je pense que j'ai failli être mineur, dans les mines de potasse près de Mulhouse !
Oui, ces hommes appartiendront un jour à la mythologie de héros dont on croira aussi peu qu'ils ont existé que les héros d'Homère. Déjà moi j'ai du mal à le croire malgré la vision nette et précise de ces galeries obscures, de ces gueules incrustées de carbone, de ces mains dont les calles mesuraient des centimètres d'épaisseur ravinée de douleur fulgurante. Et ces voix terribles, ces voix de la dénégation et du secret. Comme la vie est étrange. J'ai le sentiment que toute cette réalité garde le secret de son douloureux bonheur sous les dehors des mots de la révolte, des mots, pas des cris. Je pense en silence qu'il reste quelques millions de ces souffre-douleur de par le monde, et pas prêts de sortir de leurs trous.
Oui, qu'ai-je à voir avec cette souffrance-là ? Peut-être seulement que, comme ces mineurs, je ne vis pas dans l'attente fantasmatique d'un salut terrestre ou ultra-terrestre, mais que je taille la vie au plus près de sa veine, sa simple présence. Comme eux, je sors de mes mains ces morceaux de houille qui sont le soleil condensé des millénaires. Quelle joie de tirer de toute cette terre inerte et méchante toutes ces promesses de chaleur, toute cette masse gratuite au bout de mes doigts et qui devient si précieuse dans les fourneaux de l'existence !.
Samedi 11 décembre 1997
Comment transmettre, comment écrire l'exaltation qui me prend ce matin en écoutant les Scherzi de Chopin et de Schumann ? Ah les Scherzi ! D'abord comment comprendre cette vibration de bonheur qui m'envahit lorsque les notes s'enchaînent les unes aux autres. Tout mon être chante avec les instruments, je suis, comme on disait au dix-septième siècle, transporté. Il existe, dans le cours ordinaire de la vie, des obsessions passagères qui peuvent durer longtemps et rester sans satisfaction. Un corps de femme peut obscurcir les pensées et provoquer une sorte de douleur par défaut de possession ou simplement de lien. Mais ici, dans les Scherzi, il y a une sorte de source immédiate de bonheur, un lien parfaitement libre avec une lumière
corporelle, c'est pourquoi j'évoque le corps d'une femme. Il est libre après qu'on l'eût découvert, certes. Mais on me l'avait sans doute déjà donné dans mon enfance, déjà découvert pour moi. Comme la logique pour Husserl ou Heidegger, la musique est un absolu en soi, libre du temps et seulement phusique pour autant que la subjectivité peut en rester privée par un pur hasard. Regardez le monde : du Japon aux Amériques, ils ont fini par trouver les Scherzi et les ont cultivés sans barguigner. Phusique par défaut. Tout doit être ainsi, périssable parce que non atteint, non joui, non mort pour moi, non consumé par mon amour. Phusique veut dire de la nature des choses naturelles, de la Physis grecque, soumis au temps et à sa corruption inévitable et fatale. Est éternel en revanche, tout ce que mon amour arrache à la nuit de la vie, tout ce qui atteint mon axe, ce qui se place sur la ligne de mon centre, où tout ce sur quoi s'aligne mon propre centre, l'axe de mon être, mon âme. Ainsi les Scherzi sont-ils des autoroutes du coeur et de l'esprit. Ils portent à l'orgasme spirituel et restent intouchés par le temps. L'infini pourrait bien n'être que cela, le reste d'un bonheur ineffable, la trace que rien ne peut plus effacer, même l'oubli. Etre amoureux des mathématiques est sans doute le privilège absolu de l'être humain et la raison pour laquelle tant de penseurs s'y attardent tant. Vous rendez-vous compte que pour un mathématicien il suffit de contempler une équation pour éprouver cette même jouissance de la chose éternelle ?
Samedi 18 décembre 1997
Mon avocat est sauf ! Il végète depuis des mois. Je l'avais planté pour prendre la suite du vieil arbre, mort après plus de quinze ans de torture. Mes mains m'ont souvent, alors, paru comme des instruments de pur sadisme, je m'acharnais dans l'ignorance de l'être de l'arbre avocat. En y réfléchissant, merveille de l'écriture, je me rends compte qu'en fait, je ne savais pas ce que lui
voulais ! Je l'aimais comme on dit, à ma manière, comme une veuve noire qui étrangle son mâle. Il a été, il est vrai, le sujet principal de mon retour au dessin. Ma gouache préférée est une "étude d'avocat" qui me lave le regard à chaque fois, comme si la représentation que j'ai faite de cette plante m'avait apporté son pardon pour les ignobles traitements que je lui avais infligés. Mais elle est quand même bien morte, et à ce moment-là je n'en menais pas large, tant je m'étais identifié à ce végétal ! Et rien de miraculeux ou de pathologique à cela car hier encore je soulignais le caractère végétatif de nos existences.
Je suis donc soulagé. La jeune plante semblait, depuis presqu'un an, frappée par une maladie incurable. Les feuilles naissaient, très belles, et puis tout d'un coup commençaient à se recroqueviller et à noircir. Je me disais que le noyau d'avocat dont je l'ai fait germer avait été ionisé, radioactivé pour la conservation, et que la plante ne parviendrait jamais à s'en sortir. Traduisez vous-mêmes dans le cas d'une nouvelle identification ! Une renaissance radioactive ! Bref, mon avocat semble désormais hors de danger. De plus, je n'aurai pas à m'en faire pour les soins à y apporter puisqu'il est resté presque nain. Je n'aurai pas à me demander si je dois lui couper ceci ou cela, le mutiler comme l'autre, ME mutiler pour m'empêcher de prendre trop d'espace, de me heurter aux plafonds de l'existence.
C'est quand même un mystérieux et bel évènement. Je ne m'y attendais pas, m'étant plutôt résigné à le voir continuer à végéter pour mourir un jour, sans rien dire. Il est vrai que les arbres n'écrivent pas...
Peut-être dois-je ce miracle au retour, cette année, de la neige ? pourquoi pas. J'ai vécu cela avec une telle euphorie. Tellement heureux de voir revenir cet élément presque oublié de mon enfance, des rues blanches et silencieuses, quelle jubilation. L'avocat vit dans le faux balcon de mon salon, en compagnie d' un néflier un peu susceptible qui m'a également donné des inquiétudes après une germination magnifique. Maintenant il est reparti aussi, jaloux sans doute de la guérison du baveux. Décrypter tout ça.
Dimanche 19 décembre 1997
Voilà que je me retrouve d'un coup d'un seul sur une machine fantastique. Un Pentium IBM 150 Mhz (...). Fabuleux. Hier soir j'en avais mal à la tête, mais je suis presque déjà à mon aise, j'ai presque déjà reconquis tout le terrain perdu. C'est ma troisième machine et mon adaptabilité augmente avec le nombre. C'est dire combien ces machines nous imposent leur propre personnalité. Il va falloir méditer cette invasion morale des machines. Je m'en retourne faire les fastidieuses copies des quelques rares documents que je vais sauver.
Mardi 21 janvier 1997
J'ai tout sauvé grâce à Lucas. Nous avions, il est vrai, prévu le coup et acheté un câble par lequel nous avons tout versé d'un ordinateur dans l'autre. Epoustouflant
. Et un rien inquiétant.
J'ai dit «sauvé», mais je n'en pense rien. Il s'agit seulement d'une mise en stock de mots et de phrases, un corpus qui rendra compte. Rendre compte de l'existence, ce devrait être un devoir obligatoire. Question : aurons-nous à craindre une inflation de comptes-rendus ? Je ne le pense pas tant l'écriture est chose difficile.
Vendredi 24 janvier 1997
Je deviens un «surfer» du Web ! Et commence à avoir l'impression qu'il s'agit d'un passage obligé, d'un saut qu'il faut accomplir, sans raison, sans passion, volens nolens. Pour l'instant j'estime qu'il s'agit en quelque sorte d'entrer dans le système, de faire de l'entrisme, sans aucune illusion ni aucune sorte de conviction quant à ce qui en résultera. Internet permet au demeurant de réaliser l'un des idéaux de notre jeunesse : se promener, surtout se promener...Ce réseau permet aussi de regarder le monde, de se «monder» de cette manière précise. Au point, peut-être, de risquer de perdre les autres modes de la mondéité. ? Je ne sais pas, quoiqu'en réalité Internet ne serait sans doute pas la première méthode de mondanéisation qui aurait échoué. Que restera-t-il d'un éventuel échec de la connexion?
Il y a pourtant une différence fondamentale entre les anciennes connexions et celle-ci. En effet, les sociétés archaïques ( y compris la nôtre ) connectent d'office : les nouveaux venus sont intégrés sans demande. Ici il faut demander, parcourir un long cheminement pour accéder au Forum, complexe et parfois décourageant, surtout honéreux. Dans nos sociétés classiques, on joue l'intégration à certaines époques de l'existence : l'initiation, la guerre, le mariage etc...On la joue signifie qu'on fait semblant de formuler une demande qui, en fait, est préenregistrée. Le déroulement de la carrière de vie est préinscrit dans un mouvement abstrait de la tradition qui s'accomplit sans question.
Internet, c'est tout autre chose, c'est l'entrée dans une société qui s'est elle-même construite de toute pièce sur des demandes individuelles. Au fait, une société parfaitement libre en tant que société ? Peut-être. Peut-être Internet est-il une plus-value inespérée de la culture des valeurs occidentales ?
Il ne faut cependant pas s'illusionner. Il y a déjà des tensions naturelles à l'intérieur du réseau, au point que l'idée même de réseau est sans cesse remise en question. La concurrence entre les serveurs crée déjà des fragmentations incontournables, de même que le principe économique qui régit l'accès au réseau. Il existe bien une idée idéale d'Internet, mais cette idée ne peut pas se concrétiser tant que l'économie restera le moteur principal de la technologie qui le permet.
Vendredi, 31 janvier 1997
Angoisse. Depuis lundi je flotte à la maison. La récente agression de Peter m'a presque terrassé. J'ai résolu le problème comme d'habitude en prenant un congé inopiné et en accélérant les préparatifs pour mon opération de la vésicule. Disparaître le plus longtemps possible, c'est une manière de se rendre présent. Je me souviens de ma longue maladie en 89. J'étais revenu après plus d'un an d'absence et une grosse opération, j'avais enfin conquis la paix dans mon entreprise et mon salaire avait même grassement augmenté à la suite d'une grève que je n'avais même pas faite et qu'on a dû m'attribuer, tant mon image était liée aux conflits sociaux. Reste que cette situation n'est pas faite pour me plaire, car ces vacances forcées ressemblent trop à un congé de maladie. Ce qui me rend malade....
Mais l'angoisse vient aussi d'ailleurs. J'ai commencé mon troisième entretien préliminaire. Une mise au point ontologique sur la relation de la conscience avec le monde, sur la mondéisation et la conscientisation correspondante. Bref, un travail de logique arride dont je m'étonne qu'il n'ai pas déjà été fait depuis Heidegger. Ca se passe comme il y a treize ans, chaque jour un fragment de quelques lignes, qui viennent comme par magie. On verra ce que ça donnera.
Lundi, 3 février 1997
Il est six heures du matin. Le salon où je me trouve tremble déjà de l'assaut des camions qui crucifient l'avenue de la Forêt-Noire. Le monde se remet à hurler après un merveilleux dimanche. Hier, nous haïssions les dimanches pour leur silence, précisément. Aussi à cause de ce dont nous avons aujourd'hui la plus grande nostalgie : le recueil de la communauté. Mais nous détestions aussi la famille
. Voilà comment circulent les sentiments, en rond petit patapon. Cruauté des comptines. Trois p'tits tours et puis s'en vont, la plus grande leçon de philosophie de la vie de la plupart des êtres humains. Si les nourrissons adorent tellement ce petit théatre, c'est d'abord parce qu'ils savent instinctivement qu'ils sont les seuls à en saisir toute la saveur dans une mise en scène où c'est le compteur qui est condamné à partir le premier !
Mercredi, 5 février 1997
A noter en passant : évergétisme et IRM. Toutes les sociétés ont recours, d'une manière ou d'une autre à l'évergétisme. Les classes aisées prennent en charge tout ou partie des besoins de la plèbe par le biais de l'état ou à titre privé. Rome usait des deux systèmes, chaque citoyen riche avait la possibilité d'offrir des jeux ou de la nourriture aux plébéiens.
Cette redistribution n'est rien d'autre qu'un choix comme un autre de consumation -comme dirait Bataille- du surproduit social. La société romaine brûlait ses excédents pour son propre plaisir, ce qui me paraît être une grande preuve d'intelligence. La société chrétienne se situera toujours en-deçà de cette perspicacité, ainsi que les suivantes, techniciennes et scientifiques.
L'évergétisme créé la plèbe et l'entretient. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le RMI. Ce secours étatique a bien été conçu par les socialistes pour parer à la plus grand pauvreté, mais d'ores et déjà on peut y voir une possibilité de choix de vie, de choix de survie. Pourquoi pas ? Quel en serait le prix personnel à payer ? C'est là que la notion de plèbe est intéressante à évoquer, la plèbe n'accède pas à l'histoire. Le prix de la gratuité de l'existence est la vacuité ou l'inanité historique. Seuls les nobles et les chevaliers peuvent accéder au Panthéon du temps des gloires.
C'est une logique qui se tient très bien. Elle montre en tout cas que l'homme sait reconnaître les véritables enjeux de l'existence et construire sa praxis autour d'eux en toute souplesse. Ce qui est lamentable aujourd'hui, c'est que l'on ne comprend même plus ces choses. On distribue le RMI à contre-coeur en accusant la nature humaine des pires vicissitudes. Il faudrait demander aujourd'hui à un SDF, non pas s'il est trop malheureux parce qu'il a froid ou faim, mais s'il ne regrette pas de s'exclure de l'histoire de la famille humaine.
Lundi, 10 février 1997
Dimanche, étrange coïncidence
, Guy Labrosse nous rend visite en compagnie de Francine Lacoue-Labarthe : non seulement Guy est d'accord avec mon idée d'évergétisme moderne, mais il aurait pensé à la même mécanique. Comme moi il est d'ailleurs persuadé qu'on n'y coupera pas. Mais qui va avoir l'audace de lancer une pareille réforme ? Il faudra que quelque loge maçonnique prenne le problème en main pour qu'il ait une chance de parvenir au grand jour. Comme projet, ce qui n'est qu'un lointain début. Mieux que rien.
Car le temps presse. Les fous néo-nazis se remuent de plus en plus bruyamment, tant il est vrai qu'on leur fait beaucoup d'écho, fascination de la France pour son propre déclin. «Ils» viennent de conquérir une mairie de plus dans la PACA, Vitrolles. J'ai beau répéter que cela ne fait que quatre communes sur trois mille, Myriam tremble, inquiétée par les sombres prédictions de Norbert. Les Juifs ont une excuse, ils sont traumatisés, mais ils pourraient aussi essayer de comprendre que l'histoire ne se répète jamais, quoiqu'on en dise. Ils admettent d'ailleurs qu'ils sont dans une autre position qu'il y a cinquante ans grâce à l'existence d'Israël. Sans se douter que d'une certaine manière, l'état hébreu constitue peut-être pour eux un danger encore plus grand que l'ancienne diaspora.
Samedi, 22 février 1997
Je suis sorti hier de l'hôpital où j'ai laissé deux cailloux qui m'ont peut-être torturé pendant des décennies. On verra ça à l'usage, mais que ferai-je avec cette nouvelle vérité ? Admettons que je me rende compte que j'ai souffert des douleurs et des alarmes constantes depuis trente et quelques années, cela changerait-il quelque chose ? Je me souviens du sourire radieux de ma mère (vous voyez que je parle aussi de temps en temps de maman) lorsque vers les soixante ans elle se trouva soudain libérée de son problème hépatique, en réalité, comme le mien, vésiculaire. Intéressant la vésicule biliaire, en ai-je déjà parlé ? Deux mots. L'évolution est ici perceptible de manière patente : on sait aujourd'hui que l'on peut vivre (id est : survivre) sans cet organe, ou pseudo organe. Fonctionnant comme une réserve de substance (la bile), on peut aussi penser que cette fonction réserve est ou était liée à une diète particulière, riche ou peu riche en certaines substances que le corps devait pouvoir stocker en cas de pénurie. L'inutilité avérée de la vésicule prouve donc que le problème ou le danger de la pénurie n'existe plus. Du moins sous les conditions de la diète moyenne habituelle actuelle. Là gît le lièvre : imaginons un retour à des situations de pénurie ou d'anarchie alimentaire, comment se comporterait alors ce nouveau système privé de réserve ? Autre question : y-a-t-il là prise de risque calculée ou adaptation aveugle ?
Notre diète actuelle aboutit pour la plupart des hommes à la formation de calculs. Ces calculs sont-ils liés à la nature de notre diète ? On pourrait penser que la richesse en protéines animales et végétales de notre alimentation produit un excès de matières qui finissent par se solidifier dans certaines parties de notre corps et obstruer des canaux vitaux (reins ou système hépatique). Il faut donc choisir : abaisser les taux de protéines ou procéder à l'ablation des sites dangereux comme la vésicule, solution que j'ai été contraint d'adopter puisque ce site se trouvait chroniquement en inflammation. Ma conclusion provisoire est que l'opération d'ablation est une forme conjoncturelle d'adaptation, mais que les aléas de la conjoncture elle-même peuvent fort bien inverser les modes de cette adaptation. Je me souviens que dans mon enfance on procédait systématiquement à l'ablation des amygdales, à cause du danger présent à l'époque de dyphtérie. Moi-même j'ai eu cette maladie, et le vieux médecin de famille qui a dû s'opposer alors à l'ablation immédiate de mes amygdales, a toujours prétendu que ce fut mon salut. De fait, je suis encore vivant, vivante contradiction à l'usage courant.
Tout cela est barbant, n'est-ce pas ? Mais mon dieu, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Hier soir, après mon rapatriement sanitaire, nous avons eu une longue soirée avec les voisins. Sujet de discussion : l'affaire de la Loi Debré (Je trouve scandaleux qu'il suffise d'avoir réussi à se placer dans un gouvernement pour qu'on puisse avoir le droit de donner son nom à la première loi venue), et celle du Congrès du Front National fin mars à Strasbourg. J'ai été effrayé par la panique qui saisit les esprits en ce moment, une panique très suspecte car elle fonctionne exactement comme le désire le censeur Le Pen. Bref, en m'emportant contre cette attitude auto-contemptatrice ou sado-maso, je me suis rendu compte d'un danger tout à fait étrange : celui de se professionnaliser dans la «lutte pour les libertés». Rien de moins. Autrement dit de remplir un certain vide existentiel par certaines agitations dûment labellisés comme dramatiquement nécessaires. Il suffit pour cela de fantasmer le retour des horreurs de l'histoire. On ne dit plus aujourd'hui «un maghrébin tué au cours d'une rattonade», mais «nuit de cristal à x...».
Pour ma part j'ai beaucoup trop donné dans cette mobilisation permanente contre le despotisme, mais j'ai depuis toujours aperçu autour de moi les excès de cette névrose, et en particulier dans la tendance à la pratique des partis ou des associations. Je ne nie pas m'être vautré dans les délices de l'affairement historique des héros de roman, ni avoir joui des facilités humaines que donne le «combat», trop, beaucoup trop. Mais j'ai aussi trouvé bien d'autres choses dans la vie que les joies et les peines de cette lutte. Je pense que le suicide de personnes comme Primo Lévi est directement lié à cette fatalité qui finit par enfermer l'existence dans une posture ridicule. Primo est peut-être mort d'avoir été stigmatisé dans le paradigme que forme depuis longtemps le récit de son calvaire. Je ne souhaite surtout pas ressembler à ces enflûres staliniennes qui représentent un soldat ou un ouvrier se lançant à l'assaut d'on ne sait quoi, je crois que j'en mourrais plus sûrement que de quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs mon passé relativement public, me rend partout suspect : je dois aujourd'hui me défendre de passer pour un héros ! Surtout face à moi-même. No hero. At all : il n'en faut pas du tout, pas de professionnel de la morale privée ou publique. L'éducation devrait initier les enfants à une liberté telle qu'ils puissent un jour découvrir les joies intimes de leur existence, celles qui ne donnent pas lieu aux fanfares publiques et aux monuments. Le statut de l'art oscille constamment entre ces deux tendances : remplir le désir singulier et conforter le regard public. C'est la différence entre art décoratif et art pour l'art. Il est remarquable, et là se trouve peut-être le plus grand et le seul de tous nos «progrès», qu'un homme puisse aujourd'hui produire du moi et en vivre.
Hier soir en m'endormant j'ai rêvassé à la petite fleur qui s'appelle perce-neige et que j'affectionne tant depuis toujours. Enfant, elle était pour moi sans doute seulement le symbole de la victoire du printemps sur l'hiver - et si vous saviez ce qu'est un printemps alsacien ! - et puis beaucoup plus tard ma passion a changé de nature. J'avais contemplé longuement un perce-neige de tout près, c'est une merveille telle qu'on ne peut pas en imaginer de plus belle, c'est véritablement la forme naissante du réel, le sourire de bébé de l'être se retrouvant assis au milieu des vieilleries de l'hiver du monde. Mais, regardez vous-même, vous pourrez puiser dans cette contemplation des bonheurs que vous ignorez peut-être. Vous verrez comment cet être nargue la mort : blancheur éclatante, une blancheur qui vient de vaincre celle de la neige, innervée de délicats filets verts qui donnent la forme de ce qui s'érige au-dessus du froid et de la mort. Ces fleurs sourient, je vous le dis, et si un jour vous percevez ce sourire vous verrez s'ouvrir dans vos réalités quotidiennes bien d'autres portes de bonheur muet et sans reste. Pas besoin de vésicule à l'âme pour recevoir cette jouissance, mais peut-être faut-il quand même disposer dans l' âme d'un certain organe sans lequel cette contemplation ne peut pas se faire ? Je vais voir chez Descartes......
Mercredi, 26 février 1997
La vie fait lever l'homme à l'heure de son désir. La vie cesse d'être lorsqu'elle cesse de désirer. Se désirer ?
Jeudi, 5 Mars 1997
L'étant ne peut pas être. Illumination toute logique, il y a quelques jours. On ne peut pas parler d'étant : étant est un participe présent qui ne peut être utilisé que comme temps de la simultanéité. Cela signifie que si je dis : le monde est «étant», j'annule le temps, j'extrais le monde de la succession des instants qui constituent le temps du monde.
Pour décrire 'la réalité' du point de vue de l'être, je dois donc dire 'l'être', car l'infinitif ne se prononce pas quant à l'acte. Etre ne signifie ni 'je suis', ni 'j'étais', ni 'je serai'. Etre ne se prononce pas sur la réalité ontique d'une action, tout en en décrivant la seule dimension ontique qu'elle puisse posséder. Etre figure une action qui décrit le mouvement du réel, temps compris ou pas. Le petit-nègre qui dirait, par exemple, - Socrate être - est plus juste que le langage philosophique qui dit l'étant Socrate est. Car Socrate, le changeant dans le temps, ne peut pas être un étant.
Simultanéité du participe : Socrate étant blanc, Le Pen respecte Socrate.
Cette proposition ne dit rien sur l'être de Socrate, c'est à dire sur son existence ou non. Elle ne fait que lier des sujets et des qualités à l'aide de copules : Si Socrate
est blanc, alors...
L'étant ne peut pas être. L'étant est coincé par le blocage grammatical du temps que signifie le participe, alors que l'être possède la souplesse de se définir comme n'importe quel mode et quel temps de la réalité.
La religion avait réifié la notion d'être en l'attribuant à dieu. L'être au sens religieux est en fait un raccourci pour dire : Dieu est ce qui este, c'est à dire ce qui soutient de l'intérieur la réalité. Ce ne serait pas gênant philosophiquement si la notion ontologique n'avait pas en même temps disparu de la scène. Dire un 'être vivant' est une facilité de langage, une abstraction qui veut désigner en général une 'entité» vivante. L'erreur qui se produit est l'identification de l'être à l'entité ou de l'entité à l'être. C'est d'ailleurs dans cette confusion que dieu lui-même devient une entité, au lieu de rester une hypothèse ontologique pure. De cette confusion dépend l'idée d'une transcendance ! A quoi tiennent les choses les plus solennelles de la pensée ! Si Dieu n'est pas une entité, il ne peut pas être trenscendant, il est immanent.
Il faudra tirer les conséquences du sort que nous venons de faire au concept d'étant. Je remarque, en passant, que l'Anglais ne connaît pas ce concept : pour cette langue, il n'y a que le mot 'beeing' pour dire à la fois être et étant. L'infinitif 'to be' est inutilisable. Cette difficulté est plus sérieuse qu'il n'y paraît et plus lourde de conséquences. Les Allemands ont aussi deux mots : das Sein et das Seiende, comme en français.
Samedi, 22 Mars 1997
J'hésite sur l'importance à accorder à mon dernier texte. D'un côté il me paraît être une machine de guerre atomique contre tout un pan de la métaphysique, de l'autre un simple jeu de mots. Or toute la métaphysique est jeu de mots, il faut bien l'admettre. Mieux, il n'y a vraiment rien en-dehors des mots.
Réfléchissons. Le mot «réalité» doit recouvrir le mot «étant». Non pas définir, car réalité connote une opération de la pensée, la réalité est l'étant «pensé». Mais de l'étant non-pensé, cela n'existe pas non plus, ou plutôt, comme je l'ai indiqué dans mon dernier texte, il est impensable, radicalement impensable. Etant est une catégorie purement grammaticale, c'est un mot de grammaire pure, car il ne correspond à rien d'objectif. Je me répète, si l'on dit par exemple : - étant donné les circonstances - on dit une approximation. On dit : étant donné un ensemble mouvant de conditions qui entourent une autre réalité mouvante etc... Mais en aucun cas il n'est possible de signifier quelque chose comme : - vu l'encastrement immobile de l'objet dans des circonstances inamovibles et éternelles -... Aristote réservait un tel encastrement au premier moteur, immobile, qui meut le monde, mais à l'envers. Le monde n'est pas encastré, c'est son primum movens qui semble interné dans les circonstances du monde lui-même. Celles-ci forment les bords du monde, les frontières du réel, le délitement de l'essence, l'écume des réalités.
Comment un tel modèle imprègne tous les esprits ! Leste les âmes apeurées d'un centre décisif et calme. Il y a là tout un dispositif psychologique que l'on n'a jamais étudié pour ce qu'il vaut. Il est le dispositif du sens lui-même en cercles concentriques se diluant dans les périphéries, mais fermement installé, comme un logiciel, dans la réalité. Au fond, les religions monothéistes n'ont pas fait autre chose qu'anthropomorphiser cette structure. Etait-ce bien utile ? Ou cela correspondait-il en fait à un simple hommage au polythéisme ?
Dimanche, 23 Mars 1997
Et il m'avait semblé, hier soir, boucler une sorte de boucle en songeant que l'étant, en tant que concept, oeuvre exactement dans la lignée de ce monde immobile d'Aristote, moteur premier de toute chose et impossibilité logique. Sauf à reconsidérer totalement la théorie du mouvement et du repos chez Artistote, la chose la plus difficile de la philosophie.
A part cela Kanner est passé pour Pourrim, la fête d'Esther, une figure qui semble fasciner notre Juif fou. Pour cette fête, les Juifs sont, pour une fois l'an, invités à badiner et à picoler pour soutenir ce badinage. Il y va des débuts du Talmud, de l'invention du Midrash, bref, du passage du judaïsme prophétique au judaïsme du commentaire. Et tout ça à cause d'une femme qui sauve le peuple juif au prix d'une sorte de transgression. A noter que les traductions de la Bible sont aussi traîtresses que celles des philosophes grecs, il faut savoir l'hébreu, sans quoi on vous raconte tout simplement n'importe quoi. Dire que des générations d'Américains croient vivre et lire la Bible !!
Vendredi, 28 Mars 1997
Tropisme tragique : trente neuf jeunes Américains se sont suicidés en croyant arrivée la fin du monde, intoxiqués par une secte et par des produits médiatiques comme le feuilleton dit «culte» des «X Files». C'est du tout venant, direz-vous, sans doute. Sans doute y-a-t-il dans l'humanité autant de comportements irrationnels que dans l'espèce des lemmings par exemple, mais ici on doit quand même reconnaître une sorte de vide du désir, creusé par une histoire, l'histoire de tous les jours de ces trente neuf jeunes hommes. Une comète, des discours millénaristes dignes du 10 ème siècle européen, des fantasmes sur la virtualité du monde, des mondes informatisés, quelques comprimés de barbituriques et un verre de whisky et hop ! Ce n'est que ça la vie. En Amérique, on sent ce vide, comme une odeur de chlore. Quelques uns parlent pour remplir, parlent de philosophie, de Hegel et de Sartre, et leur profonde ignorance et incompréhension de leur sujet décuplent la sensation de vide. La culture, ce sang du destin humain, est vraiment un tissu qui ne souffre aucune négligence. L'avenir de l'Europe est tout entier dans cette constatation.
Le Pen arrive à Strasbourg. Il s'est monté un joli piège dans cette ville où il croyait triompher. Est-il aussi imbécile que cela pour s'appuyer sur de simples résultats électoraux ? Que croyait-il donc qui allait arriver ? Il va se ramasser là où il pensait triompher. Quelle cécité et quelle arrogance ! Deux graves défaut qui le privent de tout avenir politique français et européen.
A cette occasion nous colloquons à ARTE, sur le thème : quel traitement journalistique faut-il choisir pour le Front National ? Question totalement futile au demeurant, car Le Pen est un sujet comme les autres. Elle ne fait que mettre en lumière une fois de plus, la solitude du journaliste dans son milieu, dans son entreprise et dans les martingales politiques : car tout cet affairement ne fait révéler l'inquiétude permanente des manipulations extérieures au journalisme.
Mardi, 1er Avril 1997
Je n'arrive pas à me discipliner. En rien. Et surtout pas dans mes goûts artistiques. Brahms, Schumann, Haendel jour et nuit, et puis plus rien, je n'arrive plus à me détacher de ...Paolo Conte. Que faire ? Ne serait-ce qu'un reflet de l'ensemble ? Suis-je perdu pour une oeuvre ordonnée ?
Dimanche,6 Avril 1997
Pas pu terminer mon commentaire mardi dernier. Mais c'est important, cette absence d'ordre intime et stable, cette labilité entre des appétits totalement différents m'ennuie. Je me sens touche à tout, et sans doute suis-je cela et rien d'autre. Ange et bête, le sublîme et le trivial, au gré des jours et des humeurs. Il y a parfois comme une sensation de saturation en belles choses et en belles pensées, comme si, à un moment donné, on devenait quelqu'un d'autre.
Dimanche, 27 Avril 1997
Tentation de tout brûler, à nouveau. Ne rien laisser. Rien ni personne ne mérite tant d'attention, tant d'attention à la vie. Et pourtant je sais que la vie n'est justement rien d'autre que de l'attention. Un peu comme ce que dit Maine de Biran : la volonté de vivre s'exprime d'elle-même puisque la vie n'est rien d'autre que cette volonté. Et il n'y a rien d'automatique dans tout cela, ce qui signifie une profonde complicité : voilà ce qui ridiculise définitivement les Schopenhauer et autre Cioran. Leurs propres critiques sont des volontés de vivre ! Voilà ce qu'ils n'ont pas compris, faute de quoi ils se seraient tûs.
En ce moment je souffre le martyr. Le corps proteste, me châtie littéralement. Pourquoi ? Que lui ai-je fait ? La douleur envahit progressivement toutes les parties de mon anatomie. Que puis-je faire ? Désirer la mort ? Bah ! Tout cela aura bien une fin.
Au hasard des conversations : il n'y a pas d'humain ni d'humanité sans oeuvre ou projet commun passant par un langage. Il n'y a pas d'humanité sollipsistique. Le libéralisme n'a donc pas de sens car il détruit la dimension collective de l'action. Il a le sens du mal.
Jeudi, le 8 Mai 1997
Que cherche-t-on dans la vie ? Cherche-t-on le plaisir ou le contentement de soi ? Le contentement de soi est aussi un plaisir, certes, mais un plaisir beaucoup plus subtil et d'une toute autre qualité. Là où le plaisir des sens nous vide de force et donc d'avenir, la satisfaction d'être soi fait le contraire : elle dynamise et propulse dans une nouvelle action prometteuse. De plus, elle a la vertu de faire place nette pour le plaisir lui-même. On jouit beaucoup plus lorsqu'on a le sentiment d'y ajouter la vertu que lorsque le plaisir s'aquiert au prix de la culpabilité.
Schéma classique. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans ?
Primo : le principe de la recherche. En fait il serait très difficile de prouver que l'on (l'homme dans sa généralité) cherche quoi que ce soit. En réalité, j'ai plutôt l'impression que l'on se balade à l'aveuglette entre le plaisir capté ici et là et, de temps en temps, le sentiment qu'on est dans le vrai et dans le bien, et qu'à ce titre on peut se regarder dans son propre miroir sans rougir. Que l'un ou l'autre événement produise des effets différents n'est pas douteux, encore qu'un grand plaisir des sens peut aussi libérer de l'énergie...à condition qu'il trouve sa place dans un contexte vertueux. C'est ainsi, sans doute, que l'hédonisme des Anciens peut revendiquer le titre de vertu, au sens où le désespoir qu'il implique trouve sa conséquence dans leur volonté. Leur hédonisme est un abandon à la fatalité du chaos sans recherche particulière, ce qui a fait que la plupart de ceux dont on a dit qu'ils ne cherchaient que le plaisir, ont été parmi les hommes les plus vertueux.
Deuxio, précisément, l'idée culpabilisante du plaisir qui «vide», alors qu'on ne peut rien dire du tout quant à sa place dans les dynamiques énergisantes de la vie..Le plaisir est athée, dans tous les sens de ce mot. On peut même dire de lui qu'il est une sorte de contentement immédiat de soi, et donc la même chose que ce à quoi je me suis permis de le comparer.
Cette réflexion me vient de mon rapport aux échecs. Je joue pratiquement tous les jours avec ma machine, devenue très puissante ces derniers temps. Je me fais donc battre tous les jours, cultivant ainsi un très grand mécontentement de moi-même ! Parfois je me demande où je trouve l'énergie pour recommencer chaque fois, sachant que je vais perdre de toute façon. Même quand il m'arrive de gagner, je considère qu'il s'agit d'un accident de la machine. Mais l'essentiel est qu'il me paraît que jouer aux échecs c'est avant tout concentrer des forces intellectuelles, de telle manière qu'on devrait au moins toujours parvenir à un match nul. Or, je n'y arrive pas. Faiblesse qui entretient ma culpabilité, car j'y vois un défaut principal de ma personne, une carence profonde, quelque chose comme une lâcheté devant le défi d'une bataille. Elle me conforte par ailleurs dans l'opinion que toute ma vie est fondée sur une telle lâcheté. Chaque fois qu'il s'est agi de me battre, j'ai toujours choisi la fuite en arrière ou la fuite en avant. Rarement j'ai eu le sentiment de progresser dans la conquête de ce qui se présentait comme étant à conquérir. Sauf le savoir, et encore, certaines formes de savoir. Ainsi avec les hommes et les agressions de l'extérieur. En général, je n'ai aucune compréhension pour la tyrannie sous toutes ses formes. Je prends donc la fuite dès qu'un autre homme m'attaque, par pur mépris. Lorsque je ne peux pas fuir, je me sacrifie, je choisis le comportement qui doit m'anéantir à coup sûr, ce qui marche bien en général, tant il est rare qu'un agresseur aille au bout de sa propre démarche.
Mais ce n'est pas par calcul. Ma tactique est parfaitement spontanée, elle contraint les autres à la paralysie ou au passage à l'acte. Cela reflète parfaitement mon impuissance aux échecs, car sur le terrain on ne peut rien faire sans agressivité, sans esprit de conquête. Je manque totalement d'un tel esprit et ce manque me fait souffrir, il m'empêche d'être totalement satisfait de ma personne. Car, je dois bien le dire, à part ça, je me sens plutôt bien dans ma peau. S'agirait-il des restes d'un vieil instinct animal, quelque chose comme un sentiment de devoir croître ou mourir, tuer ou être tué ? Ou bien s'agit-il d'une rupture entre le monde réel et le monde spirituel ? C'est à dire une sorte d'infirmité qui découple mon destin réel d'un destin abstrait, idéal ou idéel ? Je n'en sais rien, tout ce que je sais c'est que je n'arrive pas à saisir le principe de la jouissance qui découle du combat. Je ne comprends rien à l'agon des Grecs. Depuis ma plus tendre enfance j'ai toujours refusé cette forme de tête à tête. Larmes, rage et sans doute toute ma radicalité n'ont jamais eu d'autre origine que le mépris pour la lutte et ses racines obscures.
Car je dois bien avouer que lorsque la lutte se trouve intellectuellement justifiée (pour moi), je n'hésite pas un instant, je n'ai jamais hésité.
Dimanche, 11 Mai 1997
Législatives anticipées, - 14 jours. Seulement quatorze jours pour de tels enjeux ! Toute la manipulation de Chirac repose et s'expose dans cette constatation. Autrement dit, les enjeux sont si énormes qu'ils auraient réellement fait fuir tous les électeurs d'ici Mars 98. Aussi fallait-il abréger le plus possible cette période où le peuple avait encore une chance de découvrir
le pot au roses. Il est donc assez dramatique de constater que les socialistes ne disent rien clairement, n'osent pas décrire ce à quoi s'apprête la droite.
Quoi, au fait ? D'un côté on peut dire simplement : répondre aux critères de Maastricht, c'est à dire passer sous les fourches caudines du libéralisme mondial, car cette comédie a bien été inventée, non pas à Bruxelles, Bonn, ou Paris, mais bel et bien à Washington. Dans les salons feutrés du FMI, la banque centrale occulte du monde entier, là où se trame le destin des peuples. Entre autres, celui des Français. Mais d'abord, celui des Européens, ce continent qui n'a pas voulu se plier à l'hégémonie américaine, qui ne le veut toujours pas et qui prétend même s'ériger en grande puissance. Il suffit de se rappeler que les critères de convergence sont en réalité les critères de bonne gestion du FMI. Rien d'européen là-dedans, sinon la nationalité de son président.
On peut aussi résumer le traquenard de la droite par les bonnes paroles de monsieur Balladur à France3 : «fournir plus de travail (sous-entendu : aux Français)». A ne pas confondre avec une quelconque fourniture d'emplois, ou de sécurité, ou de bien-être, ou d'avenir pour nous et pour nos enfants. Non, «plus de travail» c'est suffisamment clair et cela rejoint parfaitement les soucis monétaires et financiers du FMI, sis à une encablure de la Banque Fédérale américaine.
Les enjeux sont donc énormes. Il s'agit simplement de détruire les systèmes de solidarité sociale avec leur pendant institutionnel, l'arbitrage de l'état. Non pas que l'on aille vers une faillite, car tel est loin d'être le cas - la France a l'une des plus petites dettes publiques du monde - mais uniquement parce que l'on veut changer le destin de notre pays, bouleverser notre manière de vivre, on veut faire une véritable révolution. Je dis ceci à tous ces Tartufe de la nouvelle morale économique : vous n'avez pas voulu de notre révolution, nous ne voulons pas de la vôtre. Et, de fait, la France se situe encore exactement à équidistance des deux pôles, celui du libéralisme sauvage - car il est sauvage là où la criminalité fait cinquante fois plus de morts par an qu'en Europe - et celui d'un dirigisme néocommuniste ou néofascite, car on oublie trop fréquemment les économies dictatoriales des zones asiatiques ou latino-américaines. Les enfants de l'Indonésien Suharto possèdent près de la moitié de l'économie de leur pays. L'enjeu des législatives c'est donc ceci : détruire la substance de la République, éoconomiquement et politiquement. Un coup de poker qui vaut cher.
Samedi, le 17 Mai 1997
Etrange ambiance. Le pays semble se taire. Encore une semaine d'incertitudes sur l'avenir politique. Mais s'agit-il vraiment d'une incertitude ? Il semble plutôt que se confirme ce que j'avais écrit plus haut, à savoir que le capital ne peut plus attendre, c'est une question de minutes. La bourse de Paris se joue, elle, une comédie de l'optimisme, histoire de donner le change aux marchés. Mais ça ne passe plus. La France est très exactement en train de revenir à la place où elle était en 1789, c'est à dire à un isolement idéologique et pratique. Situation éminemment dangereuse dans une conjoncture de resserrement de ses liens objectifs avec les autres pays européens.
En réalité il y a deux sortes de partenaires dans cette conjoncture. Les premiers sont les Européens eux-mêmes qui observent la France plutôt pour savoir comment se comporter eux-mêmes, car ils sont dans des situations tout à fait comparables. Et puis il y a les autres, les «marchés» anglo-saxons, qui ont besoin de voir leur programme achevé dans les plus brefs délais et surtout en France : le pays exemplaire !! depuis...1789! Nous y voilà. Le nouveau capitalisme mondial attend que la France accepte la redéfinition du nouveau prolétariat mondial. Le capitalisme ne fait plus de distinction entre pays développés et pays «en voie de développement» car il s'en fout, maintenant que le communisme n'exige plus rien en fait de performance, de progrès etc...
Mais plus brûlant encore est le délai imparti à toutes les opérations programmées : la saisie de l'épargne des salariés sous toutes les nouvelles formes, fonds de pension, privatisation des services publics et privatisation de la santé. Wall Street a besoin de cet argent, et besoin de la garantie de la stabilité pour en user sans vergogne. Il faut donc faire vite : voilà le vrai secret de la Dissolution. Avec les risques que cela comporte, mais les marchés s'en foutent parce qu'ils ont d'énormes moyens de rétorsion au cas où l'électorat ne se montrerait pas discipliné. Et c'est ce que craignent les socialistes qui enfournent (dans leurs têtes) les schèmes libéraux comme ils peuvent. Ca promet...Il ne reste qu'à espérer une alliance européenne qui puisse résister. L'Europe dispose d'une arme absolue : elle est la seule zone solvable au monde en dehors de l'Amérique. Sauf à tuer la poule aux oeufs d'or, les marchés ne peuvent que ronger leur frein. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que les marchés, c'est aussi ...nous !
Lundi, le 19 Mai 1997
Rien n'est simple. Moins que tout l'école et son principe. En 1979 j'avais pondu un mémoire sur la «démocratisation de l'enseignement». En bon républicain, ma thèse était claire : l'école éteignait la loi du sang. Elle introduisait une sorte de droit du sol dans l'être-citoyen, sol de culture sur lequel et à partir duquel n'importe qui pouvait prétendre à participer à la souveraineté. L'état devait garantir la possibilité de la conquête de ce droit du sol intellectuel.
J'avais analysé les choses un peu trop rondement, substituant l'école tout simplement à l'éducation de l'aristocratie, et sans réfléchir trop longuement au fait que l'état se retrouvait ainsi devant l'obligation de
codifier cette éducation. Or, le code républicain n'est pas univoque dans la propre histoire des républiques. Il n'y a pas de République idéale, dont le modèle serait répétable à l'infini. Il n'existe qu'un principe dégagé par les grandes analyses de Platon, Aristote, Montesquieu, Grotius ou Rousseau, celui de la démocratie opposé à la monarchie, à l'oligarchie ou au despotisme.
Ce principe de démocratie comporte lui-même en lui-même, non pas une recette absolue de la pratique politique démocratique, mais seulement une indication vague sur la nature populaire de la souveraineté. On se retrouve ainsi, aujourd'hui, devant plusieurs possibilités ou modèles d'exercice de cette démocratie : la démocratie représentative, dont l'usage désormais séculaire dans nos nations occidentales aboutit pratiquement à des gouvernements oligarchiques. La démocratie directe, en gros le modèle athénien, ne passe pas la rampe de l'histoire, comme si la République était impuissante à se débarrasser de ses îlotes
.
Il faut donc s'y reprendre à deux fois avant de consacrer le principe de l'éducation sans aller y voir de plus près. Pour aller vite, il faut bien reconnaître que seul le principe critique et démocratique lui-même peut servir de contenu à l'éducation. Il est impossible de penser un citoyen formé par des savoirs, et c'est là le plus important, il faut concevoir le citoyen comme nature ou comme naturel. L'éducation ne doit pas servir à former une compétence vitale ou scientifique, elle doit garantir la transmission du secret de la démocratie, c'est à dire la volonté de ne pas déléguer la souveraineté.
La naissance laisse ouvert le champ des virtualités pour le sujet. L'éducation ne doit pas prétendre à autre chose qu'à lui représenter le caractère absolu de son pouvoir de citoyen, le débarrasser des tendances tout aussi naturelles de s'en remettre à d'autres formes d'existence sociale. Les conditions de naissance, la famille et toutes les formes que peuvent revêtir les relations sociales immédiates, toutes ces données sont polysémiques et peuvent justifier à priori toutes les formes de souveraineté. Père-monarque, fratrie-démocratique, bourgeoisie etc... La démocratie est donc une affaire d'étude, et ce ne sont pas les études qui sont affaire de démocratie.
Celles-ci, les études, ont subi une dérive totale : elles sont devenues une méthode de réussite sociale, acquisition hasardeuse de compétences et de savoirs et savoirs-faire qui doivent déboucher sur un être social professionnel. Contresens total car les possibilités infinies de discrimination dans les possibilités d'études contreviennent au principe fondamental d'égalité. L'expression «égalité des chances» est une abomination, car elle implique secrètement qu'à celui qui utilise sa chance, tout est permis. Les contempteurs de l'égalité s'enferment dans une contradiction absolue en décrétant vouloir s'en tenir à l'égalité des chances, car une telle égalité est bien plus impossible que toutes les autres formes de l'égalité. En tout cas de l'égalité républicaine, c'est à dire de l'égalité de la quantité de pouvoir démocratique, l'égalité de la participation de chaque citoyen au souverain. La démocratie a justement pour fonction essentielle de créer un corps de justice destiné à élaborer des réponses justes aux contradictions qu'impliquent les différences et l'inégalité naturelle.
Car l'homme naît et meurt inégal dans tous les autres domaines de la vie. C'est pourquoi l'école ne peut pas et ne doit pas prétendre à fonder l'existence économique du citoyen, ni surtout à former des récipiendaires d'emploi. L'école au service de l'industrie est la forme moderne du nazisme.
Samedi, 24 Mai 1997
Terrible soupçon, mais comment l'exprimer ? Que ma pensée, en-elle-même déjà finie, c'est à dire achevée, ne soit qu'une sorte de réponse pétrifiée, un gadget de ce qui me pense, avec ou dans une stratégie dont j'ignore tout.
Mais je ne me suis pas mis a écrire aujourd'hui pour dire seulement cela. C'est en lisant une citation de Kojève dans le Safransky que j'interviens. Il dit : «sans l'homme, l'être serait muet». L'homme est le «berger de l'être» comme dit Heidegger. Mais, cela est-il aussi vrai qu'ils le disent ? Pas sûr. Pas sûr car tout ce que l'homme peut dire, c'est qu'il est l'étant de cette manière-là, c'est à dire avec la prétention d'être la bouche de l'être. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il ne s'agit pas simplement de ce que l'être lui donne, à lui, en partage, comme il donne d'autres certitudes au reste de l'étant ? Il y a dans la remarque de Kojève tout l'anthropocentrisme qui ailleurs est critiqué. Mais pour Kojève comme pour Sartre, il est évident que ce qui prime c'est le choix de s'engager dans telle ou telle expérience de l'être, et non pas la vérité scrupuleuse des énoncés. Or, cette vérité, à mon sens, ne se mégotte pas plus que le choix qui la contourne.
Je n'oublie pas que l'étant n'existe pas en tant que tel. L'analyse du temps que fait St Augustin s'y oppose définitivement
Samedi, le 31 Mai 1997
Le rire est un moment de complicité ontico-ontologique.
Demain le deuxième tour des élections législatives. Quid ? Situation tragique : si la droite gagne ce sera le hard-course vers le néolibéralisme. Si la gauche gagne, ce qui est probable, ce sera le hard-course vers la guerre civile. Mais sans doute faut-il que le paysage politique se modifie radicalement. La vie en tant que telle doit se radicaliser, les risques du Dasein se préciser, et tout cela se joue dans le politique. Fini de rire.
Physis et Technè : un rapport inattendu m'est révélé par la lecture du livre de Vidal-Naquet sur l'économie antique. La Physis est le propre de la terre. Or, le citoyen grec doit sa souveraineté ou son statut d'homme libre à la possession de terre cultivable. Il y a donc un rapport entre la liberté et la physis au sens de croissance naturelle : l'annoblissement du statut humain a donc quelque chose à voir avec le miracle de l'agriculture. Cela signifie-t-il que les Grecs étaient encore très près de la révolution néolithique, et que la tradition de la découverte de ce mystère continuait de donner aux agriculteurs (comme à Rome à la même époque) la prééminence sur les autres catégories de personnes, les esclaves, les Hilotes ou encore les artisans. Artisanat = Technè = non-citoyenneté à Athènes = déclassement. Phidias était un artisan !
Donc, physis et technè sont au centre de la méditation philosophique des Grecs. Heidegger a longuement développé l'aventure de la technè qui aboutit à la technique telle que nous la connaissons, mais il a, semble-t-il, négligé la physis au sens de ce qui est radicalement différent de cette technè. Il a bien compris que la technè allait prendre la relève de la physis (tout en intégrant, bien sûr, les deux concepts par le biais de la métaphysique), mais s'agit-il vraiment d'une relève ?
Il faut retenir que cette situation allait de soi pour les Grecs. Xenophon avait conseillé d'autoriser les métèques à posséder du terrain dans les villes. Mais pas à acheter de la terre cultivable, privilège des citoyens à part entière. Il y a là beaucoup plus qu'une simple précaution stratégique ou sociologique envers les étrangers. Il y a peut-être le sentiment profondément ancré d'une noblesse de la possession de terre cultivable contrairement à la terre stérile des villes. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les Spartiates n'ont jamais créé de véritable polis au sens des Athéniens. Ils préféraient conserver partout un caractère sacré à la terre. La conséquence en fut un tout autre stratification sociale et un rôle tout à fait différent des Hilotes, Hilotes qu'on ne peut pas comparer immédiatement aux esclaves d'Athènes.
Que signifie tout cela ? Pour éclairer la question on pourrait peut-être comparer cette éthique de la terre fertile à la théorie des physiocrates, selon laquelle l'agriculture était seule productrice de richesse. L'industrie et l'artisanat n'étaient que des tansformateurs de matière, mais non pas des créateurs au sens de la terre productrice et reproductrice de nouvelle richesse. Aujourd'hui le débat reste ouvert entre l'industrie comme productrice de richesse
ou comme cause d'épuisement de la terre au sens de planète. Les écologistes seraient contents de me lire....Tous ceux aussi qui considère d'un oeil critique la société de consommation. Pourrait-on dire qu'entre les Grecs et nous il y a totale inversion : d'un côté il y a une société de production de réalité, de l'autre des mangeurs de réalité ? L'industrie, ou plus généralement la technè, devenant une sorte de perversion qui bouleverse l'ordre naturel ou le dissout par une manipulation indigne, c'est à dire digne des esclaves et des métèques. En ce sens Marx aurait raison, de même que Hegel dans sa dialectique du maître et de l'esclave, le capitalisme est le résultat d'une vaste conspiration des esclaves. Question : qu'est devenu le sens primitif de la physis ? Où s'est-il réfugié ? Dans les grimoires des philosophes ? Cela expliquerait entre autre le statut de la culture dans notre société, dernier point de résistance de la valeur de création. Pas étonnant que ce mot de création soit le mot le plus valorisé à notre époque, il traduit toute la nostalgie inconsciente des sociétés humaines.
Samedi, le 7 Juin 1997
La gauche a pris le pouvoir comme une lettre à la poste. Une première dans l'histoire de la cinquième république : Chirac n'a pas voulu attendre les élections normales de 98 et a dissout la Chambre. Patatrac ! Dès le premier tour les choses étaient claires, les Français ne voulaient pas continuer avec «la droite la plus bête du monde». Aujourd'hui, les pauvres socialistes se retrouvent au pouvoir sans l'avoir vraiment souhaité. A priori les problèmes sont insolubles, tant règne la terreur des marchés. Et pourtant il semble tout à coup que ces marchés aient décidé de se taire et de reprendre une place modeste dans le cours des événements. Hier encore, tout se déterminait en fonction de la température des bourses ; le ton a changé en vingt-quatre heures. Etrange. Il y d'autres vrais facteurs qui travaillent en silence l'histoire. Quelque chose comme le désir de rire ou celui de pleurer. On dirait que les sociétés humaines
s'inventent des situations «objectives» pour justifier leurs humeurs, exactement comme chacun de nous. Avec ça tout le discours sur la monnaie unique prend un virage à cent quatre-vingt degrés : tout le monde se persuade que l'Euro sera reporté, tout en sachant que c'est impossible. Deux logiques se superposent, l'une qui calcule froidement les causes et les conséquences, l'autre qui saute avec un bandeau sur les yeux. Il n'est pas sûr que tout cela se termine mal, au contraire. Quand les hommes montrent de l'audace ils se libèrent de leur déterminisme.
Je viens de relire mon texte de samedi dernier. J'aurais pu ajouter cette curieuse remarque, qu'à travers ces derniers siècles, c'est la terre et son travail qui ont perdu leur noblesse. Et aussi cette question : comment le travail paysan, l'exploitation du sol, sont-ils compatibles avec le haut degré de culture des Grecs ? Alors que de nos jours, l'exploitation agricole suscite le mépris que l'on sait. La puissance des agriculteurs ne provient plus que d'une crainte mythique de la dépendance alimentaire, mais tout le monde sait que cette dépendance est totalement réciproque et qu'il n'existe aucun risque de «trahison».
Vendredi, 13 Juin 1997
Julot, le poisson rouge de ma fille. La vie est un lieu de reconnaissance de l'être peut-être plus dense que les autres végétaux ou minéraux. Encore que, mes plantes... Mais je suis étonné quand même chaque fois que je vais saluer ce poisson, froid dans l'imaginaire et qui bondit chaque fois que je viens. Etrange. La solitude est le pire de tous les ingrédients bio-physiologiques de l'existence, et tout ce qui contient de la vie le souffre, le fête parfois aussi. Chacun à sa manière.
Dimanche, le 14 Juin 1997
La possibilité du mensonge est la meilleure protection de la vérité. (Tout ce qu'on peut faire avec des mots !!) Mais encore : la télévision. Il n'est pas douteux que nous ayons tous une relation de culpabilité avec ce «média» - je souris toujours lorsqu'on utilise ce concept pour un objet qui serait plutôt tout sauf une médiation - et pourtant. Cette culpabilité provient bien de quelque part, et sans doute d'une erreur de jugement, comme la plupart de nos inquiétudes morales. En effet, contrairement à l'idée reçue selon laquelle la télévision serait un vecteur d'intoxication ou de pédagogie du mensonge, je me rends lentement mais sûrement compte que c'est le contraire. Au lieu d'engager à l'adhésion des discours courants et des vérités jetées au public, il me semble que la télévision introduise, au contraire, une sorte de pellicule anti-adhésive autour des affirmations véritatives , qu'elles soient scientifiques, religieuses, philosophiques, politiques ou autres. Un programme télévisé n'est toujours qu'une couche de discours, jamais un discours clôs, fini, imposé par une relation directe entre une instance et un sujet isolé, comme c'est le cas en chaire d'église ou d'université, par exemple.
L'écran de télévision est un espace totalement aléatoire, spatialement et temporellement. Maintenant, au temps T, il est là, sur telle fréquence, et il dit ceci. Au temps T' il est sur une autre fréquence est dit autre chose, ou bien pire, il dit tellement la même chose qu'il en perd toute crédibilité immédiate. Dans l'expérience de la vie courante, il n'existe nulle part une telle superposition de discours d'un individu à l'autre. Et, même lorsqu'on constate que deux individus disent la même chose, on a cent pour cent de chance qu'ils se réfèrent tous les deux à un même discours «médiatique».
La télévision m'apparaît comme un instrument parfaitement athée, incappable de se faire le support d'une pédagogie idéologique. Big Brother est tout simplement un mythe faux, dont le danger que l'on dénonce est en réalité un danger contraire à celui qu'on formule. A savoir que la médiation hertzienne détruit toute possibilité de crédance naïve ou immédiate. La télévision détruit le divin comme oppression mentale ou spirituelle. La culpabilité ressentie par le public serait donc plutôt la culpabilité que produit (encore) la destruction de ce divin et la participation à cette destruction ! Tout téléspectateur est un régicide ou un déicide en puissance.
Telle est la force du discours déporté, extrait de son immédiateté. Même lorsqu'il est en direct, il n'est qu'un reflet iconique, et cette nature lui ôte toute force opérative. Sur l'écran de télévision, seule la description de faits, l'information, produit des effets réels, précisément parce qu'ils sont purs de tout discours.
Samedi, le 21 Juin 1997
En finir avec les mondes meilleurs. Pour cela il faut marteler la neutralité de l'être, de la réalité. Le bien et le mal sont des images. A ce titre elles fonctionnent de deux manières : pédagogiques et consolatrices, didactiques et divertissantes. Dans les deux cas il faut défalquer à chaque fois l'erreur de paralaxe introduite par les points de vue de la formation ou du divertissement. La formation est a priori déformation, le divertissement porte bien son nom par rapport à la réalité.
Le concept de morale provient de l'idée de changement issue de la volonté. Dans la série des changements aristotéliciens : mouvement, temps, génération etc...Le bien est donc une technè avec tous les doutes et toutes les difficultés liées à la relation nature-culture, encore que cette dichotomie peut être considérée elle-même comme sous-tendue par un point de vue moral.
Question donc : comment se débarrasser des mondes meilleurs ? En soustrayant de l'idée de bien l'idée d'une totalité bonne. Le bien peut rester un universel, dans la mesure où il est présent dans la totalité des choix possibles. Mais le bien lui-même ne peut pas se figer dans une totalité immobile, du genre de celui de la sphère immobile divine d'Aristote. Le bien, comme le mal, sont toujours le produit d'un choix, ils ne peuvent pas exister en tant que tel. Les religions ont joué un rôle fallacieux en offrant des images de situation ou d'univers du bien et d'univers du mal. Enfer et Paradis sont des entités existentielles fantasmatiques de ce genre qui fonctionnent comme des paradigmes de l'existence terrestre.
Une banalité qui nous renvoie quand même toujours à cette idée de lutte permanente sans résultat, sans éternité d'aucune sorte. On marche sur une route partagée par une ligne jaune : on peut rester du bon côté ou non, toujours et en toute circonstance. La morale, c'est ça, et rien d'autre.
Dimanche, le 22 Juin 1997
J'ai vu Norbert hier. Il est devenu conseiller spécial de Catherine. Ne pas confondre «conseiller technique» (au bas de l'échelle), conseiller auprès (au milieu de l'échelle) et «conseiller spécial», le sommet de la pyramide. Je ne confonds pas. Cette proximité du pouvoir m'est à double tranchant. D'un côté elle me rassure. Mes ennemis d'Arte sont pour ainsi dire paralysés pour quelques temps. De l'autre on me presse de forcer la cadence et d'en retirer un bénéfice personnel.
Impossible. J'essaie de faire comprendre à Miri le vrai problème. Je ne peux pas et ne veux pas sauter le pas, faire un bond de carrière qui ne correspondrait pas avec un bond personnel. C'est moi-même que je construis péniblement au cours de cette vie difficile, pas le monde. Le monde n'a pas besoin d'être construit, il se sécrète lui-même et la place que l'on y occupe dépend de ce que l'on est, pas de ce que l'on pourrait être. Il en irai autrement si je m'étais identifié plus concrètement avec le combat politique de mes amis. Mais ce n'est pas le cas.
Le seul problème est de savoir comment je vais continuer d'assumer l'usure du «placard» à Arte. Ma réserve de bonne conscience n'est certes pas entamée, mais pour combien de temps encore ?
_________________________________
«La croissance économique, le progrès technique, l'accroissement de l'efficacité ne sont pas des vertus «naturelles» ; ils n'ont pas toujours été possibles ni même désirés, du moins par ceux qui contrôlaient les moyens capables de les réaliser.» Voilà ce qu'écrit Moses Finley à la page 110 de son «Economie Antique» publiée chez Minuit. C'est très intéressant car cela recoupe l'une de mes préoccupations, la critique du concept de croissance. De nos jours, la croissance est devenu quelque chose de plus qu'une chose «naturelle». La croissance est devenu la règle même, le thermomètre de la santé du corps économique et social. Cela provient sans aucun doute du fait que nous sommes toujours dans ce que Marx appelait la phase d'accumulation de capital. Pour accumuler quoi que ce soit, il faut en produire un excédent, c'est à dire réaliser une croissance. Cela n'implique pas, en revanche, qu'il n'existe pas d'accumulation optimale, au-delà de laquelle il est inutil d'aller pour satisfaire au bonheur de l'humanité.
Si les Anciens n'ont pas toujours eu à l'esprit d'accumuler ( ce qu'on peut mettre en doute tant est évidente la permanence de l'hégémonisme, c'est à dire de la volonté d'agrandir constamment l'emprise politique), c'est qu'ils avaient non seulement atteint un équilibre de production-consommation, mais qu'ils avaient encore une «idée» de cet équilibre. Ils savaient ce qu'ils voulaient atteindre, et, l'ayant atteint, étaient capables de s'y tenir. A bien méditer les aventures de cette Antiquité, les choses ne sont pas si claires. J'aimerais bien que Finley me décrive au moins une période où ces équilibres étaient en place et où les idées étaient claires. Autre chose que les périodes dites de prospérité, comme on parle aujourd'hui des Trente Glorieuses.. Mais l'Histoire est un véritable bordel, où l'on ne distingue pas grand chose. Et même si l'on disposait de toute la documentation nécessaire, je suis à peu près convaincu qu'on n'en comprendrait pas davantage. Il y a dans l'Histoire deux mirages à éviter : le premier est l'idée qu'elle nous offre un fil d'Ariane mnésique pour retrouver notre place dans le temps. La seconde qu'elle peut nous fournir une logique quelconque du destin humain. Elle doit donc servir à autre chose. Mais quoi ? Aussi de...divertissement ?
Mardi, le 24 Juin 1997
Il faut que je fasse un catalogue de toutes les superstitions qui sont classées parmi les certitudes et qui mangent tant d'investissements concrets et tant de grandes intelligences. Car il y a toujours ce soupçon que ces croyances procurent des jouissances dont je n'ai aucune idée. Quelle jouissance ? On dit opium du peuple. Pas si bête, l'opium, c'est pas mal. Du peuple signifie hélas qu'il ne s'agit pas de l'opium vraie, mais d'un succédanée.
Vendredi, le 27 Juin 1997
Je ne pourrai jamais supporter l'absence totale d'humour. Le rire est la contrepartie du néant et à ce titre il est le guide suprême de l'humain. Ceux qui ne se nourrissent pas de rires sont les vrais cons. C'est tout l'avantage de Shakespeare sur Corneille ou Racine. Ces deux derniers ont hélas imprimé à nos élites un style qui ne laisse plus de place à l'humour, devenu entre-temps le délassement de la populace. Alors qu'il n'y a rien de plus dangereux que le rire.
Samedi, le 28 Juin 1997
L'humanité est en danger. L'humanité en tant que partie du bios. Je suis loin de partager l'écologisme comme théorie politique, mais les faits sont là. La surpopulation est une dynamique de stress, exactement comme un arbre menacé produit des rejets de stress en grand nombre afin de multiplier les possibilités de reproduction, et ainsi les possibilités de réussites ou de mutations. L'humanité se comporte vraiment comme un corps organique. Il s'agit d'une interprétation, je ne suis pas dupe. Mais l'explication me paraît plausible.
Il y aurait donc deux moyens d'assurer la persistance de l'espèce et sa multiplication, la médecine et la démographie qui régulent les flux vie-mort. Il y a donc deux possibilités :
- ou bien il existe sur la planète une multiplicité de champs relativement indépendants les uns des autres, où chacun de ces deux moyens agit en fonction de données historico-économiques ( en gros les démocraties riches peuvent se payer une médecine qui va de pair avec une démographie relativement équilibrée, tandis que les pays en voie de développement n'ont pas d'uatre choix que de s'en remettre à la démographie et à la surnatalité)
- ou bien il n'y a qu'un seul champ, et il faut considérer l'exception occidentale comme un fait marginal, immanquablement rattrapée ou noyée par les zones à forte natalité. Ce qui confirmerait la thèse selon laquelle l'espèce est en danger.
La conférence de New York illustre une impuissance réelle. Que peut-on opposer à l'impuissance ? Pas grand chose, sinon le totalitarisme, et c'est bien l'argument en béton des Américains. Mais si on peut éviter le totalitarisme par une attitude volontaire maintenant, cela ne veut pas dire que les conséquences réelles ne seront pas totalitaires.
Dimanche, le 29 Juin 1997
Hongkong «décolonisée» à partir de Lundi ! La France qui sort une deuxième fois de l'OTAN ! Tout cela sent la poudre.
Mais d'abord ceci : on a pratiquement cessé, au cours de ces dernières décennies, de raisonner en termes stratégiques globaux. On n'appelle plus un chat un chat depuis belle lurette, c'est à dire depuis que les idéologies ont pris le relais de la réalité, et même depuis que la ruine de l'une des plus grandes de ces idéologies ait paru donner raison à l'autre. Double paradoxe : d'un côté la période «idéologique» a vu la diplomatie stratégique battre son plein - c'était à qui grignoterai tel archipel pour y installer ses troupes en vue d'un conflit - de l'autre, à peine «terminée» l'ère des idéologies, on s'empresse de tenir un discours hypocrite et à contenu pacifiste sur les grands dossiers du moment. On se refuse par exemple à reconnaître que Pékin n'a qu'une chose en tête, c'est la récupération de Taïwan, et que la Chine est prête - ou fait tout pour l'être -à mener une véritable guerre pour y arriver.
Comme les petites guerres engendrent les grandes - il suffit de se souvenir de l'attaque japonaise de Moukden en 1931, véritable commencement de la deuxième guerre mondiale, car la conquête de la Mandchourie, avec ses atrocités, a fonctionné comme 'patern', à savoir comme mesure de ce qui était possible, malgré la SDN, malgré les grands envolées lyriques contre la barbarie ets...ce sera une petite guerre qui engendrera une grande guerre.
A cet égard on pourrait penser que la décision de Jospin de ne pas réintégrer l'OTAN n'est pas de saison. Sauf à imaginer un instant que les socialistes se sont mis à réfléchir (sur le mode Mittérrandien) à la nécessité de se démarquer militairement des Etats-Unis, et à se rapprocher du seul adversaire résolu de l'OTAN, la Russie. Retour à l'Alliance Franco-Russe? Pourquoi pas. Dans la perspective d'une Europe unie, il est logique de cultiver dès aujourd'hui des relations les plus étroites possibles avec l'ours russe. D'autant que cela est rendu possible par la dépendance économique du géant aux pieds d'argile.
Etats-Unis - Japon, Chine - Asie du Sud-Est, Europe - Russie : voici les trois grandes entités stratégiques du futur. Il faudra désormais tenir compte des équilibres qui se font et se défont dans leurs orbites.
Reste la question naïve, mais pourquoi pas intéressante : avons-nous tous, mondialement, quitté la culture de guerre pour une culture de paix ? La guerre économique a-t-elle définitivement pris la relève de la guerre tout court ? J'en doute et d'un certain point de vue cela m'inquiéterait, car cela signifierait que le capitalisme de la mondialisation est vraiment autre chose qu'un «tigre en papier». La solidarité n'est pas un ingrédient très solide dans l'économie, elle est un ciment de la détresse existentielle, de la peur physique de mourir.
Samedi, le 26 Juillet 1997
Une possibilité extraordinaire : que le technique ne soit qu'une conséquence marginale de la spiritualisation de la réalité.
Voici : l'esprit s'incarne dans la matière (vieille idée, entre autre Hegel). Cette incarnation entraîne un annoblissement de la matière qui lui confère une relation privilégiée avec le désir, lui-même encore largement matériel de l'esprit prisonnier de la matière. C'est à dire que l'esprit donne à la matière un statut qualitativement en rapport avec lui-même, c'est ce qu'on appelle le «progrès technique». Ce progrès détache l'homme, ou celui qui porte l'esprit à sa manière, de la préoccupation matérielle. Ou bien, enseigne à l'homme le détachement.
Au fond, le technique, c'est à dire la réalisation de la métaphysique grecque, est une voie parmi d'autres, empruntée par le processus de spiritualisation. Mais qu'est ce dernier ?
Car on pourrait dire, par exemple, que les animaux sont déjà détachés, au sens où ils ne semblent pas affectés par la nécessité de modifier leur environnement : ils «exécutent» l'esprit. Pensée égyptienne. Les hommes ne seraient alors que des animaux imparfaits, pensée parfaitement technicienne ou «libérale». Les technologues comme les libéraux ne cherchent qu'à accomplir la ruche humaine, le modèle fonctionnant automatiquement selon des lois de prédations fixes (et qui, de ce fait, ont besoin d'un Grand Architecte ou d'un dieu qui détermine ces lois).
Mais. Si la technique n'est qu'un enseignement, ou une recherche, elle doit elle-même mener ailleurs. Peut-être à un savoir de la réalité qui intègre des facteurs inconnus. Castaneda est sur une voie possible, ainsi que les mythes et traditions indiennes d'Amérique du Nord. Certaines sociétés «primitives» pourraient ainsi être considérées comme presque parfaitement spirituelles, hors histoire, hors progrès et hors technique. En détruisant ces civilisations on ne fait rien d'autre que fermer les portes de services qui restaient du Paradis terrestre. Perte du paradis : quel est le sens de cette perte ? Hegel dit Aufhebung, à savoir récupération à un plus haut niveau. Lequel ? La seule chose que l'on puisse dire, en accord avec Heidegger, c'est que le technique métaphysique récupératif au sens de Hegel, est une aventure, un pari dont le suivi s'appelle Histoire.
Sous-idée intéressante : Hegel avait déjà une conscience aigüe de l'énormité de ce pari, c'est à dire de cette perte. Or, rien du progrès technique déterminant tel que nous l'entendons (énergie nucléaire, electricité, communication etc...) ne peut l'avoir influencé : preuve a contrario que le technique était déjà bel et bien inscrit dans le métaphysique. Heidegger CQFD. Il n'y a pas eu pressentiment, mais claire conscience des enjeux du pré-platonisme et des autres «envois» de l'être.