|
 |
La séquence d'apprentissage |
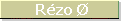 |
|
|
Remarque liminaire : alors que dans les pays
anglo-saxons elle est, dans un environnement
béhavioriste, un principe d'organisation de
l'enseignement, toutes disciplines confondues, la notion
de séquence, en France, n'est, semble-t-il, évoquée que
dans le seul contexte de l'enseignement du français, en
dehors d'ailleurs de toute référence au béhaviorisme.
Les textes officiels régissant les autres disciplines n'y
font pas allusion.
|
Organisée autour d'objectifs ( généraux ou terminaux,
intermédiaires, spécifiques... ), la séquence est un
héritage incontestable du paradigme béhavioriste. Introduite,
dans les années 1980, comme élément organisateur de la
formation dispensée dans les Lycées Professionnels ( notamment
par l'intermédiaire de M. BILLON, professeur à l'ENNA de
Paris-Nord ), la séquence s'est peu à peu imposée dans les
textes officiels de l'Éducation Nationale : toutes les
Instructions Officielles pour l'enseignement du français, du
Collège au Lycée, préconisent un enseignement organisé en
séquences. Mais, tandis qu'elle est proposée dans toute sa
vigueur béhavioriste en L.P., la notion de séquence, au lycée
et au collège, s'est singulièrement assouplie et ne subsiste,
sous le nom de séquence didactique, que comme principe
organisateur d'activités scolaires décloisonnées 1
.
Dans une perspective plus générale, une séquence
d'apprentissage est une unité de travail au cours de laquelle,
à l'occasion d'activités diverses, les élèves doivent mettre
en oeuvre des compétences assimilées, consolider des acquis
antérieurs non parfaitement stabilisés et acquérir de
nouvelles compétences. Des séances d'apprentissage, qui
jalonnent la séquence, sont élaborées en vue de favoriser
l'acquisition de ces nouvelles compétences.
La séquence est organisée autour d'un objectif terminal,
exprimé sous forme de tâche, qui spécifie la production que
les élèves auront à réaliser à l'issue de cette unité de
travail. Cet objectif terminal peut être opérationnalisé ou
non.
|
Opérationnalisation des objectifs
Un objectif est opérationnalisé à partir du moment
où l'on précise dans son intitulé en plus d'un
comportement observable et de la production attendue, les
conditions de réalisation de la tâche ( durée,
matériel à utiliser, aides autorisées... ) et les
critères d'évaluation de la production réalisée. En ce
sens, n'importe quel objectif peut être
opérationnalisé.
Ainsi
« Écrire un poème » est un objectif terminal
non opérationnalisé
« Écrire un poème en utilisant un maximum de
termes qui ne contiennent que les lettres utilisées dans
le mot « antilope ». Le poème comportera au moins trois
strophes, les vers seront, au choix, des octosyllabes,
décasyllabes ou des alexandrins. La rime n'est pas
obligatoire. L'utilisation d'un dictionnaire est
recommandée. La production sera évaluée sur le respect
de la consigne et sur la variété des termes utilisés.
La correction syntaxique du poème sera évaluée mais on
ne tiendra pas compte de l'orthographe. » est un
objectif terminal opérationnalisé. On voit bien à
quelles aberrations peut mener une volonté
d'opérationnalisation excessive.
Dans le système scolaire français, la réflexion sur
les objectifs est un héritage béhavioriste déjà
ancien. La révolution cognitive, qui a proposé une
alternative heureuse au béhaviorisme pur et dur en
vigueur jusque dans les années 1980, n'en a pas cependant
rendu obsolètes tous les apports.
Ce qu'on peut regretter, cependant, c'est la permanence
dans le discours institutionnel d'un langage béhavioriste
d'autant plus rigide qu'il est parfois peu maîtrisé par
ceux qui le tiennent. Ils n'ont retenu, en substance, de
l'approche béhavioriste de l'apprentissage que ce qui,
lorsqu'on l'y réduit, en constitue la caricature.
Même si constructivisme, cognitivisme et
béhaviorisme s'opposent radicalement, on peut
cependant retenir certains apports de ce dernier,
surtout dans le domaine de la planification de
l'enseignement. Pour une discussion de ce qui a été,
fort improprement, appelé la « pédagogie par objectifs
», voir Les
objectifs en pédagogie.
|
Les approches constructivistes et cognitivistes ont mis en
évidence les difficultés liées à l'acte d'apprendre,
notamment qu'il implique conflits, ruptures et régressions. La
séquence d'apprentissage doit donc veiller à laisser un temps
suffisant pour que les apprentissages puissent se réaliser ;
c'est pourquoi elle n'enchaîne pas les séances d'apprentissage
et ménage des plages de travail qui permettent aux élèves de
s'approprier les compétences nouvelles ou d'affermir celles qui
le nécessitent. Les activités proposées à l'occasion de ces
véritables séances d'application gagnent à être
différenciées en fonction des besoins de chacun.
Modélisation d'une séquence
d'apprentissage
Les objectifs intermédiaires de la séquence permettent la
mise en place de situations d'apprentissage. Celles-ci se
présentent comme des situations complexes à l'occasion
desquelles les élèves réalisent une tâche qui fait appel à
leurs connaissances antérieures mais qui doit également leur
faire prendre conscience des compétences à acquérir pour
résoudre le problème auquel ils sont confrontés. En ce sens,
une séance d'apprentissage, organisée autour d'un objectif
intermédiaire, est toujours une situation-problème.
|
La notion de séquence, telle qu'elle est appliquée en
ce moment dans le système scolaire français, dominé par
des objectifs de programme, implique une planification
stricte, une prédétermination forte de l'enseignement.
Elle accorde, par la force des choses, un intérêt
limité au concept d'apprentissage ( il s'agit de juger
des faits, non du discours et des énoncés d'intention ).
Dans un environnement constructiviste, elle semble donc
très peu pertinente.
En effet, dans cette perspective, l'élève devient par
lui-même constructeur de connaissances et, par
conséquent, l'enseignant ne peut plus planifier de façon
précise ses interventions puisque celles-ci doivent
suivre au plus près les activités et les démarches de
l'élève en situation de résolution de problèmes.
Si l'enseignant planifie encore, cette activité vise
essentiellement la recherche des situations et scénarios
d'apprentissage, ou encore la recherche et la mise en
oeuvre des activités authentiques ( projets d'action
culturelle, par exemple ) qui favoriseront les
apprentissages.
M. F. YOUNG, dans un article intitulé Instructional
Design for Situated Learning ( disponible ici dans sa
traduction française : Planification
pédagogique pour un apprentissage contextualisé
), a cependant jeté les bases sur lesquelles concevoir
une planification des apprentissages dans un cadre
constructiviste ( cf. également sur ce site l'apprentissage
contextualisé ).
 A lire A lire
DESSUS, P. : (2000), La
planification des séquences d'enseignement, objet de
description ou de prescription ?, Revue Française de
Pédagogie, n° 133, pp. 101 - 116. |
NOTES
1 voir notamment à
l'adresse http://www.cndp.fr/college/
dans « Textes officiels»
les textes d'accompagnement des programmes de
français retour
au texte

|