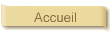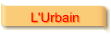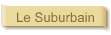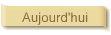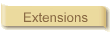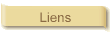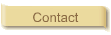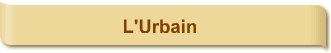
|
L'Histoire du Tramway Urbain : |
Le 5 avril 1877, est fondée la « Strassburger Pferdereisenbahngeselshafft » traduisible par la « Compagnie Strasbourgeoise de Chemin de Fer Hippomobile ». La construction des deux premières lignes, Kléber-Pont du Rhin et Kléber-Hoenheim, est donnée à une société suisse, la S.L.M. (« Shweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik ») de Winterthur, elle fournit également les premières locomotives à vapeur. Quant à elles, les voitures sont commandées à la Société Industrielle de Neuhausen (près de Schaffhouse, Suisse).
Le chantier débute Route du Rhin, le 26 mars 1878, et les locomotives peuvent être essayées dès le 1er juillet entre la station « Faubourg de Pierre » et la Rue de la Mésange. L’ouverture complète de la ligne est effectuée le 20 juillet, la voie est alors à l’écartement normal de 1,435 m. A l’intérieur du périmètre urbain, l’exploitation à la vapeur est interdite par les autorités, donc les circulations se font par la traction hippomobile, et dès la sortie des fortifications, on passe à la vapeur, c’est-à-dire au-delà de :
- la Place d’Austerlitz
- La Porte de Pierre.
Le 12 mai 1880, c’est la réception de la ligne de Koenigshoffen, tracée de la Place Kléber à Koenigshoffen, longue de 4 km. La portion en ville s’effectue en 13 minutes, et de la prise de la vapeur à son terminus, le trajet s’effectue également en 13 minutes, ce qui met ce faubourg à 26 minutes du centre de Strasbourg. Le tarif appliqué est de 30 pfennigs pour l’ensemble du parcours. Cette ligne sera prolongée en 1885, jusqu'à Wolfisheim.
Le 28 octobre 1882 débutent les travaux pour la ligne dit de la Robertsau. Le 16 février de l’année suivante, c’est la réception officielle, mais elle ne sera achevée que le 12 mars en allant jusqu'à la station « Robertsau-Eglise ». Comme pour les autres lignes, le parcours en ville se fait à cheval et au-delà du Pont Royal, la traction se fait à la vapeur.
En 1885, le tramway dessert la Gare Centrale (Strasbourg est relié à Paris par le rail en 1852 et à Kehl en 1861).
Les quartiers du Neuhof et du Neudorf sont desservis à partir du 21 novembre 1885. Le 21 avril 1886, la ligne de Strasbourg à Graffenstaden est inaugurée.
Quelques chiffres sur la fréquentation :
|
Année |
Nb de voyageurs |
Kilométrage |
|
1879 |
1 869 596 |
9,950 km |
|
1886 |
3 340 854 |
34,590 km |
|
1894 |
4 197 774 |
34,590 km |
A la fin du siècle, la voie sera mise à voie métrique (1 m d’écartement).
Grand bouleversement pour le réseau, le 14 décembre 1894, la compagnie signe avec l’ « Allegemeine Elektrizitäts Gesellshaft » (A.E.G.) de Berlin, un accord portant sur l’électrification des lignes suivantes :
- Place de la Gare-Place d’Austerlitz
- Porte de Pierre-Kléber-Orangerie.
Ainsi que sur la fourniture de 14 motrices.
Définition exacte des deux lignes :
- 1ere ligne : Gare Centrale-Rue Kuhn-Faubourg de Saverne-Quai Kléber-Pont de Paris-Rue du Noyer-Rue de la Haute Montée-Rue de la Mésange-Place Broglie-Rue Royale (Avenue de la Marseillaise de nos jours)-Quai Dietrich-Place Brandt-allée de la Robertsau-Boulevard de l’Orangerie, soit 3,900 km.
- 2eme Ligne : Place de Pierre-Faubourg de Pierre-Rue de la Nuée Bleue-Rue de la Mésange-Place Kléber-Grandes Arcades-Place Gutenberg-Rue du Vieux Marché aux Poissons-Pont et Place du Corbeau-Rue et Place d’Austerlitz, soit 1,650km, excepté le passage commun aux deux lignes Rue de la Mésange.
En même temps une liaison de 200 m avec le dépôt situé Rue des Bonnes Gens sera construit par la Rue du Chevreuil.
Caractéristiques des premières motrices :
- 20 places assises
- 12 places debout
- 12 à 15 km/h
- moteur de 25 ch.
- tension d’alimentation : 500 V.
La réception des premières motrices s’effectue le 12 mai 1895.
Le début des essais se fait le 6 juillet sur la portion électrifiée : Gare-Pont Royal.
L’inauguration officielle a lieu le 13 juillet 1892 à 10 h. A noter que la montée ou la descente se fera à droite et à l’arrêt aux stations.
Le 11 mai 1897, A.E.G., actionnaire principal de la compagnie, signe un second accord pour :
- la mise à voie métrique de l’ensemble du réseau
- l’électrification de la totalité du réseau
- la construction de nouvelles lignes :
N°1 : Rue Royal-Quai des Pêcheurs
N°2 : Place du Corbeau-Gare Centrale, par le Finkwiller et le Faubourg National
N°3 : Gare Centrale-Place de Pierre
N°4 : Place Broglie-Porte de Schiltigheim
N°5 : Place de Pierre-Avenue des Vosges-Place Brandt
N°6 : Place Brandt-Porte de Kehl
- la fourniture de 86 motrices
- la fourniture de 20 remorques.
Tableau récapitulatif à la veille de l’électrification :
|
|
Hippomobile |
Vapeur |
Electricité |
Total |
|
Km de voie |
0,900 |
16,530 |
4,000 |
21,430 |
|
Nb de lignes |
1 |
5 |
3 |
9 |
|
Nb de chevaux |
4 |
/ |
/ |
4 |
|
Locomotives |
/ |
27 |
14 |
41 |
|
Nb de voitures |
1 |
103 |
14 |
117 |
|
Personnes transportées |
70 600 |
2 590 000 |
2 114 000 |
4 774 600 |
LES GRANDS CHANTIERS :
Tout évolue très vite, en une dizaine d’années le réseau urbain passe à près de 50 km, plus du double qu’en 1897. Cette même année, la compagnie s’attelle à la mise en voie métrique de l’ensemble du réseau, tout en construisant de nouvelles lignes ainsi qu’en les mettant à double voie afin d’assurer un meilleur écoulement du trafic. Toute la ville est en chantier.
Dès le 14 mars, on inaugure la section de ligne Pont du Rhin-Kehl, et le 22 janvier 1899, la section Gare Centrale-Place de Pierre est ouverte au public. Cette dernière marque le début de la ligne dite de « Ceinture », prolongée en 1900 par la section Université-Place du Corbeau, en 1901 par celle menant de la Place du Corbeau à la Gare Centrale, par le Finkwiller et les Ponts Couverts.
En 1900, les Strasbourgeois étrennent les lignes Place Broglie-Tivoli, Faubourg de Saverne-
Cronenbourg, et Quai de l’Abattoir-Roethig. Avec l’ouverture à la circulation du prolongement Roethig-Lingolsheim le 16 novembre 1902, la ligne Tivoli-Lingolsheim s’étire sur pas moins de 7 km et les convois circulent toutes les demi-heures.
A partir du 1er juillet 1901, on peut atteindre Breuschwickersheim par Obershaeffolsheim et Achenheim, à partir de Wolfisheim.
Par la suite, nombre de nouvelles sections sont ouvertes :
- Place de Pierre-Place Arnold, le 21 décembre 1904
- Place Arnold-Place de Kehl, en 1907
- Avenue des Vosges-Rue Royal par la Rue Lamey, en 1907
- Place Arnold-Quartier des Quinze.
Autres nouveautés, les lignes se voient attribuer un numéro dès 1908. Elles se définissent alors comme suit :
N°1 : Gare-Place Kléber-Pont du Rhin-Kehl
N°2 : Gare-Place Kléber-Place Arnold-Porte de Kehl
N°3 : Gare-Place Kléber-Orangerie-Robertsau
N°4 : Gare-Place Kléber-Neudorf Est-Neuhof
N°5 : Bischheim-Place Kléber-Neudorf
Est
N°6 : Cronenbourg-Place Kléber-Austerlitz-Neudorf Ouest-Meinau-Graffenstaden (auparavant desservie uniquement au départ d’Austerlitz par la n°12)
N°7 : Hoenheim-Bischheim-Schiltigheim-Rue de la Haute Montée-Koenigshoffen-Wolfisheim-Breuschwickersheim (au départ la ligne 7 s’arrêtait à Koenigshoffen, les convois se rendant à Breuschwickersheim portaient le numéro 11)
N°8 : Comme la 9, mais seulement jusqu’à la Porte de Schirmeck
N°9 : Place de Bordeaux-rue de la Haute Montée-Porte de Schirmeck-Lingolsheim
N°10 : Ceinture, au départ de la Gare Centrale
N°11 : Comme la n°1 mais seulement jusqu’au Petit Rhin
N°15 : Place Arnold-Quartier des Quinze.
|
La carte du réseau au début du XXème siècle. |
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir) |
Etant donné que la plupart des lignes passaient par la Place Kléber, une minuscule gare miniature fut édifiée en 1900, comportant guichets, salle d’attente, salle pour le personnel de la compagnie, ainsi que de toilettes. Cet édicule disparu en 1941 à la suite du réaménagement complet de la place.
Quelques chiffres :
- 20 millions de passagers transportés en 1906
- 46 millions de passagers transportés en 1918
Composition du parc :
- 144 motrices
- 173 remorques
- 13 123 places de capacité.
Le tramway devient pratique, puisqu’en soirée la dernière rame attend la fin des représentations théâtrales ou part de la Place Kléber à minuit.
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
LA PREMIERE GUERRE
MONDIALE :
Comme dans toutes les entreprises, l’appel des hommes sous les drapeaux entraîne la compagnie à faire appel à de la main d’œuvre féminine pour le service roulant ; c’est ainsi qu’en 1917 apparaissent les premières conductrices.
Malgré les difficultés croissantes liées à la guerre, des poses de voies nouvelles sont quand même effectuées, telles que dans la Rue du 22 Novembre (anciennement appelée Nouvelle-Rue) qui est ouverte le jeudi 1er juillet 1915, où circuleront les tramways des lignes 1, 2, 4, 6, 9. Les sections Place de la Bourse-Place du Foin et Robertsau Eglise-Robertsau Papeterie sont inaugurées en 1918.
Mais le tramway ne sert pas uniquement au transport de voyageurs, mais également au transport de blessés vers les différents hôpitaux que sont Béthesda (après la pose exprès d’une voie), l’hôpital militaire de la Rue de Zurich (actuellement la cité administrative), le centre de traumatologie du Boulevard Clémenceau. Il sert également au transport de munitions ; une voie sera même aménagée entre la Place de Haguenau et la Place de Schiltigheim (actuellement Place de Bordeaux).
Mesures d’économie et manque de personnel obligent, des suppressions de portions de lignes sont effectuées, d’autres sont regroupées, les fréquences au centre ville sont réduites de 5 à 7 minutes et demie, l’on va même jusqu'à la suppression d’arrêts pour ménager le matériel en lui évitant trop de freinages et de démarrages.
LES DIFFICULTÉS :
Par suite d’une pénurie de pièces de rechanges, une fatigue du matériel roulant est constatée, c’est ainsi que les motrices ne fonctionnent plus que sur un seul moteur, ce qui implique qu’elles ne peuvent plus tracter de remorques.
Malgré ces difficultés, la C.T.S. procède quand même à quelques rajouts de lignes,
- Place de la Bourse-Arsenal (Esplanade) en 1919
- Achèvement de la ligne de la Robertsau jusqu'à la Clinique Saint-Anne le 10 juillet 1919 ; mais la compagnie renonce à la construction du tronçon Sainte-Anne-Fuchs am Buckel, quoique le matériel destiné à cette ligne soit prêt ; le service entre l’hôpital et la forêt se faisant alors par autobus
- Place de Bordeaux-Wacken, achevée le 27 mai 1923
- Place de Kehl-Pont d’Anvers, mise en service en 1927
- Schiltigheim-Route de Brumath achevée le 15 novembre 1927.
En cette année 1930, le réseau marque son apogée avec 54,6 millions de personnes transportées. Il circule de 4h30 à 1h30 de la nuit.
C’est alors que la compagnie décide d’abandonner son exigu dépôt de la Rue des Bonnes-Gens pour celui du Chemin Haut à Cronenbourg où les bâtiments et les installations sont neufs, fait sur mesure, et permettent d’envisager une gestion bien plus rentable.
Ces années d’avant guerre, qui voient encore quelques modifications de tracé, portant déjà en elles les prémices de la fin. Les lignes sortant de la ville en direction du Neuhof, de Kehl et de Graffenstaden passent par l’actuelle Rue de la Première Armée pour rejoindre les lignes entrant en ville au milieu de la Place de la Bourse.
Etant donne que seul le Pont de la Bourse est remis en état on assiste à la disparition de la ligne n°9en direction de l’Arsenal (Esplanade).
C’est alors que les autobus prennent peu à peu le pas sur le tramway. Voici une liste de ces nouvelles lignes de bus :
- A : Grand’Rue-Rue des Hallebardes-Boulevard de la Victoire (1930), mais rapidement abandonnée
- B : Place du Vieux Marché aux Vins-Cronenbourg via la Route de Mittelhausbergen (1930)
- C : Place Broglie-Rue d’Adelshoffen (Schiltigheim) via l’Avenue de la Paix et le Tivoli ( 1932)
- D : Roethig-Ostwald (1931), remplacé par le trolleybus en 1939.
A partir de 1937 la section Koenigshoffen-Breuschwickersheim se voit transférée sur route par un service de bus pour cause d’usure extrême de la voie entre ces deux communes.
Une réorganisation des lignes s'opère en 1937 par la jonction de lignes radiales en vu d’obtenir un emploi plus rationnel du personnel et du matériel roulant. C’est ainsi qu’apparaissent des lignes à double indicatif :
- 2/12 : Pont d’Anvers-Wolfisheim (jonction des lignes 7 et 2)
- 4/14 : Hoenheim-Neuhof (jonction des lignes 4 et 5)
- 6/16 : Gare Centrale-Graffenstaden, puis Place Kléber-Graffenstaden.
(Cliquez sur les images pour les agrandir)
LA SECONDE GUERRE
MONDIALE :
A partir du 4 septembre 1939 à 14h, il n’y a plus de circulation dans la ville fantôme. Les voitures les plus modernes s’en vont en longs convois sommeiller quelque part à l’extrémité des lignes suburbaines où on les juge plus à l’abri qu’en ville ; tandis que l’administration se replie à Ottrott pour continuer à gérer les lignes suburbaines ravitaillant l’armée de la ligne Maginot.
Pendant ces années difficiles le tramway lié à la production d’électricité et non aux hydrocarbures sévèrement rationnés bat son record de frequentation : 71,5 millions de voyageurs utilisent le réseau en 1943, étant privés – mis à part la précieuse bicyclette – de tout autre moyen de transport.
L’approvisionnement électrique est à nouveau assure par la remise en état progressive de la centrale du Port du Rhin (elle sera achevée en 1941). Les tramways commencent à nouveau à circuler à partir du 22 août 1940. La ligne 1/11 atteint par des ouvrages de fortune le Pont du Rhin.
Comme lors de la précédente guerre, les voitures et le réseau surexploités et mal entretenus fatiguent de plus en plus. Le bombardement de 6 septembre 1943 coupe la ligne Neudorf-Neuhof en perçant les voies et surtout, les lignes aériennes sont arrachées. Celui du 11 août 1944 arrête provisoirement toutes les circulations.
Le 25 septembre 1944, les voies sont percées en 95 endroits, 15000 mètres de lignes aériennes sont hors d’usage et une centaine de voitures sont endommagées, dont quelques-unes irrémédiablement.
La sous-station de la Rue de Molsheim a par ailleurs été fortement endommagée, et une partie du matériel passera l’hiver 44-45, particulièrement rigoureux, sous la neige à l’Orangerie.
Au total, le trafic reste interrompu pendant presque un an, notamment du 23 novembre 1944 au 18 avril 1945, suite à la destruction de la centrale du Port du Rhin par des tirs d’artillerie.
Le bilan total des dommages de guerre révèle la destruction de 15 km de voies ferrées, de 26 ponts dont plusieurs à 2 reprises, 78,5 km de lignes aériennes, de 2 sous-stations, de 24 dépôts, stations et autres bâtiments, ainsi que de 317 véhicules, principalement suite à leur usage inapproprié comme barrage anti-chars par l’armée française, lors de la contre-offensive allemande de janvier 1945.
LA DECADENCE :
Si dès le 9 juin 1945 tout le réseau urbain fonctionne tant bien que mal, le fléchissement du trafic se fait de plus en plus sensible dès l’année suivante.
|
La carte du réseau à la fin des années 1940. |
(Cliquer sur l'image pour l'agrandir) |
Malheureusement le projet d’achat de motrices neuves, remontant à 1940 ajourné par la guerre, reste irréalisable ; la France ne fabriquant pas de tramways contrairement à la Suisse et la Belgique, mais l’exportation des devises est proscrite. Lorsque vers 1960 l’on construira dans les « Ateliers de Strasbourg » des voitures neuves destinées à Saint-Etienne, il sera bien trop tard. La C.T.S. en vient tout naturellement, dans le but de rééquilibrer et de perfectionner au mieux son exploitation, au trolleybus. Celui-ci se montre, pour peu de temps, encore supérieurs aux bus, et n’y a t-il pas eu de promesses d’électricité à bon marché ?
Toujours est-il que l’introduction des premiers trolleybus à 65 places sur la ligne 5/15 Place Broglie-Quartier des Quinze en 1947, puis sur la ligne 10 en 1947 (ceinture section sud) et en 1950 sur l’ensemble du parcours, semble satisfaire la clientèle. Sur les trajets particulièrement sinueux du Finkwiller, le trolleybus peut circuler à une vitesse bien supérieure à celle du tramway, ne risquant pas, lui, de dérailler. Bientôt les fabricants de bus peuvent proposer un matériel comparable, à des prix compétitifs, et ne nécessitant ni rails, ni à fortiori de lignes électriques aériennes.
L’introduction massive commence le 15 décembre 1953 sur la ligne 9/19, prolongée jusqu’à la Cité Périgueux de Bischheim. En mars de l’année suivante, la ligne 3/13 de la Gare Centrale à la Cite des Chasseurs à la Robertsau fonctionne également au gas-oil.
Le 1er juillet 1955, le tramway effectue son dernier voyage sur la ligne 8/18 : Place Kléber-Lingolsheim, et sur la navette d’Ostwald le trolleybus disparaît également.
Le 7 juillet 1956 c’est au tour de la ligne 2/12 : Pont-d’Anvers-Obershaeffolsheim, et le 4 avril 1957 à lieu le dernier voyage du tramway de la ligne 1/11 jusqu’à la Rue du Havre seulement, suite à la reconstruction non achevée encore du Pont Vauban. Quelques années de répit sont encore accordées aux deux dernières lignes, les plus importantes, 6/16 et 4/14, le temps d’achever la construction du nouveau dépôt d’autobus du Neudorf, remplaçant l’ancienne gare locale de la Place de l’Etoile.
Le 1er janvier 1960, la ligne 6/16 : Wacken-Graffenstaden est assurée par des autobus, avec un raccordement vers la Cité Meinau toute neuve.
(Cliquer sur l' image pour l'agrandir)
Le 1er mai, plus de 100 000 personnes rendent un dernier hommage au tramway, massées sur un parcours de près de 12 km. Pour l’occasion, sous fleurs, couronnes et inscriptions diverses, l’on voit circuler une multitude de matériel, dont la locomotive à vapeur empruntée à la sucrerie d’Erstein, et un véhicule technique se voit mué pour quelques heures en voiture hippomobile.
(Cliquer sur les images pour les agrandir)
La mascarade achevée, l’ensemble des véhicules, même les plus récents, est d’abord démonté, puis pour aller plus vite, purement et simplement brûlé au dépôt de Cronenbourg. L’arrachement immédiat des rails, même ceux remis à neuf moins de 10 ans auparavant, Rue de la Mésange, peut débuter immédiatement. La demolition de la gare locale de la Place de l’Etoile à la fin de l’été tourne définitivement la page du tramway strasbourgeois, reléguant 82 années de transport au rang d’histoire ancienne.
Et ceci 34 ans durant avant sa renaissance en 1994……

Copyright (c) 2004 Strasbourg-Tramway. Tous droits réservés.