|
 |
Le Loup et l'Agneau |
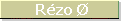 |
L'analyse du récit : situation-problème |

|
|
La raison du plus fort est toujours la meilleure, |
|
|
|
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltéroit
Dans le courant d'une onde pure. |
|
|
Un Loup survient à jeun, qui cherchoit aventure, |
|
|
|
Et que la faim en ces lieux attiroit. |
|
|
« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? |
|
|
|
Dit cet animal plein de rage : |
|
|
|
Tu seras châtié de ta témérité. |
|
|
- Sire, répond l'Agneau, que Votre Majesté |
|
|
|
Ne se mette pas en colère;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérant |
|
|
|
|
Dans le courant, |
|
|
|
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, |
|
|
Et que par conséquent, en aucune façon, |
|
|
|
Je ne puis troubler sa boisson. |
|
|
- Tu la troubles ! reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurois-je fait, si je n'étois pas né ? |
|
|
|
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. |
|
|
|
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. |
|
|
Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens : |
|
|
|
|
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers et vos chiens. |
|
|
|
On me l'a dit : il faut que je me venge. »
Là-dessus, au fond des forêts
Le Loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès. |
|
|
La FONTAINE
Fables, Livre I
( illustration G. DORÉ )
|
L'utilisation du schéma quinaire pour rendre compte de la structure de
cette fable conduit à qualifier la joute oratoire du loup et de l'agneau de
« péripétie ». Entre Un Loup survient à jeun - élément
déclencheur - et Le Loup l'emporte - élément de résolution - le
schéma quinaire ne peut qu'ignorer ce qui se joue dans la parole des
protagonistes ; les élèves voient dans le dialogue une suspension du
récit et n'ont, du point de vue narratif, rien à en dire. Au mieux, on
leur proposera d'étudier ce long passage en tant que séquence
argumentative.
Narrativement, les dialogues sont des signes d'actions en train de se
jouer. Justifications pseudo légales de l'acte prémédité ( le loup sait
depuis le début qu'il va dévorer l'agneau, il lui faut seulement justifier
juridiquement, donc moralement !, cet acte ) et réfutation des
accusations par l'agneau donnent à voir ce qui se joue : une
parodie de justice subordonnée à la loi du « plus fort »...
Le schéma de Stein et Glenn permet de rendre compte de tous les
éléments de la fable.
|
CADRE : quelque part au bord
d'un ruisseau un agneau se désaltère.
|
|
ÉPISODE 1
|
|
Déclencheur : un loup survient ( il est à jeun, il
cherche aventure, la faim l'attire )
Réponse interne : « quelle aubaine ! voici justement de
quoi satisfaire cette faim qui me tenaille. »
Plan : « Pour pouvoir le dévorer sans remords, il faut
que je puisse faire croire à mon bon droit : accusons-le. »
N.B. : L’ellipse des phases réponse interne et plan
est fréquente ; en effet, à les rendre explicites, l’auteur
alourdirait inutilement son récit. Le « plaisir du texte »
réside justement dans l’inférence nécessaire de ces phases à
partir des événements qui en constituent la mise en application.
|
|
|
Mise en application
Tentative 1: accusation « tu troubles mon breuvage. »
Conséquence 1: réfutation « Plus de vingt pas
au-dessous d'Elle...»
Réaction: le loup enrage et
|
|
ÉPISODE 2
|
|
Tentative 2 : accusation « tu médis de moi... »
Conséquence 2 : réfutation « je n'étois pas né. »
|
|
ÉPISODE 3
|
|
Tentative 3: accusation « c'est donc ton frère. »
Conséquence 3 : réfutation « je n'en ai point. »
|
|
ÉPISODE 4
|
|
Tentative 4 : accusation « c'est donc quelqu'un des
tiens... vous, vos bergers et vos chiens. »
Conséquence 4 : le déplacement de l'accusation, de la
personne de l'agneau vers d'autres, le laisse sans arguments, sans
voix
|
|
|
Réaction de l'agneau : ??? - mais on l'imagine
désemparé.
Réaction du loup : il l'emporte et le mange sans autre
forme de procès.
|
|
Proposition didactique
|
|
Situation-problème
|
1 |
Appui sur les acquis antérieurs |
Rendre compte du récit en utilisant le schéma quinaire |
| 2 |
Mise en problème |
Et si le dialogue du Loup et de l'Agneau racontait également
quelque chose ? |
| Documents fournis |
1 |
texte de la fable
|
| 2 |
Modèle quinaire de Larivaille
|
sous 2 formes : texte et schéma
|
| 3 |
Modèle de Stein et Glenn
|
sous 2 formes : texte et schéma
|
Le modèle de Stein et Glenn est apporté pour introduire un conflit
cognitif entre représentations des élèves ( « le » schéma narratif est
le seul outil d'analyse de la structure des récits ) et informations
nouvelles qui les remettent en cause. L'apprentissage vise des compétences
multiples : déclaratives, conditionnelles et procédurales, stratégiques
enfin.
| Modalités de travail |
1 |
Travaux de groupes
|
| |
2 |
Mise en commun et discussion
|
| |
3 |
Synthèse par articulation ( cf. apprentissage
contextualisé )
|
| Objectif de la séance |
Évaluer la pertinence et l'efficacité
d'un modèle d'analyse de la structure des récits
|
| Tâche |
Rédiger la partie « compte-rendu de
l'intrigue » d'un article de critique d'un récit complet en ayant
recours à un des modèles explicatifs disponibles
|
Il faut avoir conscience qu'en présentant cette séance
d'apprentissage à des élèves ( de Bac Pro ), on se met en difficulté
par rapport à l'institution. En effet, il s'agit rien moins que de la
remise en cause d'un élément important du programme ( « le » schéma
narratif ), du refus de réduire l'analyse à l'utilisation d'un « outil
» qu'on sait peu satisfaisant. De plus, il ne faut pas perdre de vue que
les élèves seront cognitivement déstabilisés par cet apport, non
reconnu par l'institution et ses représentants. Et, en définitive, c'est
bien sur « le » schéma narratif quinaire tel qu'il est présenté dans
les manuels qu'on les évaluera.

|