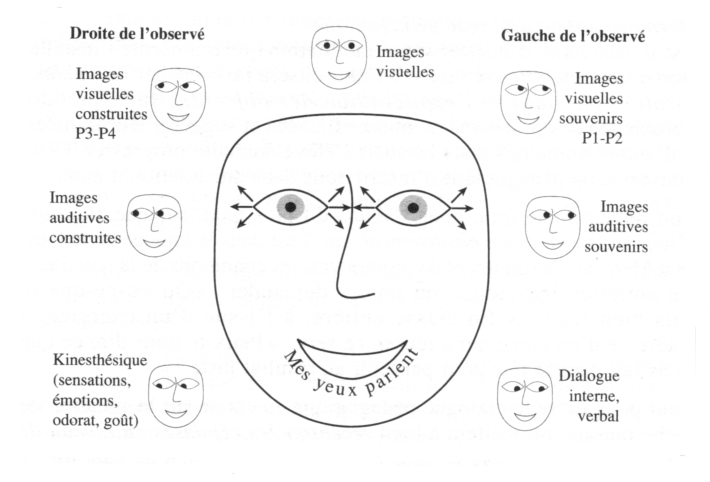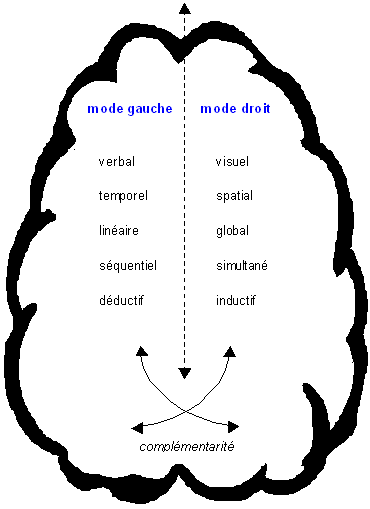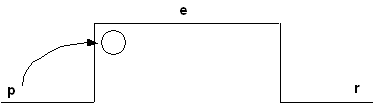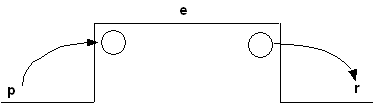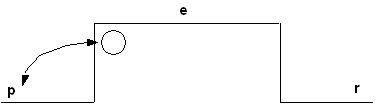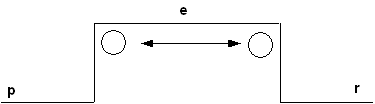|
La pédagogie de la gestion mentale |
|
| Aurore LISION
Licence de Sciences
de l'Éducation |
reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteure |
|
La « gestion mentale » désigne le courant de recherche et de pratiques issu des travaux d'Antoine de la GARANDERIE. Fort de son expérience d'enseignant, et en dépit d'un passé d'élève en difficulté scolaire - ou grâce à lui, Antoine de la GARANDERIE a identifié, par la seule technique de l'introspection, un certain nombre de « profils d'apprentissage ». Il s'est certes basé sur sa propre expérience, mais a également interrogé nombre de « bons élèves » afin de répertorier les « gestes mentaux » mis en œuvre dans une situation d'apprentissage réussie. Antoine de la GARANDERIE n'aime pas la notion de don, ni celles d'aptitude ou d'inaptitude. Il soutient que c'est la connaissance, par un individu, de ses « habitudes mentales » qui lui permet de passer d'une compétence acquise par hasard à des choix d'apprentissage plus efficaces, qui déterminent une autonomie plus vraie.
1. Quelques éléments théoriques a. Une idée novatrice : la notion d'évocation Le concept clé de la théorie de la gestion mentale est l' « évocation ». L'évocation est une activité mentale d' appropriation. C'est une étape importante du traitement de l'information, qui précède la construction de représentations et, parfois, se confond presque avec elle. Il est reconnu que la qualité de la présentation d'une information influence l'efficacité de son acquisition par l'élève. Mais le facteur déterminant, en gestion mentale, reste l'activité d'évocation, qui peut se réaliser à travers un discours, des images mentales ou d'autres modes perceptifs (kinesthésie, etc.). Le message délivré par l'enseignant passe par plusieurs étapes dans le système nerveux de l'apprenant et y subit différents codages : codage perceptif > cerveau primaire > cerveau limbique > néocortex > évocation > codage mental > représentation de l’information
Nous pratiquons tous spontanément l'évocation dans notre vie quotidienne. Le but de la pédagogie de la gestion mentale est de rendre les élèves conscients des gestes mentaux qu'ils effectuent à partir de leurs évoqués. C'est pour cette raison qu' elle préfète l'introspection à toute autre méthode. Les difficultés de l'apprenant découlent essentiellement de la méconnaissance des moyens dont il fait usage lorsqu'il réussit. Le dialogue pédagogique a pour objectif de faire prendre conscience aux apprenants de leurs ressources mentales, de proposer des remédiations. Ce dialogue est un outil d'accompagnement à l'introspection, en classe ou en entretien individuel. Il s'engage toujours à partir d'une situation de réussite, qui peut fort bien être extra-scolaire. Il est nécessaire de laisser à l'apprenant le temps d'évoquer, en ne lui posant pas trop de questions. L'enseignant demande à l'élève comment il a procédé afin de centrer les réponses au niveau de l'évocation. Puis il reformule uniquement ce qui concerne les démarches d'apprentissage, pour l'engager à poursuivre ou à rectifier la reformulation. Ce dialogue suit les règles de la non directivité (cf. C. ROGERS) car il est indispensable de ne pas induire les réponses de l'élève. Il sert à déterminer son profil d'apprentissage. L'enseignant s'appuie également sur les gestes physiques et les mouvements oculaires qui sont des indicateurs observables du fonctionnement mental de l'apprenant 1.
fig. 1 Relation entre les mouvements oculaires et les types d'évocation
c. Les profils d'apprentissage Le profil d'apprentissage d'un élève correspond à la nature des évoqués qu'il a l'habitude de produire. Il se compose de trois éléments : la famille, la constante et le paramètre.
fig. 2 Les modes évocatifs et les constantes qui leur correspondent
Déterminer le profil d'apprentissage d'un élève sert à le guider pour diversifier ses habitudes évocatives au niveau de chacun des trois éléments. Chaque élève a la possibilité de développer consciemment toutes sortes d'évoqués. Le maître l'aide en dirigeant ses évocations. Il doit, pour cela, donner une description très précise des gestes mentaux qu'il demande de réaliser.
d. Les évocations dirigées et l'autonomie L'apprenant, lorsqu'il est conscient des divers gestes mentaux qu'il sait effectuer, les sélectionne en fonction de la tâche à réaliser. En conséquence, la performance de l'élève passe par une explicitation de son projet de réutilisation de l'information. Ce projet oriente et donne du sens à l'action. Il permet de diriger les évocations. Mais pour être efficace, il ne suffit pas d'avoir à sa disposition un large choix de méthodes et un but précis à atteindre. Pour développer des stratégies opérantes, l'apprenant a besoin de juger de l'efficacité de telle méthode dans telle situation. Ainsi l'enseignant doit non seulement varier les modes de présentation d'une information en phase d'acquisition, mais doit procéder de même pour les modes d'évaluation lors de la restitution. En effet, l'activité de restitution passe par un codage de transfert. La similitude entre le code d'acquisition (le mode d'évocation) et le code de transfert facilite l'activité de l'élève. L'enseignant doit donc l'entraîner à passer d'un code à un autre.
fig. 3 Diriger les évocations
L'élève capable de diriger consciemment ses évocations saura gérer de manière autonome les diverses situation de l'école et de la vie.
e. Résumé : les trois étapes dans l'apprentissage. Le tableau ci-dessous résume les trois étapes d'une séquence d'apprentissage selon la pédagogie de la gestion mentale :
A chaque étape, l'enseignant impose aux élèves un travail d'évocation parce que celui-ci est indispensable à la réalisation d'un geste mental. Par exemple, avant la perception d'une information, la consigne sera : « Mettez-vous en projet de construire des évoqués et rappelez-vous la leçon précédente ». Elle vise à rendre les élèves attentifs et à les aider dans leur travail de compréhension. Pour chaque étape, l'enseignant fournit une description précise des gestes mentaux attendus, tout en insistant sur la liberté de chacun quant à leur utilisation et la non-exhaustivité des méthodes décrites. Un tableau permet de récapituler les cinq principaux gestes mentaux.
p = perception e = évocation r = réflexion fig. 4 Relation entre le projet et la mise en oeuvre des principaux gestes mentaux
2. Remarques La théorie de la gestion mentale n'a aucune valeur scientifique en soi, car la méthode principale de recueil de données est l'introspection. Et c'est exactement ce qu'elle revendique : être une théorie accessible au plus grand nombre. Ses concepts sont simples et elle ne nécessite pas de matériel spécifique. Je trouve particulièrement intéressantes la description des gestes mentaux, surtout parce qu'elle est compréhensible par les élèves. Notamment la description de l'attention, qui est trop souvent associée, en classe, au silence et à l'obéissance passive.
L'enseignant qui recours à la gestion mentale ne peut se dispenser de s'intéresser aux neurosciences. Au regard de l'enseignement, elles sont complémentaires car la gestion mentale étudie le langage intérieur et les neurosciences offrent, par leurs méthodes, une connaissance précise du fonctionnement cérébral. Par exemple, dans la pédagogie de la gestion mentale, la technique d'observation des mouvements oculaires et la définition des constantes du profil d'apprentissage se basent sur la notion de dominance hémisphérique. Or les neurosciences nous apprennent que cette dominance d'un hémisphère n'est pas une loi applicable à tous les individus. Notamment, pour ce qui est du langage, la dominance de l'hémisphère gauche n'est effective que pour environ 95% des droitiers et 85% des gauchers. De plus, chez certains gauchers (5% environ), on n'observe pas de dominance d'un hémisphère cérébral dans la fonction langagière. Une grande vigilance est donc nécessaire dans la déduction du fonctionnement mental d'un élève, puisque c'est à partir de son profil d'apprentissage que l'enseignant propose des remédiations. La diffusion des concepts élaborés par A. de La GARANDERIE ne s'est pas opérée de façon rigoureuse. Les profils d'apprentissage ont parfois été réduits au seul élément « famille », ce qui a eu pour conséquence de parler d'élèves « visuels » ou « auditifs ». Or, ces concepts ne suffisent pas à décrire avec précision les capacités intellectuelles d'une personne. L'objectif de la pédagogie de la gestion mentale est de rendre efficaces les stratégies de l'élève, elle répond, par là, à la question de la motivation du point de vue des savoirs.
NOTES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||